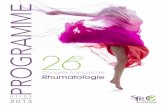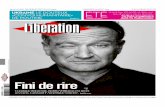« D’une catastrophe naturelle à une réussite humanitaire : le traitement public des...
Transcript of « D’une catastrophe naturelle à une réussite humanitaire : le traitement public des...
ALAIN BOVET, C"DRIC TERZI
DD##UUNNEE CCAATTAASSTTRROOPPHHEE NNAATTUURREELLLLEE $$ UUNNEE RR""UUSSSSIITTEE HHUUMMAANNIITTAAIIRREE
LLee ttrraaiitteemmeenntt ppuubblliicc ddeess %%vv%%nneemmeennttss ddee GGoonnddoo eenn SSuuiissssee
Le 14 octobre 2000, des intempéries ont provoqué une crue violente du Rhône etde ses affluents. Il en a résulté des inondations, des coulées de boue et des ébou-lements qui ont touché plusieurs dizaines de communes. Seize personnes ont ététuées et l’évacuation de plusieurs milliers d’autres a été nécessaire. La plupartdes victimes ont été atteintes par un éboulement, accompagné par la rupture d’unmur de protection en amont du village de Gondo, dans le Haut-Valais, à proxi-mité de la frontière italienne. La catastrophe a provoqué la destruction d’un tiersdes maisons du village, dont une usine électrique, la maison de commune etl’hôtel de la Poste.
Cette catastrophe naturelle a bien entendu fait l’objet d’une forte médiatisa-tion, laquelle s’est muée au fil des jours en une grande opération de manifesta-tion de solidarité nationale, orientée vers la reconstruction des villages dévastéset des habitations détruites dans les régions de montagne. Portée à bout de braspar les médias dans leur ensemble et par la télévision en particulier, cette opé-ration a mobilisé les victimes de la catastrophe, les institutions publiques et,enfin, l’ensemble de la population suisse. Celle-ci a été invitée à se sentir concer-née par ce qui s’était passé et à se constituer en public politique sous la formespécifique d’une collection de donateurs individuels, appelés à partager et soute-nir la volonté de reconstruire des habitants1.
In : L#exp%rience des probl&mes publics, Paris, "ditions de l#EHESS, 2012
1. Nous reprenons la notion de « public » de John Dewey. Le public s’ancre dans « le fait objectif
Le traitement public de cette catastrophe constitue une opportunité pourdocumenter, sur un corpus relativement restreint (les éditions du journal régionalde la Télévision Suisse Romande entre le 16 et 20 octobre), comment le collectifpolitique suisse se constitue en faisant front commun dans l’adversité. Nousmontrerons comment la catastrophe est devenue l’occasion de célébrer l’unité etla solidarité nationales dans une modalité métonymique. Dans la terminologiedéveloppée par Widmer (2004), la métonymie désigne l’opération, généralementeffacée voire occultée, par laquelle une collectivité politique se constitue commeun ensemble homogène d’éléments interchangeables. Cette opération se faitnotamment au détriment du pluralisme politique, dans la mesure où elle impliqueque les membres de la collectivité se reconnaissent dans la perspective qui lesunit, laquelle apparaît alors comme la seule envisageable2.
La mise en intrigue qui a pris forme dès le lendemain de la catastrophe a progressivement été tendue vers l’horizon de la reconstruction. Elle a étéstructurée autour de trois figures décisives. La première est celle des personnesdirectement touchées par la catastrophe. Celles-ci ont été constituées commeprotagonistes de l’intrigue sous la catégorie d’habitants revêtant une fortecharge prescriptive. Il ne s’agit pas seulement de voir les personnes touchéescomme des habitants, mais comme une catégorie à préserver face aux forcesde la nature qui la menacent. Ainsi configurés par l’intrigue, ces habitants sontdotés de vertus morales, au premier rang desquelles la ténacité, qui leur permetde « tenir le coup » et de s’engager rapidement dans la restauration de leurshabitations. Cette figure est essentielle à l’intrigue dans la mesure où leprogramme d’« action conjointe3 » qui prend forme après les intempéries est
294 ALAIN BOVET ET C"DRIC TERZI
que les actes humains ont des conséquences sur d’autres hommes, que certaines de ces consé-quences sont perçues, et que leur perception mène à un effort ultérieur pour contrôler l’actionde sorte que certaines conséquences soient assurées et d’autres évitées » (Dewey, 2010, p. 91).La constitution de ces publics revêt une portée politique : « Quand des conséquences indi-rectes sont reconnues et qu’il y a un effort pour les réglementer, quelque chose ayant les traitsd’un État commence à exister. » (Ibid.)
2. Dans son analyse des différents modes de constitution des collectivités politiques, Widmer(2004 ; 2010) distinguait l’opération métonymique de celle qu’il qualifiait de métaphorique quiconsiste à fonder l’unité par la référence à un tiers, placé en extériorité, dont une figure peut êtrecelle de l’État de droit. Cette distinction peut être lue comme une invitation à élucider les opé-rations qui fondent ce que Durkheim distinguait sous les termes de solidarité « mécanique » et« organique ». Les enquêtes dirigées par Widmer ont montré qu’en Suisse la cohésion nationaleest régulièrement envisagée comme une exigence pour ses membres de se fondre en une unitéhomogène appelée à faire face à une extériorité menaçante. Cette manière d’envisager l’uniténationale n’est pas sans lien avec l’émergence et la progression des idées nationalistes, popu-listes et xénophobes dans les débats publics suisses au cours des quinze dernières années.
3. Notre analyse reprend et prolonge la « praxéologie de l’action conjointe » initiée par Widmer(2010, p. 78-81). Son ambition est de prendre acte du « fait massif que les catégorisations depersonnes trouvent leur origine dans la catégorisation d’une action conjointe » (idem, p. 78).
entièrement fondé sur la volonté première et unanime des habitants de recons-truire leurs villages détruits.
Pour cette raison, la deuxième figure importante, celle des institutionspubliques, apparaît systématiquement comme le prolongement direct de lavolonté de reconstruire des habitants. La continuité ainsi établie entre les habi-tants et ceux qui leur viennent en aide est une caractéristique de la conceptionhelvétique des institutions de milice. En Suisse, l’armée, la protection civile ouencore les pompiers sont essentiellement composés de membres non-profes-sionnels, qui ne se distinguent pas fondamentalement des personnes auprèsdesquelles ils interviennent. Lorsqu’une catastrophe survient, ce sont doncd’abord des citoyens ordinaires, habitant sur place ou en d’autres lieux, quiviennent en aide à leurs semblables. Ainsi l’aide prodiguée aux victimes est-elle conçue comme de l’entraide, et de ce fait constitutive d’une forme de soli-darité que chaque catastrophe permet de célébrer.
La troisième figure est celle de l’instance médiatique, en l’occurrencecelle du journal télévisé régional diffusé par la première chaîne de la télévisionpublique nationale. La Société suisse de radiodiffusion (SSR) a été l’un desprotagonistes du traitement de la catastrophe : elle a joué un rôle essentiel dansson apprêtement et dans la conduite de l’opération humanitaire chargée d’yremédier. Notre argument est que les médias sont configurés par l’intrigue dela même manière que le sont les habitants et les institutions publiques. Sur ceplan, ils ne bénéficient pas de la position de surplomb ou d’extériorité que leurattribuerait une analyse qui leur assignerait l’entière responsabilité de la « construction » des événements.
Le traitement de la catastrophe par le journal télévisé régional
Afin de rendre intelligibles les analyses qui suivent, il est nécessaire de présentertrès succinctement les principales étapes du traitement public de la catastrophe,qui ont préparé l’intervention décisive de la « Chaîne du Bonheur », ordonnatricede la vaste opération humanitaire chargée d’intégrer l’ensemble de la collec-tivité suisse en un grand élan de solidarité nationale.
Les premières images diffusées par le journal régional au lendemain de lacatastrophe ont été des prises de vue muettes de cours d’eau délités et de villagesdévastés. Ces images impressionnantes marquaient la stupeur et l’affliction queles journalistes éprouvaient et qu’ils proposaient à leur audience de ressentir.L’essentiel du compte rendu journalistique était alors consacré aux opérationsde sauvetage, conduites dans l’espoir de retrouver d’éventuels survivants dansles décombres des habitations emportées.
D#UNE CATASTROPHE NATURELLE $ UNE R"USSITE HUMANITAIRE 295
À cette première phase a rapidement succédé une deuxième, de reprise enmain de la situation. L’instance médiatique a retrouvé sa voix et fait témoignerdes habitants qui ont indiqué que l’heure n’était déjà plus à la souffrance et audeuil, mais à l’affirmation de la volonté de réintégrer et reconstruire lesvillages et les habitations. Des opérations de déblaiement des gravats et dedégagement des cadavres étaient déjà en cours, avec les risques que celacomportait pour d’éventuels survivants. Les journalistes ont alors commencé à solliciter avec insistance des estimations chiffrées de l’ampleur des dégâts.De nombreuses institutions publiques (armée, chemins de fers, cantons, Étatfédéral) sont intervenues dans cette seconde phase, mais en insistant sur le faitque leur action avait pour seule vocation d’épauler les habitants dans leurvolonté de reconstruire.
Cinq jours après la catastrophe s’est ouverte une troisième phase, consistantà rassembler la collectivité suisse autour de l’effort de reconstruction que leshabitants appelaient de leurs vœux. Ce moment de solidarité, anticipé par lesphases précédentes, a été organisé par la Chaîne du Bonheur, une fondationhumanitaire créée par la Société suisse de radiodiffusion, dont les interventionsprennent la forme d’un appel à don relayé par toutes les chaînes de radio et detélévision publiques suisses, et adressé à l’ensemble de la population.
Il convient de noter que, dans le déroulement de la catastrophe, ces phasesont revêtu un caractère objectif aux yeux des protagonistes de la situation.Leur succession a résulté du travail accompli aussi bien par les institutionspubliques, les victimes et les journalistes, que par les nombreux donateurs quiont contribué à l’effort de reconstruction. Mais, en retour, tous ces participantsont été saisis par l’ordonnancement temporel de ces phases. Par exemple, il nepouvait être question pour des journalistes de ne pas manifester la stupeur etl’affliction requises face aux conséquences dramatiques des intempéries. Lepassage d’une phase à une autre a également revêtu les caractéristiques d’unfait social au sens durkheimien du terme : il a été reconnu et formulé en tantque tel par les journalistes qui en étaient un vecteur essentiel, mais égalementpar les victimes, et par les représentants des institutions publiques chargéesd’organiser les opérations de secours et de déblaiement4.
Les comptes rendus journalistiques ont d’emblée été orientés vers ledénouement figuré par l’appel à don. Cette orientation était attestée par l’em-pressement manifeste des journalistes à faire avancer l’intrigue, parfois contrece qu’ils présentaient comme l’obstination des sauveteurs ou des habitants.
296 ALAIN BOVET ET C"DRIC TERZI
4. Le geste que nous opérons ici est devenu classique en ethnométhodologie. Si Garfinkel (2007)reconnaît que les « faits sociaux » revêtent les caractéristiques d’extériorité et de contrainte queleur attribuait Durkheim, il s’applique cependant à montrer qu’ils sont accomplis en tant que telspar les agents auxquels ils s’imposent.
Elle transparaissait également dans leur insistance à disposer, sitôt après lasurvenue de la catastrophe, puis tout au long de la semaine, d’une estimationchiffrée des dégâts.
Il faut dire que ce dénouement a été porté par une figure institutionnelle.Comme à chaque fois qu’une catastrophe survient, en Suisse et dans le monde,les chaînes de radio et de télévision publiques des trois régions linguistiquesont organisé durant vingt-quatre heures leurs programmes autour d’un dispo-sitif de collecte et de solidarité humanitaire porté par la Chaîne du Bonheur. Lesappels à dons ont été lancés sur le plateau des émissions par les journalistes etles animateurs qui passaient à l’antenne. Afin de faire le point sur la progres-sion des dons, ils entraient régulièrement en liaison en duplex avec un anima-teur-vedette, qui passait la journée dans la centrale d’appel téléphoniqueinstallée dans un studio de télévision.
Dans le cas présent, la Chaîne du Bonheur a récolté le montant record de74 millions de francs versés par sept cent mille donateurs. Le bilan total desdégâts a été estimé à 670 millions de francs, dont plus de 500 pour le seulcanton du Valais. Dans ce canton, 350 millions ont été pris en charge par lesassurances. Sur les 150 millions restant, 76 ont été pris en charge par le canton(qui a fait une demande spéciale de financement à la Confédération), 32 par lescommunes et plus d’une cinquantaine par la Chaîne du Bonheur (au bilan cesont finalement 58,5 millions qui ont été attribués au Valais5). La plus grossepart de ce montant a été consacrée aux villages de montagne les plus touchés, etnotamment à la reconstruction de leurs places centrales et de leurs mairies.
D#UNE CATASTROPHE NATURELLE $ UNE R"USSITE HUMANITAIRE 297
5. Ces estimations sont calculées à partir d’un article publié par le quotidien 24 heures, un an aprèsla catastrophe (http://archives.24heures.ch/VQ/LAUSANNE/-/article-2001-10-1237/gondo-une-annee-apres-le-dramedes-cicatrices-lentes-a-guerirle-14-octobre-2000-la-montagne).Pour le bilan financier de l’opération, voir le communiqué de presse du 7 novembre 2005(http://www.vs.ch/Press/DS_3/CP-2005-11-07-8451/fr/Comm.pdf) : « La Chaîne du Bonheuret son partenaire opérationnel en Valais, la Croix-Rouge suisse, sont maintenant en mesure deprésenter le décompte final de la collecte “Intempéries Valais, Tessin et régions avoisinantes” :sur les 74,2 millions de francs collectés suite à cette catastrophe, 64,7 millions ont été utiliséspour financer des aides à des privés, des corporations et des communes en difficultés. Un tiersde ce montant est allé aux deux communes les plus sévèrement touchées, Gondo et Baltschieder.58,5 millions de francs ont été affectés en Valais, 2,1 millions au Tessin et 1,9 million auxrégions voisines d’Aoste et d’Ossola. Le coût total est finalement légèrement inférieur auxpremières estimations pour plusieurs raisons : les travaux de déblaiement de Gondo ont été inté-gralement pris en charge par la Confédération, le coût de la construction a été moins élevé queles premières offres, et les dégâts au Tessin ont été moins importants qu’estimés initialement.Après décision du conseil de Fondation, le solde de 9,5 millions de francs devrait être attribué à la fin de l’année au fonds permanent “Intempéries Suisse”, ce qui correspondrait à la volontédu donateur. Ce fonds permettra de financer des projets non encore terminés au Valais et auTessin, de répondre à des demandes lors d’autres catastrophes en Suisse et d’intervenir dans descas particulièrement difficiles. »
La figuration des habitants touchés : la résilience par la reconstruction
L’analyse de l’opération de mise en intrigue par laquelle la catastrophe a étéconstituée en tant que situation concernant indirectement l’ensemble de lacollectivité nationale fait apparaître que la Chaîne du Bonheur ne se donne pasn’importe quel bénéficiaire. Il faut que l’aide soit destinée à des personnesaffectées au titre d’habitants de villages dévastés, de logements emportés,détruits ou endommagés par la catastrophe. La normativité de cette catégorieest étroitement liée à un prédicat qui lui est associé : une ferme volonté dereconstruire. Il est en effet frappant de constater que les témoignages despersonnes affectées concordent autour de la manifestation d’un désir dereconstruire sans délai. Les comptes rendus journalistiques dont nous dispo-sons ne fournissent aucun exemple d’abattement, ni de résignation, et encoremoins d’empressement à déménager vers une région plus clémente.
Cette observation n’a rien d’ironique, du moins pas dans le sens d’unecritique des médias qui leur reprocherait de « construire » la figure des habi-tants, en ne retenant que les propos qu’ils veulent leur faire dire. Elle inviteplus profondément à analyser comment les médias contribuent à faire advenirla figure morale qui à la fois projette et soutient le dénouement que représentele programme d’action conjointe d’aide à la reconstruction. Les médias fontdire non pas ce qu’ils souhaitent entendre, mais ce qui doit se faire entendredans une telle situation.
C’est en effet en tant qu’habitants que les victimes prennent part auprogramme de la reconstruction, notamment en jouant le rôle qui est attendud’eux dans les reportages télévisés. S’ils s’y ajustent si bien, c’est que « L’action prime sur les personnages [...] D’où le précepte : d’abord concevoirl’intrigue, ensuite donner des noms. » (Ricœur, 1983, p. 69.) En devenant despersonnages de l’intrigue, les journalistes et les habitants se soumettent à saconfiguration, en même temps qu’ils la mettent en œuvre. Ce que nous visonsest donc moins un agenda caché des médias que la trame normative associéeau processus de constitution d’une collectivité solidaire.
Des habitants à ravitailler
Comment s’établit la figure morale d’habitants dont la volonté de reconstruiresert de fondement à l’action de tous les protagonistes de la situation ? Unepremière observation porte sur les catégories pertinentes et opérantes. Uneséquence du journal télévisé du mercredi 18 octobre, soit quatre jours après lesintempéries, paraît particulièrement significative à ce propos. Il s’agit d’uneséquence typique de reprise de contrôle à la suite du choc provoqué par la
298 ALAIN BOVET ET C"DRIC TERZI
catastrophe. Un reportage montre le « ballet des hélicoptères » qui s’est mis enplace pour atteindre les villages du Haut-Valais devenus inaccessibles par voieroutière. Une séquence du reportage mentionne le cas du village de Grächen.La voix off du journaliste commence par indiquer que « quatre hélicoptèresapprovisionnent ce village de 1 400 habitants et ramènent les touristes enplaine ». Ce programme d’action est ensuite confirmé par le témoignage d’unhomme préposé à l’aide au sol qui affirme : « Il y a très peu de vols à vide.Tout est coordonné de façon à ce qu’il y ait toujours un vol soit avec desmarchandises soit avec des personnes. »
Aussi bien le commentaire en voix off que le témoignage qui le suitmettent en œuvre un dispositif de catégorisation (Sacks, 1972) des personnesprésentes à Grächen au moment de la catastrophe. Ce dispositif à deux placescomprend les catégories « habitant » et « touriste ». Ces deux catégories struc-turent le programme héliporté : il faut ravitailler les habitants et évacuer lestouristes. S’il y a « très peu de vols à vide », c’est que les vols qui montentapportent des marchandises (et accessoirement une équipe de télévision) etque ceux qui descendent ramènent des touristes.
La catastrophe semble donc avoir pour effet de pousser les touristes à quit-ter les lieux sinistrés. Les habitants en revanche sont voués à y demeurer. Il n’est ainsi fait aucune mention d’habitants qui voudraient quitter ces lieuxinhospitaliers, ou qui le devraient, notamment pour rejoindre la plaine afin d’yremplir leurs obligations professionnelles. Dans cette perspective, les habitantssemblent irrémédiablement attachés, au propre comme au figuré, au lieu qu’ilshabitent. Ils semblent même dans une certaine mesure réduits à cela, puisqu’ilsne manifestent aucune attache à d’autres lieux que le village qu’ils habitent.
« Faudra bien tenir le coup, sinon ça vaut plus la peine de reconstruire quelque chose »
Les « têtes » de Baltschieder
On comprend aisément que des habitants à ce point attachés au lieu qu’ilshabitent soient fortement affectés par une telle catastrophe. Pour autant, ceshabitants n’apparaissent pas accablés. Au contraire, ils affirment sans excep-tion la nécessité de continuer à habiter les lieux détruits par la catastrophe etmanifestent leur empressement à reconstruire leurs habitations et leursvillages. Cette volonté qui transcende la détresse est décrite comme unequalité propre aux Hauts-Valaisans. Elle est à la fois exhibée et thématisée dèsl’émission du mardi 17 octobre, à l’occasion d’un entretien diffusé en direct deBaltschieder, l’un des deux villages les plus touchés. À l’avant-plan d’une
D#UNE CATASTROPHE NATURELLE $ UNE R"USSITE HUMANITAIRE 299
pelle mécanique en train de déblayer les gravats qui ont enseveli les rues duvillage, l’envoyé spécial s’entretient avec Marcel Egger, présenté comme « habit[ant] le village » et comme « pompier volontaire ». Après que ce dernierait exprimé sa détermination à lutter contre la force énorme de la nature, lejournaliste lui pose la question suivante :
Comment réagissent les habitants du village en ce moment ? Ils sont dépités ? Ilsont envie de reconstruire le village ? Quel est le sentiment général ?
À quoi Marcel Egger répond :
Moi je crois que je connais bien les têtes du Haut-Valais. Euh, on est fort et puis onessaie certainement, on croit encore à notre village. Et puis à mon avis on est, onavait toujours un futur ici hein.
La question du journaliste envisage les options de l’accablement et de lareconstruction. L’intérêt de la réponse de Marcel Egger réside moins dans lefait de choisir l’option de la reconstruction, qui a manifestement la préférencedu journaliste et des habitants du Haut-Valais, que de l’étayer sur une anthro-pologie spontanée de ces derniers : la force, voire l’entêtement des Hauts-Valaisans, est la qualité qui leur permet d’occuper la place qui leur est dévoluedans le dispositif de la reconstruction, en affirmant, immédiatement après lacatastrophe, leur ferme volonté de continuer à habiter le village sinistré.
Les habitants de Gondo vus depuis Simplon-Village : « la Suisse entière est avec vous et avec la volonté de reconstruire »
Cette caractérisation des habitants est développée lors de l’émission du lende-main. Le même envoyé spécial conduit alors une interview en direct deSimplon-Village, un village qui surplombe Gondo, et vers lequel les habitantsde Gondo ont été évacués. L’envoyé spécial s’y entretient avec AlfredSquadratti, présenté par le biais d’un synthétiseur comme « membre de lacellule de crise » et que le journaliste indique comme présent à Simplon-Village « depuis le début de la catastrophe ». La première question posée portesur l’évolution du « sentiment des gens » :
– Vous êtes là depuis samedi, depuis le début de cette catastrophe. Est-ce qu’en cinqjours, euh, le sentiment des gens a évolué ?– Oui il a évolué. Et je peux dire qu’il a évolué d’une façon réjouissante, heureuse-ment. Je me rappelle les premières images, les premières personnes que j’ai vues
300 ALAIN BOVET ET C"DRIC TERZI
ici, qui ont été évacuées de Gondo, c’était des gens qui ont vu la terreur, c’était desvisages qui exprimaient eux le drame. C’était des gens détruits, et aujourd’hui lecinquième jour après la catastrophe, j’ai eu l’occasion de parler avec euh des gens,une cousine, une connaissance. Des gens qui ont pu descendre aujourd’hui à Gondo,pour aller chercher le plus nécessaire. Et quand bien même ils avaient peur deregarder à droite ou à gauche quand ils sont rentrés dans leur village et qu’ils ontpris peut-être des choses peut-être pas les plus rationnelles. Une femme m’a dit : « Je suis revenue. Ma valise est pleine mais je ne sais pas si j’ai pris les bonnesaffaires. » Eh bien quand bien même il y a eu cela, elle m’a dit : « On va retourner à Gondo. » Il y a une volonté euh déterminée, et il y a pas une personne que j’airencontrée qui m’a dit qu’elle avait pas envie de retourner à Gondo.
Alfred Squadratti parle bien en tant que membre de la cellule de crise dansla mesure où il ne se présente à aucun moment comme une victime directe dela catastrophe. Il se borne à rapporter ce qu’il a vu et ce qui lui a été dit.Comme l’a rappelé le journaliste, ce n’est pas pour autant un spécialiste dépê-ché depuis la plaine pour agir sur la catastrophe. Il était sur les lieux depuis ledébut, ce qui suggère fortement qu’il habite le village. Cette position privilé-giée apparaît dans sa manière de se rapporter aux habitants avec lesquels ilentretient des relations d’interconnaissance ou de parenté. Ces personnes ontété exposées au drame et en ont été durement affectées. Mais, cinq jours plustard seulement, une autre attitude s’est substituée à la stupeur : ces personnesveulent « retourner à Gondo ». Alfred Squadratti peut ainsi parler d’une « volonté déterminée », qui ne souffre aucune exception parmi les personnesqu’il a rencontrées. Cette caractérisation des habitants concorde avec ce qu’ena dit Marcel Egger la veille. À défaut de se montrer pleinement rationnels, etune fois surmonté le choc initial, tous les habitants font preuve de ténacité faceà l’adversité.
Dans la suite de l’entretien, le journaliste demande à Alfred Squadratti à quoi il attribue cette volonté de « continuer à vivre sur place ». Celui-cirépond en opposant le fait d’être hébergé et d’être chez soi6. Après cetteréponse, le journaliste conclut l’entretien de la façon suivante :
Ben en tout cas on peut qu’espérer que le village sera reconstruit et puis ben soyezcertain que la Suisse entière, si ce n’est une partie de l’Europe qui a suivi lesmalheurs de Gondo, est avec vous et avec la volonté de reconstruire.
D#UNE CATASTROPHE NATURELLE $ UNE R"USSITE HUMANITAIRE 301
6. Nous reviendrons sur cette opposition structurante à la fin de cette section à propos d’unefamille hébergée qui est présentée comme « sans domicile fixe ».
Par cette formulation, le journaliste indique que la reconstruction estd’ores et déjà le seul horizon non seulement souhaitable mais simplementenvisageable. Il indique ensuite que ce ne sont pas seulement les habitants et lemédia qui convergent vers cet horizon, mais la « Suisse entière si ce n’est unepartie de l’Europe ». Tous les acteurs et toutes les échelles envisageablesfusionnent avec l’interlocuteur, qui incarne indistinctement les habitantstouchés et leur « volonté de reconstruire ». L’un des effets de l’interviewsemble résider dans le fait d’abolir les distinctions énonciatives et agentives.Plus précisément, ce n’est pas la catastrophe qui associe les téléspectateurs auxhabitants de Gondo, mais la réaction admirable de ces derniers, qui fait,comme le dira ensuite le journaliste, qu’« on a dépassé la catastrophe », ce quipermet à l’instance médiatique et aux téléspectateurs auxquels elle s’adressede fusionner avec leur volonté de reconstruire.
Une habitante de Gondo, affectée mais volontaire
De fait, le dépassement de la catastrophe opéré par les habitants devient, pourles journalistes, une consigne de lecture de la situation et, vraisemblablement,d’écriture des comptes rendus qu’ils en font. L’instance médiatique peut ainsise permettre de diffuser des séquences, qui, prises isolément, pourraientsuggérer que la catastrophe n’a pas été dépassée, sans pour autant mettre à mall’intrigue tendue vers la reconstruction. C’est le cas d’une séquence diffusée à la suite de l’interview d’Alfred Squadratti. Cette séquence est annoncée parla présentatrice de la manière suivante : « Olivier Misel a recueilli le témoi-gnage poignant de la patronne de l’hôtel de la Poste qui était heureusementfermé au moment de la catastrophe. Écoutez cette femme qui a tout perdu enquelques secondes » :
Ça me décroche le cœur. Ça me fait mal, très mal. Tous les morts qu’on a perdus,tous des parents et des amis. Et on… si on les trouve encore, c’est déjà beaucoup,mais on a trouvé trois, quatre. On voudrait encore rester à Gondo. Moi je veux allerà Gondo. Moi j’attends seulement qu’ils nous disent « Vous pouvez rester là » et jeretourne à Gondo. Et puis on est beaucoup qu’on veut rester à Gondo. On veut, onveut pas aller ailleurs. On était toujours là. On fait le possible.
Dans la première partie de l’extrait, cette femme témoigne de la peine et dela douleur que la catastrophe lui fait endurer. Il s’agit non seulement de la pertede proches, mais encore du fait que leurs corps n’ont pas encore été tousretrouvés. Par une transition thématique rapide voire abrupte, sans doute dueau montage de la séquence, elle passe immédiatement de l’expression de sa
302 ALAIN BOVET ET C"DRIC TERZI
douleur à l’affirmation de la volonté de retourner et de demeurer à Gondo.Cette volonté n’est pas (seulement) énoncée à la première personne mais ratta-chée à un « on », qui inclut les habitants de Gondo, et qu’elle oppose à un « ils »,désignant les institutions publiques qui tardent à assumer leur responsabilitéde répondre à leur désir.
Qu’elle résulte ou non du montage, la séquence est intéressante dans lamesure où elle reproduit le mouvement par lequel les habitants sont passés del’accablement à l’affirmation de la volonté de reconstruire. Ce mouvement estparticulièrement frappant chez cette femme, dont la détresse, marquée par sondiscours, mais également par le corps qui l’énonce, semble presque insurmon-table. La deuxième partie de l’extrait vient toutefois nous rappeler l’évolution« réjouissante » dont parlait Alfred Squadratti, lorsqu’il témoignait du fait queles habitants dans un premier temps « détruits » par la catastrophe manifes-taient ensuite une volonté unanime de reconstruire.
Ce qui frappe dans ces images, ce n’est pas tant la fabrication médiatiqued’un consensus artificiel, qu’il s’agirait de dénoncer, que la prégnance d’unecertaine mise en intrigue de la catastrophe, qui s’impose à tous ses protagonisteset qui appelle les téléspectateurs à déceler, au cœur même d’un accablement audemeurant parfaitement sensé et intelligible, les prémices d’une volonté indé-fectible de restaurer et continuer à habiter des lieux avérés dangereux.
La comparaison avec le traitement d’autres catastrophes fait ressortir dansce cas particulier l’absence (ou l’absence de mention) de prise en charge spéci-fique des personnes affectées, en particulier sous la forme de « débriefingspost-traumatiques », devenus presque routiniers dans de telles situations. Il nefait pas de doute qu’une telle prise en charge serait ajustée à l’état manifestépar cette femme au cours de son interview. Or cette perspective ne semble pasmême être envisagée. Ce n’est, de fait, pas le propos de l’instance médiatique.Porteuse de l’intrigue de la reconstruction, celle-ci invite ses téléspectateurs à déceler le désir de reconstruire des habitants au cœur même de leur accable-ment, marquant ainsi un tournant majeur pour l’orientation de l’intrigue versun programme d’action conjointe de reconstruction, et donc vers la poursuitede l’habitation des villages de montage.
Les habitants sans domicile fixe de Saillon
Continuer à habiter leur village constitue un véritable leitmotiv dans la présen-tation des habitants touchés par la catastrophe, à tel point qu’ils semblent seréduire ou se résumer à ce projet. On en trouve une figuration particulièrementaffirmée dans un reportage de l’émission du vendredi 20 octobre, consacré à la« famille Cottier ». Il s’agit d’une famille dont l’habitation, au village de
D#UNE CATASTROPHE NATURELLE $ UNE R"USSITE HUMANITAIRE 303
Saillon, a été endommagée par les inondations qui ont touché la plaine, aupoint de nécessiter son évacuation. Cette situation définit la vie de la familleCottier qui, comme l’indique l’annonce du reportage, « passe ses nuits dans unchalet qui lui a été prêté. Et la journée, eh bien elle éponge son appartement ».Le reportage nous apprend en effet que « Daniel, Irmgard et leur fils Lucien selèvent à l’aube pour travailler sur les ruines de leur ancienne maison ». Si lafamille Cottier doit se résoudre à passer ses nuits dans un chalet de fortune,elle consacre en revanche la totalité de sa vie diurne à remettre en état sonhabitation. Pas de mention, ni même de trace d’activité professionnelle, pourles parents, ou scolaire, pour les enfants.
La suite du reportage montre dans un premier temps Daniel Cottier à l’inté-rieur de la maison, constatant non sans abattement les dommages causés à sesantiquités. La séquence suivante montre le passage de « divers spécialistes »venus régler le sort de la maison, ce qui amène Daniel à ce commentaire pleind’amertume : « À un moment donné on a même parlé de la démolir ». À cettephase d’accablement succède, une fois encore, la manifestation d’une volontéde reconstruire, portée par Irmgard Cottier, qui est interviewée à l’extérieur del’habitation inondée. Elle commence par raconter l’attachement de son épouxà la maison et au jardin, puis elle souligne qu’aucun membre de la famille n’aperdu la vie. Cette funeste éventualité prend un sens déterminé dans la suite dureportage :
[Voix off :] Les catastrophes naturelles Madame Cottier connaît.[Irmgard Cottier :] Mon papa qui est passé sous une avalanche, qui est décédé dansune avalanche en 65 quand j’avais douze ans. Euh j’ai eu ma famille qui a ététouchée en 93 à Brigue.[Journaliste :] Vous m’avez dit que les enfants de votre mari auront le contrecoupaprès. Vous vous sentez prête à les recueillir lorsque ça se passera ?[Irmgard Cottier :] Si je tiens le coup, ouais, faudra bien. Bien sûr. Sinon je penseon … sinon ça vaut plus la peine de reconstruire quelque chose.
Il faut d’abord rappeler que Saillon, village de plaine, ne se trouve pas dansle Haut-Valais, ce qui laisse entendre qu’Irmgard Cottier a quitté le Haut-Valais, et notamment la ville de Brigue, pour vivre avec son époux. Cetteorigine haut-valaisanne lui vaut d’avoir été durement et « dûment » éprouvéepar des catastrophes naturelles, ce qui lui apporte une expérience dont elle tirela force et la ténacité nécessaires pour « tenir le coup ». C’est cette capacitédécisive qu’elle apporte à sa nouvelle famille du Bas-Valais, notamment à sonépoux – qui à lui seul semble ne pas être en mesure de « tenir le coup » –, cequi en fait la porteuse du programme de reconstruction au sein de son foyer.
304 ALAIN BOVET ET C"DRIC TERZI
C’est donc tout un imaginaire de la montagne et des qualités morales qu’elleforge chez ses habitants qui est ici convoqué.
Le reportage se conclut avec le retour au chalet de secours « après unejournée de travail les pieds dans la boue ». On y voit la famille Cottier en trainde manger dans un intérieur cossu. Mais le commentaire se soucie de prévenirune interprétation erronée de telles images :
L’image d’une famille normale dans son foyer. Image trompeuse. Ces gens-là n’ontqu’une pensée : la maison de Saillon, celle qui est si mal en point et qui fait d’euxdes sans domicile fixe.
Il ne faut donc pas s’y tromper : la famille Cottier n’a pas recouvré sonhabitation. Elle y travaille cependant d’arrache-pied en prenant appui sur lesqualités morales, spécifiquement haut-valaisannes, de la mère de famille. Il nefaudrait par ailleurs pas voir dans ce reportage une représentation pittoresquedes montagnards suisses. Il s’agit au contraire d’assurer les conditions de féli-cité de l’opération humanitaire par laquelle la population suisse est invitée à sefondre dans la volonté de reconstruire des habitants touchés par la catastrophe.La transition de la présentatrice du journal télévisé à l’issue du reportageconsacré à la famille Cottier est à cet égard explicite :
Pour venir en aide justement à toutes ces familles, la Chaîne du Bonheur est mobi-lisée depuis six heures ce matin. Et aujourd’hui on assiste à un véritable élan desolidarité. L’opération rencontre un succès sans précédent.
Tandis que, dès potron-minet, la famille Cottier retournait à Saillon pourtravailler à reconstruire son habitation, les Suisses, sans attendre le lever dusoleil, leur venaient en aide en appelant la Chaîne du Bonheur pour faire despromesses de dons.
La figuration des institutions publiques : « Nous nous entraidons »
Victimes de la catastrophe, mais surtout associés à une indéfectible volonté dereconstruire, les habitants sont apparus comme porteurs de demandes, oumême d’exigences adressées à la collectivité nationale. Des réponses leur ontnotamment été apportées par des institutions publiques. Des sauveteurs et despompiers ont immédiatement été engagés sur les lieux des glissements deterrain et des inondations. D’importants moyens militaires ont été mis enœuvre pour déblayer les voies de communication et les villages sinistrés, demanière à préparer leur reconstruction. Les autorités politiques cantonales ont
D#UNE CATASTROPHE NATURELLE $ UNE R"USSITE HUMANITAIRE 305
débloqué des fonds pour venir en aide aux habitants et ont pris la parole pourles assurer de leur soutien. Des représentants des administrations publiquessont intervenus pour élucider les causes de la catastrophe, pour évaluer lesrisques et pour envisager des mesures à prendre à l’avenir.
Dans les paragraphes qui suivent, nous nous intéresserons à la place occupée par ces institutions publiques dans le programme d’action conjointede la reconstruction, et à la manière dont leur intervention a été figurée dans lereportage télévisé. Le trait le plus frappant de l’action de ces institutions est laproximité que leurs représentants entretiennent avec les habitants, à tel pointqu’il n’est pas toujours aisé de les distinguer. Les uns et les autres apparaissentavant tout comme des membres de la même collectivité, mieux, comme deshabitants unis dans leur désir commun de rapidement reconstruire les villagesdétruits par les intempéries. Loin d’amoindrir l’autorité des institutions, cetteproximité constitue leur véritable qualité, leur garantissant notamment unsurcroît de légitimité. Saisie dans la mise en intrigue de la reconstruction, cetteproximité participe d’un mouvement continu d’intégration de la collectivitésuisse, entièrement mobilisée pour restaurer et préserver l’habitation de sesrégions de montagne.
Ce rapport particulier de la Suisse à ses institutions trouve une expressiondans le système dit « de milice », en vertu duquel de nombreux corps, tels quel’armée, la protection civile et les pompiers, sont composés d’une proportionimportante – voire presque exclusive dans le cas de la protection civile – demembres non professionnels7. L’aide apportée après les intempéries a donc étéfournie pour une part très importante par des personnes ordinaires mobiliséespour la circonstance. Il serait ici encore inutile de chercher à démêler ce quirelève du déroulement de l’action et de son compte rendu, notamment média-tique. Nous montrerons au contraire par l’analyse de quelques séquences quecette qualité de proximité imprègne aussi bien l’organisation pratique de l’ac-tion que son intelligibilité et son adéquation morale.
Cette qualité de proximité est particulièrement visible dans un reportage del’édition du jeudi, que la journaliste Stéphanie Jaquet (SJ) a consacré à l’inter-
306 ALAIN BOVET ET C"DRIC TERZI
7. Voici la manière dont le « système de milice » est présenté par le département fédéral desaffaires étrangères sur son site swissworld.org : « Le service rendu à la communauté est, enSuisse, fortement ancré dans la tradition. Il consiste pour les citoyens à accepter une chargepublique qu’ils accomplissent parallèlement à leurs activités professionnelles normales. Pour les Suisses il se concrétise par le système de milice, dont la manifestation la plus connue est l'armée, laquelle est en grande partie non professionnelle, même pour la plupart de ses officiers.Pour les Suisses, les hommes politiques font partie du système de milice. Les membres du parle-ment fédéral ne renoncent pas non plus à leurs anciennes charges professionnelles quand ils pren-nent leurs fonctions. » (http://www.swissworld.org/fr/politique/vue_densemble/le_systeme_ de_milice/, consulté le 27 janvier 2011)
vention d’un régiment de l’armée pour déblayer une voie ferrée submergée delimons. Ce document est introduit par les images d’un entretien, mené sur lethéâtre des opérations, avec le caporal Sylvain Lavenex (SL8), un hommemoustachu, vêtu d’une combinaison de camouflage et d’un gilet fluorescentorange, équipé d’une pelle. Il répond avec un fort accent vaudois :
SJ : [voix off] Le régiment du chemin de fer 1 est à pied d’œuvre depuis deux jourspour rendre sa voie au train. Du travail à la pelle et à la pioche qui semble plusagréable qu’un cours de répétition.SL : Oui c’est intéressant pour la – pour nous, oui (son d’ambiance).SJ : C’est difficile par rapport à ce qu’on vous demande de faire ?SL : Non ça ça ça nous change pas trop quoi, ça va, ouais ouais.SJ : Vous vous sentez un peu plus utile que d’habitude ?SL : Ah oui quoi … super !
Si cette séquence est riche sur le plan analytique, c’est surtout en raison detout ce qu’elle donne à reconnaître d’images ordinaires. La trame de cettereconnaissance est explicitée : ce qui se donne à voir à l’écran se présente sousles traits d’un « cours de répétition », c’est-à-dire des trois semaines d’exer-cice que tous les soldats suisses – et donc en principe tous les hommes –doivent effectuer chaque année jusqu’à leur démobilisation. Si le déploiementd’une troupe militaire composée de personnes ordinaires fait partie du paysagesuisse, les images présentées ici ont ceci de remarquable que ces hommesremplissent leur devoir sur le terrain d’une opération réelle. Cette situation aexplicitement été saisie comme une opportunité : par l’instance médiatique quien fait l’illustration de l’engagement de Suisses ordinaires dans le lancementdu programme d’action conjointe de reconstruction ; par les soldats qui y ontvu l’occasion de se sentir « un peu plus utiles que d’habitude » ; mais aussi parleur état-major, qui en a profité pour célébrer l’efficacité de l’armée de milicequi garantit la disponibilité d’une main-d’œuvre toujours prête à faire face auxsituations imprévues. C’est ce que souligne dans le même reportage le coloneld’état-major général9, Hans-Ruedi Hauri (HRH) :
SJ : Le travail est rapide. 160 hommes sont sur le terrain.HRH : Pour le moment c’est beaucoup plus que suffisant parce qu’il nous manquedes moyens lourds. Alors euh ce sont c’est la coopération avec les CFF [Chemins defer fédéraux], puis les CFF ont été un peu surpris par euh la force qui était venue ici.
D#UNE CATASTROPHE NATURELLE $ UNE R"USSITE HUMANITAIRE 307
8. Le caporal est le premier grade de sous-officier et donc le supérieur hiérarchique direct du simplesoldat.
9. Un colonel d’état-major général est un officier supérieur professionnel.
SJ : Donc vous avancez plus vite que prévu semble-t-il ?HRH : Oui, on est très puissants.
Si les propos du colonel Hauri pourraient faire croire à une tension, voire à une rivalité, entre l’armée et les Chemins de fer fédéraux, la suite du repor-tage indique qu’il n’en est rien. De fait les deux institutions apparaissentcomme consubstantielles, parce que composées de personnes ordinaires. C’estce que fait savoir le chef de division des infrastructures des Chemins de ferfédéraux, Pierre-Alain Urech (PAU) dans la suite du reportage :
SJ : Du côté des CFF on est satisfait du travail accompli par les troupes de l’armée.PAU : La collaboration est excellente. Il s’agit ici d’un engagement des troupesmilitaires du chemin de fer, en partie dirigées par des spécialistes techniques desCFF qui sont en même temps officiers. Par contre, toute la troupe, elle est duservice militaire des chemins de fer. C’est des ouvriers, des employés, des postiers.
Cette séquence fait apparaître comment le système de milice fait de l’ac-tion publique un aspect consubstantiel à la vie sociale, de telle sorte que lesofficiers qui dirigent les troupes militaires en deviennent indistincts des cadresde l’entreprise des Chemins de fer fédéraux. Les propos de Pierre-Alain Urechformulent rétrospectivement la catégorie incarnée par le caporal Lavenex, à savoir celle « des ouvriers, des employés, des postiers », bref de ces Suissesordinaires offerts comme autant de figures dans lesquelles chaque téléspec-tateur est invité à se reconnaître.
Les représentants des institutions publiques ne se distinguent donc en riendes victimes auxquelles ils portent secours. Ce n’est pas tant au titre decitoyens que d’habitants de la Suisse que ces institutions s’engagent conjointe-ment dans le programme de reconstruction. Celui-ci impose aux Suisses épar-gnés par la catastrophe de venir en aide aux victimes pour leur permettre derestaurer leurs habitations. C’est en tant qu’émanation de ces habitants, c’est-à-dire en continuité avec eux, que les institutions apparaissent comme desintervenants légitimes dans la situation. Ce récit donne donc à voir unecommunauté d’habitants qui se reconnaissent un destin commun, plutôt qu’ilsne partagent des principes et des règles de vivre ensemble10. En conséquence,cette manière de conduire l’intrigue n’organise pas l’expérience d’une citoyen-neté commune, associée à des droits et des devoirs – notamment d’assistanceet de solidarité – dont la prise en charge serait susceptible d’être déléguée à desreprésentants institutionnels.
308 ALAIN BOVET ET C"DRIC TERZI
10. Sous cet angle, les logiques métonymique et métaphorique privilégient respectivement ledroit du sang et le droit du sol.
Cette organisation caractéristique du travail des institutions publiques a étémise en abyme par le compte rendu médiatique. Prenant appui sur l’organisationdes institutions de milice, les reportages s’adressaient à un téléspectateur invitéà voir dans les victimes et ceux qui leur portaient secours des habitants commelui, et donc à se reconnaître en tant que membre de la collectivité emportée parl’intrigue tendue vers l’horizon de la reconstruction.
Cette proposition d’identification a été réitérée à maintes reprises tout aulong des reportages journalistiques. Elle s’est faite particulièrement explicitelors de la longue séquence consacrée à une compagnie de secouristes de laprotection civile, interrogés après avoir été relevés par des troupes de l’armée.Ces entretiens ne mettaient pas seulement en scène des miliciens, des Suissescomme les autres, identifiables en tant que tels par leurs noms de famille et parleur accent, genevois en l’occurrence. Plusieurs séquences ont fait apparaîtreque leur intervention dans le village de Gondo avait été précédée par une expé-rience médiatisée de la catastrophe, du même ordre que celle qu’étaient entrain d’en avoir les téléspectateurs auxquels le reportage était destiné. Cettemise en abyme a été particulièrement explicite dans le récit de deux secouristesde la protection civile, Bernard Zufferey (BZ) et Henri Richard (HR), signi-ficativement désignés par leur nom et sans indication de leur fonction ni de leurgrade :
BZ : Sur place il y a encore ces mélanges d’odeurs, de tout, lessive de tout de touteschoses qui existent quoi de… Et c’est vrai que le mélange des combinaisons desens font qu’on le vit totalement différemment sur place que ce qu’on voit par lesmédias.HR : Si on parle par rapport à ce qu’on avait vu dans le… au niveau du journal. Moi j’avais vu le journal dimanche euh ça me semblait une vision d’enfer mais enarrivant ici c’était l’apocalypse. Je pouvais pas je pouvais vraiment pas ressentireuh la même chose quoi. J’étais pas dire anéanti mais c’était vraiment très très fort.
Cette séquence fait apparaître la proximité des sauveteurs, non seulementavec les victimes, mais également avec les téléspectateurs auxquels le repor-tage est adressé. Leur trajectoire en devient exemplaire, en ceci qu’elle attestede la possibilité, pour les spectateurs du compte rendu journalistique de lasituation, d’en devenir les protagonistes. Invités à se reconnaître sous les traitsde ces personnes ordinaires engagées dans l’entraide auprès des habitants, lestéléspectateurs peuvent se ressaisir en tant que membres d’une communautéd’habitants, titre auquel ils ne peuvent ni rester indifférents au destin de leurssemblables, ni se tenir à l’écart du dispositif de reconstruction que les victimesappellent de leurs vœux.
D#UNE CATASTROPHE NATURELLE $ UNE R"USSITE HUMANITAIRE 309
La médiation journalistique : du malheur au bonheur
Il s’agit maintenant d’analyser comment les comptes rendus journalistiques dela catastrophe ont servi de point d’appui à une opération humanitaire d’ampleurnationale. Afin de retracer ce mouvement, nous nous intéresserons à la manièredont une opération humanitaire est venue se glisser dans le déroulement d’unjournal télévisé. Nous serons ainsi en mesure de montrer que c’est de l’intérieurmême du discours de l’information qu’a pris forme une mobilisation publiqueayant pour vocation de relayer, d’accompagner et de soutenir la volonté dereconstruire exprimée par les habitants victimes de la catastrophe.
C’est sans le moindre accroc que s’est réalisé le passage des reportagesjournalistiques à l’appel à don. Cette remarquable continuité est la manifes-tation d’un discours cohérent, dont l’articulation ne laisse aucune place pourinterroger la pertinence ou la légitimité de l’intervention de la Chaîne duBonheur. Son entrée en scène n’est jamais thématisée : il est tenu pour acquisqu’elle est la réponse appropriée à l’exigence morale engagée par les comptesrendus journalistiques, de telle sorte que son inscription au cœur même d’uneémission d’information entre, en quelque sorte, dans l’ordre naturel deschoses. Seule une question d’agencement pratique semble être susceptible d’êtreposée. Elle concerne la détermination du moment à partir duquel il est possible,décent et souhaitable, de lancer l’appel à don. Cette question est d’ordre stricte-ment pratique pour les participants, au premier rang desquels les journalistes,qui font évidemment bien plus que fournir le numéro de compte sur lequel lesdons peuvent être versés. Mais cette question n’est pas en tant que telle unequestion publique susceptible de faire l’objet d’une controverse. Des formesde polarisation ou de critique à ce sujet seraient vues comme indécentes etdéplacées.
Il s’agit d’un trait structurant de l’espace public suisse face aux catas-trophes : quoi qu’il arrive, et quoi que fassent les institutions étatiques etpubliques, la Chaîne du Bonheur se mobilisera, non pas au nom ou à la placedes institutions publiques, mais en tant qu’émanation directe de la commu-nauté suisse solidaire. C’est ce rapport métonymique (i.e. occultant ou effa-çant l’opération par laquelle un représentant est associé à un représenté) quiimmunise le dispositif contre la critique, laquelle n’est articulable qu’à condi-tion de trahir les engagements constitutifs de la situation, et donc de s’extrairede la communauté nationale ou de s’en faire exclure.
Cette substitution métonymique emporte l’instance médiatique qui, ayantanticipé et appelé la mobilisation de la Chaîne du Bonheur, devient le prolon-gement de la volonté des habitants et le vecteur de son extension à l’ensemblede la collectivité nationale.
310 ALAIN BOVET ET C"DRIC TERZI
Le premier extrait sur lequel nous nous arrêterons est la conclusion del’édition du jeudi 19 octobre par la présentatrice du journal télévisé RaphaëlleTschoumy (RT). L’extrait constitue la désannonce du reportage, déjà évoqué,consacré à l’engagement conjoint de l’armée et des Chemins de fer fédérauxpour dégager et remettre en service des lignes ferroviaires bloquées par lacatastrophe :
RT : Ce soir, c’est encore un petit peu tôt pour évaluer les dégâts mais une chose estsûre : toute la Suisse soutient les Valaisans et va les aider. Le conseil fédéral a annoncé qu’il allait débloquer une aide financière de même que les cantons duJura et de Neuchâtel. Par ailleurs si vous-mêmes vous voulez vous montrer soli-daires, demain la Chaîne du Bonheur organise une journée nationale. Vous pouvezverser vos dons sur le compte de chèques 10-15000-6, avec la mention « Intempériesen Suisse ». La question jurassienne est relancée […].
La présentatrice indique d’emblée qu’il « est encore un petit peu tôt pourévaluer les dégâts » et donc qu’à ce moment-là, les tenants et aboutissants dela situation ne sont pas suffisamment éclaircis pour permettre le lancementeffectif de la reconstruction. Toutefois, cela ne l’empêche pas de suggérer,dans le même souffle, qu’un tel traitement rationnel du problème se trouve enquelque sorte débordé par un irrépressible élan national de solidarité dontl’existence ne souffre manifestement aucun délai. La présentatrice est en effeten mesure d’affirmer, avant même l’articulation d’un premier état des lieux,qu’il est certain que « la Suisse soutient les Valaisans » et que cet appui va seconcrétiser sous la forme d’aides financières publiques et de dons privés.
Par cette opération métonymique, le reportage journalistique prolonge sansle moindre accroc la mise en œuvre d’une opération humanitaire, et se fondainsi dans la mobilisation d’une unité nationale solidaire. Cet appel vientremplir un horizon d’attente dont les contours ont été élaborés tout au long descomptes rendus journalistiques de la semaine. Dans la perspective de cetteattente, il ne fait aucun doute que l’aide à apporter aux Valaisans est destinée à la reconstruction, laquelle est envisagée comme un devoir moral. Ce devoirincombe indistinctement aux habitants appelés à faire part de leur volonté dereconstruire, aux autorités dont il n’est pas envisageable qu’elles s’y opposentet enfin aux Suisses appelés à les soutenir afin d’y parvenir. C’est autour de cecentre de gravité que s’organise l’expérience de l’unité nationale, laquelles’appuie sur des principes tacites, mais incarnés par la volonté de reconstruireles habitations de montagne détruites par la catastrophe.
Cinq jours après la catastrophe, il n’est donc nul besoin d’enquêter pouraffirmer que la volonté de reconstruire manifestée par les habitants et recueillie
D#UNE CATASTROPHE NATURELLE $ UNE R"USSITE HUMANITAIRE 311
par les journalistes est devenue celle de « la Suisse » dans son ensemble, etdonc qu’elle engage personnellement chacun des téléspectateurs auxquelss’adresse la présentatrice du journal télévisé. À ce sujet, il convient de soulignerque l’aide prodiguée par les institutions publiques – et donc par représentation –ne saurait satisfaire l’exigence de solidarité requise et dont la réalisation estdéjà assurée (« une chose est sûre »). Encore faut-il pour cela que tous ceux quisont affectés par le sort des Valaisans – et donc chacun de ceux qui composentla Suisse – incarnent cette solidarité nationale sous la modalité que l’instancetélévisuelle leur propose : celle d’un don à la Chaîne du Bonheur.
Le travail de médiation assuré par l’instance télévisuelle constitue l’arti-culation centrale du dispositif. Les comptes rendus journalistiques élaborés etdiffusés après la catastrophe ont mis en évidence et relayé la volonté dereconstruire manifestée par les habitants. Plus encore, les journalistes ontd’emblée reçu et présenté ces témoignages comme une exigence de solidariténationale. Or, en s’offrant en tant que scène pour les appels à dons de la Chaînedu Bonheur, le journal télévisé propose à celles et ceux qui le suivent un dispo-sitif qui leur dispense une place dans laquelle jouer le rôle qui est dévolu à laSuisse – et donc aux Suisses – dans le programme de reconstruction. Dans cetteconfiguration, l’instance télévisuelle assure l’intelligibilité du programme dereconstruction, lequel conjoint la volonté manifestée par les habitants, sonrelais par les journalistes, la mobilisation de la Chaîne du Bonheur et les donsconsentis par les Suisses. Elle exerce ainsi une fonction proprement institu-tionnelle, en établissant les versements financiers des téléspectateurs en tantque solution fonctionnellement et moralement adéquate à la situation des habi-tants, et donc comme la réponse appropriée à l’exigence de reconstruire géné-rée par la catastrophe11.
Dans ces conditions, ce que la présentatrice formule comme une proposi-tion a plutôt la portée d’une exigence morale : comment quiconque a suivi lesjournaux télévisés de la semaine pourrait-il ne pas « vouloir se montrer soli-daire » en versant un don à la Chaîne du Bonheur ? Ceci permet de mieuxcaractériser le travail de médiation réalisé par l’instance télévisuelle. Celle-cine se contente pas d’assurer un lien entre la catastrophe et les téléspectateurs.Elle interpelle ces derniers en tant qu’habitants, appelés à se reconnaître dansles figures de celles et ceux qui ont perdu leur maison dans la catastrophe. Enpareilles circonstances, se montrer solidaire, c’est être Suisse : c’est faire l’ex-périence de son appartenance à une communauté dont les membres sont unispar des liens métonymiques. Or, c’est la télévision qui – par l’intermédiaire de
312 ALAIN BOVET ET C"DRIC TERZI
11. Dans les termes de Searle (1998, p. 45-48), l’intervention de la Chaîne du bonheur est un faitinstitutionnel, en ce sens que c’est elle qui garantit que les promesses de dons des téléspectateursvalent comme l’expression de la solidarité nationale dans les circonstances de cet appel à dons.
ses reportages prolongés par l’intervention de la Chaîne du Bonheur – offreaux Suisses les moyens de prendre part à la reconstruction, et donc d’assurer laréalisation du programme d’action conjointe dévolu à la Suisse. Ainsi la télévi-sion acquiert-elle la stature d’une véritable institution politique : c’est elle quiassure la médiation entre la Suisse et les Suisses. Elle devient l’instance parlaquelle la Suisse se révèle à elle-même.
Après avoir décrit le programme d’action auquel invite la télévision,penchons-nous à présent sur un extrait du journal télévisé du vendredi 20 octo-bre, qui nous permet d’observer comment ce programme est rempli etcomment la télévision en rend compte. Il s’agit de la séquence qui fait immé-diatement suite au reportage consacré à la famille Cottier, que nous avonsanalysé à la fin de la première section. Dans cette séquence consacrée à l’opé-ration en cours de la Chaîne du Bonheur, la présentatrice (RT) s’entretient avecJean-Marc Richard (JMR) qui intervient à partir d’un studio transformé pourl’occasion en centrale téléphonique. Jean-Marc Richard est un animateur-vedette de la radio et de la télévision, qui est mis à contribution dans chacunedes opérations de la Chaîne du Bonheur.
RT : Pour venir en aide justement à toutes ces familles, la Chaîne du Bonheur estmobilisée depuis six heures ce matin. Et aujourd’hui on assiste à un véritable élande solidarité. L’opération rencontre un succès sans précédent. Jean-Marc, bonsoir,vous êtes sur pied de guerre depuis six heures ce matin.JMR : Bonsoir RaphaèleRT : Où en sommes-nous dans les –JMR : Ouais même cinq heures et quart euh ouaisRT : Même cinq heures et quart, où en sommes-nous, ce soir, dans les collectes dedons ?JMR : Alors écoutez euh c’est absolument euh, je crois qu’on va le dire, halluci-nant. C’est un terme qui paraît comme ça extraordinaire, mais qui correspond assezbien à ce que nous vivons, un peu magique aussi. Nous avons dépassé les17 millions. Le record absolu d’une journée euh de dons, de promesses de dons,c’était 13 millions avec euh la catastrophe de Mitch en Amérique centrale, donc onl’a dépassé, il était à peine 15 heures. Et nous sommes à plus de 17 millions. C’estdonc totalement inespéré.RT : Comment l’expliquer, que vous disent les gens au téléphone ?JMR : Alors ils nous disent toute leur émotion. Ils nous posent beaucoup de ques-tions auxquelles nous tentons évidemment chaque fois de répondre à l’antenne etnous l’avons fait depuis ce matin. Ils nous disent aussi qu’ils n’ont pas envie delaisser tous leurs voisins, les gens juste à côté, ils nous disent aussi qu’ils ont lesentiment de pouvoir toucher cette solidarité, qu’elle est si proche d’eux, que c’est
D#UNE CATASTROPHE NATURELLE $ UNE R"USSITE HUMANITAIRE 313
LA LEUR vraiment, et qu’ils ont confiance en l’utilisation de cet argent.RT : Merci Jean-Marc Richard, l’opération de la Chaîne du Bonheur se poursuitdonc jusqu’à ce soir minuit. Merci beaucoup.JMR : Absolument.RT : Et si vous, vous voulez également verser un don, voici le numéro de comptepostal : 10-15000-6 avec la mention « Intempéries en Suisse », ou alors téléphonezdirectement à la centrale au 08 00 87 07 07. Le Valais qui doit donc aujourd’hui seretrouver, se reconstruire comme une partie du canton de Vaud également touchépar ces intempéries. Le pont de Plan-sur-Bex vient de reprendre vie. Il a étéremplacé ce matin. On voit sur ces images tournées par Olivier Misel le goudron-nage. Le pont est opérationnel depuis la fin de l’après-midi mais il ne s’agit là qued’un pont provisoire. Le pont définitif ne sera construit qu’après l’hiver.
Si cette intervention est susceptible de revêtir un caractère comique outragique à notre regard rétrospectif, c’est que la distance historique, analytiqueet culturelle – pour ceux qui ne sont pas Suisses – nous dissocie de la situationtelle qu’elle était configurée pour ses protagonistes. Cet écart rompt la fusionmétonymique constitutive de l’événement ainsi que l’effervescence qui luiétait associée, de telle sorte que la célébration de l’unité nationale, alors mêmeque les corps des victimes n’étaient pas encore tous retrouvés, ne nous appa-raît pas (ou plus) nécessairement normale et souhaitable, bref comme la seulechose à faire pour quiconque entendait prendre part à ce qui était en train de sepasser. C’est dire qu’il serait aisé d’adopter une perspective ironique sur cetteséquence : la jubilation qui s’y manifeste apparaît en effet comme déplacée enregard d’une catastrophe ayant causé de nombreuses pertes humaines. Il seraitsans doute également aisé de refuser toute ironie et de traiter cette séquencecomme relevant du traitement ordinaire des catastrophes naturelles en Suisse,adoptant ainsi la perspective entièrement dénuée d’ironie de ses protagonistes.Nous proposons plutôt de traiter cette séquence, et en particulier l’amusementvoire l’indignation qu’elle pourrait susciter, comme des aspects signifiants denotre objet d’analyse. En effet, cette séquence télévisée nous montre tout à lafois la poursuite d’une opération humanitaire à laquelle la télévision s’est déjàlargement employée, et le constat enjoué de son « succès sans précédent ». Lesanalyses conduites jusqu’ici ont montré le caractère fusionnel de cette opéra-tion, qui interdit le type de distance critique dont relèverait l’ironie mentionnéeprécédemment. Dans la mesure où les habitants n’avaient d’autre choix que desouhaiter unanimement reconstruire au plus vite leurs villages détruits, où cettevolonté appelait un soutien des institutions publiques et de toute la collectiviténationale, une opération de récolte de dons et la célébration enthousiaste de saréussite n’étaient aucunement déplacées. En d’autres termes, cette opération et
314 ALAIN BOVET ET C"DRIC TERZI
son succès ne peuvent apparaître comme incongrus qu’à ceux qui n’auraientpas été saisis par la catastrophe sous les modalités que nous avons dégagéesprécédemment.
Tout au plus pourrait-on s’interroger sur la surprise manifestée par lesprotagonistes de la séquence à l’égard du succès d’une opération à laquelle ilsse sont à ce point employés.
Ce questionnement invite à une approche en termes de rituel. Les analysesdes rites de possession montrent que les participants contribuent activement à la survenue de la possession, notamment en prenant part à de longues danses.Mais cette contribution active ne les empêche pas de faire l’expérience de lapossession sous la forme d’une saisie abrupte par une entité extérieure quiéchappe à leur maîtrise12. Dans le cas du rite de possession, il n’y a donc pas decontradiction à être saisi, au sens littéral, par un événement qu’on a par ailleursactivement œuvré à faire advenir. L’intrigue de la reconstruction a ceci decommun avec le rite qu’elle saisit, en tant que personnages, les agents quicontribuent à son organisation. Dans cette dynamique, la séquence télévisée del’appel à dons revêt une dimension de révélation de la vraie nature de lacommunauté aux yeux de ses propres membres. C’est à ce titre qu’elle estsusceptible de s’avérer surprenante.
L’étonnement manifesté par l’animateur de la Chaîne du Bonheur rappellequ’un des aspects les plus frappants du travail de la télévision consiste préci-sément à ne pas le faire apparaître comme tel. En effet, loin de souligner lamédiation qu’elle opère entre un événement et une audience, la télévision sereprésente comme saisie par le même mouvement que les habitants et les insti-tutions qu’elle a fait intervenir tout au long de la semaine. Cet effacement desmédiations apparaît clairement dans l’échange repris ici :
RT : Comment l’expliquer, que vous disent les gens au téléphone ?JMR : Alors ils nous disent toute leur émotion. Ils nous posent beaucoup de ques-tions auxquelles nous tentons évidemment chaque fois de répondre à l’antenne etnous l’avons fait depuis ce matin. Ils nous disent aussi qu’ils n’ont pas envie delaisser tous leurs voisins, les gens juste à côté, ils nous disent aussi qu’ils ont lesentiment de pouvoir toucher cette solidarité, qu’elle est si proche d’eux, que c’estLA LEUR vraiment, et qu’ils ont confiance en l’utilisation de cet argent.
La question de la présentatrice est intéressante en ce qu’elle pourrait offrirl’occasion à Jean-Marc Richard de faire apparaître les chaînes de médiations àl’œuvre dans cette opération de solidarité : les gens téléphonent à notre standard,
D#UNE CATASTROPHE NATURELLE $ UNE R"USSITE HUMANITAIRE 315
12. Ces deux aspects des rites de possession ressortent admirablement des films de Jean Rouch,notamment Les maîtres fous (1954), et Les tambours d’avant : Tourou et Bitti (1971).
les standardistes me disent ce qu’ils disent et je vous le rapporte en réponse à votre question. Loin de procéder de la sorte, Jean-Marc Richard court-circuite les médiations, au point d’envisager le caractère tangible de la solida-rité qui se manifeste si fortement. La séquence apparaît ainsi comme lacélébration rituelle, voire cérémonielle, d’une collectivité fusionnée autourd’un programme d’action conjointe. Plutôt que de choisir entre l’ironie et lesérieux, nous proposons une perspective analytique permettant de relever quela médiation décisive de la Télévision Suisse Romande est soumise auxcontraintes du programme d’action conjointe qu’elle est en train d’instituer. Ilfaut encore une fois n’être pas saisi comme le sont les différents protagonistesde l’affaire pour s’amuser, s’étonner ou s’indigner du ton adopté par Richardpour célébrer le succès de la récolte de dons.
Si les rites propitiatoires peuvent apparaître comme des solutions trouvéespar des collectivités pour faire face aux aléas naturels, le travail considérable,bien que facilement effaçable, déployé par la Télévision Suisse Romandereprésente la solution trouvée par la collectivité suisse pour faire face auxcatastrophes exceptionnelles, en même temps qu’il la met en œuvre. Ce typede solution implique toutefois des conséquences importantes pour la culturepolitique suisse, auxquelles nous consacrerons la conclusion de cette étude.
Conclusion : la culture politique suisse en action
Le traitement médiatique des intempéries d’octobre 2000 revêt une dimensionpolitique à plusieurs titres. Il offre d’abord une occasion de faire l’expérienced’une identité nationale13, qui trouve dans la réponse apportée aux catas-trophes un lieu privilégié pour sa manifestation et sa constitution. Les diffé-rentes actions envisagées, discutées et accomplies, à la suite de la destructiondes villages de montagne participent d’un ordre social, dont la dimension poli-tique doit être pleinement prise en compte. En effet, ce qui se constitue à cetteoccasion est une collectivité politique bien particulière, laquelle émerge ets’organise au cours d’un processus dont l’élucidation permet de caractériser laculture politique suisse14.
Notre proposition consiste à dire que l’analyse du caractère politique de cegenre de phénomène requiert d’examiner attentivement non seulement ce quiest fait, ce qui est réalisé, mais encore les modalités de ce faire, ainsi que ses
316 ALAIN BOVET ET C"DRIC TERZI
13. Cette identité nationale est célébrée avec d’autant plus d’empressement que sa cohésion estrégulièrement envisagée comme problématique, voire menacée (Widmer, 2004).
14. La culture politique suisse procède d’une articulation particulière de pratiques sociales qui, entant que telles, ne sont en rien propres à la Suisse. Notre analyse vise donc à saisir des phéno-mènes politiques généraux, mais par le biais d’études empiriques délimitées.
conséquences. Les extraits que nous avons présentés documentent le travailpar lequel une catastrophe est saisie et apprêtée de manière à apparaîtrecomme un appel à donner de l’argent, action qui est immédiatement appréhen-dée comme la manifestation privilégiée de la solidarité nationale. Cette uniténationale est assurée en référence à un programme d’action sans alternative :la reconstruction, érigée en tant qu’horizon vers lequel sont appelées à conver-ger les actions entreprises par les habitants dont les villages ont été détruits, lesinstitutions publiques, les médias audiovisuels et la population suisse.
Au cœur de cette configuration, la télévision se donne pour tâche de rappelerpubliquement les uns et les autres à leur devoir : elle demande aux victimes demanifester leur désir de reconstruire malgré tout. Elle somme les institutionspubliques de dire qu’il n’est pas envisageable de s’y opposer. Elle donne auxSuisses les moyens de se montrer solidaires et les appelle à le faire.
Ainsi conçue, la reconstruction est érigée comme un bien public et commeun devoir moral, ce qui lui confère la consistance d’un fait social objectif etcontraignant. Elle peut ainsi être analysée comme le produit d’un ordre socialparticulier, mais également comme ce qui maintient et reproduit cet ordresocial. En effet, le travail par lequel la catastrophe est apprêtée de manière à permettre l’exercice d’un appel à don peut être analysé comme l’accomplis-sement d’une forme particulière d’intégration politique, dont la manifestationest portée notamment par les exigences relatives à la reconstruction desvillages de montagne et à l’action humanitaire en faveur des victimes de catas-trophes naturelles.
L’institution de cette forme d’ordre social est portée par des manières habi-tuelles de saisir les catastrophes, de considérer leurs victimes, d’envisager lesactions à mener, de concevoir la manière d’en rendre compte. Les données quenous avons mobilisées nous permettent de rendre compte de la manière dont latélévision suisse contribue à l’institution de cette forme d’ordre social. Enparlant de la « contribution » de la télévision à l’élaboration d’un ordre social,nous entendons souligner que ce que nous invitons à observer n’a rien d’uneconstruction médiatique ou discursive. Le moment de l’appel à dons est parti-culièrement intéressant à ce sujet : l’action de la Chaîne du Bonheur prétendexplicitement incarner la solidarité suisse (ou le caractère solidaire des Suisses).
Les données télévisuelles indiquent que l’appel à dons, cette forme parti-culière d’exercice de la solidarité nationale, s’inscrit sans discontinuité dans leprolongement direct du traitement journalistique de la catastrophe. Cette obser-vation permet de saisir la manière dont l’aide humanitaire est instituée commeun trait de l’identité suisse. Ce n’est pas seulement une manière d’agir. C’est unemanière de se rapporter aux situations, d’y saisir des affordances qui appellentune action humanitaire et offrent les prises nécessaires pour la mener à bien.
D#UNE CATASTROPHE NATURELLE $ UNE R"USSITE HUMANITAIRE 317
Plus précisément encore, c’est une manière de voir dans les catastrophesdes occasions privilégiées de manifester l’intégration identitaire de la Suisse,dont l’advenue, toujours ressentie comme contingente et précaire, est l’occasiond’une célébration rituelle. Ainsi, les opérations que nous avons décrites défi-nissent une perspective depuis laquelle les catastrophes sont moins un malheurqu’une occasion de célébration.
Il est possible, pour conclure, d’indiquer les conséquences de cette manièrede configurer les choses. Dans la mesure où les personnes à aider sont présen-tées comme des victimes de la fatalité, une éventuelle enquête sur les respon-sabilités n’a pas lieu d’être engagée (Fassin, 2010). On s’éloigne ainsi dutraitement politique des problèmes publics, qui selon Gusfield (2009) passenotamment par l’établissement de responsabilités causales – qu’est-ce qui acausé ce problème ? – et politiques – qui doit s’en occuper ?
Il en va de même pour une éventuelle enquête sur la validité et la perti-nence de la reconstruction. C’est notamment ce que montre le caractère soitsimplement absent, soit inaudible, de positions consistant à questionner lareconstruction, voire à lui envisager des alternatives. De fait, une conséquencedu caractère métonymique de la configuration réside dans le fait d’exclure lapossibilité même du pluralisme politique. Faire du programme d’action l’objetd’une discussion, voire d’une critique, reviendrait à se mettre en marge d’unecommunauté dont il se manifeste comme la raison d’être.
Ces conséquences sur la culture politique suisse jettent un éclairage sur lamanière dont l’action humanitaire est pratiquement constituée en tant que méto-nymie de l’identité nationale suisse, dont elle est à la fois le principe et le résul-tat. Pour le dire plus brutalement, l’analyse du traitement des intempéries permetde voir comment une catastrophe devient le lieu privilégié de célébration del’identité nationale. Ce qui permet d’envisager la possibilité de respécifier laglose ironique de Jean-Luc Godard au sujet du drapeau suisse : « Nous avonsfait une croix sur le sang des autres. »
318 ALAIN BOVET ET C"DRIC TERZI
Bibliographie
Dewey J.2010 Le public et ses problèmes, Paris, Gallimard [1927].
Fassin D.2010 La raison humanitaire. Une histoire morale du temps présent, Paris, Gallimard-
Seuil (coll. « Hautes Études »).
Garfinkel H.2007 Recherches en ethnométhodologie, Paris, PUF [1967].
Gusfield J.2009 La culture des problèmes publics. L’alcool au volant : la production d’un ordre
symbolique, Paris, Economica [1981].
Ricœur P.1983 Temps et récit 1. L’intrigue et le récit historique, Paris, Seuil.
Sacks H.1972 « On the analysability of stories by children » in J. J. Gumperz & D. Hymes
(eds.), Directions in Sociolinguistics : The Ethnography of Communication,New York, Rinehart & Winston, p. 325-345.
Searle J. R.1998 La construction de la réalité sociale, Paris, Gallimard.
Widmer J.2004 Langues nationales et identités collectives. L’exemple de la Suisse, Paris,
L’Harmattan.2010 Discours et cognition sociale. Une approche sociologique, Paris, Éditions des
archives contemporaines.
D#UNE CATASTROPHE NATURELLE $ UNE R"USSITE HUMANITAIRE 319