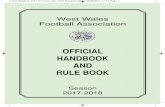« Les hypotyposes de Claude Simon »
-
Upload
univ-rennes1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of « Les hypotyposes de Claude Simon »
LES HYPOTYPOSES DE CLAUDE SIMON
Reixach, le sabre levé, « brandissant cette arme inutile etdérisoire dans un geste héréditaire de statue équestre » puis,sous une rafale de balles, « s’écroulant d’une pièce sur le côtécomme un cavalier de plomb commençant à fondre par les pieds1 », uncheval mort qui se décompose peu à peu et est comme enveloppé parla terre, « à la façon de ces reptiles qui commencent par enduireleurs proies de bave ou de suc gastrique avant de les absorber2 »,un jeune homme s’enfonçant dans une fondrière et « l’affolement,la panique alors, respirant plus vite, regardant par-dessus sonépaule les arbres (c’étaient des pins), les sabres du soleil quitraversaient les feuillages, deux papillons blancs qui sepoursuivaient3 »… Les romans de Simon ne manquent décidément pas detableaux où sont peintes « les choses d’une manière si vive et siénergique » qu’elles sont mises « en quelque sorte sous lesyeux.4 » En analysant, au début de L’Herbe, un exemple prototypiquedans lequel une vieille femme ouvre maladroitement une boîte deberlingots toute piquetée de rouille5, nous étudierons commentSimon s’est approprié cette figure macrostructurale que latradition nomme hypotypose tout en tentant d’esquisser à partir decet exemple une poétique de l’hypotypose simonienne. Pour cela,nous nous demanderons s’il s’inspire de ses prédécesseurs ou si,au contraire, comme pourrait le laisser penser le passage duDiscours de Stockholm où il se réjouit « de voir [s]es écrits […]rangés parmi les instruments d’une action révolutionnaire etdéstabilisatrice6 », il ne chercherait pas à subvertir cettefigure. Ce qui nous amènera alors à nous interroger sur la natureet la signification précises du référent représenté.
1 Claude Simon, La Route des Flandres, coll. « doubles », Ed. de Minuit, Paris,1987, p. 12.2 Claude Simon, La Route des Flandres, coll. « doubles », Ed. de Minuit, Paris,1987, p. 26.3 Claude Simon, Les Géorgiques, Ed. de Minuit, Paris, 1981, p. 423. Pour une
analyse de ce passage : Dällenbach, Claude Simon, coll. « Les Contemporains »,Seuil, Paris, 1988, pp. 100-101.
4 Pierre Fontanier, « hypotypose », Les Figures du discours, Champs, Flammarion,Paris, 1977, p. 390.5 Cf. texte en annexe. Edition de référence : Simon, L’Herbe, coll. double,Editions de Minuit, 2005, pp. 10-11.6 Claude Simon, Discours de Stockholm, Les éditions de Minuit, 1999, p. 11.
1
5
10
15
20
25
30
5
10
UNE HYPOTYPOSE DESCRIPTIVE TRADITIONNELLE ?
Lorsqu’il a recours à l’hypotypose, Claude Simon reprendplusieurs des procédés utilisés par ses devanciers pour actualiserla scène. L’un de ces procédés, mille fois signalés dans lestraités de rhétorique, est l’énallage temporelle : « Remarquez quetous les verbes de cette narration sont au présent : l’onde approche,se brise, etc., c’est ce qui fait l’hypotypose, l’image, la peinture ;il semble que l’action se passe sous vos yeux7 ». Simon ne dérogepas à la tradition puisque lui-aussi se sert du présent : « quidans sa main tient une même boîte » (l. 26). Tout aussitraditionnellement, on peut également relever dans ce texte« [d]es termes introducteurs démonstratifs (embrayeurs) [qui]donnent la présence du vécu aux éléments de l’ensemble et engagentl’action dans la trame du temps.8 » Effectivement, toujours dans lebut d’actualiser, Simon pose le référent comme déjà existant. Pourcela, il plonge son lecteur in medias res en se servant d’une exophoremémorielle. Louise « fait référence à [des] objet[s]extradiscursif[s] […] non physiquement présent[s], présent[s]seulement à la mémoire du locuteur et éventuellement del’allocutaire9 » : « cette odeur de parfum » (l. 4), « ces quatreépingles », « ce flacon d’eau de Cologne » (l. 10).
Toujours dans la droite ligne de ses prédécesseurs, ilmultiplie aussi les procédés de caractérisation. Il accumule deséléments concrets significatifs (« flacon d’eau deCologne » l. 10, « boîte à biscuits » l. 20, « longcordon » l. 34) et les caractérise par des adjectifs et desparticipes (« bon marché » l. 11, « longue […] blanche » l. 22,« piquetée » l. 21, « dépassant » l. 25) ou des comparaisons quielles-mêmes se réfèrent à du concret : « comme on en vend chez lequincaillier » (l. 17-18), « comme dans ces jeux de miroirs sansfin » (l. 28). Conscient, comme Quintilien10, de l’importance desdétails, il en use également en jouant par exemple sur la
7 César Chesneau Dumarsais, Des tropes ou des différents sens, coll. « Critiques »,Flammarion, 1988, p. 134.
8 Henri Morier, « Hypotypose », Dictionnaire de poétique et de rhétorique, PUF, Paris, 4ème
édition, 1989, p. 532.9 Fraser et Joly, repris dans Marek Kesik, La Cataphore, PUF, 1989, p. 23, cité
par Herschberg Pierrot, Stylistique de la prose, coll. « Lettres Sup. », Belin, 2003,pp. 20 et 259.
10 Quintilien, Institution Oratoire, VIII, 3, 66, trad. de Henri Bornecque, LibrairieGarnier, Paris, p. 183 : « Quelquefois c’est par le rapprochement de plusieursdétails que nous peignons la scène que nous voulons représenter ». Ibid. VIII, 3,69, p. 185 : « on dit moins en énonçant l’ensemble que tous les détails. »
2
5
10
15
20
25
30
5
10
quantification ou sur l’accumulation de caractérisants : « quatreépingles » (l. 10), « boîte à biscuits ou à berlingots, en fer,toute piquetée de rouille » (l. 21). Morier justifie cettecaractéristique en expliquant que l’hypotypose « s’attache […] àla description minutieuse des détails, parce qu’elle veut faire vrai,et que c’est le détail qui rend souvent le mensongevraisemblable ; elle pactise alors avec le réalisme.11 »
Claude Simon cherche aussi à rendre sa scène éminemmentvisuelle. Visuelle par le lexique des couleurs : « rose » (l. 5),« rouille » (l. 21) « blanche » (l. 22), « blancs » (l. 29),« bleu pervenche » (l. 31). Visuelle aussi par le registre dupictural : « pose » (l. 23), « image » (l. 27), « uncadre » (l. 30). En cela, il se conforme à la fois à l’étymologiedu mot hypotypose proposée par Dumarsais12 et, encore une fois, àtoute la tradition rhétorique. En effet, pour Cicéron, « exposerles faits brillamment et les placer pour ainsi dire sous lesyeux13 » est la caractéristique première de l’hypotypose.Quintilien, pour sa part, évoque une « figure qui peint l’imagedes choses dont on parle avec des couleurs si vives, qu’on croitles voir de ses propres yeux.14 » Les répétitions, les parenthèseset les digressions, en faisant stagner l’action, en figeant enquelque sorte les événements, contribuent également à transformerla scène en un tableau ou, comme l’écrit Yves Le Bozec, en « uneaccumulation de sketches, comme une suite de clichés fixes.15 »Selon Heinrich Lausberg, ce caractère statique, bien que paradoxalpour une figure qui représente souvent des batailles ou desdéchaînements naturels, serait une composante définitoire del’hypotypose. Ce figement, que l’on pourrait décrire comme la« fixation d’une essence dynamique », « naîtrait de lacontemporanéité des détails et tiendrait au fait que l’œil fixe unensemble d’événements vécus dans leur simultanéité.16 » Cette
11 Henri Morier, « Hypotypose », Dictionnaire de poétique et de rhétorique, PUF, Paris,4ème édition, 1989, p. 528.
12 Dumarsais rattache « hypotypose » au grec hypotypoô, dessiner (Des tropes ou desdifférents sens, coll. « Critiques », Flammarion, 1988, p. 134). Si l’on en croitHenry George Liddell et Robert Scott, ce verbe viendrait, quant à lui, de hypo,« sous », et typos, « figure gravée » (A Greek-English Lexicon, Oxford, ClarendonPress, 1940 [1843]).
13 Cicéron, De Oratore, Livre III, § 202, trad. E. Courbaud, Société d’édition« Les Belles Lettres », Paris, 1930, p. 83.
14 In « hypotypose », L’Encyclopédie Raisonnée des Sciences, des Arts et des Métiers de Diderotet d’Alembert [référence exacte ?]
15 Yves Le Bozec, « L’hypotypose : un essai de définition formelle »,L’Information grammaticale, n°92, 2002, p. 6.
16 Heinrich Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, § 810, t.. II, p. 400, citéet expliqué par Morier « Hypotypose », Dictionnaire de poétique et de rhétorique, PUF,
3
5
10
15
20
25
30
5
10
15
caractéristique des hypotyposes est évidemment en parfaiteadéquation avec tous les procédés d’écriture que Simon utilisepour rompre la linéarité du langage et restituer la simultanéitédu référent : syntagmatisation du paradigmatique, utilisation de"séparateurs faibles", coordination de segments phrastiquesdistants, effets de segmentation floue, emploi du présent del’écriture17, etc.
Moins traditionnellement, Claude Simon, conscient qu’« ils’est produit une cassure, un changement radical dans l’histoirede l’art, […] lorsque des peintres, bientôt suivis par desécrivains, ont cessé de prétendre représenter le monde visiblemais seulement les impressions qu’ils en recevaient18 », multiplieles verbes de perception (« j’ai senti » l. 4, « j’airegardé » l. 9, « cela sentait » l. 11, « cherchant desyeux » l. 39, « que l’on regarde » l. 45, « je pouvaissentir » l. 38, etc.). Cette dernière occurrence montre qu’ « à un"percevoir" Simon substitue un "pouvoir percevoir" qui donne dumonde sensible une représentation infléchie et orientée par deuxfacteurs : cette représentation est d'abord médiatisée par unsujet percevant puisque "pouvoir percevoir" suppose un actant ;elle est également rendue problématique quant aux possibilités etaux conditions de sa réalisation.19 » Cette occurrence révèleaussi que, contrairement à Quintilien, Claude Simon ne limite pasl’hypotyposes à la vue. Il lui arrive ainsi parfois de se référerà l’ouïe. D’ailleurs la description qui nous est proposée esttransmise par la voix : « Ecoute » (l. 33). De plus, une« harmonie imitative soutient l’hypotypose.20 » A l’image du parfumqui se répand dans la pièce, des consonnes constrictives sedisséminent un peu partout dans la phrase : « j’ai senti cetteodeur, ce parfum, exactement comme celui d’une rose desséchée ouplutôt – puisqu’une rose desséchée ne sent rien – celui que l’onimagine qu’elle devrait exhaler » (l. 4 à 6). Par cette dimensionsonore, on se rapproche de l’acception du mot hypotypose selonPeletier, à savoir non pas une figure « qui peint les choses d’unemanière si vive et si énergique qu’elles sont mises en quelque
Paris, 4ème édition, 1989, p. 529.17 Ilias Yocaris, : « Une poétique de l’indétermination : style et syntaxedans La Route des Flandres », Poétique, 146, 2006, pp. 225-230.18 Claude Simon, Discours de Stockholm, Les éditions de Minuit, 1999, p. 26. 19 David Zemmour, Une syntaxe du sensible : Claude Simon et l’écriture de la perception. , coll.« Travaux de stylistique et de linguistique françaises / Bibliothèque desstyles », PUPS, Paris, 2008, p. 167.20 Henri Morier, « Hypotypose », Dictionnaire de poétique et de rhétorique, PUF, Paris,
4ème édition, 1989, p. 528.4
5
10
15
20
25
30
35
5
10
sorte sous les yeux » mais « une figure qui peint les choses d’unemanière si vive et si énergique qu’elles sont mises en quelquesorte sous les oreilles » : « l’expression vive des choses par lesmots : savoir est, les soudaines et hâtives, par mots brefs etlégers : et les pesantes ou de travail, par mots longs ettardifs21. En quoi Virgile est souverain : Comme quand il veutexprimer l’ahan des tireurs d’aviron : il dit par spondées, Adnixitorquent spumas, et caerula verrunt […] Cette Figure se peut dire êtrecelle que les Grecs appellent Hypotypose : combien que Quintilienne l’induise pas bonnement à cela, mais à une représentation deschoses advenues, laquelle les donne à voir quasi mieux qu’àouïr.22 »
Cependant, pas plus qu’on ne le trouve chez Cicéron,Quintilien, Dumarsais ou Fontanier, on ne trouve chez Peletier lesens dominant de cet extrait : l’olfactif. Dans le texte de Simon,de nombreuses lexies correspondent à des objets odorants : « unerose » (l. 5), « eau de Cologne » (l. 10), « le globe de lacouronne de mariée » (l. 40). Le surmarquage sur ce sens passeaussi par des répétitions (« cette odeur, ce parfum » l. 4,« cette odeur » l. 39, « imaginaire parfum » l. 41) et parl’omniprésence du verbe « sentir » : « j’ai senti » (l. 4), « nesent » (l. 6), « sentait » (l. 11), « sentir » (l. 38). Sur lescinquante lignes de l’extrait plus d’une vingtaine se réfèrent,plus ou moins explicitement, à ce sens. Narrativement parlant,l’odeur est l’élément perturbateur qui enclenche la quête du SujetLouise : « elle m’a fait venir dans sa chambre (et c’est lapremière fois que j’ai senti cette odeur […]) » (l. 10). C’estaussi l’élément qui commande le regard : « j’ai regardé satable » (l. 9), « cherchant des yeux le globe » (l. 39). Maissurtout l’olfactif est directement associé à un des Objetsessentiels du schéma actantiel de la narratrice, l’Objet Marie.Marie dont Louise, dans la première page du roman, nous dit tropqu’elle ne lui est rien pour que cela soit vrai : « - Mais elle net’est rien. – Non, dit Louise. Elle ne t’est rien. – Non », « -Alors rien », « Rien » (p. 9).
La présence de ces différents sens permet de comprendrepourquoi Claude Simon s’appuie si souvent dans ses interviews etréflexions critiques sur la citation suivante de Conrad : « Latâche que je m’efforce d’accomplir consiste, par le seul pouvoir
21 Pour Jacques Peletier du Mans, « les mots brefs et légers » sont ceux oùdominent des dactyles, « les mots longs et tardifs » ceux où dominent lesspondées.
22 Jacques Peletier du Mans, Art poétique in Traités de poétique et de rhétorique de laRenaissance, Francis Goyet éd., Le Livre de poche, 1990, pp. 255-256.
5
5
10
15
20
25
30
35
5
des mots écrits, à vous faire entendre, à vous faire sentir, etavant tout à vous faire voir.23 » Elle permet aussi de comprendrepourquoi il s'est intéressé à l'esthétique « délibérémentsensualiste24 » des formalistes russes. Rappelons qu'un ViktorChklovski écrivait que « pour rendre la sensation de la vie, poursentir les objets, pour éprouver que la pierre est de pierre, ilexiste ce que l'on appelle l'art. Le but de l'art, c'est de donnerune sensation de l'objet comme vision et non pas commereconnaissance.25 »
Pour faire entendre, pour faire sentir, pour faire voir,Simon, outre les procédés d’écriture et les isotopies sensoriellesévoqués plus haut, exploite les potentialités de l’énonciation.Puisqu’on accorde plus d’attention aux paroles de quelqu’un quiest proche de nous, qui s’adresse à nous, qui partage avec nousses sentiments les plus intimes ou qui nous impressionne parl’enthousiasme et le talent qu’il déploie, Simon va exploiter un àun tous ces ressorts.
Par le niveau de langue courant (« quelque chose quiserait » l. 8, « fait de » l. 8) et surtout par les comparants quidécrivent un monde rural (« comme on vend chez le quincaillier àl’intention des paysans et des marchands de bestiaux » l. 13), ilcrée un référent banal, prosaïque et proche du lecteur de laFrance des années cinquante. Conformément à Quintilien quiécrivait, en parlant des détails, « Nous les rendrons sensibles,s’ils sont vraisemblables26 », il rend crédible son référent enchoisissant un cadre totalement approprié à la protagoniste qu’estMarie et correspondant aux stéréotypes que le lecteur associe à untel personnage. Les sèmes afférents socialement normés27 que l’ontrouve par exemple dans les lexies « parfum » (l. 4),« rose » (l. 5) et l’isotopie de la virginité qui est omniprésente
23 Par exemple : Claude Simon, « Reflections on the novel : Claude Simon'saddress to the colloquium on the New Novel, New York University, October 1982», The Review of contemporary fiction, t. V, 1, 1985, p. 16 signalé par David Zemmour,Une syntaxe du sensible : Claude Simon et l’écriture de la perception. , coll. « Travaux destylistique et de linguistique françaises / Bibliothèque des styles », PUPS,Paris, 2008, p. 11.
24 Michel Aucouturier, Le Formalisme Russe, coll. « Que sais-je ? », PressesUniversitaires de France, Paris, 1994, p. 63.
25 ? Viktor Chklovski, « L'art comme procédé » in Todorov (réunis, présentés ettraduits par), Théorie de la littérature, Textes des Formalistes russes, coll. Essais, Seuil,2001 [1965], p. 82.
26 Quintilien, Institution Oratoire, VIII, 3, 70, trad. de Henri Bornecque, LibrairieGarnier, Paris, p. 185.
27 François Rastier, Sémantique interprétative, coll. « Formes sémiotiques », PUF,Paris, 1987, p. 44.
6
5
10
15
20
25
30
5
10
15
(« une jeune fille » l. 12, « longue robe blanche » l. 22, « poseraide » l. 23, « pudiques » l. 25) sont ainsi en parfaiteadéquation avec les connotations désuètes du cadre : « boîtes àbiscuits ou à berlingots » (l. 20), « dernier volant » (l. 25),« petits chiens blancs frisés » (l. 29), « rubans aux nœuds d’unbleu pervenche » (l. 30-31), « long cordon enroulé une vingtainede fois autour » (l. 34-35). Cette isotopie du désuet contribue ànous rapprocher de Louise parce qu’en laissant transparaître sonregard gentiment amusé sur Marie, elle fait de nous ses alliés.Proximité, vraisemblance, cohérence, complicité aident le lecteurà visualiser, accepter, comprendre la scène, à se sentir plusconcerné par elle.
Mais Simon obtient surtout ce résultat en nous donnant sanscesse l’impression que Louise s’adresse directement à nous. C’estd’ailleurs sûrement une des raisons pour lesquelles son texten’est pas un récit mais un discours. Pour la même raison, dès laligne 7, il utilise le pronom indéfini « on » (« l’on imagine »),or ce « on » ne correspond ni à Louise ni à son amant mais a uneportée si généralisante que l’on peut s’y sentir associé. Un peuplus loin, alors que le lecteur comprend de moins en moins leréférent décrit et a de plus en plus envie d’interrompre Louisepour émettre des réserves, surgit soudain l’objection qu’il étaitsur le point de prononcer lui-même : « Mais… » (l. 32).L’allocution impérative qui suit : « Non, écoute… » peut dès lorsêtre lue comme une réponse qui ne s’adresse pas qu’à l’amant,réponse que l’on pourrait paraphraser par « cher lecteur, avantd’objecter, écoute jusqu’à la fin et là tu comprendras ».
De plus, utiliser la première personne, le passé composé (quirelie les faits racontés au moment de l’énonciation), desmodalisateurs (« sans doute imaginaire » l. 4, « peut-être aussicraint et haï autrefois » l. 47), des termes évaluatifsaxiologiques (« pudiques et ridicules » l. 25) permet d’obtenirnon pas une scène abstraite et cérébrale mais une scène vécue,imprégnée de sentiments et de subjectivité, une scène où à chaqueligne le lecteur se sent un peu plus en empathie avec lalocutrice. En ayant recours à ces différents procédés, ClaudeSimon contredit certaines des observations d’Yves Le Bozec, àsavoir que les hypotyposes suppriment « du discours touteapparence de médiation du locuteur entre l’objet de la descriptionet l’allocuteur : s’abolira donc tout point de vue issu d’uneinstance organisatrice […] Conformément à l’étymologie del’expression (sub oculos subjectio), il y a neutralisation du sujetparlant au profit de l’objet qui devient alors le seul sujet actifet entraîne conséquemment une passivation du sujet regardant :
7
5
10
15
20
25
30
35
40
"dérobée au monde l’évidence sensible est transférée à la Présenceréelle28" [c’est la parousie]. Cette mise de côté du narrateur n’estpas synonyme de la disparition du locuteur : il peut rester làcomme témoin, tant qu’il n’intervient pas dans la figure ; mieux,sa présence passive accroît l’effet de sidération, en même tempsqu’elle accrédite la scène.29 »
Si l’amant se tait, c’est bien sûr pour ne pas contrarierLouise mais c’est sans doute aussi à cause de cette sidération. Eneffet, toujours selon Yves Le Bozec, l’hypotypose « précipit[e]l’émotion de l’allocuteur, […] indui[t] en lui un effet desidération, qui le met comme bouche-bée, devant une représentationsi forte qu’elle s’impose à lui. […] L’hypotypose est de l’ordrede la stupéfaction, tant dans le discours que dans l’action : elleétonne – au sens classique du terme – et laisse pétrifié.30 » Cetétonnement vient de l’admiration ressentie pour le morceau debravoure que nous avons sous les yeux, de l’admiration pour letalent, la brillance, l’enthousiasme déployés par le créateur maisaussi d’un ébahissement total dû au fait que ce qui n’étaitjusqu’alors que mots semble s’être soudain mué en évidence vive.Autant de mots qui, symptomatiquement, dans l’histoire de larhétorique, ont été associés à l’hypotypose. Lamy, dans sonédition de 1715 de La Rhétorique ou L’Art de parler, compare en effetcette figure à « une espèce d’enthousiasme31 ». Quant aux Grecs, sil’on en croit Morier32, ils appelaient l’hypotypose enargeia,dénomination qui se retrouve encore chez les théoriciens françaisdu XVIe siècle comme par exemple Du Bellay33 et que l’on peuttraduire par évidence. Il suffit de relire Quintilien pour biensaisir la raison de ce vocable et prendre conscience de ladimension conative de cette figure : « Si j’ai à parler d’un homme
28 Marc Fumaroli, L’Age de l’éloquence, Droz, 1980, Albin Michel, Bibliothèque del’Evolution de l’Humanité, 1994, p. 680.
29 Yves Le Bozec, « L’hypotypose : un essai de définition formelle »,L’Information grammaticale, n°92, 2002, p. 5.
30 Yves Le Bozec, « L’hypotypose : un essai de définition formelle »,L’Information grammaticale, n°92, 2002, p. 5.
31 Bernard Lamy, « Hypotypose », La Rhétorique ou l’Art de parler, Livre II, chap. IX,cité par Christine Noille-Clauzade, « La figure de la description dans lathéorie rhétorique classique », Pratiques, n° 109/110, juin 2001, pp. [?].
32 Henri Morier, « Hypotypose », Dictionnaire de poétique et de rhétorique, PUF, Paris,4ème édition, 1989, p. 530.
33 « Eloquence : & dont la vertu gist aux motz propres, usitez, & non aliénesdu commun usaige de parler : aux Methaphores, Alegories, Comparaisons,Similitudes, Energies, & tant d’autres figures, & ornemens, sans les quelz toutoraison, & Poëme sont nuds, manques, & debiles », Joachim Du Bellay, La Deffence, etillustration de la langue françoyse, livre premier, chap. V, [35], [36], in Œuvres complètes,Champion, Paris, 2003, p. 27.
8
5
10
15
20
25
5
10
15
qui a été assassiné, ne pourrai-je point me figurer tout ce qui adû se passer en cette occasion ? Ne verrai-je point l’assassinattaquer un homme à l’improviste ? lui mettre le poignard sous lagorge ? Et celui-ci, saisi de frayeur, crier, supplier, faire devains efforts pour se défendre, et enfin tomber percé de coups ?Ne verrai-je point son sang qui coule, la pâleur qui recouvre sonvisage, ses yeux qui s’éteignent, sa bouche qui s’ouvre pourrendre son dernier soupir ? C’est à cela que servira l’évidence, quine semble pas tant dire une chose que la montrer : d’où naîtrontles sentiments dans notre âme […]34 » Par cette ruse énonciative,le lecteur est amené à écouter avec attention le discours deLouise, à se sentir concerné, associé, ce qui fait que sareconstruction mentale du référent en devient plus vive et plusfrappante.
Le relief de cette reconstruction mentale doit aussi beaucoupau fait que, en insérant dans son texte de temps à autres descommentaires sous forme d’incidente (« puisqu’une rose desséchéene sent rien » l. 6), en jouant sur la paraphrase, sur lespolysyndètes (« et c’est la première fois que […] et j’ai regardésa table […] et pourtant cela sentait […] et alors elle afouillé » l. 3 à 15), en additionnant des épanorthoses (« ouplutôt […] celui que l’on imagine » l. 7, « ou plutôt letombeau » l. 12), Claude Simon édifie sa scène par additions defragments, par éléments épars, par petites touches qui,cognitivement, contribuent à ce que le lecteur construise lui-même, peu à peu, le référent, un référent qu’il s’approprierad’autant plus aisément qu’il a participé à son élaboration. Pourle dire autrement, le « signifié [ainsi que le conseillaitQuintilien35] n’est indiqué […] que par des lexies véhiculant, parrapport à l’objet à dénoter, des valeurs sémantiques parcellaires,fragmentaires, et singulièrement sensibles. L’hypotypose ainsidéfinie consiste donc à ne pas dire de quoi l’on parle, et à neprésenter du sujet que des éléments épars, fortement pittoresques.[…] [U]n blanc est laissé dans le discours, qui est entouré dedonnées concrètes très vives, et qui autorise une interprétationautomatique et inconsciente, par les lecteurs ou les auditeurs,selon l’isotopie d’un sens dont le dénoté essentiel n’est pourtant
34 Cité par Molinié in Dictionnaire de rhétorique et de poétique, « La Pochotèque », Lelivre de poche, 1999, p. 166.
35 « [E]lle consiste généralement non pas à indiquer qu’un fait s’est passé,mais à montrer comment il s’est passé, et cela non pas dans les grandes lignes,mais dans le détail », Quintilien, Institution Oratoire, IX, 2, 40, trad. de HenriBornecque, Librairie Garnier, Paris, p. 291.
9
5
10
15
20
25
30
35
5
pas précisé.36 » On retrouve une nouvelle fois l’influence deChklovski. Pour ce dernier, « [l]e but de l'image n'est pas derendre plus proche de notre compréhension la signification qu'elleporte, mais de créer une perception particulière de l'objet, decréer sa vision et non pas sa reconnaissance.37» L'hypotyposerelève de ce qu’il a nommé « la singularisation. » Ce procédé «chez L. Tolstoï consiste en ce qu'il n'appelle pas l'objet par sonnom, mais le décrit comme s'il le voyait pour la première fois ;de plus, il emploie dans la description de l'objet, non pas lesnoms généralement donnés à ses parties mais d'autres motsempruntés à la description des parties correspondantes dansd'autres objets.38 » La singularisation étant, comme le rappelleencore Chklovski, « la base et l'unique sens de toutes lesdevinettes39», elle amène le lecteur à remettre en cause sesautomatismes perceptifs, à en quelque sorte chercher la solutionde l’énigme à laquelle il se trouve confronté. Ce mécanismeinconscient est amplifié par la mise en avant de détails quisemblent à première lecture hétéroclites et sans signification, etpar le fait que la situation semble mystérieuse voirecontradictoire : « je pouvais sentir cette odeur […] mais il n’yavait rien » (l. 38-40). Devant tant d’incohérences, tantd’énigmes, tant de trous, le lecteur, en quête d’unité et de sens,comble avec son propre imaginaire les blancs narratifs et, par làmême, crée un référent personnel, construit son propre monde,actualise la scène.
En reprenant la plupart des procédés traditionnelsd’actualisation et de caractérisation et, surtout, en jouant surla vue, l’ouïe, l’odorat et les différentes potentialités del’énonciation, Simon réussit donc à créer une hypotyposeparticulièrement évocatrice. Pourtant, limiter à ces quelquescaractéristiques la spécificité de l’hypotypose simonienne seraitplus que réducteur et cela d’autant plus que Simon semble en faitsubvertir cette figure en s’en prenant à son essence même.
UNE HYPOTYPOSE SUBVERTIE
36 Jean Mazaleyrat et Georges Molinié, Vocabulaire de la stylistique, PUF, Paris, 1989,pp. 171-172.37 ? Viktor Chklovski, « L'art comme procédé » in Todorov (réunis, présentés ettraduits par), Théorie de la littérature, Textes des Formalistes russes, coll. Essais, Seuil,2001 [1965], p. 89.38 ? Ibid., p. 83.39 ? Ibid., pp. 91-92.
10
5
10
15
20
25
30
35
5
Alors que selon les Anciens l’hypotypose cherche à placer lesfaits sous les yeux (« sub oculos jacere »), Simon les place« sous nos nez ». Alors que Quintilien « subordonne [l’hypotypose]à l’évidence » et que Celse lui donne même le nom d’euidentia40,Simon ne cesse de répéter que rien dans le référent n’est clair etque Louise est incapable de voir quoi que ce soit : « j’ai regardésa table, sa coiffeuse, mais il n’y avait rien » (l. 9),« cherchant des yeux le globe, la couronne de mariée, cherchant,mais il n’y avait rien » (l. 40). Alors que normalementl’hypotypose sert à représenter une scène de la manière la plusévocatrice possible, Simon semble au contraire prendre un malinplaisir à nous répéter qu’il est dans l’incapacité de décrirecorrectement ce que Louise perçoit.
En effet, non seulement son texte contient de nombreux termesindéfinis (le pronom « quelque chose » l. 7, le démonstratif« cela » l. 11) qui déjà, en soi, empêchent une reconstitutionprécise du référent mais il utilise à plusieurs reprises la valeurmodale du conditionnel qui remet totalement en causel’actualisation du procès : « devrait exhaler » (l. 7), « quiserait » (l. 8), « aurait conservé » (l. 14). De même, on peutinterpréter la récurrence des comparaisons comme une preuve que lenarrateur n’arrive pas à trouver les mots justes pour décrire leréférent : « comme celui d’une rose desséchée » (l. 5), « commeune fleur, comme une jeune fille, comme peut sentir lachambre » (l. 11-12). Dans ce dernier exemple, l’accumulationamplifie le constat d’échec. La locutrice tente de décrire au plusprès le réel mais aucune des comparaisons qui surgissent dans sonesprit ne la satisfait. C’est sans doute pour la même raison queles négations abondent : « il n’y avait rien que ces quatreépingles » (l. 10), « non pas un coffret à bijoux ni même un deces coffrets d’acier » (l. 17).
Simon nous amène ainsi peu à peu à nous rendre à l’évidence :les caractérisations proposées ne suffisent pas à décrire leréférent. Pour réussir à restituer une image fidèle de la scènequ’elle a vécue, pour réussir à discerner ce qu’elle ne voit pas,la narratrice, insatisfaite, est donc obligée de se remettre àl’ouvrage, encore et encore ; d’où, dans ce texte, toutes lesformes possibles et imaginables de répétition : des figuresdérivatives (« celui que l’on imagine » l. 7, « imaginaire »l. 41), des polyptotes (« senti » l. 4, « sent » l. 6,« sentir » l. 12), une anadiplose (« mais il n’y avait rien. Rien
40 Quintilien, Institution Oratoire, IX, 2, 40, trad. de Henri Bornecque, LibrairieGarnier, Paris, p. 291.
11
5
10
15
20
25
30
35
40
5
que » l. 40), etc. D’où les mêmes syntagmes nominaux constammentréitérés : « une rose desséchée (…) une rose desséchée » (l. 5-6) ; « comme une jeune fille » (l. 12), « sentir cetteodeur » (l. 39), « cette odeur de jeune fille, de fleur » (l. 39).D’où aussi la reprise de certains syntagmes verbaux : « il n’yavait rien » (l. 9), « mais il n’y avait rien.» (l. 40). Dans cetextrait, la répétition est en fait structurelle. En effet, auxdeux extrémités du texte, l’on retrouve le même schéma :odeur (l. 3-8), recherche de la provenance de cette odeur (l. 9-10), tentative de caractérisation de l’odeur (l. 11-15) /odeur (l. 38-39), recherche de la provenance de cetteodeur (l. 39-40), tentative de caractérisation de l’odeur (l. 40-42). Ces répétitions sont la manifestation de l’insatisfactionprofonde de Louise. Elles révèlent une sorte de ressassementobsessionnel, une prise de conscience que la simple perceptionsensorielle du référent n’est pas satisfaisante, qu’il faut allerplus loin.
En fait, au-delà des quelques entorses à la tradition relevéesplus haut, la réalité décrite est avant tout remise en cause parl’utilisation de caractérisants mutuellement incompatibles. Lavision unitaire et cohérente du moment vécu est comme torpillée del’intérieur. Outre le paradoxe « intacte quoique prête àtomber » (l. 14) et les multiples connecteurs argumentatifsd’opposition, « mais il n’y avait rien » (l. 9), « etpourtant » (l. 11), « mais une boîte à biscuits » (l. 20), on peutrepérer un peu partout des enchaînements d’adjectifs et desubstantifs antithétiques, voire oxymoriques : « langoureuse etraide » (l. 22), « poussière et fraîcheur » (l. 8), « parfum defraîcheur (…) et de temps accumulé » (l. 42). Les oppositionsparaissent même parfois si fondamentales qu’elles deviennentcontradictions : « il n’y avait rien (…) et pourtant celasentait » (l. 11). On retrouve aussi ces oppositions au niveauconnotatif. En effet, certaines lexies sont fortement péjoratives(« desséchée » l. 5, « bon marché » l. 11, « ridicules » l. 25,« maladroites et raide » l. 37) alors que d’autres, au contraire,semblent mélioratives : « cadres de fleurs » (l. 30),« fraîcheur » (l. 42), « vieux compagnon de route » (l. 46),« sourire » ( l. 50).
Par ce biais, se dessinent peu à peu dans le texte des couplesd’isotopies antinomiques. Le couple amitié/inimitié : « cet ennemihéréditaire » (l. 44), / « un vieux compagnon de routefamilier » (l. 47). Le couple culture/ nature :« coiffeuse » (l. 9), « flacon d’eau de Cologne » (l. 10), « le
12
5
10
15
20
25
30
35
40
sarcophage » (l. 13), « le dernier volant, pudiques etridicules » (l. 25) / « rose » (l. 5), « comme unefleur » (l. 11), « poussière » (l. 14). A noter que la culture esten général plutôt associée à la vieillesse et aux termespéjoratifs alors que la nature, elle, semble plutôt corrélée à lajeunesse et aux termes mélioratifs. On peut aussi détecter lecouple peur/sérénité : « terrifié » (l. 45),« impitoyable » (l. 46), « craint et haï » (l. 47), « craintes etdes terreurs » (l. 50) / « couché près d’elle […] un de ces petitschiens blancs et frisés » (l. 26-29), « un sourire » (l. 50).Autre binôme fortement représenté, le binôme vieillesse/jeunesse,binôme remettant d’autant plus en cause le référent décrit que lajuvénilité est attribuée non pas à Louise mais à Marie, la vieillefemme : « ces mains maladroites et raides, essayant de l’ouvrir –et toujours je pouvais sentir cette odeur de jeune fille » (l. 37-39). En fait, derrière toutes ces oppositions, se cache, enstructure profonde, une autre, beaucoup plus fondamentale, quisous-tend l’ensemble, l’opposition mort/vie : «poussière » (l. 8), « desséchée » (l. 5), « tombeau » (l. 13)/« fraîcheur » ( l. 8), « jeune fille » (l. 12).
Par ces caractérisations contradictoires qui font perdre à lascène décrite sa cohérence, l’hypotypose se retrouve donc minée ;en même temps, Louise est ainsi amenée à prendre conscience que,puisque sa perception du référent est insatisfaisante, elle doitcontinuer à affiner sa recherche. C’est aussi cette insatisfactionqui explique que, contrairement à la tradition, Louise n’est pasun narrateur qui s’efface et se laisse oublier. Les marqueurs desubjectivité, les modalisateurs, les termes axiologiques prouventque loin d’être une spectatrice inactive, elle cherche àcomprendre, elle analyse. Là encore, il y a subversion del’hypotypose. En effet, selon Yves Le Bozec, normalement cettefigure, au contraire, « séduit à en perdre la raison41 ». Iljustifie cette remarque en s’appuyant sur le pseudo-Longin :« comme en toutes choses on s’arrête naturellement à ce qui brilleet éclate davantage, l’esprit de l’auditeur est aisément entraînépar cette image qu’on lui présente au milieu d’un raisonnement ;et qui lui frappant l’imagination, l’empêche d’examiner de si prèsla force des preuves à cause de ce grand éclat dont elle couvre etenvironne le discours.42 » Or, chez Simon, c’est exactement le
41 Yves Le Bozec, « L’hypotypose : un essai de définition formelle »,L’Information grammaticale, n°92, 2002, p. 5.
42 (pseudo-) Longin, Traité du sublime, trad. de N. Boileau, F. Goyet éd., Le Livrede Poche, LGF, 1995, p. 97, cité par Yves Le Bozec, « L’hypotypose : un essai
13
5
10
15
20
25
30
35
40
5
contraire qui se passe : l’hypotypose au lieu de neutraliser laraison la met en éveil et l’amène même souvent à œuvrer plus quejamais. Cela explique pourquoi on peut repérer dans le texte demultiples verbes de quête : « dérouler » (l. 36)« cherchant » (l. 39), « cherchant » (l. 40), « elle afouillé » (l. 15), « essayant de l’ouvrir » (l. 38). Cela expliqueaussi pourquoi, insensiblement mais sûrement, Louise, qui déjàdans l’incipit pressentait la présence d’une réalité plus profondepuisqu’elle « regard[ait] devant elle quelque chose que [sonamant] ne pouvait voir » (p. 9), approche sans cesse davantage dece « quelque chose ». De multiples indices le prouvent. Enutilisant une série de reformulations et d’épanorthoses, ellecaractérise avec de plus en plus de précision le référent :« cette odeur, ce parfum » (l. 4), « la chambre, ou plutôt letombeau, le sarcophage » (l. 13). Les comparants, au fur et àmesure du texte, sont de plus en plus longs, de plus en plusprécis : « comme une fleur, comme une jeune fille, comme peutsentir la chambre ou plutôt… » (l. 14). De même, la longueur descaractérisants de l’odeur ne cesse de croître passant de 4,5lignes (« j’ai senti cette odeur (…) de poussière et defraîcheur » l. 4 à 8) à une dizaine de lignes : « Rien que cetentêtant et sans doute imaginaire (…) sourire » (l. 41 à 50).
Plusieurs gradations révèlent ces progrès. Louise pénètre deplus en plus dans l’intériorité de Marie : « dans sachambre » (l. 3), « dans un tiroir » (l. 16), « sous le derniervolant » (l. 25). Elle analyse de plus en plus finement : par unlong mouvement de zoom, son regard glisse du très grand au trèspetit, du visible à l’invisible (« sa chambre » l. 3, « untiroir » l. 16, « une boîte à biscuits » l. 20, « unefemme » l. 21, « une boîte » l. 26, « le couvercle » l. 27, « lamême image » l. 27). Par l’entremise de Louise, nous passonsgraduellement du monde physique au monde idéel. Au début du texte,l’odeur est ramenée à des objets concrets spécifiques : « rosedesséchée » (l. 5), « coiffeuse » (l. 9), « épingles » (l. 10),« eau de Cologne » (l. 10). Elle est ensuite comparée à des termesconcrets génériques : « comme une fleur, comme une jeunefille » (l. 11-12). Un concret qui devient de plus en plusinsaisissable : « prête à tomber en poussière au moindresouffle » (l. 15). A la fin du texte, l’odeur est cette foiscaractérisée par des abstractions sans cesse plus immatérielles :« imaginaire parfum de fraîcheur, de virginité et de tempsaccumulé » (l. 41-42). Dans un mouvement parallèle, nous glissonsde définition formelle », L’Information grammaticale, n°92, 2002, p. 5.
14
5
10
15
20
25
30
35
40
aussi d’un monde en trois dimensions (la chambre, les objets) à unmonde en deux dimensions (l’image de la boîte) pour nous retrouverdans la dernière partie du texte dans un univers purementconceptuel : « parfum (…) de temps accumulé » (l. 42).
Les répétitions, les figures d’opposition, la gradation duconcret à l’abstrait dynamitent donc complètement l’hypotypose.Ces « subversions » sont une invitation à chercher, au-delà desqualités sensorielles des phénomènes particuliers perçus,l’invariant de ces phénomènes, leur essence. Si le texte passe duconcret à l’abstrait, c’est parce que, contrairement à sesprédécesseurs qui cherchaient à retranscrire avec le plus devivacité possible la réalité empirique, Simon cherche à atteindre,au-delà de cette réalité, « une réalité plus réelle que leréel43 », la réalité ultime, ce qu’Husserl appelle l’eidos : ceteidos devrait permettre à Louise, si elle le trouve, de donner unsens à l’omniprésence des répétitions dans son environnement et dedépasser les oppositions relevées.
UNE HYPOTYPOSE RHÉTORIQUE
Le surmarquage de la boîte à berlingots est l’interprétant44
qui met sur la voie de cet eidos. Ce surmarquage est d’autant plusune perche tendue par Claude Simon pour aider le lecteur àdécouvrir dans le référent d’autres mises en abyme fictionnelles,métatextuelles et transcendantales45 que celles représentées sur lecouvercle qu’il est lui-même redoublé par une comparaisonexplicite : « comme dans ces jeux de miroir sans fin » (l. 28)46.Les similitudes lexicales et référentielles entre d’une part la43 Simon, La Route des Flandres, coll. « doubles », Ed. de Minuit, Paris, 1987, p.123.44 François Rastier, Sémantique interprétative, coll. « Formes sémiotiques », PUF, 1987,Paris, p. 274.45 Dällenbach, dans Le récit spéculaire, Essai sur la mise en abyme (coll. Poétique, Seuil,Paris, 1977), distingue cinq types de mise en abyme élémentaires (p. 141) : 1)la mise en abyme fictionnelle (« dédoublant le récit dans sa dimensionréférentielle d’histoire racontée », p. 123 ), 2) énonciative ( caractérisée par« la « présentification » diégétique du producteur ou du récepteur du récit,[…] la mise en évidence de la production ou de la réception comme telles,[…] lamanifestation du contexte qui conditionne (qui a conditionné) cette production-réception », p. 100), 3) textuelle (« réfléchissant [le récit] sous son aspectlittéral d’organisation signifiante », p. 123), 4) métatextuelle (mettant enabyme le code, opérant à la façon d’un mode d’emploi du texte, pp. 128,130), 5)transcendantale (réflexion qui dévoile « un signifié dernier en avant ou enarrière du récit », p. 131).
15
5
10
15
20
25
30
5
10
15
chambre et d’autre part le décor de la boîte associent déjà en soiMarie et la jeune femme en blanc : « cette odeur de […]fleur » (l. 39), « un long cordon » (l. 34) / « dans un cadre defleurs et de rubans aux nœuds d’un bleu pervenche » (l. 30-31). Sil’on ajoute à cela le fait que ces deux femmes ont une attitudephysique assez similaire (la femme représentée est« allongée » (l. 22) comme le sera Marie sur son lit pendant lesdix jours de l’agonie) et surtout que le même adjectif est utilisépour les caractériser (« mains maladroites et raides » l. 37 /« une pose à la fois langoureuse et raide » l. 23), l’on en arriveà l’hypothèse que la jeune femme sur la boîte, mise en abyme parune femme similaire, pourrait bien elle-même être une mise enabyme de Marie. S’il était besoin d’argumenter, on pourrait encoreajouter que toutes deux tiennent une boîte (« serrant ensuite laboîte contre elle tandis qu’elle s’escrimait avec ces mainsmaladroites » l. 37)/ « dans sa main tient une boîte » l. 26) etqu’elles sont l’une et l’autre associées à la même isotopie,l’isotopie de la virginité : « cette odeur de jeunefille » (l. 38), « parfum de fraîcheur, de virginité » (l. 42) /« longue robe blanche » (l. 22), « raide, avec juste la pointe despieds […] dépassant sous le dernier volant, pudiques » (l. 23-25)
Cependant une mise en abyme peut en cacher une autre et lasimilitude entre le décor de la boîte et le cadre associé tout aulong du roman à la narratrice peuvent nous amener à nous demandersi la jeune femme du couvercle ne serait pas aussi une mise enabyme de Louise. Toutes deux sont effectivement associées à lanature : « sur l’herbe » (l. 23), « un cadre de fleurs » (l. 30).Toutes deux sont constamment accompagnées d’un animal domestiquefamilier : un chat pour Louise et un caniche (l. 29) pour lafemme. Là encore, la pose « à demi allongée sur l’herbe » (l. 23)est révélatrice. N’annonce-t-elle pas la scène finale du roman oùLouise s’étendra sur l’herbe avec son amant ? Et cela d’autantplus que finalement, malgré la virginité affichée, de nombreusesconnotations sensuelles sont actualisées : « jeune femme vêtued’une longue robe blanche, à demi allongée sur l’herbe dans unepose […] langoureuse » (l. 21-23), « dépassant sous le derniervolant » (l. 25).
Mais si, par le jeu de la mise en abyme, Marie est un doublede la jeune fille sur la boîte et si cette dernière est également
46 Dällenbach écrit : « L’usage de la plupart des critiques témoigne suffisammentdu caractère interchangeable de la mise en abyme et du miroir pour qu’il soitpermis de les confondre et de baptiser récit spéculaire tout texte recourant à notreprocédé » in Le récit spéculaire, Essai sur la mise en abyme, coll. Poétique, Seuil, Paris,1977, p. 51.
16
5
10
15
20
25
30
35
5
un double de Louise, celle-ci, par transitivité, devient alors, àson tour, la mise en abyme de Marie. Le jeu des pronoms et desdéterminants rapproche effectivement sans cesse les deux femmes :« elle m’ » (l. 2), « elle m’ » (l. 3), « j’ai regardésa » (l. 9). L’aposiopèse et la réplique « Mais… / - Non, écoute» (l. 31) n’est-elle pas aussi une façon de signifier quel’ingénieur est de trop, qu’il n’a pas sa place dans cettehistoire, que la véritable relation n’est pas celle entre Louiseet son amant, mais entre Louise et Marie ? La transmission de labague puis, plus tard dans le roman, la transmission des carnetsde compte prennent alors un sens allégorique. Marie mourant,Louise prend sa place dans le grand cycle des mises en abyme. Onvoit donc que, comme le suggérait déjà la structure du passage,les répétitions observées ci-dessus ne sont pas un simple élémentde surface, elles sont architectoniques, elles sont un écho de lamise en abyme décrite dans le texte : la jeune fille représentéesur la boîte est « répétée » plusieurs fois dans l’image maiscette jeune fille est aussi et avant tout une « répétition » despersonnages féminins évoqués dans ce passage. Quant aux antithèsesrelevées précédemment, elles prennent également sens. On peut lesexpliquer par le fait que la mise en abyme est double. La pose dela femme en blanc est « langoureuse et raide » (l. 23) parcequ’elle décrit à la fois Marie, la vieille femme « raide », etLouise, la jeune femme « langoureuse ». Le parfum évoque« poussière et fraîcheur » (l. 8) parce qu’il décrit l’odeur de lavieille femme qui est sur le point de mourir, mais aussi parce quecette femme va continuer à vivre grâce à Louise qui, elle, estdans la fleur de l’âge.
Mais alors en quoi Simon renouvelle-t-il la figure del’hypotypose ? Et quel est l’eidos de cette scène ? Si le textepasse, comme nous l’avons vu, du concret à l’abstrait, c’est parceque contrairement à ses prédécesseurs qui avaient principalementrecours aux hypotyposes descriptives, Simon nous propose ce queBernard Dupriez appelle une hypotypose rhétorique, c’est-à-direune hypotypose « où l’action est un artifice de représentation del’idée47 » : l’idée ainsi représentée est bien sûr ici l’eidos qu’ilnous reste maintenant à découvrir. Pour nous amener à cet eidos,Simon se sert de ce que Kant appelle dans la Critique de la faculté dejuger48 des hypotyposes symboliques. Deleuze, en grand pédagogue,
47 Bernard Dupriez, « Hypotypose », Gradus, Les procédés littéraires, coll. 10/18,1984, p. 240, Rem. 1.
48 Emmanuel Kant, Critique de la Faculté de juger, Paris, Vrin, 1982, première partie,Livre II, § 59, p. 174 : « Toutes les intuitions, que l’on soumet à des concepts
17
5
10
15
20
25
30
35
40
5
explique ce concept kantien en prenant l’exemple d’un lion :« Kant nous dit ceci : […] il y a deux manières "d’exposer" unconcept. Lui-même il a un mot merveilleux qui est "hypotypose".Une exposition c’est une hypotypose […]. Vous pouvez exposer unconcept en fournissant l’intuition qui lui correspond directementquant au contenu […] Ca veut dire quoi, ça ? Ca veut dire unechose très simple. Vous dites le mot lion et quelqu’un vous dit"qu’est-ce que tu dis, là, lion c’est quoi ? " et je fais un signeet on pousse dans la salle un lion. […] J’ai fourni une intuitionqui correspond directement au concept. » Cette intuition, ce lionqui est dans la salle et qui correspond directement quant aucontenu au concept de lion, Kant l’appelle « hypotyposeschématique ». Deleuze poursuit : « Par exemple, je ne vois pas,je suis là tranquille, et puis quelque chose traverse le mur et[…] raie l’espace, et j’ai l’impression confuse que c’est unepatte griffue qui s’abat sur moi. Mais tout en dynamisme, je nepeux même pas dire : c’est une patte, c’est pas un… quelque chose.[…] C’est un geste de lion. Lion c’est la meilleure forme, ou laseule forme sous laquelle ce geste puisse être effectué. Mais ceque je vise, c’est l’acte pur. Un pas de lion, une allure delion49 ». Comme le montre cet exemple, le geste du lion, l’acte purdu lion, le concept analysé, ne peuvent être exposés directementpar une intuition sensible, ils ne peuvent être pensés que par laraison. L’hypotypose présentée par Deleuze est donc non passchématique mais symbolique.
Etant donné que Louise semble regarder au-delà des apparencesdu réel, il est tentant de lire l’extrait que nous étudions nonpas comme une simple représentation de la réalité empirique maiscomme une représentation de concepts qu’on ne peut exposerdirectement par une intuition sensible, autrement dit, comme uncondensé d’hypotyposes symboliques. Or, comme nous venons de ledécouvrir, l’une des hypotyposes symboliques qui semble assezrapidement se dégager est la succession : la succession des femmessur la boîte, la succession Marie/Louise, la succession mort/vie,succession que l’on retrouve aussi dans les répétitions, dans lescouples « poussière/fraîcheur », « desséchée/rose »,« raide/langoureuse », « boîte rouillée/jeune femme »,a priori, sont donc ou bien des schèmes,ou bien des symboles, et de ces intuitionsles premières contiennent des représentations directes du concept, tandis queles secondes en contiennent d’indirectes. Les schèmes effectuent < laprésentation> démonstrativement ; les symboles le font par la médiation d’uneanalogie (pour laquelle on se sert aussi d’intuitions empiriques)[…] »
49 Gilles Deleuze – Cinéma, cours 32 du 22/02/83,http://www.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=212.
18
5
10
15
20
25
30
35
5
10
« tombeau/jeune fille ». En faisant de Louise un maillon dans unechaîne de mises en abyme qui se prolonge à l’infini, en nousamenant à voir derrière la mise en abyme fictionnelle (les femmessur la boîte réfléchissent Louise et Marie) une mise en abymemétatextuelle (la succession des femmes sur la boîte permet decomprendre que Louise est appelée à succéder à Marie), Simon nousconduit insidieusement à poursuivre notre démarche herméneutiqueet à interpréter la succession des boîtes comme une mise en abymetranscendantale50, mise en abyme qui met en lumière une deuxièmehypotypose symbolique : le mouvement cyclique. La transmission dela bague est bien sûr une autre manifestation de ce caractèrecyclique, et cela d’ailleurs d’autant plus que le sémème de« bague » contient entre autres le sème /circularité/ : « elle m’adonné cette bague » (l. 2). Mais de nombreuses autres hypotyposessymboliques sont présentes dans ce texte : la répétition,l’infini, l’éternel, etc. Ces hypotyposes sont toutes desvariantes de l’eidos que recherche Louise.
Celle-ci a en effet dans son approche du réel une attitudecomplètement phénoménologique. Dans la chambre de Marie, elleanalyse des « phénomènes », ce qui apparaît dans l’expérience,mais elle ne prend pas naïvement ce que lui offre le monde, ellesait que le monde dépasse la simple conscience qu’elle en a. Pouraller au-delà de la vision empirique et atteindre la réalitéultime, l’essence des choses, l’eidos, elle utilise une démarcherigoureuse qu’Husserl a nommé la variation éidétique51. C’est-à-dire qu’elle fait varier par l’imagination les points de vue surla réalité observée et essaye de faire sortir l’invariant desdifférentes variantes imaginées. Si par exemple, elle avaitcherché l’eidos du concept de couleur, elle aurait imaginé une à unetoutes les nuances de l’arc-en-ciel et aurait tenté de trouver lepoint commun à toutes ces nuances. Par cette méthode, elle enserait alors arrivée à la conclusion que cet invariant était
50 Cf. note 44.51 Jean-François Lyotard, La Phénoménologie, « Que sais-je ? », Puf, Paris
[1954], 2007, p. 12-13 : « Quand nous disons « le mur est jaune », impliquons-nous des essences dans ce jugement ? Et par exemple la couleur peut-elle êtresaisie indépendamment de la surface sur laquelle elle est « étalée » ? Non,puisque une couleur séparée de l’espace où elle se donne serait impensable. Carsi, en faisant « varier » par l’imagination l’objet couleur, nous lui retironsson prédicat « étendue », nous supprimons la possibilité de l’objet couleur lui-même, nous arrivons à une conscience d’impossibilité. Celle-ci révèle l’essence. Il y adonc dans les jugements des limites à notre fantaisie, qui nous sont fixées parles choses mêmes dont il y a jugement, et que la Phantasia elle-même décèlegrâce au procédé de la variation. Le procédé de la variation imaginaire nous donnel’essence elle-même, l’être de l’Objet. »
19
5
10
15
20
25
30
5
10
15
l’étendue. Chacune des hypotyposes symboliques que nous avonsdétectées dans le texte de Simon doit donc être analysée comme unevariante de la réalité perçue. La somme de tous les points de vuesuccessifs de Louise, la confrontation de toutes les variantes,doit amener à découvrir l’invariant. Or l’invariant de lasuccessivité, du cyclique, de la répétition, de l’infini, del’éternel est, comme Louise finit par le comprendre à la fin dutexte, le Temps : « rien que cet entêtant et sans doute imaginaireparfum de fraîcheur, de virginité et de temps » (l. 42). A noterque le schéma structurel observé précédemment révélait déjà ceteidos. Lors de la première occurrence, la triade odeur/provenance decette odeur/ tentative de caractérisation de l’odeur était suiviepar un quatrième élément : la description de la boîte deberlingots. Lorsque, en fin de texte, la structure est répétée, lequatrième élément est cette fois non plus la boîte mais le Temps.Autrement dit, structurellement parlant, la boîte de berlingotsest associée au Temps. Elle le sera également plus loin dans leroman quand elle sera réfléchie, ainsi que l’a noté Dällenbach52,par une horloge ayant de nombreux sèmes communs avec elle(« l’idée d’un circuit fermé sur lui-même et inlassablementreparcouru […] supportant une bergère à houlette revêtue d’uneample robe de métal doré et se tenant assise, ou plutôt demi-couchée, gracieusement appuyée sur le boîtier renfermant […]53 »)et surtout quand l’on découvrira qu’elle contient des carnets decompte qui sont caractérisés comme « en quelque sorte le tempslui-même » (p. 85). Cette boîte qui par étapes nous conduit au« temps lui-même » est donc une mise en abyme métatextuelle dutexte qui, d’abord perçu comme hypotypose descriptive, s’estrévélé hypotypose rhétorique puis hypotypose symbolique puis eidosdu Temps. On comprend maintenant pourquoi cette boîte était sisurmarquée.
L’eidos, puisqu’il concerne l’essence, l’invariant, a unedimension universelle. L’Herbe ne saurait donc se limiter à lapetite histoire de Louise et de Marie. Son véritable sujet estl’Homme en général. Le passage du concret à l’abstrait mais aussiles pronoms et les déterminants le confirment. Au début du texte,le « nous » (l. 1) se réfère à Georges et Louise. A la fin dutexte, « on » (l. 45), « nos » (l. 49), « nous » (l. 50) ont uneportée beaucoup plus générale. Les jeux sur l’énonciation observésdans la première partie et tout particulièrement la modalitéinjonctive « Non, écoute » (l. 32) ne servent donc pas seulement à
52 Dällenbach, Le récit spéculaire, Essai sur la mise en abyme, coll. Poétique, Seuil, Paris, 1977, p. 173.
53 Claude Simon, L’Herbe, coll. double, Editions de Minuit, 2005, p. 65.20
5
10
15
20
25
30
35
40
5
rendre l’hypotypose plus évocatrice, plus vivante, ce sont desinvitations pour le lecteur à chercher dans le roman non pasl’histoire d’une femme qui s’appelle Louise mais bel et bien notreHistoire à tous.
Les figures d’opposition doivent aussi être relues à lalumière de cette interprétation. Alors qu’elles étaient source decontradiction et d’incohérence lorsque l’on ne s’en tenait qu’auniveau sensoriel et empirique, elles deviennent, en revanche, auniveau de l’eidos, parfaitement cohérentes et compréhensibles. Ellesrévèlent qu’en l’Homme deux conceptions du temps s’affrontent. Sil’on est une Sabine, le temps est perçu comme linéaire etdévorateur, d’où les isotopies de l’inimitié, de la peur, de lavieillesse, de la mort, d’où la dévalorisation de la culture qui,à l’échelle de l’éternité, est éphémère et est appelée àdisparaître, d’où également des jeux sur l’intertextualité.Plusieurs caractérisations rappellent en effet le Dieu de l’AncienTestament : « omniprésent et omnipotent, et que l’on regarde,terrifié, s’avancer et s’écouler avec cette impitoyable[…] » (l. 43). Un peu auparavant, c’est même le temps proustienqui est remis en cause par la négation : « parfum de […] tempsaccumulé. Non, pas perdu » (l. 43).
Mais, si l’on est une Marie, le temps est perçu comme cycliqueet donc, puisque toute fin est aussitôt suivie d’unrecommencement, comme beaucoup moins tragique. D’où alors lesisotopies de l’amitié, de la sérénité, de la jeunesse, de lasensualité, de la vie, d’où aussi la valorisation de la nature. Eneffet, au sein de celle-ci la mort n’est que provisoire. L’hiverest toujours suivi du printemps, le grain de blé qui semblepourrir dans la terre renaît à la saison nouvelle. Le tempsdevient alors non plus un ennemi mais un compagnon de vie que l’ona « vaincu ou plutôt surmonté, apprivoisé » (l. 43), autrementdit, une entité comparable au chat qui suit sans cesse Louise ou àces caniches « blancs et frisés » qui décorent la boîte deberlingots. Lorsqu’au contraire on ne l’accepte pas, lorsqu’onlutte contre lui, il se métamorphose en cette image de dévorationet de mort que l’on découvre au début de La Route des Flandres : « il mesemblait voir les chiens, des sortes de créatures infernalesmythiques leurs gueules bordées de rose leurs dents froides etblanche de loups mâchant la boue noir dans les ténèbres de lanuit, peut-être un souvenir, les chiens dévorant nettoyant faisantplace nette54 ».
54 Simon, La Route des Flandres, coll. « doubles », Ed. de Minuit, Paris, 1987, p.9.
21
5
10
15
20
25
30
35
40
Comme le souligne Jean-Yves Laurichesse55, l’association desisotopies de l’odorat et de la virginité signifie donc que Marie,en acceptant, en apprivoisant le temps, en prenant consciencequ’elle fait partie du grand cycle de la vie, vainc la mort, d’oùl’hypotypose symbolique de l’éternel signalée plus haut. A lamanière des vierges de La Légende dorée, dont le corps ne secorrompait pas et se mettait à exhaler des effluves merveilleuses,elle est en odeur de sainteté, elle sent « comme peut sentir lachambre ou plutôt le tombeau, le sarcophage d’une toute jeunefille que l’on y aurait conservé intacte quoique prête à tomber enpoussière » (l. 13-14). Dans L’Herbe, en faisant donner à Marie sabague et sa boîte à Louise, le phénoménologue Simon rappellequ’Autrui, lui aussi, essaye de percer les eidê du monde et que parson point de vue différent, il complète et enrichit ma vue dumonde. La somme des variantes de son point de vue et du miendonnent plus de chance d’approcher l’eidos, plus de chance de vivreen adéquation, en harmonie avec le monde. Certes, à partir de LaRoute des Flandres, les points de vue des différents personnages surle référent devenant contradictoires, la variation éidétique ne sembleplus possible mais L’Herbe met en place un univers fictionnel encoredépourvu de contradiction narrative, ce qui permet à Louise des’approprier le point de vue de Marie et d’apprendre ainsi à neplus être son « antithèse » mais sa « répétition », à luiressembler, à apprivoiser comme elle le temps, à accepter den’être qu’une image de plus dans la mise en abyme, qu’un maillonde plus dans le cycle de la vie. De la sorte, elle peut sentirpour « la première fois » (l. 4) la plénitude naturelle etoriginelle, plénitude qu’elle n’appréhendera totalement qu’à lafin du roman quand, allongée sur l’herbe, elle sera à son tour encommunion complète avec le monde, communion qui remet en cause« les "représentations claires et distinctes" qui avaient fait lagloire du rationalisme cartésien.56 » Le vieux dualisme sujet-objetest effectivement en train de s’effondrer : le sujet Louise sefond dans l’objet Nature à moins que ce ne soit le sujet Naturequi se fond dans l’objet Louise.
Simon restitue donc non pas le référent mais la perceptionqu’a Louise de ce référent, un référent qui, à cause descontradictions et des incohérences qu’elle croit y percevoir, la
55 Jean-Yves Laurichesse, La Bataille des odeurs, L’espace olfactif des romans de Claude Simon,L’Harmattan, Paris, 1998, p. 98.
56 Ilias Yocaris, : « Une poétique de l’indétermination : style et syntaxedans La Route des Flandres », Poétique, 146, 2006, p. 219.
22
5
10
15
20
25
30
35
40
5
rend insatisfaite. Cependant, peu à peu, elle finit par discernerderrière les apparences une réalité plus profonde, derrièrel’image de la jeune femme en blanc un eidos, l’eidos du Temps etalors, tout prend soudain sens, y compris et surtout sa proprevie.
Certes, mais qu’en déduire sur les hypotyposes de ClaudeSimon ? Tout d’abord que pour arriver à les caractériser d’unefaçon satisfaisante, il faudrait à coup sûr explorerstatistiquement un corpus bien plus étendu. Cependant, ens’appuyant sur l’analyse qui précède, il est tout de même tentantd’esquisser les prémisses d’une poétique simonienne de cettefigure. Il semblerait donc que, si l’on se limite à l’observationdes procédés utilisés pour actualiser et caractériser, leshypotyposes de Claude Simon ressembleraient à celles de sesprédécesseurs. De même, comme eux, il tendrait à figer ledynamisme de l’élément perçu en transformant la scène en une imagefixe mais, contrairement à Quintilien et à la plupart de sessuccesseurs, il ne limiterait pas les notations sensorielles à lavue, il les élargirait à l’ouïe et l’odorat. En refusantl’opacification et la passivation du narrateur, en jouant sur laproximité, la vraisemblance, la cohérence, la complicité,l’interlocution, l’empathie, la sidération, la fragmentation, lasingularisation, l’hétérogénéité et l’incomplétude, en un mot enfaisant participer ses lecteurs à la construction du référent, ilexploiterait aussi, beaucoup plus que ses devanciers, lespotentiels de l’énonciation. Mais surtout, par les répétitions,par l’emploi de caractérisants antinomiques et par un glissementdu concret à l’abstrait, il subvertirait cette figure dans sonessence même. Au lieu d’être décrit avec le plus de réalismepossible, le référent serait au contraire comme laminé, laminéparce que le réel est trop complexe et trop éloigné de la quidditédu langage pour qu’il soit possible de le décrire mais aussi etsurtout parce que les hypotyposes de Simon seraient non pas deshypotyposes descriptives qui évacuent la raison mais, à l’opposé,des hypotyposes rhétoriques qui la sollicitent. En effet, en lesutilisant, il ne chercherait pas à décrire les qualitéssensorielles de phénomènes particuliers mais bel et bien àreprésenter des symboles qui nous conduiraient, grâce à larecherche de leur invariant universel, à l’eidos des phénomènesperçus. Une telle utilisation du langage figuré amènerait à penserque pour Claude Simon « la symbolisation […] est notre modeessentiel de connaissance et de compréhension du monde57 » et que
57 Catherine Fromilhague, Les Figures de style, Armand Colin, 2007, p. 13.23
5
10
15
20
25
30
35
40
l’homme ne serait pas seulement, comme l’écrit Nietzsche, un« animal métaphorique58 » mais bel et bien un « animalhypotypotique. »
Dans l’extrait que nous avons analysé, en jouant sur lapolysémie du mot « image », Claude Simon semble confirmer cettehypothèse : il nous propose à la fois une image visuelle de lachambre de Marie et une « image » au sens rhétorique du terme, unemétaphore du Temps. Image dans l’image, la boîte à berlingots,objet matériel représentant une femme reliée à une autre femme,est elle aussi une image au double sens du terme : une imagereprésentant un tableau bucolique et une image autonymique,l’image d’un certain livre intitulé… L’Herbe. Ce qui fait que, sansnous en rendre compte, nous, lecteurs, comme les femmes ducouvercle, nous nous retrouvons avec entre les mains un objetreprésentant une femme à demi allongée sur l’herbe, Louise, elle-même écho d’une femme à demi allongée, sur son lit de mort, Marie,elle-même répétition de toutes ces jeunes filles qui figurent surla boîte. Il nous faut alors « un moment pour dérouler » (l. 36)le « long cordon enroulé » (l. 34) des phrases, un moment pourcomprendre que nous sommes inclus dans la mise en abyme, un momentpour comprendre que cette hypotypose nous aide certes à découvrirun eidos mais surtout nous amène, nous, lecteurs, à réfléchir surnotre propre existence, à prendre conscience que, comme Louise,comme Marie, n’en déplaise à Pascal qui nous voyait tout de même« roseau pensant », nous ne sommes qu’Herbe, nous ne sommes qu’unpetit « rien » dans le grand cycle de la vie, qu’un petit« rien » dans le grand « tout »59.
Stéphane GallonE. A. LIDILE
Université Rennes II
ANNEXE quand nous nous sommes mariés, Georges et moi,elle m’a donné cette bague, elle58 Cité par Catherine Fromilhague, Les Figures de style, Armand Colin, 2007, p. 13.59 Avec tous mes remerciements à Ilias Yocaris et Laurence Bougault pour leurprécieuse contribution à cette étude.
24
5
10
15
20
25
30
35
40
5
m’a fait venir dans sa chambre (etc’est la première fois que j’aisenti cette odeur, ce parfum,exactement comme celui d’une rosedesséchée ou plutôt – puisqu’unerose desséchée ne sent rien –celui que l’on imagine qu’elledevrait exhaler, c’est-à-direquelque chose qui serait à la foisfait de poussière et de fraîcheur,et j’ai regardé sa table, sacoiffeuse, mais il n’y avait rienque ces quatre épingles et ceflacon d’eau de Cologne bon marché,et pourtant cela sentait comme unefleur, comme une jeune fille,comme peut sentir la chambre ouplutôt le tombeau, le sarcophaged’une toute jeune fille que l’on yaurait conservée intacte, quoiqueprête à tomber en poussière aumoindre souffle), et alors elle afouillé dans un tiroir et elle en asorti non pas un coffret à bijouxni même un de ces coffrets d’aciercomme on en vend chez lequincaillier à l’intention despaysans et des marchands debestiaux qui ne veulent pas mettreleur argent à la banque, mais uneboîte à biscuits ou à berlingots,en fer toute piquetée de rouilleavec, dessus, une jeune femme vêtued’une longue robe blanche, à demiallongée sur l’herbe dans une poseà la fois langoureuse et raide,avec juste la pointe des pieds, ouplutôt des souliers, dépassant sousle dernier volant, pudiques etridicules, et, couché près d’elle(qui dans sa main tient une mêmeboîte sur le couvercle de laquellesa même image se répète, comme dansces jeux de miroir sans fin) un de
25
5
10
15
20
25
30
35
40
ces petits chiens blancs et frisés,le tout (la dame, le caniche, laprairie) dans un cadre de fleurset de rubans aux nœuds d’un bleupervenche et… - Mais… - Non, écoute : il n’y avaitnaturellement pas de clef et laboîte n’était fermée que par unlong cordon enroulé une vingtainede fois autour, qu’il lui a falluun moment pour dérouler, serrantensuite la boîte contre elle tandisqu’elle s’escrimait avec ces mainsmaladroites et raides, essayant del’ouvrir – et toujours je pouvaissentir cette odeur de jeune fille,de fleur, cherchant des yeux leglobe, la couronne de mariée,cherchant mais il n’y avait rien.Rien que cet entêtant et sans douteimaginaire parfum de fraîcheur, devirginité et de temps accumulé.Non, pas perdu : vaincu, ou plutôtsurmonté, apprivoisé : non plus cetennemi héréditaire, omniprésent etomnipotent, et que l’on regarde,terrifié, s’avancer et s’écouleravec cette impitoyable lenteur,mais un vieux compagnon de route,familier, peut-être, aussi, craintet haï autrefois, mais il y a silongtemps de cela que le souvenirdes craintes et des terreursressemble à celui de nos paniquesenfantines qui maintenant ne tirentplus de nous qu’un sourire…
26
5
10
15
20
25
30
35
40
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Michel Aucouturier (1994) : Le Formalisme Russe, Paris, PressesUniversitaires de France, coll. « Que sais-je ? ».
Roland Barthes (1982 [11968]) : « L’effet de réel », in Genette etTodorov éds 1982 : 81-90.
Lucien Dällenbach (1977) : Le Récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme,Paris, Seuil, coll. « Poétique ».– (1988) : Claude Simon, Paris, Seuil, coll. « LesContemporains ».
Jacques Derrida (1972) : La Dissémination, Paris, Seuil, coll.« Points Essais ».
Jean Duffy (1983) : « Art as defamiliarisation in the theory andpractice of Claude Simon », in Romance Studies, 2, été1983, pp. 108-123.
Catherine Fromilhague (2005 [11995]) : Les Figures de style, Paris,Armand Colin, coll. « Lettres / 128 ».
Gérard Genette et Tzvetan Todorov éds (1982) : Littérature et réalité,Paris, Seuil, coll. « Points Essais ».
Henry George Liddell et Robert Scott (1940 [11843]) : A Greek-EnglishLexicon, Oxford, Clarendon Press.
François Jost (1977) : « Les aventures du lecteur », Poétique, 29,pp. 77-89.
Mary-Annick Morel (1982) : « Pour une typologie des figures derhétorique : points de vue d'hier et d'aujourd'hui »,DRLAV (Documentation et Recherche en Linguistique Allemande,Vincennes), 26, pp. 1-62.
Charles S. Peirce (1978) : Écrits sur le signe, trad. de l’américain parGérard Deledalle, Paris, Seuil, coll. « L’ordrephilosophique ».
François Rastier (1996a [11987]) : Sémantique interprétative, Paris, PUF,coll. « Formes sémiotiques ».
– (2001) : Arts et sciences du texte, Paris, PUF, coll.« Formes sémiotiques ».
Jean Ricardou et Françoise Van Rossum-Guyon éds (1972) : NouveauRoman : hier, aujourd’hui, Paris, Union Générale d’Éditeurs,t. II.
Jean Ricardou éd. (1975) : Claude Simon : Analyse, théorie, Paris, UnionGénérale d’Éditions, coll. « 10/18 ».
Claude Simon (1960a) : « Techniciens du roman. Claude Simon »,entretien avec André Bourin, in Les Nouvelles littéraires,1739, 29 décembre 1960, p. 4. – (1960b) : « Les secrets d’un romancier. Entrevueavec Claude Simon », entretien avec Hubert Juin, in Les
27
5
10
15
20
25
30
35
40
Lettres françaises, 844, 6-12 octobre 1960, p. 5.– (1960c) : « Avec "La Route des Flandres" ClaudeSimon affirme sa manière », entretien avec ClaudeSarraute, in Le Monde, 8 octobre 1960, p. 9.– (1960d) : « Entretien avec Claude Simon », entretien
avec Madeleine Chapsal, in L’Express, 491, 10 novembre1960, pp. 30-31.
– (1972) : « La fiction mot à mot », in Ricardou etVan Rossum-Guyon éds 1972 : 73-97 ; suivi d’unediscussion, pp. 99-116. – (1974) : « Interview with Claude Simon », entretienavec Claud DuVerlie, in Sub-stance, 8, hiver 1974, pp. 3-20.– (1975) : « Claude Simon, à la question », inRicardou éd. 1975 : 403-406 ; suivi d’une discussion,pp. 406-431.– (1977) : « Un homme traversé par le travail »,entretien avec Alain Poirson et Jean-Paul Goux, in LaNouvelle Critique, 105, juillet 1977, pp. 32-44.
Ilias Yocaris (1997) : « Esquisse d’une nouvelle approche de laréférence », in Ralph Sarkonak éd., Claude Simon 2 :L’Écriture du féminin/masculin, Paris, Les Lettres modernes,pp. 153-181.− (2002) : L’Impossible totalité. Une étude de la complexité dansl’œuvre de Claude Simon, Toronto, Paratexte.− (2006) : « Une poétique de l’indétermination : styleet syntaxe dans La Route des Flandres », Poétique, 146, pp.217-235.
David Zemmour (2008) : Une syntaxe du sensible : Claude Simon et l’écriture de laperception. Paris : PUPS, coll. « Travaux de stylistiqueet de linguistique françaises / Bibliothèque desstyles ».
28
5
10
15
20
25
30