« Res gestas scripti memorie comendare. Rufat et le premier cartulaire de Saint-Seurin (années...
-
Upload
ephe-sorbonne -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of « Res gestas scripti memorie comendare. Rufat et le premier cartulaire de Saint-Seurin (années...
ausonius éditions— mémoires 21 —
autour de saint-seurin : lieu, mémoire, pouvoir
des premiers temps chrétiens à la fin du moyen âge
actes du colloque de Bordeaux (12 - 14 octobre 2006)
Textes édités par Isabelle Cartron, Dany Barraud, Patrick Henriet
& Anne Michel
Publié avec le concours du Ministère de la Culture (DRAC Aquitaine)
— Bordeaux 2009 —
ausoniusmaison de l’archéologieuniversité michel de montaigne - Bordeaux 3F - 33607 pessac Cedexhttp://ausonius.u-bordeaux3.fr/editionsausonius
diFFusion de BoCCard11 rue de médicis75006 parishttp://www.deboccard.com
directeur des publications : Jérôme francesecrétaire des publications : nathalie tranGraphisme de couverture : stéphanie Vincent
© ausonius 2009issn : 1283-29995isBn : 978-2-35613-012-2-9
achevé d’imprimer sur les pressesde l’imprimerie Gráficas Calima, s.a.avda Candina, s/ne - 39011 santander - Cantabria - espagne
septembre 2009
Res gestas scripti memorie comendare. Rufat et le premier cartulaire de Saint-Seurin
(années 1160-1190)*
Patrick Henriet
– Autour de Saint-Seurin, p. 129 à 140
L e seul cartulaire de Saint-Seurin à avoir été conservé est connu sous le nom de Petit Sancius (PS). Il a été copié vers la fin du xiie siècle, continué en 1250 et relié à l’époque Moderne 1. Le PS, qui a été édité par Jean-Auguste Brutails en 1897, renferme plusieurs centaines d’actes. Il englobe donc le cartulaire composé
dans la seconde moitié du xiie siècle par un chanoine appelé Rufat. Nous connaissons l’existence d’un autre codex, appelé Xantius Comes, ou Grand Sancius (GS), disparu à l’époque de la Révolution 2. Enfin nous savons par le prologue que le cartulaire de Rufat fut, dans la seconde moitié du xiie siècle le premier jamais rédigé à Saint-Seurin. Son auteur était alors sacriste, mais il apparaît ensuite, entre 1182 et 1199, comme doyen de la collégiale :
“Nos prédécesseurs, les chanoines de l’église de Saint-Seurin confiaient à l’Écrit les droits de cette même église, leurs possessions et les donations qu’on leur faisait, ainsi que les litiges et les controverses, les arrangements et toutes les choses dignes d’être rappelées ; ils les consignaient très attentivement pour leur époque, en laissant pour nous un utile exemple. Mais comme ils écrivaient chaque chose sur des chartes différentes, et comme ils les conservaient ensuite dans différentes armoires, plusieurs d’entre elles disparurent soit par tromperie, soit par négligence, et non sans dommage pour cette église. En outre, il arrivait qu’en raison de leurs nombreux déplacements, lorsqu’on cherchait quelque chose de précis, bien souvent, les lecteurs étaient gagnés par la lassitude. Voilà pourquoi moi Rufat, chanoine et sacriste de cette église, travaillant pour le bien de tous, j’ai soigneusement cherché à copier en un seul volume toutes les chartes de l’église que j’ai pu rassembler, sur le conseil de tous les chanoines, afin qu’à l’avenir, si d’aventure certains écrits manquaient, on pût ainsi y remédier, et que lorsqu’on aurait besoin de voir quelque chose, on pût l’y trouver facilement” 3 .
Le premier acte mentionnant Rufat comme sacriste remonte aux années 1162-1169 4. Le cartulaire a donc été commencé entre ces années et 1182, date de son accession au décanat. Rufat compilait beaucoup d’actes à des fins pratiques, très souvent sous forme de notices. Mais il se proposait aussi, comme bien d’autres auteurs de cartulaires, de rappeler l’histoire et les
1. La date de 1250 est donnée au folio 54, par un titre rajouté postérieurement : Anno Domini M°CC°Lmo, omnes carte perpetuitatem continentes que a tempore Rufati, decani hujus ecclesie, usque ad illud tempus inveniri potuerunt, de consilio capituli, in presenti volumine sunt fideliter conscripte, ut facilius et cicius inveniantur et etiam conserventur, et primo compositio facta inter capitula Sancti Andree et Sancti Severini Burdegale. Brève description du manuscrit par J.-A. Brutails (éd. Cartulaire de Saint-Seurin, p. X-XI). Le PS est aujourd’hui conservé à Bordeaux, AD Gironde, G. 1030.
2. Brutails suggère (éd. Cartulaire de Saint-Seurin, p. X) que le GS était vraisemblablement une “copie du petit”. L’option inverse est défendue par Meaudre de Lapouyade 1936, 242-243 et 1938, 110-118. Pour cet auteur, qui s’appuie sur un document de 1657, Rufat était auteur et aussi scribe du GS, celui-ci ayant servi de “minute du cartulaire de Saint-Seurin”. Seule une connaissance précise du contenu du GS et des changements de main permettrait d’y voir clair. A n’en pas douter, le GS fut durant toute l’époque moderne celui des deux cartulaires que l’on considérait comme le plus précieux, celui qui servait à vidimer les copies. Notons cependant qu’une note du xviiie siècle décrit le GS comme “écrit en lettres gothiques” (Meaudre de Lapouyade, 1938, 111), ce qui ne parle guère en faveur d’un manuscrit commencé dans les années 1160-1170. On peut aussi imaginer un cartulaire écrit sous ou par Rufat, modèle du PS comme du GS, mais cette hypothèse apparaît peu économe. Quelle que soit l’option retenue, le présent article porte sur le travail attribuable à Rufat. Nous parlerons donc du “cartulaire de Rufat”.
3. …antecessores nostri canonici ecclesie Sancti Severini ipsius jura ecclesie, possessiones earumque donationes, lites et controversias earumque diffinitiones ac cetera quecumque memoria digna ab eisdem fiebant litteris, suis quique temporibus, attentius mandabant, nobis non inutile relinquentes exemplum. Sed quoniam singula propriis annotabant cartulis et eas diversis passim servabant armariolis, ex eis plurime sive per fraudem sive per negligentiam, non sine maximo detrimento ecclesie substracte sunt. Accidebat preterea quod propter earum multiplicem revolutionem, cum aliquid forte querendum occurrebat, tedio legentes plerumque afficiebantur. Quapropter ego Rufatus, ejusdem ecclesie canonicus et sacrista, comuni utilitati inserviens, universas ecclesie cartulas quas potui colligere, omnium consilio canonicorum sub uno redigere volumine sollicite curavi, ut et scriptorum, si qua in posterum casu aliquo defecerint, ibidem subpleatur defectus, et cum ex eis aliquod necessario videndum fuerit, sine dificultate repperiatur, Cartulaire de Saint-Seurin, n° VI, 5-6. Nous avons ici un bel exemple de la topique des prologues de cartulaires.
4. Les éléments relatifs à chronologie du projet de Rufat sont donnés infra, p. 138-139.
* L’auteur remercie vivement Laurent Morelle et Pierre Chastang, qui ont bien voulu relire ce texte avec leur rigueur et leur acuité coutumières.
130 – Patrick Henriet
Car
tula
ire
de
Sain
t-Se
urin, AD
Gironde,
G. 10
30, fo
l. 7
|
v 8.
Le
cartula
ire
de
Rufa
t co
mm
ence
au fol.
8 :
quon
iam
vit
a h
omin
um
bre
vis
est ...
rufat et le Premier cartulaire de Saint-Seurin – 131
gloires de sa collégiale 5. Son œuvre était donc, en cette seconde moitié du xiie siècle, un monument d’affirmation identitaire pour toute la communauté canoniale, monument comparable aux réalisations de pierre plus ou moins contemporaines même s’il s’en différenciait du point de vue de sa fonction directe. Le cartulaire de Rufat est aujourd’hui noyé dans les continuations et les ajouts des xiiie et xive siècles, l’ensemble formant le PS. Nous nous proposons ici de lui restituer son identité primitive et de brosser à grands traits les objectifs de Rufat et de la communauté dont celui-ci s’était fait le défenseur et le porte-parole. Le PS pose bien des problèmes, tant dans la partie de Rufat que dans les ajouts postérieurs à 1250, qui ne seront pas traités ici 6. Les lignes qui suivent ne sont donc rien d’autre qu’une introduction à une œuvre qui mériterait un examen approfondi sur des plans variés, depuis la codicologie jusqu’à la diplomatique en passant par la prosopographie. Une nouvelle édition du PS, qui discuterait les datations et relèverait systématiquement les éléments faux ou interpolés, ne serait pas inutile.
Reconstitution du caRtulaiRe de Rufat
Il convient d’écarter :
- Cinq pièces des xiiie et xive siècles, contenues dans un quaternion (f. 1-7) qui a été rajouté au PS bien après la réalisation de celui-ci 7.
- Deux pièces du xiiie siècle, rajoutées à la fin du cartulaire primitif par deux copistes différents, après la réalisation du PS et pour mettre à profit un folio largement inutilisé 8. En effet, au folio 54 (numérotation moderne), on trouve le petit texte de transition suivant, “avertissement du compilateur” pour reprendre les mots de J.-A. Brutails :
“En l’année du Seigneur 1250, toutes les chartes faites pour l’éternité qui purent être trouvées depuis l’époque de Rufat, doyen de cette église, jusqu’à la nôtre, par décision du chapitre, furent fidèlement recopiées dans le présent volume, afin qu’on pût les trouver plus rapidement et plus facilement, et aussi afin de les conserver. Et pour commencer, le compromis conclu entre les chapitres de Saint-André et de Saint-Seurin de Bordeaux”.
Pour bien marquer le début des ajouts au cartulaire de Rufat, le copiste de 1250 commença au début d’un folio et cet avertissement fut placé en tête, peu de temps après 9. Du coup, le folio précédent, qui marquait la fin de l’entreprise du xiie siècle, se trouvait largement inutilisé. Pour cette raison, on put y copier ultérieurement les deux pièces dont il vient d’être question. Situées avant l’“avertissement du compilateur”, elles n’en sont pas moins totalement étrangères au cartulaire de Rufat.
- Toutes les pièces qui suivent l’“avertissement du compilateur” 10.
En définitive, le premier cartulaire de Saint-Seurin, œuvre de Rufat, comprenait 167 actes ou privilèges, précédés d’un prologue et d’une notice relative à l’histoire de Saint-Seurin et de ses rapports avec les “comtes de Gascogne”. Cela représente moins de la moitié du PS. On notera par ailleurs que la foliotation donnée par J.-A. Brutails, imprimée en haut des feuillets, est récente. On distingue encore fort bien la foliotation médiévale, qui devrait lui être préférée dans la mesure où elle fait abstraction des pièces préliminaires, sans doute rajoutées au moment de la reliure actuelle. Pour ne pas créer de distorsions avec l’édition de Brutails, nous renverrons cependant à la foliotation moderne.
5. Pour une approche “moderne” des cartulaires, voir le volume fondateur de Guyotjeannin et al. 1993, ainsi que Chastang 2001, et tout récemment Le Blévec 2006.
6. Il conviendrait par exemple de réfléchir sur le fait qu’après 1250, le cartulaire intègre des documents relatifs à la cathédrale Saint-André, comme le fait très justement remarquer Frédéric Boutoulle dans ce volume, en proposant, p. 256, l’hypothèse qui suit : “Le cartulaire de Saint-Seurin a intégré un cahier dont le début présente les privilèges reçus de l’archevêque Hélie de Malemort (1188-1207) en faveur de l’Église de Bordeaux, comme si en l’absence de cartulaire épiscopal, les chanoines de Saint-Seurin avait dû, pour un temps, partager l’espace de leur cartulaire pour accueillir les actes de l’archevêque” (il s’agit des pièces CCCXLVIII-CCCLIII de l’édition Brutails, correspondant aux folios 140-162).
7. Le quaternion est incomplet d’un folio. Les pièces sont numérotées I à V par Brutails. Il s’agit du serment des bénéficiers (xive siècle, n° I, p. 1-2), de la concession d’une pension annuelle à Guillaume Gaucelme (1325, n° II, p. 2), de la démission du maître d’œuvre (operarius. Brutails traduit par “ouvrier”) Gaillard de Lacaze (1325, n° III, p. 2-3), d’un inventaire d’objets du culte (1294, sur un morceau de parchemin cousu en haut du feuillet 7 v°, n° IV, p. 3-4), de la visite du Prince Noir à Saint-Seurin, avec prise d’armes sur l’autel (1355, n° V, p. 4-5).
8. Cartulaire de Saint-Seurin (f. 53-53 v°), n° CLXXIII et CLXXIV, p. 133-135.9. Texte latin en n. 1. Ce court texte a été ajouté postérieurement par une autre main et il est rubriqué en rouge.10. Soit les numéros CLXXVI-CLXXVII et suivants de Brutails, p. 135 sq.
132 – Patrick Henriet
le pRologue et la “notice histoRique”Le cartulaire de Rufat s’ouvre par un véritable morceau de bravoure, qui livre ce qui peut être considéré comme le
mythe fondateur de Saint-Seurin, tout du moins en ce qui concerne les relations entre les chanoines et le pouvoir séculier. Nous avons affaire à deux pièces, un prologue et une notice historique en forme de privilège, qui sont présentées comme bien différentes par Rufat mais forment en réalité un même ensemble.
Après avoir expliqué qu’il va pour la première fois réunir en un même volume des actes jusque là dispersés, le “sacriste” Rufat annonce qu’il rappellera d’abord “de quelle dignité cette église fut autrefois dotée par saint Amand, ainsi que le respect et la révérence que le comte de Gascogne doit manifester envers elle” 11. Suit une notice aussi passionnante que formellement curieuse. Un acte qui semble être un privilège introduit pas des formules classiques entre toutes (In nomine Patris… Notum esse omnibus christianis volumus etc.) donne des éléments touchant à la première histoire de Saint-Seurin. Il concerne un comes présenté de façon générique mais jamais nommé. On ne comprend pas très bien qui s’exprime et l’acte n’est pas daté. Nous apprenons que saint Amand, sur le conseil d’un ange, donna autrefois le comitatus et l’archiepiscopatus – un mot que l’on n’imagine guère au cours du Haut Moyen Âge – à saint Seurin 12. Les évêques de Bordeaux titulaires de la fonction comtale, voici une précision qui ne figurait même pas dans les textes hagiographiques relatifs à saint Seurin... Amand fait ensuite enterrer ce dernier dans l’église et décrète que les comtes recevront désormais leur charge sur son autel, en même temps que le glaive et le vexillum 13. Pour la fête de saint Seurin, ils verseront un cens aux chanoines.
Cet “acte” vise clairement à affirmer l’indépendance de Saint-Seurin et sa prééminence symbolique sur Bordeaux et sa région. Le candidat le plus autorisé à la rédaction est Rufat lui-même, qui bâtit tout son prologue comme une introduction à cet exposé. On a donc bien le sentiment que ces deux pièces préliminaires n’en font en réalité qu’une. Elles nous invitent à poser la notion de “cartulaire d’auteur”, Rufat ayant indéniablement joué un rôle qui dépasse largement celui du simple compilateur 14. Les différentes interventions du cartulariste sur la matière originelle devraient être soigneusement recensées. L’une des plus importantes, comme le montre ici même Frédéric Boutoulle, est assurément la réécriture complète d’une donation du comte Sanche Guillaume (1010-1032) où Rufat réaffirme avec force que les comtes reçoivent le consulatum de saint Seurin 15. De façon générale, de très nombreux documents se présentent sous la forme de notices résumant les actes, y compris les actes “récents”. L’interventionnisme de Rufat est donc constant 16. Ainsi dans cette donation des alentours de l’an Mil qui rappelle, conformément à la seule Vita de saint Seurin écrite à Bordeaux, très certainement à une date postérieure, le rôle du saint patron dans la lutte contre les ariens 17. Ainsi également des documents relatifs au prieuré de Barbezieux et aux querelles avec la cathédrale quant au droit d’inhumation, deux dossiers essentiels qu’il convient maintenant de présenter brièvement.
11. Ex quibus primo scribendum censui qua dignitate ipsa ecclesia a sanctissimo Amando quondam dotata fuerit, quidve iuris quamque reverentiam comes Gasconie eidem debeat exibere, Cartulaire de Saint-Seurin, n° VI, p. 6.
12. Sanctus igitur Amandus illo tempore comes et archiepiscopus Burdegale fuit quando sanctus Severinus advenit, sed angelo jubente, utrumque et archiepiscopatum et comitatum sancto tradidit Severino ut sub illius esset dominio, ibid., n° VII, p. 7.
13. Ut quicumque comes in hac patria constitueretur apud hunc locum, ob honorem sancti Severini, gladium suum super altare ipsius poneret, et cum vexillo et eodem gladio, comitatum a sancto Severino reciperet et per omne tempus quicquid magni vel in prelio vel in alio negotio facturus esset per auctoritatem et licentiam talis patroni faceret, ibid.
14. L’auteur en question n’étant évidemment pas un “auteur” au sens moderne et encore romantique du terme. Rufat écrit omnium canonicorum consilio et on ne peut exclure une commande de son doyen Bertrand, lui-même neveu de l’archevêque Bertrand de Montaud (voir l’article de Fr. Boutoulle dans ce même volume). Notons cependant l’absence de toute référence à ces personnages dans le prologue. Sur la notion de “cartulaire d’auteur”, voir Geary 2001.
15. Cartulaire de Saint-Seurin, n° IX, 10 : Mos etenim est nullum comitem posse huic Burdegale urbi statu legitimo praeesse, nisi sui consulatu honorem a predicto pontifice vultu demisso suscipiat….
16. Ainsi, dans un acte relatif au bois du Bouscat (Cartulaire de Saint-Seurin, n° CXXXIX, 108, f. 44, 22 août 1182), le cartulariste renvoie à l’achat de ce même bois l’année précédente avec la formule sicut supra sciptum est. Et de fait, l’acte de vente par Arnaud d’Illac se trouve au folio 43-43 v°.
17. Cartulaire de Saint-Seurin, n° XI, 12. Voir dans ce volume l’article de Chr. Baillet, ici p. 99, ainsi que l’article de Chr. Baillet, P. Henriet et S. Junique, ici p. 84 et n. 59.
rufat et le Premier cartulaire de Saint-Seurin – 133
un monument à la gloiRe des chanoines de saint-seuRin… accessoiRement anti-clunisien
Des érudits modernes tels que les auteurs de la Gallia christiana et Mabillon pensaient que Saint-Seurin avait d’abord été un monastère. On a depuis fait justice de cette assertion sans fondement 18. Mais le cartulaire montre bien comment, à la fin du xiie siècle, Rufat et ses chanoines revendiquaient fièrement leur identité canoniale 19. Voyons comment et pourquoi.
Rappelant dans son prologue les rapports entre saint Amand et saint Seurin, Rufat fait un peu œuvre d’hagiographe. Il avait sans doute alors à sa disposition une Vita sancti Severini (BHL 7650) écrite pour devenir le texte officiel de la collégiale en matière hagiographique 20. Or cette Vita parlait de Saint-Seurin comme d’un monasterium 21. De la même façon, les deux diplômes de Louis le Pieux transmis par le cartulaire mentionnent le monasterium sancti Severini 22. On peut voir dans ces mentions, en particulier dans les diplômes carolingiens, le reflet d’une époque où la distinction entre chanoines et moines, monastères et collégiales, était encore très floue. Ils ne doivent donc pas être surinterprétés et ne peuvent servir à poser un passé monastique pour Saint-Seurin. Cependant, au xiie siècle, le sens de monasterium était plus clair. Rufat prend donc bien soin de ne jamais l’utiliser lorsqu’il se fait auteur, en particulier dans le prologue. Dès les toutes premières lignes, il parle des antecessores nostri canonici ecclesie sancti Severini : une façon de rappeler qu’il n’y eut jamais que des chanoines dans la première église de Bordeaux… Celle-ci est désignée par Rufat comme ecclesia ou locus, jamais comme monasterium, ce terme n’apparaissant plus jamais dans la documentation 23. On peut y voir, tout simplement, la fierté d’appartenir à une communauté puissante et chargée d’histoire. Mais on est en droit de se demander si ne perce pas ici la volonté d’une affirmation identitaire face au monachisme, et peut-être plus précisément face à Cluny. Nous fondons cette hypothèse sur deux points, vraisemblablement liés selon des modalités qui nous échappent.
1) Après le prologue et la donation de Louis le Pieux, Rufat livre quelques pièces de la première moitié du xie siècle. Suit un petit dossier constitué de deux actes relatifs à l’église de Barbezieux (Charente), qui avait été disputée dans les années 1050-1080 entre Saint-Seurin et Cluny. Un acte du début des années 1080 (et non de 1070 comme le proposait J.-A. Brutails) 24 expose l’arrangement auquel sont parvenus les deux établissements lors du concile de Bordeaux (1080). Hugues de Semur est présent et entérine par des prières ce qui est présenté un peu vite comme une renonciation des moines 25. L’importance accordée par les chanoines à cet épisode est perceptible bien après les événements et apparaît en
18. Voir l’introduction de Brutails au cartulaire, p. XXII-XXIV. Notons cependant que vers le milieu du xie siècle, lorsqu’un groupe de chanoines voulut rattacher Saint-Seurin à Cluny, il fut question de “réformer” (= re-former) la collégiale selon son “antique dignité”. On ne peut exclure que les chanoines de cette époque aient eu le sentiment que leur église avait autrefois été un monastère. Ce qui expliquerait aussi l’emploi du terme monasterium dans les textes dont il est question infra.
19. La question d’une tentative de “régularisation” du chapitre au xiie siècle excède les limites de ce travail et mériterait d’être reprise. Il est souvent question d’une sécularisation au xiie siècle, mais Brutails, p. XXVI, fait remarquer qu’il “serait plus exact de dire que la sécularisation, qui était dès lors un fait accompli, fut reconnue par le Saint-Siège, puisque la décision de celui-ci est motivée sur la prescription”. Les chanoines de la cathédrale avaient eux-mêmes adopté très difficilement la règle de saint Augustin en 1145, suite à une intervention de saint Bernard qui vint au secours de l’archevêque Geoffroy du Loroux : texte dans Lopès [1668] 1882, II, 444-445, mais aussi dans les miracles de saint Bernard rapportés à la fin de la Vita prima (ici Geoffroy d’Auxerre), col. 410. Les chanoines de la cathédrale étaient favorables à une régularisation de Saint-Seurin qui échoua. Dans un compromis entre les deux chapitres daté de 1222 (Cartulaire de Saint-Seurin, n° CLXXVI, 138 sq.), on apprend que la question fut particulièrement d’actualité vers 1160. Et l’on apprend aussi qu’un accord fut trouvé entre les deux chapitres à l’époque où Rufat était doyen pour que les chanoines de Saint-Seurin pussent continuer à mener vie séculière (ibid., p. 140). Le fait qu’il n’y ait aucune trace de ce document dans le cartulaire de Rufat montre que celui-ci ne tenait pas à rappeler ces controverses. Aussi loin que l’on puisse remonter, les chanoines de Saint-Seurin semblent jouir de leurs biens. Ils habitent des maisons individuelles et ont des propriétés : voir par exemple ce document des années 1120-1130, en tout cas antérieur à 1144 puisque réalisé sous le doyen Gofran, qui confirme l’usufruit de la terre appelée aus Domiuns au chanoine Boson, dum vixerit et si in ecclesia canonice permanere voluerit (Cartulaire de Saint-Seurin, n° XXXVII, 36). Si les chanoines de Saint-Seurin ont été réguliers un jour, c’est sans doute en suivant sans zèle particulier la règle d’Aix.
20. À moins que Rufat n’ait lui-même écrit cette Vita ? Hypothèse hardie dont je reconnais volontiers qu’elle n’est pas vérifiable en l’état actuel des connaissances (cf. dans ce volume, p. 83). Présentation de la Vita BHL 7650 dans ce volume p. 81 ainsi que p. 117 pour le manuscrit qui la renfermait.
21. Vita s. Severini, éd. Cirot de la Ville 1859, p. 426-444, ici lect. 4, p. 432, et lect. 5, p. 434. Voir la présentation du dossier hagiographique de Saint-Seurin dans ce volume, p. 79-85.
22. Ad monasterium sancti Severini prope urbem Burdegalim, Cartulaire de Saint-Seurin, n° VIII, 8. Regesta imperii, 526 et 527.23. Canonici ecclesie sancti Severini, Cartulaire de Saint-Seurin, n° VI, 5 ; ejusdem ecclesie canonicus et sacrista, et p. 6 ; ipsa ecclesia,
ibid. ; iste locus ; n° VII, 6 ; apud istum locum, ibid. ; apud hinc (…) locum, et p. 7 ; apud hunc locum, ibid. ; consuetudo est istius loci, ibid. ; locum sancti Severini, ibid.
24. L’acte est daté de 1070 : anno millesimo ab incarnatione Domini nostri Jhesu Christi septuagesimo, indictione secunda, Gregorii septimi pape nono… Brutails donne donc 1070, mais il ajoute lucidement un point d’interrogation. La neuvième année du pontificat de Grégoire VII correspond à 1081 ou 1082. Ce qui cadre bien avec le fait que l’acte mentionne le concile de Bordeaux, qui a eu lieu en 1080. Voir Cowdrey 1970, n. 2, 88.
25. Insuper etiam quatinus firmius hoc fieret, domnus abbas Ugo Cluniacensis, fideles cum suis orationes spondens spopondit, Cartulaire de Saint-Seurin, n° XIII, 14.
134 – Patrick Henriet
particulier dans la Chronique saintongeaise du Pseudo-Turpin, peut-être composée à Saint-Seurin au début du xiiie siècle 26 : ce texte assez mystérieux rapporte en effet comment Charlemagne donna Barbezieux à l’archevêque de Bordeaux, qui aurait à son tour cédé l’église à un parent avec “diz sous d’omenagie de deniers de la table” 27 : formule qui s’éclaircit à la lecture d’une charte de 1060, transmise par Rufat sous la forme d’une notice juste avant celle des années 1081-1082. Nous y apprenons, sans que tout soit là non plus parfaitement clair, qu’un certain Alduin avait fondé Barbezieux sous l’autorité de l’archevêque de Bordeaux Geoffroy (1027-1043), puis que, devenu très âgé, il avait ensuite donné cette église à Cluny, où il était devenu moine 28. Conscient que son père avait fait erreur, Itier aurait quant à lui “rendu” Barbezieux à la collégiale bordelaise 29. L’accord stipule que le doyen de celle-ci, Éléazar, doit désormais verser tous les ans dix sous à saint Seurin 30. Peut-être cet Éléazar était-il parent de l’évêque Goscelin de Parthenay (1059-1086) 31. En tout cas, la connaissance de ce cens de dix sous par l’auteur du Pseudo-Turpin saintongeais indique que celui-ci était fort bien informé. Peut-être avait-il eu accès, comme le suggère André de Mandach, au cartulaire de Saint-Seurin. Ce dossier ne fut pas oublié à Bordeaux : il est question du cens de cinq sous, que le prieur de Barbezieux devait verser à Saint-Seurin depuis l’accord de 1081-1082, d’abord dans la confirmation des possessions de la collégiale bordelaise par le pape Alexandre III, puis à nouveau dans un document de 1231 32. C’est bien Cluny qui, moyennant un cens payé par son prieuré, avait en réalité conservé le contrôle de l’église de Barbezieux. 33.
Le sentiment prévaut que cette dispute avec le monastère bourguignon joua un rôle important dans la mémoire de Saint-Seurin. Rufat nous la donne à connaître sous la forme de deux notices qui ne s’en tiennent certainement pas à la teneur originelle des actes : le document de l’année 1060 résume les errances du fondateur, Alduin, en même temps que les décisions de son fils, Itier. Il est donné sous la forme d’un récit écrit à la troisième personne du singulier, et la soi-disant restitution à Saint-Seurin est présentée comme un effet de la “raison” (ratio) 34. La première phrase parle d’une possession par Saint-Seurin ex antiquo tempore, formule qui paraît difficile en 1060, lorsque que la fondation de Barbezieux par Alduin n’avait que quelques dizaines d’années 35. Dans le document de 1081-1082, on voit d’abord Itier s’exprimer à la première personne, puis ce sont les chanoines qui prennent la parole 36. À l’évidence, Rufat est fortement intervenu dans ce dossier.
26. Telle est l’hypothèse de A. de Mandach (éd. Chronique dite Saintongeaise, 48-57), qui relève tous les ajouts favorables à Saint-Seurin. Mandach fait, p. 57, l’hypothèse que l’auteur de la Chronique saintongeaise pourrait être Rufat, mais la chose apparaît chronologiquement assez difficile, puisque l’auteur écrit après 1202/1205 et avant 1222.
27. Lo fé de Berbesil dona ensement Karles a l’arcevesque de Bordeu. E l’arcevesques / lo dona a un son parent am diz sous d’omenagie de deniers de la table, ibid., p. 282, et commentaire p. 30-32.
28. Il n’est question de Saint-Seurin qu’au moment de la “restitution”. La fondation sous l’autorité de l’archevêque de Bordeaux est intéressante en ce sens qu’elle se manifeste par la pose des trois premières pierres : l’archevêque Geoffroy tres lapides suis manibus in fundamento ecclesie posuit (Cartulaire de Saint-Seurin, n° XII, 13). Sur le rituel de la pose de la première pierre comme enjeu de pouvoir, cf. Iogna-Prat 2006, 549-574. Par la suite, Alduin Sancto Petro Cluniacensi et ejus monachis, factus et ipse monachus, eam injuste donavit, Cartulaire de Saint-Seurin, ibid. L’acte qualifie Alduin de jam senex etiamque emeritus, ce qui est sans doute une façon de le traiter de gâteux sans le dire…
29. Contrairement à Aldoinus, Heiterius agit “mu par la raison” (coactus ratione), animadvertens patrem suum in hoc dono quidem errasse, Cartulaire de Saint-Seurin, n° XII, 13. Aldoinus était rentré à Cluny jam senex etiamque emeritus.
30. Et, quoniam Eleazarus diligenter procuravit ut hec ecclesia ad sanctum Severinum, cujus ipse decanus est, rediret, ab eodem sancto et archiepiscopo eam habet, et in unoquoque anno quamdiu vixerit beato Severino X solidos solvet tributum, ibid.
31. C’est l’hypothèse de Mandach, p. 31, à partir du texte de la Chronique saintongeaise (“a un son parent”). L’hypothèse d’un lien de parenté entre l’archevêque et le doyen de Saint-Seurin paraît parfaitement plausible, comme le montre le cas de Bertrand de Montaut et du doyen Bertrand un siècle plus tard : cf infra, p. 137.
32. Singulis annis ecclesia ipsa betissimi Severini servientibus altari solidos quinque redderet monete pictavensis veteris, Cartulaire de Saint-Seurin, n° XIV, 14 (1081 ou 1082) ; Alios quinque solidos pictavenis monete veteris de ecclesia Sancte Marie de Berbezillo, ibid., n° CXXXII, 100 (confirmation d’Alexandre III, entre 1159 et 1181) ; Noveritis quod prior de Berbezillo confessus est, coram nobis se debere mittere quinque solidos pictavinorum veterum censuales in festo sancti Severini singulis annis pro ecclesia Sancti Severini prope Berbezillum capitulo Sancti Severini Burdegalensi, ibid., n° CLXXXI, 149 (1231).
33. Il convient de bien lire les termes de l’accord de 1081-1082 : Barbezieux reste en réalité à Cluny, moyennant un arrangement complexe : Itier, fils d’Alduin verse cent sous à Barbezieux, qui versera à son tour à Saint-Seurin un cens annuel de cinq sous en “vieille monnaie de Poitiers”. La suite de la “restitution” montre que deux moines clunisiens demeureront sur place (duobus monachis locum ipsum habitantibus, Cartulaire de Saint-Seurin, n° XIII, 14). Le jugement anti-clunisien a donc permis à Cluny de garder son prieuré… Résumé de l’affaire dans Köhnle 1993, 212-213 (qui rapproche le cas de Barbezieux de celui du prieuré de Nogent-le-Rotrou). Pour l’histoire de Barbezieux, voir l’édition du Cartulaire du prieuré de Notre-Dame de Barbezieux. Pour que la phrase post multum vero temporis (…) precibus soit compréhensible, il faut lire ipsiusque et non ipsi usque comme Brutails.
34. Voir à la fois la n. 29 et la note suivante. 35. Sicuti ex antiquo tempore, exigente ratione, constitutum est, quicumque Birbidelensis principatus fructum sortitur de sancto Severino
et archiepiscopo se principatum prenotatum habere non ignorare debet, Cartulaire de Saint-Seurin, n° XII, 13.36. Itier ne commence cependant pas sa phrase par un ego. Le sujet est miles Iterius, puis suivent des verbes à la première personne du
singulier. On trouve plus loin la formule hec quidem sponsio nobis canonicis placuit nimis ; Cartulaire de Saint-Seurin, n° XIII, 14.
rufat et le Premier cartulaire de Saint-Seurin – 135
2) Il est un autre document relatif aux relations entre Saint-Seurin et Cluny qui a été pratiquement ignoré par les historiens de la collégiale 37. Cet acte se trouve à la Bibliothèque Nationale de France, sous la forme d’une copie de la collection Moreau. Il a été publié par A. Bernard et A. Bruel 38. On y apprend que vers le milieu du xie siècle, Saint-Seurin fit l’objet d’une donation à Cluny 39. Les circonstances de cet épisode méconnu sont obscures. Au vu du texte, il apparaît qu’un groupe de chanoines, dont il est difficile de savoir s’ils représentaient bien toute la communauté, avait choisi de réformer la collégiale conformément à son “ancienne dignité”, de la “promouvoir” avec l’aide de Dieu et de suivre “un mode de vie consacré” 40. Cette donation ne fut pas suivie d’effet. On note que quatre des donateurs se retrouvent parmi les souscripteurs dans la “restitution” de Barbezieux en 1081-1082, ce qui nous incite à proposer une datation plus tardive que celle de A. Bernard et A. Bruel, “c. 1050” 41. Il est difficile d’aller plus loin. Le sentiment prévaut qu’un groupe de chanoines, emmenés par un certain Amalvinus, avait choisi d’intégrer l’Ecclesia cluniacensis, mais que pour une raison qui nous échappe (opposition des autres chanoines ? De l’archevêque ? Du pouvoir laïque ? Tout cela à la fois ?), leur projet ne put être mené à bien. Dans les années 1050-1080, les relations entre Saint-Seurin et Cluny étaient donc à la fois complexes et conflictuelles : échec de l’intégration de Saint-Seurin à l’Ecclesia cluniacensis et dispute à propos d’une église importante. Si bien des zones d’ombre demeurent, on comprend tout de même mieux l’insistance de Rufat sur le passé canonial de Saint-Seurin, un passé que ne revendiquaient pas les chanoines amis de Cluny lorsque, projetant de devenir moines, ils parlaient du retour de leur église à son “ancienne dignité”. La fierté canoniale de Rufat s’accompagne donc, ce qui ne surprendra pas, d’un silence total quant à cette éphémère donation, sans doute soigneusement écartée du cartulaire. Il est peu vraisemblable que ce texte gênant n’ait pas été connu de Rufat, et l’on peut penser qu’une trace écrite en subsistait encore à Saint-Seurin. Mais l’auteur d’un cartulaire n’est pas seulement un compilateur, il élimine aussi les documents gênants… Pour cette même raison, la donation à Cluny ne semble pas avoir été connue des principaux historiens de Saint-Seurin, Cirot de la Ville, J.-A. Brutails ou la marquise de Maillé, qui ne la citent jamais 42 : ces trois grands érudits dépendaient en effet des archives bordelaises et non clunisiennes. D’une certaine façon, Rufat et les chanoines de Saint-Seurin étaient arrivés à leurs fins et avaient imposé l’oubli…
indépendance et pRéséance symbolique face à la cathédRale saint-andRé
La volonté d’indépendance des chanoines de Saint-Seurin s’était d’abord manifestée dans la “notice historique”, largement consacrée aux relations avec les pouvoirs laïques. Le traitement de l’affaire de Barbezieux avait ensuite permis de prendre position face aux prétentions des moines. Troisième étape importante, un gros dossier qui suit de près celui des relations avec Cluny et concerne la dispute entre Saint-Seurin et la cathédrale Saint-André, à propos de leurs droits respectifs de sépulture 43. Sans jamais dire que saint Seurin avait établi sa cathédrale dans l’église qui accueillit son corps, Rufat suggère dès le prologue que pour Amand et Seurin, l’édifice qui comptait vraiment était ce locus où ils avaient été inhumés 44. Nous avons maintenant, à nouveau, deux pièces : une notice montre d’abord comment l’archevêque Goscelin (1059-1086) renonça au droit de sépulture pour la cathédrale en 1081, puis le compte-rendu d’un jugement rendu quelques années plus tard par l’archevêque et légat Amat d’Oloron, à la suite d’une médiation de l’abbé de Sainte-Croix, confirme le bon droit de la collégiale 45. Rufat est à coup sûr intervenu dans le premier document, qui se présente sous la forme d’une notice historique, et sans doute aussi dans le second, qui rapporte les événements sans donner ni datation ni liste de témoins. La sentence de 1081 oppose dès la première ligne l’“institution des saints pères” et l’“authentique autorité des chanoines”
37. Il est cependant cité par Adler 1963, 161, n. 63, et 124, n. 10, Diener 1959, 488, Claude 1966, Chronique dite Saintongeaise (Pseudo-Turpin), éd. A. de Mandach, p. 31, Mussot-Goulard 1982, 197 (l’Austindus precentor serait “peut-être” Austinde d’Auch selon l’auteur) ; Köhnle 1993, 213, n. 81.
38. Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny, IV (1027-1090), n° 3321, p. 414.39. Nos et nostram ecclesiam ecclesie Cluniacensi damus atque concedimus, et in quantum possumus in ius ipsius transfundimus…,
ibid.40. …optantes atque sperantes ut per ordinationem illius sancte congregationis ecclesia nostra non solum in antiquam dignitatem
reformetur, verum etiam multo excellentius Deo juvante promoveatur, et in rigore sacre religionis stabiliatur, ibid. 41. Ce sont Austendus/Ostindus, préchantre dans la donation à Cluny et chantre dans le document du début des années 1080 ; Goframnus/
Gofrannus ; Wilelmus, devenu Wilelmus sacerdos au début des années 1080 ; Fortis Arnaldi/Fortis Arnaldi (en enlevant la virgule rajoutée à tort par Bernard et Bruel entre Fortis et Arnaldi). Amalvinus, l’homme qui se trouvait en tête de liste de la donation à Cluny, est absent du document de 1081-1082. Peut-être était-il mort. Il n’est fait mention d’un doyen dans aucun des deux actes.
42. Pour Cirot de la Ville et Brutails, voir supra ; Maillé 1960.43. On trouve entre les deux “dossiers” une renonciation de l’archevêque Goscelin (1059-1086) à une vigne (n° XIV, 15-16) et la
restitution d’un bois et d’une terre par un nommé Arnaud (n° XV, 16-17). 44. Post sancti Severini ergo transitum, quem sanctus Amandus ipsius peticione apud hunc sepelivit locum, ob reverentiam santissimi
Severini confessoris…Cartulaire de Saint-Seurin, p. 7. La thèse ancienne d’un transfert de la cathédrale primitive de Saint-Seurin à Saint-André se retrouve dans Maillé 1960.
45. Cartulaire de Saint-Seurin, n° XVI-XVII, 18-20.
136 – Patrick Henriet
(i.e. ceux de saint-Seurin) à l’audace de la “congrégation” de Saint-André, qui a décidé de construire un cimetière “moderne” “dans son église” 46. Or le cimetière de Saint-Seurin, apprenons-nous, avait été consacré dès l’époque de l’“Église primitive”. Précision évidemment fantaisiste puisque la consécration des cimetières n’est attestée qu’à partir du milieu du xe siècle, pour la première fois dans le Pontifical romano-germanique 47. Possible en 1081, cette revendication prend encore plus de sens à partir du xiie siècle, lorsque le prestige et l’antiquité du cimetière de Saint-Seurin sont soulignés dans la Chronique (latine) du Pseudo-Turpin : selon ce texte célèbre, il existait en Gaule deux cimetières particulièrement renommés, celui des Alyscamps, à Arles, et celui de Saint-Seurin, à Bordeaux. Tous deux avaient été consacrés par saint Maximin d’Aix, saint Trophime d’Arles, saint Paul de Narbonne, saint Saturnin de Toulouse, saint Fronton de Périgueux, saint Martial de Limoges et saint Eutrope de Saintes 48. L’auteur de la notice rapporte ensuite comment sous l’archevêque Goscelin, les chanoines de Saint-André vinrent dérober à Saint-Seurin le corps du miles Otho de Montalt et l’emportèrent à la cathédrale illegaliter. Goscelin donne finalement sa sentence sans prononcer encore, semble-t-il, l’interdiction formelle d’inhumer ailleurs qu’à Saint-Seurin 49. Il n’en va pas de même dans la sentence d’Amat d’Oloron, non datée, qui est rapportée dans une autre notice. Celle-ci nous livre une sorte d’historique du conflit, que les chanoines de Saint-Seurin font remonter jusqu’à l’archevêque Geoffroy (1027-1043) 50. Une partie des dîmes perçues inter muros, soit dans la ville close, est également en jeu, ainsi qu’un problème de préséance liturgique, puisque les chanoines de la cathédrale prétendaient avoir le droit de dire la messe dans des églises dont ceux de Saint-Seurin considéraient qu’elles relevaient de leur juridiction 51. Selon l’histoire très orientée qui nous est rapportée, l’archevêque Geoffroy lui-même aurait ensuite renoncé à ensevelir des corps dans la cathédrale et se serait fait inhumer “dans cette même église qu’il avait si mal traitée” 52. Sous ses successeurs, Archambaut (1044-avant 1059) et Andron (1059 ?), la cathédrale respecte l’accord, mais le conflit renaît sous l’épiscopat de Goscelin, à cause d’un doyen de Saint-André nommé Boson. Il est ensuite question, après la mort de Goscelin (1086), d’une invasion de Saint-Seurin et d’une magna perturbatio cleri et populi, mais à la suite d’une médiation de l’abbé Arnaud de Sainte-Croix, les chanoines de la cathédrale promettent finalement de ne plus inhumer personne dans leur cimetière et ils reconnaissent aussi les droits de Saint-Seurin en matière de dîmes et d’églises dépendantes. Amat, légat et archevêque, confirme les prérogatives de Saint-Seurin en matière d’inhumation 53.
Il est difficile de savoir ce qui, dans ces deux pièces, reprend fidèlement les documents de la fin du xie siècle et ce qui a pu être réécrit et mis en forme par Rufat. Saint-Seurin l’emporte finalement sur toute la ligne, ce qui semble douteux dans la mesure où la procédure a finalement privilégié la conciliation, l’arbitrage et le compromis. Le récit des égarements et des remords de l’archevêque Geoffroy, les événements qui suivent jusqu’à l’époque d’Amat d’Oloron, tout cela est rapporté du seul point de vue de Saint-Seurin. L’objectif est clair : après avoir rappelé l’indépendance par rapport à Cluny, il s’agit de bien montrer l’indépendance vis-à-vis de la cathédrale, sans doute plus encore vis-à-vis des chanoines de Saint-André que des évêques. Une impression d’irréductible hostilité entre les deux chapitres se dégage des documents, mais cette impression, il importe de le souligner, n’est sans doute qu’un reflet très déformé de la réalité… Dans les faits, les rapports entre la collégiale et la cathédrale sont toujours restés très étroits, et les membres des deux chapitres avaient vraisemblablement le sentiment d’appartenir aux branches rivales d’une même institution. Rufat n’éprouve aucune gêne à reconnaître, lorsqu’il réécrit la sentence de 1081, que les évêques de Bordeaux ont toujours présidé aux destinées des deux églises 54. Mais aurait-il pu penser autrement ? À l’époque où il était sacriste et entreprenait la rédaction du cartulaire, son
46. Contra sanctorum patrum institutionem autenticamque canonum auctoritatem Sancti Andree congregatio, pravo promota consilio, ad destruendum sanctissimi confessoris atque pontificis Severini cimiterium, ab initio primitive ecclesie consecratum, alterum in sua cepit ecclesia fundare modernum, Cartulaire de Saint-Seurin, n° XVI, 18.
47. Treffort 1996, 142, Lauwers 2005, 146-154. Sur l’importance du modèle de l’Ecclesia primitiva à l’époque de la réforme dite grégorienne, Miccoli 1960, 470-498.
48. Historia Turpini, I, 28, in : Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, p. 222. Une inscription relative à la consécration du cimetière, presque identique au texte du Pseudo-Turpin mais mentionnant l’intervention du Christ habillé en archevêque, se trouvait autrefois sur un mur de la collégiale : voir le texte introductif supra, p. 14.
49. Ut numquam deinceps illa ecclesia mitteret manum supra Sancti Severini ecclesiam nec ista in illam, sed ut antecessores sui (= les prédécesseurs de Goscelin) rexerant utramque ecclesiam suis cum bonis, sic regeret et ipse, Cartulaire de Saint-Seurin, p. 18-19. La formule est intéressante dans la mesure où l’on sent bien, au-delà des divergences conjoncturelles, le sentiment d’appartenir à une sorte de structure commune à deux têtes.
50. Ipsi dicebant habere cimiterium a Godefrido archiepiscopo absque calumpnia benedictum, Cartulaire de Saint-Seurin, n° XVII, 19.51. Conquesti sunt etiam de stationibus, dicentes debere in eodem loco missam decanum juste cantare, ibid. 52. Et rogavit clericos sancti Severini ecclesie, ut, si ipse moreretur, in ecclesia quam male tractaverat, sepeliretur. Quemadmodum ipse
predixit, ita ejusdem congregatio sancti Severini honorifice in medio ejusdem ecclesie sepelivit, ibid. 53. Les chanoines promettent nunquam amplius cimiterium in ecclesia sua facturos, ibid., p. 20. Quant à Amat, ex toto difinivit cimiterium
nunquam ibi amplius esse facturum, ibid. 54. Voir supra, n. 31 On peut aussi relire sous cet angle la notice de 1060 relative à Barbezieux, où il est dit que la collégiale tiendra
cette église ab eodem sancto et archiepiscopo, Cartulaire de Saint-Seurin, n° XII, 13. Tout cet épisode montre que si Saint-Seurin prétend tenir Barbezieux, c’est à travers l’archevêque.
rufat et le Premier cartulaire de Saint-Seurin – 137
doyen se nommait Bertrand. Or ce Bertrand était le neveu de l’archevêque Bertrand de Montaut (1162-1173) 55… On sait par ailleurs que certains chanoines appartenaient aussi, en droit sinon dans les faits, au chapitre rival. Un acte des années 1160-1180 dresse ainsi la liste des biens donnés à Saint-Seurin par Raymond le sacriste (Raimudnus dictus sacrista) au moment où il fut reçu comme “frère et conchanoine” dans le chapitre de la collégiale 56. Or Raymond était alors sacriste de Saint-André. Ce processus d’association est également attesté en sens inverse. Dans un acte sans doute quelque peu postérieur, le chanoine Milon, qui fut durant de nombreuses années, après le doyen et avant Rufat lui-même, le deuxième chanoine le plus important de Saint-Seurin, se voit qualifié de canonicus ecclesie Sancti Andree et ecclesie Sancti Severini 57. Raymond le Sacriste d’un côté, Milon de l’autre, ce sont visiblement les plus hauts dignitaires des deux chapitres qui pouvaient bénéficier de cette double appartenance. Cependant, ce concanonicat ne signifie certainement pas que les chanoines se partageaient à part égale entre les deux institutions. Ils appartenaient en réalité au clergé de Saint-Seurin ou à celui de Saint-André. Leur intégration au sein de l’institution rivale et complémentaire était honorifique et leur ouvrait assurément des droits en matière de commémoration 58. Cette complémentarité structurelle, qu’il conviendrait évidemment d’étudier beaucoup plus en détail, n’était en rien contradictoire avec le maintien d’une rivalité constante sur le plan des intérêts, des pouvoirs et aussi, mais ces choses ne sont guère dissociables, du “capital symbolique”. Rufat fondait celui-ci sur une antériorité qui renvoyait aux premiers temps du christianisme : non seulement les saints évêques, Amand et Seurin, avaient été inhumés dans la collégiale, mais encore le cimetière de celle-ci avait été consacré à l’époque fondatrice de l’Eclesia primitiva. Saint-Seurin tirait donc sa légitimité des origines mêmes de l’Église bordelaise.
le caRtulaiRe de Rufat, “lieu de mémoiRe” d’un homme et de sa paRenté
Les développements qui précèdent se sont attachés d’une part à reconstituer la structure du premier cartulaire de Saint-Seurin, composé à la fin du xiie siècle, d’autre part à bien marquer l’importance fondatrice de quelques actes datant essentiellement de la seconde moitié du xie siècle mais réécrits par la suite. La compilation est aussi création, elle a un sens et des objectifs, elle est l’œuvre de Rufat, au sens plein du terme. Celui-ci transmet ensuite des dizaines d’actes, donations, ventes et “restitutions”, qui se font plus nombreux à mesure que l’on approche de la fin du xiie siècle. On ne les étudiera pas en tant que tels, seul le cartulaire en tant que projet cohérent nous retenant ici. Mais il convient tout de même d’insister pour terminer sur la place de Rufat lui-même dans cet ensemble d’actes.
Qui était Rufat ? J.-A. Brutails parle toujours de lui, à juste titre, comme du sacriste, nom sous lequel notre homme se désigne dans le prologue 59. Tous les rédacteurs ou concepteurs de cartulaires ne déclinent pas leur identité, loin de là, mais Rufat le fait clairement… Ce personnage issu d’une grande famille bordelaise ne fut pas toujours sacriste, puisqu’il apparaît comme doyen de la collégiale entre 1182 et 1199 60. Il avait alors atteint le sommet du cursus honorum à Saint-Seurin. Cette situation pose le problème d’une exacte datation de son cartulaire, question que J.-A. Brutails n’a pas abordée mais qui n’est pas sans intérêt. En effet, de nombreux actes mentionnent Rufat comme decanus et non plus sacrista. On doit donc admettre que si le projet de cartulaire fut entrepris avant 1182, il fut poursuivi sous le “décanat” de Rufat, soit directement par lui, soit par des collaborateurs proches, ce qui ne fait pas beaucoup de différence. Le dernier document daté mentionnant le “doyen Rufat” date de 1199 61. Or cet acte commence par la formule Rei geste memoria scripture solet beneficio conservari, qui est plus ou moins calquée sur la première phrase du prologue (decrevit antiquitas res gestas scripti
55. Voir la donation d’Amanieu de Veyrines, à l’occasion de l’entrée de son frère Pierre au chapitre, in manu Bertrandi archiepiscopi et Bertrandi decani, nepotis ejus, Cartulaire de Saint-Seurin, n° XLVIII, 42 (années 1163-1173).
56. Notum sit omnibus presentibus et futuris quod Raimundus dictus Sacrista, cum a canonibus Sancti Severini in fratrem et concanonicum fuerit susceptus, dedit…, Cartulaire de Saint-Seurin, n° CXVII, 88-89. Raymond réapparaît dans la donation par l’archevêque Guillaume Ier, dit le Templier, de l’église de Gaillan à Saint-Seurin (ibid., n° CXXXI, 99).
57. ibid., n° CXXXIII, 102. Sur Milon, voir infra, n. 74.58. On ne connaît pas de nécrologe manuscrit de Saint-Seurin, mais Françoise Lainé prépare actuellement l’édition du nécrologe de
Saint-André. Celui-ci devrait permettre de mieux comprendre les relations entre les deux chapitres. Peut-on part ailleurs percevoir l’existence de “conchanoines laïques”, comme on en trouve en Péninsule ibérique mais aussi sans doute à Dax ? Un texte de la fin des années 1160 signale que Milet, fils d’Amanieu de Pessac, a été reçu par les chanoines comme fratrem et concanonicum (Cartulaire de Saint-Seurin, n° CV, 83). L’expression utilisée est la même que pour le concanonicat entre chanoines de la note 56. Mais peut-être Milet est-il simplement devenu chanoine à Saint-Seurin ? Sur la question du concanonicat à Dax et en Péninsule ibérique, avec rappel de la bibliographie antérieure, voir Ryckebusch 2004, 34-45.
59. Quapropter ego Rufatus, ejusdem ecclesie canonicus et sacrista, Cartulaire de Saint-Seurin, n° VI, 6.60. Le dernier document daté à mentionner Rufat avant son accession au décanat est une donation d’un manse sis à Ambarès, anno
ab incarnatione Domini MCLXXX, Cartulaire de Saint-Seurin, n° CXXXV, 104. Le doyen Bertrand, qui n’est pas mentionné dans cet acte, est cependant présent dans la vente du bois du Bouscat le 14 février 1180 (n° CXXXVII, 107). Le premier acte daté à mentionner Rufat comme doyen est du 22 août 1182 (n° CXXXIX, 108). Rufat a donc remplacé Bertrand au poste de doyen à une date comprise entre le 14 février 1180 et le 22 août 1182.
61. Cartulaire de Saint-Seurin, n° CLXV, ici p. 128 (31 mars 1199).
138 – Patrick Henriet
memorie comendare) 62. Il est difficile de ne pas voir ici une intervention personnelle de l’ancien sacriste, d’autant que l’accord en question est conclu in domo predicti decani 63. Présent dans les actes du cartulaire en tant que sacriste depuis plus de trois décennies, celui-ci était sans doute alors assez âgé, et l’on peut penser que l’accord fut conclu dans sa maison car il ne pouvait plus se déplacer 64. Il mourut vraisemblablement peu de temps après.
Le cartulaire fut donc régulièrement complété pendant dix-sept sans au moins, sans doute plus en réalité. Il était un livre ouvert et représentait assurément l’une des principales activités d’écriture de la collégiale dans les dernières décennies du xiie siècle. On a vu l’orientation de ce projet : indépendance de Saint-Seurin face au pouvoir comtal et face au pouvoir du chapitre cathédral, affirmation d’une identité canoniale, défense des droits seigneuriaux, construction d’un passé glorieux légitimant les prétentions du présent. Mais on peut aussi se demander si ce “lieu de mémoire” collectif n’était pas aussi un lieu de mémoire individuel et familial 65. Il n’est en effet pas indifférent de constater que Rufat est de loin la personnalité la plus présente dans le cartulaire. On relève au total plus d’une soixantaine d’occurrences de son nom, qui vont des années 1160 à 1199 66. Certains actes montrent clairement que Rufat se préoccupait de consigner pour la prospérité certaines décisions familiales importantes, à conditions bien entendu qu’elles eussent un rapport avec Saint-Seurin. Sont ainsi conservés l’acte par lequel Giralda, sa mère, fait une donation à la collégiale afin d’y entretenir sa mémoire et celle de son époux, également appelé Rufat 67. Le frère de Rufat, un miles nommé Galard, apparaît également dans l’acte. La notice suivante rapporte comment notre sacriste avait progressivement acquis les quatre parts d’une maison de pierre, qui n’était pas celle où il vivait 68. Ailleurs, après avoir rappelé la nécessité d’entretenir la mémoire de ses parents, Rufat fonde un anniversaire pour lui-même 69. Ailleurs encore, c’est un troisième Rufat, fils de Galardus et neveu du notre, qui rentre à Saint-Seurin 70. Ce personnage réapparaît ensuite comme sacriste à l’époque où son oncle est doyen : sans doute celui-ci avait-il formé celui-là pour prendre sa succession 71. Nous découvrons un peu plus loin deux autres neveux de l’auteur du cartulaire, Guillaume Bertrand et Boniface 72. Enfin, certains indices montrent que ses relations avec des parents plus ou moins éloignés appartenant au puissant groupe des Bordeaux restèrent sans doute privilégiées 73. Au total, la question des liens de parenté entre les chanoines et l’aristocratie locale, mais aussi sans doute des chanoines entre eux, voire des chanoines de Saint-Seurin avec ceux de Saint-André, apparaît fondamentale et mériterait d’être étudiée plus à fond 74.
62. Un autre acte, qui se présente sous la forme d’une notice, non daté, daté, proche de celui-ci dans le cartulaire et sans doute dans le temps, utilise une formule analogue : exogitavit [sujet : antiquorum sollertia] rerum gestarum seriem et ea maxime que perpetuitatem desiderant scripture laqueis innodare, Cartulaire de Saint-Seurin, n° CLXXII, 131.
63. Actum est hoc pridie kalendas aprilis in domo predicti decani, Cartulaire de Saint-Seurin, n° CLXV, 128.64. Le plus ancien acte mentionnant Rufat date des années 1162-1169. Il y donc entre le premier et le dernier acte datés mentionnant
Rufat une période comprise entre 32 et 37 ans. Mais Rufat n’a évidemment pas intégré le chapitre comme sacriste. 65. L’envahissante présence de Rufat dans le cartulaire n’est sans doute pas un fait isolé. Elle rappelle par exemple celle de Folcuin et
de son “cartulaire-chronique” au début des années 960 : voir Morelle (à paraître). Mes remerciements à l’auteur pour m’avoir permis de lire son article avant parution.
66. Dans l’index de Brutails, Rufat apparaît sous les entrées “Rufat doyen de SS”, “Rufat sacriste de SS”, et aussi “Rufat chanoine”, puisqu’il s’agit de notre Rufat dans sept cas sur onze. Je relève en tout 47 actes dans lesquels le nom de Rufat apparaît une ou plusieurs fois (éd. Brutails, n° VI, XXXII, XLVII, XLVIII, XCII, XCVII, XCIX à CI, CV à CVII, CIX à CXI, CXVI, CXVII, CXIX CXXIII, CXXIV, CXXX, CXXXIV à CXXXVI, CXXXVIII, CXXXIX, CXLI, CXLIII, CXLVI, CXLIX à CLXV, CLXVIII, CLXIX). Pour un total de 167 pièces, Rufat est donc présent dans 28 % des cas.
67. Giralda, mater Galardi militis et Rufati canonici, cum circa finem suum rebus suis disponeret, dedit ecclesie Sancti Severini, pro suo anniversario et mariti sui Rufati et ut orationum ipsius ecclesie ambo participes fierent…. , Cartulaire de Saint-Seurin, n° CXXIII, 93. La donation de la mère a eu lieu consilio et assensu predictorum filiorum suorum.
68. Cartulaire de Saint-Seurin, n° CXXIV, 95 (il est question d’une domus lapidea qui se trouve inter solium operarii ubi manet Milo canonicus et solium sacriste ubi manet Rufatus sacrista).
69. Sciendum est quod Rufatus, decanus ecclesie Sancti severini, pro suo anniversario XII solidos ordinavit…, Cartulaire de Saint-Seurin, n° CLXIII, 126.
70. Cartulaire de Saint-Seurin, n° CXIX, 90-91. Il est à noter que Rufat sacriste effectue une donation à Saint-Seurin en même temps que son frère Galardus. Le rôle des neveux dans les actes du cartulaire mériterait une étude. Voir aussi sur ce point supra, p. 137 et n. 55, le lien entre l’archevêque Bertrand de Montaut et le doyen Bertrand.
71. Cartulaire de Saint-Seurin, n° CXLI (1183), 110 et n° CXLVI (1184), 114. Dans le document de 1183, Rufat le jeune apparaît d’abord dans une liste de chanoines comme “neveu du doyen” (presentibus… Rufato nepote decani…, p. 109), puis comme sacrista (p. 110). Dans un document daté de 1199, le sacriste s’appelle B. Vigerius. Le neveu était peut-être mort.
72. …et Willelmus Bertrandi et Bonifacius, frater ejus, nepotes decani, Cartulaire de Saint-Seurin, n° CLXIII, 129.73. Arbre généalogique de la famille dans Boutoulle 2007, 363. Dans son testament (Cartulaire de Saint-Seurin, n° CXXXVI, 104-106),
Pierre III de Bordeaux confie la garde de sa maison, de sa femme et de ses enfants à Raimundus Arnaldi et Galardus, qui appariennent à la branche de cette maison où se trouve également Rufat (Boutoulle 2007, tableaux p. 362-363 et la note du tableau p. 362). Galardus (voir supra, n. 70) est précisément le frère de celui-ci. Ajoutons que cette décision est prise en présence de deux chanoines, Mathieu et, précisément, Rufat. Ce Mathieu ne semble pas avoir eu de dignité particulière au sein du chapitre et n’apparaît que deux autres fois, Cartulaire de Saint-Seurin, n° CXVI, 88 et n° CXXI, 91-92. Ce dernier document se présente sous la forme d’une double notice donnant la liste des donations effectuées pour son entrée au chapitre et in morte sua. On peut se demander s’il n’appartient pas à la même nébuleuse familiale que Pierre de Bordeaux et Rufat.
74. Le cas du chanoine Milon, qui apparaît dans plusieurs dizaines de documents, est éclairant mais demanderait aussi à être étudié plus précisément. Milon confirme normalement après le doyen Bertrand et avant Rufat lorsque celui-ci est sacriste. Il occupe donc pendant longtemps la seconde position au sein du chapitre, alors que Rufat occupe la troisième. Or un document non daté, qui renvoie à des événements antérieurs
rufat et le Premier cartulaire de Saint-Seurin – 139
Rufat passa au moins quarante ans dans le chapitre de Saint-Seurin, dont il fut sacriste puis doyen. Clerc et notable, il apparaît comme le grand homme de la collégiale dans la seconde moitié du xiie siècle. Chanoine séculier, il était bien éloigné de la régularité qui, ailleurs et à la même époque, semblait si attrayante à des esprits désireux de mener vie parfaite. Le dernier acte à le mentionner, en 1199, fut comme nous l’avons vu dressé dans sa propre maison 75. Il précède sans doute de peu son décès. Défenseur infatigable des intérêts de son Église, Rufat entreprit avec son cartulaire la composition d’une sorte de mémorial construit selon un système qui rappelle celui des poupées russes, ou encore, si l’on préfère, qui s’organise en une série de cercles concentriques. Au centre du dispositif, on trouve sa propre personne, constamment citée. Ses proches parents, père et mère, frère, neveu, apparaissent ensuite. Au-delà se trouvent des aristocrates laïques et d’autres chanoines du chapitre, parents plus lointains et non présentés comme tels. Le cartulaire nous fait pénétrer au sein d’une société dirigée par des ecclésiastiques et des laïques, tous plus ou moins directement apparentés. Mais si Rufat est un bon représentant de ces notables qui savaient vivre confortablement sans oublier leurs devoirs religieux, s’il apparaît comme un gestionnaire avisé, il n’en fut pas moins un idéologue, le seul que nous connaissions nommément pour Saint-Seurin au xiie siècle. Nous sommes habitués aux constructions mémoriales émanant des cathédrales, des monastères et des milieux de chanoines réguliers. Mais Rufat, qui a subtilement enchâssé la mémoire de sa famille et la sienne propre dans le cartulaire du grand saint bordelais, nous montre que les collégiales séculières n’étaient pas nécessairement en reste. C’est aussi l’intérêt de ce dossier.
conclusion : “pRospéRité dans la vie pRésente et félicité dans la vie futuRe”Le premier cartulaire de Saint-Seurin consigne ce que Rufat appelle les res gestas de la collégiale. Il constitue à la fin
du xiie siècle une pièce essentielle dans la définition d’une identité canoniale en même temps que dans la défense de droits seigneuriaux soigneusement consignés. Les deux orientations ne sont d’ailleurs pas dissociables. Suivant l’ordre du temps, Rufat pose dès les premiers folios les trois libertés fondamentales de la collégiale : liberté vis-à-vis des pouvoirs laïques et en particulier des comtes, qui prennent leur charge, leur glaive et leur vexillum sur l’autel de saint Seurin ; liberté vis-à-vis des moines de Cluny, qui manquèrent de peu, au milieu du xie siècle, d’absorber la prestigieuses collégiale ; liberté, enfin, vis-à-vis du chapitre concurrent de Saint-André, qui contestait divers privilèges de la collégiale. Comme beaucoup de cartulaires, celui de Rufat, ultérieurement poursuivi par des continuateurs, est bien plus qu’une compilation supposément exhaustive et fidèle. Au côté de la Vita sancti Severini (BHL 7650) jadis exhumée par le chanoine Cirot de la Ville, grand érudit et lointain successeur de Rufat, au côté aussi, peut-être, de la Chronique saintongeaise du Pseudo Turpin, il est l’un des textes les plus importants produits par la collégiale au cours du Moyen Âge central.
Lieu privilégié des constructions idéologiques propres aux chanoines de Saint-Seurin, le cartulaire de Rufat apparaît aussi comme le résumé d’un “système de salut” sans doute dominant au cours du Moyen Âge central, système qui mêle inextricablement le spirituel et le matériel, le pouvoir et les sacralités, le terrestre et le céleste. Mais on a tout de même le sentiment que nos chanoines séculiers avaient particulièrement peu d’états d’âme au moment de justifier l’enrichissement terrestre ! Rufat n’explique-t-il pas lui-même, dans son long prologue écrit tout entier à la gloire de saint Seurin, comment les bons comtes jouiront de “la prospérité dans la vie présente et de la félicité dans la vie future” ? 76 La félicité céleste s’accommodait visiblement fort bien de la “la richesse en biens terrestres” (de terrenis bonis habundantiam), une richesse dont il était possible de jouir au cours d’une vie très longue 77. Prospérité matérielle ici-bas, salut dans l’au-delà : assurément, cet idéal n’était pas proposé aux seuls bienfaiteurs et protecteurs, mais aussi aux chanoines de Saint-Seurin.
à 1180 puisque Pierre III de Bordeaux († 1180) est vivant, signale que Milon était cognatus de celui-ci (aliam sortem habuerat jam ecclesia pro Milone canonico, cognato suo, Cartulaire de Saint-Seurin, n° CXX, 91). Ce document consigne l’entrée au chapitre de Raimond Guillem, lui-même frère de Pierre de Bordeaux ! Et Pierre III étant comme on l’a vu lointainement apparenté à Rufat (voir n. 74), ce dernier l’était aussi avec Raimond Guillem et Milon ! Ce dernier disparaît de la documentation juste avant l’accession de Rufat au canonicat. On en vient à se demander s’il existait beaucoup de chanoines n’entretenant aucune espèce d’attache familiale entre eux… Pour les liens de parenté entre les chanoines des deux chapitres, voir par exemple le cas du doyen Bertrand supra, n. 55.
75. Voir n. 63. Il semble légitime de penser que l’acte fut dressé dans la maison de Rufat car celui-ci était malade et ne pouvait plus se déplacer. La fondation de son anniversaire se trouve au folio précédent (voir n. 69), ce qui indique sans doute aussi une proximité chronologique et renforce l’idée que Rufat voyait alors sa fin comme proche.
76. Hec si quis comes bene persolvat et locum sancti Severini in honore et in defensione habeat, pro certo sciat se habiturum omnem prosperitatem et in presenti et in futuro vite felicitatem…, Cartulaire de Saint-Seurin, n° VII, 7.
77. …sciat se sancti Severini intercessione longitudinem habere vite et de terrenis bonis habundantiam ac contra inimicos suos ubique constanciam, ibid.
140 – Patrick Henriet
Sources manuscrites
Archives Départementales de la Gironde (AD Gironde)
G. 1030
Sources éditées
Cartulaire de l’église collégiale Saint-Seurin de Bordeaux, éd. J.-A. Brutails, Bordeaux, 1897.
Cartulaire du prieuré de Notre-Dame de Barbezieux, éd. J. de la Martinière, Paris-Saintes, 1911.
Chronique dite Saintongeaise. Texte franco-occitan inédit “Lee”. A la découverte d’une chronique gasconne du xiiie siècle et de sa poitevinisation, éd. A. de Mandach, Tübingen, 1970 (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 120).
Cirot de la Ville, J.-P.-A. (1859) : “Vie inédite de saint Seurin, tirée d’un eucologe manuscrit du xiiie siècle, appartenant à la Fabrique de l’église Saint-Seurin de Bordeaux”, AHG, 1, Bordeaux, 1859, n° 201, 426-444. [= BHL 7650 & 7651 (5621)]
Geoffroy d’Auxerre : Vita prima sancti Bernardi, éd. J.-P. Migne, PL, 185, col. 396-416.
Liber sancti Jacobi. Codex Calixtinus, éd. K. Herbers et M. Santos Noia, Saint-Jacques de Compostelle, 1998.
Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny, IV (1027-1090), éd. A. Bernard et A. Bruel, Paris, 1888.
Regesta imperii, I, éd. J.-F. Böhmer J.-F. et E. Mühlbacher, Hildesheim, 1966.
Références bibliographiques
Adler, A. (1963) : Rückzug in epischer Parade. Studien zu Les Quatre Fils Aymon, La Chevalerie Ogier, Garin le Lorrain, Raoul de Cambrai, Aliscans, Huon de Bordeaux, Francfort.
Boutoulle, Fr. (2007) : Le duc et la société. Pouvoirs et groupes sociaux dans la Gascogne bordelaise au xiie siècle (1075-1199), Bordeaux.
Chastang, P. (2001) : Lire, écrire, transcrire : le travail des rédacteurs de cartulaires en Bas-Languedoc, xie-xiiie siècles, Paris.
Claude, H. (1966) : “Le légat Gérard d’Angoulême et la résistance de l’abbaye de Baignes à la centralisation clunisienne”, in : Gallais & Riou 1966, 515-521.
Diener, H. (1959) : “Das Itinerar des Abtes Hugo von Cluny”, in :Tellenbach 1959, 353-426.
Cowdrey, E. H. J. (1970) : The Cluniacs and the Gregorian Reform, Oxford.
Gallais, P. et Y.-J. Riou, éd. (1966) : Mélanges offerts à René Crozet à l’occasion de son 70e anniversaire par ses amis, ses collè-gues, ses élèves et les membres du CESCM, Poitiers.
Geary, P. (2001) : “Auctor et auctoritas dans les cartulaires du Haut Moyen Âge”, in : Zimmermann 2001, 61-71.
Guyotjeannin, O, L. Morelle et M. Parisse, éd. (1993) : Les cartulai-res, Actes de la table ronde organisée par l’École nationale des chartes et le GDR 121 du CNRS (Paris, 5-7 décembre 1991), Paris.
Iogna-Prat, D. (2006) : La Maison Dieu. Une histoire monumentale de l’Église au Moyen Âge (v. 800-v. 1200), Paris.
Köhnle, A. (1993) : Abt Hugo von Cluny, 1049-1109, Sigmaringen.
Lauwers, M. (2005) : Naissance du cimetière. Lieux sacrés et terre des morts dans l’Occident médiéval, Paris.
Le Blévec, D., dir. (2006) : Les cartulaires méridionaux, Paris.
Lopès, H. [1668] 1882-1884 : L’église métropolitaine et prima-tiale de Sainct-André de Bourdeaux, où il est traité de la noblesse, droits, honneurs et prééminences de cette Église, avec l’histoire de ses archevesques et le pouillé des bénéfices du diocèse, Bordeaux, 2 vol, rééd. annotée et complétée par M. l’abbé Callen.
Maillé, A. de (1960) : Recherches sur les origines chrétiennes de Bordeaux, Paris.
Maxwell, R. (à paraître) : Representing History, 1000-1300 : Art, Music, History.
Meaudre de Lapouyade, M. (1936) : “Le chanoine Rufat de Bordeaux, rédacteur du cartulaire de Saint-Seurin”, Revue historique de Bordeaux, 29, 242-243.
— (1938) : “Le chanoine Rufat de Bordeaux scribe du Grand Sancius, cartulaire original de Saint-Seurin”, Revue histori-que de Bordeaux, 31, 110-118.
Miccoli, G. (1960) : “Ecclesiae primitivae forma”, Studi Medievali, 3e ser. II, 470-498.
Morelle, L. (à paraître) : “Diplomatic Culture and History Writing : The Chronicle-Cartulary of St-Bertin by Folcuin (961/962)”, in : Maxwell (à paraître).
Mussot-Goulard, R. (1982) : Les princes de Gascogne, Lectoure.
Ryckebusch, F. (2004) : “Entre la règle et le siècle : les chanoines de Dax dans le Liber rubeus”, L’Église et la société dans le diocèse de Dax aux xie-xiie siècles, Journée d’études sur le Livre rouge de la cathédrale de Dax (Dax, 1er mai 2003), Dax, 17-45.
Tellenbach, G., éd. (1959) : Neue Forschungen über Cluny und die Cluniazenser, Fribourg.
Treffort, C. (1996) : L’Église carolingienne et la mort. Christianisme, rites funéraires et pratiques commémoratives, Lyon.
Zimmermann, M., éd. (2001) : Auctor et auctoritas. Invention et conformisme dans l’écriture médiévale, Paris.




















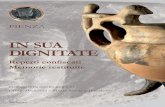




![Memorie si patrimoniu. Inventarul bisericii evanghelice din Cisnadie (judeţul Sibiu) [Memory and Heritage. The Inventory of the Lutheran Church in Cisnadie (Sibiu County)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63419116b29ad637670103c7/memorie-si-patrimoniu-inventarul-bisericii-evanghelice-din-cisnadie-judetul-sibiu.jpg)











