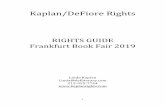« Littérature », « littéraire » et supports d’écriture. Contribution à une théorie de la...
Transcript of « Littérature », « littéraire » et supports d’écriture. Contribution à une théorie de la...
EEGGYYPPTTOOLLOOGGIICCAALLDOCUMENTS, ARCHIVES & LIBRARIES
E DA L
II . 2010/2011
PONTREMOLI EDITORE
EGYPTIAN &
ED
AL
II ·
2010
/201
1
EGYPTOLOGICAL
EGYPTOLOGICAL
EDAL II . 2010 / 2011
ISSN 20382286
© 2011 PONTREMOLI EDITOREall rights reserved
Libreria Antiquaria Pontremolivia Vigevano 15 . 20144, Milano !MI", Italytel +39 02 58103806 . fax +39 02 58102157www.libreriapontremoli.it . [email protected]
layout & designGiacomo Coronelli
printed byTipostampa, Moncalieri !TO", Italy
price of the single issue !inclusive of VAT and shipping"· Europe # 95 institutions / # 65 privates· Abroad # 115 institurions / # 85 privates
For purchase and any information please contact us
SCIENTIFIC BOARDManfred Bietak !Wien"
Peter Der Manuelian !Boston, MA"Christopher J. Eyre !Liverpool"
Jochem Kahl !Berlin" Antonio Loprieno !Basel"
Jaromír Málek !Oxford"Laure Pantalacci !Lyon $ Cairo"
Stephen Quirke !London"Pascal Vernus !Paris"
HONORARY BOARDJohn Baines !Oxford"
Sergio Donadoni !Roma"Anna Maria Donadoni Roveri !Roma"
Nicolas Grimal !Paris"Jean Leclant!!Paris"
William Kelly Simpson !Katonah, NY"
DIRECTOR & EDITOR$IN$CHIEFPatrizia Piacentini
EDITORSLaura Marucchi
Christian Orsenigo
EDAL is a peer$reviewed journal
E D A L
II . 2010 / 2011
Editorial. The activities of the Egyptological Archives and Library ofthe Università degli Studi di Milano !2010"2011#
Patrizia Piacentini
« Littérature », « littéraire » et supports d’écriture. Contribution à unethéorie de la littérature dans l’Égypte pharaonique
Pascal Vernus
The Anglo"Saxon"Branch of Berlin School. The war"correspondence!1914"1916# of J.H. Breasted !1865"1935# and J.P.A. Erman !1854"1937#
Thomas L. Gertzen
Gardiner and graffitiHana Navrátilová
Who was Who in EgyptologyMorris L. Bierbrier
Il dottor Granville e la sua mummiaPaola Cosmacini
The Egyptological Archives and Library of the Università degli Studidi Milano. Bibliography !II #
Christian Orsenigo
List of Authors
Plates
EDAL II . 2010 / 2011
TABLE OF CONTENTS
PAGE 9
19
147
171
187
193
215
221
223
I testi antico!egiziani sono scritti su due tipi principali di supporti, destinati a uso pratico "papiri, tavolette,ostraca#, o a memoria perenne "monumenti in senso lato#. A partire da questa distinzione di base, il presentecontributo si prefigge di chiarire le diverse utilizzazioni dei termini « letteratura » e « letterario » in Egittologia,che si raggruppano attorno a due significati principali: "A# in senso lato/debole, « letteratura » e « letterario » siriferiscono a testi che non sono strettamente legati alle necessità terrene e quotidiane di ambito privato o pubblico;"B# in senso stretto/forte, si riferiscono invece a testi che si possono considerare come appartenenti alla « letteraturadi alto livello » "« belles!lettres » o « schöne Literatur »#.All’interno del senso lato/debole "A#, si devono distinguere due sottocategorie: "A.I# comprendente tutti i tipi di testisenza riguardo delle superfici su cui sono scritti; "A.II# ristretta a testi scritti su supporti maneggevoli. Lasottocategoria A.I è ben rappresentata nelle antologie classiche della letterartura egizia. Un testo deve rispondere adue criteri per essere classificato in questa sottocategoria: un criterio negativo $ il testo non deve essere il prodottodi attività terrene e quotidiane $ un criterio positivo $ il testo deve focalizzarsi almeno in parte sul messaggioche esprime di per se stesso, in un deliberato sforzo « estetico » che non era richiesto dal mero assolvimento del suoscopo primario. La sottocategoria A.II riflette una preoccupazione più tecnica. È ristretta a testi scritti su papiro,tavolette e ostraca. Ingloba tutti i tipi di testi che concernono l’universo culturale e immaginario egizio. Non èfondamentalmente richiesto alcun criterio « estetico ». All’interno di questi testi si può fare una distinzionesecondaria tra quelli « semi!letterari », che in ultima analisi fanno riferimento alla conoscenza, e quelli « letterari »veri e propri.Il senso stretto / forte "B# solleva il problema difficile e molto dibattuto di cosa sia « letteratura ». È ovvio cheproporre ancora una volta una definizione che si vorrebbe universale va ben al di là del presente contributo.Tuttavia, solo come bozza di lavoro, suggeriremmo di far entrare nell’ambito dell’« alta letteratura » quei testi cherispondono alla specifica funzione di fiction in sé e per sé. Ciò significa quei testi che riescono a ricreare un mondoautonomo e fittizio in cui l’utente possa trovare sia piacere sia spunti di riflessione critica sul mondo reale. Ottenerela connivenza del pubblico è un requisito essenziale per creare questo mondo fittizio.Sulla base di questo approccio, ci sono due categorie di testi egizi che possono essere considerati « alta letteratura »: 1. testi che sono stati scritti originariamente con questo scopo, e che sono stati riconosciuti come tali dal pubblico;
appartengono all’« alta letteratura » come destinazione primaria "ad esempio, Sinuhe#;2. testi che sono stati scritti originariamente per assolvere un’altra funzione, ma sono andati incontro a un destino
letterario grazie alla bacchetta magica della ricezione, perché il pubblico vi ha trovato qualcosa suscettibile dicreare uno specifico mondo immaginario. Questi appartengono all’« alta letteratura » per diversione o trasfi !gurazione. Per esempio, La battaglia di Qadesh era inizialmente una composizione ideologica che aveva loscopo di fornire l’interpretazione politicamente corretta di una serie di eventi storici. Ma dal momento chemostrava delle caratteristiche che potevano fornirle un interesse specifico al di là del suo scopo originario, fuapprezzata come opera di « alta letteratura » e quindi inserita in questo ambito.
« Littérature », « littéraire » et supports d’écriture.Contribution à une théorie de la littérature
dans l’Égypte pharaonique
Pascal Vernus
A Jan Assmann, qui a ouvert une« ère des Meiji » en littérature
Prolégomènes:De la nature du support dans la classification de la production écrite
1. Comme bien d’autres civilisations séparées par le temps et l’espace, lacivilisation pharaonique utilise pour fixer les textes, tout à la fois:1
· Des supports manuscrits « à fin de maniement ».2 Ce sont des supportsfondamentalement conçus pour les divers usages et manipulations auxquelspeuvent être soumis les textes: lecture silencieuse, lecture publique sousdiverses modalités, enseignement, copie, consultation, confrontation, vérifica !tion, contrôle, inventaire, récolement, comptes, archivage, etc. Dans l’ensemblequ’ils constituent avec le texte manuscrit qu’ils reçoivent " le plus souvent aupinceau ou à la brosse 3 " ces supports tiennent une place mineure, réduite àleur fonction élémentaire de rendre le texte aisément disponible pour toutes lesactivités pratiques, idéologiques ou religieuses. Corrélativement, le texte sedonne une large autonomie 4 par rapport à sa matérialisation.
1. Certaines civilisations restreignent l’usage de l’écriture à l’un ou l’autre de ces domaines. Par exemple,les écritures harapéennes ne sont connues que sur des petits objets. Ce qui a conduit certains àconclure, à tort, qu’il ne s’agissait pas d’une écriture. Cf. A. PARPOLA, L’écriture oubliée de la Vallée del’Indus, dans R. VIERS #éd.$, Les premières cités et la naissance de l’écriture: actes du colloque du 26 septembre 2009,Musée archéologique de Nice!Cemenelum, Arles 2011, pp. 155!68. Par ailleurs, on se méfiera desargumentations qui, dans des cas de ce genre, postulent systématiquement que les textes manuscritsexistaient, mais ne nous sont pas parvenus.
2. A strictement parler, on ne saurait se contenter de parler simplement de « textes manuscrits ». En effet,un texte peut être manuscrit sur un objet ou un monument, pensons, par exemple, aux graffiti. Celaposé, quand le contexte est clair, l’expression « textes manuscrits » peut être utilisée à la rigueur parabréviation pour « textes manuscrits à fin de maniement ». On pourraitt aussi utiliser la dénomination« textes sur manuscrits », à condition de restreindre le terme « manuscrits » au sens de « supports à finde maniement ».
3. Les tablettes de Balat #oasis de Dakhla$ illustrent le recours à l’incision sur argile.4. Bien entendu, cette autonomie est plus ou moins relative. La manière dont le texte est matérialisé
participe toujours de sa signification si on pousse l’analyse à l’extrême.
22 EDAL II . 2010 / 2011
Une nuance toutefois, il existe une tendance bibliophilie avant la lettre,5
dans laquelle la beauté du manuscrit participe au plaisir du texte. Elle estmarquée, entre autres, par la valorisation particulière du rouleau neuf commesupport.6
· Des supports « à fin de pérennité ». Ce sont des objets et des monu !ments qui répondent, à tout le moins en première instance,7 à d’autres finalitésqu’une simple matérialisation maniable du texte,8 et visent la pérennité de parleurs matériaux. Le texte, souvent " pas toujours " apposé selon d’autrestechniques #gravures, incisions, etc.$ que la simple écriture manuscrite à labrosse ou au pinceau " n’a pas nécessairement la prééminence sur le supportdans la signification globale de l’ensemble qu’il forme avec lui;9 il concourt à ladite signification à des degrés variables.10 Au mieux, il forme avec le supportune unité symbiotique; c’est le cas, par exemple, d’un décret gravé sur une stèle;
5. Cf. P. VERNUS, Les manuscrits de l’Égypte ancienne, dans H.!J. MARTIN ! J. VEZIN #éds$, Mise en page et miseen texte du livre manuscrit, Paris 1990, pp. 16!23. Dans un sens plus général, la distinction discernée parG. MOERS, Der „Autor“ und sein „Werk“ : Der Beginn der Lehre des Ptahhotep in der Tradition des Neuen Reiches,dans D. KESSLER ! R. SCHULZ ! M. ULLMANN ! A. VERBOVSEK ! S. WIMMER #Hrsgg.$, Texte ! Theben !Tonfragmente: Festschrift für Günter Burkard, « ÄAT » 76, Wiesbaden 2009, p. 329 entre « Schriftlichkeitund Materiälität des Schriftträgers ».
6. xsf=j n=k m!mjt.t=s Hr awty m mAw.t, « si je te réponds sur le même mode qu’elle #= ta lettre$, c’est sousforme d’un rouleau original » #P. Anastasi I, 7, 4!5$; S. SCHOTT, Bücher und Bibliotheken im Alten Ägypten:Verzeichnis der Buch! und Spruchtitel und der Termini technici, Wiesbaden 1990, p. 371 # Sfd mAwj $. Cf. aussi« C’est sur des papyrus!vierges qu’un homme met le propos de son semblable », cité ci!dessous § 54.
7. Un objet peut être réutilisé dans des « pratiques scribales »; par exemple, un vase entier, et non pas unsimple tesson, comme support: H. GUCKSH, Grabherstellung und Ostraka!Produktion, dans H. GUCKSH !D. POLZ #Hrsgg.$, Stationen: Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens. Rainer Stadelmann gewidmet, Mainz1998, pp. 283!90. Les parois des chapelles de tombe peuvent être utilisées dans le cadre de pratiquesd’école. Cf. les graffiti récemment collectés dans les tombes d’Assiout, entre autres, U. VERHOEVEN, Vonder ,,Loyalistischen Lehre“ zur „Lehre des Kaïrsu“. Eine neue Textquelle in Assiut und deren Auswirkungen, dans« ZÄS » 136 #2009$, pp. 87!98.
8. Bien entendu, les textes monumentaux présupposent, eux!aussi, mais à des stades antérieurs, des textessur supports à fin de maniement, ne serait!ce que pour leur rédaction, pour leur ordinatio. Cf., exempligratia, P. TALLET, Un nouveau témoin des « Devoirs du Vizir » dans la tombe d ’Aménemopé "Thèbes, TT 29#, dans« CdE » 80 #2005$, pp. 66!75.
9. En ce sens, cette appréciation de CH. EYRE, The Semna Stelae: quotation, genre and functions of Literature,dans S.I. GROLL #ed.$, Studies in Egyptology Presented to Miriam Lichtheim, Jerusalem 1990, p. 138, à proposd’une stèle de Sésostris III à Semna: « the direct function of the stela was carried rather by its physicalpresence than the content of its texts ».
10. Pour la relation du texte et de son support monumental, cf. le cas du naos d’Héliopolis analysé parL.D. MORENZ, Wie die Schrift zu Text wurde, dans ID. ! ST. SCHORCH #Hrsgg.$, Was ist ein text? Alttesta !mentliche, ägyptologische und altorientalische Perspektiven, « Beihefte zur Zeitschrift für die alttesta ment !liche Wissenschaft » 362, Berlin ! New York, 2007, p. 36.
23« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
dans ce cas, la matérialisation du texte développe l’impératif de publicité qui luiest propre. Inversement, le texte peut n’être qu’un élément marginal dansl’ensemble monumental qui lui sert de support; pensons, par exemple auxgraffiti des visiteurs du Nouvel Empire par rapport au complexe de Djoser oùils les avaient apposés.
Dans l’Égypte pharaonique, ces deux catégories de supports 11 sont prisesdans un système de valorisation fondé sur l’opposition entre « textes sacra lisés »et textes « non sacralisés ». Pas question ici d’entrer dans le détail d’une questiontrès complexe,12 et sur laquelle on reviendra ci!dessous #cf. § 40$. Simplement,ces deux catégories de supports définissent deux ensembles relativementautonomes, possédant leurs caractères propres, quand bien même ils sont l’un àl’autre poreux. Au demeurant, le passage d’un même texte de l’une à l’autre deces deux catégories de supports se révèle riche de significations #par exemple§§ 54!55 et 61$.
Aussi, le sens des termes « littérature » et « littéraire » peut varier, selonqu’on les applique indistinctement à l’un et à l’autre ou qu’on les restreint à unseul.
11. H. KEES, Die ägyptische Literatur, dans B. SPULER #Hrsg.$, Der Nahe und der Mittlere Osten, I, Ägyptologie,II, Literatur, « HdO » 1, Leiden 1952, p. 1, avait proposé de distinguer « Texten, die der Öffentlichkeit vorAugen treten sollten » et « solchen, bei denen dies nicht notwendig oder sogar unerwünscht war ». Cegenre de distinction rudimentaire, mais à ne pas négliger pour autant, ne me paraît guère pertinente enl’occurrence.
12. Cette opposition se révèle opératoire dans l’analyse de la production écrite, à condition de la manieravec souplesse, sans raidissement dogmatique excessif. J’en ai esquissé les linéaments dans P. VERNUS,Support d ’écriture et fonction sacralisante dans l’Egypte pharaonique, dans R. LAUFER #éd.$, Le texte et soninscription, Paris 1989, pp. 23!34; ID., Les « Espaces de l’écrit » dans l'Égypte pharaonique, dans « BSFE » 119#1990$, pp. 35!56; ID., L’écriture du pouvoir dans l’Égypte pharaonique. Du normatif au performatif, dansA. BRESSON ! A.!M. COCULA ! CH. PÉBARTHE #éds$, L’écriture publique du pouvoir, « Ausonius Etudes » 10,Bordeaux 2005, pp. 126!28. C’est à la lumière de cette théorie qu’on peut expliquer la transposition detextes profanes dans des environnements religieux, ou inversement l’utilisaition d’une écriture profanesur un objet à fonction religieuse. J. QUACK, Inhomogenität von Ägyptischer Sprache und Schrift in Textenaus dem Späten Ägypten, dans K. LEMBKE ! M. MINAS ! N.S. PFEIFFER #eds$, Tradition and Transformation:Egypt under Roman Rule. Proceeding of the International Conference, Hildesheim, Roemer! and Pelizaeus Museum3!6 July 2008, « Culture and History of the Ancient East » 41, Leiden ! Boston 2010, pp. 325!26, apportede précieux matériaux.
24 EDAL II . 2010 / 2011
Deux acceptions annexes de « littérature »
2. C’est avec des acceptions bien différentes que le substantif « littérature »et l’adjectif « littéraire » sont utilisés à propos de la civilisation pharaonique, cesdifférences procédant aussi bien de la variété des sources, et des supports quede la diversité des perspectives et de la complexité des notions visées.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, mentionnons, pour déblayer la route,trois de ces acceptions, qui, quoique annexes par rapport au débat fondamental,méritent d’être isolées.
3. « Littérature », dans les sciences sociales, en particulier anglo!saxonnes,peut désigner l’ensemble de la production écrite d’une civilisation ou d’uneépoque: « anything written down »;13 « a broader definition includes the totalityof Egyptian transmitted written elite culture % . . .& ».14
Si cette acception se révèle peu rentable dans la pratique de l’égypto !logue, étant donné la masse écrasante de la production écrite pharaonique, ellen’en demeure pas moins légitimée par le fait même qu’elle est courammentutilisée quand prévaut un point de vue comparatiste. On doit donc en tenircompte dans une perspective transdisciplinaire.
4. Par ailleurs, s’agissant d’une même civilisation, on qualifie de « litté ra !ture » l’ensemble de la production écrite relevant de tel ou tel secteur d’activité.Par exemple, on parle
· de « littérature médicale », pour désigner la production écrite suscitéepar des activités « médicales »;
· de « littérature judiciaire », pour désigner la production écrite suscitéepar les activités « judiciaires et juridiques »;
13. J.L. FOSTER, Literature, dans D.B. REDFORD #ed.$, Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, II, Oxford 2001,p. 299.
14. R.B. PARKINSON, Poetry and Culture in Middle Kingdom Egypt. A Dark Side to Perfection, London ! NewYork 2002, pp. 4!5.
25« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
· de « littérature historique », pour désigner des textes « délibérément adres !sés à la postérité » et qui « renferment déjà une interprétation de leurépoque », et « constituent un aspect primordial de la pensée historique »;15
· de « littérature hymnique », pour désigner les textes structurés par laforme hymnique:
Literatur als Synonym für Corpus, als Zusammennfassung einer Anzahlvon Texten, die sich aufgrund bestimmter inhaltlicher, formaler undkontextueller Kriterien zu einer Gruppe zusammenfassen lassen.16
· de « wisdom literature » représentant un des « types of literature »: dansce cas, le terme recouvre plus ou moins la difficile notion de genre.17
J’arrête ici une énumération que chacun pourrait prolonger. Dans cette manièrede segmenter la production écrite selon des critères thématiques ou formels,sont pris en compte des textes de provenances, de dates, de statuts, decontextes d’utilisation très différents. Ils constituent une « littérature » du seulfait que le passage à l’écrit leur confère une formalisation textuelle.18
5. Dans le même ordre d’idées, on désigne sous le terme « littérature », unensemble matériel provenant d’un même contexte archéologique, la manièremême dont l’ensemble avait été constitué montrant que les égyptiens luiavaient reconnu une certaine cohérence. Le fondement de cette cohérencepouvait être une spécialisation. Ainsi l’ensemble représenté par les manuscritstrouvés au Ramesséum dans le coffret d’un magicien du Moyen Empire avancéa pu être qualifié de « littérature professionnelle ». Nous sommes bien prochede l’acception signalée précédemment.
A la cohérence pour ainsi dire « archéologique » de ces ensembles, il y a
15. A. ROCCATI, La littérature historique sous l’Ancien Empire égyptien, Paris 1982, p. 14.16. C. KNIGGE, Das Lob der Förschung. Die Entwicklung ägyptischer Sonnen! und Schöpfungshymne, nach dem
Neuen Reich, « OBO » 219, Fribourg ! Göttingen 2006, p. 6.17. FOSTER, Literature, p. 300; cf. ci!dessous § 42, pour les trois « types of literature ».18. « La démotivation du discours factuel au moyen de sa formalisation textuelle marque la naissance de la
littérature », selon A. ROCCATI, Le temps différé dans les récits égyptiens, dans L. GABOLDE #éd.$, Hommagesà Jean!Claude Goyon offerts pour son 70ème anniversaire, « BdE » 143, Le Caire 2008, p. 343.
26 EDAL II . 2010 / 2011
aussi d’autres fondements. Ainsi, certains qualifient de « littérature familiale »,des textes réunis en un ensemble dont la finalité est la perpétuation d’uneculture familiale. A dire vrai, beaucoup préféreront les termes « archives patri !mo niales » ou « archives mémoriales », ou mieux encore de « bibliothèque ».
6. Justice ayant été rendue à ces deux acceptions adjacentes, consacrons!nous aux emplois les plus usuels. Ces emplois usuels se regroupent autour dedeux sens:
A. dans un sens large/faible, « littérature » et « littéraire » sélectionnent dansl’ensemble de la production écrite, les textes qui ne relèvent pas dutrivial et des nécessités terre!à!terre de la sphère privée ou publique;
B. dans un sens restreint/fort « littérature » et « littéraire » sélectionnentdans l’ensemble de la production écrite, les textes susceptibles de releverdes « belles!lettres » de la « schöne Literatur ».
A. « littérature » « littéraire » au sens large / faible
7. Ce sens « faible » ou « large » est lui!même susceptible de fluctuation,selon qu’on l’applique:
A.I. à l’ensemble de la production écrite, quelle que soit la nature du support,quelle que soit la nature de l’écriture #écriture hiéroglyphique outachygraphie$;
A.II. aux seuls textes manuscrits sur supports « pour maniement » #papyrus,tablettes, ostraca, cf. § 1$.
A.I. « Littérature » et « littéraire » appliqués à l ’ensembledes textes quels que soient leurs supports
8. Dans une perspective très générale, on classe comme « littéraires » ourelevant de la « littérature » au sens large des textes choisis dans l’ensemble de la
27« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
production écrite de l’Égypte pharaonique, quelle que soit la catégorie dessupports sur lesquels ils ont été fixés, c’est!à!dire, pour reprendre notreterminologie, aussi bien les supports « à fin de maniement » que les supports « àfin de pérennité » #cf. ci!dessus § 1$.
Cette classification est fort bien illustrée dans deux anthologiesdevenues des classiques. D’une part, celle proposée par Myriam Lichtheim,19
d’autre part, celle réunie par William Kelly Simpson.20 Certes, dans l’une etl’autre, ont été retenus des textes que nous sommes spontanément inclinés àclasser comme « littérature », selon notre conception moderne des « belles!lettres »: oeuvres narratives, sapientiales, lyriques #cf. § 42$.
Mais, par ailleurs, ont été élus aussi des textes qui, au débotté, neparaissent guère en relever, par exemple les « royal decrees », « private tombsinscriptions », « theological treatises », « prayers », « penitentials hymns »,« Book of the Dead », etc. Symptomatiquement, dans le sous!titre de la plusrécente édition de William Kelly Simpson #2003$, ont été ajoutés Stelae,Autobiographies à Stories, Instructions and Poetry de l’édition de 1972. Qui plus est,chez lui comme chez Myriam Lichtheim, ont été également élus des textesdélibéremment inaccessibles à un quelconque public; ainsi les Textes despyramides, gravés dans les appartements funéraires à jamais clos " en théorie "ou les Textes des sarcophages tracés sur des sarcophages déposés au fin fond de lachambre sépulcrale.
Indifférentes aux motivations qui régissent le choix des supports, leurlocalisation et leurs conditions d’accès, ces anthologies s’attachent davantage àla simple teneur du texte, plutôt qu’à l’ensemble qu’il constitue avec sesmatérialisations. S’étant ainsi affranchies du support, elles mettent en oeuvredeux critères fondamentaux pour distinguer ce qui est « littéraire » ou relève dela « littérature » et ce qui ne l’est pas.
19. M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, I: The Old and Middle Kingdoms, II: The New Kingdom, III: TheLate Period, Berkeley ! Los Angeles ! London 1973, 1976, 1980.
20. W.K. SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, New Haven ! London 1972, et édition augmentée ID., TheLiterature of Ancient Egypt, Cairo 2003.
28 EDAL II . 2010 / 2011
Premier critère: le non trivial
9. Le première critère est négatif. Il repose sur le rôle des textes dans lefonctionnement de la société pharaonique. Selon ce critère, relèvent de la« littérature » ou du « littéraire », au sens large, les textes qui ont pour caracté !ristiques de ne pas avoir été produits par les activités triviales et les nécessitésterre!à!terre de l’existence dans ce qu’elle a de plus élémentaire, par la pratiquegestionnaire, administrative et judiciaire tant dans la sphère privée que dans lasphère publique. Voici quatre citations d’égyptologues illustrant l’application dece critère à l’ensemble des textes égyptiens:
The term ‘ literature ’ as used here must be understood in a wide sense, embracingevery kind of written text that is not, on common!sense ground, to be classed asdocumentary.21
I call here « literature » any text that is not written for everyday private use, from ad !min istrative exercises, through historical inscriptions to hymns, songs and so forth.22
La troisième citation mérite particulière attention, puisqu’elle est extraite del’ouvrage de Myriam Lichtheim précédemment évoqué:
Egyptian literature, then means all compositions other than the merely practical#such as lists, contracts, lawsuits, and letters$.23
La conception s’étend aux textes démotiques
gelten erst einmal alle Texe die Urkunden, Briefe, Geschäfstexte, Quittungen unddergleichen sind, als literarisch. Hierzu gehören religiöse Spruchsammlungen,magische Werke, wissenschaftliche Traktat und vieles mehr ganauso wie die« schöne » Literatur.24
21. W.J. TAIT, Demotic Literature and Egyptian Society, dans J.H. JOHNSON #ed.$, Life in a Multi!Cultural SocietyEgypt from Cambyses to Constantine and Beyond, « SAOC » 51, Chicago 1992, p. 303; suivi par G. VITTMANN,Tradition und Neuerung in der demotischen Literatur, dans « ZÄS » 125 #1998$, p. 63.
22. O. GOLDWASSER, ‘Low’ and ‘High’ Dialects in Ramesside Egyptian, dans S. GRÜNERT ! I. HAFEMANN #Hrsgg.$,Textcorpus und Wörterbuch. Aspekte zur ägyptischen Lexicographie, « PdÄ » 14, Leiden 1999, p. 334.
23. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, I, p. VI!VII.24. FR. HOFFMANN ! J. QUACK, Anthologie des demotischen Literatur, « Enführungen und Quellentexte zur
Ägyptologie » 4, Berlin 2007, p. 3.
29« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
Le non trivial est parfois défini positivement par la présence, fût!ce à un degréminimal, de l’imaginaire. En témoigne l’analyse suivante:
belles!lettres or writings that include an imaginative and creative dimension, eventhough their primary purpose may be more utilitarian #a prayer, a letter, a moralinstruction$.25
On notera le or dans « belles!lettres or writings. . . », indiquant que « littéraire »ne saurait, en l’occurrence, se réduire à « belles!lettres ».
Le non trivial, ou, corrélativement, la dimension imaginaire impliqueune prise de distance par rapport aux circonstances les plus immédiates del’existence, par rapport à ce que la condition humaine a de plus élémentaire. Ence sens, certains ont été tentés d’affiner l’opposition à l’aide d’une théorisationembryonnaire opposant aux textes rapportant un événement brut, ceux quisont « littéraires » parce qu’ils mettent en oeuvre une interprétation par leurauteur, un peu, mutatis mutandis, comme la doctrine journalistique préconise dedistinguer les « faits » des « commentaires »:
Primary materials such as documents, letters, and speeches which give ustestimony about events and are themselves a part of history, whereas literary workstransmit the past as interpreted by the writer.26
Le place des textes dans le fonctionnement de la société peut être définie demanière un peu différente, mais, en dernière analyse, relativement apparentée,en mettant en avant, d’une part leur diffusion, d’autre part, leur portée. A partirde ce double point de vue, sont qualifiés de « littéraires » des textes à diffusionlarge ou à portée générale:
Die Literaturbegriff, von dem ich hier ausgehe, ist weit gefasst. Er umschliesst diegesamte schriftliche Überlieferung, soweit sie öffentliche Geltung und " wasimmer nicht identisch ist " allgemeine Bedeutsamkeit beansprucht; Rituale etwagalten als geheim, konnten aber für den Fortsbestander Gesellschaft unentbehrlichsein. Ausgeschlossen sind folglich Dokumente der Verwaltung #Erlasse, Akten,Protokolle, Briefe, u.a.$, soweit sie nicht publiziert wurden, und Schriftzeugnissedes Privatlebens % . . .& Gegensatz von Nicht!Literatur, die aktuell und spezielle und
25. FOSTER, Literature, p. 299.26. R. GOZZOLI, The Writing of History in Ancient Egypt during the First Millenium BC "CA 1070!180 BC#. Trends
and Perspectives, « GHP Egyptology » 5, London 2006, p. 1.
30 EDAL II . 2010 / 2011
häufig auf Private Belange konzentriert ist, und allgemeingültiger und öffentlicher#bzw. geheimgehaltener$ Literatur.27
Comme on le voit dans cette classification, le critère de la portée et de ladiffusion restreintes utilisé pour distinguer les textes « non!littéraires » sesuperpose plus ou moins à ce que j’avais appelé « le trivial et les nécessités terre!à!terre et profanes », mais implique en plus l’absence de publicité #« soweit sienicht publiziert wurden »$.
Second critère: élaboration du texte pour lui!même
10. Le second critère pour distinguer ce qui " au sens large " est « litté !raire » ou relève de la « littérature » est positif. Il peut demeurer implicite, réduità l’impératif de choix propre à l’anthologie, comme dans celle de MyriamLichtheim. Mais d’autres le mentionnent ouvertement:
The compositions in the anthology at hand have been selected on the basis ofliterary merit or pretensions thereto, with a few additions % . . .& The literary meritand interest of these selections %= « the few additions »& warrant their inclusion.28
L’expression « literary merit » de cette citation évoque de manièrecondensée ce second critère. On observera qu’elle s’applique d’abord à desoeuvres où se laisse percevoir une recherche en ce sens, mais aussi à d’autres oùelle ne se manifeste pas consciemmment. Explicitons!le: la « valeur littéraire »" la « littérarité » puisque ce terme jargonnant est reçu dans les scienceshumaines " s’apprécie à travers le rapport entre la finalité première du texte,c’est!à!dire la fonction qui lui est assignée par son contexte même d’utilisa !tion,29 et la manière dont il mène à bien cette finalité. Quand dans un texte semanifeste une élaboration " aussi bien formelle que structurale #cf. ci!dessous$
27. E. BLUMENTHAL, Prolegomena zu einer Klassifizierung der ägyptischen Literatur, dans CH. EYRE #ed.$,Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptologists Cambridge, 3!9 September 1995, « OLP » 82,Leuven 1998, p. 174.
28. SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, 1972, p. 4.29. J’écris « contexte » au sens habituel de circonstances matérielles spatiales, temporelles et sociales où le
texte développe ses significations. Pour la confusion entre le contexte et l’univers de référencespécifique, cf. infra.
31« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
" qui outrepasse ce qui est nécessaire pour remplir purement et simplement safonction première, on a tendance à convoquer le terme « littéraire » pour lecaractériser. En fait, ce second critère met en jeu, implicitement, et souventinconsciemmment, ce que R. Jacobson, dans une analyse d’une perspicacité quiconserve toute sa valeur de nos jours, à condition de tenir compte soigneuse !ment de ses présupposés #cf. § 11$,30 appelait fonction « poétique », en la défi !nissant avec bonheur comme « the set toward the message as such, focus on themessage for its own sake, is the poetic function of language ».
Le travail qui relève de cette fonction tend à orienter, selon des degrésvariables, l’intérêt d’un texte vers lui!même, parallèlement et indépendammentde la destination originelle qui lui est assignée. On peut, dans le même ordred’idée, parler de « self!conscious use of language ».31 Quoi qu’il en soit, enappliquant consciemment ou non, ce second critère, certains égyptologuestiennent que des textes écrits sur supports « à fin de pérennité » aussi bien quedes textes sur supports « à fin de maniement » « may be classed as “literary”insofar as they have a deliberate artistic form appreciated as such by theaudience ».32
L’expression « deliberate artistic form » correspond à peu près à la notionde « travail sur le texte pour lui!même ». L’addition « appreciated as such by theaudience » implique que cette élaboration « artistique » délibérée est simanifeste à notre moderne appréciation que nous supposons raisonnablementqu’elle l’était aussi à celle des anciens égyptiens.
11. Pour bien évaluer ce second critère, quelques précisions s’imposent.· Du « focus on the message for its own sake »,33 relèvent la recherche et
30. On n’oubliera pas que R. Jacobson était avant tout influencé, consciemment ou non, par la poésied’avant!garde dans sa définition de la fonction « poétique » du langage, et qu’il convient de l’élargir pourprétendre lui donner une puissance d’explication suffisante pour le problème de la littérature.
31. ST. QUIRKE, Egyptian Literature 1800 BC. Questions and readings, « GHP Egyptology » 2, London 2004, p. 24.Cf. aussi R.A. PARKINSON, Literary Form and the Tale of the Eloquent Peasant, dans « JEA » 78 #1992$, p. 176,à propos de « awareness of form ».
32. A. SPALINGER, The Destruction of Mankind: a Transitional Literary Text, dans « SAK » 28 #2000$, p. 262.33. Pour cette notion si féconde de R. Jacobson du « message orienté vers lui!même », appliquée aux textes
32 EDAL II . 2010 / 2011
l’apprêt esthétiques dans l’expression, le style,34 bien évidemment. Il suffit d’évo !quer le riche répertoire des procédés dits « stylistiques » qui incite les égyptologuesà utiliser le qualificatif « littéraire »;35 parallèlisme; jeu sur les anto nymes; homo !téleute; homophones; etc.; une énumération exhaustive serait oiseuse.
· En relèvent aussi la prosodie et les formes « métriques » éventuelles;36
au demeurant certains s’appuient sur elles pour étendre la portée du terme« littérature »
Wenn, wie es scheint, in ägyptischen Texten fast nur metrisch geformte Sprachebegegnet % . . .&, dürfen wie den Begriff « Literatur » nicht zu eng fassen, sondernmüssen neben theologischen, politische und wissenschaftlichen Werken auchBriefe und Biographie mit einbeziehen.37
· Cela posé, on prendra bien garde de ne pas s’enfermer dans uneconception purement stylistique ou prosodique de ce qu’on appelle « qualitésesthétiques », et de les limiter à la forme de l’expression #cf. ci!dessus n. 29, àpropos de R. Jacobson$. Bien des contes, assurément consommés en tantqu’« oeuvres littéraires », enfilent platement une morne succession de formulesrépétitives, dénonçant une transmission orale orientée vers l’ouvertureimmédiate à un très large public.38 Analysons, par exemple, la première moitiéde Méryrê dans le monde souterrain " celle qui est la mieux conservée.
égyptiens, cf. A. LOPRIENO, Loyalty to the King, to God, to one self, dans P. DER MANUELIAN #ed.$, Studiesin Honor of William Kelly Simpson, II, Boston 1996, pp. 538!39.
34. Pour la forme #« Gestalt » $ dans le sens esthétique, cf. G. BURKARD, Überlegungen zur Form der ägyptischenLiteratur. Die Geschichte des Schiffbrüchigen als literarisches Kunstwerk, « ÄAT » 22, Wiesbaden 1993, p. 37 sq.
35. Pour ne pas alourdir la bibliographie, je me contente de renvoyer aux indications fondamentales dansla contribution de W. GUGLIELMI, Der Gebrauch rhetorische Stilmittel in der ägyptischen Literatur, dansA. LOPRIENO #ed.$, Ancient Egyptian Literature. History and Forms, « PdÄ » 10, Leiden ! New York ! Köln1996, pp. 465!97. D’autres travaux touchant cette problématique seront cités ci!dessous.
36. Là encore, je me restreins à un seul travail, à partir duquel on peut rayonner dans la bibliographieégyptologique: G. BURKARD, Metrik, Prosodie und formaler Aufbau ägyptischer literarischer Texte, dansLOPRIENO #ed.$, Ancient Egyptian Literature, pp. 447!63. Pour la littérature démotique, cf. VITTMANN,Tradition und Neuerung in der demotischen Literatur, p. 64.
37. E. HORNUNG, Einführung in die Ägyptologie Stand. Methoden. Aufgaben, Darmstadt 19934, p. 41. Pour lespoints dits de versification, cf. ci!dessous § 23.
38. Selon J. ASSMANN, Die Entdeckung der Verganheit. Innovation und Restauration in der ägyptischen Literatur !geschichte, dans H.V. GUMBRECHT ! U. LINKER!HEEL #Hrsgg.$, Epochenschwellen und Epochenstrukturen imDiskurs der Literatur! und Sprachhistorie, « STW » 486, Frankfort 1985, p. 492, cette platitude stylistique semanifeste particulièrement dans les narrations à partir de l’Époque Ramesside.
33« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
L’intensité d’une action #pleurer, crier, féliciter$ d’un sentiment #colère,abattement$, d’une qualité #grandeur, compétence$ ou d’un état #jeunesse$ estinévitablement exprimée par le même adverbe convenu m!Ss: onze exemples de1,1 à 4,6!
La succession des actions dans la chaine narrative est exprimée par lesDm=f perfectif. Peu de variations,39 si ce n’est que la forme sDm!jn=f peut êtreutilisée en place du sDm=f quand le sujet est un personnage divin ou le hérosprincipal.40 Par ailleurs, G. Posener avait relevé pas moins de 82 occurrences deDd « dire » et 74 de pr!aA « pharaon » dans ce qui subsistait du conte.41 Et que degaucheries, comme celle!ci:
Or, le pharaon, Vie, Intégrité, Santé, ne répugnait pas à manger de la nourriture lanuit, car l’oeil du pharaon, Vie, Intégrité, Santé, était très grand.
La répétition dans « du pharaon, Vie, Intégrité, Santé » au lieu d’un pronomanaphorique *« son oeil » paraît stylistiquement oiseuse. Elle s’explique dansune logique de la narration pour la narration. L’éminence d’un personnagedominant tel le pharaon incite à autonomiser, pour ainsi dire les éléments qui leconstituent. Il s’agit, à l’origine, de frapper un auditoire composite,42 facilementébaubi à l’évocation des puissants plutôt que de séduire des esthètes en mal degongorisme.
Si ce texte possède une vertu « littéraire », elle ne réside évidemment pasdans son élaboration stylistique, mais plutôt dans l’absence même d’une telleélaboration. Replacée dans son contexte de mise en oeuvre, l’absence de marque
39. Pour une forme apparemment relevant de la chaine narrative et qui serait à interpréter comme unprésent 1 plutôt que comme un séquentiel, cf. J. QUACK, Notes en marge du papyrus Vandier, dans « RdE »46 #1995$, pp. 164 et 167!68.
40. A. SHISHA!HALEVY, Papyrus Vandier Recto: an Early Demotic Literary Text?, dans « JAOS » 109 #1989$, pp.423!24.
41. G. POSENER, Le papyrus Vandier, « BiGen » 7, Le Caire 1985, p. 15: « Dans ces conditions, la narration nepeut!être que monotone pour ne pas dire indigente ».
42. Dans beaucoup de récits, des marques grammaticales signalent qu’il sont censés s’adresser originel !lement à un auditoire réuni autour d’un narrateur, cf. J.L. CHAPPAZ, Quelques réflexions sur les conteurs dansla littérature égyptienne ancienne, dans A. GUILLAUMONT #éd.$, Hommages à François Daumas, Montpellier1986, pp. 105!06. Bien entendu, cet auditoire peut n’être que fictivement évoqué, et la forme originelledu conte faire l’objet de manipulations diverses.
34 EDAL II . 2010 / 2011
devient une marque.43 Elle signale une organisation #consciente ou incon sciente$de l’oeuvre entièrement vouée à ouvrir grand l’accès à l’univers fictif qu’ellepropose. Le public, elle cherche sa connivence non par l’accumulation decoquetteries et d’afféteries séduisantes, mais par l’immersion directe dans le fluxnarratif qui la dynamise. On pourrait évoquer plaisamment ici ce constat deR. Barthes: « le récit se moque de la bonne et de la mauvaise littérature ».
Par ailleurs, l’économie et la structuration de l’oeuvre, sa dynamiqueargumentaire, les stratégies discursives, la manière dont est conduite unenarration, même si le style en est morne, rudimentaire et fastidieux, le recours àdes formes, des thèmes, des topos et des motifs standardisés, peuvent donc, euxaussi, participer de ce travail du texte pour lui!même. En voici deux illustrations.La première, dans ce jugement de J.L. Foster, sur les autobiographies:
Most tomb biographies, of course, tend to be list of titles and accomplishments,but the « Catalogue of Virtues » seems to be literar y , however stereotypic.44
La seconde, dans cette analyse de Ch. Eyre sur les inscriptions privées duMoyen Empire:
There are few other contemporay inscriptions that present substantial ‘ l iterar y ’compositions praising the king and his activities, and these are mostly semi!officialmonuments % . . .&.45
Le terme ‘ l iterar y ’ " au demeurant mis entre guillemets " désigne ici desunités textuelles pourvues d’une forme et d’un contenu spécifiques, et inséréesdans des ensembles visant à l’auto!célébration de l’élite. Bien entendu, le mêmeterme peut être attribué à des textes émanant du pharaon. Ainsi, le longpréambule du décret de Nauri, avec sa longue proclamation idéologiquedéfinissant les rapports entre le roi et les dieux est qualifié de « literary frame »s’opposant aux dispositions proprement normatives.46
43. Le problème est bien vu par A. COMPAGNON, Le démon de la théorie Littérature et sens commun, Paris 1998,p. 46 : « le comble de la défamiliarisation est la familiarité absolue ».
44. FOSTER, Literature, p. 300 #je suis responsable des caractères gras de literary$.45. EYRE, The Semna Stelae, p. 142.46. A. DAVID, Syntactic and Lexico!Semantic Aspects of the Legal Register in Ramesside Royal Decrees, « GOF »
IV / 38, Wiesbaden 2006, p. 18, n. 7.
35« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
Dans le même ordre d’idée, examinons l’analyse de G. Burkard face à untexte se présentant comme le récit de la restauration d’édifices sacrés, et quicombine le thème d’une famine de sept jours au thème du rêve du pharaon:
Es ist evident, dass insbesondere die beiden lestgenannten Motive " und vor allemihre Verbindung miteinander " in rein historischen Berichten und Urkundenkeinen Platz haben: Es sind eindeutig literarischen Motive, und damit muss auchder Verwendungzweck unseres Textes innerhalb der Gattung « literarische Texte »gesucht werden.47
Le raisonnement de G. Burkard est le suivant: il y a dans ce texte un travail surle message, en l’occurrrence le recours à deux « motifs littéraires » #« litera ri !schen Motive »$ standardisés, le « motif » de la famine, et le « motif » du rêve. Safinalité première, à savoir relater une restauration, ne les exigeait pas. Ce travailsur le message incite à le classer dans la catégorie des textes littéraires.
Autre exemple: A. Spalinger juge en ces termes le Mythe de la destructiondes hommes, tel que l’actualisent des versions monumentales à usage funéraire,entre autres, celle copiée sur une des chapelles de la tombe de Toutankhamon:
a literary rendition of earlier separate mythologies and stories about the gods. Nowthey have been placed within a more cohesive and consistent unity % . . .&. This workexposes the literary qualities of the narrative and not necessarily any theologicalone. Such a technique is to be expected in mythological texts which, though builtup from pre!existent shorter stories and explanations, nonetheless partake of andreflect the master hand of an author or authors.48
Ce n’est donc pas, ou pas seulement, à travers le style ou l’expression formelleque se manifeste, dans ce cas, le travail sur le message, la « literary rendition »,évoquée par A. Spalinger, mais, plutôt à travers l’organisation de l’oeuvre et lesthématiques qu’elle met en jeu. On a employé « literary » dans une acceptionsemblable, à propos d’un autre mythe, la célèbre « légende » d’Isis et de Rê:
the myth can have the structure and import of a work of « literary » fiction, notsimply of a retelling of something sited in the « mythical » past.49
47. G. BURKARD, Frühgeschichte und Römerzeit: P. Berlin 23071 vso, dans « SAK » 17 #1990$, p. 121. Pour le Livredu temple, dont relève le texte étudié par G. Burkard, cf. les travaux de J. Quack.
48. SPALINGER, The Destruction of Mankind, p. 262; cf. p. 278: « The “Destruction” was created by anindividual, an author, who was interested in literature ».
49. J. BAINES, Prehistories of Literature Performance, Fiction, Myth, dans G. MOERS #ed.$, Definitely: Egyptian
36 EDAL II . 2010 / 2011
12. Quand elle est appréciée à travers ce second critère, un travail du textepour lui!même, perceptible dans le style et/ou dans l’organisation, et outre !passant la finalité première du message, la qualité de « literary » est non pas« discrète », mais « graduable » ou « scalaire » dans le jargon des scienceshumaines, débitrices, en l’occurrence, des sciences « dures ». Voici une citationsignificative en ce sens:
Although the Victory Stela is considered to be the more ‘ literary ’ of Merneptah,the Karnak inscription also incorporates literary topoi into its narrative of theLibyan Invasion.50
On notera l’expression « the more ‘ literary ’ », très significative. Dans la mesure où il est graduable, un seul et même texte peut
comporter des parties « littéraires » et d’autres qui ne le sont pas:
Indeed one can even demarcate the literary aspect as having a terminus line 165.51
13. En tout cas, l’effort déployé afin de travailler le message pour lui!même,par delà sa finalité première, traverse une très grande variété de textesmonumentaux et manuscrits, et leur vaut souvent le qualificatif de « littéraires »,bien qu’ils aient fondamentalement peu à voir avec la littérature au sensrestreint de « belles!lettres ». Ce genre d’effort, on le discerne non seulementdans des hymnes, une forme, qui intrinsèquement, l’appelle aisément de par sescaractéristiques propres,52 mais aussi dans des formules relevant du fatras de
Literature, « LingAeg Studia Monographica » 2, Göttingen 1999, p. 35. Pour la couleur clairement« littéraire » de ces mythes, cf. P. VERNUS, Isis et les scorpions: le frémissement du littéraire sous le fatrasmagique, dans J.P. MONTESINO #éd.$, De Cybèle à Isis, Paris 2011, pp. 30!37.
50. C. MANASSA, The Great Inscription of Merneptah: Grand Strategy in the 13th Century BC, « YES » 5, NewHaven 2003, p. 107 sq.
51. SPALINGER, The Destruction of Mankind, p. 276.52. Cf. J. ASSMANN, Verkünden und Verklären. Grundformen hymnischer Rede im Alten Ägypten, dans LOPRIENO
#ed.$, Ancient Egyptian Literature, p. 313. Au demeurant, c’est les potentialités littéraires du genrehymnique qui ont facilité l’admission de certains hymnes dans les anthologie de la littératureégyptienne; ainsi, les hymnes à Sésostris III, l’hymne à Aton. Symptomatiquement, le deuxième volumede l’Ancient Egyptian Literature de M. LICHTHEIM comporte une partie intitulée Hymns, Prayers, and aHarper’s Song.
37« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
textes suscités par les croyances funéraires. On avait précédemment soulignéque parmi les morceaux choisis sélectionnés dans les anthologies de référencede la littérature égyptienne, figuraient des formules tirées des Textes despyramides,53 et des Textes des sarcophages #ci!dessus § 8$. Voici, à titre d’échan !tillon, un bref passage pris dans ce dernier corpus:
jnk bA Sw xpr m ra % . . .& xpr!n=j xpr.t Hnmnm!n=j Hnnm.yt dbn!n=j dbn.t rd!n=jrd.t qA!n=j qA.yt mj jt=jJe suis la manifestation de Shou, produite à partir de Rê % . . .& C’est comme monpère que je me suis transformé d’une #vraie$ transformation, que j’ai rampé d’une#vraie$ reptation, que j’ai vagabondé d’un #vrai$ vagabondage, que j’ai crû d’une#vraie$ croissance, que je me suis élevé d’une #vraie$ élévation.54
Comment n’être point pas frappé par l’extrême élaboration « stylistique » dupassage épinglé? La phrase est constituée par cinq formes d’accompli, marquéespar le suffixe !n. Tous étant intransitifs, tous sont sémantiquement complétéspar un adverbe, mais pas n’importe lequel: un nom action formé sur le mêmeradical. Il s’agit du procédé appelé parfois « complément étymologique »,procédé, qui même s’il se cristallise parfois en expressions idiomatiques "comme dans le français « vivre une vie » 55 " révèle une recherche formelle,recherche d’autant plus manifeste dans le cas qui nous concerne, qu’il est répétécinq fois.
Qui plus, les cinq accomplis avec leur compléments étymologiques, sonten position de « temps seconds », c’est!à!dire, du point de vue de la viséecommunicative, qu’allégés de leur charge rhématique, ils fonctionnent commethème pour faire porter le poids essentiel de l’information sur le syntagmeadverbial, « comme mon père », qui est en facteur commun, selon le schémasuivant:
53. O. FIRCHOW, Grundzüge der Stilistik in den altägyptischen Pyramidentexte. Untersuchungen zur ägyptischenStilistik, II, « Institut für Orientforschung, Veröffentlichung » 21, Berlin 1953.
54. CT IV, 181 p!r, et aussi, partiellement CT IV, 173 i!174 a; cf. P. VERNUS, Études de philologie et de linguistique" III #, dans « RdE » 35 #1984$, p. 175 et ID., Le nom d’action étymologique comme modificateur du verbe: uneconstruction égyptienne proche du mafoul moutlaq, dans J. CERVELLO AUTUORI ! A.J. QUEVEDO ALVAREZ#eds$, Ir a buscar leña. Estudios dedicados al Prof. Jesus Lopez, « Aula Aegyptiaca Studia » 2, Barcelona 2001,pp. 193!202.
55. Cette construction est utilisée dans un texte à prétention littéraire comme l’Enseignement de Chéty, cf.P. VERNUS, Sagesses de l’Égypte pharoanique, Arles 20102, p. 255, n. 58.
38 EDAL II . 2010 / 2011
xpr!n=j xpr.t
Hnmnm!n=j Hnnm.yt
dbn!n=j dbn.t } mj jt=j
rd!n=j rd.t
qA!n=j qA.yt
La fonction du texte, à lui assignée par son contexte même, c’est!à!dire unsarcophage est évidente: assurer au défunt déposé dans ce sarcophagel’identification à la manifestation de Shou, et bénéficier ainsi de ses pouvoirspour affronter les difficultés de l’Au!delà. Rien, a priori, de très « littéraire » sion songe aux belles!lettres. Pourtant, s’y manifeste un travail que ne requéraitpas impérativement sa fonction première.
14. Par ailleurs, le même corpus montre aussi, çà et là, un travail sur textepour lui " même, parfois orienté sur le style et l’expression, voire la prosodie, leplus souvent davantage sur l’économie et la structuration de l’oeuvre, ce quirelève tout autant du « littéraire » au sens large #§ 11$.56 Ainsi, le jeu des construc !tions narratives dans les récits mythologiques,57 la dynamique argu men tative desdialogues, l’économie des discours alternés,58 les arétologies, etc.59
Sont passibles d’observations analogues, non seulement les décretsptolémaïques 60 " après tout leur statut exige de la tenue dans l’expression entant qu’actes de droit et expressions solennelles du pouvoir " mais même lakyrielle des scènes rituelles qui couvrent les parois des temples gréco!romains.
56. L. COULON, Rhétorique et stratégies du discours dans les formules funéraires: les innovations dans les Textes dessarcophages, dans S. BICKEL ! B. MATHIEU, D’un monde à l’autre. Textes des pyramides et Textes des Sarcophages.Actes de la table ronde internationale Ifao 24!26 septembre 2001, « BdE » 139, Le Caire 2004, p. 119.
57. Exemple topique CT II, 332d!346b, et, plus largement les mythes des chapitres de « connaître lespuissances de Nekhen », cf. P. VERNUS, La notion de mythe dans la civilisation pharaonique, dans « Cadernosde Filosofia » 9 / 10 #2001$, pp. 16!18.
58. Ainsi les chapitres 38!40, où père et fils prennent tour à tour la parole, cf. R.O. FAULKNER, Spells 38!40of the Coffin Texts, dans « JEA » 48 #1962$, pp. 36!44. Cf. encore D. TOPMANN, Die « Abscheu » ! Sprüche deraltägyptischen Sargtexte. Untersuchungen zu Textemen und Dialogstrukturen, « GOF » IV / 39, Göttingen 2001.
59. Sur les différentes structures énonciatives dans les CT, cf. E. OTTO, Zum Komposition von Coffin TextsSpell 1130, dans J. ASSMANN ! E. FEUCHT ! R. GRIESHAMMER #Hrsgg.$, Fragen an die altägyptieche Litératur.Studien zum Gedenken an Eberhad Otto, Wiesbaden 1977, pp. 1!18.
60. PH. DERCHAIN ! M. ROSSI!BUCCI, Les assonances existent aussi dans les décret de Canope, Rephia et Memphis,dans « GM » 211 #2006$, pp. 71!80.
39« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
Je me bornerai, ici à citer ces perspicaces remarques de Ph. Derchain 61
à propos du spécialiste en science sacerdotale qui composa les hymnesthéologiques à Souchos à Kom Ombo:
la description qu’il insère dans son oeuvre sort de son expérience, banale, qui estaussi celle de ses lecteurs potentiels. Dans sa richesse et son exubérance, elle estsans portée informative pour personne au contraire des récits mythiques % . . .& Il nelui reste donc dans l’oeuvre qu’une fonction littéraire: le dessein de l’auteur, sonplaisir de céder à l’élan poétique % . . .& en est la seule justification.
Dans la même perspective, on peut sentir frémir le littéraire jusque dans leslégendes des scènes des chapelles de tombe, lorsque les dialogues sontconsciemment organisés en véritables saynettes; ainsi le « banquet des mijaurées »,dans la tombe de Paheri ou « la curiosité de gardes », dans celle de Ay.62
Il y a assurément des traits « poétiques », au sens de R. Jacobson,largement disséminés dans l’ensemble de la production écrite de l’Égyptepharaonique, qu’elle soit sur supports monumentaux ou sur manuscrits.Toutefois, ces traits demeurent le plus souvent embryonnaires, marginaux,accessoires, et, en tout cas, quelle que soit leur extension et leur sophistication,ils ne valent qu’en passant. Ils ne sont ni indispensables, ni simplementnécessaires pour que les textes où ils se manifestent remplissent les fonctions àeux assignées par leurs conditions originelles d’utilisation.
15. Toutefois, en seconde instance, ce parachèvement formel " exprimé àtravers le jeu de smnx et de nfr en égyptien " peut être senti comme apportantà ces textes un supplément d’efficacité, une chance de plus de remplir leur
61. PH. DERCHAIN, Portrait d ’un divin crocodile ou l’originalité d ’un écrivain du temps de Domitien, dansF. LABRIQUE #éd.$, Religions méditerranéennes et orientales de l’Antiquité, « BdE » 135, Le Caire 2002, p. 92.Dans le même esprit, cf. PH. DERCHAIN, Théologie et littérature, dans LOPRIENO, Ancient EgyptianLiterature, pp. 351!60; PH. DERCHAIN, Manièrisme, dans « BSEG » 21 #1997$, pp. 11!12; FR. LABRIQUE,Stylistique et théologie à Edfou, « OLA » 51, Leuven 1992.
62. P. VERNUS, Comment l’élite se donne à voir dans le programme décoratif de ses chapelles funéraires. Stratégied ’épure, stratégie d ’appogiature et le frémissement du littéraire, dans J.C.M. GARCIA #éd.$, Élites et Pouvoir enÉgypte ancienne, dans « CRIPEL » 28 #2009!2010$, pp. 109!15. On remarquera que Pahery fait valoirl’agrément # md.t nDm.t nt sDAy!Hr $ des inscriptions de sa tombe, cf. L. COULON, Les épithètesautobiographiques formées sur skm, dans I. RÉGEN #éd.$, Verba manent: recueil d'études dédiées à Dimitri Meekspar ses collègues et amis, Montpellier 2009, p. 72.
40 EDAL II . 2010 / 2011
fonction originelle. Laquelle demeure prédominante dans leur mise en oeuvre.Ils peuvent donc être qualifiés de « littéraires », et éventuellement inclus dansdes anthologies de la « littérature » dans la mesure où on estime qu’ils possèdentdes « literary features so evident as to categorize them as literature »,63 maisseulement au sens large, sans véritablement que « literature » implique obliga !toirement « belles!lettres ».
Donc, dans une perspective qui envisage indifféremment supportsmonumentaux et supports manuscrits, on englobe sous le terme « littérature »,ou on qualifie de « littéraires », non seulement les oeuvres des belles!lettres,mais aussi nombre de textes qui, d’une part, ne relèvent pas de la pratique et dutrivial quotidien, et qui, d’autre part, présentent, au jugement de l’égyptologue,une élaboration stylistique ou structurale du texte, que n’exigeait pas a priorileur fonction première .
16. L’importance relative de ces deux critères, le non trivial et l’élaborationdu texte pour lui!même dans la qualification de « littéraire » et de « littérature »#au sens large$ varie selon les auteurs. Soit deux exemples opposés.
· Dans le volume propre à l’Égyptologie 64 d’une somme des connaissancessur l’ensemble de l’Orient #Handbuch der Orientalistik$, c’est le premier critèrequi prévalait dans le choix de ce qui était classé en tant que « littérature »,comme le révèlent les catégories thématiques prises en compte: « Littératurefunéraire », « Dogmatique et didactique », « Littérature historique », « Litté ra tu !re scientifique ». On y inclut même des traités avec opérations mathéma tiques,où franchement, avec la meilleure volonté du monde, on aurait bien du mal àdétecter quelque « fonction poétique », au sens défini ci!dessus! Finale ment,seuls les documents de la pratique se retrouvent totalement exclus de la« littérature » dans la perspective élue par les auteurs de ce volume. Endéfinitive, à prendre chaque catégorie isolément, nous sommes bien proche de
63. W.K. SIMPSON, Belles Lettres and propaganda, dans LOPRIENO #ed.$, Ancient Egyptian Literature, p. 442#à propos des textes dits « historiques »$.
64. SPULER #Hrsg.$, Der Nahe und der Mittlere Osten, I, Ägyptologie, II, Literatur.
41« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
l’acception « thématique » du terme, précédemment évoquée #ci!dessus § 4$.Sauf que globalement, l’ostracisme dont font l’objet les textes de la pratiqueimplique que ne sont admis à constituer une « littérature » que ceux possèdantune intervention " fût!elle minimale " de l’« imaginaire » les démarquant dutrivial. Par là, la perspective du Handbuch der Orientalistik rejoint celle mise dansla catégorisation « littéraire » manuscrits sur supports à fin de maniement #ci!dessous II$. Sauf que globalement, on prend en compte tous les types desupport, loin de se limiter aux supports « à fin de maniement ».
· En revanche, c’est plutôt par le second critère, l’élaboration du textepour lui!même, que W.K. Simpson et M. Lichtheim s’étaient inspirés dans leursanthologies précédemment évoquées. Cela transparaît et dans leurs sélections,et dans la manière dont M. Lichtheim les justifie dans l’introduction de sonpremier volume:
First % . . .& all works that fall under the narrow definition of belles!lettres have beenincluded % . . .& Second in choosing from the vast numbers of monumentalinscriptions % . . .& the focus of this selection has been on compositions that arerepresentative of three major genres: biographical inscriptions, historicalinscriptions, and the broad class of texts known as mortuary literature.
Les trois genres qu’elle prend en considération sont clairement, dans l’Égyptepharaonique, les plus propres à appeler un travail du message pour lui!même,par delà ce que nécessite la fonction première qu’assigne au texte son contextede mise en oeuvre.65 L’exclusion des textes médicaux, au demeurant effectuée àregret #« which may well deserve a place within the definition of egyptianliterature »$, est justifiée:
out of practical considerations, having to do with their bulk and with their veryspecialized character.
Le premier argument expliquant l’exclusion #« their bulk »$ est plutôt de principe,car rien ne l’empêchait de se limiter à des extraits. Le second argument #« veryspecialized character »$ trahit au fond une appréciation négative sur la capacité
65. Pour les textes mortuaires, joue le fait, déjà évoqué, que le parachèvement formel renforce leurefficacité.
42 EDAL II . 2010 / 2011
de ces textes à s’ouvrir à la « fonction poétique »,66 la technicité étant perçue, enquelque sorte, comme propre à inhiber l’élévation de l’âme. Sur ce point, en toutcas, la catégorie « non littéraire » dans une perspective générale, indépendam !ment du support, ne recoupe pas exactement la catégorie « non littéraire »appliquée aux seuls textes manuscrits #ci!dessous § 20$.
« Littéraire », « littérature », indépendamment du support
LIT TÉRAIRE#sens large/faible$
Littéraire au sens restreint/fort de belles!lettres
Pas de marques formelles spécifiques
Marque distinctive: « focus on themessage for its own sake »
Idéologie royale
Autobiographie
Didactique
Savoir et ReligionMagie
NON LIT TÉRAIRE# DOCUMENTAIRE $
Textes à usage trivial, pour lesnécessités du quotidien
Traités « techniques »
66. Une telle appréciation, au demeurant, est discutable. Certes il y a des textes médicaux hautementtechniques. Mais, la frontière entre magie et médecine étant floue, il y en a d’autres qui s’ouvrent à unecertaine élaboration, entre autres en convoquant des narrations mythologiques; un exemple dansP. VERNUS, Deux métaphores trahissant une élaboration littéraire, dans Fs. D. Franke #sous presse$.
FIGURE 1
43« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
A.II. « Littéraire », « littérature », limités aux textes manuscrits
17. Dans la mesure où le statut des textes diffère selon la nature de leurssupports #§ 1$, on peut s’attendre que les termes « littéraire » et « littérature »puissent prendre une acception particulière à l’intérieur d’une catégorieparticulière de suports.
18. S’agissant des textes sur supports manuscrits « à fin de maniement », leségyptologues désignent sous les qualificatifs « non littéraires » et « littéraires »des catégories des textes qui ne se superposent pas exactement aux catégoriesdésignées par les mêmes qualificatifs lorsque la nature du support n’entre pas enligne de compte #ci!dessus A.I$.
Une illustration exemplaire est fournie par l’immense documentationostracologique de Deir el!Médina. Les égyptologues furent amenés à classer unensemble d’ostraca " plus de dix!mille alors, pour ne rien dire des papyrus, etle nombre s’est accru " écrits de manière prépondérante en écriture cursive, lehiératique, et provenant du célèbrissime village où vivait le personnel del’Institution de la Tombe. Quand il fallut les inventorier, deux immensessavants, J. 'ern( et G. Posener, convinrent de se partager la tâche. Au premierrevenaient les documents appelés « non littéraires ».67 Étaient ainsi qualifiéstous ceux produits tant dans la sphère privée que publique, par les nécessités dutrivial quotidien, du bassement matériel, et par les activités administratives etjuridiques: lettres privés, comptabilités, inventaires, bordereaux, journaux.68
G. Posener, quant à lui, put se délecter des ostraca « littéraires »; nous verronsplus loin quels textes il jugeait dignes de ce qualificatif gratifiant #§ 29$.
67. Pour des projets récents de traitement cf. G. BURKARD, Publikation und Erschliessung nichtliterarischerOstraka aus Deir el Medine im Internet, dans GRÜNERT ! HAFEMANN #Hrsgg.$, Textcorpus und Wörterbuch,pp. 21!37, et R.J. DEMARÉE ! B.J.J. HARING, The Deir el!Medina Database, ibidem, pp. 41!48.
68. Pour les classifications internes à cette catégorie, cf. K. DONKER VAN HELL ! B.J.J. HARING, Writing ina Workmen’s Village. Scribal Practice in Ramesside Deir el!Medina, « EU » 16, Leiden 2003.
44 EDAL II . 2010 / 2011
19. Au delà des ostraca, cette répartition des textes manuscrits en deuxcatégories fondamentales se retrouve dans la bibliothèque de Deir el!Médina.Une partie des textes qu’elle comportait ont été classés comme « non litté rai !res ». Ce sont des textes produits par les nécessités triviales et immédiatementmatérielles tant dans la sphère privée #1$, que dans la sphère publique #2$, c’est!à!dire produits par les besoins élémentaires du fonctionnement de l’organisa !tion sociale. 1$ Correspondance avec les familiers sur des affaires privées #P. DeM XIX, XX,
XXI$; lettre à Anynakht #P. DeM XIV$; lettre du dessinateur Hormin #P. DeM
XVI$; textes réglementaires ou juridiques de droit privé; ainsi, reçu dupaiement d’un boeuf #P. Chester Beatty I vo$. Document sur un procès d’adul !tère #P. DM XXVII$; un gros dossier relatif à un partage testamentaire et à ladévolution de biens de Naunakhte #P. DeM XXIII, XXV, XXVI; P. Ashmolean II
et III$.2$ a. Lettres réceptionnées et brouillons ou copie de lettres envoyées à des
administrateurs: lettre de Hay au scribe Iyemsab #P. DeM III$; lettre deMaanekhetef au scribe du vizir Amenmès #P. DeM IX, X, XI$; lettre deMaanekhetef au vizir #P. DeM XIII$; lettre de Qenherkhepeshef au vizirPanehey #P. Chester Beatty III vo$; lettre du scribe du vizir Amenmès #P. DeM
VIII, XVIII$; lettre du scribe du temple d’Hathor, maîtresse de Hou,Amenmès à Maanakhtef #P. DeM VIII$; lettres des hautes autorités auxadministrateurs de la Tombe #P. DeM XXVIII, XXIX$.
b. Documents produits par les activités de gestion, comptabilités, inventaires,récépissés de livraisons, mémoranda administratifs, etc.: liste d’objets#P. DeM XVII$; livraison de denrée #P. DeM II, XXIV$; comptabilité de céréales#P. Chester Beatty XI vo$; comptabilité du personnel auxiliaire de l’Institutionde la tombe #P. Chester Beatty XVI vo$; mémoranda administratifs #P. ChesterBeatty I vo E, F, H; P. Genève 15274 vo$.
45« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
20. Combiné à l’exemple des ostraca, l’exemple de la bibliothèque de Deirel!Médina fournit une base de réflexion sur la classification interne des textesmanuscrits. A la considérer, la catégorie « non littéraire », quand elle estrestreinte aux textes manuscrits, repose sur des fondements semblables à ceuxde la catégorie « non littéraire », quand elle est appliqué aux textes quels quesoient leur support. Une exception, toutefois: les écrits « techniques » #méde !cine, mathématique$. Ces derniers participent du « non littéraire », quand lanature du support n’est pas prise en compte #cf. § 16, in fine$. En revanche, leursmanuscrits sont rangés parmi les manuscrits « littéraires » #ci!dessous § 22, etcitation de P.W. Pestman, § 32$.69
Cela posé, à « non littéraire » mieux vaudrait à mon sens, préférer leterme « documentaire », comme le font certains, ou encore, la très commodeexpression « textes de la pratique », moins chargée de présupposés axiologiques.
21. Car, soit dit en passant, la désignation négative « non littéraire »,évoquant le terme non marqué d’une opposition privative en linguistique, estrévélatrice d’une hiérarchisation inconsciente, sinon implicite, de la discipline.La qualité de « littéraire » est érigée en critère fondamental et discriminant. Àchaque texte reconnu comme tel s’ouvre le cénacle des oeuvres de bonnecompagnie. Les documents à qui on la refuse s’entassent en une plèbe disparated’écrits, perçus plus ou moins confusément comme sans grand relief et demoindre intérêt.70 Ainsi, A.H. Gardiner,71 après la description des textes litté !raires, de prime importance, il est vrai, copiés sur un magnifique papyrus,concède:
It now remains to translate and annotate % . . .& the business memoranda,
c’est!à!dire le
69. Cas exemplaire les textes médicaux des P. Chester Beatty VI ro et XVIII vo #à côté de textes didactiqueslittéraires$.
70. Pour ce genre de présupposés, voire de préjugés dans l’Égyptologie, cf. J.!C. MORENO GARCIA, FromDracula to Rostovtzeff or the misadventure of economic history in early Egyptology, dans « IBAES » 10 #2009$,pp. 175!98.
71. A.H. GARDINER, The Library of A. Chester Beatty. Description of a hieratic Papyrus with a mythological Story,Love Songs, and other Miscellaneous Texts, London 1931, p. 43.
46 EDAL II . 2010 / 2011
rest of a mass of entries of the same kind which from time to time turned topractical account the entire portion of the verso unoccupied by its literary texts.
22. Par opposition à ces textes « non!littéraires », ou « documentaires », ou« de la pratique », qui constituent la première composante, la seconde compo !sante majeure de la bibliothèque de Deir el!Médina regroupe des textes classéscomme « littéraires ». Ce sont les suivants:
· NarrationLe jugement entre Horus et Seth #P. Chester Beatty I ro$.
Vérité et Mensonge #P. Chester Beatty II ro$.
Bataille de Qadesh #P. Chester Beatty III vo$.
· Lyrique Doux couplets #P. Chester Beatty I ro$, Formule du grand déduit #P. Chester Beatty I vo$,
poèmes d’amour dont l’unité se fonde sur l’anaphore de l’expression « Siseulement! » #P. Chester Beatty I vo$.
Hymne à la crue #P. Chester Beatty V ro$.
Panégyrique de Ramsès V #P. Chester Beatty V vo$.
· Sagesse et apparenté 72
La sagesse d ’Ani #P. DeM I ro$.
La lettre satirique du scribe Hori #P. Chester Beatty XVII$.
Réfection sapientiale à l’aide de deux extraits de la Sagesse d ’Ani #P. Chester Beatty Vvo 2, 6!11$.
· DidactiqueLettre modèle: éloge du métier de scribe; conseil au jeune scribe; satire des métiers
#P. Chester Beatty IV ro!vo; P. Chester Beatty V ro; P. Chester Beatty XVIII; P. ChesterBeatty XIX$.
Onomasticon: minéraux, produits des oasis #P. Chester Beatty IV vo, 3$.
72. « Sagesse » au sens d’enseignement, d’instruction, informée par une situation modèle qui est celle depréceptes d’un « enseignant » à un « enseigné ». Ce que j’appelle « didactique » dans la rubrique suivanteest une sagesse au sens large de savoir sur le monde, mis à disposition sous différentes formes.Cf. VERNUS, Sagesses.
47« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
· Magie prophylactique et mantiqueFormules magiques contre les scorpions #P. Genève 15274; P. Chester Beatty VII ro; P.
Chester Beatty XI ro$.
Formule magique contre la migraine, contre la fièvre, contre la maladie nsyt
#P. Chester Beatty V ro; P. Chester Beatty VII vo; P. DeM I vo$; contre la mortravisseuse #P. Chester Beatty XV; P. DeM I vo$; contre un démon #P. BM 10731$.
Formule magique: protection du corps #P. Chester Beatty VIII ro$; purification#P. Chester Beatty IX vo; P. Chester Beatty XVI ro$.
Formule magique pour redonner la vigueur sexuelle #P. Chester Beatty X ro+vo +P. Chester Beatty XIII$; formule magique pour manger poisson et tortue #P.P. Chester Beatty XI vo$.
Livre de protection #P. Chester Beatty VIII vo$; livre pour se concilier les dieux#P. Chester Beatty VIII ro$.
Traité d’oniromancie #P. Chester Beatty III$.
· Médecine Prescriptions médicales #P. Chester Beatty VI ro; P. Chester Beatty XVIII vo$.
· ReligionHymne au dieu créateur; à Amon!Rê!Horakhty; à Amon #P. Chester Beatty IV;
P. Chester Beatty XI vo; P. Chester Beatty I vo$; hymne à %Thot& le chien.
Litanie #P. Chester Beatty VIII ro; même texte P. Chester Beatty IX vo$.
Rituel d ’Amenhotep I #P. Chester Beatty IX ro+vo$.
Unité matérielle des textes « littéraires » sur supports manuscrits
23. Il faut éviter ce qui a pu être parfois un savoureux exemple decircularité. Il est arrivé que faute de parvenir à établir des critères définitoires,on se soit résigné à donner à la catégorie « textes littéraires » un contenupurement négatif. Autrement dit, si on poussait malicieusement jusqu’au boutles logiques sous!jacentes, on aurait opposé ce qui est « non!littéraire » à ce quiest « non!non!littéraire »!
En fait, les textes sur support manuscrits classés « littéraires », par delàleurs subdivisions, sur lesquelles nous aurons à revenir, partagent générale !
48 EDAL II . 2010 / 2011
ment 73 une certain nombre de caractéristiques matérielles particulières. Ellesindiquent que les anciens égyptiens leur reconnaissaient une unité catégorielle,par opposition aux textes de la pratique, et ce, dès le Moyen Empire. Pour cettepériode, St. Quirke observe:
the literary book has rather clearer profile in ancient Egypt, as a category ofmanuscript with distinctive physical appearance % . . .& The selection of certainpage!heights and line!spacing, and the combination of vertical and horizontal linesof writing on Middle Kingdom literary manuscripts, imply intentional difference,and also have an impact on the shape of the signs. As a result literary booksconstitute a category distinct from other written products, and can be recognizedby visual features even without reading the content % . . .& the material presence of the literary book as a distinctive object category, in formalfeatures such as the handwriting style, spacing of signs and lines, and sometimesthe combination of vertical and horizontal lines for segments of writings.74
Dans une perspective élargie, ces caractéristiques se manifestent avec évidem !ment des fluctuations selon les époques et les contenus, dans les domainessuivants:75
· Le format.76
· Mise en page,77 la diplomatique, et le « pavé » d’écriture.78
· L’apparat rédactionnel guidant leur lecture,79 entre autres, les points dits de
73. Pas question, bien sûr, de nier des exceptions, ne serait!ce que parce qu’un manuscrit « littéraire » peutrecevoir des insertions « non!littéraires », et vice!versa. Par exemple, à propos du P. Chester Beatty I,GARDINER, The Library of A. Chester Beatty, p. 43, identifie le « rest of a mass of entries of the same kindwhich from time to time turned to practical account the entire portion of the verso unoccupied by itsliterary texts ». Dans le cas du P. Turin B, évoqué ci!dessous § 37, le manuscrit littéraire a été lavé pourrecevoir des comptabilités. Inversement des manuscrits originellement non!littéraires sont souventrécupérés comme manuscrits littéraires; par exemple, les P. Saint Petersbourg 1116 A et B, cf. A.M. GNIRS,Das Motiv des Bürgerkriegs in Merikare und Neferti, dans G. MOERS ! H. BEHLMER ! K. DEMUSS !K. WIDMAIER #Hrsgg.$, jn.t Dr.w : Festschrift für Friedrich Junge, Göttingen 2006, p. 254!55; nombreuxautres exemples, cf., inter alia, la « bibliothèque » de Berlin, R.B. PARKINSON, Reading Ancient EgyptianPoetry among other Histories, Oxford 2009, p. 84.
74. QUIRKE, Egyptian Literature, p. 26 et 27.75. Je ne veut point faire intervenir le niveau linguistique dans ces caractérisations pour ne pas compliquer
outrageusement le problème. ST. WIMMER, Hieratische Paläographie der nicht!literarischen Ostraka der 19.und 20. Dynastie, I, « ÄAT » 28, Wiesbaden 1995, p. 9, remarque: « Wenn sich Alltagstexte i. allg. auch imSprachniveau von literarischen Werken abgrenzen, so gibt es doch auch Beispiele füt nicht!literarischeTexte in “poetical, civilized and learned” Sprachstil ».
76. J. 'ERN), Paper and Book in Ancient Egypt, London 1952, pp. 14!17.77. N. DE HALLEUX, Aspects de la mise en page des manuscrits de l’Égypte pharaonique, dans « Communications et
Langages » 69 #1986$, pp. 67!91.78. Sur cet aspect, cf. VERNUS, Les manuscrits de l’Égypte ancienne, pp. 16!23.79. H. GRAPOW, Sprachliche und schriftliche Formung ägyptischer Texte, « LÄS » 7, Leipzig 1936, pp. 51!53.
49« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
« versification » en rouge, divisant les textes en unités prosodiques, ouservant de simples repères pour l’apprenti scribe, le lecteur ou lecopiste 80 #cf. ci!dessous § 25$, les signes de pauses, les rubrications de titresou de formulaires ou de constructions grammaticales introduisant desnouveaux paragraphes,81 des espaces blancs, des formules d’incipit du typeHAtj!a m, « début de »; la formule de colophon de type jw=f pw/jw=s pw, avecun pronom suffixe, !f ou !s référant à l’oeuvre prise comme un tout.82 Bienentendu, les manuscrits dits « non!littéraires » sont passibles, eux aussi d’unapparat rédactionnel qui leur est propre, même si la rubrication joue aussiun rôle essentiel.
· Le style d’écriture: une tachygraphie, le hiératique, en général pluscalligraphique, moins cursif que pour les documents de la pratique.83
Le fait est si connu que je n’insiste pas, en me bornant à ce tableau qui illustre,comment, sur un même support, en l’occurrence une tablette, a priori utilisé parun scripteur unique, la paléographie selon que le texte écrit est « littéraire » ou« non!littéraire / documentaire ».84
80. N. TACKE, Verspunkte als Gliederungsmittel in ramessidischen Schülerhandschrifter, « SAGA » 22, Heidelberg2001. Pour les fluctuations dans l’emploi des points de versification, cf. récemment A.J. SPALINGER, TheTransformation of an Ancient Egyptian Narrative: P. Sallier III and the Battle of Kadesh, « GÖF » IV / 40,Wiesbaden 2002, p. 116. A méditer le document édité et mis en valeur par A. VON LIEVEN, Einepunktierte Osirisliturgie, dans K. RYHOLT #ed.$, The Carlsberg Papyri 7: Hieratic Texts from the Collection,« CNI Publications » 30, Copenhague 2006, pp. 9!38.
81. Sans entrer dans le détail, pour le cas particulier des narrations, cf. J. WINAND, La progression au sein dela narration en égyptien. Éléments d ’une grammaire du texte, dans « BIFAO » 100 #2000$, p. 435.
82. Pour le statut grammatical, cf. P. VERNUS, Observations sur la prédication de classe "“Nominal Predicate”#,dans « LingAeg » 4 #1994$, pp. 338!39. Pour le colophon en tant qu’apparat rédactionnel, la bibliographieest bien fournie. Cf. inter alia: R.A. PARKINSON, Teachings, Discourses and Tales from the Middle Kingdom,dans ST. QUIRKE #ed.$, Middle Kingdom Studies, New Malden 1991, pp. 94!96; D.M. MAC DOWELL,Teachers and Students at Deir el!Medina, dans R.J. DEMARÉE ! A. EGBERTS #eds$, Deir el!Medina in the ThirdMillenium A.D. A Tribute to Jac. J. Janssen, « EU » 14, Leiden 2000, pp. 223!25; G. LENZO MARCHESE, Lescolophons dans la littérature égyptienne, dans « BIFAO » 104 #2004$, p. 366; M. LUISELLI, The colophons as anindication of the attitudes towards the literary tradition in Egypt and Mesopotamia, dans S. BICKEL ! A.LOPRIENO #eds$, Basel Egyptology Prize I. Junior research in Egyptian history, archaeology and philology,« AegHelv » 17, Basel 2003, pp. 343!60; J. QUACK, Zum Kolophon des Totenbuch der Gatseschen, dans « GM »218 #2008$, p. 8.
83. PARKINSON, Poetry and Culture, p. 73.84. P. VERNUS, Omina calendériques et comptabilité d ’offrandes sur une tablette hiératique de la XVIIIe dynastie, dans
« RdE » 33 #1981$, p. 91. Cf. de même, à propos des ostraca, A. GASSE, Les ostraca littéraires de Deir el!Medina. Nouvelles orientations de la publication, dans R.J. DEMARÉE ! A. EGBERTS #eds$, Village Voices.Proceedings of the Symposium « Texts from Deir el!Medîna and their Interpretation. Leiden, May 31 !June 1, 1991,Leiden 1992, p. 52.
50 EDAL II . 2010 / 2011
La relative attraction du contenu sur le type de cursive est illustrée aussi par lecas des Aventures d ’Ounamon #cf. ci!dessous § 70$.
24. Bien sûr, il y a dans ces caractéristiques nombre de variations quicorrespondent à des sous!catégories à l’intérieur de la catégorie des manuscrits« littéraires », au sens de non « documentaires ». Par exemple, il y a plusieursstyles de tachygraphies « littéraires »,85 comme il y a, au demeurant, plusieursstyles de tachygraphies « non littéraires » ou « documentaires », « de la prati !que », en particulier l’écriture dite « de chancellerie »;86 parfois la tachygraphie
85. Bien sûr, gardons nous de simplifications outrancières; il n’y a pas une hiératique, mais plusieurshiératiques utilisées dans les manuscrits « littéraires »; cf. A. ERMAN, Die ägyptischer Schülerhandschriften,« APAW » 2, Berlin 1925, pp. 12!13.
86. L’écriture dite « de chancellerie » constitue le style le plus élaboré des tachygraphies « non littéraires »,ce qui se comprend aisément puisqu’elle entre fondamentalement dans la diplomatique des décrets, untype de textes à travers lesquels s’exprime l’auctoritas du pharaon, lequel véhicule dans ce cas de lavolonté du démiurge: cf. § 33, et P. VERNUS, Les décrets royaux "wD!nsw#: l’énoncé d ’auctoritas comme genre,dans S. SCHOSKE #Hrsg.$, Akten des Vierten Internationalen Ägyptologen Kongress München 1985, « SAKBeihefte » 4, Hamburg 1990, pp. 239!46. Cette connotation de l’écriture de chancellerie expliqued’autres de ses emplois, par exemple:· dans la copie d’une eulogie royale, comme celle du P. Chester Beatty I vo, Section B « written in stately
characters obviously adapted to the scribe’s high estimation of his theme » #GARDINER, The Libraryof A. Chester Beatty, p. 39$.
· dans le P. Turin 1882 #Turin A, LEM, p. XIX ; A.H. GARDINER, A pharaonic Encomium, dans « JEA » 41#1955$, p. 30, pl. VII!XI, et ID., A pharaonic Encomium "II#, dans « JEA » 42 #1956$, pp. 8!20; KRI VI,pp. 70!76; A.J. PEDEN, The Reign of Ramesses IV, Warminster 1994, pp. 53!54 et 104!09.
· dans la titulature de Ramsès II en « large characters », s’étendant éventuellement sur tout la page#P. Leiden 348 vo, cf. LEM, p. 132a ad 13, et p. 133a ad 4$.
FIGURE 2
51« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
épistolaire s’oppose à la tachygraphie purement admnistrative.87 Il y a desdispositifs spécifiques, qui jouent, entre autres, sur l’opposition entre ligneshorizontales et colonnes, sur le décrochement des éléments « en facteurcommun » dans la sous!catégorie hymnique.88
Mode de consommation commun aux textes manuscritsde la catégorie littéraire
25. Si par delà leur diversité, les textes manuscrits de la catégorie « litté !raire » partagent des caractéristiques semblables, c’est sans doute parce qu’ilsavaient en commun d’être fondamentalement consommés par récitation orale,89
entre autres dans leur emploi à fin didactique. On a suggéré, par exemple, quel’association de rituel, de textes magiques et de textes des belles!lettres dansune même archive est l’indice de leur utilisation par récitation orale de la partde leur possesseur:
The owners of such archives should be performers, of literature as well as rituals.90
Dans le même ordre d’idée, les points de « versification », qui ont suscité uneabondante littérature, sont probablement, serait!ce partiellement, des guidespour une récitation, en premier lieu " certes pas exclusivement " dans lecadre « scolaire ».91
· La pesanteur est si forte qu’elle vaut aussi dans des ostraca, ainsi HO pl. XVII, 3 et 4.· Pour d’autres exemples, cf. D. LEFEVRE, Les papyrus « d ’El!Hibeh » à la 21ème Dynastie. Étude philologique
et prosopographique #thèse de doctorat EPHE IVe section, 2008$, pp. 114!16.87. PARKINSON, Reading ancient Egyptian Poetry, p. 29.88. Exemple caractéristique les hymnes à Sésostris III dans les archives d’Illahoun; pour ce dispositif, cf.
entre autres H. GRAPOW, Der Liederkranz zu Ehren Königs Sesostris des Dritten aus Kahun, dans « MIO » 1#1953$, pp. 189!209; J. OSING, Zu zwei literarischen Werken des Mittleren Reiches, dans ID. ! E. KOLDINGNIELSEN #eds$, The Heritage of Egypt, Studies in Honour of Erik Iversen, « CNI Publications » 13, Copenha !gue 1992, pp. 101!09. Autres exemples plus tardifs: P. Berlin 3055 vo XXXI; P. Berlin 301 et 3052 vo XXVII.Symptomatiquement, certains parlent de « literarisch!eulogischer Form » #G. MOERS, Unter den SohlenPharaos Fremdheit und Alterität im pharaonischen Ägypten, dans F. LAUTERBACH ! F. PAUL ! U!CH. SANDER,Abgrenzung ! Eingrenzung Komparatische Studien Zur Dialektik kultureller Identitätsbildung, « AAWG. Phil.!Hist. Kl. 3. Folge » 264, Göttingen 2004, p. 110$.
89. Cf. la formule Dd m Hs.wt : SCHOTT, Bücher und Bibliotheken im Alten Ägypten, pp. 414!16.90. CH. EYRE, Why was Egyptian Literature, dans S. CURTO ! S. DONADONI ! A.M. DONADONI ROVERI !
B. ALBERTON #a cura di$, Sesto Congresso Internazionale di Egittologia. Atti, II, Torino 1992, pp. 118!19.91. En ce sens J. WINAND, La ponctuation avant la ponctuation: l’organisation du message écrit dans l’Égypte
52 EDAL II . 2010 / 2011
Plus généralement, on a proposé tout simplement d’englober dans lacatégorie « littérature »
those compositions written with the primary function of being read. This definesthe category ‘literature’ by usage.92
26. Si cette mise en vedette de la consommation orale des textes manuscrits« littéraires » se révèle parfaitement recevable, elle ne doit pas exclure, toutefois,leur utilisation dans l’expérience solitaire, immédiatement « égoïste », et querien ne permet de sous!estimer.93 Au demeurant, la consommation en solitairen’exclut pas la récitation. Pensons à Flaubert qui s’obligeait à faire passer sestextes par son « gueuloir » pour en apprécier le parachèvement.
Cela posé, on discerne sans conteste un incessant travail de modifi !cation, de décomposition et de recomposition, qui, dans son exécution n’est pasnécessairement assujetti systématiquement à l’oralisation, quand bien même ilne l’exclut pas. Un texte constituant une unité peut être divisé en deux textesprésentés comme indépendants, ou inversement.94 Dans la bibliothèque deDeir el!Médina, une miscellanée se termine avec deux extraits de l’Enseignementd’Ani, réunis en un ensemble apparemment cohérent, alors que dans l’intégraledu texte, ils sont séparés par une bonne portion du texte.95 Un ostracon montrecomment un maître retaille une miscellanée pour l’adapter à une viséeparticulière, en fonction de son disciple.96 L’Enseignement du Papyrus ChesterBeatty IV laisse apparaître la réunion de morceaux d’origines différentes autourd’un thème directeur: la nécessité de l’instruction.97
pharaonique, dans J.!M. DEFAYS ! L. ROSIER ! FR. TILKIN #éds$, A qui appartient la ponctuation? Actes duColloque international et interdisciplinaire de Liège "13!15 mars 1997#, Paris ! Bruxelles 1997, p. 174; et récem !ment, O. GOELET, Writing Ramessid Hieratic: what the Late Egyptian Miscellanies tell us about scribaleducation, dans S.H. D’AURIA #ed.$, Servant of Mut. Studies in Honor of Richard A. Fazzini, Leiden ! Boston2008, pp. 109!10. Cf. aussi ci!dessus § 23.
92. QUIRKE, Egyptian Literature, p. 25.93. Pour la lecture intérieure: SPALINGER, The Transformation of an Ancient Egyptian Narrative, p. 336. 94. TACKE, Verspunkte als Gliederungsmittel, p. 3, n. 8.95. HPBM, Third Series, p. 50: « a skilful combination of two extracts ».96. O. Petrie 8, d’après l’analyse de MCDOWELL, Teachers and Students at Deir el!Medina, p. 229.97. VERNUS, Sagesses, p. 345!46.
53« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
Donc, vocation à être consommés oralement pour les textes manuscrits« littéraires », au sens large du terme: certes. Mais cette vocation, quand bienmême elle serait fondamentale ou présentée comme telle par les égyptiens,98 nedoit pas occulter un face à face purement individuel, et où l’oralité « partagée »se trouve sinon absente, ou à tout le moins, secondaire.
Teneur commune aux textes manuscrits de la catégorie « littéraire »
27. Par delà son unité matérielle et son unité de mode de consommation,qu’est!ce qui fait l’unité de la catégorie « littéraire »?
On écartera tout d’abord un des critères utilisés quand il s’agissait dedistinguer du littéraire dans l’ensemble de la production écrite, compte nontenu des supports, à savoir l’élaboration du texte pour lui!même, par delà safinalité originelle #ci!dessus § 10$. Certes, ce genre d’élaboration peut êtreaisément perçue par l’égyptologue et, sans doute, a fortiori par les égyptiensanciens dans un grand nombre de textes de la catégorie « littéraire » des textesmanuscrits, mais il ne suffit pas à la définir. Car, par ailleurs, beaucoup d’autrestextes en elle inclus ne la manifestent pas. Par exemple, où serait la fonction« poétique » dans cette compilation onomastique égrenant les principaux realiade l’univers égyptiens?99 Ou serait!elle dans la recette médicale suivante?
Remède #pour$ quelque chose dans l’anus: Poudre de coloquinthe: une #dose$.Sel du nord: une #dose$.Natron: une #dose$.Sel de l’est: une #dose$.Miel: une #dose$.100
98. Sur l’oralité factice, noter la remarque de PARKINSON, Literary Form and the Tale of the Eloquent Peasant,p. 169: « does not indicate that the texts are transcriptions of oral works % . . .& but that they are writtenwithin an orally constituted sensibility and tradition ».
99. AEO I, p. 35 sq.100. P. Chester Beatty VI ro 5, 5!6.
54 EDAL II . 2010 / 2011
28. En fait, ce qui fait l’unité des textes relevant de la catégorie « littéraire »,
c’est que loin de se limiter aux aspects terre!à!terre, triviaux de l’existence, ils
mettent en jeu directement quelque chose qu’on qualifierait grosso modo comme
le « culturel »,101 ou l’« imaginaire »,102 à ne pas prendre, bien sûr, au sens de
« non crédible », car les anciens égyptiens y croyaient ou, à tout le moins, étaient
tenus d’y croire, ne serait!ce que pour donner sens à leur existence.
Au demeurant, J. Assmann a défendu la thèse que l’inculcation de « all
fundamentals of cultural and moral formation » serait, en dernière instance,
« the functional frame for most of those texts which we are used to classify as
“literature” ».103 Aurement dit, les textes manuscrits classés dans la catégorie
« littéraire » participeraient de l’ensemble des textes culturels #y compris la
tradition orale$104 à travers lesquels la sociéte pharaonique exprimerait et main !
tiendrait son identité
Der kulturelle Text ist zum Auswendiglernen bestimmt. Kulturelle Texte sindTexte, in denen einen Kultur die gültige, verpflichtende und massgeblicheFormulierung ihrer Weltansicht ausgedrückt sieht und in deren kommunikativerVergegenwärtigung sie dieses Weltbild % . . .& Die Funktion der kulturellen Texteliegt in der Reproduktion und Vermittlung kultureller identität.105
Dans cet ensemble, ils assumeraient plus particulièrement un rôle « normatif et
formatif ».
101. Le terme est dangereux ici, car « culturel » peut, après tout englober les textes de la pratique dans lamesure où ils entrent dans la constitution d’une personnalité individuelle ou familiale.
102. Cf. l’expression « imaginative % . . .& dimension » utilisée par FOSTER, Literature #ci!dessus$.103. J. ASSMANN, Cultural and literary Texts, dans MOERS #ed.$, Definitely: Egyptian Literature, p. 8. Discussion
récente par G. MOERS, Zur Relevanz der Namensliste des pChester Beatty IV für Versuche einer funktionalenBinnendifferenziehung des geheimhin als « literarisch » bezeichneten Gattungssystems des Mittleren Reiches, dansK. PEUST #Hrsg.$, Miscellanea in honorem Wolfhart Westendorf, Göttingen 2008, pp. 47!48.
104.ASSMANN admet que les « ‘cultural texts’ may be other than purely linguistic phenomena » #Cultural andliterary Texts, p. 7$.
105. J. ASSMANN, Kulturelle und literarische Texte, dans LOPRIENO #ed.$, Ancient Egyptian Literature, p. 68 et 69.Pour une tentative d’extension du concept, cf. K. ZINN, Librairies and Archives: the Organization ofCollective Wisdom in Ancient Egypt, dans R.J. DANN #ed.$, Current Research in Egyptology. Proceedings of theFifth Annual Symposium, Oxford 2006, pp. 169!75.
55« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
Les deux sous!catégories subdivisant la catégorie « littéraire »des textes manuscrits
29. Voilà donc établie l’unité de la catégorie « littéraire » des textes manus !crits. Cela posé, loin d’être indépassable, elle recouvre deux sous!catégories.
Quand G. Posener prit en charge l’édition des ostraca « littéraires » deDeir el!Médina #cf. § 18$,106 il fut amené à distinguer deux composantes majeu !res à l’intérieur de cette classe de manuscrits, comme le montre son constat:
Le contenu de ces documents est très varié. Ils renferment, à côté de compo !sitions littéraires proprement dites, des formules magiques, des hymnesaux dieux, des recettes médicales et des lettres modèles.107
Autrement dit, à son sentiment, les manuscrits « littéraires » #sens large/faible$comprenaient d’une part des textes « littéraires proprement dits » #donclittéraire au sens restreint / fort de belles!lettres$,108 et, d’autre part d’autrestextes qui ne relevaient pas des belles!lettres, et présentaient une assez grandevariété à première vue. Au fur et à mesure que progressait son admirablepublication, cette variété s’est accrue. Dans l’index thématique des fasciculesparus en 1972 et 1980, on relève des listes onomastiques, des exerciceslexicographiques, des extraits du Livre des morts, des extraits de rituel,comme le Rituel de l’ouverture de la bouche.
Sur ce point, le cas des ostraca de Deir el!Médina est emblématique del’ensemble du corpus des textes manuscrits. Ainsi, dans sa publication dumagnifique Papyrus Chester Beatty I, compte non tenu des textes qui n’avaientpas l’heur d’être « literary », A.H. Gardiner 109 avait réparti les oeuvres qu’ilcontient en deux groupes:· un conte #Le jugement entre Horus et Seth$, et des chants d’amour;
106.G. POSENER, Catalogue des ostraca hiératiques littéraires de Deir el Médineh, « DFIFAO » 1, 18, 20, Le Caire1938, 1951, 1977!1980. Cf. aussi GASSE, Les ostraca littéraires de Deir el!Medina, pp. 51!56.
107. POSENER, Catalogue des ostraca hiératiques, I, p. III; les caractères gras sont de mon fait.108. Analyse: FR. HAGEN, Literature and Teaching at Deir el Medina, dans R. MAIRS ! A. STEVENSON #eds$,
Current Research in Egyptology. Proocedings of the Sixth Annual Symposium wich took place at the University ofCambridge, 6!8 January 2005, Oxford 2007, pp. 38!41.
109.GARDINER, The Library of A. Chester Beatty, pp. 2!5.
56 EDAL II . 2010 / 2011
· « the remaining literary texts ». Cette dernière dénomination recouvraitd’une part un hymne à %Thot& chien, avec une phraséologie de la piété person !nelle, et une eulogie du pharaon Ramsès V.
Voilà qui fait entrevoir comment la catégorie « literary » appliquée auxtextes manuscrits peut!être elle!même subdivisée.
30. On retrouve la même répartition en deux composantes majeures,correspondant à deux sous!catégories, si on élargit la perspective, en partant dece papyrus pour l’étendre à l’archive à laquelle il appartenait, c’est!à!dire lacélèbre bibliothèque de Deir el!Médina.110
Les textes de la bibliothèque qui ont été classés sous le chef « littéraires »se révèlent, à l’examen, pouvoir être répartis en deux sous!groupes.
· Sous!groupe AD’une part, dans une premier sous!groupe, les oeuvres immédiatementassignables aux « belles!lettres » de la tradition égyptologique, c’est!à!dire lesnarrations, la lyrique, les sagesses proprement dites ainsi que les oeuvresapparentées dans la mesure où elles mettent en jeu une vision éthique #cf. ci!dessous § 42$.
· Sous!groupe BD’autre part, dans un second sous!groupe, des miscellanées 111 et descompositions, des listes onomastiques, des exercices lexicographiques,explicitement, ou, à tout le moins, manifestement didactiques, et aussi deshymnes à diverses divinités, des compositions religieuses et rituelles, desformules magiques, des formules médicales.
110. Fondamental: P.W. PESTMAN, Who were the Owners, in the ‘Community of Workmen’, of the Chester BeattyPapyri, dans R.J. DEMARÉE ! J.J. JANSSEN #eds$, Gleanings from Deir el!Medina, « EU » 1, Leiden 1982,pp. 157!72. Parmi d’autres contributions analysant la bibliothèque: J. OSING, School and Literature in theRamesside Period, dans I. BRANCOLI ! E. CIAMPINI ! A. ROCCATI ! L. SIST #a cura di$, L’impero Ramesside.Convegno internazionale in onore di Sergio Donadoni, « Vicino Oriente, Quaderno » 1, Roma 1997, p. 140;QUIRKE, Egyptian Literature, pp. 18!19.
111. Pour les miscellanées dans la bibliothèque, cf. FR. HAGEN, Literature, Transmission, and the Late EgyptianMiscellanies, dans DANN #ed.$, Current Research in Egyptology, pp. 93!97.
57« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
Bien entendu, la co!existence dans une même archive de textes qualifiésde « littéraires », mais susceptibles d’être subdivisés en deux groupes analoguesn’est nullement limitée à la bibliothèque de Deir el!Médina. Elle pourrait semanifester dans ce qui pourrait bien être une bibliothèque déposée dans unetombe de l’Époque Ramesside.112 On le constate auparavant, au MoyenEmpire, dans la bibliothèque conservée dans coffret du Ramesséum,113 ou dansles archives d’Illahoun.114 La publication de ces dernières a été sympto mati !quement répartie en deux volumes par leurs récents et excellents éditeurs,M. Collier et St. Quirke:
· The UCL Lahun Papyri. Letters, Oxford 2002.· The UCL Lahun Papyri. Religious, Literary, Legal Mathematical and Medical,
Oxford 2004.Ces deux intitulés révèlent la classification sous!jacente.
On la constate aussi après le Nouvel Empire.115 Ainsi, dans les archivesd’Éléphantine, attribuables à la Basse Époque, on a reconnu, d’une part desLebenslehren, et, d’autre part des
112. R. ENMARCH, The Dialogue of Ipuwer and the Lord of All, Oxford 2005, pp. 3!5 a réuni les indices suggérantl’appartenance à une même archive, au minimum de P. Leiden I 343 + 344 et P. Leiden I 344. Bien entendu,l’idée quoique plausible, demeure hypothétique, en raison de l’obscurité qui entoure les circonstancesdans lesquelles ces papyrus furent découvert par les trafiquants.
113. ST. QUIRKE, The Administration of Egypt in the Late Middle Kingdom. The hieratic Documents, New Malden1990, pp. 187!88; L.D. MORENZ, Beiträge zur Schriftlichkeitskultur im Mittleren Reich und in der 2.Zwischenzeit, « ÄAT » 29, Wiesbaden 1996, pp. 144!54; G. MOERS, Fingierte Welten in der ägyptischenLiteratur des 2. Jahrtausends v. Chr. Grenzüberschreitng, Reisemotiv und Fiktionalität, « PdÄ » 9, Leiden 2001,pp. 159!60; PARKINSON, Poetry and Culture, pp. 4!5, 71!72; ID., Reading ancient Egyptian Poetry, pp. 139!69; A. ROCCATI, Qu’est!ce qu’un texte magique dans l’Égypte ancienne? En quête d ’une definition, dansY. KOENIG #éd.$, La magie en Égypte: à la recherche d ’une définition. Actes du colloque organisé par le Musée duLouvre les 29 et 30 septembre 2000, Paris 2002, pp. 75!76; QUIRKE, Egyptian Literature, p. 16; J. QUACK, ZurLesung des Dramatischen Ramesseumpapyrus, dans « ZÄS » 133 #2005$, pp. 72!73.
114. QUIRKE, Egyptian Literature, pp. 26!27; R.A. PARKINSON, Two new « literary » Texts on a Second IntermediatePeriod Papyrus? A preliminary Account of P. BM EA 10475, dans J. ASSMANN ! E. BLUMENTHAL #Hrsgg.$,Literatur und Politik im pharaonischen und ptolemäischen Ägypten, « BdE » 127, Le Caire 1999, p. 188.
115. Exempli gratia: · sur le P. Chassinat III, un conte occupe le recto et une partie du verso; puis vient un hymne de la piété
personnelle: entre eux, fut rajoutée une comptabilité #CH. BARBOTIN, Le papyrus Chassinat III, dans« RdE » 50, 1999, pp. 6!7$.
· Le P. BM 10474 comporte au recto une sagesse, L’enseignement d ’Aménemopé, considéré comme relevantdes belles!lettres, à en juger par sa transmission, et au verso une encyclopédie onomastique, uncalendrier des jours fastes et néfastes, et deux hymnes; F.R. HERBIN, Un hymne à la lune croissante, dans« BIFAO » 82 #1982$, p. 239.
58 EDAL II . 2010 / 2011
Ritualtexten, Götterhymnen, magischen und, in signifikant hoher Anzahl,medizinischen Texten.116
Ainsi encore, dans la bibliothèque des temples de Soknopaiou Nesos et deTebtynis, se manifeste aussi
die Kombination von literarischen und wissenschaftlichen neben in engerem Sinnereligiösen und teilweise magischen Texten.117
31. Les égyptologues ont évidemment pris conscience que le terme « litté !raire », appliqué aux textes manuscrits sur supports « à fin de maniement » étaitun bien large qualificatif, certes opératoire au niveau très général de sonopposition à « non littéraire/documentaire », mais approximatif quand il fallaitse colleter de plus près à la variété de ce qu’il recouvrait.
Car, si « littéraire » " pris dans son sens fort " s’entend aiséments’agissant du premier groupe #A $, il ne vaut que par extension pour le second #B $,et encore, à condition de le prendre au sens large. L’ambiguité du qualificatif« littéraire », en l’occurrence sous son équivalent germanique « literarische », ence qu’il désigne à la fois une catégorie des textes manuscrits et l’une des deuxsous!catégories que cette catégorie comporte #sous!groupes A et B$ apparaîtdans cette citation d’un admirable connaisseur des textes manuscrits:
eine erkleckliche Menge neuen literarischen und religiösen Textgutesbekannt worden, das uns mit jedem Faszikel besser den einstigen Bestandaltägyptischen literarischen Schaffens erahnen lässt.118
116. G. BURKARD, Literarische Tradition und historische Realität: die persische Eroberung Ägyptens am BeispielElephantine, dans « ZÄS » 121 #1994$, p. 101. QUACK, Zur Lesung des Dramatischen Ramesseumpapyrus, p. 77,fait justement valoir aussi « die Kombination von literarischen und wissenschaftlichen neben inengerem Sinne religiösen und teilweise magischen Texten ».
117. QUACK, ibidem; K. RYHOLT, On the Contents and nature of the Tebtunis Temple Library, dans S. LIPPERT !M. SCHENTULEIT #Hrsgg.$, Tebtynis und Soknopaiu Nesos. Leben im römerzeitliche Fajum, Wiesbaden 2005,pp. 141!70. Ce qui contraste avec des archive au contenu purement administratif de l’Époque Ptolé !maïque, comme celle reconstituée par B. MUHS, The Berkeley Tebtunis Grapeion Archives, dansG. WIDMER ! D. DEVAUCHELLE #éds$, Actes du IXe Congrès International des Études démotiques, « BdE » 147,Le Caire 2009, pp. 243!51.
118. H.!W. FISCHER!ELFERT, Lesefunde in literarische Steinbruch on Deir el Medineh, « KÄT » 12, Wiesbaden 1997,p. V; les caractères gras sont de mon fait.
59« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
32. La pratique égyptologique pallie cette difficulté de diverses manières.Certains distinguent des « compositions littéraires proprement dites », impli !quant qu’il y en pour lesquelles le terme ne vaut que moyennant élargissement#cf. la citation de G. Posener, § 29$.119
D’autres préfèrent lever l’ambiguité en désignant par le genre dont ilsparaissent relever les textes sur support manuscrit qui ont en commun avec lesbelles!lettres de n’être point « documentaires », mais qui s’en distinguent troppour être qualifiés de « littéraires proprement dits », c’est!à!dire sans unimplicite sit venia verbo. Ils admettent ainsi dans la catégorie « littéraire » destextes manuscrits, les « Ritualtexten, Götterhymnen, magischen %...& medizi !nischen Texten », les « formules magiques, des hymnes aux dieux, des recettesmédicales et des lettres modèles », pour reprendre certaines citationsprécédentes.
Par besoin de précision, on en est venu à forger le qualificatif « semi!littéraires » pour caractériser, dans l’ensemble des textes manuscrits sursupports pour maniement, le sous!groupe de ceux qui, à défaut de relever des« belles!lettres » à proprement parler, possédait quelque chose qui les distinguaitdes textes véritablement « non!littéraires ». Ainsi, à propos de la bibliothèquede Deir el!Médina, aux « real literary texts », P.W. Pestman 120 oppose les« semi!literary texts », qu’il inventorie de la manière suivante:
medical prescriptions, prophylactic spells, incantations against scorpions’ stings,
119. Cf. la citation de G. POSENER mentionnée supra, à propos des ostraca de Deir el!Médina; les caractèresgras sont de mon fait.
120. A noter deux acceptions différentes de semi!littéraires:· Pour qualifier la Lettre de Menna, un texte littéraire au sens étroit, mais utilisant une forme non
littéraire, en l’occurrence la forme épistolaire; « appears to be a semiliterary composition #even versepoints are provided$ though purporting to be a letter from his father Menna, who was a drafts man inthe village », selon L.H. LESKO, Literature, Literacy and Literati, dans ID. #ed.$, Pharaohs’s Workers, NewYork 1994, p. 134. Personnellement, je caractériserais la lettre, non comme « semi!littéraire », maiscomme « littéraire », au sens fort #cf. ci!dessous § 68$.
· Pour qualifier un texte à finalité originalement documentaire, mais où l’auteur tend à déployer unetechnique et des procédés littéraires. Ainsi, J. QUACK, Einführung in die altägyptischen Literaturgeschichte,III, Die demotische und gräco!ägyptisch Literatur, « Einführungen und Quellentexte zur Ägyptologie » 3,Münster 2005, p. 162, traite, dans un appendice appelé An den Grenzen der Literatur, de textes qualifiésde « semiliterarischen », et tout d’abord la pétition de Pétisis.
60 EDAL II . 2010 / 2011
the dream!book and other texts which may have been the scope of beingsomething like ‘practical handbooks for daily use’.121
Des philologues de langue germanique ont proposé un autre terme« subliterarisch », tiré de la papyrologie grecque, dans un sens à peu prèsidentique à « semi!littéraire »:
% . . .& dem Bereich, den man z.B. bei der Edition griechischer Papyri gerne als« subliterarisch » bezeichnet. Damit gehört er in dieselbe Kategorie wie etwamedizinische, mathematische oder astrologische Handbücher; die auch in eineKopiertraditon aufgenommen werden und teilweise sogar ebenfalls fiktiveFundberichte aus änhlich früher Zeit enthalten.122
33. Quelle unité d’ensemble discerner entre tous ces textes, qui, à unpremier niveau, relèvent de la catégorie « littéraire », au sens large, en ce qu’ilsse s’opposent aux textes documentaires, mais, à un second niveau, sedistinguent des belles!lettres? Ils ont en commun de mettre en oeuvre, d’unemanière ou d’une autre, un fragment des connaissances sur le monde réel etimaginaire que la société pharaonique tenait pour avérées et légitimait commetel. Ce sont donc des textes véhiculant le « Savoir », dans ses diverses domaines.Suivant la conception égyptienne, ce savoir englobe non seulement des oeuvresmédicales, astronomiques, mathématique, des encyclopédies, etc. " disciplinesque nous appellerions « scientifiques » " mais aussi des oeuvres religieuses etmagiques auxquelles, quant à nous, nous refuserions ce qualificatif. Il faut yajouter certains textes qu’a priori nous qualifierions de « juridiques », et serionstentés de classer parmi les textes documentaires: je veux dire les décrets/rescritsroyaux,123 qui, dans la mesure où ils manifestaient une parole divine véhiculéepar le pharaon, impliquaient que leur contenu était voué à devenir une manière
121. PESTMAN, Who were the Owners, in the ‘Community of Workmen’ of the Chester Beatty Papyri, p. 165.122. J. QUACK, Der historische Abschnitt des Buches vom Tempel, dans ASSMANN ! BLUMENTHAL #Hrsgg.$,
Literatur und Politik, p. 278; cf. aussi QUACK, Einführung in die altägyptischen Literaturgeschichte, p. 162.123. Symptomatiquement, M. LICHTEIM inclut dans le volume I de son Ancient Egyptian Literature, un décret
royal de Pépi I pour la chapelle de sa mère. En l’occurrence, elle s’appuie sur une version en écriturehiéroglyphique et gravée sur pierre. Mais elle a perçu que ce genre de texte avait quelque chose d’unpeu différent de ce qu’elle appelle les textes « merely practical #such as lists, contracts, lawsuits, andletters$ ».
61« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
d’accrétion au monde terrestre.124 Ils étaient, au demeurant, pourvus d’unediplomatique distinctive et copiés dans une écriture de chancellerie sentiecomme spécifique.125
Modes d ’édition des textes du Savoir
34. Ce savoir, constitué et ordonné au fil du temps et des transmissions, lestextes manuscrits le véhiculaient sous des modalités diverses: sommes, traités,répertoires, collections et recueils thématiques, mélanges, ordonnées autour dedeux orientations majeures:126
· l’édition de stockage #1$;· l’édition pour actualisation ad hoc #2$.
Édition de stockage
35. Des éditions étaient destinées à l’archivage, dans un sens large,127 entant que stockage 128 pour référence, lecture, consultation, transmission.129
Grâce à elles, le Savoir était mis à disposition pour mobilisation éventuelle. Enelles sont puisés les matériaux pour des actualisations particulières, ad hoc.
Exemple: le Rituel d ’Amenhotep 130 est copié intégralement sur le P.ChesterBeatty IX, et la copie en est terminée par un colophon, explicitant que l’oeuvre
124. VERNUS, Les décrets royaux, pp. 239!46. Plusieurs copies de décrets de l’Ancien Empire " peut!être fictifs" étaient conservés dans la bibliothèque de Tebtynis, cf. RYHOLT, On the Contents and nature, p. 152.
125. Pour l’écriture dite de chancellerie cf. supra, § 24, n. 86.126. Cette bipartition est à rapporter aux deux fonctions majeures de l’écrit selon J. ASSMANN: « There
seems to be two fundamentally different functions of writing, namely storage and communication »#Cultural and literary Texts, p. 6$. Cf., de manière analogue, l’opposition entre la littérature commeprotection et la littérature comme régulation chez A. LOPRIENO, As a Conclusion: Towards a DetailedPerspective on Deir el!Medina, dans A. DORN ! T. HOFFMANN #eds$, Living and Writing in Deir el!Medine.Socio!historical Embodiment of Deir el!Medine Texts, « AH » 19, Basel 2006, pp. 169!70.
127. « Archives » étant entendu au sens de « books % . . .& deposited in small group % . . .& This local disciplinaryuse of the word ‘archive’ contrasts with the more precise modern usage of ‘archive’ to denote groups ofwritings that are no longer of direct practical use, but are nevertheless retained for reference in specialstorage » #QUIRKE, Egyptian Literature, p. 13$.
128. Pour la notion de « storage » cf. ASSMAN, Cultural and literary Texts, pp. 6!7.129. Je ne prends évidemment pas en compte le problème des archives administratives si bien posé par le
débat entre CH. EYRE et S. ALLAM dans « EDAL » 1 #2009$.130. W. BARTA, Kult, dans LÄ 3 #1979$, coll. 843!44.
62 EDAL II . 2010 / 2011
est perçue comme une unité se suffisant à elle!même.131 Il s’agit ici d’uneversion archivée avant tout pour stockage,132 où le texte est pour ainsi dire misen réserve et peut demeurer à peine utilisé parce qu’il sert d’exemplaire deréférence, une sorte de « mètre étalon », mutatis mutandis. À la limite, il tire savaleur de sa seule positivité, car une conception tant soit peu « fétichiste » del’écrit ne saurait être exclue. Il ne porte guère alors de marques d’usure.133 Uneautre copie du Rituel d ’Amenhotep est connue par un papyrus partagé entre entrele Musée de Turin et le Musée du Caire. Le texte participe de ces rituels de cultedont d’autres versions de référence sont connues, par exemple dans la biblio !thèque du temple gréco!romain de Tebtunys.134
36. Cela posé, le texte stocké demeure aussi à disposition, potentiellementaccessible à qui peut / veut / sait l’utiliser. Aussi, à partir des textes ou d’extraitsde textes ainsi édités, on peut recomposer d’autres ensembles eux aussipassibles du même genre d’édition.
Par exemple, plusieurs scripteurs à différentes époques, d’abord dansune écriture appliquée #« littéraire »$, avec points de « versification », puis, dansune écriture plus rapide mais très professionnelle, contribuèrent successi !vement à constituer dans la bibliothèque de Deir el!Médina une édition deréférence 135 de formules prophylactiques en compilant des textes et extraits detextes d’origines diverses.
131. P. Chester Beatty IX #P. BM 10689$ = HPBM, Third Series, I, p. 78; le texte occupe le recto et une partie duverso. Sur ce verso, à partir de la fin, on a ajouté un texte magique; il est suivi d’un livre d’invocation etd’un livre de protection.
132. Certains se sont élevés contre l’existence d’un archivage en ce sens à époque ancienne, à tout le moinsdans le cas du mythe: « The notion of a record of religious knowledge made for its own sake "something close to writing down a myth with the principal purpose of fixing it or preserving it " findsno counterpart in the Egyptian record % . . .& before a late date, and the idea itself seems ratherextraneous to Egyptian culture » #BAINES, Prehistories of literature Performance, Fiction, Myth, p. 33$.
133. E.g. le P. Ebers, selon l’observation de R.A. PARKINSON, Voices from ancient Egypt, London 1991, p. 22.134. Rituel d ’Amenhotep I, version publiée par J. OSING ! G. ROSATI, Papiri geroglifici e ieratici da Tebtynis,
Firenze 1998, pp. 101!28; cf. RYHOLT, On the Contents and nature, p. 150. On pourrait évoquer aussi leRituel de l’ouverture de la bouche avec ses nombreuses versions; cf. le remarquable article de J. QUACK,Fragmente des Mundöffnungsrituals aus Tebtynis, dans RYHOLT #ed.$, The Carlsberg Papyri 7, pp. 69!150.
135. P. Chester Beatty VIII = HPBM, Third Series, I, pp. 66!76.
63« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
Bien plus, nous saisissons peut!être sur le vif la mobilisation pour un casparticulier de formules magiques à partir d’archives où elles étaient stockées.Au verso d’un papyrus comportant des incantations contre les scorpions, dansun extrait du type « journal de la nécropole », on relève la mention:
%Venir& par le scribe Panétcher pour donner 136 la formule d’extirper le poison auscribe de l’Institution de la tombe Panéferemdjedet dans la maison de Abiment.137
Au demeurant il arrive que quelque notation explicite la mise en oeuvre pour descas particuliers des textes copiés sur un manuscrit. Ainsi, avec son habituelleperspicacité, A.H. Gardiner avait remarqué, que dans un recueil de textesmagiques, le scribe portait parfois une indication supralinéaire à l’encre rouge
, jr(w), « a été fait », au!dessus d’une formule. Il avait suggéré que cetteindication signalait la mise en pratique de ladite formule.138
Editions pour actualisation ad hoc
37. A côte des éditions de stockage, voué à l’archivage, il y a des éditionssous forme d’actualisations ad hoc 139 pour répondre à des besoins particuliers.Elles sont élaborées par copies, prélèvements, regroupements et recompo si !tions à partir la masse stockée dans des éditions de stockage de type #1$.140 Bien
136. J’interprète Hr dj.t, comme une graphie pour rdj.t.137. P. Genève MAH 15274 vo II = A. MASSART, The Egyptian Geneva Papyrus MAH 15274, dans « MDAIK » 15
#1957$, p. 182, pl. XXXVIII; A. Manisami, „Imitate but innovate“ oder: Eine Götterbedrohung mit hymnischerStruktur im Papyrus Genf MAH 15274, dans « SAK » 32 #2004$, p. 302. Pour l’appartenance à la bibliothèquede Deir el!Médina, cf. PESTMAN, Who were the Owners of the Chester Beatty Papyri, p. 155. Un autre passagedu même papyrus mentionne la délivrance de « documents »; mais il ne s’agit pas nécessairement deformules magiques; cf. F. NEVEU, À propos du P. DM 28: un conseil royal consacré aux affaires de ‘la tombe’, dans« RdE » 41 #1990$, p. 147, n. 30; DONKER VAN HELL ! HARING, Writing in a Workmen’s Village, p. 101.Comparer avec la mention de papyrus médicaux dans une lettre démotique traduite par FR. HOFFMANN! J. QUACK, Demotische Texte zur Heilkunde, dans B. JANOWSKI ! D. SCHWEMER #Hrsgg.$, Texte zurHielkunde, « TUAT Neue Folge » 5, p. 311.
138. « indicates that the magician had made practical use of this incantation » #HPBM, Third Series, I, p. 59$.Pour cette indication dans les documents admnistratifs, cf. W. HELCK, Altägyptische Aktenurkunden des 3.Und 2. Jahrausend v. Chr., « MÄS » 31, München 1974, p. 61.
139. C’est sans doute en ce sens que P.W. Pestman comptait parmi les « semi!literary texts » de la biblio !thèque de Deir el!Médina, des textes « which may have been the scope of being something practicalhandbooks for daily use »; cf. ci!dessus.
140.Bien évidemment, il ne s’agit pas systématiquement de copie mécanique, reproduisant scrupuleu !sement les textes des éditions de référence. Loin de là. La mobilisation dans une fin particulière dusavoir entraîne souvent des modifications " parfois importantes " des textes consultés. Pour la magie,cf. Y. KOENIG, Le papyrus de Moutemheb, dans « BIFAO » 104 #2004$, pp. 314!21.
64 EDAL II . 2010 / 2011
entendu, une édition ad hoc peut à son tour être archivée secondairement, soitpour elle même, soit à travers la composition pour laquelle elle est mobilisée.
D’entre les finalités fonctionnelles qui motivent les actualisations ad hoc,deux saillent particulièrement:
· l’actualisation ad hoc à fin didactique #2a $ ;· l’actualisation ad hoc à fin de sacralisation #2b $ .
Actualisation ad hoc à fin didactique
38. Dans les éditions d’archivage, on puise parmi les textes de référence, desmatériaux textuels à usage pédagogique.
Premier exemple: un fragment du célèbre mythe d’Isis et de Rê, a été copiésur un ostracon où il est suivi immédiatement d’une lettre fictive, ou, à tout lemoins passée comme morceau choisi, faisant l’éloge de la Résidence royale de Pi!Ramsès.141 Qui plus est, cette lettre était introduite par un titre Hsy TAw, « chantdes vents », référence à son mode d’énonciation primaire, fût!il théorique.142 Toutdonne à penser que si le fragment du mythe a été copié immédiatement avant cetéloge, c’est en tant qu’actualisation à finalité didactique.143
En revanche, le même mythe, dans la même formulation, est utilisécomme récit #« historiola »$ visant à fournir une caution prototypique dansl’agumentation d’une formule magique. Laquelle formule est copiée avec sontitre et sa notice d’utilisation 144 parmi d’autres textes magiques dans un
141. O. Queen’s College 1116 = HO, pl. II. 142. Cf. CHL. RAGAZZOLI, Éloge de la ville en Égypte ancienne. Histoire et Littérature, Paris 2008, p. 103.143. Pour l’utilisation des textes magiques dans le cadre de pratiques « scolaires » cf. M. MÜLLER, Magie in
der Schule. Die magischen Sprüche des Schülerhandschrift pBM EA 10.085 + 10.105, dans MOERS ! BEHLMER !DEMUSS ! WIDMAIER #Hrsgg.$, jn.t Dr.w ! Festschrift für Friedrich Junge, p. 462, en particulier le cas duP. Leiden I 348. Il faut ajouter le P. Leiden I 349 = A. DE BUCK ! B.N. STRICKER, Teksten tegen Schorpioenennaar Pap. I 349, dans « OMRO » 21 #1940$, pp. 53!62. Cf. aussi récemment ENMARCH, The Dialogue ofIpuwer and the Lord of All, p. 3. Quelques ostracas du Nouvel Empire comportent des extraits del’épisode d’Isis dans les marais de Chemmis, bien connu par des objets ou monuments magiques de laBasse Époque; cf. H. ALTENMÜLLER, Magische Literatur, dans LÄ 3, col. 1155; O. IFAO 1689 = A. GASSE,Catalogue des ostraca littéraires de Deir al!Médîna Nos 1676!1774, IV, « DFIFAO » 25, Le Caire 1990; J. QUACK,Kontinuität und Wandel in der Spätägyptischen Magie, dans « SEL » 15 #1998$, p. 79; J. BORGHOUTS,Lexicographical Aspects of magical Texts, dans GRÜNERT ! HAFEMANN #Hrsgg.$, Textcorpus und Wörterbuch,p. 166. Il s’agit probablement d’actualisations à fins didactiques.
144. P. Turin 1993 #Pleyte Rossi$ = 54052; LÄ 4, col. 734; cf. J. BORGHOUTS, Ancient Egyptian Magical Texts,Leiden 1978, pp. 51!55, no 84; ID., The Ram as a Protector and Prophetiser, dans « RdE » 32 #1980$, p. 33.
65« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
papyrus représentant une édition d’archivage du type #1$, Il s’agissait sans douted’un recueil de formules prophylactiques mises en disponibilité, à toute finutile, comme un autre papyrus où la même formule est derechef suivie d’autresformules prophylactiques.145
Deuxième exemple: on a évoqué des éditions de référence du Ritueld ’Amenhotep I, dans des bibliothèques familiales ou de temple. Par ailleurs, unextrait du même rituel figure dans des morceaux choisis d’une miscellanée,146
après deux lettres administratives. Là, il est mobilisé dans un ensemble à finalitédidactique, à tout le moins à l’origine,147 dans une édition plutôt de type #2a$,et où le texte a été actualisé ad hoc.
Actualisation ad hoc à fin de sacralisation
39. Dans les éditions de références, on puise de quoi élaborer un texte vouéà être un élément constituant d’un objet ou d’un monument sacralisé.148
Revenons sur le Rituel d ’Amenhotep I. On a mentionné des éditions deréférences pour stockage de type #1$, et aussi des actualisation à fin didactiquetype #2a$. Par ailleurs, la composition a été maintes fois exploitée, sous formesd’extraits dans des scènes censées reproduire le rituel idéal dont bénéficiaientles divinités.149 Dès lors, les textes sélectionnés à partir de la compositions’intègrent dans un ensemble « sacralisé » par le support " les parois du temple" et par le recours à l’écriture hiéroglyphique; elles constituent des actua !lisations de type #2b$.
40. L’actualisation ad hoc à fin de sacralisation de textes par ailleurs connuspar des éditions de référence pour stockage, est particulièrement bien illustrée
145. P. Chester Beatty XI ro; au verso, un hymne à Amon a été copié plus tard.146. P. Turin B vo 4, 3!8 = LEM, pp. 127!28, cf. p. XX; CLEM p. 473. 147. La miscellanée n’est plus qu’un vestige; les premiers textes avaient été lavés pour recevoir des
comptabilités.148. Sur cette notion, cf. la bibliographie donnée ci!dessus § 1.149. Par exemple dans la salle hypostyle du temple de Karnak et dans le temple de Ramsès III à Médinet
Habou, cf. H.H. NELSON, Certain Reliefs at Karnak and Medinet Habu and the Ritual of Amenophis I, dans« JNES » 8 #1949$, pp. 201!29.
66 EDAL II . 2010 / 2011
dans le domaine de la magie. Par exemple, une formule contre le venin estconnue:150
· à travers une édition d’archivage, dans des rouleaux de papyrus où elleprend place dans un recueil de magie prophylactique, lui!même intégrédans une compilation de charmes magiques, avec point de « versifica !tion » #édition de type 1 $;151
· à travers des actualisations ad hoc à fin didactique 152 #édition de type 2a $;· à travers des des actualisations ad hoc à fin de « sacralisation » #édition de
type 2b $. Ce sont soit des stèles, en particulier à la Basse Époque, soitdes talismans comportant un manuscrit en hiératique, comme le P. Deirel!Médina 41.
Dans le cas de stèles, la sacralisation s’opère à travers ses marques habituelles,la fixation sur des monuments en matériau non périssables ou perçus commetel, le recours à l’écriture hiéroglyphique, sans compter l’utilisation d’un état delangue mimétique de la langue originelle #égyptien de tradition$; illustrationprototypique: la stèle de Metternich et bien d’autres « monuments » apparentés.
En revanche, dans le cas de ces talismans,153 c’est seulement l’apparatd’ensemble qui joue. La feuille de papyrus est destinée à être pliée ou roulées,ficelée et suspendue par une corde à noeuds au cou en tant que phylactère.154
Dépassant son rôle premier de support « à fin de maniement », le papyrus est ici
150. Inventaire, et étude des documents par Y. KOENIG, Deux amulettes de Deir el!Médinah, dans « BIFAO » 82#1982$, pp. 283!91.
151. P. Turin 1993 = W. PLEYTE, Papyrus de Turin. Facsimilés de F. Rossi de Turin, Leiden 1869!1876, pl. 131, etP. Vatican B II.
152. O. Strasbourg H 111; les données disponibles sur cet ostracon m’inciteraient à conjecturer qu’il avait étécopié dans le cadre d’activités scolaires, mais il est incomplet.
153. P. Deir el!Médina 41. Ce sont les dimensions du manuscrit et l’analogie qui ont poussé Y. Koenig à lecaractériser sous le terme « amulette ». L’ « amulette » P. Deir el!Médina 42 qu’il publie serait uneactualisation ad hoc d’un autre texte connu par une version de mise en disponibilité, le P. Chester BeattyVII, vo 7.
154. HPBM Fourth Series; Y. KOENIG, Un revenant inconvenant "Papyrus Deir El!Medineh#, dans « BIFAO » 79#1979$, p. 102; ID., Le contre!envoûtement de Ta!di!Imen. Pap. Deir el!Médineh 44, dans « BIFAO » 99 #1999$,pp. 259!81; ID., Le papyrus de Moutemheb, dans « BIFAO » 104 #2004$, p. 291. G. BURKARD, Drei Amulettefür neugeboren aus Elephantine, dans MOERS ! BEHLMER ! DEMUSS ! WIDMAIER #Hrsgg.$, jn.t Dr.w !Festschrift für Friedrich Junge, pp. 120!21. Une allusion à cette pratique dans la Lettre satirique de Hori:« comme un papyrus!enroulé contre le mal au cou de quelqu’un qui souffre » #P. Anastasi I, 7, 4$.
67« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
investi d’une fonction « sacralisante » par défaut, et le talisman devient enquelque sorte le substitut d’un monument « sacralisé », les matériaux habituel !lement propres à la sacralisation ne pouvant être utilisés pour des raisonspratiques, le coût, bien entendu, et la commodité d’emploi: même pourbénéficier au maximum des vertus d’une formule, on hésite à suspendre unepierre à son cou, encore que cela ne soit pas totalement exclu.155
41. Dans ce genre d’exemple, le passage du savoir stocké au savoirmobilisé ad hoc est manifeste entre autres, dans l’indication du bénéficiaire,même si elle n’est pas systématique.
Par exemple, dans une version d’une composition comme le Livre deprotéger le corps, créée pour l’actualisation ad hoc, à fin de sacralisation sous formede talisman #édition de type 2b $, la bénéficiaire est désignée par son nom dansune formule standardisée:
Ce n’est pas moi qui l’ai dit; ce n’est pas moi qui l’ai répété. C’est cette magie létalequi vient pour s’abattre s’abattre sur Tadiimen qui l’a dit. C’est elle qui l’a répété.156
Dans une une édition de référence de type #1$, dans une composition différente,mais du même genre, la même formule standardisée utilise une expressiongénérale anonyme, afin de s’adapter à tout destinataire potentiel:
Ce n’est pas moi qui l’ai dit; ce n’est pas moi qui l’ai répété. C’est cette magie quivient contre Untel #litt.: montagne$ né de Unetelle #litt.: ciel$ qui l’a dit, qui l’arépété.157
155. Il existe des amulettes faites d’un matériau « sacralisant », avec textes hiéroglyphiques et, théori !quement, suspendues au cou. Mais le plus souvent, elles appartiennent à l’équipement de la momie; cf.Y. KOENIG, Magie et magiciens dans l’Égypte ancienne, Paris 1994, pp. 345!50.
156. ID., Le contre!envoûtement de Ta!di!Imen, p. 269.157. Pour ce genre d’expression laissant la place à une actualisation postérieure, cf. J. SPIEGEL, Ein neuer
Ausdruck für ‘der und der ’ im Ägyptischen, dans « ZÄS » 71 #1935$, p. 159; J. BORGHOUTS, The magical Texts ofPapyrus Leiden I 348, dans « OMRO » 51 #1970$, pl. 13, 3a!b; L. LIMME, Derechef le “nom du propriétaire” dupapyrus Vandier "verso#, dans « CdE » 69 #1994$, pp. 5!8; H.!W. FISCHER!ELFERT, Drei Personalnotizen, dans« GM » 119 #1990$, pp. 15!16; J. QUACK, Notes en marge du papyrus Vandier, dans « RdE » 46 #1995$, pp. 168!69. A noter que ce genre d’expression est déjà utilisé dans les Textes des pyramides #§ 147a$, et pour desextraits des Textes des pyramides en attente d’actualisation, cf. C. BERGER ! EL NAGGAR, Des Textes desPyramides sur papyrus dans les archives du temple funéraire de Pépy Ier, dans BICKEL ! MATHIEU, D’un monde àl’autre. Textes des pyramides et Textes des Sarcophages, pp. 85!88. Pour un cas posssible plus ancien:H.G. FISCHER, A Fragment of Late Predynastic Egyptian Relief from the Eastern Delta, dans « Artibus Asiae »
68 EDAL II . 2010 / 2011
Bien entendu, dans le cadre d’actualisation ad hoc, des mobilisations d’un mêmetexte dans des finalités différentes " à fin didactique ou à fin de sacralisation" peuvent induire des différences dans sa formulation. Ainsi, dans sa versionpour mise en oeuvre thérapeutique, sur une feuille de papyrus, une formulemagique, comporte, dans son mode d’emploi, une allusion à la flèche à laquelleelle devait être attachée. En revanche, point d’allusion à cette flèche dans lesdeux versions copiées sur ostraca, et relevant des activités didactiques;158 elleétait jugée non pertinente pour ce genre d’utilisation.
Voilà pour la sous catégorie des textes du savoir, ou « semi!litteraires »,s’opposant à la sous!catégorie des textes « littéraire » au sens fort de « belles!lettres ». Ces deux sous!catégories constituant la catégorie « littéraire » #au sensfaible$ des textes manuscrits sur supports à fin de maniement.
21 #1958$, p. 85, n. 46. Y. KOENIG, Le papyrus Boulaq VI. Transcription, traduction et commentaire, « BdE » 87,Le Caire 1981, 41#c$, signale l’expression dans les CT.
158. I.E.S. EDWARDS, Kenhikhopshef ’s prophylactic Charm, dans « JEA » 54 #1968$, p. 157. Noter que s’agissant dece charme, on peut opposer là encore, une version « scolaire » où le bénéficiaire n’est évoqué qu’à traversla formule anonyme « untel », à un ostracon #O. Gardiner 300$ et à un papyrus monté en amulette #P. BM10371$, où les bénéficiaires sont nommément explicités; cf. J. 'ERN), A Community of Workmen at Thebesin the Ramesside Period, « BdE » 50, Le Caire 20012, pp. 335!36; BORGHOUTS, Ancient Egyptian Magical Texts,pp. 17!18, n° 2. Un cas intermédiaire est illustré par le P. Boulaq 4 #CGC 58042$ vo #J. QUACK, Die Lehrendes Ani Ein neuägyptischer Weisheitstext in seinem kulturelle Umfeld, « OBO » 141, Fribourg ! Göttingen 1994,p. 8$, avec le brouillon d’un texte actualisé par le nom de son bénéficiaire, mais qui n’est manifestementpas une version sacralisée par défaut.
LIT TÉRAIRE#sens large / faible$
Littéraire au sens restreint/fort
Belles!lettres
Marques formelles spécifiques #écri !ture, manuscrits, etc.$
Le « focus on the message for its ownsake» n’est pas une marque distinctivenécessaire, même s’il est fréquent
Semi!littéraireDidactique Savoir
y compris traités techniques
ReligionScienceMagie
69« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
« Littéraire », « littérature », limité aux textes manuscrits
B. « littérature », « littéraire » au sens restreint / fort de belles!lettres
42. Outre ses acceptations larges ou faibles, « littérature » désigne undomaine d’activité culturelle relevant de production artistique, de la dimension« poétique », si on veut, mais à condition que cette dimension « poétique » s’avèreprédominante dans la réception et la consommation du texte, loin d’affleurercomme annexe, en demeurant subordonnée à sa fonction première.159 Dans cesens fort et corrélativement beaucoup plus restreint que notre civilisationaccorde à ce terme " certains parlent de « narrow concept of high literature»160
" on lui associe comme quasi synonyme « belles!lettres », par delà ses fluc !
159. « Poétique », au sens large, et non au sens plus restreint du terme « poésie », quand il désigne un typeparticulier de littérature, quand bien même serait!ce le plus prestigieux.
160.PARKINSON, Voices, p. 25.
NON LIT TÉRAIRE# ou documentaire, de la pratique $
Textes à usage trivial, pour lesnécessités du quotidien
FIGURE 3
70 EDAL II . 2010 / 2011
tuations sémantiques, au demeurant porteuses d’ambiguité.161 La traditionallemande utilise « Schöne Literatur ».162
Pour débusquer et décrire les vestiges de la littérature ainsi entenduedans les productions écrites de la civilisation pharaonique, l’Égyptologie s’estcontentée " s’est satisfaite? " pendant longtemps, de critères plutôt vagues.On s’accordait vaille que vaille à en définir le « noyau dur » à travers unetripartition de ce genre:
a$ les oeuvres narratives;b$ les oeuvres sapientiales #sagesses proprement dites, et, par extension,
compositions visant à transmettre une interprétation du monde$;163
c$ les oeuvres lyriques.164
Voici une citation illustrative:
Within the mass of material studied by several generations of Egyptologists therehas emerged a series of compositions which can unquestionably be regarded asliterature in our sense. The closest parallels are to be found in other parts of theancient Near East in the literature of Mesopotamia and the people of the OldTestament. These compositions are narratives and tales, teaching #instructions$,and poetry.165
Cette tripartition suscitait un consensus d’autant plus large que pour ces trois« genres » en question, notre modernité se retrouve, peu ou prou,166 dans leprolongement de l’Égypte pharaonique:
161. Fines études du terme « belles!lettres » et de sa relative pertinence comme traduction de md.t nfr.t dansQUIRKE, Egyptian Literature, pp. 49!51. Pour l’expression schöne Literatur dans l’Égyptologie allemande,cf. J. BAINES, On Wenamun as a literary Text, dans ASSMANN ! BLUMENTHAL #Hrsgg.$, Literatur und Politik,p. 224.
162. « Der Gegensatz von Gebrauchsliteratur, angewandter oder pragmatische Literatur, Literatur ‘inweiteren Sinne’, und Schöner Literatur, Literatur ‘im engeren Sinne’ »: BLUMENTHAL, Prolegomena zueiner Klassifizierung der ägyptischen Literatur, p. 174; cf. encore le titre significatif du chapitre SchöneLiteratur? B.U. SCHIPPER, Zur Grundlegung der ägyptischen Literatur, dans ID., Die Erzählung des Wenamun.Ein Literaturwerk im Spannungsfeld von Politik, Geschichte und Religion, « OBO » 209, Fribourg ! Göttingen2005, pp. 323!33.
163. Cf. VERNUS, Sagesses, pp. 11!15.164. Par exemple, on peut retrouver cette tripartition dans les oeuvres définies comme « narrowly literary
compositions » par ST. QUIRKE, dans LOPRIENO #ed.$, Ancient Egyptian Literature, p. 383, si on veut bienconsidérer les hymnes au pharaon et à Hâpy comme relevant de la lyrique.
165. W.K. SIMPSON, dans l’introduction de ID., The Literature of Ancient Egypt, p. 3.166. L’analyse de la célèbre évocation des écrivains du passé montrerait que les égyptiens reconnaissaient au
moins deux genres: « within what we may call “littérature”, the Egyptian of the New Kingdom
71« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
there are well represented types of literature that modern readers can distinguishas familiar genres. These are the lyric, the narrative and the instructions # i.e.wisdom literature$.167
Mais elle ouvrait grande la porte aux appréciations subjectives et impression !nistes dès qu’on circulait à la périphérie du noyau dur, et laissait pour compteune bonne partie de la problématique qui s’attache aux belles!lettres.
43. Bien sûr, pour justifier ces tâtonnements empiriques, les égyptologuesarguaient " ou auraient pu arguer " d’un alibi relativiste du genre « chaquecivilisation a sa propre conception de la littérature ». Est!ce pleinement jus !tifié? 168 Certes, il faut se défier d’une naïveté romantique qui érigerait lanotion de littérature, participant de l’art, en dimension transcendante de l’âmehumaine, en catégorie ontologique affranchie de tout conditionnementhistorique et social. Il s’agit, en fait, d’une construction sans cesse remaniée, etdont le plein développement est intimement lié à notre modernité.169
Cela posé, la cantonner à cette modernité au nom d’un relativismeexacerbé, en instaurant d’infranchissables limès entre elle et une spécificitéprétendue irréductible des civilisations passées et / ou lointaines estdifficilement soutenable, hors théorie purement spéculative. Comment nierque la littérature, telle que nous la percevons empiriquement, a quelque choseà voir avec nombre d’oeuvres de l’Égypte pharaonique, pour ne rien dire duProche Orient ancien?
Il est donc légitime de renoncer à l’alibi relativiste, confortable, maisstérile, et de recourir à notre notion moderne de littérature, à condition,toutefois de s’inspirer d’une axiologie prototypique. Il est bien entendu, que
distinguished #at least$ two categories, a didactic and a narrative one » #MOERS, Zur Relevanz derNamensliste des P Chester Beatty IV, pp. 44!52$ . Cf. sur ce point, VERHOEVEN, ,,Loyalistischen Lehre“ zur„Lehre des Kaïrsu“, p. 91.
167. FOSTER, Literature, p. 300; dans cette citation, « wisdom literature » et « types of literature » illustrentl’emploi du terme étudié ci!dessus § 3.
168. Pour une position proche du problème, cf. A. LOPRIENO, La pensée et l’écriture. Pour une analyse sémiotiquede la culture égyptienne, Paris 2001, pp. 55!58.
169. Cf. PARKINSON, Poetry and Culture, pp. 4!5 et 23.
72 EDAL II . 2010 / 2011
si notre notion moderne se trouve pour l’occasion promue modèle le plusproche du prototype, c’est pour des motifs purement pratiques, et non en vertud’un parachèvement idéal. Après tout, cette notion qu’on postule inconsciem !ment aboutie désormais, en ce début du vingt!et!unième siècle, les temps àvenir ne manqueront pas de lui apporter de substantiels remaniements, lajugeant un peu rudimentaire!
Acceptons!donc, méthodologiquement, de reconnaître à un ensembled’oeuvres à l’intérieur de la production écrite de l’Égypte pharaonique, unespécificité relative mais pertinente, et pour laquelle notre notion de « littéra !ture » fournit un prototype, sans risque d’anachronisme.170
44. Cela posé, sur quelles bases le définir? 171 En ce domaine, l’Égyptologie,se départissant de sa tendance au splendide isolement,172 est entrée de plain!pied dans la modernité en s’ouvrant aux débats transculturels dans le cours desannées soixante!dix, sous l’égide de J. Assmann. Dans un article 173 qui méritesans conteste l’épithète anglo!saxonne « epoch!making », il ouvrit en quelquesorte une « ère des Meiji » en promouvant le débat égyptologique dans le champde la modernité. Sa grande avancée fut d’introduire la notion de fonction socialepour définir la littérature au sens fort. L’absence de fonction et donc, le nonassujettissement à un contexte spécifique était précisément ce qui, selon lui, lacaractérisait:
This contextual independance is the hallmark of literature in ancient Egypt.174
170. Pour l’exorcisation relative du risque d’anachronisme: « we witness the rise of a comparatively de!functionalized sphere of literay production and reception which we may classify as belles!lettreswithout making ourselves guilty of too much anachronism » #ASSMAN, Cultural and literary Texts, p. 13$.
171. La fluidité évidentes des limites de la littérature n’en invalide pas le concept, comme le souligneR.A. PARKINSON, Types of Literature in the Middle Kingdom, dans LOPRIENO #ed.$, Ancient EgyptianLiterature, p. 308.
172. Sur cette tendance, cf. P. VERNUS, Dictionnaire amoureux de l’Égypte pharaonique, Paris 2009, pp. 286!90.173. J. ASSMANN, Der literarische Text im alten Ägypten: Versuch einer Begriffstimmung, dans « OLZ » 69 #1974$,
pp. 117!26.174. ID., Cultural and literary Texts, p. 4.
73« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
Par là se dissipaient les apories sur lesquelles débouchaient inéluctablement lerecours à des considérations d’esthétique:
The difference between literary and non!literary texts can only be functionalydetermined but not by criteria such as « dichterische Gestaltung oder derenAbglanz ».175
Ce critère de « non fonctionnalité » dans le jargon des sciences humaines,souleva l’intérêt. Certes, il fut évoqué pour être immédiatement révoqué dansla préface de l’anthologie de Myriam Lichtheim, devenue classique de lalittérature pharaonique #cf. ci!dessus § 8$:
For the most part, ancient literatures are purposeful: they commemorate, instruct,exhort, celebrate and lament. To define literature narrowly as non!functional worksof the imagination would eliminate the bulk of ancient works of the past and wouldintroduce a criterion quite alien to the ancient writers.176
Mais, par ailleurs, la thèse de J. Assmann eut tôt fait de gagner l’adhésion deségyptologues qui avaient à traiter de littérature. Certains s’en tenaient stricte !ment à la « non fonctionnalité »:
literary compositions would be those with no functional application, and so standapart from all other content, from letters and accounts, to ritual for temple orfestival rites and mathematical and medical treatises.177
Variante de la « non fonctionnalité »: l’absence de finalité. Ainsi:
literarischen Texten % . . .& Diese Art von Texen wäre gewissermassen « zweckfrei »gewesen und nur um ihrer selbst willen entstanden.178
De même dans l’énumération des traits propres aux oeuvres littéraires, certainsmettent en avant:
keine zu enge Zweckbestimmung #wie Theologie, Kult, Grab$;
175. Ibidem, p. 3; ID., The History of the Text before the Era of Litterature. Three Comments, dans MOERS #ed.$,Definitely: Egyptian Literature, p. 87: « the first step was to abolish substantial notions of aesthetic valueand poetic form in favor of relational or functional description ».
176. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, I, p. VI. Ce qui a valu ce jugement de PARKINSON, Poetry andCulture in Middle Kingdom Egypt, p. 17: « Miriam Lichtheim’s influential anthology resists westernexpectations of ‘literature’ with a selection of wider types of text than Posener’s Canon ».
177. QUIRKE, Egyptian Literature, p. 25.178. KNIGGE, Das Lob der Förschung, p. 27.
74 EDAL II . 2010 / 2011
keine zu starke « Ortsbindung » #Tempelinschriften, Stelen vs Papyrus$.179
D’autres préférent parler d’indépendance vis!à!vis du contexte ou de lasituation, peut!être parce que consciemment ou non, la pure notion de « nonfonctionnalité » les gêne:
! Es ist der Gegensatz von Gebrauchsliteratur, angewandter oder pragmatischeLiteratur, Literatur « in weiteren Sinne », und Schöner Literatur, Literatur « imengeren Sinne », die nach einer grundlegenden Einsicht von J. Assmann dadurchdefiniert ist, dass die einen, die pragmatischen Texte, Verwendungssituationen inder gesellchaftlichen Praxis unmittelbar zugehören, die anderen die literarischenTexte, frei davon sind.180
! Situationsabstrakt or narrowly literary.181
! One distinction between literary #in the narrowest sense$ and non!literary textsis that literary texts are fictional compositions that are contextually unbound.182
45. Bien plus, le chemin qu’avait frayé J. Assmann, d’autres l’ont élargi envaste avenue en faisant bénéficier l’Égyptologie des avancées des réflexionsmodernes sur la notion de littérature en général,183 et en les appliquant auxtextes égyptiens.184 Ont été particulièrement mises en vedette trois propriétésmajeures de la dimension littéraire #sens fort$:
179. G. BURKARD ! H.J. THISSEN, Einführung in die altägyptische Literaturgeschichte, « Einführungen undQuellentexte zur Ägyptologie » 1, Münster ! Hamburg ! London 2003, pp. 14!28.
180. BLUMENTHAL, Prolegomena zu einer Klassifizierung der ägyptischen Literatur, p. 174.181. BAINES, Prehistories of Literature Performance, Fiction, Myth, p. 33. Cf. récemment ID., Research on egyptian
Literature: Background, Definitions, Prospects, dans Z. HAWASS #ed.$, Egyptology at the dawn of the twenty!firstCentury. Proceedings of the Eight International Congress of Egyptologists, III, Cairo 2003, pp. 1!27.
182. PARKINSON, Two new « literary » Texts on a Second Intermediate Period Papyrus?, p. 189.183. On trouvera d’excellents exposés dans A. LOPRIENO, Defining Egyptian Literature: Ancient Texts and
Modern Literary Theory, dans G. SCHWARTZ ! J. COOPER, #eds$, The Study of the Ancient Near East in theTwenty!First Century. The William Foxwell Albright Memorial Volume, Winona Lake 1996, pp. 1!24;A. LOPRIENO, Defining egyptian Literature: ancient texts and modern theories, dans ID. #ed.$, Ancient EgyptianLiterature, pp. 39!58; MOERS, Fingierte Welten in der ägyptischen Literatur, pp. 19!164 #Zweites Kapitel:theoretischen Modellierungen$; ID., Der Spurensucher auf falscher Fährte? Überlegungen zu den Voraussetzungeneiner ägyptologischen Literaturwisenschaft, dans G. BURKARD ! A. GRIMM ! S. SCHOSKE ! A. VERBOVSEK#Hrsgg.$, Kon!Texte. Akten des Symposions „Spurensuche ! Altägypten im Spiegel seiner Texte“, München, 2. bis 4.Mai 2003, « ÄAT » 60, Wiesbaden 2004. Cf. encore H. GUTSCHMIDT, Literaterätsbegriff und Literizitäts !kriterien in der Ägyptologie, dans « LingAeg » 12 #2004$, pp. 75!87; SCHIPPER, Die Erzählung des Wenamun,§ 4.1.1 #« Schöne Literatur »? ! Zur Grundlegung der ägyptischen Literatur$.
184. A. LOPRIENO, The Sign of Literature in the Shipwrecked Sailor, dans U. VERHOEVEN ! E. GRAEFE #Hrsgg.$,Religion und Philosophie im Alten Ägypten. Festgabe für Philippe Derchain zu seinem 65. Geburtstag am 24. Juli1991, « OLA » 29, Leuven 1991, pp. 209!18; A. LOPRIENO, Loyalty to the King, to God, to one self, dans DERMANUELIAN #ed.$, Studies in Honor of William Kelly Simpson, II, pp. 534!52.
75« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
· l’intertextualité, qui est un prolongement de l’autonomie contextuelle;185
· la fiction " techniquement, le terme jargonnant « fictionnalité » seraitplus approprié " c’est!à!dire la création d’un monde autonome, acquise,elle aussi en s’affranchissement du contexte immédiat par rapportauquel on valide son expérience concrète du monde;186
· la réception, qui consacre l’autonomie du texte littéraire par rapport àses conditions et sa finalité originelles de production.
A partir des acquis fondamentaux de ces réflexions, un consensus s’est apparem !ment imposé pour dégager une définition approfondie de la littérature / belles!lettres " un « modèle » théorique si on se veut plus ambitieux " et pour l’ap !pliquer aux corpus de textes égyptiens.
Bien sûr, le débat demeure largement ouvert.
46. Soit, entre autres, la notion de « non!fonctionnalité ». Sa féconditéheuristique est incontestable; c’est à travers elle que s’est opéré un renouvel !lement salutaire dans l’Égyptologie, en libérant la réflexion de l’aporie danslaquelle l’enfermaient inéluctablement des critères purement esthétiques. Celaposé, les recherches auxquelles elle a donné l’impulsion ont conduit en sedéveloppant à son ré examen, ce qui, après tout, relève d’une saine dialectiquescientifique. Un ré examen d’autant plus significatif qu’il a été mené par celui!là même qui l’avait introduite. Désormais, J. Assmann tend à assigner à lalittérature, non pas l’absence de fonction, mais une fonction culturelle qu’ellepartage avec l’ensemble des manifestations « textuelles » #au sens large, cf. ci!dessus § 28$ à travers lesquelles la société pharaonique exprime, affirme etmaintient son identité.187
185. « Intertextuality is just another device of achieving and affirming functional independance »: ASSMANN,Cultural and literary Texts, p. 4.
186. G. MOERS, Fiktionalität und Intertextualität als Parameter ägyptologischer Literaturwissenschaft. Perspektivenund Grenzen der Anwendung zeitgenössicher Literaturtheorie, dans ASSMANN ! BLUMENTHAL #Hrsgg.$,Literatur und Politik, pp. 37!52.
187. J. ASSMANN, Kultuelle und literarische Texte, dans LOPRIENO #ed.$, Ancient Egyptian Litterature, p. 59 sq.;ASSMANN, Cultural and literary Texts, pp. 1!15.
76 EDAL II . 2010 / 2011
Fonction de fiction plutôt que fiction de fonction
47. Franchement, cette révision est la bienvenue dans ses prémisses mêmes.Car n’y a!t!il pas quelque naïveté à postuler que la littérature soit contextuallyunbound,188 comme si elle flottait, immatérielle entre terre et ciel, alors mêmeque sa seule thématisation implique un contexte, depuis le contexte de laconsommation solitaire par lecture silencieuse à celui de la consommation post!mortem, dont les dépôts de manuscrits avec oeuvres littéraires dans la tombenous suggèrent l’espérance? 189 Peut!on imaginer une activité humaine au seinde la société sans finalité? 190 Le fait même de se poser hors de toute finalités’inscrit en dernière instance dans une finalité, à savoir se distancier del’assujettissement au tout!venant des finalités. L’absence apparente de fonctionne serait!elle pas, en dernière analyse une fonction, celle de se soustraire àl’impératif trivial de fonctionnalité? De même que l’acte prétendument gratuit,accompli par un des héros dans le roman d’André Gide, Les caves du Vatican, loind’être effectivement gratuit, se trouve en réalité motivé par le désir de prouverqu’on peut faire un acte gratuit.
Aussi, plutôt que la caractéristique définitoire de n’avoir point defonction #ou pas de finalité, pas de contexte pour certains$, ne vaudrait!il mieuxpas assigner aux textes littéraires au sens fort #belles!lettres$, une fonctionspécifique,191 la fonction de fiction? Voici ce que j’entends par là, étant bienentendu qu’il s’agit d’une définition « de chantier » pour ainsi dire, et qui neprétend nullement résoudre une problématique extrêmement complexe et
188. Pour la confusion implicite entre « contexte » compris comme « univers de référence » et « contexte » entant qu’ensemble de circonstances spatiales, temporelles et sociales, cf. ci!dessous n. 195.
189. La présence de manuscrits littéraires dans la tombe a diverses causes; cf. VERNUS, Sagesses, pp. 53!54.Pour une étude du problème, cf. A. AMENTA, The egyptian Tomb as a House of Life for the Afterlife, dansR. PIRELLI #ed.$, Egyptological Essays on State and Society, « Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi. Serieegittologica » 2, Napoli 2002, pp. 13!26.
190.En ce sens, bien naïve me paraît l’assertion de LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature I, p. VI: « For themost part, ancient literatures are purposeful: they commemorate, instruct, exhort, celebrate, andlament ». Mêmes quand elles ne visent aucune de ces finalités, les « littératures » anciennes ont toutes" et non pas « for the most part », une finalité.
191. PARKINSON, Poetry and Culture, p. 35: « Literature in itself can be interpreted not as a lack of functionbut as a cultural function and context in itself ».
77« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
subtile. Si les anciens égyptiens s’étaient donné une littérature #sens restreint /fort$ écrite,192 c’est parce qu’une puissante pulsion les poussait à jouir de cequ’en procurait la fonction spécifique: la création, grâce à l’imagination, d’ununivers fictif, autonome par rapport au monde réel, et néanmoins à luiconcomitant.
Une oeuvre littéraire au sens fort serait une oeuvre · qui, d’une part, à travers une élaboration pleinement développée du
texte pour lui!même, crée un univers autonome, un Als!Ob!Welt,193 à lafois mimétique, à des degrés très variables, et différent du monde réel;
· et qui, d’autre part, parvient à faire adhérer à ce monde celui qui laconsomme en gagnant sa connivence.194
Des oeuvres où, à travers une élaboration pleinement développée du texte pourlui!même, et en promouvant la fonction de fiction comme finalité prédo !minante, grâce, surgissait un univers fictif pour celui qui les consommait. Loind’être sans contexte, la littérature s’instaurait dans un contexte spécifiqueproduit par sur le chevauchement de deux contextes de référence, celui de cetunivers fictif et celui du monde réel à travers une schizophrénie délicieusementassumée. L’oeuvre qui ouvrait l’accès à un tel univers fictif se donnait alors àjouir pour elle!même, qu’elle eût originellement ou non une autrefinalité.
Dans cette perspective, elle s’avérait « autoréférentielle » " c’est!à!direqu’elle parvenait à se suffire en elle!même, en se donnant ses propresfondements par la vertu d’une « fictionnalité » parachevée, porteuse intrinsè !quement de sa propre justification.195 Dès lors, un texte littéraire se trouvait
192. Je laisse de côté, le problème de la littérature orale.193. Pour les théories de la littérature à l’arrière!plan de cette heureuse expression, cf. MOERS, Fiktionalität
und Intertextualität, dans ASSMANN ! BLUMENTHAL #Hrsgg.$, Literatur und Politik, p. 41.194. La notion essentielle de complicité entre l’auteur et le public est judicieusement soulignée par
LOPRIENO, Loyalty to the King, to God, to one self, p. 539.195. C’est à partir de là que beaucoup, à commencer par J. Assmann, tiennent que l’oeuvre littéraire fournit
en elle!même son propre contexte. En fait, il y a ambiguité sur la notion de « contexte » qui désigneplutôt un « univers de référence spécifique ». En dernière instance, l’univers spécifique que crée lalittérature est inéluctablement enchâssé dans un contexte matériel, recouvrant différentes situations#de la récitation à l’occasion de cérémonies publiques à la lecture solitaire$.
78 EDAL II . 2010 / 2011
affranchi " dans sa réception par le public à tout le moins, ce qui ne signifie pasnécessairement à l’origine " de toute fonction autre que celle la fonction defiction.
La fiction, nourrice de plaisir et mère porteuse de réflexion critique
48. W. Helck avait heureusement défini ce que pouvait être l’intérêt de lalittérature au sens fort:
Benutzen wir aber diesen Terminus »Literatur«, so letzen wir voraus, dass in dembetreffenden Werk ein »Dichter« #Schriftsteller, Büchermacher$ sein ganz eigenesBild der Welt im weitesten Sinn ausdrückt, um Leser seiner Zeit damit zuerfreuen, unterhalten, belehren, erschüttern, moralisch zurechtzurücken oderreligiös zu beeinflussen.196
De fait, le parcours du monde imaginaire que crée l’oeuvre d’art littéraire parcelui qui la consomme présente un double intérêt: d’une part, il peut être sourcede détachement, éventuellement porteur de plaisir et de délectation #§§ 49!50$,et, d’autre part, être instrument de réflexion #§ 51$, là encore au sens étymolo !gique comme au sens standard.
La fiction nourrice de plaisir
49. L’oeuvre littéraire procurait le « détachement », la « distraction » desvicissitudes terre!à!terre et triviales du quotidien, des contraintes inhérentes àla vie et à la position sociale et, tout bonnement, des limites de l’humainecondition, grâce à la prise de distance par rapport à la réalité du moment et dulieu. C’est cette suspension paradoxale 197 d’un assujettissement pourtantinéluctable au hic et nunc, que j’ai qualifiée de « quasi schizophrénique ».
Le détachement propre au « littéraire » #sens fort$ peut tout aussi bien
196. W. HELCK, Die »Geschichte der Schiffbrüchigen« eine Stimme der Opposition?, dans OSING ! KOLDINGNIELSEN #eds$, The Heritage of Egypt, Studies in Honour of Erik Iversen, p. 73.
197. Sur l’important concept de suspension, cf. W. ISER, Prospecting: From Reader Response to Literary Anthro !pology, Baltimora ! London 1989, pp. 238!39; ASSMANN, The History of the Text before the Era of Literature,p. 89: « the literary text is qualified by the ‘willing suspension of normative order which constitutepoetic complexity ». Pour son écho dans « willing suspension of disbelief », selon Coleridge, cf.
79« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
générer un agrément, un plaisir et une délectation,198 purement contingents, entout cas orientés sur le moment présent, et la vie ici!bas, relèguant, fût!ceprovisoirement, les préoccupations de l’au!delà hors du champ de la jouissance.
En cela la littérature se nourrit d’une valorisation du divertissementérigé en privilège de l’élite #lettrée$. Cet idéal est déjà formulé dans l’Enseigne !ment de Ptahhotep:
Suis ton désir le temps de ton existence,Ne fais pas plus que ce qui est en question.N’écourte pas le temps où tu suis ton désir. Mettre fin à l’instant de sa plénitude est l’abomination du ka.Ne gaspille pas un moment du quotidienEn te consacrant plus qu’il ne faut à tenir en ordre ta maison. Surviennent les biens qu’on doit suivre le désir.Point d’intérêt aux biens, quand cela #= le désir$ est délaissé.199
Voilà donc un plaidoyer éloquent en faveur d’une gestion du temps qui fassebonne place au divertissement,200 au plaisir, à l’otium, c’est!à!dire l’abandonaux désirs de l’instant, loin des soucis domestiques.
Qui plus est, cet idéal a été formalisé et standardisé dans le répertoire dudécor des chapelles funéraires,201 et ce jusqu’au crépuscule de l’état pharao !nique.202 La reconnaissance que la langue puisse être exploitée pour divertir endistrayant est manifeste dans la captatio benvolentiæ de textes dont la fonctionpremière n’est pourtant pas « littéraire » au sens restreint / fort. Ainsi, déjà les
L.D. MORENZ, Geschichte als Literatur Reflexe der Ersten Zwischenzeit in den Mahnworten, dans ASSMANN !BLUMENTHAL #Hrsgg.$, Literatur und Politik, pp. 113!14.
198. W. GUGLIELMI, Die Ägyptischen Liebespoesie, dans LOPRIENO #ed.$, Ancient Egyptian Literature, p. 34.199. F. LEXA, Enseignements moraux ge%ne%raux des anciens Égyptiens, II, Enseignements de Ptahhotep et fragment de
l’enseignement de Kagemni, Prague 1928, pp. 186!89. 200. Analyses lumineuses de J. ASSMANN, Spruch 62 der Sargtexte und die ägyptischen Totenliturgien, dans
H. WILLEMS #ed.$, The World of the Coffin Texts. Proceedings of the Symposium Held on the Occasion ot the 100thBirthday of Adriann de Buck Leiden, December 17!19, 1992, « EU » 9, Leiden 1996, pp. 26!28.
201. W. GUGLIELMI, Reden, Rufe und Lieder auf altägyptischen Darstellungen der Landwirtschaft Viehzucht, desFisch! und Vogelfangs vom Mittleren Reich bis zur Spätzeit, « TÄB » 1, Bonn 1973; VERNUS, Comment l’élite sedonne à voir dans le programme décoratif de ses chapelles funéraires, pp. 15!16.
202.Le tombeau de Pétosiris comporte encore une mise en oeuvre du moment agréable dans le pavillon, àjouer et à boire: G. LEFEBVRE, Le tombeau de Pétosiris, I, Le Caire 1924, pp. 50!51. Cf. aussi J. ASSMANN,Mort et Au!delà dans l’Égypte ancienne, Paris 2001, pp. 228!30.
80 EDAL II . 2010 / 2011
autobiographies de la XVIIIe dynastie recourent à l’argument, pour se gagnerleur public potentiel:
md.wt nDm.t nt sDAy!Hr n sAr!n HAty m sdm=s
des paroles agréables, propres à susciter le plaisir, l’esprit ne saurait se rassasier deles entendre.203
Il arrive même qu’un particulier mette en valeur dans son autobiographie songoût pour le plaisir et la distraction, son caractère de « bon vivant » apprécié entant que tel.204
L’idéal de plaisir en vient à être brandi comme argument dans lescontroverses sur l’Au!delà que véhiculent les chants de harpiste à partir de la finde la XVIIIe dynastie.205
50. Sur un tel terreau idéologique, le plaisir et la distraction propres aulittéraire ne pouvaient manquer d’être célébrés.206 Bien sûr, c’est souvent àtravers la consommation orale #récitation, lecture publique$207 des oeuvres.Pour se distraire, Snéfrou demande à Néferty de lui dire:
nh n md.t nfr.t Ts.w stp.w DAy Hr n Hm=j n sDm st
203. Urk. IV, 122, 16; Urk. IV, 510: M. NASR, The Theban Tomb 260 of User, dans « SAK » 20 #1993$, p. 189.204. B. BACKES, Sei fröhlich und sprich darüber. Die Inschriften des Heqaïb, Sohn des Penidbi, als individuelles
Selbstzeugnis, dans « ZÄS » 135 #2008$, pp. 97!103; Backes utilise le terme bon « vivant » en français dansle texte. Pour la célébration du bon temps à l’époque gréco!romaine, cf. PH. DERCHAIN, Tragédie sur unétang, dans « GM » 176 #2000$, pp. 45!52.
205. Très significatif à cet égard le chant de harpiste de la tombe d’Antef, cf. J. ASSMANN, Fest des Augenblick! Verheissung der Dauer Die Kontroverse der ägyptische Harfnerlieder, dans ASSMANN ! FEUCHT !GRIESHAMMER #Hrsgg,$, Fragen an die altägyptieche Litératur, pp. 55!84. Un passage illustratif est évoquéci!dessous § 60.
206. A noter que récemment R. ENMARCH, A World upturned. Commentary and Analysis of the Dialogue of Ipuwerand the Lord of All, Oxford 2008, p. 25, n’exclut pas qu’un prêtre ritualiste ait pu inclure le texte desLamentations d ’Ipouour dans sa bibliothèque « purely for entertainment ».
207. J. Assmann lui!même mentionne des indications en ce sens.
81« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
quelques belles paroles, des formulations choisies, à entendre lesquelles MaMajesté puisse se distraire.208
Encore que cette oralité s’appuie sur l’écrit: dans le Conte de l’Oasien, le roi prenddes mesures visant à fournir à un virtuose de l’éloquence des motifs de déployersa rhétorique pour le plus grand agrément proprement littéraire de ceux quipourront en profiter. Mais précisément, pour ce faire, il ordonne de consignerpar écrit les discours de l’oasien.209
Connue par un manuscrit de la XVIIIe dynastie, une oeuvre est passéesymptomatiquement dans l’Égyptologie sous le nom des Plaisirs de la pêche et dela chasse. Certes, ce titre est une attribution moderne, mais le texte se veut sansambiguité une apologie du bon temps et des activités distrayantes:
hrw nfr(.w) jw=n m hA.t r SA
Le jour est bon! nous sommes sur le point de descendre vers cette prairieinondable.210
Le plaisir allégué est celui du passe!temps sportif, mais s’il est convoqué, c’estévidement comme matière première dont le traitement dans l’oeuvre suscite leplaisir littéraire. A l’Époque Ramesside,211 pour morigéner un jeune blanc!bec,le scribe Hori entend faire de la lettre qu’il lui retourne en réponse un texte dedistraction à son détriment:
j.jr=j n=k m sxr mj sDAy!Hr xpr.te m sxmx!jb 212 n Hr!nb
208.Prophétie de Néferty #P. Ermitage 1116 b ro 13!4$. Pour le pharaon cherchant à trouver de la distraction cf.G. POSENER, Littérature et politique dans l’Égypte de la XIIe dynastie, Paris 1956, p. 30!31.
209. PARKINSON, Literary Form and the Tale of the Eloquent Peasant, p. 178.210. R.A. CAMINOS, Literary Fragments in the hieratic Script, Oxford 1956, pl. I, section A 2, 1 cf. p. 5 pour le
titre.211. « The great innovation of ramesside age is the textualization of some part of oral tradition pertaining
to the function of pleasure and entertainment » #ASSMAN, Cultural and literary Texts, p. 12$.212. Écrit sxsx!jb ; cf. H.!W. FISCHER!ELFERT, Die satirische Streitschrift des Papyrus Anastasi I. Ubersetzung und
Kommentar, « ÄA » 44, Wiesbaden 1986, p. 82.
82 EDAL II . 2010 / 2011
C’est une composition 213 dans le genre distrayant #litt.: à l’instar d’une distraction$que je vais faire à ton sujet, toi qui te trouveras devenu un sujet d’amusement pourtout un chacun.214
Cela posé, s’il y a du « divertissement » dans l’agrément de ce détachement et decette distraction, il n’a rien de celui dénoncé par Blaise Pascal. Loin dedétourner de la spiritualité, il peut, au contraire s’en nourrir. Ainsi, c’est sous letitre:
kt!xy Tnj n sDA!Hr
Autres morceaux saillants propres au divertissement #litt.: passibles de divertisse !ment$.215
qu’est présentée l’évocation d’une expérience personnelle illustrant l’avantaged’abandonner les mesquines préoccupations pour remettre à une divinitéd’élection afin d’attendre la mort dans la sérénité.216
Plus ostensiblement encore, Aménemopé assigne à ses préceptes unedouble finalité: à leur vertu divertissante est appariée une vertu instructive:
ptr n=k tAy 30 n Hw.t se (m) sDA!Hr se (m) sbAy(.t)
213. sxr : « to denote a certain amount of texts that is supposed to be coherent », d’après DONKER VAN HELL! HARING, Writing in a Workmen’s Village, p. 119.
214. P. Anastasi I, 8, 7.215. O. Glasgow D. 1925.69 #Colin Campbell no 4$, ro 1 = HO, pl. 39, 1, et A.G. MCDOWELL, Hieratic Ostraca in
the Hunterian Museum, Glasgow "The Colin Campbell Ostraca#, Oxford 1993, pp. 7!8; traduction:J. ASSMANN, Ägyptische Hymnen und Gebete, Zürich ! München 1975, no 186, pp. 386!87. Pour le titre, cf.GUGLIELMI, Die Ägyptischen Liebespoesie, p. 341. Je donne à Tnj, le sens de « saillant », par référence au senspremier du verbe, « élever au!dessus, distinguer ».
216. L’association du religieux et de la distraction culmine évidemment dans Le procès entre Horus et Seth; cf.ci!dessous § 63, et, sur ce point particulier, E.F. MORRIS, Sacred and Obscene Laughter in The Contending ofHorus and Seth in Egyptian Inversions of Everyday Life and in Context of cultic Competition, dans T.SCHNEIDER! K. SZPAKOWSKA #eds$, Egyptian Stories. A british Egyptological Tribute to Alan B. Lloyd on the Occasion of hisRetirement, « AOAT » 347, Münster 2007, pp. 197!224.
83« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
Considère donc ces trente chapitres. Ils constituent un divertissement; ils consti !tuent un enseignement.217
Le parallèle est frappant entre
sDA!Hr, « divertis sement » et
sbAy(.t), « enseignement ». C’est tout simplement la prise de conscience de cettedialectique qui hissait les sagesses, à l’origine à fonction purement didactique,dans le domaine de la littérature, d’où elles était, en seconde instance, puiséescomme textes d’autant plus adaptés à l’instruction que leur appartenance auParnasse ajoutait à leur auctoritas #§ 66$.
La fiction porteuse de réflexion critique
51. À travers cette citation se donne à voir l’autre intérêt de la littératuredans l’Égypte pharaonique. Elle facilitait, au second degré, l’expression destensions que suscitaient les vicissitudes et les contraintes de la vie en lesobjectivant, en les sublimant, en les exacerbant, mais, quoi qu’il en soit, en lesréfléchissant. En ce sens, on a pu souligner qu’avaient été reçues comme« littéraires » des oeuvres qui visaient originellement à traiter de la conditionhumaine, du mal dans le monde,218 de l’ingratitude au coeur des hommes,219 ou,plus humblement, mais plus concrètement, des règles de conduite pour bienmener sa vie, pour ne rien dire des relations entre littérature et politique, surlesquelles voir ci!dessous. Le souhait que le démiurge refasse une monde trop
217. Enseignement d ’Aménemopé, chapitre 30 #27, 7!8$ = VERNUS, Sagesses, pp. 397!98. A cette dualité de viséesfait écho notre appréciation fluctuante des oeuvres égyptiennes. Par exemple, si certains voient dansl’Enseignement de Chéty une oeuvre avant tout orientée sur la place des scribes dans la société, PARKINSON,Poetry and Culture in Middle Kingdom Egypt, pp. 273!79, plaide pour une visée avant tout divertissante.
218. Cf. R.A. PARKINSON, The Dream and the Knot. Contextualizing Middle Kingdom Litterature, dans MOERS#ed.$, Definitely: Egyptian Literature, p. 76; A. ASSMANN, The History of the Text before the Era of Litterature,p. 88, parle admirablement de « Job!syndrome ».
219. C’est la thèse de l’Enseignement d ’Amménémès I.
84 EDAL II . 2010 / 2011
imparfait revient de manière lancinante, entre autres dans la Prophétie de Néferti,dans les Lamentations d ’Ipouour et dans l’Enseignement d ’Aménemopé.220
Dans ses premières manifestations, ou, en tout cas, dans celles tenuescomme fondatrices #L’enseignement de Ptahhotep$, la littérature s’en tient surtoutà la prise de conscience d’un ordre qui, loin de s’épuiser dans son immanence,doit être reconnu comme tel " ce qui est tout bonnement la découverte du« politique » #ce qui ne veut pas dire « la politique »$.221
De la reconnaissance de l’ordre on passe à sa défense; d’où unelittérature qui s’ouvre au « loyalisme ».222 Une réflexion critique sur la manièred’appliquer concrètement cet ordre bénéficie d’une mise en oeuvre extrême !ment littéraire dans le Conte de l’Oasien, grâce à l’exploitation symbiotique desvertus distrayantes de la rhétorique, et, sur un mode différent, dans Leslamentations d ’Ipouour.223 Dès lors s’institue une coupure entre l’idéologie quiirrigue les monuments religieux de l’élite, où la déviation est reconnue, maisneutralisée en même temps qu’elle est évoquée,224 et la littérature qui fonde surelle une mise en cause de l’ordre dominant en allant jusqu’à la théodicée. Au fildu temps, s’affirme en la littérature une tendance à laisser passer un messagecritique à l’encontre de cet ordre dominant. Elle peut alors devenir sinonproprement dissidente,225 à tout le moins, persiflante, comme Le voyage d ’Ouna !mon, où on a bien du mal à n’y pas discerner, sans doute à divers niveaux, unemise à l’épreuve ironique de l’idéologie nouvelle, la théocratie.226 Qui s’éton !
220.VERNUS, Sagesses, p. 426, n. 107.221. P. VERNUS, Le discours politique de l’Enseignement de Ptahhotep, dans ASSMANN ! BLUMENTHAL #Hrsgg.$,
Literatur und Politik, pp. 139!52.222. LOPRIENO, Loyalty to the King, to God, to one self, pp. 533!32; très abondants matériaux réunis récemment
par A.M. GNIRS, Zum Verhältnis von Literatur und Geschichte in der 18. Dynastie, « AH », Basel 2010 #souspresse$.
223. Bien formulé par ENMARCH, A World upturned, p. 64: « an extreme poetic exploration for the problemsinherent in the gap between ideology and the imperfection of lived experience ».
224. La stratégie prééminente, la « stratégie d’épure » inclut dans la norme la transgression châtiée de lanorme: VERNUS, Comment l’élite se donne à voir, pp. 91!92.
225. Bien vu par CH. EYRE, Is Historical Litterature ‘political’ or ‘literary’?, dans LOPRIENO #ed.$, Ancient EgyptianLiterature, p. 432; cf. aussi VERNUS, L’écriture du pouvoir dans l’Égypte pharaonique, pp. 135!37.
226. Des analyses d’une admirable finesse sont présentées par CH. EYRE, Irony in the Story of Wenamun: thePolitics of Religion in the 21st Dynasty, dans ASSMANN ! BLUMENTHAL #Hrsgg.$, Literatur und Politik, pp. 235!52. SCHIPPER, Die Erzählung des Wenamun, pp. 315!31, me paraît bien en retrait.
85« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
nerait qu’au crépuscule de la Période dynastique, la littérature en soit arrivée àporter sur l’ordre social des saillies aussi acerbes que celle!ci:
Les hauts dirigeants sont ceux qui n'auront qu'à tendre la main pour remplir leursventres alors que ceux qui travaillent la terre sont morts de faim au milieu des rues.227
Quelle distance parcourue depuis les textes classiques qui faisaient du « hautdirigeant » le modèle de référence!
Cela posé, un caveat: cette propension de la littérature à véhiculer uneréflexion sur le monde a été exploitée de manière très restrictive dansl’Égyptologie à travers le « propaganda model », lequel visait à rendre!compte decertaines oeuvres littéraires, comme des manifestes à finalité purementpolitique.228 La perfection avec laquelle G. Posener illustra ce modèle lui valutnon seulement d’être reçu avec enthousiasme, mais aussi de passer dans la doxacomme une sorte de prêt!à!porter de l’exégèse littéraire. On en vint à tenterd’expliquer toute oeuvre « littéraire » ou non par le souci de légitimer tel ou telpharaon. Procédé d’autant plus aisé à mettre en oeuvre, que notre ignorance dela conjoncture politique réelle des successions et des forces se disputant lepouvoir dans la plupart des cas laisse libre carrière aux spéculations. Puis, s’estamorcé un mouvement de réflexion critique qui a récemment abouti au constatde son obsolescence.229 On ne saurait oublier que le contenu « politique » "dans le sens le plus restreint du terme " n’entre que très marginalement dansla destinée d’une oeuvre littéraire. Seraient!ce ses allusions appuyées " cousuesde fil blanc! " à la grandeur de Louis XIV " imposées à Molière par le biencompréhensible besoin de fund!raising " qui ont promu Tartufe parmi les chefs!d’oeuvre du théâtre français?
227. Sagesse du P. Brooklyn 47.218.135, col. 6, 6!7 = VERNUS, Sagesses, p. 442.228. L’ouvrage « epoch making » de POSENER, Littérature et politique, en est l’illustration topique. Intéressante
du point de vue épistémologique, la tendance à pousser à leurs dernières extrémités les potentialitéspolitiques de la littérature qui se manifeste dans l’article de HELCK, Die »Geschichte der Schiffbrüchigen«,pp. 73!74.
229. Jalons: le recueil de communications présentées dans ASSMANN ! BLUMENTHAL #Hrsgg.$, Literatur undPolitik, 1999; QUIRKE, Egyptian Literature, pp. 47!8. Réfutation solidement argumentée: G. MOERS !A. LOPRIENO, Dating Egyptian Literary Texts: An Introduction, à l’occasion du Colloque Dating EgyptianLiterary Text #Göttingen juin 2010$.
86 EDAL II . 2010 / 2011
Ce caveat ne saurait obérer ce constat: la littérature était dans l’Égyptepharaonique, comme elle l’est ailleurs, le médium privilégié à travers lequel unesociété tolère la prise de conscience de ses principes, l’exploration de ses margeset, éventuellement, l’investigation, l’explicitation ou le dévoilement de ses fonc !tionnements, voire la mise en examen et la mise en cause de son axiologie,230
dans le rapport entre le monde qu’elle crée et le monde réel.231 Voici donc jetéun pont avec le rôle reconnu à la littérature dans notre monde moderne:
La littérature confirme un consensus, mais elle produit aussi de la dissension, dunouveau, de la rupture.232
Et quand la même réflexion fait valoir que les grands écrivains ont vu avant lesautres #c’étaient des « voyants »$, comment ne pas évoquer le célèbris sime élogedu P. Chester Beatty IV #vo 2, 5!6, et 13; vo 3, 7!8$:
Quant aux écrivains savants, depuis le temps de ceux qui vinrent à l’existence après les dieux, ceux qui annonçaient ce qui allait arriver et cela se produisait % . . .&Il est bon d’avoir celà l’esprit: c’est pour les confins de l’éternité qu’ils ont agi % . . .&Ces savants, qui annonçaient l’avenir, Ce qui est sorti de leurs bouches s’est réalisé.233
En élargissant la perspective, on plaiderait pour une prise en compte des belles!lettres égyptiennes dans les plus modernes recherches qui tendent à mettre enexergue la puissance cognitive de la littérature, et à définir la fiction commel’exploitation par l’homme de sa faculté à produire des mondes possibles.234
230. De là, la prégnance du voyage à l’étranger parmi les thèmes littéraires, en ce qu’il implique la mise enquestion des limites géographiques et culturelles; cf. MOERS, Fingierte Welten in der ägyptischen Literatur.
231. Emblématique et, au demeurant, accueilli comme tel, le travail de A. LOPRIENO, Topos und Mimesis. ZumAusländer in der ägyptischer Literatur, « ÄA » 48, Wiesbaden 1988. Sur la notion de mimesis, cf. récemmentL. POPKO, Untersuchungen zur Geschichtsschreibung der Ahmosiden! und Thutmosidenzeit, « KulturgeschichteBeiträge zur Ägyptologie » 2, Würzburg 2006, pp. 124!29.
232. COMPAGNON, Le démon de la théorie Littérature, p. 39.233. VERNUS, Sagesses, pp. 349!51.234. Parmi l’abondante production sur le sujet, M. TURNER, The Literary Mind, Oxford 1996; J. GOTTSCHALL
! D.S. WILSON, The Literary Animal: Evolution and the nature of narrative, Evanston 2005, avec la recensionde ST. PINER, Toward a Consistent Study of Literature, dans « Philosophy and Literature » 31 #2007$,pp. 162!78; A. RICHARDSON ! E. SPOLSKI #eds$, The Work of Fiction: Cognition, Culture and Complexity,Aldershot 2004.
87« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
Les deux types majeurs d ’oeuvres des belles!lettres
52. Voilà pour l’amont; voici pour l’aval. Puisque l’oeuvre littéraire au sensfort se définit par la capacité à se suffire à elle!même pour assurer la fonctionspécifique de créer un univers générateur de plaisir et de réflexion sur le monde,elle doit s’annexer des supports de manifestations appropriés à sa consom !mation. Et c’est évidemment le support manuscrit « à fin de maniement » #cf. ci!dessus § 1$, qui s’impose pour les belles!lettres par sa maniabilité et sa dispo !nibilité. On imagine mal qu’un passionné de littérature fût systématique mentcontraint, pour s’adonner à sa passion, de se jucher sur un échafaudage afin dedéchiffrer une oeuvre gravée en hiéroglyphes sur le couronnement d’un pylône.C’était déjà assez pour lui d’avoir à déchiffrer une autobiographie dans la demipénombre d’une chapelle funéraire.
Et pourtant, il y a bel et bien des textes classés comme littéraires, ausens fort de belles!lettres, pour lesquels sont connues des versions sur des objetsou des monuments, c’est!à!dire sur des supports « à fin de pérennité », ou vice!versa. Ainsi, l’Enseignement loyaliste, le Récit héroïque de Kamès, le Récit héroïque dela Bataille de Qadesh, le Chant du harpiste de la tombe d ’Antef #cf. ci!dessous$.
53. On a donc plaidé contre la thèse selon laquelle la nature du supportserait un critère:
This would mean that we may not speak of literary texts but only of literarymanuscripts. As far as texts are concerned, there would be no distinction betweenthe literary and the non!literary % . . .& This extreme position, however, does notstand for the test.235
En fait, il faut poser autrement le problème. La création de cet univers de plaisirlittéraire par l’oeuvre ne se réalisait qu’avec la connivence du public de l’Égyptepharaonique. Autrement dit, la réception participait étroitement à l’admissiond’un texte dans le royaume belles!lettres. Or, cette admission pouvait se faire dedeux manières:
235. ASSMAN, Cultural and literary Texts, pp. 1!2.
88 EDAL II . 2010 / 2011
· soit le public apportait sa caution à la finalité première d’un texte,d’emblée écrit en tant qu’oeuvre des belles!lettres;
· soit, par le pouvoir même que lui conférait son rôle de récepteur, ilchangeait le statut d’une texte en le transfigurant en oeuvre des belles!lettres, détournant ainsi sa finalité originelle.
A partir de là, on doit distinguer deux types majeurs d’oeuvres « littéraires » #ausens restreint/fort$:
· d’une part, les oeuvres littéraires par détournement, ou, si on préfère,par transfiguration #§§ 54!66$;
· d’autre part, les oeuvres littéraires par destination première #§§ 67!76$.
Oeuvres littéraires « par détournement » ou « par transfiguration »
54. Certes, nombre de ces oeuvres n’étaient pas spécifiquement littéraires,puisqu’elles remplissaient originellement des fonctions sociales qui n’avaientrien de tel, entre autres, des fonctions religieuses à travers des récits mythiques,des finalités doctrinales à travers des compositions au service de l’idéologieroyale, des finalités didactiques à travers des morceaux choisis ou descompositions édifiantes, etc. Mais il faut accepter qu’un texte échappe à sonauteur et à ses conditions premières de productions. Quelle qu’ait été sa finalitéoriginelle, un texte pouvait devenir proprement littéraire quand son public "contemporain ou postérieur " lui reconnaissait comme intérêt cardinal etprédominant de créer grâce à ses qualités, ses agréments, ou, à tout le moins,grâce à quelques propriétés particulières, un univers autonome pour le seulplaisir qu’on pouvait trouver à le parcourir grâce à l’imagination.236
D’où un premier type: les oeuvres littéraires « par détournement » ou« par transfiguration ». Ce sont des oeuvres qui, avaient été originellementcomposées pour remplir fonction particulière, laquelle n’avait rien, à propre !
236. Pour le problème de « the emergence of an autonomous literary discourse in Ancient Egypt », cf.LOPRIENO, Loyalty to the King, to God, to one self, pp. 535!36.
89« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
ment parler de « littéraire » au sens étroit. Mais au fil de leur réception, le publicen était venu à les apprécier pour elles!mêmes, par delà la fonction qu’ellesétaient censées remplir, et les avait promues dans le domaine des belles!lettres.Pourquoi cette promotion? Parce qu’il y trouvait un intérêt spécifique etindépendant de leur intérêt originel. Voici quelques exemples.
Commençons par un cas simple. Un scribe du tout début du NouvelEmpire recopia sur une tablette le début du texte gravé sur une des stèlesdressées dans le temple de Karnak par le roi Kamès.237 Lequel visait à consacrerdans le domaine divin une relation de ses hauts faits dans sa lutte contre lesHyksôs, ces asiatiques qui avaient trop longtemps tenu l’Égypte sous leur férule.C’était donc, originellement une production de l’idéologie pharaonique, dumême ordre que les relations monumentales de la bataille de Qadesh #cf. § 56$.Que notre scribe l’ait effectivement copiée sur l’original, et non sur une versionmanuscrite, est prouvé par le fait qu’il prend en compte l’indication « an 3 »,indication qui avait été gravée en surcharge sur le texte originel de la stèle,lequel ne comportait point de date chiffrée.238
Il y a plus, il a copié ce texte sur une tablette,239 où, sur l’autre côté, il
237. P. LACAU, Une stèle du roi Kamosis, dans « ASAE » 39 #1939$, pp. 245!71. Pour la deuxième stèle, L. HABACHI,The second Stela of Kamose and his Struggle against the Hyksos Ruler and his Capital, « ADAIK » 8, Glückstadt1972; W. HELCK, Historische!biographische Texte der 2. Zwischenzeit und neue Texte der 18. Dynastie, « KÄT »,Wiesbaden 1975, pp. 82!97, no 119; F. MIOSI, A Reading Book of the Second Intermediate Period Texts, Toronto1981; B. VON BOTHMER ! J. ROMANO, Musée d ’art égyptien de Louxor, « BdE » 95, Le Caire 1985, pp. 20!21,no 43, fig. 32!33; H.S. SMITH ! A. SMITH, A consideration of the Kamose Texts, dans « ZÄS » 103 #1976$, pp. 48!76; H. GOEDICKE, Studies about Kamose and Ahmose, Baltimora 1995, pp. 31!120. Pour sa place dans laproduction « militaire », cf. P. LUNDH, Actor and Event. Military Actvity in Ancient Egyptian Narrative fromThutmosis II to Merenptah, « USE » 2, Uppsala 2002, pp. 16!17, qui la considère comme représentant « aformative stage of the royal presentation of military activities ». Pour une troisième stèle, cf.L. GABOLDE, Une troisième stèle de Kamosis, dans « Kyphi » 4 #2005$, pp. 35!42; CH. VAN SICLEN, La cour duIXe pylône à Karnak, dans « BSFE » 13 #2005$, p. 35 et p. 34, fig. 9.
238. Pour cette date: D.B. REDFORD, History and chronology of the eighteenth dynasty of Egypt; seven studies,Toronto 1967, p. 40, n. 60; A. SPALINGER, Aspects of the military documents of the Ancient Egyptians, « YaleNear Eastern Researches » 9, New Haven ! London 1982, p. 37. Pour une seule date couvrant une séried’événements, cf. W. MURNANE, The Road to Qadesh. A historical Interpretation of the Battle Reliefs of KingSety I at Karnak, « SAOC » 42, Chicago 1990, pp. 77!78.
239. Tablette Carnavon I = Caire JdE 41790, provenant d’une nécropole de la fin de l’époque Hyksos et dudébut de la XVIIIe dynastie près du temple de la Vallée d’Hatshepsout à Deir el Bahri; cf. THE EARL OFCARNAVON ! H. CARTER, Five Years’ Explorations at Thebes: A record of work done 1907!1911, London 1912,pl. XXVII; PM I2, p. 618. Photographies: A.H. GARDINER, The Defeat of the Hyksos by Kamose, The CarnavonTablets No I, dans « JEA » 3 #1916$, pl. XII!XIII. Pour le début de l’Enseignement de Ptahhotep, au verso, cf.
90 EDAL II . 2010 / 2011
avait, par ailleurs, copié le début de l’Enseignement de Ptahhotep, oeuvre littérairemajeure, et référence première de la culture. En ce faisant, notre scribe adétourné le texte de Kamès de la finalité originelle, au profit d’une autrefinalité: ouvrir à qui le consomme l’accès à un univers autonome propre àsusciter intérêt et plaisir. Autrement dit, à travers cet exemple, nous saisissonssur le vif le début d’un processus qui mène à transposer dans le domaine desbelles!lettres des oeuvres qui n’en relevaient pas originellement.
Ce genre de conduite procède d’une propension à apprécier de manièrepurement individuelle les beaux textes, propension çà et là évoquée. Songeonsau magicien Nanéferkaptah qui se plaisait à lire les inscriptions des tombes,240
au fil de ses déambulations dans la nécropole memphite, dans la premièrehistoire de Setne Khaemouast. Il illustre, en quelque sorte, cette exhortation dansun appel aux vivants, à l’intention des visiteurs, et où est formulée une théoriede l’initiative individuelle dans la transmission de la tradition écrite:
spXr=tn mr.(.t)=tn jm Hr Sw.w % . . .& mr(.t)=tn jm zS=tn Hr Sw rdj z rA n snwy=f ws(j.w)Hr Sw.w gm.tw jm r zSmw Hr!sA
à vous de copier ce que vous apprécierez là!dedans sur des papyrus vierges . . . Ceque vous apprécierez là!dedans, à vous de #l’$écrire sur un papyrus vierge. C’est surdes papyrus!vierges qu’un homme met le propos de son semblable, quand il #= lepropos dans sa version originelle$ a été reduit en sciures. On y trouve de quoi servirde guide après.241
P. VERNUS, Le début de l’Enseignement de Ptahhotep: un nouveau manuscrit, dans « CRIPEL » 18 #1996$,pp. 119!40.
240.Que les inscriptions des chapelles funéraires soient proposées à la lecture des visiteurs est bien connu.Bon exemple dans l’Appel aux vivants de Khâemhat #TT 57$: « aux homme qui viendront à l’existence, àceux qui seront sur terre, grands et petits, tout scribe qui dénouent les écrits, ceux à l’esprit délié, quiauront accédé au savoir, qui se plairont à des activités utiles, qui passeront devant ce château que j’aifait devant les glorifiés, qui porteront le regard vers mes parois, qui feront lecture de mes formulations »;cf. A. VARILLE, L’appel aux visiteurs du tombeau de Khaemhet, dans « ASAE » 40 #1940$, pp. 601!06.
241. Tombe d’Ibi #TT 36$, texte 98, col. 15: K. KUHLMANN ! W. SCHENKEL, Das Grab des Ibi, Obergutsverwaltersder Gottesgemahlin des Amun: thebanisches Grab Nr. 36, « AV » 15, Mainz am Rhein 1983, pl. 23, l. 13!14;parallèles et bibliographie dans J. HEISE, Erinnern und Gedenken. Aspekte der biographischen Inschriften derägyptischen Spätzeit, Fribourg ! Göttingen 2007, pp. 116!20. Le passage, très difficile, ne me paraît pasavoir été parfaitement compris; je crois qu’il enjoint de refaire une édition nouvelle des textes anciens.Cf. encore J. ASSMANN, Schrift, Tod und Identität: das Grab als Vorschule der Literatur im alten Ägypten, dansID. et alii #Hrsgg.$, Schrift und Gedächtnis Archäologie des literarischen Kommunikation, I, München 1983,pp. 66!67 #mais cette allusion vise avant tout les textes religieux$; W. SCHENKEL, Die Gräber des PA!Tnf!jund einer Unbekannten in der thebanischen Nekropole "Nr 128 und Nr 120#, dans « MDAIK » 31 #1975$, p. 137,fig. 6, col. 9 #TT 128$: EYRE, The Semna Stelae, p. 158.
91« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
Revenons à la tablette Carnavon. Les raisons qui ont conduit son scripteur àpromouvoir ainsi le texte de Kamès se laissent deviner. D’une part, il magnifieun sentiment nationaliste, sans doute exacerbé par un siècle de dominationHyksôs. D’autre part, ce texte montre une élaboration complexe mettant enoeuvre des figures de styles, l’exploitation de différents types de situationsénonciatives, des citations de lettres, et surtout une animation propre au récit« historique » en général. Il y a donc un travail sur le texte lui!même qui va au!delà de sa seule finalité première. Autrement dit, il possèdait intrinsèquementdes potentialités littéraires " il a été, au demeurant, qualifié de « littéraire » "dans le sens large # / faible$ pointé ci!dessus " par d’excellents commenta !teurs.242 Sa réception par le public, en l’occurrence notre scribe, a réalisé ce quin’était que potentialités à l’origine.
55. La copie de la stèle de Kamès sur la tablette illustrait le début d’unprocessus de détournement vers les belles!lettres. Voici maintenant ce quiillustre le processus totalement achevé.
La bataille que Ramsès II livra aux Hittites près de Qadesh 243 suscitaplusieurs relations par le texte et l’image, fixées en hiéroglyphes sur les paroisdes temples, Louqsor #face extérieur du pylône, mur extérieur de la cour deRamsès II, mur extérieur ouest de la cour d’Amenhotep III$, Karnak #murextérieur ouest de la salle hypostyle, angle nord!ouest de la cour de la cachette,face du mur ouest entre le neuvième et le dixième pylône$, Ramesséum #aile
242. SPALINGER, Aspects of the military Documents, pp. 37!38: « The first ten lines of these stela represent amythical literary ideal ».
243. Bibliographie volontairement limitée: KRI II, pp. 1!147; A.H. GARDINER, The Kadesh Inscriptions ofRamesses II, Oxford 1960; CH. DESROCHES NOBLECOURT ! S. DONADONI ! E. EDEL, Grand temple d ’AbouSimbel. La bataille de Qadesh, « CEDAE Collection scientifique », Le Caire 1971; T. VON DER WAY, DieTextüberlieferung Rameses’II zur Qades!Schlacht, « HÄB » 20, Hildesheim 1984; G. FECHT, Das « Poeme » überdie Qades!Schlacht, dans « SAK » 11 #1984$, pp. 281!333; H. GOEDICKE #ed.$, Perspective on the Battle of Kadesh,Baltimora 1985; Qadesh!schlacht, LÄ V, 1983, coll. 31!37; S. IGNATOV, Literature and politics in the Time ofRamesses II: the Kadesh Inscriptions, dans ASSMANN ! BLUMENTHAL #Hrsgg.$, Literatur und Politik, pp. 87!88;SPALINGER, The Transformation of an Ancient Egyptian Narrative; CL. OBSOMER, Ramsès II face aux événementsde Qadech. Pourqoui deux récits différents?, dans N. GRIMAL ! M. BAUD #éds$, Evénement, récit, histoire officielle.L’écriture de l’histoire dans les monarchies antiques, « Etudes d’Égyptologie » 3, Paris 2003, pp. 87!95.
92 EDAL II . 2010 / 2011
nord du deuxième pylône, Abydos #mur nord ouest du temple$, Abou Simbel#mur nord de la grande salle$. On distingue:#1$ la Relation iconographique #Pictorial Record$. Elle est constituée, d’unepart, de représentations qui s’ordonnent en fonction d’une logique narrative,244
d’autre part, par des légendes explicatives en annexe. Ces légendes sont engénéral brèves. Toutefois, celles qui accompagnent le pharaon sont plusdéveloppées. Ce qui avait conduit à les classer de manière erronée en uneversion indépendante, appelée souvent soit le Bulletin, soit la Relation officiellealors qu’elles participent de la Relation iconographique.245
#2$ Le Récit, bien qu’en relation complémentaire avec la Relation iconogra !phique,246 constituait néanmoins un composition relativement autonome. Lemontre, d’une part, le découpage de l’espace d’écriture qui lui avait été ménagé:dans ses version monumentales, lui sont consacrées en général des paroisentières. Le montre, d’autre part, son incipit:
HAtj!a m pA nxtw n nsw bjty wsr!mAa.t!ra!stp!n!ra
commencement de la suprématie du roi du sud et du nord Ousermaât!sétepenrê.
Cet incipit « thématise » le texte; on comparera HAtj!a m pA nxtw, « commen ce !ment de la suprématie » à HAtj!a m sbAy.t, « commencement de l’enseignement »;pA nxtw est érigé en catégorie textuelle.247 De plus, l’incipit consacre le textecomme un ensemble se suffisant à lui!même, à tout le moins à un premierniveau. Originellement, il était destiné « no less than the reliefs, to be inscribedon a temple wall ».248 Secondairement, il a été copié sur des manuscrits, nous
244.Pour la prise en charge du narratif par l’iconographie, cf. G.A. GABALLA, Narrative in Egyptian Art,Mainz 1976; S. HEINZ, Die Feldzugdarstellungen des Neuen Reiches. Eine Bildanalyse, «DÖAW» 17, Wien 2001.
245. Une fois de plus, c’est la lucidité de GARDINER, The Kadesh Inscriptions, pp. 3!4, qui a permis de dissiperun flou regrettable dans la caractérisation des relations. Toutefois, cf. contra, E. BRUNNER!TRAUT,Illustrierte Bücher im alten Ägypten, dans H. BRUNNER ! R. KANNICHT ! K. SCHWAGER #Hrsgg.$, Wort undBild. Symposion des Fachbereichs Altertums! und Kulturwissenschaften zum 500 jährigen Jubiläum der Eberhard!Karls!Universität Tübingen, Tübingen 1977, p. 217, n. 23.
246.Comme le montrent les perspicaces analyses de GARDINER, The Kadesh Inscriptions, pp. 46!54.247. Pour des cas analogues, cf. S. ROSMORDUC, Quelques passages de la stèle d ’Israel, dans « RdE » 60 #2009$,
pp. 140!41.248.GARDINER, The Kadesh Inscriptions, p. 52.
93« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
y reviendrons. Les premiers égyptologues avaient qualifié ce Récit de « poème »,à la limite du contresens. A.H. Gardiner dénonça judidicieusement le terme« poème », mais lui substitua « the Literary Record », où l’adjectif « Literary »était pris évidemment dans l’acception large/faible, dont nous avons vu l’usageen Égyptologie. D’autres ont pleinement " excessivement? " développé lesimplications du qualificatif élu par A.H. Gardiner. Ainsi:
the Bulletin is not literary; but the Kadesh Poem #= le « Récit »$ is a work ofliterature, even though it is true that his audience was far different from that of,for exemple, a Late Ramesside Story.249
Il y a dans cette caractérisation une conflagration entre le statut originel duRécit héroïque et son destin ultérieur.
56. C’est la source d’une confusion possible qu’il faut conjurer par la mise aupoint suivante.
Originellement, le Récit de la bataille de Qadesh n’est pas uneoeuvre « littéraire » au sens fort / étroit du terme. Il était en relationcomplémentaire avec la Relation iconographique pour constituer un produit del’idéologie royale,250 voué à une fixation monumentale en exploitant lesressources des deux modes d’expression fondamentaux, l’image et l’écriture,selon les principes de la sémiotique égyptienne.
· D’une part, la Relation iconographique faisait fond sur l’associationsymbiotique du texte et de la représentation 251 et la synergie de leursressources respectives, investissement spatial d’une part, individuali !sation de l’autre.
· D’autre part, le Récit n’utilisait que l’écriture en tant que véhicule d’untexte développé.
La combinaison de deux types de composition autonomes, l’une jouant sur
249.SPALINGER, The Transformation of an Ancient Egyptian Narrative, p. 328.250. Pour la place de la bataille de Qadesh dans l’histoire des idées de l’Égypte pharaonique, cf. J. ASSMANN,
Ägypten. Eine Sinngeschichte, Wien 1996, p. 278 sq.251. P. VERNUS, Des relations entre textes et représentations dans l’Égypte pharaonique, dans A.M. CHRISTIN #éd.$,
Ecritures II, Paris 1985, pp. 45!66.
94 EDAL II . 2010 / 2011
l’image et ses légendes, l’autre s’organisant en un récit continu, est un des modesd’expression de ce qui était jugé digne de constituer le Savoir dans l’Égyptepharaonique. Songeons, par exemple, au Livre de la Vache du ciel, au PapyrusJumilhac, au Livre du Fayoum.
La Relation iconographique comme le Récit sont fondamentalement descompositions dont la finalité première est idéologique.252 L’une et l’autreremplissent, avec des moyens quelque peu différents, une même fonction:contribuer à un recomposition de l’histoire, c’est!à!dire d’une partie de ce quele démiurge a laissé à l’état de latence, en « jachères », pour ainsi dire en enconfiant le développement aux pharaons ses successeurs. Elles étaient là pourfournir d’un événement historique majeur une interprétation qui le rendîtintelligible dans la vision du monde propre à l’Égypte et qui se trouvât légitiméeet accréditée par l’apparat où elle se donnait à voir en tant que compte!rendupertinent. Ladite interprétation était pérennisée par sa fixation sur la pierre ou,éventuellement, sur tout autre matériau perçu comme durable, par l’entremised’objets ou de monuments sacralisés, en principe voués à l’éternité. Ainsisacralisée, elle devenait ainsi une accrétion au monde existant, un prolon !gement de l’oeuvre démiurgique, la réalisation concrète d’une partie de ce quele dieu créateur a laissé à l’état virtuel, en en confiant aux humains ledéveloppement et le parachèvement.253
Au demeurant, leurs supports monumentaux ne prédisposaient pas laRelation iconographique et le Récit à la lecture du public, même si, par leur masse,ils étaient susceptibles de donner aux pharaons qui les avaient édifiés une gloireposthume propre à en faire des héros littéraires.254 En effet, ils étaientpratiquement « illisibles » dans leur continuité. Pour ne rien dire de l’écriture
252. EYRE, Is historical literature ‘political’ or ‘literary’?, p. 427.253. P. VERNUS, Essai sur la conscience de l’Histoire dans l’Égypte pharaonique, « Bibliothèque de l’ÉPHE Sciences
historiques et philologiques » 132, Paris 1995, pp. 163!68; cf. aussi ma communication Les jachères dudémiurge et la souveraineté du pharaon. Concept d ’empire et latences de la création #Université de Buenos Aires,Septembre 2009$.
254. K.RYHOLT, Egyptian Historical Literature from the Greco!Roman Period, dans M.FITZENREITER #Hrsg.$, DasEreignis Geschichtsschreibung zwischen Vorfall und Befund, « IBAES » 10, London 2009, pp. 232, 237 et 238.
95« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
hiéroglyphique pour ces versions utilisée, et qui était seulement accessible à untrès petit nombre, leurs localisation même à l’intérieur des temple était unobstacle à leur pleine appréciation. En effet, ils étaient placés dans des situationqui les tenaient matériellement hors du portée du lecteur de bonne volonté,sauf à dresser un réseau complexe d’échafaudages et à les parcourirhorizontalement et verticalement selon leur disposition;255 de quoi sélection !ner sévèrement les amateurs de littérature! 256
En fait, ces versions monumentales étaient vouées à un fonctionnement« performatif », c’est!à!dire à faire advenir et à saisir l’essence de qu’ils relataientà travers la matérialité même du dispositif mis en oeuvre pour cette relation.257
Cela posé, par certaines de leurs caractéristiques le Récit, et même laRelation iconographique présentent des virtualités qu’on est en droit, de qualifierde « literary », à condition de bien avoir concience que c’est au sens large / faible.
57. Secondairement, au fil de la réception, ces virtualités littéraires ontété développées. En effet, l’élite dirigeante se trouva en position d’apprécier le« Récit » de la bataille de Qadesh. A la différence du cas du récit de Kamès, cen’est vraisemblablement pas les versions monumentales qui furent détermi !nantes dans cette appréciation, à tout le moins au premier chef. On songeplutôt à des récitations publiques à l’occasion de fêtes solennelles, voire à deséditions manuscrites à l’intention des dignitaires et courtisans et de tous ceux àqui Ramsès II entendait signifier sa faveur. Faute d’attestations positives de cegenre de publicité, on peut, à tout le moins, évoquer l’émission de scarabées
255. Autant dire que dans leur fixation originelle, elles ne remplissaient pas l’un des critères de l’oeuvrelittéraire selon LOPRIENO, Defining egyptian Literature: ancient texts and modern theories, dans ID. #ed.$,Ancient Egyptian Literature, pp. 51!52: « the text must be made public % . . .& accessible beyond the timeand space of its composition ».
256. Comparer avec ce que dit EYRE, The Semna Stelae, p. 138, à propos des stèles de Sésostris III à Semna:« there is no need to assume that the Semna stela was inscribed to be read by any ordinary literateperson. There is an element of adress to posterity ».
257. Sur cette notion à deux degrés, P. VERNUS, Ritual sDm.n.f and some Values of the ‘Accompli ’ in the Bible andthe Koran, dans S.I. GROLL, Pharaonic Egypt. The Bible and Christianity, Jerusalem 1985, pp. 307!16;P. VERNUS, La naissance de l’écriture dans l’Égypte ancienne, dans « Archéo!Nil » 3 #1993$, p. 90.
96 EDAL II . 2010 / 2011
relatant à l’intention de l’élite ce que le pharaon considérait comme les élémentssaillants de son règne, pratique particulièrement développée par AmenhotepIII, mais connue aussi d’Hatshepsout à l’époque saïte.258
On ne négligera pas pour autant, une diffusion à travers les pratiqueséducatives. En ce sens, un point de comparaison: une célébration d’une desvictoires de Ramsès II, connue par une stèle de Deir el!Médina, bien sûr enhiéroglyphes, est attestée aussi sur un ostracon qui a toute chance de relever despratiques « scolaires ».259
Quelles qu’aient été les voies de diffusion du « Récit » de la bataille deQadesh, il provoquait chez ceux qui le recevaient un plaisir spécifique, par delàsa finalité originelle. Ils finirent par l’accueillir dans le royaume des belles!lettres. Ainsi fut!il détourné ou transfiguré, et parallèlement à son statut deproduit de l’idéologie, il assuma celui d’oeuvre littéraire #« literary »$ au sensfort / restreint. C’est que semble bien indiquer, à tout le moins, sa transmission.
En effet, on connaît des éditions en hiératique, attestées sur des papyrusen possession de particuliers:
· le P. Raifé #Louvre E 4889$, deuxième page d’un rouleau,260 à compléterpar le P. Sallier III #BM 10181$:261 le colophon indique qu’il fut copié par un scribedu trésor Pentaourt, à qui on doit aussi le P. Sallier I, rouleau fait de bric et debroc, et comportant des miscellanées sous le titre « enseignement de lettres »,262
deux textes des belles!lettres, La querelle d ’Apopis et de Seqenerê et l’Enseignementd’Amménémès I.263 On a postulé une origine memphite, mais ce n’est pas assuré.
258. J. BAINES, On the Genre and Purpose of the ‘Late Commemorative Scarabs’ of Amenhotep III, dans N. GRIMAL !A. KAMEL ! C. MAY!SHEIKHOLESLAMI #éds$, Hommages à Fayza Haikal, « BdE » 138, Le Caire 2003, pp. 29!43; VERNUS, L’écriture du pouvoir dans l'Égypte pharaonique, pp. 132!33.
259. Stèle: KRI V, 90. Ostracon: CGC 25201. Cf. J. YOYOTTE, Trois notes pour servir à l’histoire d ’Edfou, dans« Kêmi » 12 #1952$, p. 93. Cf. aussi O. Glasgow D.1925.86 = MCDOWELL, Hieratic Ostraca in the HunterianMuseum, pl. 29; il s’agit d’une copie probablement « scolaire » d’un texte « historique », avec formulairede la Königsnovelle, texte qu’on imagine aisément avoir fait l’objet d’une version « sacralisée » sur stèleen hiéroglyphes.
260.Photographie dans CH. DESROCHES NOBLECOURT, Ramsès II, Paris 2007, p. 64.261. HPBM. Second Series, pp. 32!34, pl. LXXVII!LXXXVII; cf. LEM, p. XVII.262. Pour sbAy.t Sat, cf. VERNUS, Sagesses, p. 15.263. SPALINGER, The Transformation of an Ancient Egyptian Narrative, pp. 106!33.
97« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
Il s’agirait d’une version « intended for personal use », et qui « was distributedamong a small group of his colleagues and superiors ».264
· Deux fois la même copie du début du « Récit » dans le P. Chester BeattyIII,265 dont le copiste est certainement, durant le règne de Merneptah, lecélèbre scribe Qenherkhepeshef,266 d’après son écriture, si caractéristiquequ’elle est immédiatement identifiable pour un expert comme J. 'ern(. On aémis l’hypothèse qu’il s’agirait d’exercice de « virtuosité tachygrahique ».267 Aurecto, une « clef des songes » d’un copiste inconnu 268 sous le règne de RamsèsII; au verso après les deux extraits du Récit, une lettre au vizir Panehesy écriteaussi par Qenherkhepeshef.
On a beaucoup spéculé sur les motivations exactes de ces copies.269 Ilest sûr, en tout cas, qu’elles n’ont pas été effectuées directement sur les versionsmonumentales en hiéroglyphes.270 L’orientation littéraire de le première#P. Sallier$ est flagrante, et l’une et l’autre témoignent de l’usage à fin personnelle271
264.Ibidem, p. X; cf. aussi p. 129: « I believe it correct to view many of these copies as the Poem as beingrelated to private use ».
265. Cf. HTBM. Third Series, pp. 23!24, pl. 9!10; photographie dans M. BIERBRIER, Les bâtisseurs de pharaon. Laconfrérie de Deir el!Medineh, Paris 1986, fig. 20 face à la p. 55.
266.P. VERNUS, Le scribe Qenherkhepeshef, dans G. ANDREU #éd.$, Les artistes de Pharaon. Deir el!Médineh et laVallée des Rois, Paris 2002, pp. 58!69.
267. B. VAN DE WALLE, La transmission des textes littéraires égyptiens, Bruxelles 1948, p. 25. On observera que lefait de copier deux fois le même texte suggère évidemment un exercice. A comparer, mutatis mutandis,le même début de titulature copiée trois fois sur un ostracon: O. Turin CGT 57101 = A.M. DONADONIROVERI, La scuola nell’antico Egitto "Museo Egizio di Torino#, Torino 1997, p. 77. Cf. aussi le cas du cuir BM10379; au verso, figure un extrait de l’onomasticon dont le début avait été copié au recto; plusieurslignes de ce recto sont répétées, mais en investissant différement les pages #AEO I, p. 31$. Cf. encore lessignes et les phrases entières d’un hymne répétées à côté du texte principal: S. GÜLDEN, Die hieratischenTexte des P. Berlin 3049, « KÄT » 13, Wiesbaden 2001, p. XV. Dans la même bibliothèque, deux copies duPaysan Éloquent pourrait s’expliquer par le « physical ease of reading the poem » #PARKINSON, Readingancient Egyptian Poetry, p. 88$. Cela posé, des nécessités administratives peuvent aussi expliquer desduplicata. Songeons au rapport d’Ipy copié en deux exemplaires sur deux papyrus de Gourob. Cf., endernier lieu, D. LABOURY, Akhénaton « Les grands pharaons », Paris 2010, p. 140.
268. Sous les règnes de Ramsès III et Ramsès IV, Amennakht s’est approprié le manuscrit par un colophon.269.Pour SPALINGER, The Transformation of an Ancient Egyptian Narrative, p. 330, le choix des textes copiés par
Pentaourt marquerait sa prédilection pour les textes mettant en jeu le pharaon. On pourrait aussidiscerner, après tout, la même prédilection chez Qenherkhepeshef, qui a consacré une table d’offrandesavec une liste de pharaons ayant oeuvré à Thèbes. Mais tout cela demeure, en fait, bien impalpable.
270.Fort bien souligné par SPALINGER, The Transformation of an Ancient Egyptian Narrative. Pour un casfrappant de modification linguistique dans les versions sur papyrus, cf. J. WINAND, Études de néo!égyptien, I, La morphologie verbale, « Aegyptiaca Leodensia » 2, Liège 1992, § 301.
271. Ce qui n’exclut pas, bien entendu, une utilisation impliquant un public #fêtes privées, cérémoniesofficielles, etc.$.
98 EDAL II . 2010 / 2011
d’un texte, originellement voué à un public idéalement étendu à l’ensemble del’humanité " de l’humanité du moment et l’humanité de sa postérité.
D’une manière générale, la nature et le contexte des manuscrits qui lesconservent paraissent bien suggérer que le « Récit » de la bataille de Qadeshavait été reçu parmi les belles!lettres à partir de son statut originel de texte del’idéologie royale. Entre version monumentale et version sur manuscrit privé,on observe çà et là un travail d’amplification qui va en ce sens. En voici unexemple.
Dans la version monumentale est mise en oeuvre cette comparaison:
jry=f n=j xAs.t nb.t m dHA r!HAt=j
Il a réduit pour moi chaque pays étranger à de la paille devant moi.
Or dans la version sur manuscrit, elle a été ainsi reformulée:
jry=f n=j xAs.t nb.t m dHA r!HAt ssmt
Il a ramené pour moi chaque pays étranger à de la paille devant des chevaux. 272
Autrement dit, la transmission a modifié la manière dont fonctionne la pailledans le mécanisme symbolique. Dans la version originale, elle symbolisait de cequi est négligeable au regard du pharaon.273 Dans la version littéraire #au sensfort$, elle prend sens en tant que fourrage attirant irésistiblement les chevaux.En conséquence enrichissement de la métaphore: les pays étrangers ne sont passeulement comparés à un matériau insignifant par sa légéreté et sa fragilité,mais aussi à du fourrage attirant vers eux les chevaux des chars égyptiens pourles dévorer.
272. KRI II, 72, 15, P. Sallier. La variation est jugée « interesting » par SPALINGER, The Transformation of anAncient Egyptian Narrative, p. 57.
273. La paille est convoquée à plusieurs titres dans les métaphores #VERNUS, Sagesses, p. 433, n. 58$. Dans lecas de la version originale du Récit, elle représente ce qui est si fragile que le vent suffit à l’éparpiller;comparer mj dHA r!HA.t TAw, « comme la paille devant le vent » #O. Glasgow D. 1925.85 = O. Colin Campbell 19vo 2. MCDOWELL, Hieratic Ostraca in the Hunterian Museum, pl. 28$.
99« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
58. Quelles sont le potentialités « littéraires » #sens faible$ intrinsèques quiont stimulé le passage dans le domaine « littéraire » #sens fort$ de belles!lettres?En premier lieu la tendance évidente de son rédacteur à orienter l’intérêt dutexte sur lui!même par delà le message qu’il véhicule. Elle se manifeste dediverses manières.a$ Par son élaboration formelle; la langue utilisée se distingue du
vernaculaire ou de la langue de la pratique, et recourt à des formesgrammaticales narratives issues de la tradition classique antérieure àl’Époque Ramesside.
b$ Par son intrigue; c’est la narration d’une campagne guerrière avec forcepéripéties et rebondissements.
c$ Par la dramatisation du récit:! dramatisation, d’abord, à travers les enjeux, les deux plus grandes puis !
sances proche!orientales du moment s’affrontent en un choc violent;! dramatisation à travers la mise en scènes de plusieurs personnages, entre
autres Mena, le porte!bouclier avec lequel le pharaon instaure undialogue qui vient souligner un rebondissement de l’action. La relationiconographique fait intervenir successivement le vizir, l’échanson, lemessager, auxquels sont prêtés des propos accentuant la dramatisationdu récit;274
! dramatisation, surtout à travers son héros, Ramsès II, qui montre tout àla fois des faiblesses bien humaines, puisqu’il est berné par lamachination du roi hittite, et se retrouve dans une situation quasidésespérée, mais aussi des vertus héroïques qui tiennent à son lienparticulier avec le dieu Amon. Loin de se manifester seulement à traversles stéréotypes de sa fonction, voici qu’il se présente comme un simpleindividu face à la divinité. Il n’est plus seulement l’agent immédiat del’histoire sur terre, mandaté par un dieu qui se contente d’assurer aureprésentant qu’il a élu les principes généraux nécessaires à l’accompli !
274. KRI II, 133, 5!16.
100 EDAL II . 2010 / 2011
sement de sa tâche. Désormais, il est devenu un individu, certes de rangprépondérant, mais qui, malgré tout, partage le statut de millionsd’autres ceux que manipulent directement le créateur dans sa gestion dela société humaine. Cette dramatisation éveille d’autant plus depotentialités littéraires qu’elle touche le pharaon, une figure propre àl’investissement « fictionnel » par son statut d’interface entre le mondetrivial des humains et le monde imaginaire des divinités.275
d$ L’inspiration quasi épique déployée dans cette dramatisation pour con !férer au pharaon l’envergure d’un héros apportait au texte un intérêtoutrepassant sa fonction première. Le refaçonnage de la réalité, inhé rentau travail d’interprétation de l’idéologie, est ici ostensiblement marquépar les circonstances particulières, et entraîne un important apparat« fictionnel », intrinsèquement porteur de développement littéraire.276
59. Le cas du « Récit » de la bataille de Qadesh est emblématique desconfusions suscitées par les ambiguités de terme « literary » et « literature ».Ainsi un admirable connaisseur de l’oeuvre a!t!il été amené à écrire dans uneétude très riche et très féconde:
· the reader can justifiably deem the Poem is literature and as such consider itindependently from the temple walls themselves;
· it is nxtw literature, not belles!lettres, sxm!ib, or even a « story » per se.277
Dissipons une fois pour toutes, brumes et nuées. Originellement, le Récit de la bataille de Qadesh n’a pas le statut
d’oeuvre de la littérature au sens fort / étroit de belles!lettres. S’il peut êtrequalifié de « literary », c’est au sens large / faible, parce qu’il manifeste une trèsforte élaboration du texte pour lui!même #§ 10$.
275. Sur ce point A. LOPRIENO, The King’s novel, dans ID. #ed.$, Ancient Egyptian Literature, p. 286.276. Pour le façonnage des événements: MOERS, Unter den Sohlen Pharaos Fremdheit und Alterität im pharao !
nischen Ägypten, p. 119.277. SPALINGER, The Transformation of an Ancient Egyptian Narrative, pp. 357!58. Les caractères gras sont de
mon fait.
101« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
En revanche, cette élaboration a facilité sa transfiguration en oeuvre desbelles!lettres, donc « literary » au sens fort / étroit sous la baguette magique dela réception. C’est le public lettré qui l’a jugé digne d’un si gratifiantdétournement.
Il vaudrait mieux désormais parler simplement de « récit » de la bataillede Qadesh, plutôt que de « récit littéraire », ou, à tout le moins, limiter cettedernière appelation aux versions manuscrites, qui, peut!on présumer,impliquent un détournement du texte vers le royaume des belles!lettres.
60. Voici un exemple de nature différente illustrant le dédoublement dansle statut d’un texte, la réception lui ménageant une destinée littéraire #sensrestreint / fort$, parallèlement à sa destinée originelle.
Le chant du harpiste appartient au répertoire dans lequel on puisait pourdécorer les chapelles funéraires. Il vise à célèbrer la destinée funéraire du défuntet à perpétuer, en les vantant, l’efficacité des nombreux rites dont il a bénéficié.Il vient étoffer le dispositif complexe et touffu des procédés favorisant la surviedu défunt. Il y remplit alors une fonction funéraire. Parmi les très nombreusesattestations considérons cette représentation tirée de la tombe dePaitenemheb, un notable ayant vécu sous Horemheb.278 S’appuyant sur un petitorchestre, un harpiste psalmodie en s’accompagnant de son instrument unchant dont le texte est écrit en hiéroglyphes au!dessus de lui. Une partiemanque, mais pas assez toutefois pour empêcher l’identification.
278. PM III2, pp. 709!11; Leiden K 6 = P.A.A. BOESER, Beschreibung der Ägyptischen Sammlung des Niederländi !schen Reichsmuseums der Altertümer in Leiden. Die Denkmäler des Neuen Reiches, I, Gräber, Den Hag 1911,pp. 1!4, pl. I!XII, harpiste: pl. VI et VII; D. WILDUNG, Imhotep und Amenhotep: Gottwerdung im altenÄgypten, « MÄS » 36, München ! Berlin 1977, p. 23, pl. II; R. TEFNIN, À propos d ’un vieux harpiste du Muséede Leyde et du réalisme dans l’art égyptien, dans « Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. UniversitéLibre de Bruxelles » 10 #1988$, pp. 7!26; K. SABRI KOLTA ! D. SCHWARZMANN!SCHAHAUSER, Die Heil !kunde im Alten Ägypten. Magie und Ratio in der Krankheitsvorstel lung und therapeutischen Praxis, « StudhoffsArchiv Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte » 42, Stuttgart 2000, fig. 52. Pour la date B. GESSLER!LÖHR, Bemerkungen zu einigen wbAw njswt der nach!Amarnazeit, dans « GM » 112 #1989$, pp. 29!30.
103« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
J’ai %pris connaissance& des paroles d’Iymhotep %et de Hordjedef.Si on peut formuler, c’est en utilisant #litt. : avec$ leurs formulations& mêmes.279
Considérez leurs emplacements funéraires. %Leurs murs se sont délités.Ils %n’ont plus d’emplacements funéraires& à l’instar de ceux qui ne sont jamaisvenus à l’existence. Il n’est personne %qui n’en #= le monde des morts$ soit revenupour rapporter leur condition, pour apaiser& nos %esprits& avant que nous allions àl’endroit %où ils& sont partis. %Puisses!tu avoir l’âme assez sereine pour te sentir indifférent #litt. : que ton espritsoit indifférent$ aux glorifications à ton bénéfice.Suis ton désir& durant ton existence. Mets de la myrrhe sur ta tête. %Vêts!toi de linge!fin. Oins!toi des véritables merveilles du bien!divin. Ajoute& à ton bien!être. Ne %te décou&rage pas.Suis ton désir et ton bien!être.Fais ce qui t’importe sur& terre. Ne brime pas ton désir jusqu'à ce que vienne à toi%ce& jour%!là de lamentation&.
Voici un chant connu par ailleurs. Certains passage sont repris dans le décor dechapelles funéraires, autrement dit dans un même environnement général, soitdans d’autres chants de harpistes,280 soit dans une proclamation mise dans labouche du propriétaire et son épouse.281 Rien que de banal. La représentationdu harpiste avec la notation de son chant participe du riche et complexe apparatintégré au décor de la chapelle, et qui vise à favoriser la survie du propriétaire.282
61. Cela posé, le même chant, que nous venons de voir assujetti à unefonction précise dans cette tombe, nous le retrouvons dans un contexte tout àfait différent, parmi les textes copiés sur un papyrus.283 Or, ce contexte montreindiscutablement qu’il n’y remplit pas sa fonction funéraire originelle.
279. Ce vers trouve sens au prix d’une saine interprétation de la grammaire sous jacente:! sDd.tw fonctionne comme temps second, avec valeur modale;! l’élément rhématisé est le syntagme prépositionnel m sDd.t=sn, renforcé par la particule rsy.On peut aussi, bien sûr, considérer sDd.tw comme un participe passif, épithète de md.wt.
280.Le chant de harpiste de la tombe d’Inhertkhâou à Deir el!Médina #N. CHERPION ! J.!P. CORTEGGIANI,La tombe d ’Inherkhâouy "TT 359# à Deir el!Médina, « MIFAO » 128, I!II, Le Caire 2010, pl. 107$, comportebien quelques expressions communes, mais n’est pas vraiment un parallèle. Il en va de même pourd’autres chants de harpiste #TT 158, TT 106, TT 364$.
281. Tombe no 355 de Deir el Médina, plusieurs rameaux d’une même famille = B. BRUYÈRE, Fouilles de Deirel Médineh "1927#, « FIFAO » 5, Le Caire 1928, p. 117, fig. 79; PM I, p. 419; WILDUNG, Imhotep undAmenhotep, p. 22; Ramsès IV.
282. Sur ce chant dans les croyances funéraires, cf. ASSMANN, Mort et Au!delà, pp. 225!26.283. P. Harris 500, col. VI, 2 et VII, 3 = P. BM 10060: HPBM, Second Series, pl. 44/45. Pour la fin et le début,
105« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
En effet, dans le papyrus, il figure après deux chants d’amour, et avantun troisième, sans rupture dans la mise en page, ni même dans la succession deslignes. Son statut d’oeuvre indépendante était indiqué par les signes « pauses »qui le précédaient et le suivaient.
Son statut d’oeuvre indépendante était aussi indiqué par son titre:
Hsw nty m Hw.t!jntf mAa xrw nty m bAH (pA Hsy m bjn.t)
Le chant qui est dans la demeure d’Antef, juste de voix, qui est devant #le chanteurà la harpe$.
Des pharaons Antef, il y en eut de glorieux à la XIe dynastie et d’autres, un peumoins heureux, à la XVIIe dynastie. Les uns et les autres ont en commun d’êtred’origine thébaine et d’avoir oeuvré, avec des succès divers, à la réunification del’Égypte, dans le premier cas contre un royaume nordiste, dans le second contreles occupants Hyksôs. Un faisceau d’indications dénonce le caractère fictif decette attribution qui, comme souvent, vise à conférer une caution prestigieuseau texte. Dans la mesure où la XVIIIe dynastie a érigé en modèle prègnant laThèbes du début du Moyen Empire, on serait enclin à postuler que la figure dupharaon Antef, convoquée dans le titre du chant du harpiste se nourrissaitplutôt des Antef de la XIe dynastie.284
En tout cas, cette fiction et le mode d’édition trahissent ainsi saréception parmi les « belles!lettres », à la suite de son détournement. Son étroiteimbrication dans des copies de chants d’amour suggère qu’il était consommé en
respectivement, des chants d’amour qui l’encadrent B. MATHIEU, La poésie amoureuse de l’Égypte ancienne.Recherches sur un genre littéraire au Nouvel Empire, « BdE » 115, Le Caire 1996, pl. 13. Pour les titres Hsw etHsw m bjn.t, cf. ST. QUIRKE, Titles and Bureaux, « GHP Egyptology » 1, London 2004, pp. 40!42.
284.Sur le problème cf. A. STAUDER, L’émulation du passé à l’ère thoutmoside. La dimension linguistique #souspresse$.
106 EDAL II . 2010 / 2011
tant qu’oeuvre lyrique, évenutellement à l’occasion de fêtes privées,285 sanspréjudices d’autres occasions. En tout cas, l’orientation du manuscrit vers lalittérature est manifeste: au verso, ont été copiées deux oeuvres narratives, Laprise de Joppé et Le Prince Prédestiné.286
62. Le processus de détournement de textes hors leur fonction originellevers les belles!lettres opère bien entendu avec les mythes. Déjà au MoyenEmpire, le mythe de la déesse du désert libyen est mis en oeuvre, d’une partdans l’arsenal au service du défunt dans les Textes des sarcophages, et donc, enfonction de prophylaxie funéraire, prolongement de sa fonction originelle demythe.287 D’autre part, ce mythe est informé dans une narration visant trèsprobablement le plaisir littéraire; elle est passée dans l’Égyptologie sous ladénomination Le pâtre et la déesse #Hirtengeschichte$.288 Au Nouvel Empire,289
quand se font plus abondamment documentées les narration mythiquessuivies,290 ce genre de détournement est bien illlustré.
63. Un exemple frappant est fourni par le mythe du combat entre Horus etSeth transformés en hippopotames.
De ce mythe, nous possédons une version à vocation étiologique, donc
285. OSING, School and Literature in the Ramesside Period, p. 140.286. LES, p. IX et XII.287. VERNUS, La notion de mythe dans la civilisation pharaonique, pp. 16!19.288. Le débat sur le statut précis de la feuille de papyrus du conte du Pâtre et de la déesse #Hirtengeschichte$
réutilisé dans le P. Berlin 3024 n’est pas clos. Mais qu’elle provienne originellement d’un manuscrit« littéraire » semble très probable. Cf. en dernier lieu T. SCHNEIDER, Contextualising the Tale of theHerdsman, dans ID. ! SZPAKOWSKA #eds$, Egyptian Stories, pp. 309!18, qui propose un très astucieuxrapprochement avec le mythe préislamique de l’ogresse venue de l’ouest.
289. A. LOPRIENO, Defining Egyptian Literature: ancient texts and modern theories, dans ID. #ed.$, Ancient EgyptianLiterature, p. 50; BAINES, Prehistories of Literature Performance, Fiction, Myth, pp. 32!37.
290. SPALINGER, The Destruction of Mankind, pp. 257!79. Au Moyen Empire, outre de brèves mentions, il y adéjà des narrations mythiques relativement développées illustrant différentes fonctions du mythe; lasérie de mythes récupérés dans les textes des sarcophages #CT II, formule 154!158$, prédécesseurs desfameux Sprüche für das Kennen der Seelen der heilige Ort. Le statut du récit des rapports sexuels entre Horuset Seth dans les archives d’El!Lahoun, n’est pas clairement défini. Il pourait s’agir d’une « historiola »,visant à donner un précédent mythologique pour cautionner une formule magique; cf. en dernier lieuF. RÖPKE, Überlegungen zum « Sitz im Leben » der Kahuner Homosexuellen Episode zwischen Horus und Seh"pKahun VI, 12 = pUniversity College London 32158, ro#, dans H. ROEDER #Hrsg.$, Die Erzählen in frühenHochkulturen I. Der Fall Ägypten, « Ägyptologie und Kulturwissenschaft » 1, München 2009, pp. 239!90.
107« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
dans le prolongement de sa fonction originelle, dans un calendrier desjours fastes et néfastes. Dans l’Égypte pharaonique, chaque jour de l’année n’estpas a priori neutre, mais possède un caractère faste ou néfaste en fonction desévénements dont il est l’anniversaire. Précisément, ce calendrier 291 justifie lepronostic funeste pour le 26ème jour du premier mois de la saison!de!l’inondation en relatant l’affrontement d’Horus et de Seth, transformés tousdeux en hippopotames, et tour à tour harponnés par Isis. Dans ce calendrier, sile récit mythique est évoqué, c’est clairement parce qu’il joue un rôle précisdans l’organisation d’ensemble; il vient expliquer le caractère néfaste du jour parl’évocation d’un événement déterminant qui s’était passé, le même jour, maisaux temps des dieux.
Du même épisode mythologique, nous possédons une autre versionfonctionnant comme épisode d’une long récit, le Jugement entre Horus et Seth,classé comme conte par les égyptologues 292 #pour le titre inspiré de la pratiquejudiciaire, cf. § 73$. De fait, l’oeuvre avait été reçue assurément en tant quebelles!lettres à en juger par le manuscrit où elle a été copiée,293 le PapyrusChester!Beatty I, qui figurait dans une bibliothèque de Deir el!Médina précé !demment évoquée. Les seize premières pages du recto sont occupées par elle.Suit un ensemble de poèmes d’amour, intitulés Début des doux couplets trouvés dansun étui à manuscrits. Au verso, un hymne à Thot le Chien, un long panégyriquede Ramsès V, puis deux autres poèmes d’amour.
291. CH. LEITZ, Tägewählerei. Das Buch HAt nHH pH.wy Dt und verwandte Texte, «ÄA» 55, Wiesbaden 1994, pp. 54!57.292. Par souci de concision je ne mentionnerai que la plus récente étude d’ensemble sur l’oeuvre: M.
CAMPAGNO, Una lectura de La contiendia enre Horus y Seth, « Coleccion Razon Politica », Buenos Aires 2004. 293. La thèse d’une lecture de l’oeuvre à l’occasion d’une cérémonie en relation avec l’investiture du pharaon
a été excellement présentée par U. VERHOEVEN, Ein historischer Sitz im Leben für die Erzählung von Horusund Seth des papyrus Chester Beatty I, dans M. SCHADE!BUSCH #Hrsg.$, Wege öffnen Fs. R. Gundlach,Wiesbaden 1996, pp. 347!63; cf. M. CAMPAGNO, Horus Seth y la Realeza Cuestiones de politica y religion en elAntiguo Egipto, dans ID. ! J. GALLEGO ! C. GARCIA MAC GAW, Politica y religion en el Mediterraneo antiguaEgipto, Grecia, Roma, « PEFSCE » 6, Buenos Aires 2008, pp. 45!48; MOERS, Fingierte Welten in der ägyp !tischen Literatur, pp. 150!51, et contre la thèse, BAINES, Prehistories of Literature: Perfor mance, Fiction,Myth, pp. 38!39. La thèse de U. Verhoeven est extrêmement astucieuse et brillamment défendue. Celaposé, j’ai bien du mal à imaginer que la version du P. Chester Beatty n’ait pas été utilisée, avant tout, pourle delectare proprement littéraire, même si le plaisir qu’elle dispensait pouvait être amplifiée par sesrésonances « politiques ».
108 EDAL II . 2010 / 2011
64. La comparaison entre la version du calendrier et celle du conte illustrele travail effectué sur le matériau mythologique dans une perspectiveproprement littéraire. Si leurs récits respectifs montrent non seulement unparallèlisme étroit dans la succession des actions et des propos, mais aussi desformulations apparentées, parfois même identiques #« Préfères!tu #/ préfère!t!on$ l’étranger à un frère!de!mère? »$, quelques variations apparaissent aussi dansles formes verbales 294 et dans le vocabulaire.295 Ces variations révèlent parfoisplus de travail stylistique dans le conte. Par exemple, dire que la pointemétallique « pique » #dp, litt.: goûte$ le dieu transformé en hippopotameprocède évidemment d’une rédaction plus recherchée que de dire simplementqu’elle « tombe » #xr $ sur lui.
Cela posé, alors que l’anecdote mythologique est réduite à son épurefonctionnelle dans la version du calendrier,296 dans le Jugement entre Horus etSeth, elle laisse transparaître une élaboration proprement littéraire. D’abord parl’introduction qui relie cette anecdote, en soi totalement autonome, àl’argument de l’oeuvre, la querelle pour la fonction, alors que dans le calendrier,elle vient justifier le caractère néfaste du jour et l’interdiction qui lui est propre,ce qui est le rôle d’un mythe étiologique. Ensuite, par l’effort déployé pourrendre plus cohérent l’enchaînement des actions. D’emblée, le récit enracine lesagissements d’Isis dans son amour maternel " « Seth va #/pourrait$ tuer mon
294.Le calendrier recourt très souvent à l’auxiliaire de narration wn!jn=f là où le conte préfère l’auxiliaireaHa!n. Inversement, pour formuler la délivrance de Seth par le harpon, le conte emploie l’auxiliaire denarration wn!jn=f #P. Chester Beatty 9, 7$, quand le calendrier préfère aHa, qui représente soit une graphiede aHa!(n), soit l’auxiliaire aHa.
295. Par exemple, sbH qA, « grand cri » #calendrier$, face à sgb aA, « grand cri » #conte$. xar, « se mit en colère »#calendrier$, face à qnd, « se mit en colère » #conte$. Dans le calendrier le terme amortisseur est xfty,« ennemi », dans le conte, c’est Hm, « la corporalité ». Cf. G. POSENER, Sur l’emploi euphémique de xftj(w)‘ennemi"s# ’, dans « ZÄS » 96 #1969$, p. 34, et le commentaire de M. BROZE, Mythe et roman en Égypteancienne. Les aventures d ’Horus et Seth dans le papyrus Chester Beatty I, « OLP » 76, Leuven 1996, p. 79,« néanmoins, l’emploi de Hm est moins spectaculaire que celui de xfty, et de ce fait, l’emploi euphémiqueest moins évident ».
296. La version du calendrier semble avoir été délimitée respectivement: par « Alors, les deux personnagess’empoignèrent l’un l’autre », et par « Alors, les deux comparses se retrouvèrent dans une position oùchacun avait mis sa nuque à l’écart de celle de l’autre ». Je me demande si ce qui suit: « Sur ce, Horus,fils d’Isis se trouva irrité contre sa mère Isis. Il sortit, son visage féroce comme le léopard du Sud » n’apas été copié mécaniquement dans le texte qu’utilisait le rédacteur du calendrier, sans vraiment fairepartie de ce qu’il jugeait pertinent.
109« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
enfant! » " s’écrie!t!elle en utilisant une forme grammaticale " le prospectif "chargée de subjectivité, et contrastant paradigmatiquement avec le futurobjectif.297 En revanche, dans la version du calendrier, pas la moindrejustification n’est présentée pour expliquer son recours au harpon. Enfin, alorsque la version du calendrier débouche sur un mythe étiologique " Thotremplace la tête d’Isis par une tête de vache " le conte utilise habilementl’étrange apparence de la déesse comme prétexte pour faire rebondir l’intrigue.Phrê!Horakhty s’écrie en la voyant:
Qu’est!ce, celle qui est venue sans avoir de tête?
Thot lui explique :
Mon bon maître, c’est Isis, la puissante, la mère du dieu, alors que Horus, son filslui a enlevé la #litt. : sa$ tête.
Indigné le dieu solaire exige qu’Horus soit châtié, ce qui amène un nouvelépisode.
D’une manière générale, la version du calendrier s’en tient aux maigreslinéaments de l’intrigue, quand le conte se plaît à lui donner plus de chair.298 Ilaccentue l’humanisation des divinités.299
Dans le calendrier, à l’interpellation plaintive de Seth, réduite à « Vois, jesuis ton frère Seth! », Isis commence par réagir négativement: « Sur ce, elle lançaun appel à ladite pointe métallique en ces termes: “Tiens bien fort!” ». Ce n’estqu’après que Seth a argumenté dans une seconde interpellation, en prononçantle mot clef « frère!de!mère » 300 qu’elle s’amadoue.
297. P. VERNUS, Future at Issue. Tense, Mood and Aspect in Middle Egyptian: Studies in Syntax and Semantics, « YES »4, New Haven 1990, chapter 1.
298. Toutefois, le calendrier conclut l’épisode du harpon par une phrase absente du conte, lequel passedirectemment à un autre rebondissement, la colère d’Horus.
299.Cf. sur ce point LOPRIENO, The King’s novel, p. 284.300. Le fait qu’il y ait un arrière!fond juridique est notable, cf. infra § 73. Cela posé, ce n’est pas le lieu de
discuter cet arrière!fond juridique. Cf. en dernier lieu M. CAMPAGNO, Juridical Practices, Kingship and theState in the ‘Contending of Horus and Seth’, dans « ZÄS » 133 #2006$, pp. 20!33; H. DIAZ RIVAS, La herencia enel antiguo Egipto: entre el modelo mitico y la realidad social, dans M. CAMPAGNO #ed.$, Parentesco, patronazgo yEstado en las sociedades antiguas, « Estudios del Mediterraneo Antiguo ! PEFSCEA » 5, Buenos Aires 2009,p. 76.
110 EDAL II . 2010 / 2011
Dans le conte, dès la première interpellation de Seth, beaucoup plusélaborée et contenant déjà le mot!clef « frère!de!mère », Isis s’amadoue.
Le conte concède davantage au souci du détail, comme l’illustre ladescription élaborée de la fabrication du harpon et de sa corde. Dans le conte,c’est le même instrument qui est utilisé pour chacun des deux dieux:
Puis, elle recommença à en frapper l’eau; elle #= la pointe$ vint à mordre lacorporalité #euphémisme$ de Seth.
Dans le calendrier, Isis recourt à deux harpons: Puis, elle fit aller une autre pointe métallique qui se trouva tomber sur « l’ennemi »de son frère Seth.
Le conte tend à amplifier le récit et les échanges verbaux. Significative en cesens, la comparaison entre les propos d’Horus, quand, blessé par le harpon, ilinterpelle Isis. Dans la version du calendrier, ils ont réduits à:
Vois, je suis ton fils Horus!
Dans le conte, en revanche, ils sont plus développés: A moi, Mère Isis, ma mère! Lance à ta pointe métallique l’appel : « Détache!toi delui ». Je suis Horus, fils d’Isis.
Des obervations du même genre peuvent être aisément étendues à toutel’anecdote. Bornons!nous à opposer l’extrême concision de la réaction d’Isis àl’interpellation d’Horus dans le calendrier:
Sur ce Isis lança un appel à ladite pointe métallique en ces termes: « Détache!toi,détache!toi de mon fils Horus! »
à sa formulation plus élaborée dans le conte:
Alors, Isis poussa un grand cri et elle dit à la pointe métallique, pour qu’elle sedétache de lui: « Vois, c’est le fils Horus, mon enfant! »
Sa réaction à l’interpellation de Seth, marque un dégré de plus dansl’argumentation dans la version du calendrier:
Détache!toi, détache!toi! Vois, c’est un #ou: mon$ frère!de!mère.
Toutefois en ce domaine, cette version est stylistiquement surpassée par celledu conte:
111« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
Détache!toi de lui! Vois, c’est un frère!de!mère d’Isis que celui dans lequel tu asmordu!
Le conte utilise une construction particulière qui met en vedette le premierélément #« c’est un frère!de!mère d’Isis »$, bien plus expressive que la simplephrase nominale du calendrier #« c’est un #ou: mon$ frère!de!mère »$, laquellen’exprime que l’appartenance à une classe. Que le statut soit en jeu par delà lapersonne est habilement souligné par le fait qu’Isis se distancie en sementionnant sous son nom #« un frère!de!mère d’Isis »$, et non par un pronompossessif à la première personne.
65. A travers l’épisode des hippopotames, on saisit presque sur le vif latransfiguration d’un mythe en narration désacralisée, ou, à tout le moins,valorisée avant tout pour le plaisir littéraire qu’elle dispensait.
Le processus est largement répandu. En effet, les mythes ontintrinsèquement trois caractéristiques propres à susciter leur détournementvers la littérature,301 pourvu que la réception le juge bon.1$ En soi, le monde du mythe, qui est celui des dieux et qui se situe dansun temps et une temporalité différentes du temps historique et de latemporalité humaine, est un monde fictif. Par la même, il a intrinsèquement defortes affinités potentielles avec la fiction qui est l’essence même du « littéraire »au sens fort / restreint.2$ L’impératif étiologique qui génère le mythe, c’est!à!dire le souci dedonner une explication rétrospective à une réalité dont le sens originel estperdu, accroît le merveilleux des situations. En effet, on est prêt à mobiliserl’extraordinaire pour rendre compte du commun. Le trivial et le terre!à!terres’allègent quand il s’agit d’imaginer ad hoc un scénario aboutissant à une situa !tion ou à des paroles censées avoir produit la réalité à expliquer. Transfigurant
301. Cf. P. VERNUS, Les animaux dans la littérature Égyptienne, dans ID. ! J. YOYOTTE, Le Bestiaire des pharaons,Paris 2005, pp. 57!58; VERNUS, La notion de mythe dans la civilisation pharaonique, pp. 11!32; ID.,Dictionnaire amoureux, articles Mythe, Mythes en oeuvres, Mythe "typologie des récits#.
112 EDAL II . 2010 / 2011
le prosaïque et le quotidien, le mythe anime un monde en apesanteur, suscep !tible de fasciner pour peu qu’on le départisse de sa sacralité originelle.3$ La narration,302 qui est l’essence du mythe, produit intrinsèquement uneffet spécifique qui peut aisément s’infléchir en plaisir proprement littéraire.L’enchaînement incessant d’actions et d’événements transporte l’auditeur ou lelecteur dans l’euphorie grisante d’un univers halluciné, et animé de mouvementsprotéiformes.
Les mythes possèdent donc intrinséquement des potentialités d’intérêtlittéraire, par delà leurs usages religieux. Et de fait, ces potentialités ont étémaintes fois développées au fil de leur réception, et d’autant plus que ces usages,loin de se limiter à la rédaction de gloses ou de traités de science sacerdotale,comprenaient vraisemblablement des lectures publiques.303 Elles ont même étéactualisées au goût du jour pour ainsi dire. Ainsi, un mythe comme le Mythe desdieux contre la mer semble avoir été ajusté à une forme nouvelle le sDd bAw, « lerécit des exploits » d’une divinité.304
D’où leur transfiguration relativement aisée en contes ou récitsmerveilleux. D’expressions théologiques d’un savoir sacré sur le monde, lesmythes ont propension à être réutilisés pour la dynamique des récits à euxconsubstantiellement liés. Leur élaboration les détourne de leur fonctionoriginelle et les livre à une exploitation pour le seul plaisir spécifique quedistillent leurs potentialités de fiction et de narration. Si le récit se nourrit deleur enchaînement, sa dynamique procède de leurs apories et de leurscontradictions. L’oeuvre littéraire ne fonctionne en tant que tel que parce queleurs mécanismes originaux se grippent quand ils sont promus en un discours.
302. Cf. le récent recueil de contributions: ROEDER #Hrsg.$, Die Erzählen in fru&hen Hochkulturen, I.303. A. VON LIEVEN, Fragments of a Monumental Proto!Myth of the Sun’s Eye, dans WIDMER ! DEVAUCHELLE
#éds$, Actes du IXe Congrès International des Études démotiques, p. 175.304.Cf. les fines analyses de PH. COLLOMBERT ! L. COULON, Les dieux contre la mer. Le début du « papyrus
d’Astarté » "pBN 202#, dans « BIFAO » 100 #2000$, pp. 224!26.
113« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
Dialectique du didactique et du littéraire
66. Ce processus de détournement " ou de transfiguration " a eu unelarge extension. On a tout lieu de croire, entre autres, qu’il explique lapromotion de textes didactiques 305 dans le domaine des belles!lettres.
N’oublions pas que ces sagesses, que l’Égyptologie classe dans les belles!lettres, appartiennent fondamentalement à un ensemble dont la finalitéoriginelle est trivialement didactique. Ainsi, dans cet ensemble, un salmigondisde formules comme La somme " traduction de Kemyt, qui les désignait enégyptien " visait d’abord à inculquer au lettré débutant des bases phraséo !logiques indispensables à sa pratique quotidienne.306 Nul ne saurait attribuer àson auteur, ou plutôt, à son compilateur, une intention littéraire, c’est le moinsqu’on puisse conclure à parcourir son égrénement fastidieux de formulationsstéréotypées, même si elles mettaient en jeu des conceptions théologiques.307
Les sagesses, elles aussi, avaient bel et bien originellement une fonctionpurement didactique, aussi bien l’inculcation de modèles phraséologiques etplus généralement langagiers que l’inculcation des normes du comportement.
Dans la transfiguration en belles!lettres de textes remplissant originel !lement une autre fonction, l’« école » joue évidemment un rôle détermi !nant.308 En elle s’abolit, fût!ce provisoirement, la distinction entre culturel etlittéraire. Les textes qu’ils soumettaient à leurs étudiants, les maîtres les élisaientsans doute en partie pour leur contenu immédiatement instructif, mais aussi,
305. Pour l’identification des textes didactiques, cf. récemment GOELET, Writing Ramessid Hieratic: what theLate Egyptian Miscellanies tell us about scribal education, pp. 102!10.
306.Bibliographie volontairement limitée: QUIRKE, Egyptian Literature, pp. 52!54; A. GASSE, Catalogue desostraca littéraires de Deir al!Médîna Nos 1775!1873 et 1156, V, « DFIFAO » 44, Le Caire 2005; H.W. FISCHER!ELFERT, Schreiberscherben $ Zu den ramessidischen Ostraka des British Museum, dans « GM » 207 #2005$, p.90; J. GALAN, An Apprentice Board from Dra Abu el!Naga, dans « JEA » 93 #2007$, pp. 109!10; O. GOELET,Ancient Egyptian Scripts $ Literary, Sacred, and Profane, dans L.H. SCHIFFMAN #ed.$, Semitic Papyrology inContext: A Climate of Creativity. Papers from a New York Conference marking the retirement of Baruch A. Levine,« Culture and History of the Ancient Near East » 14, Leiden 2003, pp. 20!21.
307. En ce sens D. KLOTZ, Fish at Night and Birds by Day "Kemit VIII#, dans « ZÄS » 136 #2009$, pp. 136!40.308.Pour le rôle de l’école dans la sélection des textes véhiculant des « valeurs normatives et formatives », cf.
J. ASSMANN, La mémoire culturelle. Écriture, souvenir et imaginaire politique dans les civilisations antiques, Paris2010, p. 83.
114 EDAL II . 2010 / 2011
tout simplement parce qu’eux!mêmes en tiraient une jouissance proprementlittéraire pour peu qu’ils y pussent apprécier la symbiose entre distraction etsavoir sur le monde. Autrement dit, les sagesses avaient intrinsèquement unetendance à être détournées de leur fonction didactique originelle:
Unspecificity is a feature that a text acquires after it has been transferred from onegenre and context to another % . . .& from the instructions as specifically orprofessionnally addressed to an individual to an indeterminate audience of thewisdom texts.309
Nul besoin d’aller chercher bien loin des analogies. L’enseignement secondairedans la France du Vingtième Siècle se fondait sur des extraits des grands écrivainsqu’on expliquait solennellement aux écoliers dans l’ordre chrono logique, quitte àce qu’un petit niais de douze ans dût se colleter à Rabelais et à Montaigne.
Il est évident que dans la civilisation pharaonique, les sagesses avaientété hissées à l’empyrée des belles!lettres, parce qu’elles avaient su polir uneesthétique de l’éthique, parce qu’elles convoquaient le beau pour révoquer lemal, parce que, si elles disaient le bien, elles le disaient bien.
Inversement, dans la mesure où la « poésie est perle de la pensée » " leurstatut même de belles!lettres incitait à les choisir parmi les textes utlisés pourl’enseignement parce qu’elles présentaient de la manière la plus séduisante lesfondements nécessaires à la formation des jeunes esprits. Ainsi, ont!elles étéprises dans une mouvement continu, de la pratique didactique à la promotiondans le Parnasse, et du Parnasse à la pratique didactique. Cas topique: l’Enseigne !ment de Ptahhotep. À l’origine, voici un recueil de préceptes à finalité didactiqueet visant à former l’élite lettrée " peut!être plus particulièrement la « sub!élite »de l’élite, en dépit de sa situation cadre #d’un vizir à l’autre$.310 Puis, au fil de laréception, il se trouva promu au statut de classique des belles!lettres parce queson public l’appréciait pour lui!même, par delà sa finalité première, parce queceux qui avaient à composer un texte s’en inspiraient. Enfin, le statutprestigieux qu’il avait acquis en tant que classique renforçait au second degré la
309. ID., The History of the Text before the Era of Literature Three Comments, p. 88. 310. Sur cette ambiguité de l’enseignement, cf. VERNUS, Sagesses, p. 106.
115« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
propension des enseignants à l’élire parmi les textes proposés à leurs étudiants:après avoir été prescrit pour ses vertus didactiques de base, il le fut pour laperfection même avec laquelle il les mettait en oeuvre.
La leçon a été retenue par l’auteur de l’Enseignement d ’Aménemopé: ilassigne à son oeuvre une double finalité, divertir et instruire #§ 50$. Horace,dans son Ars poetica associera dans une perspective analogue dulce et utile.
Ainsi, à force de d’être mobilisée dans des oeuvres qui n’avaient étéreçues dans les belles!lettres que par détournement ou transfiguration, la formede la sagesse a fini par être élue pour des oeuvres « littéraire » #sens fort /restreint$ par destination première.
Oeuvres littéraires par destination première: formes empruntées
67. Si maints textes n’ont été accueillies au Parnasse des belle!lettres qu’à lasuite d’un détournement de leur fonction originelle au fil de leur réception,d’autres étaient certainement littéraires de par leur destination première. Lesaventures de Sinouhé en sont le parangon. Le texte a été écrit d’emblée pourêtre une oeuvre littéraire #sens fort / restreint$, sa « littérarité » se manifestepréméditée, jargonnerait!on plaisamment, son auteur bâtissant un universconsciemment fictif. L’analyse rend évident sa nature « fictionnelle » " pourderechef donner dans les tics de langage des théoriciens. Cela posé, si c’est untexte originellement littéraire, il n’a pas été bâti sur une forme spécifiquementlittéraire. En fait, il emprunte comme cadre général la forme de l’auto !biographie, pour ne rien dire d’autres formes secondaires auxquelles l’auteur deSinouhé a eu recours pour certains épisodes: hymnes, décret, idéologieroyale.311 L’autobiographie relève intrinsèquement d’une tout autre destinationque la littérature. C’est un genre attesté depuis l’Ancien Empire,312 et à travers
311. Autobiographie comme point de départ d’oeuvres littéraires: LOPRIENO, Loyalty to the King, to God, to oneself, p. 537. Pour la forme autobiographique des Aventures de Sinohé, et les thèses " pas toujoursconvaincantes " qu’elle a suscitées, cf. V.A. TOBIN, The Secret of Sinuhe, dans « JARCE » 32 #1995$, n. 6.
312. Pour ne pas alourdir démesurément les notes, je me borne à renvoyer à J. STAUDER, Les autobiographiesévénémentielles de la Ve dynastie: premier ensemble de textes continus en Égypte, dans M. BARTA #ed.$, Abusir and
116 EDAL II . 2010 / 2011
lequel sur ses monuments funéraires, ou sur des objets déposés en des lieuxsacralisés, un particulier dresse de lui un portrait apte à lui valoir le respect etles prières, voire même des offrandes, de la part de ses contemporains, et plusencore de la postérité. Sa finalité première est fondamentalement commé !morative: elle vise à construire une image attrayante. Mais, en raison de sonusage intensif pour les membres de l’élite et aussi par les membres de l’élite" car ses produits étaient affichés en des lieux ouverts, et souvent visités parceux qui maîtrisaient l’écriture 313 " ce genre a fait l’objet d’une profonde miseen cause: on a exploré ses possiblités et mis en question de la véracité de soncontenu durant la Première Période Intermédiaire.314 Dès lors, ainsi « théma !tisé », et isolé de ses conditions originelles de production, le genre devenaitsusceptible d’être réutilisé comme forme dans d’autres types de textes,315 et, enparticulier pour des oeuvres proprement littéraires; les Aventures de Sinohéillustrent ce processus.
Le constat peut être généralisé. Le Parnasse de l’Égypte pharaonique nemanque pas d’oeuvres littéraires par destination première. Mais ellesempruntent des formes qui a priori étaient mises en oeuvre dans des fonctionsqui n’avaient intrinsèquement rien de littéraires. Ainsi
! l’autobiographie #cf. ci!dessus$;! la lettre #§ 68$;! le rapport administratif #§ 69!72$;! la pratique judiciaire #§ 73$;! la lyrique religieuse #§ 74$;
Saqqara in the Year 2010 $ Proceedings of the Conference held in Prague May 31!June 4, Prague 2011 #souspresse$.
313. Des récentes découvertes dans la nécropole d’Assiout illustrent le fait. Par exemple, J. KAHL, EinZeugnis altägyptischer Schumlausflüge, dans « GM » 211 #2006$, pp. 25!29, qui met en évidence l’utilisationde la partie ouverte des tombe d’Assiout dans les pratiques didactiques et culturelles. Cf. aussi l’articleU. VERHOEVEN cité ci!dessous.
314. Très bonnes analyses de L. COULON, Véracité et rhétorique dans les autobiographies égyptiennes de la PremièrePériode Intermédiaire, dans « BIFAO » 97 #1997$, p. 136.
315. Pour la forme autobiographique utilisée parodiquement dans les légendes de scènes de chapellefunéraire: VERNUS, Comment l’élite se donne à voir dans le programme décoratif de ses chapelles funéraires, p. 102.Dans une composition funéraire tardive: S.R. GLANVILLE ! M. SMITH, Catalogue of Demotic papyri in theBritish Museum, III, The mortuary Texts of Papyrus BM 10507, London 1987, p. 29.
117
! la geste royale #§ 75$;! la sagesse #§ 76$.
La lettre comme forme d’oeuvre l ittéraire« par destination première »
68. Au premier chef, la forme épistolaire. C’est le médium fondamental dela communication écrite, depuis le plus humble subalterne, relégué au dernieréchelon des dominés des dominants, jusqu’au pharaon qui y recourtrégulièrement pour signifier ses volontés et sa satisfaction à tel dignitaire.316
La lettre est le tout!venant de l’expression écrite dans la culture dulettré.317 En témoignent ces exercices écrits " le plus souvent sur ostraca " etqui prennent la forme de lettres avec des formulaires variés. Des lettres modèlesfaisaient l’objet de versions avec des « points de versification » pour en faciliterla lecture à haute voix.318 Les égyptiens cultivés s’aguerrissaient à maîtriserl’expression écrite, essentiellement en maniant les formulaires et le styleépistolaires.
La fréquence d’emploi de la forme épistolaire la prédisposait donc à êtrerécupérée.
Ce fut fait et bien fait.319 Jusqu’à un hymne à Amon, caractéristique de lapiété personnelle, à se présenter comme une lettre écrite au vizir Neferrenpet! 320
« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
316. Exemple: les lettres des pharaons pieusement intégrées à l’autobiographie à l’Ancien Empire, ouencore, au Nouvel Empire, la mention d’une lettre adressée au pharaon dans le récit d’une expéditionannexée au monument funéraire de Khnoumhotep au Moyen Empire #J.P. ALLEN, L’inscription historiquede Khnumhotep à Dahschour, dans « BSFE » 173, 2009, p. 24$. Le pharaon Kamès va jusqu’à citer une lettre" réelle ou fictive " d’un souverain étranger sur ses stèles évoquées ci!dessus.
317. Cf. A. BAKIR, Egyptian Epistolography from the Eighteenth to the Twenty!First Dynasty, « BdE » 48, Le Caire1970; J.J. JANSSEN, Literacy and Letters at Deir el!Medina, dans DEMARÉE ! EGBERTS, Village Voices, pp. 81!94; D. SWEENEY, Correspondance and Dialogue. Pragmatic Factors in Late Ramesside Letter!Writing, « ÄAT »49, Wiesbaden 2001; FR. JUNGE, Einführung in die Grammatik des Neuägyptischen, Wiesbaden 1996, pp.310!13; et, récemment, R.J. DEMARÉE, Letters and Archives from the New Kingdom Necropolis at Thebes, dansL. PANTALACCI #éd.$, La lettre d ’archive: communication administrative et personelle dans l'antiquité proche!orientale et égyptienne; actes du colloque de l'Université de Lyon 2, 9 ! 10 juillet 2004, « Topoi » 9, Lyon 2008,pp. 43!52.
318. MCDOWELL, Teachers and Students at Deir el!Medina, p. 232. Pour le rôle de la ponctuation, cf. ci!dessus§§ 23 et 25.
319. B. SCHAD, Die Entdeckung des Briefes als literarisches Ausdruckmittel in der Ramessidenzeit, Hambourg 2006. 320. O. KV 18 / 3.576 = A. DORN, mAA! nxt.w=f, ein "?# einfacher Arbeiter, schreibt Briefe, dans ID. ! HOFFMANN
#eds$, Living and Writing in Deir el!Medine, pp. 75!76.
118
Des oeuvres adoptent la forme épistolaire pour viser d’emblée ledomaine des belles!lettres. Ainsi, la Lettre de Menna 321 est assurément unevéritable oeuvre littéraire au sens fort, même si elle adopte la structurationénonciative propre aux lettres, et si elle en emprunte aussi les formulationsstéréotypées 322 comme:
mte=k sAw tAy=j Sa.t jry=s mtr
Et prends soin de cette mienne lettre, elle servira de preuve.
En témoigne autant la Lettre satirique de Hori. Sous la fiction d’une missive danslaquelle un vieux maître scribe répond en vingt thèmes au quatorze paragraphesrédigés par un jeune blanc!bec infatué, l’oeuvre se présente au premier degrécomme un panorama des connaissances requises d’un scribe:
hAb=j n=k r mtr=k mj xnmsw Hr sbA aA r=f r zS jqr
Je t’écris pour t’instruire comme à un ami enseignant quelqu’un de plus importantque lui à être un scribe compétent.323
Il y a grimage faussement réaliste grâce à des énonciations d’identité à la manièredes usages épistolaires. Mais au second degré, elle ne vise à rien de moins queprésenter une critique d’une conception trop superficielle de l’apprentissage dusavoir.324 La préméditation littéraire est parfois quasi avouée:
C’est une composition dans le genre distrayant #litt.: à l’instar d’une distraction$que je vais faire à ton sujet #cité ci!dessus § 50$.
EDAL II . 2010 / 2011
321. Cf. VERNUS, Sagesses, pp. 469!75. Significative la remarque selon laquelle la lettre « appears to be asemiliterary composition #even verse points are provided$ though purporting to be a letter from hisfather Menna, who was a drafts man in the village »: LESKO, Literature, Literacy and Literati, p. 134. Parailleurs, JANSSEN, Literacy and Letters at Deir el!Medina, p. 87, est tenté de classer comme oeuvre« littéraire » sous forme de lettre l’O. Berlin 10627.
322. Pour cette formulation stéréotypée, cf. CLEM, p. 245; A. THÉODORIDÈS, Propriété et mandat dans lePapyrus Berlin 8523, dans « RIDA » 10 #1963$, p. 99.
323. P. Anastasi I, 5, 3; version O. Nash 8.324. Cf. les analyses de FISCHER!ELFERT, Die satirische Streitschrift des Papyrus Anastasi I, pp. 279!90.
119
Elle transparaît aisément au fil du texte. Entre autres à travers l’intertextualitéexplicite. Elle comporte une allusion à la culture classique qui devrait êtrecommune à l’émetteur et au récepteur. En fait, le collègue du rédacteur de lalettre, n’en a qu’une teinture superficelle; quand il cite une sentence del’Enseignement d ’Hordjedef, un fils de Chéops à qui la tradition attribuait unesagesse, c’est en ignorant son contexte, à partir d’un recueil de morceaux choisisou d’incipit de maximes.325
Autre illustration de la forme épistolaire choisie pour une oeuvre écritepréméditée comme littéraire: la Lettre d ’Ourmai.326
Il arrive aussi qu’un oeuvre littéraire, bien qu’écrite dans une formedifférente de la forme épistolaire, emprunte à celle!ci une de ses locutions.Ainsi la locution
r!dj.t!rx=k, « pour t’informer » est utilisée dans un des manuscrits de la Sagesse d’Ani#P. Boulaq 4 = CGC 58042, 19, 1$ dans l’intro duction d’un nouveau développement:
r!dj.t!rx=k hry!tp zPour t’informer de l’existence terrestre d’un homme qui. . . 327
Il pourrait s’agir d’une reformulation sous l’influence de la pratique admi !nistrative de la XXe dynastie, période où la locution était particulièrement envigueur.328 Les manuscrits plus anciens ont:
#D $ my dj=j amA=k m tp!rd n z, fais!moi prendre connaisssance de la règle!de!conduited’un homme qui. . . #L$ ptr te Hr mtr=k r pA sxr n rmt, Vois, je t’instruis dans le projet d’un homme qui... 329
« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
325. « Tu es venu muni de très importants secrets. Tu m’as énoncé une sentence de Hordjedef. #Mais$ tu nesais pas si elle est positive ou négative. Quel chapitre la précède? Qu’est!ce qui y fait suite? Tu es unexpert qui dépasse ses collègues » #P. Anastasi I, 10, 9!11, 2, cf. FISCHER!ELFERT, Die satirische Streitschriftdes Papyrus Anastasi I, pp. 95!97$.
326. MOERS, Fingierte Welten, pp. 273!79; H.W. FISCHER!ELFERT, Abseits von Ma’at Fallstudien zu Aussenseiternim Alten Ägypten, « WSA » 1, Würzbug 2005, chapitre IV, Ein literarischen Genesis.
327. VERNUS, Sagesses, p. 307, n. 11.328. DONKER VAN HELL ! HARING, Writing in a Workmen’s Village, p. 147, situe le floruit de la formule dans la
première moitié de la XXe dynastie et juge qu’elle « seems to have been reserved for texts concerningpersonal matters ».
329. QUACK, Die Lehren des Ani, p. 297.
120
Rapport administratif comme forme d’oeuvre l ittéraire « par destination première »
69. Notre modernité est encline, a priori, à situer les productions admi !nistratives aux antipodes de la littérature. Dans notre imaginaire, la caricaturedu gratte!papier s’oppose au poète éthéré. Il en va tout autrement dans l’Égyptepharaonique. Point d’infranchissable muraille entre le bureaucrate et l’hommede lettres. Au niveau les plus élémentaire, la formulation Dd.t!n!N, « ce qu’a ditN », utilisée dans la pratique administrative pour consigner une déposition, estmise en oeuvre dans des oeuvres littéraires par destination première, comme Ledésespéré et Les lamentations d ’Ipouour.330
Bien plus, voici deux exemples illustrant comment l’auteur d’un rapportadministratif ne s’interdit pas, au détour d’une relation attendue a prioriimpersonnelle, de se départir de la neutralité objective requise pour laisser sonégo s’immiscer dans la texture narrative, d’une manière que nous jugerionssaugrenue dans un tel contexte,331 dans la mesure même où nous y discernerionsun affection quasi littéraire.332
70. Premier exemple dans une plainte relative à des conduites scandaleusesà Éléphantine, connue dans l’Égyptologie sous le nom de « scandale d’Éléphan !tine ».333 Le document est intitulé: Les mémoranda qui sont à l’encontre du prêtre!purdu domaine de Chnoum Penanouqet, surnommé Sed. Il se présente formellement
EDAL II . 2010 / 2011
330. ENMARCH, A World upturned, p. 28.331. A comparer avec le changement de personne pour marquer l’émotion; par exemple: dans le « Récit »
de la bataille de Qadesh, S. MORSCHAUSER, The Speeches of Ramesses II in the Literary Record of the Battle ofQadesh, dans GOEDICKE, Perspective on the Battle of Kadesh, p. 140; l’interpellation en tant qu’interlocuteurdu « bouillant », jusqu’alors traité en délocutaire, dans le deuxième chapitre #4, 17$ de L’enseignementd’Aménemopé, « O Bouillant, dans quel état te trouves!tu ? ». A distinguer des cas où le changement depersonne est dû à des manipulations de textes différents, par exemple dans le P. Chester Beatty IV, vo 2,cf. VERNUS, Sagesses, p. 358, n. 37, p. 349, n. 49, et p. 363.
332. On perçoit l’écho d’une distinction d’ordre linguistique entre « narration » proprement dite, en principedétachée du hic et nunc de l’énonciation, et « récit » #ou « rapport »$ où les événements rapportés enenchaînement séquentiel interviennent dans l’univers de l’énonciateur. Cf., entre autres, J. WINAND,Review of K. Jansen!Winkeln, Text und Spracher in der 3. Zwischenzeit, dans « LingAeg » 6 #1999$, p. 221.
333. P. Turin 1887, transcription hiéroglyphique dans RAD pp. 73!82, traduction P. VERNUS, Affaires et scandalessous les Ramsès, « Bibliothèque de l’Égypte ancienne », Paris 1993, chapitre IV.
121
comme une énumération des différents memoranda " le terme égyptiendésignant un type particulier de texte administratif à implication juridique 334
" consignant les différents méfaits et forfaitures du dénommé Penanouqet. Enprincipe, chacun d’eux est rédigé dans un style objectif. L’emploi des personnesde l’interlocution est limité aux propos rapportés au style direct. En voici unexemple représentatif:
Mémorandum concernant le fait que le vizir Néferrenpet nomma le prêtre!purBakenchonsou prophète de Chnoum. Ce prêtre!pur #= Penanouqet$ dit au prêtre!pur Nebounnef: « Si nous disposions de trois autres prêtres!purs, nous ferions jeterdehors le fils de ce courtier! » On l’interrogea; on constata qu’il l’avait vraiment dit.On lui fit prononcer un serment par le maître, Vie, Intégrité, Santé, de ne pasentrer au temple. Il donna son bakchich à ce prophète en disant: ‘Laisse!moiaccèder auprès du dieu!’ Ce prophète accepta son bakchich. Il le laissa accèderauprès du dieu.335
Dans ce passage le récit est à la troisième personne. Le recours aux personnesde l’interlocution #« nous disposions ... nous ferions ... Laisse!moi »$ est limitéaux citations au style direct.
Cela posé, l’uniformité de cette stratégie énonciative, évidemment dueau genre, le rapport administratif, est rompue en une occasion:
Mémorandum concernant le fait que le vizir Néferrenpet envoya le suivant Pakhar!le!jeune et le suivant Patchaouemdichonsou avec cet ordre: « Allez chercher le pèredivin Qakhepesh! » Les suivants me trouvèrent alors que j’étais dans le servicemensuel de la première phylé. Les suivants me relâchèrent, en disant: « On ne doitpas se saisir de toi, puisque tu es dans ton service mensuel », ainsi %me& dirent!ils.Ce prêtre!pur leur donna des jupes de tissu de Haute Égypte, une chaise pliante,deux paires de sandales, deux défenses d’ivoire, une botte de légumes, mille noix!doum, des poissons vidés, et également du pain, de la bière. Il leur dit: « Ne lerelâchez pas.336
Dans ce passage, à côté des cas où les personnes du discours sont utilisés dansune citation au style direct #« se saisir de toi, puisque tu es »$, selon l’usage, voiciqu’elles apparaissent dans la texture narrative elle!même, alors que par ailleurselles en étaient proscrites:
« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
334. Pour cette qualification, cf. récemment DONKER VAN HEEL ! HARING, Writing in a Workmen’s Village,pp. 108!10.
335. P. Turin 1887, ro, 12!14.336. P. Turin 1887, ro, 4!7.
122
Les suivants me trouvèrent alors que j’étais dans le service mensuel de la premièrephylé. Les suivants me relâchèrent.
Tout donne à penser que l’auteur de ces memorandum, a secoué soudainementle carcan de l’impersonnalité requise par le style administratif, tout simplementparce qu’il était directement impliqué.
71. Second exemple dans le document appelé « papyrus de la grève », ou« Turin Strike Papyrus » dans la tradition égyptologique, parce qu’il traite degrèves, même si ce n’est pas le seul sujet. En fait, ce document d’économiecomplexe est avant tout un rapport sur les dysfonctionnements de l’Institutionde la Tombe. Il prend la forme d’une relation impersonnelle des événements quil’avaient agitée, relation organisée en une succession de notices introduites parune date. Le fait que les dernières notices soient datées du dernier jour del’année civile, c’est!à!dire le jour précédent l’anniversaire de l’accession dupharaon règnant 337 témoigne éloquemment du caractère fondamentalementadministratif du texte. Et comme attendu, la relation est à la troisièmepersonne, le recours aux premières et deuxièmes personnes étant limité auxcitations au style direct.
Toutefois, comme dans les memoranda d’Éléphantine, ce parti!prisénonciatif va se trouver occasionnellement abandonné:
L’an 29, le premier mois de la saison d’été; le deuxième jour. Donner les deux « sacs »de blé amidonnier à l’équipe par Amenkhâou et Ouserhat, en tant que ration dupremier mois de la saison d’été. Alors le chef d’équipe de l’équipe Chonsou dit:« Voyez, je vous dis: “Prenez les rations et descendez vers l’embarcadère à l’Enclos.Et que les indicateurs du vizir le lui disent.” Et quand le scribe Amennakht eut finide leur donner les rations, ils se dirigèrent vers l’esplanade conformément à ce qu’illeur avait dit. Puis ils franchirent une redoute. Le scribe Amennakht partit et leurdit: “Ne franchissez pas #les redoutes pour aller$ jusqu’à l’esplanade. Eh bien, eneffet, je vous ai donné deux ‘sacs’ de blé amidonnier à l’instant. Et si vous partez, jevous ferai être en tort dans tout tribunal devant lequel vous irez.” » Je lesramenai de nouveau en haut.338
Il faut bien disitinguer deux cas différents:
EDAL II . 2010 / 2011
337. DONKER VAN HEEL ! HARING, Writing in a Workmen’s Village, p. 67, n. 106.338. P. Turin 1880, ro 3, 6!3, 13.
123
· quand il écrit « je vous ai donné deux “sacs” », et « je vous ferai être entort », Amennakht respecte le parti!pris énonciatif prévalant dans son rapport,puisqu’il s’agit de citations au style direct;
· en revanche, quand il écrit:
jw=j Hr jn.t=w, Je les ramenai,
il transgresse ce parti!pris, puisqu’il recourt à la première personne dans latexture même du récit, alors qu’auparavant, il s’en tenait à la troisième personnepour cette texture, même quand il était lui!même un des personnages mis enscène; voir, par exemple:
jw zS jmn!nxt (Hr) Sm, Le scribe Amennekht partit.
Sans doute emportée par la fierté d’avoir déployé une persuasion efficace àl’égard de ses administrés, il jette bas le masque de la troisième personne.
Cette intervention inopinée de la subjectivité dans un document a prioritenu à l’impersonnalité a d’autant plus de sel que celui!ci qui s’y laisse aller, cescribe Amennakht, est bien connu, entre autres pour avoir composé des oeuvreslittéraires.339
Par là, le passage est aisé à l’oeuvre littéraire prenant la forme du rapportadministratif,340 comme c’est le cas dans Les aventures de Ounamon.341 Le texte
« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
339. Sur ce scribe, cf. 'ERN), A Community of Workmen at Thèbes, pp. 339!50; CH. EYRE, A ‘Strike’ Text from theTheban Necropolis, dans J. RUFFLE ! G.A. GABALLA ! K.A. KITCHEN #eds$, Glimpses of Ancient Egypt. Studiesin Honour of H.W. Fairman, Warmister 1979, p. 84; J.J. JANSSEN, A Draughtsman who became Scribe of theTomb: Harsh're, son of Amennakht!, dans ID. ! DEMARÉE #eds$, Gleanings from Deir el!Medîna, pp. 149!53;P.W. PESTMAN, The ‘Last Will of Naunakhte’ and the Accession Date of Ramesses V, ibidem, p. 174; B. MATHIEU! S. BICKEL, L’écrivain Amenakht et son enseignement, dans « BIFAO » 93 #1993$, p. 37 sq.; B.G. DAVIES, Whowas who at Deir el!Medina. A prosopographic Study of the Royal Workmen’s Community, « EU » 13, Leiden 1999,index; A. DORN, Die Lehre Amunnachts, dans « ZÄS » 131 #2004$, p. 40; DONKER VAN HEEL ! HARING,Writing in a Workmen’s Village, p. 40, n. 3.
340. À propos des archives de El!Lahoun, QUIRKE, Egyptian Literature, p. 27 observe: « Legally!bindingreports also share features of content with literary compositions ».
341. Pour le débat sur le statut des Aventures d’Ounamon, cf. SCHIPPER, Die Erzählung des Wenamun, pp. 28!40.
124
s’ouvre par une formulation conforme aux usages administratifs, une date étantsuivi de l’énoncé d’une action à l’aide d’une forme impersonnelle commel’infinitif. Mais immédiatement après voici que surgit la première personne.342
Par ailleurs, l’ensemble du texte est écrit dans une tachygraphie calligraphiée, engénéral peu attendu dans ce genre de documents.343 Très significativement pournotre propos, le statut de la composition a été longuement débattu. Que deségyptologues aussi éminents que E. Edel ou J. 'ern( aient défendu la thèsedésormais abandonnée du rapport authentique montrent combien une oeuvreconçue originellement comme littéraire #belles!lettres$ peut se draper dans leoripeaux d’un genre administratif.
72. Et, c’est dans la même perspective qu’il convient d’examiner le grandensemble écrit en démotique et dénommé la Pétition de Petisis.344 Nul ne sauraitnier qu’il « certainly has impressive literary characteristics ».345 Reste à détermi !ner s’il s’agit simplement d’un texte « littéraire » au sens faible / large, ou au sensfort / restreint. Sans entrer dans le long débat qu’a suscité la nature de cedocument, voici deux citations caractéristiques:
The initial stimulus for its composition may have been a wish to document thecircumstances of a particular dispute, perhaps for an immediate practical end, but itis hard not to feel that the writer was carried away by enthusiasm for his task, andthat the finished product has a good claim to literary status as many other texts.346
It is hard to tell whether the dramatic literary qualities #for instances the twohymns or songs inspired by Amon himself $ are intentional or whether the scribesjust got carried away by enthusiasm for his just cause.347
EDAL II . 2010 / 2011
342. BAINES, On Wenamun as a literary Text, pp. 210!11.343. WIMMER, Hieratische Paläographie der nicht!literarischen Ostraka, I, p. 10. On prendra bien garde, toutefois
à ne pas tomber dans la caricature. Certains documents administratifs peuvent être écrits dans unetachygraphie, sinon calligraphiée, à tout le moins non seulement soignée, mais même maniérée. C’estle cas des décrets qui utilisent une écriture de chancellerie, cf. ci!dessus § 24, n. 86.
344.En dernier lieu: HOFFMANN ! QUACK, Anthologie des demotischen Literatur, pp. 22!54 et 331!33.345. R. JASNOW, Remarks on Continuity in egyptian literary Tradition, dans E. TEETER ! J.A. LARSON, Gold of
Praise: Studies on Ancient Egypt in honor of Edward F. Wente, Chicago 1999, p. 202, n. 39.346.TAIT, Demotic Literature and egyptian Society, p. 303, n. 1.347. M. DEPAUW, A Companion to demotic Studies, « Papyrologica Bruxellensia » 28, Bruxelles 1997, p. 102.
125
D’autres l’ont rangé dans la zone grise des textes « An den Grenzen der Lite !ratur »,348 à la « blurred border between documentary and literary text ».349 LaPétition de Pétisis pourrait bien être une oeuvre conçue comme littéraire #sensfort / restreint$ par destination première, mais faisant fond sur le genre de laplainte, abondamment représenté dans une civilisation où la chicane était reine.On a même proposé des rapprochements avec des genres analogues mis enoeuvre dans l’Ancien Testament.350
La pratique judiciaire comme forme d’oeuvre l ittéraire « par destination première »
73. Dans la mesure où administratif et judiciaire sont entremêlés, je suisbien tenté d’évoquer en annexe une forme mise en oeuvre dans la littérature,mais assurément transposée de la pratique judiciaire. Cette forme c’est lacontroverse, formulée en égyptien comme le jugement entre X et Y. Quatreexemples illustrent son utilisation dans les belles!lettres.
· Une composition parodique, précédemmment évoquée #§ 63!65$,orchestre des mythes détournés de leur fonction originelle sous le titre:
[HAtj!a m] pA wp Hr Hna stX, %Commencement du& jugement entre Horus et Seth.351
· Une autre à fonds mythologique avait probablement un titre du mêmegenre, étant donné son contenu. Qui plus est, apparaît dans le fil du récit uneexpression qui, en substituant l’infinitif à l’impératif, pourrait être ce titre perdu:
« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
348. QUACK, Einführung in die altägyptischen Literaturgeschichtek, p. 162; V. WESSETSKY avait déjà présenté sur lesujet un travail au titre significatif An der Grenze von Literatur und Geschichte, dans ASSMANN ! FEUCHT !GRIESHAMMER #Hrsgg.$, Fragen an die altägyptieche Litératur. Studien zum Gedenken an Eberhad Otto, p. 499 sq.
349. JASNOW, Remarks on Continuity in egyptian literary Tradition.350. Pétition de Pétisis: D.B. REDFORD, Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times, Oxford 1992, p. 307, suggère
une comparaison avec le document de Histoire de la succession de David dans la Bible.351. Il faut donner raison à J.L. CHAPPAZ, Quelques réflexions sur les conteurs dans la littérature égyptienne ancienne,
p. 107, n. 8, qui proposait de restituer [HAtj!a m], contre BROZE, Mythe et roman en Egypte ancienne, p. 14,en effectuant un judicieux rapprochement avec le titre de la tablette de Turin. En revanche, wp, signifie« jugement », et non pas « fable ». Il s’agit de la transposition d’un terme judiciaire dans le mythe et lalittérature, et non d’une désignation d’un genre spécifiquement littéraire.
126
wp mAa.t Hna grg, jugez entre Vérité et Mensonge.352
· Une fable a pour titre
wp X.t Hna tp, juger entre le corps et la tête.353
· Une fable a pour titre
pA wp jrp jrm Hnq.t, juger entre le vin et la bière.354
L’expression wp(j) Hna est clairement judiciaire à l’origine, et est utilisée aveccette connotation dans les menaces d’un jugement intenté par le mort auprofanateur de la tombe; ainsi
jw(=j) (r) wp.t Hna=f,« je serai jugé avec lui ».355
Comme souvent, la thématique judiciaire a été transposée dans les croyancesfunéraires.356
EDAL II . 2010 / 2011
352. P. Chester Beatty II 10, 3 = LES, p. 35353. Tablette Turin 58004 ro 1; Procès de la tête et des jambes, bibliographie dans J. LOPEZ, Cuentos y fabulas del
Antiguo Egipto, Barcelona 2005, pp. 149!50.354. O. IFAO 10270 = P. GRANDET, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deir el!Médîneh, XI, Nos
10124!10275, « DFIFAO » 48, Le Caire 2010, p. 153 et 377 .355. E. EDEL, Untersuchungen zur Phraseologie der ägyptischen Inschriften des Alten Reiches, dans « MDAIK » 13
#1944$, p. 12. Cf. aussi S. MOSCHAUSER, Threat!Formulae in Ancient Egypt. A Study of the History, Structureand Use of Threats and Curses in Ancient Egypt, Baltimore 1991, p. 72; R. HANNIG, Ägyptisches Wörterbuch,I, Altes Reich und Erste Zwischenzeit, « Hannig!Lexica » 4, « Kulturgeschichte der Antiken Welt » 98,Mainz 2003, p. 332.
356. Comparer, entre autres, la forme de l’« ordre # / décret$ royal » #wD nsw$ transposé dans les Textes dessarcophages, en dernier lieu J. GEE, On the Practice of Sealing in the Book of the Dead and the Coffin Texts,dans « JSSEA » 35 #2008$, pp. 105!22.
127
Elle n’en est pas restée là. Sans être trop spéculatif, on a tout lieu decroire que le goût pour la chicane et les pratiques judiciaires du jugement entredeux parties ont inspiré à la littérature la forme de la controverse qu’elle autilisée de manière parodique, quitte même à recourir à la prosopopée. Nous laconnaissons explicitement désignée à travers un procès entre deux divinités#Horus et Seth$, entre deux personnifications #Vérité et Mensonge$ et à traversdes « disputes » entre des entités personnalisées, tête et corps, vin et bière.Cette forme textuelle a emprunté à la pratique judiciaire son intitulé: wp X Hna
#en néo!égyptien évolué jrm$ Y.
La lyrique religieuse comme forme d’oeuvre l ittéraire « par destination première »
74. On peut légitimement s’interroger sur le statut de l’Hymne à Hâpy.357
Texte liturgique détourné dans les belles!lettes? ou composition voulued’emblée oeuvre littéraire #sens fort / étroit$ par son auteur, en élisant dans cebut une forme bien établie de la lyrique religieuse? En tout cas son utilisation àfin didactique, et, dans cette fonction, son association étroite avec d’autrestextes « littéraires » est indiscutable. Qui plus est, nous sont parvenues d’autrescompositions traitant du même thème dans des contextes d’utilisationdidactique.358
Par ailleurs, le genre du chant de harpiste, lié à des cérémonies festives,et particulièrement exploité dans le domaine funéraire, a non seulement fournides oeuvres devenues « littéraires » par détournement ou transfiguration " com !me on l’a vu avec le chant de harpiste de la tombe d’Antef #§ 60$ " mais aussi,tardivement à tout le moins, il a été utilisé pour écrire des oeuvres littéraires pardestination première, comme le Harpiste dévoyé, satire en démotique.359
« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
357. LOPRIENO, Loyalty to the King, to God, to one self, p. 549; en dernier lieu D. VAN DER PLAS, communicationau Colloque « Dating Egyptian Literary Texts » : The case of the Hymn to the Inundation #Université deGöttingen 14!6!2010$.
358. Cf. O. DM 1105 et surtout O. DM 1675, étudié par H.!W. FISCHER!ELFERT, Literarische Ostraka derRamessidenzeit in Übersetzung, « KÄT », Wiesbaden 1986, pp. 29!62.
359. PH. COLLOMBERT, Le harpiste dévoyé, dans « Égypte Afrique Orient » 29 #2003$, pp. 29!40.
128
Enfin, la poésie amoureuse laisse transparaître l’emprunt à des formehymniques, qui relevaient peut!être à l’origine des liturgies religieuses.360
Parallèlement à la poésie amoureuse, la lyrique religieuse a pu fournir desformes à une hymnique passible de prolongement « littéraire », bien qu’elle ait pourinspiration « la piété personnelle ». On a repéré dans certains de ces hymnes destraces d’une phraséologie par ailleurs en oeuvre dans des chants d’amour.361 L’élogede la ville pourrait bien être un surgeon productivement « littéraire » de la piétépersonnelle, même son utilisation cérémonielle n’est pas exclue.362
Par ailleurs, la proclamation de la puissance d’une divinité a ététhématisée comme forme spécifique comme l’indique l’incipit formulaire HAtj!a
m sDd bAw, « commencement dans la relation de la puissance ».363 Elle peut êtredéveloppée en narration mythologique: le texte intitulé dans l’Égyptologie Lalégende des dieux contre la mer l’illustre de manière exemplaire. Toutefois, unraccord astucieux entre deux papyrus conservés dans des collections différentessuggère que son statut d’oeuvre littéraire « par destination première » est bienloin d’être avéré. On croirait plutôt que le texte prenait place originellementdans un ensemble cérémoniel.364 Si tant est que sa version manuscritetémoigne d’une destinée proprement littéraire, ce serait plutôt pardétournement ou transfiguration. Cela posé, en étant étendue du panégyriquede la divinité au panégyrique du pharaon, la forme sDd bAw, « relation de lapuissance », s’affran chit de ses conditions originelles d’utilisation et s’affirmecomme procédé de composition. Et d’autant plus que la geste royale en générals’est prêtée à des mises en oeuvre proprement littéraires.
EDAL II . 2010 / 2011
360. MATHIEU, La poésie amoureuse de l'Égypte ancienne, pp. 232!41; A. VON LIEVEN, Wein, Weib und Gesang (Rituale für die Gefährliche Göttin, dans C. METZNER!NEBELSICK #Hrsg.$, Rituale in der Vorgeschichte, Antikeund Gegenwart. Studien zur Vorderasiatischen, Prähistorischen und Klassischen Archäologie, Ägyptologie, AltenGeschichte, Theologie und Religionwissenschaft Interdisziplinäre Tägung vom 1.!2. Februar 2002 an der FreienUniversität Berlin, Berlin 2003, p. 51.
361. P. VERNUS, Le Cantique des cantiques et l'Égypte pharaonique, dans A.C. HAGEDORN #ed.$, Perspectives on theSongs of Songs, « Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentiche Wissenschaft » 346, Berlin ! New York,2005, pp. 150!62.
362. RAGAZZOLI, Éloge de la ville en Égypte ancienne, chapitre 3. 363. G. POSENER, La piété personnelle avant l’âge amarnien, dans « RdE » 27 #1975$, p. 201.364.COLLOMBERT ! COULON, Les dieux contre la mer, pp. 222!23.
129
La geste royale comme forme d’oeuvre l ittéraire« par destination première »
75. De même, des textes de l’idéologie royale où étaient mis en scène etcélébrés les exploits du pharaon et qui répondaient à la finalité ultime d’ajouterà une création inachevée les produits de l’histoire, à force d’être reçus dans lesbelles!lettres par détournement ou par transfiguration, comme on l’a vu avec lacampagne de Kamès, la bataille de Qadesh #§§ 55!59$, ont fini par donnernaissance à un genre littéraire spécifique servant de cadre à des oeuvreslittéraires par destination première. Ce genre, le récit épique a pour héros unroi ou un chef guerrier. Il est déjà illustré dès le Nouvel Empire avec La Querelled ’Apopi et de Seqenenrê, La prise de Joppé, et, peut!être, par une narration créée surle souvenir de la lutte contre les libyens et les peuples de la mer dans la BasseÉgypte occidentale.365
Le récit épique se développera amplement tardivement en démotiqueoù une très importante partie de la littérature narrative s’appuie sur desévénements « historiques » et met en scènes des pharaons ou des grandshommes.366
La sagesse comme forme d’oeuvre l ittéraire « par destination première »
76. On a vu que les sagesses avaient bonne propension à être détournées deleur finalité didactique originelle pour être promues au statut de belles!lettres,quitte, à être pour ainsi dire ré injectées ensuite, dans ces mêmes pratiquesdidactiques où elles étaient nées et desquelles elles s’étaient dégagées #cf. § 66$.
« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
365. P. Louvre N 3136: SPALINGER, The Transformation of an Ancient Egyptian Narrative, pp. 359!65, pl. I!III;MANASSA, The Great Inscription of Merneptah, pp. 123!33. Bien que l’état très lacunaire du papyrus troublele diagnostic, certains indices pourraient suggérer une narration proprement littéraire. Le plus notableest l’emploi de la première personne du pluriel pour représenter le point de vue égyptien. Pour uneattestation de cet emploi au Moyen Empire, cf. mny=n r kbny, « nous amarrer à Byblos », dans uncontexte fragmentaire #ALLEN, L’inscription historique de Khnumhotep à Dahschour, p. 20, fig. 3$; l’Enseigne !ment d ’un homme à son fils, Section VII " mais la datation au Moyen Empire est contestée; J.C. DARNELL,The Eleventh Dynasty Royal Inscription from Deir el!Ballas, dans « RdE » 59 #2008$, p. 83, n. 10. Cf. plusgénéralement H. GRAPOW, Wie die alten Agypter sich anredeten, wie sie sich grussten und wie sie miteinandersprachen, Berlin 1960, pp. 179!82.
366. RYHOLT, Egyptian Historical Literature from the Greco!Roman Period, pp. 231!38.
130
Leur forme spécifique, une série de préceptes énoncés en situationd’interlocution par une personne présentée comme pourvue d’auctoritas à uneautre présentée comme novice a!t!elle inspiré des oeuvres littéraires pardestination première? Ce n’est pas exclu. Font de bons candidats, entre autresl’Enseignement pour Mérykarê, et, plus particulièrement l’Enseignementd’Amménémès I. Peu d’oeuvres présentées formellement comme « enseignement »paraîssent marquer autant la distance entre leur cadre proclamé et leur finalitévéritable que cette composition, qui vise avant tout à dénoncer la noirceur dehumaine condition, dans la ligne des Mots de Khâkheperrêseneb ou des Lamen !tations d ’Ipouour.367
On observera en passant que ce n’est seulement pour informer desoeuvres littéraires par destination première que la sagesse a pu être utilisée horssa finalité didactique première. A l’occasion, certains « dominants » l’ont mobi !lisée aussi au service de leur propre présentation #ci!dessous § 78$.
Comment distinguer l ’oeuvre littéraire « par destination première » ?
77. A travers l’interrogation sur cette oeuvre, apparaît la question fonda !mentale: si oeuvres littéraires #sens fort / restreint$ par destination première etoeuvres littéraires #sens fort / restreint$ par transfiguration recourent auxmêmes formes comment distinguer celles!ci de celles!là? Le problème s’est poséde manière emblématique à propos des Aventures de Sinohé, où certains avaientproposé de voir une véritable autobiographie, que la postérité aurait reçue dansles belles!lettres, autrement dit, dans notre terminologie, une oeuvre littérairepar détournement ou transfiguration. Un aussi lucide connaisseur que G.Posener n’admettait qu’avec la plus extrême prudence qu’il pût s’agiroriginellement d’une fiction.368
EDAL II . 2010 / 2011
367. Argumentation en ces sens dans VERNUS, Sagesses, p. 233. 368. « On ne peut écarter la possibilité de considérer le texte comme une pure fiction » #POSENER, Littérature
et politique, p. 92$.
131
Pour faire le départ entre oeuvres littéraires par destination première etoeuvres littéraires par transfiguration, le critère de la réception n’estévidemment pas déterminant. Reste l’analyse interne, et, immanquablement,une démarche herméneutique " donc vulnérable à l’hypercriticisme " fondéesur une théorie implicite ou explicite de la littérature. Je me bornerai à signalerune tendance parfois relativement saillante, et qui dénonce l’oeuvre conçuecomme littéraire #sens fort / restreint$ au départ. C’est la tendance à développerde manière parfois exubérante un trait propre au genre choisi comme cadreprincipal de l’oeuvre. Un exemple très accessible. Nul ne contesterait qu’enrédigeant la Lettre de Hori, son auteur entendait apporter une contribution auxbelles!lettres. Cette perspective l’a conduit à développer avec luxuriancecertaines caractéristiques du genre épistolaire, lequel servait de cadre, à sacomposition; avec une luxuriance qui tourne à l’éxubérance. Ainsi la lettres’ouvre sur une très longue série de voeux à l’adresse du destinataire. Si de telsvoeux relèvent effectivement du genre épistolaire, ici leur surabondance " ilss’étendent sur trois colonnes du manuscrit principal ! 369 " et l’extrêmerichesse du répertoire mis en oeuvre excèdent manifestement et consciemmentce que laisserait attendre le standard du genre. Autrement dit, il y a un jeu surun des codes. D’où l’excellent commentaire de J. Assmann:370
Das ist natürlich reine Literatur. Gewiss hat niemand im Alten Ägypten so geredetund in einem echten Brief so geschrieben.
On pourrait faire un commentaire analogue sur la foisonnante accumulation detitres et d’épithètes dont s’affuble Amenémopé dans l’introduction de sonenseignement. Le genre implique que son « auteur » réel ou supposé, présentetoutes les garanties d’auctoritas pour donner le poids nécessaire à ces préceptes.Mais ici, l’acharnement à satisfaire cette exigence se donne si libre carrière quipourrait presque frôler la caricature. Ne serait!ce pas parce que l’enseignement
« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
369. P. Anastasi I, 2, 7!4, 5.370. ASSMANN, Verkünden und Verklären, pp. 325!26.
132
a été consciemment voulu comme littéraire, au sens fort / restreint, sans doutepar souci de mieux faire passer son contenu didactique?
De telles manipulations exubérantes des codes propres au genre élucomme cadre d’une oeuvre littéraire par destination se laissent percevoir au fildes analyses. Ainsi, à titre d’exemple cette fort pertinente analyse de l’imageriedéployée dans les Aventures de Sinouhé:
Sinuhe’s imagery shows that the narration deliberatetly diverges from theexpectations of its framing genre of a ‘true’ official account of a real life.371
D’une manière générale, on touche là ce que des théoriciens de la littérature ontappelé l’« excès mimétique »,372 ou encore les procédés « parodiques » impliquésdans le « palimpseste » #au sens de la création littéraire$.373
À un plus haut niveau de généralité, l’identification des oeuvres litté !raires « par destination première » utilisant une forme textuelle originellementnon « littéraire » relève du problème de la « littérarité », précédemment évoqué#cf. §§ 44!46$.
La boucle bouclée: le détournement de l ’oeuvre littérairedans des finalités non spécifiquement littéraires
78. Les relations entre célébration de l’élite et littérature sont complexes. Sil’autobiographie a fourni des formes à la littérature, inversement la littérature apu, par effet de retour, fournir des formes à l’autobiographie et au monumentcommémoratif dont elle est une composante. Ainsi, à partir de l’Enseignementloyaliste, fictivement attribué à Kairse, Séhetepibrê a composé une versionréduite qu’il a incluse sur sa stèle.374 De même, si le vizir Ouser a jugé bon de
EDAL II . 2010 / 2011
371. PARKINSON, Poetry and Culture, p. 280.372. Pour l’application à la littérature égyptienne, cf. MOERS, Fingierte Welten, p. 82.373. Cette notion a été proposée, avec référence à G. GENETTE, par L.D. MORENZ, dans sa communication
Warum bleibt Sinuhe sich immer so gleich?, à l’occasion du Colloque Sinuhe #Université de Leiden 27!29novembre 2009$.
374. G. POSENER, L’enseignement loyaliste. Sagesse égyptienne du Moyen Empire, « Centre de Recherches d’Histoireet de Philologie de la IVe Section de l’EPHE II Hautes Études Orientales » 5, Paris 1976, p. 3; LOPRIENO,
133
faire copier sur les murs de sa chapelle funéraire un enseignement censé luiavoir été énoncé par son père, le vizir Âmetch/Iahmès,375 c’est sans doute parceque la promotion de certaines sagesses dans le royaume des belles!lettres avaitconféré à cette forme un prestige propre à rejaillir sur celui qui l’actualisait surson monument. Quant au premier prophète d’Amon Amenemhat, il a donné àson autobiographie la forme de la sagesse en l’introduisant par le titre:
Commencement de l’enseignement qu’a fait N. Il dit en tant qu’enseignementauprès de ses enfants.376
Pourquoi avoir substitué à la formule d’introduction propre à l’autobiographiela formule propre à la sagesse? Sans doute celle!ci avait!elle été canonisée parl’élite en tant que mode d’expression impliquant intrinsèquement une auctoritasétablie, alors que celle!là n’était pas " ou n’était plus " nécessairement ainsiconnotée. C’était une manière de renforcer le poids de la parole autobio !graphique, depuis longtemps implicitement contestée,377 en lui apportant lesurcroît de prestige propre à la sagesse par l’adoption de ses marquesdistinctives, fussent!elles simplement phraséologiques.
Ainsi, la forme du récit anonyme est illustré par le conte du Naufragé, quicommence par Dd!jn Smsw jqr, « Ainsi parla un suivant compétent », et évoqueun « gouverneur » #HAti!a$, non moins anonyme qui s’apprête à faire rapport aupharaon de son expédition.
Peut!être est!ce cette forme que Khnoumhotep a voulu utiliser dans ledispositif monumental voué à sa propre célébration à Dahshour. Là, en effet, en
« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
Loyalty to the King, to God, to one self, p. 549. Tout est remis en question par la découverte d’un graffitoattribuant l’enseignement à Kairse, cf. le bel article de VERHOEVEN, Von der ,,Loyalistischen Lehre“ zur„Lehre des Kaïrsu“, pp. 87!98. Cf. encore tout récemment GNIRS, Zum Verhältnis von Literatur undGeschichte in der 18. Dynastie, pp. 51!56.
375. VERNUS, Sagesses, pp 59!62.376. Ibidem, p. 26, et ma communication Canonicity in pharaonic Egypt #Colloque Université de Copenhague
26!29 mai 2010$. Cf. aussi GNIRS, Zum Verhältnis von Literatur und Geschichte in der 18. Dynastie, pp. 33!36.J.!CH. THOMAZO, La maison et le temple, les stratégies familiales durant la première moitié de la XVIIIe dynastie#Thèse EPHE IVe Section Paris 21!1!2010$, p. 427, présente une intéressante suggestion selon laquelle lasubstitution du titre « père divin » au titre « prophète » viserait à renforcer le caractère littéraire del’autobiographie.
377. COULON, Véracité et rhétorique dans les autobiographies égyptiennes de la Première Période Intermédiaire, pp.109!38.
134
se désignant sous son seul titre et sans mentionner son nom, doncen contradiction apparente avec la logique même du dispositif, il raconte uneexpédition sur la côte syrienne.378 Toutefois, dans ce cas, il est possible qu’enfait, et l’oeuvre littéraire d’une part, et le récit du monument funéraire, d’autrepart, procèdent l’un comme l’autre d’une forme palatine.379 On peut imaginerune cérémonie où un diginitaire relatait devant le pharaon une expédition qu’ilavait dirigée. Cette relation solennelle exigeait qu’il se cloisonnât dansl’anonymat. Car, en raison de l’étiquette propre à la cérémonie, il lui fallaitprésenter ses activités en ces terres lointaines en tant qu’actualisations de lapuissance pharaonique, dont lui!même n’était qu’un simple instrument.Songeons à La prise de Joppe où il est dit: « Le bras puissant de Pharaon, Vie,Intégrité, Santé, s’empara de la ville ».
Selon l’interprétation littérale, le Pharaon aurait mené en personne laprise de la ville grâce à son « bras puissant ». En fait, comme l’indique plus loinle récit, loin de mener lui!même l’armée en campagne, il avait délégué sespouvoirs à son général Djehouty.
EDAL II . 2010 / 2011
378. ALLEN, L’inscription historique de Khnumhotep à Dahschour, pp. 30!31.379. Echo possible de ce genre de célébrations dans les formules à travers lequelles est affirmée l’application
de la volonté de Pharaon par un haut dignitaire palatin: cf. P. VERNUS, La stèle du pharaon mnTw!Htpi, dans« RdE » 40 #1989$, pp. 152!53.
135
Listes des ouvrages cités
AEO = A.H. GARDINER, Ancient Egyptian Onomastica, London 1947.G. ANDREU #éd.$, Les artistes de Pharaon. Deir el!Médineh et la Vallée des Rois, Paris
2002.J. ASSMANN, Ägyptische Hymnen und Gebete, Zürich ! München 1975.J. ASSMANN, Ägypten. Eine Sinngeschichte, Wien 1996.J. ASSMANN, Mort et Au!delà dans l’Égypte ancienne, Paris 2001.J. ASSMANN, La mémoire culturelle. Écriture, souvenir et imaginaire politique dans les
civilisations antiques, Paris 2010.J. ASSMANN ! A. ASSMANN ! C. HARDMEIER #Hrsgg.$, Schrift und Gedächtnis
Archäologie des literarischen Kommunikation, I, München 1983.J. ASSMANN ! E. BLUMENTHAL #Hrsgg.$, Literatur und Politik im pharaonischen und
ptolemäischen Ägypten, « BdE » 127, Le Caire 1999.J. ASSMANN ! E. FEUCHT ! R. GRIESHAMMER #Hrsgg.$, Fragen an die altägyptische
Litératur. Studien zum Gedenken an Eberhad Otto, Wiesbaden 1977.A. BAKIR, Egyptian Epistolography from the Eighteenth to the Twenty!First Dynasty,
« BdE » 48, Le Caire 1970.M. BARTA #ed.$, Abusir and Saqqara in the Year 2010 ( Proceedings of the Conference
held in Prague May 31!June 4, Prague 2011 #sous presse$.S. BICKEL ! A. LOPRIENO #eds$, Basel Egyptology Prize 1. Junior research in Egyptian
history, archaeology and philology, « AegHelv » 17, Basel 2003.S. BICKEL ! B. MATHIEU, D’un monde à l’autre. Textes des pyramides et Textes des
Sarcophages. Actes de la table ronde internationale Ifao 24!26 septembre 2001,« BdE » 139, Le Caire 2004.
M. BIERBRIER, Les bâtisseurs de pharaon. La confrérie de Deir el!Medineh, Paris 1986.P.A.A. BOESER, Beschreibung der Ägyptischen Sammlung des Niederländischen
Reichsmuseums der Altertümer in Leiden. Die Denkmäler des Neuen Reiches, I,Gräber, Den Hag 1911.
J. BORGHOUTS, Ancient Egyptian Magical Texts, Leiden 1978.B. VON BOTHMER ! J. ROMANO, Musée d ’art égyptien de Louxor, « BdE » 95, Le
Caire 1985.I. BRANCOLI ! E. CIAMPINI ! A. ROCCATI ! L. SIST #a cura di$, L’impero Ramesside.
Convegno internazionale in onore di Sergio Donadoni, « Vicino Oriente,Quaderno » 1, Roma 1997.
« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
136
A. BRESSON ! A.!M. COCULA ! CH. PÉBARTHE #éds$, L’écriture publique du pouvoir,« Ausonius Etudes » 10, Bordeaux 2005.
M. BROZE, Mythe et roman en Égypte ancienne. Les aventures d ’Horus et Seth dans lepapyrus Chester Beatty I, « OLP » 76, Leuven 1996.
H. BRUNNER ! R. KANNICHT ! K. SCHWAGER #Hrsgg.$, Wort und Bild. Symposiondes Fachbereichs Altertums! und Kulturwissenschaften zum 500 jährigenJubiläum der Eberhard!Karls!Universität Tübingen, Tübingen 1977.
B. BRUYÈRE, Fouilles de Deir el Médineh "1927#, « FIFAO » 5, Le Caire 1928.G. BURKARD, Überlegungen zur Form der ägyptischen Literatur Die Geschichte des
Schiffbrüchigen als literarisches Kunstwerk, « ÄAT » 22, Wiesbaden 1993.G. BURKARD ! A. GRIMM ! S. SCHOSKE ! A. VERBOVSEK #Hrsgg.$, Kon!Texte.
Akten des Symposions „Spurensuche ( Altägypten im Spiegel seiner Texte“,München, 2. bis 4. Mai 2003, « ÄAT » 60, Wiesbaden 2004.
G. BURKARD ! H.J. THISSEN, Einführung in die altägyptische Literaturgeschichte,« Einführungen und Quellentexte zur Ägyptologie » 1, Münster ! Hamburg! London 2003.
R.A. CAMINOS, Literary Fragments in the hieratic Script, Oxford 1956.M. CAMPAGNO, Una lectura de La contiendia entre Horus y Seth, « Coleccion Razon
Politica », Buenos Aires 2004.M. CAMPAGNO #ed.$, Parentesco, patronazgo y Estado en las sociedades antiguas,
« Estudios del Mediterraneo Antiguo * PEFSCEA » 5, Buenos Aires 2009.M. CANNATA ! C. ADAMS #eds$, Current Research in Egyptology. Proceedings of the
Seventh Annual Symposium which took place at the University of Oxford, April2006, Oxford 2007.
J. 'ERN), Paper and Book in Ancient Egypt, London 1952.J. 'ERN), A Community of Workmen at Thebes in the Ramesside Period, « BdE » 50,
Le Caire 20012.J. CERVELLO AUTUORI ! A.J. QUEVEDO ALVAREZ #eds$, Ir a buscar leña. Estudios
dedicados al Prof. Jesus Lopez, « Aula Aegyptiaca Studia » 2, Barcelona 2001.N. CHERPION ! J.!P. CORTEGGIANI, La tombe d ’Inherkhâouy "TT 359# à Deir el!
Médina, « MIFAO » 128, I!II, Le Caire 2010.A.M. CHRISTIN #éd.$, Ecritures II, Paris 1985.CLEM = R.A. CAMINOS, Late Egyptian Miscellanies, « Brown Egyptological Studies »
1, Oxford 1954.A. COMPAGNON, Le démon de la théorie: littérature et sens commun, Paris 1998.
EDAL II . 2010 / 2011
137
S. CURTO ! S. DONADONI ! A.M. DONADONI ROVERI ! B. ALBERTON #a cura di$,Sesto Congresso Internazionale di Egittologia. Atti, Torino 1992.
R.J. DANN #ed.$ Current Research in Egyptology. Proceedings of the Fifth AnnualSymposium which took place at the University of Durham, January 2004,Oxford 2006.
S.H. D’AURIA #ed.$, Servant of Mut. Studies in Honor of Richard A. Fazzini, Leiden !Boston 2008.
A. DAVID, Syntactic and Lexico!Semantic Aspects of the Legal Register in RamessideRoyal Decrees, « GOF » IV / 38, Wiesbaden 2006.
B.G. DAVIES, Who Was Who at Deir el!Medina. A Prosopographic Study of the RoyalWorkmen’s Community, « EU » 13, Leiden 1999.
J.!M. DEFAYS ! L. ROSIER ! FR. TILKIN #éds$, A qui appartient la ponctuation? Actesdu Colloque international et interdisciplinaire de Liège "13!15 mars 1997#, Paris!Bruxelles 1997.
R.J. DEMARÉE ! A. EGBERTS #eds$, Village Voices. Proceedings of the Symposium« Texts from Deir el!Medîna and their Interpretation », Leiden, May 31 !June 1,1991, Leiden 1992.
R.J. DEMARÉE ! A. EGBERTS #eds$, Deir el!Medina in the Third Millenium A.D.A Tribute to Jac. J. Janssen, « EU » 14, Leiden 2000.
R.J. DEMARÉE ! J.J. JANSSEN #eds$, Gleanings from Deir el!Medina, « EU » 1, Leiden1982.
M. DEPAUW, A Companion to Demotic Studies, « Papyrologica Bruxellensia » 28,Bruxelles 1997.
P. DER MANUELIAN #ed.$, Studies in Honor of William Kelly Simpson, I!II, Boston1996.
CH. DESROCHES NOBLECOURT, Ramsès II, Paris 2007.CH. DESROCHES NOBLECOURT ! S. DONADONI ! E. EDEL, Grand temple d ’Abou
Simbel. La bataille de Qadesh, « CEDAE Collection scientifique », Le Caire1971.
A.M. DONADONI ROVERI #ed.$, La scuola nell’antico Egitto "Museo Egizio di Torino#,Torino 1997.
K. DONKER VAN HELL ! B.J.J. HARING, Writing in a Workmen’s Village. ScribalPractice in Ramesside Deir el!Medina, « EU » 16, Leiden 2003.
A. DORN ! T. HOFFMANN #eds$, Living and Writing in Deir el!Medine. Socio!historicalEmbodiment of Deir el!Medine Texts, « AH » 19, Basel 2006.
« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
138
R. ENMARCH, The Dialogue of Ipuwer and the Lord of All, Oxford 2005.R. ENMARCH, A World upturned. Commentary and Analysis of the Dialogue of Ipuwer
and the Lord of All, Oxford 2008.A. ERMAN, Die ägyptischer Schülerhandschriften, « APAW » 2, Berlin 1925.CH. EYRE #ed.$, Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptologists
Cambridge, 3!9 September 1995, « OLP » 82, Leuven 1998.G. FECHT, Literarische Zeugnisse zur “Persönlichen Frömmigkeit” in Ägypten, « AHAW »
1965/1, Heidelberg 1965. O. FIRCHOW, Grundzüge der Stilistik in den altägyptischen Pyramidentexte.
Untersuchungen zur ägyptischen Stilistik, II, « Institut für Orientforschung,Veröffentlichung » 21, Berlin 1953.
H.!W. FISCHER!ELFERT, Die satirische Streitschrift des Papyrus Anastasi I. Ubersetzungund Kommentar, « ÄA » 44, Wiesbaden 1986.
H.!W. FISCHER!ELFERT, Literarische Ostraka der Ramessidenzeit in Übersetzung,« KÄT » 9, Wiesbaden 1986.
H.!W. FISCHER!ELFERT, Lesefunde in literarische Steinbruch on Deir el Medineh,« KÄT » 12, Wiesbaden 1997.
H.!W. FISCHER!ELFERT, Abseits von Ma’at Fallstudien zu Aussenseitern im AltenÄgypten, « WSA » 1, Würzburg 2005.
M. FITZENREITER #Hrsg.$, Das Ereignis Geschichtsschreibung zwischen Vorfall undBefund, « IBAES » 10, London 2009.
G.A. GABALLA, Narrative in Egyptian Art, Mainz 1976.L. GABOLDE #éd.$, Hommages à Jean!Claude Goyon offerts pour son 70ème anniversaire,
« BdE » 143, Le Caire 2008.J. GALLEGO ! C. GARCIA MAC GAW, Politica y religion en el mediterraneo antiguo:
Egipto, Grecia, Roma, « PEFSCE » 6, Buenos Aires 2008.A.H. GARDINER, The Library of A. Chester Beatty. Description of a hieratic Papyrus
with a mythological Story, Love Songs, and other Miscellaneous Texts, London1931.
A.H. GARDINER, The Kadesh Inscriptions of Ramesses II, Oxford 1960.A. GASSE, Catalogue des ostraca littéraires de Deir al!Médîna, IV, Nos 1676!1774,
« DFIFAO » 25, Le Caire 1990.A. GASSE, Catalogue des ostraca littéraires de Deir al!Médîna, V, Nos 1775!1873 et 1156,
« DFIFAO » 44, Le Caire 2005.
EDAL II . 2010 / 2011
139
A.M. GNIRS, Zum Verhältnis von Literatur und Geschichte in der 18. Dynastie, « AH »,Basel 2010 #sous presse$.
H. GOEDICKE #ed.$, Perspectives on the Battle of Kadesh, Baltimora 1985.H. GOEDICKE, Studies about Kamose and Ahmose, Baltimora 1995.R. GOZZOLI, The Writing of History in Ancient Egypt during the First Millenium BC
"CA 1070!180 BC#. Trends and Perspectives, « GHP Egyptology » 5, London2006.
P. GRANDET, Catalogue des ostraca hiératiques non littéraires de Deir el!Médîneh, XI,Nos 10124!10275, « DFIFAO » 48, Le Caire 2010.
H. GRAPOW, Sprachliche und schriftliche Formung ägyptischer Texte, « LÄS » 7,Leipzig 1936.
N. GRIMAL ! M. BAUD #éds$, Evénement, récit, histoire officielle. L’écriture de l’histoiredans les monarchies antiques, « Etudes d’Égyptologie » 3, Paris 2003.
N. GRIMAL ! A. KAMEL ! C. MAY!SHEIKHOLESLAMI #éds$, Hommages à FayzaHaikal, « BdE » 138, Le Caire 2003.
S.I. GROLL, Pharaonic Egypt. The Bible and Christianity, Jerusalem 1985.S.I. GROLL #ed.$, Studies in Egyptology Presented to Miriam Lichtheim, Jerusalem
1990.S. GRÜNERT ! I. HAFEMANN #Hrsgg.$, Textcorpus und Wörterbuch. Aspekte zur
ägyptischen Lexicographie, « PdÄ » 14, Leiden 1999.W. GUGLIELMI, Reden, Rufe und Lieder auf altägyptischen Darstellungen der Land !
wirtschaft Viehzucht, des Fisch! und Vogelfangs vom Mittleren Reich bis zurSpätzeit, « TÄB » 1, Bonn 1973.
A. GUILLAUMONT #éd.$, Hommages à François Daumas, Montpellier 1986.H. GUKSCH ! D. POLZ #Hrsgg.$, Stationen: Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens.
Rainer Stadelmann gewidmet, Mainz 1998.H.V. GUMBRECHT ! U. LINKER!HEEL #Hrsgg.$, Epochenschwellen und Epochen !
strukturen im Diskurs der Literatur! und Sprachhistorie, « S T W » 486,Frankfort 1985.
L. HABACHI, The Second Stela of Kamose and his Struggle against the Hyksos Ruler andhis Capital, « ADAIK » 8, Glückstadt 1972.
A.C. HAGEDORN #ed.$, Perspectives on the Songs of Songs, « Beihefte zur Zeitschriftfür die alttestamentiche Wissenschaft » 346, Berlin ! New York 2005.
R. HANNIG, Ägyptisches Wörterbuch, I, Altes Reich und Erste Zwischenzeit, «Hannig!Lexica » 4, « Kulturgeschichte der Antiken Welt » 98, Mainz 2003.
« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
140
S. HEINZ, Die Feldzugdarstellungen des Neuen Reiches. Eine Bildanalyse, « DÖAW » 17,Wien 2001.
J. HEISE, Erinnern und Gedenken. Aspekte der biographischen Inschriften derägyptischen Spätzeit, Fribourg ! Göttingen 2007.
W. HELCK, Altägyptische Aktenkunden des 3. und 2. Jahrtausend v. Chr., « MÄS » 31,München 1974.
W. HELCK, Historische!biographische Texte der 2. Zwischenzeit und neue Texte der 18.Dynastie, « KÄT », Wiesbaden 1975.
HO = J. 'ERN) ! A.H. GARDINER, Hieratic Ostraca, I, Oxford 1957.FR. HOFFMANN ! J. QUACK, Anthologie des demotischen Literatur, « Einführungen
und Quellentexte zur Ägyptologie » 4, Berlin 2007.E. HORNUNG, Einführung in die Ägyptologie Stand. Methoden. Aufgaben, Darmstadt
19934.HPBM Second Series = E.A. WALLLIS BUDGE, Facsimiles of Egyptian Hieratic Papyri
in the British Museum, Second Series, London 1923.HPBM Third Series = A.H. GARDINER, Hieratic Papyri in the British Museum, Third
Series: Chester Beatty Gift, I, London 1935.HPBM Fourth Series = I.E.S. EDWARDS, Hieratic Papyri in the British Museum, Fourth
Series: Oracular Amuletic Decrees of the Late New Kingdom, I, London 1960.J.H. JOHNSON #ed.$, Life in a Multi!Cultural Society. Egypt from Cambyses to
Constantine and Beyond, « SAOC » 51, Chicago 1992.D. KESSLER ! R. SCHULZ ! M. ULLMANN ! A. VERBOVSEK ! S. WIMMER #Hrsgg.$,
Texte ! Theben ! Tonfragmente: Festschrift für Günter Burkard, « ÄAT » 76,Wiesbaden 2009.
C. KNIGGE, Das Lob der Förschung. Die Entwicklung ägyptischer Sonnen! undSchöpfungshymne, nach dem Neuen Reich, « OBO » 219, Fribourg ! Göttingen2006.
Y. KOENIG, Le papyrus Boulaq VI. Transcription, traduction et commentaire, « BdE »87, Le Caire 1981.
Y. KOENIG, Magie et magiciens dans l’Égypte ancienne, Paris 1994.Y. KOENIG #éd.$, La magie en Égypte: à la recherche d ’une définition. Actes du colloque
organisé par le Musée du Louvre les 29 et 30 septembre 2000, Paris 2002.D. LABOURY, Akhénaton, « Les grands pharaons », Paris 2010.FR. LABRIQUE, Stylistique et théologie à Edfou, « OLA » 51, Leuven 1992.
EDAL II . 2010 / 2011
141
FR. LABRIQUE #éd.$, Religions méditerranéennes et orientales de l’Antiquité, « BdE »135, Le Caire 2002.
R. LAUFER #éd.$, Le texte et son inscription, Paris 1989.F. LAUTERBACH ! F. PAUL ! U!CH. SANDER, Abgrenzung !Eingrenzung Komparatische
Studien zur Dialektik kultureller Identitätsbildung, « AAWG. Phil.!Hist. Kl.3. Folge » 264, Göttingen 2004.
G. LEFEBVRE, Le tombeau de Pétosiris, I, Le Caire 1924.CH. LEITZ, Tägewählerei. Das Buch HAt nHH pH.wy Dt und verwandte Texte, « ÄA » 55,
Wiesbaden 1994.LEM = A.H. GARDINER, Late!Egyptian Miscellanies, « BAe » 7, Bruxelles 1937.K. LEMBKE ! M. MINAS!NERPEL ! N.S. PFEIFFER #eds$, Tradition and Transfor !
mation: Egypt under Roman Rule. Proceedings of the International Conference,Hildescheim, Roemer! and Pelizaeus Museum 3!6 July 2008, « Culture andHistory of the Ancient East » 41, Leiden ! Boston 2010.
LES = A.H. GARDINER, Late Egyptian Stories, « BAe » I, Bruxelles 1932.L.H. LESKO #ed.$, Pharaoh’s Workers, New York 1994.M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, I #The Old and Middle Kingdoms$, II
#The New Kingdom$, III #The Late Period$, Berkeley ! Los Angeles !London 1973, 1976, 1980.
S. LIPPERT ! M. SCHENTULEIT #Hrsgg.$, Tebtynis und Soknopaiu Nesos. Leben imrömerzeitliche Fajum, Wiesbaden 2005.
J. LOPEZ, Cuentos y fabulas del Antiguo Egipto, Barcelona 2005.A. LOPRIENO, Topos und Mimesis. Zum Ausländer in der ägyptischer Literatur, « ÄA »
48, Wiesbaden 1988.A. LOPRIENO #ed.$, Ancient Egyptian Literature. History and Forms, « PdÄ » 10,
Leiden ! New York ! Köln 1996.A. LOPRIENO, La pensée et l’écriture. Pour une analyse sémiotique de la cuture égyptienne,
Paris 2001.P. LUNDH, Actor and Event. Military Activity in Ancient Egyptian Narrative from
Thutmosis II to Merenptah, « USE » 2, Uppsala 2002.R. MAIRS ! A. STEVENSON #eds$, Current Research in Egyptology. Proceedings of the
Sixth Annual Symposium which took place at the University of Cambridge, 6!8January 2005, Oxford 2007.
C. MANASSA, The Great Inscription of Merneptah: Grand Strategy in the 13th CenturyBC, « YES » 5, New Haven 2003.
« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
142
H.!J. MARTIN ! J. VEZIN #éds$, Mise en page et mise en texte du livre manuscrit, Paris1990.
A.G. MCDOWELL, Hieratic Ostraca in the Hunterian Museum, Glasgow "The ColinCampbell Ostraca#, Oxford 1993.
C. METZNER!NEBELSICK #Hrsg.$, Rituale in der Vorgeschichte, Antike undGegenwart. Studien zur Vorderasiatischen, Prähistorischen und KlassischenArchäologie, Ägyptologie, Alten Geschichte, Theologie und ReligionwissenschaftInterdisziplinäre Tägung vom 1.!2. Februar 2002 an der Freien UniversitätBerlin, Berlin 2003.
F. MIOSI, A Reading Book of the Second Intermediate Period Texts, Toronto 1981.G. MOERS #ed.$, Definitely: Egyptian Literature, « LingAeg Studia Monographica »
2, Göttingen 1999.G. MOERS, Fingierte Welten in der ägyptischen Literatur des 2. Jahrtausends v. Chr.
Grenzüberschreitng, Reisemotiv und Fiktionalität, « PdÄ » 9, Leiden 2001.G. MOERS ! H. BEHLMER ! K. DEMUSS ! K. WIDMAIER #Hrsgg.$, jn.t Dr.w :
Festschrift für Friedrich Junge, Göttingen 2006.L.D. MORENZ, Beiträge zur Schriftlichkeitskultur im Mittleren Reich und in der 2.
Zwischenzeit, « ÄAT » 29, Wiesbaden 1996.L.D. MORENZ ! ST. SCHORCH #Hrsgg.$, Was ist ein text? Alttestamentliche,
ägyptologische und altorientalische Perspektiven, « Beihefte zur Zeitschriftfür die alttestamentliche Wissenschaft » 362, Berlin ! New York 2007.
S. MOSCHAUSER, Threat!Formulae in Ancient Egypt. A Study of the History, Structureand Use of Threats and Curses in Ancient Egypt, Baltimore 1991.
W. MURNANE, The Road to Qadesh. A historical Interpretation of the Battle Reliefs ofKing Sety I at Karnak, « SAOC » 42, Chicago 1990.
J. OSING, Das Grab des Nefersecheru in Zawyet Sultan, « AV » 88, Mayence 1992.J. OSING ! E. KOLDING NIELSEN #eds$, The Heritage of Egypt, Studies in Honour of
Erik Iversen, « CNI Publications » 13, Copenhague 1992.J. OSING ! G. ROSATI, Papiri geroglifici e ieratici da Tebtynis, Firenze 1998.R.B. PARKINSON, Voices from ancient Egypt, London 1991.R.B. PARKINSON, Poetry and Culture in Middle Kingdom Egypt. A Dark Side to
Perfection, London ! New York 2002.R.B. PARKINSON, Reading Ancient Egyptian Poetry among other histories, Oxford
2009.A.J. PEDEN, The Reign of Ramesses IV, Warminster 1994.
EDAL II . 2010 / 2011
143
K. PEUST #Hrsg.$, Miscellanea in honorem Wolfhart Westendorf, Göttingen 2008.R. PIRELLI #ed.$, Egyptological Essays on State and Society, « Studi e Ricerche su
Africa e Paesi Arabi. Serie egittologica » 2, Napoli 2002.W. PLEYTE, Papyrus de Turin. Facsimilés de F. Rossi de Turin, Leiden 1869!1876.L. POPKO, Untersuchungen zur Geschichtsschreibung der Ahmosiden! und Thutmosidenzeit,
« Kulturgeschichte Beiträge zur Ägyptologie » 2, Würzburg 2006.G. POSENER, Catalogue des ostraca hiératiques littéraires de Deir el Médineh,
« DFIFAO » 1, 18 , 20, Le Caire 1938, 1951, 1977!1980.G. POSENER, Littérature et politique dans l’Égypte de la XIIe dynastie, Paris 1956.G. POSENER, L’enseignement loyaliste. Sagesse égyptienne du Moyen Empire, « Centre
de Recherches d’Histoire et de Philologie de la IVe Section de l’EPHE IIHautes Études Orientales » 5, Paris 1976.
G. POSENER, Le papyrus Vandier, « BiGen » 7, Le Caire 1985.J. QUACK, Die Lehren des Ani. Ein neuägyptischer Weisheitstext in seinem kulturelle
Umfeld, « OBO » 141, Fribourg ! Göttingen 1994.J. QUACK, Einführung in die altägyptischen Literaturgeschichte, III, Die demotische und
gräco!ägyptisch Literatur, « Einführungen und Quellentexte zur Ägyptologie »3, Münster 2005.
ST. QUIRKE, The Administration of Egypt in the Late Middle Kingdom. The HieraticDocuments, New Malden 1990.
ST. QUIRKE #ed.$, Middle Kingdom Studies, New Malden 1991.ST. QUIRKE, Titles and Bureaux of Egypt 1850!1700 BC, « GHP Egyptology » 1,
London 2004.ST. QUIRKE, Egyptian Literature 1800 BC. Questions and Readings, « GHP Egyptology »
2, London 2004.RAD = A.H. GARDINER, Ramessid administrative Documents, London 1948.CHL. RAGAZZOLI, Éloge de la ville en Égypte ancienne. Histoire et Littérature, Paris
2008.D.B. REDFORD #ed.$, Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Oxford 2001.A. ROCCATI, La littérature historique sous l’Ancien Empire égyptien, Paris 1982.H. ROEDER #Hrsg.$, Die Erzählen in frühen Hochkulturen I. Der Fall Ägypten,
« Ägyptologie und Kulturwissenschaft » 1, München 2009.J. RUFFLE ! G.A. GABALLA ! K.A. KITCHEN #eds$, Glimpses of Ancient Egypt.
Studies in Honour of H.W. Fairman, Warmister 1979.
« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE
144
K. RYHOLT #ed.$, The Carlsberg Papyri 7: Hieratic Texts from the Collection, « CNIPublications » 30, Copenhague 2006.
K. SABRI KOLTA ! D. SCHWARZMANN!SCHAHAUSER, Die Heilkunde im AltenÄgypten. Magie und Ratio in der Krankheitsvorstellung und therapeutischenPraxis, « Studhoffs Archiv Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte » 42,Stuttgart 2000.
B. SCHAD, Die Entdeckung des Briefes als literarisches Ausdruckmittel in derRamessidenzeit, Hamburg 2006.
M. SCHADE!BUSCH #Hrsg.$, Wege öffnen Fs. R. Gundlach, Wiesbaden 1996.L.H. SCHIFFMAN #ed.$, Semitic Papyrology in Context: A Climate of Creativity. Papers
from a New York Conference marking the retirement of Baruch A. Levine,« Culture and History of the Ancient Near East » 14, Leiden 2003.
B.U. SCHIPPER, Die Erzählung des Wenamun. Ein Literaturwerk im Spannungsfeldvon Politik, Geschichte und Religion, « OBO » 209, Fribourg ! Göttingen2005.
T. SCHNEIDER ! K. SZPAKOWSKA #eds$, Egyptian Stories. A British EgyptologicalTribute to Alan B. Lloyd on the Occasion of his Retirement, « AOAT » 347,Münster 2007.
S. SCHOTT, Bücher und Bibliotheken im Alten Ägypten: Verzeichnis der Buch! undSpruchtitel und der Termini technici, Wiesbaden 1990.
G. SCHWARTZ ! J. COOPER, #eds$, The Study of the Ancient Near East in the Twenty!First Century. The William Foxwell Albright Memorial Volume, Winona Lake1996.
W.K. SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, New Haven ! London 1972.W.K. SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, Cairo 2003.A.J. SPALINGER, Aspects of the military documents of the Ancient Egyptians, « Yale
Near Eastern Researches » 9, New Haven ! London 1982.A.J. SPALINGER, The Transformation of an Ancient Egyptian Narrative: P. Sallier III
and the Battle of Kadesh, « GÖF » IV / 40, Wiesbaden 2002.B. SPULER #Hrsg.$, Der Nahe und der Mittlere Osten, I #Ägyptologie$ et II #Literatur$,
« HdO » 1, Leiden 1952.D. SWEENEY, Correspondance and Dialogue. Pragmatic Factors in Late Ramesside
Letter!Writing, « ÄAT » 49, Wiesbaden 2001.N. TACKE, Verspunkte als Gliederungsmittel in ramessidischen Schülerhandschrifter,
« SAGA » 22, Heidelberg 2001.
EDAL II . 2010 / 2011
145
D. TOPMANN, Die « Abscheu » !Sprüche der altägyptischen Sargtexte. Untersuchungenzu Textemen und Dialogstrukturen, « GÖF » IV / 39, Göttingen 2001.
U. VERHOEVEN ! E. GRAEFE #Hrsgg.$, Religion und Philosophie im Alten Ägypten.Festgabe für Philippe Derchain zu seinem 65. Geburtstag am 24. Juli 1991,« OLA » 29, Leuven 1991.
P. VERNUS, Future at Issue. Tense, Mood and Aspect in Middle Egyptian: Studies inSyntax and Semantics, « YES » 4, New Haven 1990.
P. VERNUS, Affaires et scandales sous les Ramsès, « Bibliothèque de l’Égypte ancienne »,Paris 1993.
P. VERNUS, Essai sur la conscience de l ’Histoire dans l ’Égypte pharaonique,« Bibliothèque de l’École des Hautes Etudes Sciences historiques etphilologiques » 132, Paris 1995.
P. VERNUS, Dictionnaire amoureux de l’Égypte pharaonique, Paris 2009.P. VERNUS, Sagesses de l’Égypte pharaonique, Arles 20102.P. VERNUS ! J. YOYOTTE, Le Bestiaire des pharaons, Paris 2005.T. VON DER WAY, Die Textüberlieferung Rameses’ II zur Qades!Schlacht, « HÄB » 20,
Hildesheim 1984.G. WIDMER ! D. DEVAUCHELLE #éds$, Actes du IXe Congrès International des Études
démotiques, « BdE » 147, Le Caire 2009.D. WILDUNG, Imhotep und Amenhotep: Gottwerdung im alten Ägypten, « MÄS » 36,
München ! Berlin 1977.H. WILLEMS #ed.$, The World of the Coffin Texts. Proceedings of the Symposium Held
on the Occasion ot the 100th Birthday of Adriann de Buck, Leiden, December 17!19, 1992, « EU » 9, Leiden 1996.
ST. WIMMER, Hieratische Paläographie der nicht!literarischen Ostraka der 19. und 20.Dynastie, I, « ÄAT » 28, Wiesbaden 1995.
J. WINAND, Études de néo!égyptien, I, La morphologie verbale, « Aegyptiaca Leodensia »2, Liège 1992.
« LITTÉRATURE », « LITTÉRAIRE » ET SUPPORTS D’ÉCRITURE