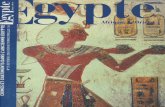« L’enfant et la huppe dans l’Égypte antique », Archéologia 531, pp. 30-35.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of « L’enfant et la huppe dans l’Égypte antique », Archéologia 531, pp. 30-35.
31
Égypte
L’enfant et la huppe
Plus que tout autre oiseau, la huppe (Upupa Epops) est étroitement associée à l’enfant sur les peintures et les reliefs des mastabas * de l’Ancien Empire (2700 à 2200 avant J.-C.). Certains égyptologues l’ont alors cataloguée comme animal apprivoisé avec lequel les plus jeunes s’amusent. Mais ce rapprochement entre la huppe et l’enfant, en particulier de sexe masculin, va bien au-delà de la simple expression d’un lien affectif. La preuve en images. AMANDINE MARSHALL
dans l’Égypte antique
Dans un article de 1931 consacré à l’oiseau, l’égyptologue Ludwig Keimer explique que la huppe est « une espèce de jeu d’enfants, fait sur lequel ont déjà insisté plusieurs savants. D’ailleurs, on m’a confi rmé à plusieurs reprises que les enfants des fellahs dans les villages égyp-tiens s’amusent souvent avec une huppe captive. » De cette idée d’enfants jouant avec des huppes a ensuite découlé l’hy-pothèse que les volatiles étaient des oiseaux de compagnie, particulièrement
prisés par les plus jeunes. Or L. Keimer n’indique jamais rien de tel : il rapporte simplement l’anecdote d’enfants s’amu-sant avec une huppe captive. Captive, non apprivoisée. En outre, l’association iconographique entre l’enfant et la huppe n’est en vigueur que pendant l’Ancien Empire, et sur une période limitée d’envi-ron 350 ans (de 2550 à 2200 avant J.-C.). Cette courte tranche chronologique semble donc aller à l’encontre d’une hypothèse faisant, de toute éternité, des
huppes les oiseaux de compagnie préfé-rés des enfants égyptiens. Il est temps, aujourd’hui, de reconnaître que peu d’éléments probants étayent la théorie d’une amitié entre l’enfant et l’oiseau.
QUESTIONNER LES HYPOTHÈSES TRADITIONNELLESSur 44 scènes présentes sur les parois de 27 mastabas (dont 25 situés en Basse-Égypte), on distingue 44 petits garçons et 2 fi llettes tenant une huppe
CI-CONTRE Huppe se promenant parmi les vestiges archéologiques. © A. Marshall
PAGE DE GAUCHE L’iconographie égyptienne montre l’oiseau tenu au niveau des ailes par l’enfant. Mastaba de Niânkhkhnoum et Khnoumhotep à Saqqarah. © A. Marshall
* Un mastaba est une tombe qui accueillit les pre-miers rois égyptiens avant d’être communément adopté par la noblesse à l’Ancien Empire.
32
L’ENFANT ET LA HUPPE
par les ailes. À titre de comparaison, pendant la même période et sur le même support iconographique, on ne rencense que 36 enfants portant une, deux ou trois volailles par les ailes – ou plus rarement par le cou et exceptionnellement par les pattes –, et 29 autres ont un oiseau, dont l’es-pèce est impossible à déterminer en raison de l’état de conservation de la scène. De toute évidence, la huppe fait partie des volatiles les plus fré-quemment associés aux enfants – et ce alors qu’aucun adulte n’est jamais fi guré avec cet oiseau. L’enfant et la huppe sont associés dans cinq cas précis : les scènes d’offrandes, les scènes de chasse et de pêche, les scènes d’inspection par le défunt et les scènes d’évocation familiale (où le jeune sujet est montré seul ou avec son père, et éventuellement avec d’autres membres de sa fratrie). S’il paraît légitime de voir des enfants tenir une huppe dans le cadre de scènes de chasse et de pêche dans les marais, ou à l’occasion d’offrandes faites au défunt, en revanche, « l’enfant à la huppe » dans un contexte de simple fi guration ou dans un cadre familial (dans 29 cas sur 46) n’a, de prime abord, aucune jus-tifi cation. Il faut donc en déduire que la huppe n’est pas considérée de la même manière que les autres oiseaux et qu’elle entretient avec l’enfant un rapport plus complexe. Si l’on se penche maintenant sur l’atti-tude des petits Égyptiens vis-à-vis des huppes, on se rend compte qu’elle est extrêmement codifi ée : d’une main, les enfants tiennent la huppe et de l’autre, ils tiennent le bâton de l’homme placé devant ou derrière eux (dans 18 cas), une fl eur (dans 9 cas), un ou plusieurs oiseaux (dans 6 cas) ou une arme (dans 2 cas) ; ils touchent la cuisse ou le bras de l’adulte (dans 4 cas) ; ils portent l’index à la bouche (dans 2 cas) ; ou ils abaissent simple-ment le bras opposé (dans 5 cas). Aucune de ces sept gestuelles ne tra-duit le moindre signe d’affection vis-à-vis de l’oiseau.
CI-CONTRE Mastaba de Mererouka à Saqqarah. © A. Marshall
À DROITE Mastaba de Niânkhkhnoum et Khnoumhotep à Saqqarah. © A. Marshall
34
QUI SONT CES ENFANTS À LA HUPPE�?Considérons l’identité des enfants qui tiennent une huppe par les ailes. Il s’agit toujours du fi ls ou de la fi lle du défunt, une reconnaissance induite par le contexte et éventuellement confi rmée par la dési-gnation fi liale sa ef (son fi ls) ou sat ef (sa fi lle). Ce résultat n’est pas vraiment éton-nant, étant donné qu’au cours de l’An-cien Empire, les enfants fi gurés sur les parois des tombes sont essentiellement ceux du défunt. Mais qu’un enfant avec une huppe soit, dans la plupart des cas,
désigné par son nom et par sa fi liation, est un fait qui mérite d’être signalé car il est loin de s’inscrire dans la norme. En effet, de manière générale, les garçons représentés sur les parois des tombes de l’Ancien Empire ne sont connus ni par leur nom ni par leur fi liation. Certes, l’échantillonnage restreint contraint à une certaine prudence, mais il est mani-feste qu’il y a eu une volonté particulière de mettre en avant l’identité et le statut familial des enfants tenant une huppe. Si l’on s’intéresse à la proportion d’enfants désignés comme sa ef semessou (son fi ls
aîné), on constate que 11 garçons sont ainsi désignés. La proportion pourrait paraître faible pourtant elle est loin de l’être. En effet, 148 garçons ayant reçu une désignation fi liale ont été recen-sés sur les parois des mastabas. Seuls 48 d’entre eux sont qualifi és de semes-sou (aîné) ; et sur ces 48, 11 tiennent en main une huppe, soit près d’un enfant sur quatre. L’association enfant/huppe est donc particulièrement privilégiée chez les aînés de sexe masculin. Un dernier point participe, lui aussi, de la mise en valeur de l’enfant à la huppe. Il s’exprime cette fois dans le port de parure. Alors que l’absence de bijou caractérise largement les enfants des tombes de l’Ancien Empire, le phéno-mène inverse s’observe chez ceux qui sont associés à la huppe… Il est peu pro-bable que ce fait soit une simple coïn-cidence. Indéniablement, le thème de la huppe entre les mains d’un enfant a revêtu, au cours de l’Ancien Empire, une symbolique toute particulière.
UNE HUPPE HAUTEMENT SYMBOLIQUEL’égyptologue Nadine Cherpion réfute également l’idée de la huppe comme simple compagne de jeu d’enfants ; elle propose de voir dans cet oiseau la mise en valeur de l’identité sexuelle des jeunes garçons. Cette idée tient diffi -cilement dans la mesure où le sexe des enfants est visible dans 45 cas sur 46 et où, dans la plupart des exemples, ils sont défi nis par leur nom et/ou par une dési-gnation fi liale. En revanche, la mise en valeur de la virilité de l’enfant, en tant que signe de puissance, paraît plus jus-tifi ée, surtout dans le cadre où l’enfant est désigné comme le successeur du chef de famille. Plusieurs éléments conduisent à cette hypothèse. Premièrement, l’asso ciation enfant/huppe concerne presqu’exclusivement des individus de sexe masculin ; or l’organisation du culte funéraire, ainsi que la charge d’entre tenir ses parents, revenaient aux garçons de la famille et principalement à l’aîné. Le cas exceptionnel des deux fi lles (ou d’une même fi llette fi gurée à deux reprises) peut s’expliquer par le fait qu’elles se trouvent sur les parois du mastaba de la
CI-CONTRE Mastaba d’Akhethetep à Saqqarah. © A. Marshall
35
L’ENFANT ET LA HUPPE
reine Meresânkh III à Gizeh, seul cas de tombe érigée pour une femme dans le cadre de cette étude. Deuxièmement, la désignation expresse du garçon en tant que fi ls aîné est également importante dans les scènes où l’enfant tient une huppe. Et cette proportion devait être plus considérable encore puisque le titre d’aînesse n’était pas systématiquement associé à toutes les représentations de l’aîné. Troisièmement, presque la moitié des petits garçons soulevant une huppe par les ailes tiennent, dans leur autre main, la canne de leur père. Ce motif iconogra-phique classique exprime la future trans-mission de charge du père envers son fi ls aîné. L’oiseau viendrait donc ici renforcer cette idée de passation de pouvoir. Par ailleurs, la forme égyptienne la plus ancienne du nom de l’oiseau semble avoir été djeba(ou) qui signifi e « l’orné » ou « le couronné ». La ressemblance entre l’ai-grette de l’oiseau et la coiffe royale a peut-être orienté ce choix. Le fait que, dans la moitié des cas, le fi ls aîné du défunt, donc son héritier, ait tenu en main un oiseau dont le nom évoque l’image du roi à travers sa couronne, ne peut être tenu pour une coïn-cidence. Enfi n, Élien et Horapollon, deux auteurs de l’époque romaine, mentionnent le fait que la huppe était considérée par les Égyptiens comme l’emblème de la piété fi liale. Le premier indique : « Les Égyptiens vénèrent les huppes […] parce qu’elles font preuve de piété fi liale envers leurs parents. » Et le second note : « Quand ils veulent écrire la gratitude, ils peignent une huppe. Car c’est le seul des êtres privés de parole qui, ayant été soigné par ses parents, leur rend le même service quand ils sont devenus vieux. » S’il convient d’être prudent avec ces deux témoignages tar-difs que plus de deux millénaires séparent des représentations d’enfants tenant des huppes à l’Ancien Empire, le symbolisme de l’oiseau en tant qu’emblème de piété fi liale ne relève pas, une fois de plus, de la simple coïncidence. Il paraît évident qu’un lien existe entre les deux. Si les deux auteurs tentent de l’établir avec une expli-cation peu crédible – et qui n’est pas rap-portée par les ornithologues –, c’est très probablement parce qu’à leur époque, l’origine première de la symbolique de la huppe s’est perdue.
UN RÉBUS EN IMAGESAinsi, loin d’être une simple évocation attendrissante de la vie quotidienne, l’image de l’enfant tenant une huppe est l’expression manifeste de codes icono-graphiques traduisant un symbole puis-sant lié à la succession. La huppe, à l’ins-tar du bâton évoquant la transmission de la charge familiale, est tenue fermement en main par celui qu’elle désigne impli-citement comme le successeur du père. L’image ne s’arrête pas là : l’héritier, le « couronné », doit être au centre de l’attention – après le défunt bien sûr. À cette fi n, les artisans le parent de bijoux plus qu’à l’accoutumée, inscrivent soi-gneusement son nom, soulignent par écrit qu’il est le fi ls du défunt, précisent dans certains cas qu’il est l’aîné et le montrent dans des scènes où il a l’hon-neur d’apparaître seul, ou fi guré comme le compagnon unique, sinon privilégié, du père. Pourquoi le choix d’une huppe ? Ce vola-tile n’a certainement pas été plébiscité par hasard. Sa huppe naturelle forme une véritable couronne de plumes sur sa tête, et c’est très certainement cette caractéristique qui a conduit les Égyptiens à lui donner un nom synonyme de « couronné ». Cette touffe colorée
permet d’identifi er l’oiseau au premier coup d’œil. Ainsi donc, l’observateur antique comprenait de suite le sens du rébus imagé, placé sous ses yeux. L’association de la huppe et de l’en-fant se rencontre principalement sur les parois de mastabas du nord du pays et sur une période limitée de l’Ancien Empire, allant du début de la IVe dynas-tie (vers 2550 avant J.-C.) au milieu de la VIe dynastie (vers 2200 avant J.-C.). Ensuite, pour une raison encore indéter-minée, elle disparaît des programmes iconographiques de ces demeures d’éter nité, tout comme l’imagerie de l’enfant tenant le bâton de son père…
Amandine Marshall, docteur en égyptologie, archéologue, chercheur associé à la MAFTO (Mission archéologique française de Thèbes Ouest), auteur de Être un enfant en Égypte ancienne, Auguste Mariette et Les momies
égyptiennes (avec R. Lichtenberg)
SUR LE MÊME SUJETKEIMER L., 1931, « Quelques remarques sur la huppe (Upupa Epops) dans l’Égypte ancienne », in Bulletin de l’Institut français d’ar-chéologie orientale 30, Le Caire, p. 305-331ÉLIEN, La personnalité des animaux, livre X, chap. 16.HORAPOLLION NILIACUS, Hieroglyphica, livre I, chap. 155.
CI-CONTRE Mastaba d’Hermerou à Saqqarah. © A. Marshall