La ville démobilisée. Ordre urbain et fabrique de la ville au Caire avant et après 1517,...
Transcript of La ville démobilisée. Ordre urbain et fabrique de la ville au Caire avant et après 1517,...
La ville démobilisée 269
LA VILLE DÉMOBILISÉE : ORDRE URBAIN ET FABRIQUE DE LA VILLE AU CAIRE AVANT ET APRÈS 1517
Julien Loiseau
L’entrée du sultan Selīm dans la capitale égyptienne, en janvier 1517, est l’une des péripéties majeures de la conquête ottomane de l’Égypte. Le Caire entrait alors, pour près de trois siècles, dans le trésor de la Maison d’‘Osmān dont il devait être l’un des joyaux, bien plus encore que Bagdad prise dix-sept ans plus tard. C’est que la capitale égyptienne était devenue, sous le règne des sultans mamelouks (1250-1517), le refuge de l’islam sunnite et la métropole de ses savants, et qu’elle offfrait à celui qui s’en rendait maître la suzeraineté sur les lieux saints du Hedjaz et le titre convoité de Serviteur des sanctuaires de La Mecque et de Médine. La prise du Caire par le sultan Selīm a fait de l’entrée des troupes ottomanes dans la vallée du Nil un véritable événement et donné sa portée immédiate à la conquête de l’Égypte. Il est moins évident, en revanche, que ce changement brutal dans la domination politique ait afffecté aussi profondément la trajectoire propre de l’histoire de la ville, ni même que le passage de l’ordre mamelouk à l’ordre ottoman ait radicalement transformé les formes urbaines de la domination politique – l’ordre urbain qui jusque-là avait façonné la ville1.
Mais y a-t-il seulement un sens à évaluer l’impact d’un événement sur une ville dont la masse et la densité historique sont telles qu’elle pourrait bien avoir à peine frémi sous le choc ? En 1549 paraissait chez l’éditeur vénitien Matheo Pagano une carte du Caire, dont aucun élément n’est semble-t-il postérieur à l’année 1517, ni dans le dessin de la ville dressé au plus tard à la toute fijin du xve siècle, ni dans la légende de la carte et sa notice qui font un large usage du manuscrit de Jean-Léon l’Africain, présent au Caire l’année même de la conquête ottomane2. Sur la carte, seuls quelques espaces historiés rappellent l’événement : l’artillerie du sultan mamelouk al-Ašraf Ṭūmānbāy disposée au nord de la ville (fijig. 1) et l’armée de Selīm contournant la Citadelle par le Désert (fijig. 2). Ainsi, trois décen-nies après la conquête ottomane, rien ne semble avoir changé au Caire, du
1 On prendra la mesure de cette transition dans l’histoire égyptienne à la lecture du livre important de D. Behrens-Abouseif, 1994.
2 J.-Cl. Garcin, 1981.
Lellouch_Book 1.indb 269Lellouch_Book 1.indb 269 18-4-2012 11:34:5318-4-2012 11:34:53
Julien Loiseau270
moins dans l’image assez précise que s’en forme le public vénitien. L’auteur de la notice qui accompagne la publication de la carte en 1549 compare Le Caire à Mexico, Paris, Venise, Pékin et à la plus grande de toutes, Hang-zhou : dans cette énumération des plus grandes villes du monde, Istanbul est absente3. À l’heure même où triomphent le sultan Soliman et l’archi-tecture impériale de Sinān, Le Caire semble encore capitale.
Aussi la tentation est forte de privilégier la continuité dans l’histoire de la capitale égyptienne. Le Caire est une très grande ville en 1517 : 270 000 habitants, si l’on veut bien se fijier au dénombrement de feux livré par Jean-Léon l’Africain4. Le Caire reste une très grande ville sous la domination ottomane : 260 000 habitants en 1798 d’après la Description de l’Égypte5. Mais les grands agrégats ne disent pas tout. La conquête ottomane n’en marque pas moins une cassure majeure dans la destinée de la ville, pour avoir mis un terme défijinitif à une histoire impériale inaugurée en 969 par
3 P. Boucheron et J. Loiseau, 2009, p. 674-676.4 J.-Cl. Garcin, 2000, p. 208-213.5 E.-F. Jomard, 1821-1829, p. 363-365.
Fig. 1. L’artillerie mamelouke disposée au nord de la ville. Détail de la carte du Caire publiée chez Matheo Pagano (Venise, 1549), Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin.
Fig. 2. L’armée ottomane contournant la Citadelle par le Désert. Détail de la carte du Caire publiée chez Matheo Pagano (Venise, 1549), Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin.
Lellouch_Book 1.indb 270Lellouch_Book 1.indb 270 18-4-2012 11:34:5318-4-2012 11:34:53
La ville démobilisée 271
la fondation de la cité fatimide. Une histoire certes interrompue par la prééminence de Damas et de la Syrie sous les Ayyoubides, mais restaurée par les premiers sultans mamelouks et singulièrement par al-Manṣūr Qalāwūn (1280-1290) qui y ancrait le règne des esclaves soldats. Une histoire impériale qui vient se clore en 1517, non pas tant avec l’entrée des troupes ottomanes, mais, huit mois plus tard, avec le départ du sultan Selīm quit-tant Le Caire pour Istanbul, reléguant défijinitivement en province la capi-tale égyptienne6.
Paysage de guerre, paysage de ruine
La prise du Caire en janvier 1517 est un événement sans réel précédent dans son histoire. La ville avait bien essuyé un siège, en mai 1389, quand des émirs rebelles au sultan al-Ẓāhir Barqūq, venus de Syrie, s’étaient emparés de la capitale. On s’était beaucoup battu au nord de la ville, dans les collines de décombres du faubourg d’al-Ḥusayniyya, ainsi qu’aux abords de la Citadelle atteints depuis le Désert ; nombre de belles demeures appartenant à des émirs en fuite avaient été pillées par les assaillants et les habitants profijitant du désordre7. Mais jamais les quartiers de résidence aristocra-tique, entre le grand Canal (al-Ḫalīǧ) et la Citadelle, le long de la Ṣalība, n’avaient connu les combats acharnés qui y sont livrés dans les derniers jours de janvier 1517, suite à la contre-attaque du sultan Ṭūmānbāy8. Au xve siècle, c’était aux portes de la Citadelle que les factions mameloukes s’afffrontaient : seules, ou presque, les Écuries du sultan et la grande madrasa d’al-Nāṣir Ḥasan, forteresse improvisée située juste en face, en subissaient les conséquences9. Le Caire, ville ouverte, n’a donc pas en janvier 1517 de véritable mémoire de guerre.
Sans doute les destructions alors occasionnées par les combats ne sont-elles pas très étendues. On sait que, pour des raisons mal élucidées, les
6 C’est bien ce dont s’indignait alors le chroniqueur Ibn Iyās (1448-1524). Ibn Iyās, éd. M. Muṣṭafā, 1982-1984, V, p. 206-207 / trad. G. Wiet, 1945-1960, II, p. 196-197.
7 Ibn al-Furāt, 1938, IX, p. 72-93.8 Ibn Iyās, éd., 1982-1984, V, p. 153-155 / trad., 1945-1960, II, p. 147-149.9 Ainsi, parmi d’autres circonstances, lors des combats qui émaillèrent l’avènement
d’al-Ẓāhir Ǧaqmaq en 1438 : le danger que représentaient les hauts minarets de la madrasa d’al-Nāṣir Ḥasan pour les défenseurs de la Citadelle était si pressant que l’on décida, avec l’approbation des autorités judiciaires, d’en démolir les escaliers – mesure prise déjà un demi-siècle plus tôt par al-Ẓāhir Barqūq. Ibn Taġrī Birdī, éd. W. Popper, 1909-1936, VII, p. 49 / trad. W. Popper, 1954-1963, XIX, p. 36 / éd. Dār al-Kutub, 1963-1972, XV, p. 273.
Lellouch_Book 1.indb 271Lellouch_Book 1.indb 271 18-4-2012 11:34:5418-4-2012 11:34:54
Julien Loiseau272
troupes de Selīm profanèrent le sanctuaire de Sayyida Nafīsa10. On sait aussi que la mosquée de Šayḫū, devenue le quartier général de Ṭūmānbāy, fut incendiée, ainsi que les demeures alentour. L’importance des dégâts matériels importe peu, cependant, devant le nombre efffrayant des morts. Le massacre, aux yeux d’Ibn Iyās, n’a que deux précédents : la dévastation de l’Égypte par le Babylonien Nabuchodonosor et la ruine de Bagdad par le Mongol Hülegü11. Le parti pris anti-ottoman du chroniqueur de la conquête est bien connu. Mais l’évocation de la prise de Bagdad en 1258, aussi excessive soit-elle, suggère à elle seule la brutalité politique de l’évé-nement tel que ses contemporains l’ont vécu et donne toute la mesure de la déchéance. L’entrée des Ottomans au Caire en janvier 1517 vint faire violence non pas simplement à une ville, mais à une histoire vieille de plus de cinq siècles qui avait fait du Caire, sous bien des aspects, la première cité du monde islamique.
Dans l’histoire longue du corps urbain, cependant, le début du xvie siècle ne marque pas un infléchissement majeur. S’il faut identifijier une rupture dans les directions prises par le développement de la ville, elle est déjà intervenue, longtemps avant la conquête ottomane, au tournant des xive et xve siècles. La peste, la crise de l’État, les désastres militaires, la désagré-gation du sultanat avaient alors combiné leurs efffets et entraîné la ruine de la ville12. Des secteurs entiers du Caire avaient été laissés à l’abandon, dans les quartiers d’urbanisation récente entre le Nil et le grand Canal, mais aussi intra muros, à l’exemple de la Ḥārat al-ʿUṭūfijiyya – quelque douze hectares au nord-est de la vieille ville fatimide, abandonnés aux décombres et réurbanisés seulement dans la seconde moitié du xxe siècle (fijig. 3)13. Sur les 144 mosquées du vendredi (soit les ǧāmiʿs proprement dits, ainsi que les autres institutions où se tenaient la ḫuṭba et la prière collective) construites dans l’agglomération du Caire jusqu’au début du xve siècle, ce sont environ quarante lieux de culte qui ont été, avec un degré variable de
10 Faut-il y voir l’efffet d’une hostilité particulière pour le culte de cette sainte, à laquelle les autorités ottomanes préféreront bientôt Sayyida Zaynab ? Voir B. Lellouch, 2006, p. 14, n. 66 ; D. Behrens-Abouseif, 1994, p. 163.
11 Ibn Iyās, éd., 1982-1984, V, p. 157 / trad., 1945-1960, II, p. 150-151.12 J. Loiseau, 2010.13 Les mentions des atteintes de la ruine (ḫarāb) se comptent par dizaines dans la
grande description du Caire dressée au lendemain du désastre par al-Maqrīzī (1364-1442). Sur l’abandon de la Ḥārat al-ʿUṭūfijiyya, voir al-Maqrīzī, 1853, I, p. 376 et II, p. 13-14 / 2002-2004, II, p. 252 et III, p. 37.
Lellouch_Book 1.indb 272Lellouch_Book 1.indb 272 18-4-2012 11:34:5418-4-2012 11:34:54
La ville démobilisée 273
certitude, défijinitivement abandonnés au cours de la crise14. Le Caire au début du xve siècle n’a pas connu la guerre, mais c’est tout comme.
La ruine de la capitale des sultans mamelouks a laissé des traces dans l’espace urbain, qui sont toujours visibles à l’époque ottomane : des éten-dues de ruines (ḫirba) qui se signalent désormais, au sein même du tissu urbain, dans la délimitation des parcelles établie pour les actes de vente et de constitution en waqf ; des collines de décombres (kīmān) qui font comme une sinistre ceinture tout autour du Caire, et dont les plus impo-santes accueillent à la fijin du xviiie siècle une douzaine de forts construits par les soldats de Bonaparte pour mieux surveiller la ville15. Mais la ruine intervenue au tournant des xive et xve siècles a également légué des formes d’occupation urbaine toujours actuelles à l’époque ottomane : c’est à la faveur de la crise et de l’affflux d’une population d’origine rurale que se sont multipliés, dans les interstices ouverts par la ruine, ces enclos urbains (ḥawš) où s’installe l’habitat le plus précaire ; c’est dans les mêmes circons-tances que se sont formés les premiers petits cimetières insérés dans le tissu urbain, qui concurrencent à l’époque ottomane les grandes nécropoles situées extra muros16. Avec le resserrement et la densifijication de l’espace urbain, la capitale du xve siècle ressemble bien davantage à la ville otto-mane qu’au grand Caire du xive siècle.
Mosquées du vendredi et dynamique urbaine
Est-ce à dire qu’une dynamique urbaine ancienne s’est d’ores et déjà brisée avant même la conquête ottomane ? Il n’en est rien. Le Caire fait peau
14 J. Loiseau, 2010, I, p. 39-74.15 Ibid., I, p. 100-104.16 J.-Cl. Garcin, 1982, p. 189-190 et 203 ; J. Loiseau, 2010, I, p. 92-95 et 107-108.
Fig. 3. La Ḥārat al-ʿUṭūfijiyya à la fijin du xviiie siècle. Détail du Plan particulier du Kaire, Description de l’Égypte, État moderne, I, pl. 26.
Lellouch_Book 1.indb 273Lellouch_Book 1.indb 273 18-4-2012 11:34:5418-4-2012 11:34:54
Julien Loiseau274
neuve dans la première moitié du xve siècle : on y construit sur un rythme soutenu et certains des édifijices les plus monumentaux de l’architecture mamelouke datent des lendemains de la ruine. À ce titre, la construction de nouvelles mosquées du vendredi, où l’institution de la ḫuṭba n’est pas seulement une question de prestige et de patronage social, mais aussi la réponse à une demande urbaine, constitue un indice pertinent de la vigueur de l’urbanisation17.
Dans la première moitié du xve siècle, soixante nouveaux lieux de culte sont construits dans l’agglomération du Caire, auxquels viennent s’ajouter sept institutions plus anciennes où la ḫuṭba est établie pour la première fois et six anciennes mosquées rénovées et rouvertes aux fijidèles. Le rattra-page de la ruine est peu ou prou achevé sous le règne d’al-Ẓāhir Ǧaqmaq (1438-1453). Or, cette phase de réurbanisation vigoureuse fijixe les grandes lignes de force de l’espace urbain pour au moins deux siècles. Elle consacre ainsi, par exemple, le nouveau statut du port de Būlāq, devenu ville à part entière avec pas moins de quinze mosquées du vendredi au milieu du xve siècle, et dont on sait l’importance toujours croissante après 151718.
Dans la seconde moitié du siècle, les constructions se font certes moins nombreuses, mais elles sont plus régulières, signe d’une prospérité retrou-vée. Dans les six décennies qui précèdent la conquête ottomane, ce sont tout de même trente-neuf nouveaux lieux de culte qui sont fondés dans la capitale égyptienne, auxquels viennent s’ajouter douze institutions plus anciennes où la ḫuṭba est établie pour la première fois et sept anciennes mosquées partiellement reconstruites. Le beau Caire de la fijin du xve siècle, celui du sultan al-Ašraf Qāytbāy, peut bien rappeler le grand Caire du xive siècle, celui d’al-Nāṣir Muhammad19.
De ce point de vue, l’année 1517 marque une rupture signifijicative dans la dynamique qui avait porté la réurbanisation du Caire au xve siècle. Entre 1517 et 1600, au cours des huit premières décennies de la domination otto-mane, on ne connaît que onze nouvelles mosquées du vendredi édifijiées au Caire. Un certain nombre de fondations, établies par des notables civils ou par des šayḫs soufijis, échappent sans doute à ce décompte où ne fijigurent que des institutions fondées par des gouverneurs ottomans et certains de
17 D. Behrens-Abouseif, 2007, p. 18-19 et 56-57 ; J. Loiseau, 2010, II, 519-541 ; J. Loiseau, à paraître.
18 N. Hanna, 1983 ; J. Loiseau, 2010, I, p. 86-87.19 D. Behrens-Abouseif, 1995.
Lellouch_Book 1.indb 274Lellouch_Book 1.indb 274 18-4-2012 11:34:5518-4-2012 11:34:55
La ville démobilisée 275
leurs offfijiciers20. Néanmoins, même à se limiter aux fondations nouvelles des « gens de l’État » (ahl al-dawla) comme les désignaient les textes de l’époque mamelouke, ces onze nouvelles mosquées du vendredi en huit décennies représentent près de quatre fois moins que les fondations des sultans, émirs et hauts fonctionnaires civils pendant les quatre décennies de la reconstruction du Caire, dans la première moitié du xve siècle (39) ; et trois fois moins que pendant les six décennies qui ont précédé la conquête ottomane (34).
Un ralentissement spectaculaire du rythme des grands chantiers monu-mentaux intervient ainsi au Caire à partir de 1517. Or, la retombée soudaine de la dynamique urbaine qui avait caractérisé la capitale des sultans mame-louks ne peut s’expliquer par des raisons démographiques : la ville de 1517 et ses quelque 220 mosquées du vendredi n’est pas plus peuplée que celle de 1348 et ses 124 lieux de culte, ni moins peuplée que celle de 1798 et ses 233 mosquées21. En revanche, ce qui est en jeu dans le maintien du nombre de lieux de culte à un niveau sensiblement égal tout au long de l’époque ottomane, c’est bien l’avènement d’un nouvel ordre urbain qui ne repose plus, comme l’ordre mamelouk, sur la démultiplication des fondations pieuses monumentales.
Un rapide excursus par Istanbul peut éclairer ce changement. La nou-velle capitale ottomane est un vaste chantier dans la seconde moitié du xve siècle. Comme l’avait montré Stéphane Yerasimos, Sainte-Sophie mise à part (elle était devenue grande mosquée le vendredi 1er juin 1453, à la fijin du pillage légal de la ville), il a fallu attendre 1457 pour que les premiers
20 Sulaymān Pacha fonde deux ǧāmiʿs : l’un en 935 H./1528 à la Citadelle (Index to Mohammedan Monuments, n° 142), l’autre entre 943 et 945 H./1537 et 1538 à Būlāq (sans numéro d’inventaire) ; Dāwūd Pacha fonde un ǧāmiʿ en 961 H./1553-1555 à Suwayqat al-Lālā (n° 472) ; Iskandar Pacha fonde un ǧāmiʿ entre 963 et 966 H./1556 et 1559 à Bayn al-Sūrayn (aujourd’hui détruit) ; Maḥmūd Pacha fonde un mausolée (turba) où se tient la ḫuṭba entre 973 et 974 H./1566 et 1567, sous la Citadelle (n° 135) ; Sinān Pacha fonde un ǧāmiʿ en 979 H./1571 à Būlāq (n° 349) ; Murād Pacha fonde un ǧāmiʿ en 986 H./1578 à Qanṭarat al-Mūskī (n° 181). À ces sept fondations établies par des gouverneurs ottomans s’ajoutent l’institution de la ḫuṭba en 937 H./1531 dans la madrasa du premier gouverneur de l’Égypte ottomane, Ḫāyrbak al-Ašrafī (1517-1522), à al-Tabbāna (n° 248), et la construction par ʿAlī Pacha al-Wazīr du Mašhad Sayyida Zaynab entre 956 et 961 H./1549 et 1553 à Qanāṭir al-Sibāʿ, où l’on peut supposer qu’en toute vraisemblance la ḫuṭba a été instituée (reconstruit au xixe siècle, sans numéro d’inventaire). Enfijin, l’émir Taġrī Birdī fonde un ǧāmiʿ au milieu du siècle dans la ville intra muros (n° 42) ; en 1007 H./1598-99, le daftardār Ḫiḍr constitue un waqf au profijit de la mosquée établie dans la Qubbat Šāhīn al-Ḫalwatī, à la Qarāfā (n° 212). Voir D. Behrens-Abouseif, 1994, p. 179-180, 183-187, 191-195, 198-202 et 275 ; M. Abul Amayem et E. İhsanoǧlu, 2003, n° 5, 9, 11, 13, 14, 17, 18 et 20.
21 E.-F. Jomard, 1821-1829, p. 121 ; J. Loiseau, 2010, I, p. 77.
Lellouch_Book 1.indb 275Lellouch_Book 1.indb 275 18-4-2012 11:34:5518-4-2012 11:34:55
Julien Loiseau276
lieux de culte musulmans soient fondés à Istanbul. Entre 1457 et 1478, l’année du recensement de la population urbaine, environ 70 mosquées ont ouvert leurs portes dans la capitale ottomane – un chifffre qui témoigne d’une dynamique urbaine remarquable. Mais parmi ces fondations nou-velles, la plupart sont de simples masǧid, des oratoires n’accueillant ni la prière collective ni le prêche du vendredi22. De manière très signifijicative, parmi les premières mosquées du vendredi attestées à Istanbul, cinq sont fondées ou instituées par Meḥmed II lui-même23 et deux autres édifijiées par de grands serviteurs du souverain issus du Sérail24.
Le nombre de mosquées du vendredi est certes lié au nombre de musul-mans, et l’évolution démographique d’Istanbul au xvie siècle explique sans doute en partie la démultiplication des ǧāmiʿs : 43 mosquées du vendredi seront construites dans la capitale ottomane entre 1540 et 158825. Mais le faible nombre de lieux de culte à Istanbul dans la première phase de réur-banisation a sans doute au moins autant une explication politique : l’efffet d’une certaine réticence du sultan à abandonner cet ancien privilège sou-verain qu’était, traditionnellement, la fondation d’une mosquée du ven-dredi. Une réticence qui, dans le sultanat mamelouk, n’avait pas résisté à la montée en puissance, dès la fijin du xiiie siècle, des grands émirs désireux d’investir leur pouvoir et leur fortune précaires dans un projet édilitaire ambitieux, où l’élévation d’un minbar et l’institution de la ḫuṭba étaient déjà fréquentes au xive siècle et sont devenues systématiques au xve siècle.
Un resserrement brutal de la souveraineté est intervenu en 1517 au Caire, où désormais un seul homme s’en voit confijier l’exercice : le gouverneur ottoman. De fait, sur les onze mosquées du vendredi édifijiées entre 1517 et 1600, huit sont l’œuvre de pachas ; une neuvième est instituée par l’éléva-tion d’un minbar dans la madrasa du premier gouverneur ottoman, l’émir
22 St. Yerasimos, 2002, p. 163, 176, 191 et 200.23 Il s’agit, outre de Sainte-Sophie, devenue mosquée par décision du sultan dès la
conquête de Constantinople, de la mosquée Eyyüp édifijiée en 1458 au fond de la Corne d’Or, de la monumentale mosquée du Conquérant (Fatih) achevée en 1471, ainsi que de deux églises transformées en mosquées du vendredi et intégrées en 1472 au waqf de Meḥmed II : l’église du monastère du Pantokrator, devenue la mosquée de Zeyrek et l’église Saints-Pierre-et-Paul des Dominicains à Galata, devenue la mosquée des Arabes. St. Yerasimos, 2002, p. 176 et 187-188.
24 La mosquée de Maḥmūd Pacha, édifijiée au Nord de l’ancienne Mésè, sur les pentes qui descendent vers la Corne d’Or, est achevée dès 1463 ; celle de Murād Pacha, construite sur l’ancien Forum du Bœuf pour desservir le nouveau quartier peuplé par les déportés d’Aksaray, en 1471. St. Yerasimos, 2002, p. 194, 198 et 200. Voir également Th. Stavrides, 2001, p. 267-270.
25 H. İnalcık, 1978, p. 243.
Lellouch_Book 1.indb 276Lellouch_Book 1.indb 276 18-4-2012 11:34:5518-4-2012 11:34:55
La ville démobilisée 277
mamelouk Ḫāyrbak al-Ašrafī26. Si Le Caire est bien devenu une ville de province en 1517, c’est dans cette restriction sociale du pouvoir souverain que le changement est d’abord sensible.
L’Espace urbain, entre ordre ancien et ordre nouveau
La localisation des nouvelles fondations, après 1517, n’est pas non plus dénuée de sens. Au xve siècle, nombre de sultans avaient établi une fon-dation funéraire monumentale dans la nécropole du Désert (al-Ṣaḥrā’), au nord de la Citadelle. C’est là, dans l’espace funéraire privilégié par l’aristo-cratie militaire, sur l’axe monumental fijixé par le mausolée d’al-Ẓāhir Barqūq édifijié entre 1400 et 1411 (fijig. 4), que ses héritiers politiques, les sultans circassiens, avaient choisi le plus souvent d’exalter la mémoire de leur règne. Et c’est avec une véritable tradition que le sultan al-Ašraf Qānṣūh al-Ġawrī avait choisi de rompre, en 1503, en faisant bâtir son mau-solée au cœur de la capitale, non loin de la mosquée al-Azhar27.
26 Voir supra note 20.27 J. Loiseau, 2009, p. 319-320.
Fig. 4. La turba d’al-Ẓāhir Barqūq (Ḫānqāh al-Nāṣir Faraǧ) au Désert (cliché J. Loiseau)
Lellouch_Book 1.indb 277Lellouch_Book 1.indb 277 18-4-2012 11:34:5518-4-2012 11:34:55
Julien Loiseau278
En 1528, le gouverneur ottoman Sulaymān Pacha fait bâtir la première mosquée du vendredi fondée au Caire sous le nouveau régime (fijig. 5). Elle n’est située ni dans la nécropole du Désert ni dans le centre de la ville, mais à la Citadelle, qui plus est non pas dans sa partie résidentielle mais dans sa section la plus fortifijiée. On ne pouvait mieux dire le retranchement du nouveau pouvoir et sa volonté prudente de passer sous silence la rupture politique dans le cœur de la cité. Le même Sulaymān Pacha fait édifijier neuf ans plus tard, en 1537-1538, une seconde mosquée, cette fois-ci dans le port de Būlāq, où un autre gouverneur, Sinān Pacha, construira à son tour en 157128. Hormis ces deux mosquées à Būlāq, et celles d’Iskandar Pacha et de Murād Pacha sur le grand Canal, on ne constate aucune concentration topographique signifijicative, aucune logique d’ensemble dans les fondations ottomanes du xvie siècle. Une seule mosquée du vendredi est alors édifijiée dans la vieille ville intra muros d’al-Qāhira, mais c’est à un émir circassien, un certain Taġrī Birdī, qu’on la doit.
Passé 1517, on ne construit plus au Caire ces complexes funéraires qui étaient devenus au xve siècle la marque identitaire du régime mamelouk, au point que l’on faisait visiter la nécropole du Désert aux ambassadeurs
28 D. Behrens-Abouseif, 1994, p. 184-187 et 200-202.
Fig. 5. La mosquée Sulaymān Pacha à la Citadelle (cliché A. du Boistesselin)
Lellouch_Book 1.indb 278Lellouch_Book 1.indb 278 18-4-2012 11:34:5718-4-2012 11:34:57
La ville démobilisée 279
étrangers29. On ne construit plus de grands mausolées, sans doute parce que les offfijiciers ottomans ne résident au Caire que pour un mandat de quelques années et pensent rarement y fijinir leurs jours – et l’on peut dès lors s’étonner que Maḥmūd Pacha ait choisi pour sa part de fonder une turba, sous la Citadelle, faisant également offfijice de mosquée du vendredi (fijig. 6)30. Mais la fijinalité pratique – le lieu réel du tombeau – n’épuise pas le sens des grands monuments funéraires. Après tout, deux sultans mame-louks et non des moindres, al-Ẓāhir Barqūq (1382-1399) et al-Ašraf Barsbāy (1422-1438), avaient fait édifijier au centre du Caire une madrasa funéraire où ils avaient fijinalement choisi de ne pas se faire inhumer…
29 À l’exemple de Pierre Martyr d’Anghiera, ambassadeur des Rois catholiques auprès du sultan Qānṣūh al-Ġawrī en 1502, invité à visiter, comme un honneur, « le sepolture degli antichi soldani ». Cité par J.-Cl. Garcin, 1981, p. 279 et n. 4. Voir également la comparaison entre les fondations funéraires des Mamelouks, des Moghols, des Safavides et des Ottomans esquissée par G. Necipoǧlu, 1996, p. 35-36.
30 D. Behrens-Abouseif, 1994, p. 199-200.
Fig. 6. La turba de Maḥmūd Pacha sous la Citadelle (cliché J. Loiseau)
Lellouch_Book 1.indb 279Lellouch_Book 1.indb 279 18-4-2012 11:34:5918-4-2012 11:34:59
Julien Loiseau280
En renouant avec des formes institutionnelles traditionnelles (madrasa, takiyya ou mosquée sans fonction funéraire), les offfijiciers ottomans ont délibérément cherché à rompre avec la tradition monumentale mame-louke. Le nouvel ordre urbain se veut plus anonyme que l’ancien. Dans ses monuments, il veut moins célébrer la gloire présente de ses grands hommes que la lointaine protection du souverain. L’époque est révolue où l’épigra-phie monumentale couronnait encore les mosquées du Caire en célébrant en grandes lettres la mémoire de leur fondateur.
Plus largement, après 1517, c’est toute une économie politique de l’espace urbain qui glisse et modifijie ses points d’appui. Le patronage généreux du pouvoir ottoman à l’égard des vieux sanctuaires musulmans de la capitale égyptienne est bien connu : la mosquée al-Azhar, mais aussi le tombeau de l’Imām al-Layṯ et celui surtout de l’Imām al-Šāfiji‘ī, auprès duquel les pachas qui venaient à mourir au Caire étaient inhumés. À ces trois véné-rables sanctuaires est venu s’ajouter celui de Sayyida Zaynab, édifijié au milieu du xvie siècle par ‘Alī Pacha al-Wazīr31. Al-Azhar mise à part, ce sont les grands sanctuaires de la nécropole de la Qarāfa ou de ses abords qui sont à l’honneur après 1517.
Par contrecoup, la nécropole du Désert, haut lieu de mémoire du sulta-nat mamelouk, s’en est trouvée marginalisée, tant dans l’investissement monumental du nouveau pouvoir que dans le nouvel espace politique que dessine en ville le parcours des processions offfijicielles. Certes, le vieil axe monumental de la capitale égyptienne, qui traverse la ville intra muros et les quartiers plus récents jusqu’à la Citadelle, est toujours parcouru, comme à l’époque mamelouke, du nord vers le sud. Avant 1517, les processions quittaient la Citadelle par le Désert, traversaient la nécropole des sultans avant de rejoindre cet axe par l’une des deux portes nord de la ville. Mais après 1517, c’est l’arrivée d’un nouveau gouverneur qui constitue désormais le motif principal des festivités urbaines – une arrivée qui s’efffectue, le plus souvent, depuis le port de Būlāq. Le nouveau parcours processionnel qui conduit le représentant de la Porte depuis le Nil jusqu’à la Citadelle longe les fondations monumentales des sultans des xiiie et xive siècles, mais relègue aux marges de l’espace urbain les monuments funéraires des sou-verains circassiens32.
En 1517, sur le point de repartir pour Istanbul, le sultan ottoman Selīm s’était recueilli sur le tombeau du sultan mamelouk al-Ašraf Qāytbāy (1468-
31 Ibid., p. 58, 89-91, 139-140 et 163.32 Ibid., p. 55 et 59.
Lellouch_Book 1.indb 280Lellouch_Book 1.indb 280 18-4-2012 11:35:0118-4-2012 11:35:01
La ville démobilisée 281
1496), dans la nécropole du Désert. Il initiait ainsi une « politique de mémoire » exaltant la fijigure du souverain le plus respectable de l’ancien régime, pour mieux masquer la brutalité de la conquête : seul le règne impie, injuste et arbitraire de Qānṣūh al-Ġawrī (1501-1516) méritait alors d’être oublié33. Mais par leur usage de l’espace comme par leurs œuvres pieuses, les gouverneurs ottomans du xvie siècle ont établi un ordre urbain oublieux de l’ensemble du siècle précédent. Un ordre délibérément tradi-tionnel, renouant avec le passé civil et musulman de la ville, pour mieux taire le règne des grands sultans mamelouks du xve siècle.
La ville démobilisée
Ainsi est-ce presque insensiblement que Le Caire, après 1517, est discrète-ment dépouillé de son passé impérial. Il y a bien sûr des changements d’usage, la réafffectation de certains lieux qui rappellent que l’ancien régime est défijinitivement passé. En ville, la vénérable madrasa de l’Ayyoubide al-Ṣāliḥ Naǧm al-Dīn (1240-1249) n’est bientôt plus le siège de la plus haute juridiction du Caire, le tribunal des quatre grands qāḍī-s, transféré non loin de là dans la grande loggia d’un ancien palais mamelouk. À la Citadelle, l’ancienne salle du trône d’al-Nāṣir Muḥammad, le Grand Īwān (fijig. 7), sert désormais de prison et le maq‘ad d’al-Ašraf Qāytbāy, où le sultan recevait ses hôtes, n’est plus qu’un simple oratoire34.
La destinée du Palais Yašbak, au pied de la Citadelle, en offfre une illus-tration saisissante (fijig. 8). Édifijié au début des années 1330, le plus monu-mental des palais émiraux du Caire était devenu au xve siècle la résidence ex offfijicio de l’émir le plus haut gradé de la hiérarchie militaire, l’atābak al-‘asākir. En 1521, il accueillait encore des offfijiciers ottomans, de passage dans la capitale égyptienne. Mais en 1607, le palais et son vaste périmètre sont concédés en waqf à l’ordre des derviches mevlevi, venus d’Anatolie en Égypte dans les bagages des Ottomans. Le Palais Yašbak s’est ainsi trouvé démobilisé35.
Au fijinal, rien ne change vraiment après 1517. La ville reste en place, comme elle a toujours été ou comme elle aurait toujours dû être. Le nouvel ordre urbain assure la continuité des institutions, soutenues par le maillage
33 Ibn Iyās, éd., 1982-1984, V, p. 206 / trad., 1945-1960, II, p. 196. Voir B. Lellouch, 2006, p. 106-107.
34 D. Behrens-Abouseif, 1994, p. 79, p. 206, n. 145 et p. 229.35 J. Loiseau, 2006, p. 137.
Lellouch_Book 1.indb 281Lellouch_Book 1.indb 281 18-4-2012 11:35:0118-4-2012 11:35:01
Julien Loiseau282
Fig. 7. Le Grand Īwān, salle du trône d’al-Nāṣir Muḥammad à la Citadelle, Description de l’Égypte, État moderne, I, pl. 70.
Fig. 8. Le Palais Yašbak (cliché J. Loiseau)
Lellouch_Book 1.indb 282Lellouch_Book 1.indb 282 18-4-2012 11:35:0118-4-2012 11:35:01
La ville démobilisée 283
déjà très dense des fondations en waqf, dont seule la gestion de la fortune immobilière change de main. La ville ne change pas, puisque ce sont ses plus anciens lieux de culte, ses dévotions les plus vénérables, qui sont désormais généreusement soutenus par les nouveaux maîtres du pays. Rien ne change vraiment – et c’est peut-être précisément en cela que l’ancienne capitale impériale est bel et bien devenue une ville de province. Passé l’événement même de la conquête, il n’y a plus grand chose à dire au Caire et les textes se font très rares au xvie siècle, une fois refermée la chronique d’Ibn Iyās et celle de Diyārbakrī. C’est dans ce silence nouveau de l’histo-riographie que réside sans aucun doute le principal changement intervenu en 151736. La riche historiographie composée dans la capitale égyptienne aux xive et xve siècles, dans le fracas des événements qui rythmaient la vie politique du régime mamelouk n’a plus lieu d’être. C’est dans le silence de l’ordre ottoman que Le Caire des Mamelouks est défijinitivement démobi-lisé.
BIBLIOGRAPHIE
SourcesIndex to Mohammedan Monuments appearing on the special 1:5000 scale maps of Cairo, 1948.Ibn al-Furāt, Ta’rīḫ al-duwal wa-l-mulūk, Zurayq (Qusṭantīn) et ʿIzz al-Dīn (Naǧlā) (éd.),
Beyrouth, 1938.Ibn Iyās, Badā’iʿ al-zuhūr fī waqā’iʿ al-duhūr, Muṣṭafā (Muḥammad) (éd.), Le Caire, al-Hay’a
al-miṣriyya al-ʿāmma li-l-kitāb, 5 vols., 1982-1984 ; Wiet (Gaston) (trad.), Journal d’un bourgeois du Caire, Paris, Armand Colin, 2 vols., 1945-1960.
Ibn Taġrī Birdī, Al-Nuǧūm al-zāhira fī mulūk Miṣr wa-l-Qāhira, Popper (William) (éd. et trad.), University of California Publications in Semitic Philology, 1909-1963 ; édition Dār al-Kutub, Le Caire, 16 vols., 1963-1972.
Al-Maqrīzī, Al-Mawā‘iẓ wa-l-iʿtibār fī ḏikr al-ḫiṭaṭ wa-l-āṯār, édition de Būlāq, 2 vols., 1853 ; Fu’ad Sayyid (Ayman) (éd.), Londres, al-Furqān Islamic Heritage Foundation, 5 vols., 2002-2004.
ÉtudesAbul Amayem (Mohammed) et İhsanoǧlu (Ekmeleddin), Āṯār al-Qāhira al-islāmiyya fī l-ʿaṣr
al-ʿuṯmānī, Istanbul, Markaz al-abḥāṯ li-l-ta’rīḫ wa-l-funūn wa-l-ṯaqāfa al-islāmiyya, 2003.Behrens-Abouseif (Doris), Egypt’s adjustment to Ottoman rule: institutions, waqf and archi-
tecture in Cairo, 16th and 17 thcenturies, Leyde, New York, E.J. Brill, 1994.———, « Al-Nāṣir Muḥammad and al-Ašraf Qāytbāy – Patrons of Urbanism », in Vermeulen
(Urbain) et De Smet (Daniel) (ed.), Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, Orientalia lovaniensia analecta, 73, Louvain, Peeters, 1995, p. 267-284.
———, Cairo of the Mamluks. A History of the Architecture and Its Culture, Le Caire, The American University in Cairo Press, 2007.
36 B. Lellouch, 2006, p. xxi-xxiii.
Lellouch_Book 1.indb 283Lellouch_Book 1.indb 283 18-4-2012 11:35:0418-4-2012 11:35:04
Julien Loiseau284
Boucheron (Patrick) et Loiseau (Julien), « L’archipel urbain. Paysage des villes et ordre du monde » in Boucheron (Patrick) (dir.), Histoire du monde au xve siècle, Fayard, 2009, p. 668-690.
Garcin (Jean-Claude), « Une carte du Caire vers la fijin du sultanat de Qāytbāy », Annales islamologiques, 17, 1981, p. 272-285.
———, « Évolution de l’habitat médiéval et histoire urbaine », in Garcin (Jean-Claude), Maury (Bernard), Revault (Jacques) et Zakariya (Mona), Palais et maisons du Caire, I, Époque mamelouke (xiiie-xvie siècle), Paris, CNRS, 1982, p. 143-216 ; repris in Garcin (Jean-Claude), Espaces, pouvoirs et idéologies de l’Égypte médiévale, Londres, Variorum Reprints, 1987.
———, « Note sur la population du Caire en 1517 », in Garcin (Jean-Claude) (dir.), Grandes villes méditerranéennes du monde musulman médiéval, Rome, École française de Rome, 2000, p. 205-213.
Hanna (Nelly), An Urban History of Būlāq in the Mamluk and Ottoman Periods, Le Caire, IFAO, 1983.
İnalcık (Halil), « Istanbul », Encyclopédie de l’Islam, 2ème édition, 1978, IV, p. 233-259.Jomard (Edme-François), « Description de la ville et de la citadelle du Kaire », in Description
de l’Égypte, État moderne, 1821-1829, t. XVIII, 2e partie, p. 113-538.Lellouch (Benjamin), Les Ottomans en Égypte. Historiens et conquérants au xvie siècle, Paris,
Louvain, Dudley, Peeters, collection Turcica, XI, 2006.Loiseau (Julien), « Les demeures de l’empire. Palais urbains et capitalisation du pouvoir au
Caire (xive-xve siècle) », in Les villes capitales au Moyen Age, acte du xxxvie congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public (SHMESP), Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 373-390.
———, « Le tombeau des sultans. Constructions monumentales et stratégies funéraires dans les sultanats mamelouk et ottoman », Turcica, 41, 2009, p. 305-340.
———, Reconstruire la Maison du sultan. Ruine et recomposition de l’ordre urbain au Caire (1350-1450), Le Caire, IFAO, Études urbaines 8, 2010.
———, « The City of two hundred mosques. Friday worship and its spreading in the monu-ments of Mamluk Cairo », in Behrens-Abouseif (Doris) (ed.), The Arts of the Mamluks, à paraître.
Necipoǧlu (Gülru), « Dynastic Imprints on the Cityscape: The Collective Message of Imperial Funerary Mosque Complexes in Istanbul », in Bacqué-Grammont (Jean-Louis) et Tıbet (Aksel) (éd.), Cimetières et traditions funéraires dans le monde islamique, Ankara, 1996, vol. II, p. 23-36.
Stavrides (Theoharis), The Sultan of Vezirs. The Life and Times of the Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha Angelović (1453-1474), Leyde, Boston, Cologne, E.J. Brill, 2001.
Yerasimos (Stéphane), « La ville ottomane, de 1453 à la fijin du xviiie siècle », in Auzépy (Marie-France), Ducellier (Alain), Veinstein (Gilles) et Yerasimos (Stéphane), Istanbul, Paris, Citadelles & Mazenod, 2002, p. 163-360.
Lellouch_Book 1.indb 284Lellouch_Book 1.indb 284 18-4-2012 11:35:0418-4-2012 11:35:04
















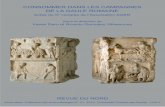






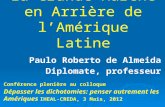









![MONTEIL (M.) 1996 – La ville romaine et wisigothique [Nîmes, Gard].](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63413433671643e7130cf979/monteil-m-1996-la-ville-romaine-et-wisigothique-nimes-gard.jpg)



