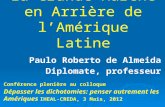Musiques populaires et engagement politique : les exemples de Rough Trade et Rock Against Racism
PIGIERE F. & LEPOT A., 2014. Une économie de marché entre la ville de Tongres et son arrière-pays...
Transcript of PIGIERE F. & LEPOT A., 2014. Une économie de marché entre la ville de Tongres et son arrière-pays...
CONSOMMER DANS LES CAMPAGNESDE LA GAULE ROMAINE
Actes du Xe congrès de l’Association AGER
Sous la direction deXavier Deru et Ricardo González Villaescusa
REVUE DU NORDHors série. Collection Art et Archéologie N° 21. 2014. Université Charles-de-Gaulle - Lille 3
1. INTRODUCTION
Dans le système socio-économique romain, il estcouramment considéré que l’approvisionnement ennourriture de la part de la population qui n’est pasdirectement impliquée dans la production primaire,tels les militaires, les fonctionnaires ou encore les arti-sans, repose sur les surplus dégagés par la populationrurale1. En même temps, la théorie extrême qui voulaitque la ville soit le parasite des campagnes semblemaintenant complètement abandonnée2. De plus enplus d’études ont démontré que la ville était impliquéedans le commerce et la production de biens. Dans plu-sieurs régions de l’Empire, les données archéozoolo-giques ont récemment fourni des résultats qui mon-trent que les animaux consommés sur les sites urbainsont été en partie élevés en ville ou dans son voisinageproche et en partie importés de la campagne3. Pour laGaule septentrionale, et plus précisément dans larégion couverte par les lœss4, les données archéozoo-logiques reflètent également l’installation d’une éco-nomie de marché durant le Haut-Empire romain5. Cesystème économique, soumis à l’offre et à lademande, se base sur des échanges entre producteurset consommateurs dépendant de produits extérieurs.Dans la zone lœssique, les bovins occupent une placeimportante dans ce système d’échange. Ils fournissentla force motrice pour les travaux des champs danscette région qui connaît une intensification de l’acti-vité agricole à la période romaine. Ce développements’accompagne d’un accroissement des surfaces agri-
coles, d’un choix plus ciblé des céréales, d’une évolu-tion de l’équipement technique et de l’organisationsociale de la production6. L’élevage des bœufs permetaussi d’approvisionner en viande les producteurs ainsique les consommateurs, en ville et dans les agglomé-rations.
L’étude de cas présentée dans cet article se penchesur les modalités d’acquisition, de transformation etde consommation des ressources animales des habi-tants de la ville et des agglomérations, mais égalementsur la production et la consommation de produits ani-maux sur différents sites ruraux7. La redistribution dessurplus générés par les sites ruraux a ensuite été repla-cée dans un cadre d’échange entre ville et campagnemis en évidence par un autre bien de consommationspécifique, en l’occurrence, la céramique culinaire.
2. MATÉRIELS ET MÉTHODES
La recherche se focalise sur une microrégion de1 000 km2 à l’intérieur de la civitas Tungrorum, cor-respondant à la zone couverte par les lœss fertiles.Nous avons sélectionné neuf occupations au sein decette microrégion : la capitale de cité, Tongres, l’ag-glomération routière de Braives et sept exploitationsrurales : Broekom, Latinne, Piringen, Velroux,Verlaine, Froidmont et Liège/Place Saint-Lambert(fig. 1). La région est traversée par la voie reliantBavay à Cologne et bordée au sud et à l’est par laMeuse. Cette zone d’étude a été choisie dans le cadre
*. — Fabienne PIGIèRE, Institut Royal des Sciences naturelles deBelgique, rue Vautier 29, B-1000 Bruxelles, Belgique ; Annick LEPOT,Université catholique de Louvain, Centre de recherches d’archéologienationale, avenue du Marathon 3, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique.1. — GARNSEy, WHITTAkER 1985 ; ROyMANS 1996.2. — WALLACE-HADRILL 1991 ; HOPkINS 1978.3. — MALTBy 1994 ; OUESLATI, ROBIN 2006.4. — Territoire correspondant à la moyenne Belgique.5. — PIGIèRE 2009, p. 248-250.
6. — ROyMANS 1996, p. 58-65 ; kOOISTRA 1996, p. 119-126.7. — La présente recherche a été réalisée avec le support financier de laDirection de l’Archéologie du Service public de Wallonie (DGO4), duprogramme Pôles d’Attraction Interuniversitaires de la Politique scien-tifique fédérale (PAI VI/22 & PAI VII/09-CORES) et du F.R.S.-FNRS.Nous tenons à remercier chaleureusement Anton Ervynck, AnLentacker et Alain Vanderhoeven (Agentschap Onroerend Erfgoed).Nos remerciements vont également à Wim Van Neer (IRSNB), ainsiqu’à Guy Destexhe (musée de Saint-Georges-sur-Meuse).
REVUE DU NORD - N° 21 HORS SÉRIE COLLECTION ART ET ARCHÉOLOGIE - 2014, P. 155-169
FABIENNE PIGIÈRE ET ANNICK LEPOT*
Une économie de marché entre la ville de Tongres et son arrière-pays ? Les exemples de la gestion des ressources
animales et de l’approvisionnement en céramique
d’un projet de recherche interuniversitaire visant àévaluer l’impact de la romanisation sur les villes etleur arrière-pays en Italie et dans les provinces del’Empire. Ce projet interdisciplinaire tente de mettreen évidence les moyens et les mécanismes d’échangeentre les villes, les agglomérations et la campagne àtravers la production, la distribution et la consomma-tion de biens.
L’étude archéozoologique porte sur les modes deproduction, d’acquisition, de transformation et deconsommation des ressources animales. Ceux-ciseront examinés de manière distincte entre la ville deTongres, l’agglomération de Braives et les sitesruraux. Le corpus issu de ces occupations se composede 18 826 restes osseux déterminés (tab. 1). L’étude seconcentre sur les trois principaux mammifères domes-tiques : le porc, le bœuf et les caprinés. Les donnéessont relativement nombreuses pour Tongres et Braiveset résultent de fouilles menées dans différentes parties
de la ville et de l’agglomération antique. Pour les sitesruraux, le plus souvent fouillés partiellement, les cor-pus sont généralement plus réduits. Par ailleurs, lesétudes archéozoologiques de différents auteurs ont étéintégrées dans cette recherche, ce qui entraîne des dif-ficultés pour réaliser des comparaisons inter-sites, enparticulier pour l’étude des âges d’abattage (voirinfra). Cependant, les données déjà disponibles nouspermettent de produire une synthèse archéozoolo-gique pour cette microrégion.
Les âges d’abattage des animaux ont été estimés surla base de l’état d’épiphysation des os longs et dustade d’éruption et d’usure des dents inférieures. Lorsdes études archéozoologiques réalisées sur la faune deBraives dans le courant des années 1980, des classesd’âges peu précises ont été utilisées pour indiquerl’état d’usure de la troisième molaire, classée commepeu, moyennement et fortement usée. En revanche,pour les sites de Velroux et Verlaine, les âges dentaires
156 FABIENNE PIGIèRE, ANNICk LEPOT
FIG. 1. — Localisation de la microrégion étudiée autour de Tongres et des sites mentionnés dans le texte. APIS-UCL/CRAN
reposent sur la méthode de A. Grant8 et les donnéesont été regroupées en suivant les classes d’âges propo-sées par S. Payne pour ce qui est des caprinés9.
Concernant la prise de mesures sur les os, on seréférera aux normes établies par A. Von den Driesch10.La méthode du log ratio a été utilisée lors de l’étudeostéométrique des os de bovins. Le log size index(LSI) est le logarithme du rapport entre une mesure‘X’ et son standard ‘S’ et il est calculé comme log(X/S)11. Le standard utilisé dans cette étude est unefemelle auroch du site Ullerslev (Danemark) qui datede la période Boréale12.
Plusieurs outils archéozoologiques ont été dévelop-pés ces dernières années pour approcher les modesd’acquisition des animaux domestiques sur un site.Cette approche s’appuie sur la notion de distance entrele producteur et le consommateur13. La distance estd’autant plus grande que les producteurs impliquéssont nombreux et le circuit de distribution des produitsest complexe. À l’inverse, la distance se réduit lorsquele consommateur est en contact direct avec le produc-teur ou lorsqu’il est lui-même le producteur. Le profildes courbes d’âge et de sexe des animaux domestiquesest l’un des principaux outils exploités dans cetteapproche14. Lorsque la distance entre producteurs etconsommateurs est grande, les sélections opérées aux
différents niveaux du circuit d’approvisionnementpeuvent occasionner une plus grande uniformité descaractéristiques d’âge et de sexe des animaux. Parcontre, lorsque la distance entre producteurs etconsommateurs est réduite, ces derniers auront accès àun spectre d’âge et de sexe plus diversifié. Les ani-maux réformés, car ils ne sont plus productifs, ouencore les animaux morts accidentellement ou demaladie se retrouveront plus facilement sur la tabledes consommateurs. L’évaluation de cette distances’appuie également sur le postulat que la morphologiedes animaux tend à être relativement homogène ausein d’un même troupeau15. Dès lors, les donnéesmétriques vont montrer moins de variabilité au seind’un même troupeau que dans un assemblage dérivantde plusieurs troupeaux provenant de différents centresde production. Suivant la méthode décrite parT. Oueslati16, la déviation standard et le coefficient dePearson sont utilisés pour évaluer la diversité de tailled’une espèce au sein d’un assemblage archéologique.
La question de la distance entre producteur etconsommateur implique une réflexion sur le cadred’échange régional. Afin de mettre en évidence lesliens entre ville et campagne, nous proposons de com-biner l’étude archéozoologique à une approche sur unautre bien de consommation. La région autour de
UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ ENTRE LA VILLE DE TONGRES ET SON ARRIèRE-PAyS ? 157
8. — GRANT 1982.9. — PAyNE 1973.10. — VON DEN DRIESCH 1976.11. — MEADOW 1999.12. — DE CUPERE, DURU 2003, p. 116, tabl. 9.
13. — OUESLATI 2006 ; OUESLATI, ROBIN 2006.14. — OUESLATI 2006 ; OUESLATI, ROBIN 2006.15. — OUESLATI, ROBIN 2006. 16. — OUESLATI, ROBIN 2006.
Site Nature Chronologie RéférencesTongres-Momberstraat Ville Milieu Ier s. ap. J.-C. Vanderhoeven, Vynckier 2007Tongres-Hondstraat Flavien-première moitié du IIe s. Ervynck,Vanderhoeven, 1997 ; Vanderhoeven,
Ervynck 2007Tongres-Minderbroederstraat Première moitié du Ier-deuxième Vanderhoeven, Vynckier 1994
moitié du IIe s.Tongres-Elisabethwal Flavien- IIe s. Vanderhoeven, Ervynck 2007Tongres-Veemarkt Ier-IIIe s. Vanderhoeven, Ervynck 1993Tongres-kielenstraat Ier-IIIe s. Vanderhoeven, Van De konijnenburg 1987 ;
Vanderhoeven, Vynckier 1992 ; Van Neer 1994Braives-Habitat central Agglom. Fin IIe-début IIIe s. Cordy 1981Braives-Quartier des potiers IIe-IIIe s. Cordy, Stassart 1983Braives-Habitat occidental Ier-IIe s. Cordy, Rapaille 1985. Braives-Habitat centre-ouest Ier-IIIe s. Trabert 1990Braives-Habitat sous fortification du Bas-Empire Ier-IIIe s. yernaux, Udrescu 1992Broekom Site rural IIe-IIIe s. Van Neer 1988Latinne Haut-Empire Cordy 1984Piringen 65/70-85/90 Van Neer 1990Velroux Ier-IIIe s. Pigière à paraîtreVerlaine IIe-première moitié du IIIe s. Pigière en préparationFroidmont Deuxième moitié du IIe-IIIe s. Tromme, Vilvorder 2008Liège/Place Saint-Lambert IIe-première moitié du IIIe s. Gautier, Hoffsummer 1988
Tableau 1. — Sites de la civitas Tungrorum soumis à une étude archéozoologique.
Tongres a récemment fait l’objet d’une étude spéci-fique sur les céramiques de production régionale qui apermis d’identifier des réseaux d’échanges locauxentre ville et arrière-pays sur base de l’analyse céra-mologique17. En effet, les céramiques régionales et enparticulier les céramiques culinaires sont, parmi lesbiens de consommation, probablement la meilleureclasse de vaisselle pour documenter les échanges àcourte ou moyenne distance. Produites dans un cadredomestique puis dans des ateliers de potiers, elles pré-sentent systématiquement des caractéristiques cultu-relles et/ou régionales qui tendent à suivre une cer-taine mode mais avant tout à s’adapter aux besoins dela population. Elles sont à ce titre à classer dans la hié-rarchisation des biens de consommation parmi lesbiens nécessaires18. L’acquisition de ces céramiquespar le consommateur se fait soit dans le cadre domes-tique, autoproduction, soit à l’extérieur chez un artisanspécialisé. C’est à partir de ce second cas de figureque l’on peut commencer à évaluer les échanges àcourte ou moyenne distance. En ce sens, la productionartisanale de céramiques culinaires d’époque romainedoit être considérée comme un artisanat de proximitépar opposition à l’artisanat de masse que sont les sigil-lées qui, elles, bénéficient d’une diffusion commer-ciale à plus longue distance19. L’identification des cen-
tres de productions, ou, au minimum, de la régiond’où proviennent les céramiques culinaires est doncune condition sine qua non à la compréhension desmécanismes commerciaux.
Plusieurs sites ruraux ayant fourni des donnéesarchéozoologiques, ceux de Piringen, Broekom,Verlaine, Froidmont et Velroux, ont bénéficié d’uneétude spécifique sur les provenances des céramiquesculinaires permettant d’aborder le réseau d’échangelocal dans lequel les habitants de ces sites étaientimpliqués20.
3. ACQUISITION, TRANSFORMATION ET CONSOMMA-TION DES RESSOURCES ANIMALES À TONGRES ETBRAIVES
3.1. Approche de la consommation de produits ani-maux
Tant à Tongres qu’à Braives, de vastes assemblagesde déchets de consommation provenant de différentssecteurs de l’occupation nous renseignent sur les pra-tiques alimentaires des habitants. À Tongres, les dépo-toirs de la ville, fouillés sur les sites de la kielenstraatet de la Veemarkt, montrent que le bœuf est l’espèceprépondérante parmi les principaux mammifères
158 FABIENNE PIGIèRE, ANNICk LEPOT
17. — LEPOT, ESPEL 2010.18. — DERU, GONzáLEz-VILLAESCUSA dans ce même volume.19. — FERDIèRE 2001.20. — L’étude est basée sur un classement des céramiques au sein desgrandes fabriques de la collection de l’International Fabrics ReferenceCollection établie par le laboratoire de céramologie du Centre de
recherches d’archéologie nationale de l’Université catholique deLouvain (BRULET, VILVORDER 2010). La détermination des groupes depâtes a été effectuée à la loupe binoculaire afin de rattacher le matérielcéramique soit à un atelier, soit à un groupe de production ou encore àun groupe technologique.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
Kielen
straa
t 1-30
(n=2
27)
Kielen
straa
t 30-5
0 (n=
393)
Kielen
straa
t 50-6
9 (n=
613)
Kielen
straa
t fin I
er -déb
ut IIe s.
(n=1
080)
Kielen
straa
t 2e m
oitié
IIe s. (n
=195
)
Kielen
straa
t IIIe s.
(n=2
48)
Veemark
t Ier -II
Ie s. (n
=233
)
Braive
s-Hab
occ.
Ier -IIe s.
(n=6
11)
Braive
s-Qua
rt. po
t. IIe -III
e s. (n
=112
)
Braive
s-Hab
c.-o.
Ier -III
e s. (n
=103
7)
Braive
s-Hab
ss fo
rt. Ier -
IIIe s.
(n=1
926)
Porc
Caprinés
Bœuf
FIG. 2. — Proportions relatives du porc, du bœuf et des caprinés à Tongres et Braives.Hab occ. : habitat occidental ; Quart. pot. : quartier des potiers ; Hab c.-o. : habitat centre-ouest ; Hab ss fort :habitat sous la fortification.
domestiques consommés et ce, tout au long du Haut-Empire (fig. 2). Le porc occupe la deuxième positionet les caprinés viennent en dernier lieu.
Pour Tongres, le nombre de données relatives auxâges d’abattage des animaux consommés est limité.Les informations basées sur l’état d’épiphysation desossements sont résumées dans le tableau 2. Ces don-nées montrent que ce sont principalement des bœufsadultes qui ont été consommés. Ceci a été mis en évi-dence pour le dépotoir général du site de la Veemarktmais aussi pour le contexte de la Momberstraat attri-bué à de riches habitants de la ville. Seul le site de lakielenstraat a livré tant des restes de jeunes individusque d’adultes. En ce qui concerne les caprinés, ce sontprincipalement des animaux adultes qui ont été identi-fiés sur les deux sites (tab. 2). L’alimentation desriches habitants de la ville se distingue, entre autres,par une forte consommation de porcs, comme le mon-trent les sites de la Veemarkt21 et de la Momberstraat22.Ces animaux étaient de très jeunes individus, habituel-lement des porcelets de moins d’un an.
L’analyse des assemblages fauniques de plusieurssecteurs de Braives montre, comme pour Tongres, quele bœuf est prédominant au sein des déchets deconsommation des habitants durant le Haut-Empireromain (fig. 2). Les caprinés se placent en deuxième
position habituellement, ce qui diffère de Tongres, oùle porc est prépondérant par rapport aux caprinés. Lesâges d’abattage des animaux ont été établis sur la basede l’état d’éruption et du stade d’usure des dents infé-rieures issues de différents secteurs du vicus. Dans lequartier des potiers, les bœufs consommés ont princi-palement été abattus à un âge compris entre 18 et 30mois (33 %) et alors qu’ils étaient jeunes adultes(tab. 3 : 31 %). Un petit nombre a été abattu entre 6 et18 mois. Enfin, les animaux adultes et séniles sont peufréquents. Dans la zone d’habitat sous la fortificationdu Bas-Empire, on enregistre également un picd’abattage entre 18 et 30 mois (43 %). On a égalementrelevé un nombre élevé d’animaux adultes (21 %) ettrès vieux (24 %). Les données sur l’âge d’abattagedes bovins disponibles sur la zone d’habitat centre-ouest ne sont pas suffisamment détaillées, cependantelles montrent que les animaux de moins de 18 moissont abondants (24 %). À nouveau, les individus âgésentre 18 et 30 mois sont fréquents (30 %) et un grandnombre a été maintenu en vie après 27-30 mois(46 %). Pour résumer, le schéma d’abattage à Braivesrévèle une forte présence de sub-adultes et des jeunesadultes, ce qui indique qu’une majorité des bœufsconsommés ont principalement été élevés pour leurviande. Concernant les caprinés, les données prove-nant de la zone d’habitat sous la fortification indiquent
UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ ENTRE LA VILLE DE TONGRES ET SON ARRIèRE-PAyS ? 159
21. — VANDERHOEVEN, ERVyNCk 1993. 22. — VANDERHOEVEN, ERVyNCk 2007.
Site Nature des contextes Chronologie Bœufs Caprinés PorcsMomberstraat Contexte clos-riches habitants Milieu du Ier s. Adultes Surtout adultes, Très jeunes
peu de sub-adultes et séniles
kielenstraat Dépotoir général de la ville Ier s. Jeunes et adultes Surtout adultes -Veemarkt Dépotoir général de la ville Ier-IIIe s. Adultes > 4 ans - -Veemarkt Contexte clos-riches habitants Flavien-première moitié du IIe s. - - Très jeunes < 1 an
Tableau 2. — Résumé des données épiphysaires sur les âges d’abattage des porcs, bœufs et caprinés à Tongres.
Quartier des potiers Habitat sous fortification Habitat centre-ouestStades Âges IIe-IIIe s. Ier-IIIe s. IIe-IIIe s.M1 absente, Dp4 présente 0-6 mois 0 11% 0 9%M1 en train de sortir 6 mois 0 0 24%M1 usée, M2 pas sortie 6-18 mois 2 0M2 en train de sortir 18 mois 3 6M2 usée, M3 pas sortie 18-27 mois 9 33% 18 43% 30%M3 sortant 27-30 mois 6 11M3 + usée Jeunes adultes 14 31% 3 4%M3 ++ usée Adultes 5 11% 14 21% 46%M3 +++ usée Séniles 6 13% 16 24%NR total 45 68 46
Tableau 3. — Âges d’abattage des bovins sur la base du stade d’éruption et d’usure des dents à Braives.+ peu ; ++ moyennement ; +++ fort.
qu’un nombre significatif a été tué avant d’avoiratteint l’âge d’un an (tab. 4 : 45 %). Un grand nombrea été abattu à l’âge adulte (25 %). Un petit groupe sesitue entre un an et deux ans, tandis qu’un autre cor-respond à des individus très vieux. Ce profil de morta-lité semble suggérer un élevage orienté vers la produc-tion de lait et de viande23. En effet, dans le cadre d’uneproduction laitière, un grand nombre d’agneaux estabattu pour assurer l’approvisionnement en lait des-tiné à la consommation humaine et un grand nombred’adultes (principalement des femelles) est maintenuen vie pour la reproduction. En ce qui concerne la pro-duction de viande, l’abattage de jeunes animaux demoins d’un an indique la sélection d’une viande ten-dre. Les quelques données disponibles pour le secteur4 indiquent également un abattage important de jeunesindividus de moins d’un an (31 %). La majorité desvestiges provient toutefois de caprinés adultes et/ou dejeunes adultes (63 %), tandis que les très vieux indivi-dus ne sont pas représentés. Pour terminer, seul le sec-teur 5 a fourni suffisamment de données pour exami-ner le schéma d’abattage des porcs (tab. 5). La
majorité des porcs ont été abattus dans le courant deleur première année (45 %) et alors qu’ils étaient âgésentre 13 et 22 mois (24 %). Un nombre non négligea-ble a atteint un âge avancé (19 %) et ces animauxétaient probablement gardés pour la reproduction.3.2. Approche du mode d’acquisition des animauxdomestiques
Les données démographiques des grands bovins quiviennent d’être présentées pour plusieurs secteurs dusite de Braives fournissent des indications sur la dis-tance physique qui sépare les producteurs et lesconsommateurs. Les profils de mortalité des bovinssont tronqués ; on note en particulier l’absence desjeunes individus de moins de 6-18 mois. Bien que lasous-représentation des animaux de cette classe d’âgepuisse en partie s’expliquer par les effets de la préser-vation et de la collecte différentielle, les profils tron-qués constituent des indicateurs d’une certaine dis-tance entre producteurs et consommateurs.
À Braives toujours, un autre indice permet d’appro-cher la distance entre producteurs et consommateurs.La couche d’abandon d’un puits datant de la fin duIIIe siècle contient les restes de carcasses de porcs,bœufs et caprinés (tab. 6). Les squelettes comprennentégalement des fœtus de porcs et de caprinés, montrantainsi que les petits ongulés ont été élevés localement.On note par contre l’absence de fœtus de bœufs.Lorsque l’on compare les assemblages fauniques pro-venant du même type de contexte à Tongres, il estfrappant de constater que l’on n’y relève pas d’indicesd’un élevage local. Les contenus de trois puits de lacapitale n’ont livré que les squelettes de chiens et dechevaux.
Pour la ville de Tongres, le corpus de données n’estpas suffisant pour établir les courbes des âges d’abat-tage des principaux mammifères domestiques. Une
160 FABIENNE PIGIèRE, ANNICk LEPOT
23. — HELMER, GOURICHON 2007.
Tableau 4. — Âges d’abattage des caprinés sur la base du stade d’éruption et d’usure des dents à Braives.+ peu ; ++ moyennement ; +++ fort.
Tableau 5. — Âges d’abattage des porcs sur la base du staded’éruption et d’usure des dents à Braives.
+ peu ; ++ moyennement ; +++ fort.
Habitat sous fortification Habitat centre-ouestStades Âges Ier-IIIe s. Ier-IIIe s.Dp3/Dp4 pas usées 0-2 mois 6 45%Dp3/Dp4 usées, M1 pas usée 2-6 mois 10 31%M1 usée, M2 pas usée 6-12 mois 8M2 usée, M3 pas usée 1-2 ans 7 13% 6%M3 + usée 2-3 ans 3 6% 63%M3 ++ usée Adultes 13 25%M3 +++ usée Séniles 6 11% -NR total 53 16
Habitat sous fortificationStades Âges Ier-IIIe s.M1 absente, Dp4 présente 0-6 mois 0 45%M1 en train de sortir 6 mois 5M1 usée, M2 pas sortie 6-12 mois 8M2 en train de sortir 12 mois 6M2 usée, M3 pas sortie 13-18 mois 6 24%M3 en train de sortir 18-22 mois 4M3 + usée 2-3 ans 1 2%M3 ++ usée Adultes 4 10%M3 +++ usée Séniles 8 19%NR total 42
approche de la distance entre producteurs et consom-mateurs sur la base des données démographiques n’adonc pas pu être réalisée. En ce qui concerne l’acqui-sition des bœufs, cette distance peut cependant êtreévaluée à travers la diversité des tailles des animauxqui ont été consommés sur le site. À l’inverse, cetteanalyse n’a pas pu être effectuée pour le site deBraives faute de disposer d’un corpus ostéométriquesuffisant. Le coefficient de variation des bœufs a étécalculé pour les données métriques d’assemblagesosseux provenant de deux sites à Tongres : le site de laHondstraat daté de la période flavienne – premièremoitié du IIe s. et celui de la kielenstraat daté du IIe s.ap. J.-C.24. Ces données sont comparées à celles deneuf sites en France datés entre La Tène et la périoderomaine qui ont été publiées par T. Oueslati et al25.Les valeurs du coefficient de variation pour les diffé-rents sites sont comprises entre 8,27 et 12,59. Les sitessont classés par ordre décroissant de la valeur du coef-ficient de variation dans le tableau 7. Un site a unevaleur de coefficient de variation plus élevé queTongres-kielenstraat : le site de La Tène à Villeneuve-Saint-Germain. Cependant, la comparaison avec lesite de Villeneuve Saint-Germain doit être réaliséeavec prudence, étant donné la large fourchette chrono-logique couverte par cet assemblage comparé à ceux
de la période romaine. Il en ressort que les deux sitesde Tongres ont des valeurs plus élevées que les autresvilles romaines de Lyon, Paris, Saint-Marcel, Arras etVieux. Par conséquent, il peut être établi que lesbœufs de Tongres présentent une grande diversité detaille pendant la période flavienne et le IIe s.
En conclusion, des indicateurs d’une distance rela-tivement grande entre producteurs et consommateursen ce qui concerne l’approvisionnement en bœufs ontété relevés tant pour la ville de Tongres que l’agglo-mération de Braives. En revanche, l’identification defœtus de porcs et de caprinés indique que ces espècesétaient élevées à Braives, sans toutefois pouvoir éva-luer l’importance de cette activité sur la base de cesseuls témoins.3.3. Approche de la transformation des produitsanimaux
Des différences de traitement entre les grandsbovins et les petits ongulés apparaissent aussi auniveau des modes de transformation de leurs produits.Une activité de boucherie bovine professionnelle àlarge échelle a été identifiée à Tongres et à Braives.Un assemblage d’ossements typique de cette activité aété mis au jour dans un contexte datant de la deuxième
UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ ENTRE LA VILLE DE TONGRES ET SON ARRIèRE-PAyS ? 161
24. — BOUSSIER 2011. 25. — OUESLATI, ROBIN 2006.
Tableau 6. — Présence de carcasses d’animaux domestiques dans les puits de Braives et Tongres.
Tableau 7. — Données statistiques des mesures de la largeur distale des métatarses de bœufs à Tongres et sur neuf sites français de comparaison. Les sites sont classés selon l’ordre décroissant de la valeur du coefficient de variation.
Site Chronologie Porc Bœufs Caprinés Chien Cheval Références
Braives Hab. sous fort. Fin IIIe s. x (foetus) x x (foetus) x x Lentacker, Van Neer 1993Tongeren Extra-muros - x Gautier 1975Tongeren Kielenstraat IIIe s. x x Vanderhoeven, Van De Konijnenburg 1987Tongeren Veemarkt Deuxième moitié x Vanderhoeven, Ervynck 1993
du IIe s.
Site Nature N Moyenne Min Max Dev.Std Coeff. V.
Villeneuve-St-Germain Urbain-La Tène 99 48,57 50,5 63 6,12 12,59Tongres-Kielenstraat IIe s. Urbain 21 53,47 44,8 68,4 6,5 12,15Lyon Urbain 41 54,07 45,2 67,5 6,39 11,82Tongres-Hondstraat Flavien- Urbain 46 54,36 42,7 67,1 6,33 11,64première moitié du IIe s.Lutecia Urbain 68 60,86 44,9 76 6,81 11,19Saint-Marcel Urbain 144 51,17 44 70 5,36 10,47Arras Urbain 29 57,38 43,9 71,4 5,92 10,32Zouafque Rural 19 58,54 49,4 66,7 5,6 9,56Levroux Urbain-La Tène 15 50,86 42,4 58,9 4,51 8,87Meulan Port 29 50,69 45 61 4,42 8,73Vieux Urbain 19 53,41 48,7 64,2 4,42 8,27
moitié du IIe s. sur le site de la kielenstraat26.L’assemblage est majoritairement composé de frag-ments crâniens et de vertèbres thoraciques, qui sontdes éléments squelettiques rejetés au début du traite-ment de la carcasse27. De plus, plusieurs artisanatsdépendant de ces boucheries bovines pour leur appro-visionnement en matière première étaient établis àTongres au moins dès la période flavienne. Des lotsd’ossements attestent la présence d’une activité detabletterie sous le site du musée gallo-romain deTongres, du travail de la corne et/ou de tannerie sur lesite de l’Elisabethwal et d’une large production degraisse, moelle et colle sur le site de la Hondstraat.Bien que non mentionnée dans la publication ini-tiale28, une activité de boucherie bovine profession-nelle est attestée à Braives. Un assemblage fauniquemis au jour dans un dépotoir fouillé dans la zone cen-trale du vicus, datant de la fin IIe-début du IIIe s., peutêtre rattaché à cette activité. On enregistre une pré-pondérance d’os de bœufs dans l’assemblage (99 %du NRtotal : 504) et une surreprésentation de certainséléments squelettiques (principalement des côtes etdans une moindre mesure des omoplates) qui consti-tuent des déchets typiques de boucherie. Les côtesprésentent en outre des incisions longitudinales quisont réalisées lors du désossage de la viande29. Unpetit lot d’os longs fortement fragmentés a égalementété rejeté dans le dépotoir (NR : 81). Ce sont desdéchets de la production de graisse, moelle et colle30,
mais sur la base de ces vestiges, il est difficile dedéterminer l’ampleur de cette activité. Des boucheriesbovines professionnelles ont été identifiées dans d’au-tres agglomérations de la région lœssique, comme parexemple à Tirlemont, Maastricht et Liberchies31. Lesbœufs faisaient très certainement l’objet d’un abattageet d’une découpe au sein de l’unité domestique paral-lèlement à leur traitement en boucherie, comme celaest attesté à Paris32. Par ailleurs, la découpe du porc etdes caprinés au sein des boucheries professionnellesn’est pas connue à ce jour dans la zone lœssique de lamoyenne Belgique33. Bien que des exceptions soientconnues sur le territoire des Gaules, les données dis-ponibles jusqu’à présent montrent que la boucherieprofessionnelle se concentre sur les bœufs.
4. PRODUCTION ET CONSOMMATION DE PRODUITS ANIMAUX SUR LES SITES RURAUXAUTOUR DE TONGRES
Si l’on compare les proportions des principauxmammifères domestiques sur les sites de Broekom,Piringen et Velroux, on constate la prépondérance desbœufs sur le porc et les caprinés au cours des Ier et IIe s.(fig. 3). Les assemblages de Velroux indiquent que lesbœufs sont prédominants à partir de la période clau-dienne et jusque dans le courant du IIe s.
Cependant, les indices d’une diversité dans la pro-duction des campagnes ont été relevés, comme le
162 FABIENNE PIGIèRE, ANNICk LEPOT
26. — VANDERHOEVEN, VyNCkIER 1991.27. — LEPETz 2007.28. — CORDy 1981.29. — LEPETz 2007.
30. — STOkES 2000 ; LENTACkER, PIGIèRE 2001.31. — PIGIèRE 2009.32. — OUESLATI 2006.33. — PIGIèRE 2009.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Broeko
m IIe -III
e s. (n
=166
)
Piringe
n 65/7
0-85/9
0 (n=
122)
Velrou
x 40/4
5-65/7
0 (n=
118)
Velrou
x 110
/120-1
65/17
5 (n=
197)
Velrou
x IIe s.
(n=2
72)
Velrou
x IIe -III
e s. (n
=133
)
Velrou
x 230
/240-2
70/28
0 (n=
172)
Verlain
e 110
/120-1
65/17
5 (n=
128)
Liège
100-2
50 (2
mm n=
1911
)
Verlain
e 1re m
oitié
du III
e s. (n
=845
)
Verlain
e 1re m
oitié
du III
e s. (5
mm n=
1403
)
Porc
Caprinés
Bœuf
FIG. 3. — Proportions relatives du porc, du bœuf et des caprinés sur les sites ruraux dans les environs de Tongres.
montre une comparaison entre les sites rurauxcontemporains de Verlaine et Velroux. Ces deux sitessont localisés à 8 km l’un de l’autre et sont implantésdans le même terroir, sur le fertile plateau lœssique(fig. 4). Pourtant, des différences entre les deux sitesapparaissent lorsque l’on examine l’importance rela-tive des principaux mammifères domestiques. Lebœuf est prépondérant à Velroux au cours des Ier etIIe s. Au IIIe s., on relève une diminution de la fré-quence du bœuf au profit du porc, tandis que les capri-nés viennent seulement en troisième position. Cechangement a été mis en évidence au sein des diffé-rents assemblages fauniques issus de plusieurs typesde contextes (dépotoirs, comblement d’un puits, épan-dages de déchets). Cette évolution apparaît ainsicomme une tendance générale sur le site et elle peutdès lors indiquer une nouvelle orientation dans lespratiques d’élevage à Velroux dans le courant du IIIe s.
Pour Verlaine, les données pour le IIe s. sont relative-ment limitées et elles montrent une prépondérance duporc au sein des animaux de la triade. Pour le IIIe s. àVerlaine, les données sont plus nombreuses et l’onconstate une prédominance des caprinés et du porc,tandis que le bœuf n’occupe que la troisième position.
Les âges d’abattage des caprinés ont pu être recons-titués pour le site de Verlaine. Ils ont été établis sur labase des mandibules découvertes dans le remplissaged’un puits situé à proximité du bâtiment principal etdaté de la première moitié du IIIe siècle (fig. 5). La fré-quence de chaque classe d’âge a été corrigée en pro-portion de sa probabilité, suivant la méthode de J.-D.Vigne et D. Helmer34. De plus, le profil de mortalité aété comparé aux modèles d’exploitation pour la pro-duction de viande, de lait et de laine proposés parD. Helmer et L. Gourichon35. La courbe d’abattage
UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ ENTRE LA VILLE DE TONGRES ET SON ARRIèRE-PAyS ? 163
34. — VIGNE, HELMER 2007. 35. — HELMER, GOURICHON 2007.
FIG. 4. — Localisation des sites de Velroux et Verlaine sur le plateau hesbignon, par rapport au relief, à gauche, et aux types de sols, à droite. APIS-UCL/CRAN.
établie pour Verlaine indique que la plupart des ani-maux ont été abattus avant d’avoir atteint l’âge d’unan (79 %). Le pic d’abattage principal correspond à unâge de 2-6 mois (53 %). Les animaux restants ontensuite été abattus entre 3 et 4 ans et surtout entre 4 et6 ans. Le profil d’abattage de Verlaine est proche dumodèle de production de viande de type A proposé parD. Helmer et L. Gourichon36, dans lequel de nombreuxagneaux sont tués entre 2 mois et un an. Cependant, lenombre significatif d’animaux tués avant l’âge de2 mois et entre 4 et 6 ans suggère une exploitationmixte de viande, lait et laine. Étant donné que ces ves-tiges fauniques ont été rejetés à proximité du bâtimentprincipal, il y a de grandes chances qu’ils représententles restes de la consommation des habitants de lademeure principale. Ceci peut amener à un biais enfaveur des jeunes animaux élevés pour la viande. Enconséquence, la production de lait et de laine pourraitavoir été plus importante dans l’économie de l’exploi-tation agricole que ne l’indiquent ces données.
À Velroux, quelques données sont disponibles pourétudier les âges d’abattage des bœufs. Les donnéesépiphysaires semblent indiquer que ce sont principale-ment des individus adultes qui ont été consommés àVelroux (tab. 8). Les quelques données dentaires dis-ponibles sur les âges confirment les résultats des âgesépiphysaires. En effet, sur un total de douze mandi-bules, huit proviennent d’animaux adultes et très âgés,deux appartiennent à de jeunes adultes et deux autres àdes sub-adultes. Il est également intéressant de releverla présence d’animaux de plus grande taille à Velrouxen comparaison avec les sites proches de la vallée dela Meuse (Verlaine et Froidmont). Les mesures de lon-
gueur et largeur des os longs de bovins de Velroux,Verlaine et Froidmont ont été comparées en utilisant lelog size index et c’est à Velroux que les plus grandsanimaux ont été enregistrés (fig. 6-7). Or, en faisantappel aux données d’âge d’abattage, au sex ratio etaux pathologies associées à la traction, une étudearchéozoologique réalisée précédemment a montréque les grands bœufs étaient élevés dans le but priori-taire d’être utilisés comme animaux de traction37.
164 FABIENNE PIGIèRE, ANNICk LEPOT
36. — Ibidem. 37. — PIGIèRE 2009, 2011.
0
10
20
30
40
50
60
0-2 mois 2-6 mois 6-12 mois 1-2 an(s) 2-3 ans 3-4 ans 4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans
%
FIG. 5. — Profil de mortalité des caprinés dans le courant dela première moitié du IIIe s. sur le site de Verlaine (NMI = 29).
FIG. 6. — Diagramme des log size index pour les mesures de longueur des métatarses de bœufs à Velroux, Verlaine
et Froidmont.
Tableau 8 — Données sur les âges épiphysaires des bœufspour la fin du Ier-IIIe s. sur le site de Velroux.
7-10 mois F NFScapula, tuber scapulae 1 -Pelvis, acetabulum - -NR total 1 -1 an - 1 an 1/2 F NFHumerus, distal 6 -Radius, proximal 5 -Phalanx 1, proximal 8 -Phalanx 2, proximal 3 -NR total 22 -2 - 3 ans F NFMetacarpus, distal 2 1Tibia, distal 4 -Metatarsus, distal 1 -Metapodia, distal 1 -NR total 8 13 ans 1/2 - 4 ans F NFHumerus, proximal 1 -Radius, distal 1 -Ulna, proximal 1 -Femur, proximal 2 -Femur, distal - -Tibia, proximal 2 -Calcaneum, proximal - -NR total 7 -
0
1
2
3
4
-0.3 -0.26 -0.22 -0.18 -0.14 -0.1 -0.06 -0.02 0,02
n
LSI
Verlaine Velroux Froidmont
5. DÉFINIR LES RÉSEAUX D’ÉCHANGES RÉGIONAUX :L’INTÉRÊT DES CÉRAMIQUES CULINAIRES
Le mobilier céramique provenant des fouilles desétablissements ruraux autours de Tongres confirmeque les habitants avaient accès à des produits prove-nant du grand commerce à partir du milieu du Ier s.jusqu’à la fin du IIIe s. : sigillées du Sud, du Centre etde l’Est de la Gaule, amphores de Narbonnaise ou ibé-riques entre autres. Des produits provenant des citésvoisines témoignent également d’un commerce trans-régional : vaisselles de table issues des ateliers deCologne ou de Trèves, mortiers provenant de la régionde Bavay, ou encore cruches-amphores fabriquéesdans le bassin de l’Escaut. Cet approvisionnement àlongue distance (100-150 km) concerne donc pourl’essentiel, la vaisselle de table et les conteneurs dedenrées spécifiques. Pour se fournir en récipients decuisson – marmites, jattes, plats et autres couvercles –l’approvisionnement est nettement plus local. Dans larégion étudiée, les ateliers produisant des récipients decuisson n’apparaissent, a priori, pas avant l’époqueclaudienne. Ils sont localisés dans un premier temps àTongres38, et se développent dans les agglomérationsdès l’époque flavienne – à Amay, à Jupille-sur-Meuseou plus à l’ouest de la zone d’étude, à Tirlemont39
(fig. 8). Ces implantations en relation avec un réseauroutier ou fluvial, voire les deux, mettent les potiers enlien avec une clientèle de passage nettement plusimportante40. Ces ateliers proposent également de lavaisselle de table et pour certains, comme Amay, desmortiers et des cruches. Ces artisans répondent à unedemande, ou plutôt requièrent une demande « renta-
ble » de la population. Leur implantation à Tongres vade pair avec le développement urbanistique de laville41 et l’installation des premières exploitationsagricoles dans l’arrière-pays de la capitale. Ils reflè-tent la mise en place de ce système d’économie demarché dans lequel les habitants de la campagne sontdépendants d’un produit spécifique qu’ils ne produi-sent pas ou plus, à l’inverse donc des ressources ani-males.
L’identification de céramiques culinaires issues desateliers de Tongres dans les assemblages céramiquesissus des sites ruraux nous permet d’évaluer l’impor-tance de cette production dans l’approvisionnementdes habitants. Durant la seconde moitié du Ier s., lematériel archéologique des sites de Piringen etBroekom montre que les occupants se sont approvi-sionnés, quasi exclusivement en céramique culinaireprovenant des ateliers de la capitale42. Les donnéesdisponibles pour le IIe s. sur les sites de Velroux etVerlaine attestent de l’importance de cette fabrique ausein de l’approvisionnement régional. Les ateliers dela capitale ne sont évidemment pas les seuls à offrir cetype de produits aux consommateurs. Dans les assem-blages céramiques du IIe s., l’appoint est couvert pardes récipients provenant de la région de l’Entre-Meuse-et-Rhin. Ces observations sur le matériel céra-mique appuient l’importance de la capitale commeplace de marché et mettent également en lumière lerôle économique de la chaussée Bavay-Cologne. À cetitre, la Meuse, constitue également un second couloird’échange important. Les données disponibles concer-nant l’approvisionnement en céramiques culinaires
UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ ENTRE LA VILLE DE TONGRES ET SON ARRIèRE-PAyS ? 165
38. — VILVORDER, HARTOCH 2010.39. — HANUT 2010.40. — DUFAÿ, BARAT 1997, p. 145.
41. — VANDERHOEVEN 1996 ; COQUELET 2011.42. — LEPOT 2012.
FIG. 7. — Diagramme des log size index pour les mesures de largeur des métatarses de bœufs à Velroux, Verlaine
et Froidmont.
FIG. 8. — Localisation des ateliers de potiers connus ayant fabriqué des récipients culinaires dans la partie centrale
de la cité des Tongres. APIS-UCL/CRAN.
0
1
2
3
4
5
6
7
-0.4 -0.36 -0.32 -0.28 -0.24 -0.2 -0.16 -0.12 -0.08 -0.04 0 0,04
n
LSI
Verlaine Velroux Froidmont
des exploitations rurales durant le IIIe siècle permettentde discerner différents mécanismes d’échanges. Àcôté de la vaisselle produite dans la capitale et tou-jours bien présente dans les assemblages, une autrefabrique fait une apparition significative dans lescomptages. Il s’agit d’une production dont l’origineest à localiser dans le bassin moyen de la Meuse43.L’étude du matériel de plusieurs sites ruraux situés àmoins de 10 kilomètres du sillon mosan – ceux deFroidmont notamment, mais également de Rosmeer,d’Eben-Emaël et de Verlaine – démontre l’importancede cette fabrique dans l’approvisionnement des sitesau IIIe s.44. La proximité de la vallée mosane est proba-blement une des explications. Pourtant, les données dusite de Velroux, plus proche de la Meuse que de lacapitale montrent une constante dans l’approvisionne-ment en céramique de cuisson provenant toujoursmajoritairement de Tongres. L’étude céramologiquepermet donc de faire deux observations : les habitantsdes exploitations agricoles de l’arrière-pays entretien-nent des relations commerciales avec la ville deTongres de manière plus ou moins soutenue entre leIer s. et le IIIe s. au moins en ce qui concerne l’approvi-sionnement en vaisselle d’usage commun et donc pro-bablement pour d’autres types de produits. En secondlieu, il n’existe pas un schéma unique, d’autres placesde marché, localisées sur des axes commerciauxcomme la Meuse, ont également joué un rôle attractifen raison soit de leur proximité, soit en fonction desmarchés visés pour la revente des produits de l’exploi-tation agricole45.
6. PRODUCTION ET REDISTRIBUTION DE SURPLUS ANIMAUX DANS LE RÉSEAU D’ÉCHANGE DE LA RÉGION DE TONGRES
Les activités de boucherie bovine professionnellesont probablement l’expression la plus marquante dusystème centralisé romain d’approvisionnement ennourriture qui se développe pour répondre au besoind’importantes populations sur les sites urbains et mili-taires. La présence de ces boucheries professionnellesà Tongres et Braives nécessite un approvisionnementen bœufs à une grande échelle. Les données archéo-zoologiques provenant des rejets de consommationdes habitants de la ville et de l’agglomération confir-ment que les bœufs sont les principaux pourvoyeursen viande tout au long du Haut-Empire. Les premiersindices sur la distance entre producteurs et consom-mateurs semblent montrer que les deux sites dépen-daient des campagnes pour leur approvisionnement en
bœufs. Cependant, les inégalités relevées dans lesschémas d’abattage semblent indiquer que les bœufsconsommés à Tongres sont issus d’un régime d’éle-vage différent de ceux consommés à Braives. En effet,à Braives il s’agit de sub-adultes et de jeunes adultesélevés pour la viande. À Tongres, les quelques don-nées collectées sur les âges montrent que les bœufssont principalement des adultes, y compris au seind’occupations liées aux riches habitants de la ville, etqu’ils ont été élevés en premier lieu pour servir d’ani-maux de traction et/ou pour la production de lait et lareproduction.
Les bœufs sont également les plus consommés surles sites ruraux de Broekom, Velroux et Piringen aucours des Ier et IIe s. par rapport aux porcs et aux capri-nés. Sur le site rural de Velroux, les indicationsconjointes sur l’âge d’abattage tardif des animaux et laprésence d’individus de grandes tailles semblent indi-quer que les bœufs ont été élevés pour le travail detraction. Ces résultats sont cohérents avec la vocationagraire de la fertile région lœssique. Dans une écono-mie orientée vers cette activité, les bovins jouent unrôle complémentaire en fournissant de l’engrais et enservant pour les labours agricoles. Arrivés à l’âgeadulte, ils sont, pour une part, consommés sur place,mais ils ont également pu alimenter les boucheriesspécialisées de Tongres. Cette hypothèse s’appuie surle fait que les habitants des exploitations agricoles del’arrière-pays s’approvisionnent en céramiques culi-naires sur les marchés de Tongres comme on l’a vupour Piringen et Broekom, entre la seconde moitié duIer et le IIe s., et pour le site de Velroux du Ier au IIIe s.
Toutefois, les indices d’une diversité dans la pro-duction agro-pastorale des exploitations agricolessituées dans les environs de Tongres ont été collectésgrâce à une comparaison entre le site de Velroux etcelui de Verlaine. Ainsi, à Velroux, les donnéesarchéozoologiques montrent que le porc domineparmi les principaux pourvoyeurs en viande, tandisque le bœuf occupe la deuxième position au cours duIIIe s. À Verlaine, les caprinés et le porc sont les princi-paux pourvoyeurs en viande à cette période. Le profilde mortalité des caprinés à Verlaine suggère que lesfinalités de leur élevage étaient mixtes et orientéesvers la production de viande, lait et laine. Différentstypes de surplus ont donc pu être produits par chacunde ces sites ruraux en fonction des marchés visés. Cecas est d’autant plus intéressant que les données céra-mologiques de Verlaine montrent que les habitants
166 FABIENNE PIGIèRE, ANNICk LEPOT
43. — HANUT 2010.44. — LEPOT, ESPEL 2010, p. 234-235, fig. 15.45. — Il n’est évidemment pas exclu que ce rôle ait également pu être
tenu par des agglomérations routières, comme Braives, mais les don-nées disponibles ne permettent pas encore de les documenter.
s’approvisionnaient majoritairement en récipients decuisson dans les ateliers de Tongres durant le IIe s. Ilsmodifient leurs habitudes au siècle suivant et semblentfréquenter un marché achalandé en céramiques prove-nant de la vallée mosane. Au cours de la mêmepériode, les occupants du site de Velroux, qui se situeà 8 km à vol d’oiseau continuent eux d’approvisionnerleur cuisine avec une grande majorité de récipients decuisson provenant des officines de la capitale. Cecimontre que ces sites ruraux46, localisés tout deux sur leplateau limoneux fertile, le long d’un même réseauroutier et à proximité de la vallée mosane peuvent êtreimpliqués dans différents réseaux d’échanges (fig. 4).L’étude de la provenance des céramiques culinairespermet une approche de la circulation des biens deconsommation et d’identifier en particulier les mar-chés sur lesquels les métayers sont susceptiblesd’écouler les surplus agricoles : en l’occurrence, lacapitale de Tongres pour Velroux et une aggloméra-tion mosane, éventuellement Amay, pour Verlaine.
CONCLUSION
La présente recherche a montré la nécessité d’uneapproche globale prenant en compte tant les sites pro-ducteurs que consommateurs au sein d’une microré-gion pour approcher la production et la redistributionde surplus animaux. Au moyen d’une démarche inter-disciplinaire associant l’étude de la céramique culi-naire et des données archéozoologiques provenant desmêmes sites, il est possible d’aborder les relationsd’échange entre la ville et la campagne et d’évaluerles surplus produits par les sites ruraux. Cetteapproche met en évidence le rôle important de la capi-tale, mais également des agglomérations commeplaces de marché et centres de redistribution au seind’une même microrégion. Les résultats de cette étudemontrent également le rôle important que jouaient lesbœufs dans l’approvisionnement en masse de viandeet de produits artisanaux des habitants de la ville deTongres et de Braives tout au long du Haut-Empireromain. Les bœufs sont également prépondérants surles sites ruraux de la campagne environnante. Cesexploitations agricoles ont donc pu fournir les bouche-ries mises en évidence dans la capitale. Toutefois,seules des indices préliminaires ont pu être collectéssur le mode d’acquisition des bœufs à Tongres etBraives. Il reste dès lors à constituer une large base dedonnées sur les âges d’abattage des bœufs à Tongrespour confirmer les résultats obtenus par l’approchemétrique, celle-ci indiquant une relative distance entre
producteurs et consommateurs. Néanmoins, les don-nées récoltées reflètent la mise en place d’une écono-mie de marché entre la ville de Tongres, l’aggloméra-tion de Braives et les sites ruraux dans laredistribution des biens de consommations. Les orien-tations différentes dans les activités d’élevage quesemblent prendre les habitants des établissementsruraux peuvent résulter de l’influence de plusieursfacteurs, parmi lesquels on épinglera les voies decommunication, les marchés visés et les caractéris-tiques du terroir. Dans le futur, il faudrait multiplier cetype d’étude en vue de confronter les données rela-tives aux régions agricoles, aux activités agro-pasto-rales des sites ruraux et aux réseaux d’échanges danslesquels les sites sont impliqués.
Mots-clés : archéozoologie, céramologie, Haut-Empire romain, cité des Tongres, ville, campagne,économie de marché.
BibliographieBOUSSIER 2011 : BOUSSIER J., Voedseleconomie in RomeinsTongeren : faunaresten uit de opgravingen aan de Kielenstraat(eind 1ste – begin 3de eeuw n. Chr.), Louvain, 2011. (Mémoirede maîtrise inédit, katholieke Universiteit Leuven)BRULET, VILVORDER 2010 : BRULET R., VILVORDER F., DELAGER., La céramique romaine en Gaule du Nord. Dictionnaire descéramiques. La vaisselle à large diffusion, Turnhout, 2010.COQUELET 2011 : COQUELET C., Les capitales de cité des pro-vinces de Belgique et de Germanie. Étude urbanistique,Louvain-la-Neuve, 2011.CORDY 1981 : CORDy J.-M., « Archéozoologie », dans BRULETR. (dir.), Braives Gallo-Romain. I. La zone centrale, Louvain-la-Neuve, 1981, p. 191-200. (Publication d’Histoire de l’Art etd’Archéologie de l’Université catholique de Louvain, XXVI)CORDY 1984 : CORDy J.-M., « Villa de Latinne : archéozoolo-gie », dans VAN OSSEL P., PLUMIER J., CLAEyS P. (éds.),Archéolo-J. 15 années, 15 chantiers, Rixensart, 1984, p. 83-84.CORDY, STASSART 1983 : CORDy J.-M., STASSART M.,« Archéozoologie », dans BRULET R. (dir.), Braives Gallo-Romain. II. Le quartier des potiers, Louvain-la-Neuve, 1983,p. 190-200. (Publication d’Histoire de l’Art et d’Archéologiede l’Université catholique de Louvain, XXXVII)CORDY, RAPAILLE 1985 : CORDy J.-M., RAPAILLE A.,« Archéozoologie », dans BRULET R. (dir.), Braives Gallo-Romain. III. La zone périphérique occidentale, Louvain-la-Neuve, 1984, p. 137-147. (Publication d’Histoire de l’Art etd’Archéologie de l’Université catholique de Louvain, XLVI)
UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ ENTRE LA VILLE DE TONGRES ET SON ARRIèRE-PAyS ? 167
46. — Pour répondre à une question formulée lors du colloque, la tailleet la typologie des deux sites est difficile à prendre en compte dans
l’analyse en raison des fouilles inégales, extensives à Velroux, limitéesà une parcelle cadastrale à Verlaine (DESTEXHE 1994 et 1996).
DE CUPERE, DURU 2003 : DE CUPERE B., DURU R., « Faunalremains from Neolithic Höyücek (SW-Turkey) and the pres-ence of early domestic cattle in Anatolia », Paléorient, 29/1,p. 107-120.DESTEXHE 1994 : DESTEXHE G., « La villa gallo-romaine de la“Campagne du Vivier” à Verlaine », Archéologie hesbignonne,12, 1994, p. 23-98.DESTEXHE 1996 : DESTEXHE G., « Un remarquable puits gallo-romain à Verlaine », Archéologie hesbignonne, 14, 1996, p. 3-93.DUFAŸ, BARAT 1997 : DUFAÿ B., BARAT y., RAUX St.,Fabriquer de la vaisselle à l’époque gallo-romaine -Archéologie d’un centre de production céramique en Gaule -La Boissière-École (Yvelines - France) (Ier et IIIe siècles aprèsJ.-C.), Versailles, 1997.ERVYNCK, VANDERHOEVEN 1997 : ERVyNCk A., VANDERHOEVENA., « Tongeren (Belgium) : changing patterns of meat con-sumption in a Roman civitas capital », Anthropozoologica, 25-26, p. 457-464.FERDIÈRE 2001 : FERDIèRE A., « La “distance critique” : arti-sans et artisanat dans l’Antiquité romaine et en particulier enGaule », dans Les Petits Cahiers d’Anatole (publ. en ligne del’UMR Archéologie et Territoires), 1, 07/02/2001(http://www.univ-tours.fr/lat/F2_1.html)GARNSEY, WHITTAKER 1985 : GARNSEy P., WHITTAkER C. R.,« Rural life in the later Roman Empire », dans CAMERON A.(éd.), The Late Empire, Cambridge, 1985, p. 312-335. (TheCambridge ancient history, XIII)GAUTIER 1975 : GAUTIER A., « De dierlijke skeletresten », dansMERTENS J. et VAN VINCkENROyE W. (éds.), Een Romeinsgebouwencomplex extra-muros te Tongeren, Tongeren, 1975,p. 53-54. (Publicaties van het Provinciaal Gallo-RomeinsMuseum te Tongeren, 22)GAUTIER, HOFFSUMMER 1988 : GAUTIER A., HOFFSUMMER P.,« Les restes d’animaux de la zone septentrionale », dansOTTE M. (éd.), Les fouilles de la Place Saint-Lambert à Liège2. Le vieux marché, Liège, 1988, p. 227-232. (Études etRecherches Archéologiques de l’Université de Liège, 23)GRANT 1982 : GRANT A., « The use of tooth wear as a guide tothe age of domestic animals », dans WILSON B., GRIGSON C.,PAyNE S. (éds.), Ageing and sexing animal bones from archae-ological sites, Oxford, 1982, p. 91-108. (BAR British Series,109)HANUT 2010 : HANUT Fr., « La présence romaine à Andenne etl’artisanat gallo-romain de la céramique dans la vallée de laMeuse (Ier-Ve siècles apr. J.-C.) », dans GOEMAERE É. (dir.),Terres, pierres et feu en vallée mosane. L’exploitation des res-sources naturelles minérales de la commune d’Andenne : géo-logie, industries, cadre historique et patrimoines culturel etbiologique, Bruxelles, 2010, 53-66. (Geosciences)HELMER, GOURICHON 2007 : HELMER D., GOURICHON L., VILAE., « The development of the exploitation of products fromCapra and Ovis (meat, milk and fleece) from the PPNB to theEarly Bronze in the northern Near East (8700 to 2000 BCcal.) », Anthropozoologica, 42/2, 2007, p. 41-68.HOPKINS 1978 : HOPkINS k., « Economic growth and towns inclassical antiquity », dans ABRAMS Ph., WRINGLEy E. A. (éds.),Towns in societies. Essays in Economic History and historicalSociology, Cambridge, 1978, p. 35-77.KOOISTRA 1996 : kOOISTRA I. L., Borderland farming : possi-bilities and limitations of farming in the Roman period andearly Middle Ages between the Rhine and Meuse, UitgeverijVan Gorcum, Amersfoort, 1996.LENTACKER, VAN NEER 1993 : LENTACkER A., VAN NEER W.,
DESENDER k., « Archéozoologie », dans BRULET R. (dir.),Braives Gallo-Romain. V. La fortification du Bas-Empire,Louvain-la-Neuve, 1993, p. 284-339. (Publications de l’Art etd’Archéologie de l’Université catholique de Louvain,LXXXIII).LENTACKER, PIGIERE 2001 : LENTACkER A., PIGIERE F.,VILVORDER F., « Archéozoologie », dans BRULET R., DEWERTJ.-P., VILVORDER F. (dir.), Liberchies IV. Vicus Gallo-Romain.Travail de rivière, Louvain-la-Neuve, 2001, p. 379-409.(Publications de l’Art et d’Archéologie de l’Université deLouvain, CI)LEPETZ 2007 : LEPETz S., « Boucherie, sacrifice et marché à laviande en Gaule romaine septentrionale : l’apport de l’archéo-zoologie », dans VAN ANDRINGA W. (éd.), Sacrifices, marchés àla viande et pratiques alimentaires dans les cités du monderomain, Food and History, 5 (1), 2007, p. 73-105.LEPOT 2012 : LEPOT A., « Les expressions plurielles des céra-miques culinaires dans le nord de la Gaule : Approche techno-logique », dans BATIGNE-VALLET C. (éd.), Les céramiques com-munes dans leur contexte régional. Faciès de consommation etd’approvisionnement, Lyon, 2012, p. 295-318. (Travaux de laMaison de l’Orient et de la Méditerranée, 60)LEPOT, ESPEL 2010 : LEPOT A., ESPEL G., « Analyses techno-typologique et spatiale des céramiques communes culinaires enGaule septentrionale », dans SFECAG Actes du Congrès deChelles, Marseille, 2010, p. 225-240.MALTBY 1994 : MALTBy J. M., « The meat supply in RomanDorchester and Winchester », dans HALL A. R., kENWARD H. k.(eds.), Urban-rural connexions : perspectives from environ-mental archaeology, Oxford, 1994, p. 85-102. (Symposia of theAssociation for Environmental Archaeology, 12 ; Oxbowmonograph, 47) MEADOW 1999 : MEADOW R. H., « The use of size index scal-ing techniques for research on archaeozoological collectionsfrom the Middle East », dans BECkER C., MANHART H., PETERSJ., SCHIBLER J. (éds.), Historia animalium ex ossibus : Beiträgezur Paläoanatomie, Archäologie, Ägyptologie, Ethnology undGeschichte der Tiermedizin, Festschrift für A. von den Drieschzum 65, Geburtstag, Rahden/Westfalen, 1999, p. 285-300.(Internationale Archäologie, Studia Honoria, 8)OUESLATI 2006 : OUESLATI T., Approche archéozoologique desmodes d’acquisition, de transformation et de consommationdes ressources animales dans le contexte urbain gallo-romainde Lutèce (Paris, France), Oxford, 2006. (BAR Internationalseries, 1479)OUESLATI, ROBIN 2006 : OUESLATI T., ROBIN S., MARQUIS Ph.,« A multidisciplinary approach towards the definition of thestatus of the Gallo-Roman city of Paris : Ceramic and animals-resource production and provisioning », dans MALTBy M. (éd.),Integrating Zooarchaeology, Oxford, 2006 p. 98-108.PAYNE 1973 : PAyNE S., « kill-off patterns in sheep and goats :the mandibles from Asvan kale », Anatolian Studies, 23, 1973,p. 281-303.PIGIÈRE 2009 : PIGIèRE F., Évolution de l’économie alimentaireet des pratiques d’élevage de l’Antiquité au haut Moyen Âge enGaule du nord. Une étude régionale sur la zone limoneuse dela Moyenne Belgique et du sud des Pays-Bas, Oxford,Archaeopress, 2009. (BAR International series, 2035)PIGIÈRE 2011 : PIGIèRE F., « The development of cattle hus-bandry in the Belgian loess region during the Roman period »,dans BoneCommons, Item #1451, http://www.alexandri-aarchive.org/bonecommons/items/show/1451 (accessible depuisle 20 décembre 2011)
168 FABIENNE PIGIèRE, ANNICk LEPOT
PIGIÈRE à paraître : PIGIèRE F., « Archéozoologie », dansVILVORDER F., WEINkAUF E. (dir.), La villa romaine de Grâce-Hollogne, Velroux. Fouilles 2004-2005 dans la zone d’exten-sion de l’aéroport de Liège/Bierset. (Bulletin de la Fédérationdes Archéologues de Wallonie. Namur : Fédération desArchéologues de Wallonie)PIGIÈRE en préparation : PIGIèRE F., « La faune de la villaromaine de Verlaine », dans DESTEXHE G., « Le matériel de lavilla gallo-romaine de la “Campagne du Vivier” à Verlaine :nouvelles études », Archéologie Hesbignonne, en prép.ROYMANS 1996 : ROyMANS N., From the sword to the plough :three studies on the earliest romanisation of Northern Gaul,Amsterdam, 1996. (Amsterdam Archeological Studies, 1)STOKES 2000 : STOkES P. R. G., « The butcher, the cook and thearchaeologist », dans HUNTLEy J. P., STALLIBRASS S. (éds.),Taphonomy and interpretation, 2000, p. 65-70.TRABERT 1990 : TRABERT I., « Paléoenvironnement.Archéozoologie », dans BRULET R. (dir.), Braives Gallo-Romain. IV. La zone centre-ouest, Louvain-la-Neuve, 1990,p. 203-214. (Publications d’Histoire de l’Art et d’Archéologiede l’Université catholique de Louvain, LXXVII)TROMME, VILVORDER 2008 : TROMME F., VILVORDER F.,PIGIèRE F., GRUWIER B., QUINTELIER k., « La villa gallo-romaine de Haccourt/Froidmont-Oupeye », Vie Archéologique,65, 2008, p. 4-81.VANDERHOEVEN 1996 : VANDERHOEVEN A., « The earliesturbanization in Roman Gaul. Some implications of recentresearch in Tongres », dans ROyMANS N. (éd.), From the swordto the plough. Three studies on the earliest Romanisation ofNorthern Gaul, 1996, p. 189-245. (Amsterdam ArchaeologicalStudies, 1)VANDERHOEVEN, VAN DE KONIJNENBURG 1987 :VANDERHOEVEN A., VAN DE kONIJNENBURG R., DE BOE G.,« Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de kielenstraat teTongeren », Archaeologia Belgica, 3, 1987, p. 127-138.VANDERHOEVEN, VYNCKIER 1991 : VANDERHOEVEN A.,VyNCkIER G., VyNCkIER P., « Het oudheidkundig bodemonder-zoek aan de kielenstraat te Tongeren (prov. Limburg) »,Archeologie in Vlaanderen, 1, 1991, p. 107-124.VANDERHOEVEN, VYNCKIER 1992 : VANDERHOEVEN A.,VyNCkIER G., ERVyNCk A., COOREMANS B., « Het oudheidkun-dig bodemonderzoek aan de kielenstraat te Tongeren (prov.Limburg). Interimverslag 1990-1993. Deel 1. De voor-Flavische bewoning », Archeologie in Vlaanderen, 2, 1992,p. 89-146.VANDERHOEVEN, ERVYNCK 1993 : VANDERHOEVEN A., ErvynckA., VAN NEER W., « De dierlijke en menselijke resten », dansVANDERHOEVEN A., VyNCkIER G., VyNCkIER P. (éds.), « Hetoudheidkundig bodemonderzoek aan de Veemarkt te Tongeren(prov. Limburg) », Archeologie in Vlaanderen, 3, 1993, p. 177-186.VANDERHOEVEN, VYNCKIER 1994 : VANDERHOEVEN A.,VyNCkIER G., ERVyNCk A., VAN NEER W., COOREMANS B.,
« Het oudheidkundig bodemonderzoek aan deMinderbroederstraat te Tongeren (prov. Limburg). Eindverslag1991 », Archeologie in Vlaanderen, 4, 1994, p. 49-74.VANDERHOEVEN, ERVYNCK 2007 : VANDERHOEVEN A.,ERVyNCk A., « Not in my back yard ? The industry of second-ary animal products within the Roman civitas capital ofTongeren (Belgium) », dans HINGLEy R., WILLIS S. (éds.),Promoting Roman finds : context and theory, Oxford, 2007,p. 156-175.VANDERHOEVEN, VYNCKIER 2007 : VANDERHOEVEN A.,VyNCkIER G., ERVyNCk A., LENTACkER A., VAN NEER W., DEGROOTE k., « Het oudheidkundig bodemonderzoek aan deMombersstraat te Tongeren (prov. Limburg) », Relicta, 3, 2007,p. 139-151.VAN NEER 1988 : VAN NEER W., « Archeozoölogische vondstenuit de La Tène en de Romeinse periode te Broekom(Limburg) », dans VANVINCkENROyE W., De Romeinse villa hetSassenbroekberg te Broekom, Hasselt, 1988, p. 37-42.(Publicaties van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum teTongeren, 38)VAN NEER 1990 : VAN NEER W., « De archeozoölogische res-ten », dans VANVINCkENROyE W., De Romeinse villa’s vanPiringen (« Mulkenveld ») en Vechmaal (« Walenveld »),Hasselt, 1990, p. 31-33. (Publicaties van het Provin ciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren, 42)VAN NEER 1994 : VAN NEER W., « Het dierlijk beendermate -riaal », dans VANVINCkENROyE W., Een bijdrage tot het stads-kernonderzoek van Romeins Tongeren, Hasselt, 1994, p. 28-36.(Publicaties van het Gallo-Romeins Museum Tongeren, 46)VIGNE, HELMER 2007 : VIGNE J.-D., HELMER D., « Was milk a“secondary product” in the Old World Neolithisation process ?Its role in the domestication of cattle, sheep and goats »,Anthropozoologica, 42 (2), 2007, p. 9-40.VILVORDER, HARTOCH 2010 : VILVORDER F., HARTOCH E.,VANDERHOEVEN A., LEPOT A., « La céramique de Tongres, qua-tre siècles de production d’un caput civitatis », dans SFECAG Actes du Congrès de Chelles, Marseille, 2010,p. 241-255.VON DEN DRIESCH 1976 : VON DEN DRIESCH A., A guide to theMeasurements of Animal Bones from Archaeological Sites,Cambridge, 1976. (Peabody Museum Bulletin, 1)WALLACE-HADRILL 1991 : WALLACE-HADRILL A., « Elites andtrade in the Roman town », dans RICH J., WALLACE-HADRILL A.(éds), City and country in the Ancient World, London and Newyork, 1991, p. 241-271. (Leicester-Nottingham Studies inAncient Society, 2)YERNAUX, UDRESCU 1992 : yERNAUX G., UDRESCU M., CORDyJ.-M., « Archéozoologie », dans BRULET R. (dir.), BraivesGallo-Romain V. La fortification du Bas-Empire, Louvain-la-Neuve, 1992 225-237. (Publications d’Histoire de l’Art etd’Archéologie de l’Université catholique de Louvain, 83)
UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ ENTRE LA VILLE DE TONGRES ET SON ARRIèRE-PAyS ? 169
Sommaire
Préface Michel Reddé 9Xavier Deru,
Discussion préalable autour du concept de consommation. Ricardo González Villaescusa 13
Se nourrirL’essor des blés nus en France septentrionale : Véronique Zech-Matterne,systèmes de culture et commerce céréalier autour de Julian Wiethold et Bénédicte Pradatla conquête césarienne et dans les siècles qui suivent. avec la coll. de Françoise Toulemonde 23Mouture de subsistance, d’appoint et artisanat alimentairede rendement. Les meules gallo-romaines entre villeset campagnes dans le nord de la Gaule. Paul Picavet 51Le matériel de mouture des habitats du Pôle d’activités Alexandre Audebert,du Griffon, à Barenton-Bugny et Laon (Aisne). Vincent Le Quellec 67Les meules rotatives en territoire carnute : provenances et consommation. Boris Robin 85La consommation des poissons en France du nord àla période romaine. Marqueur socio-culturel et Benoît Clavel etartefacts taphonomiques. Sébastien Lepetz 93Coquillages des villes et coquillages des champs :une enquête en cours. Anne Bardot-Cambot 109La consommation des ressources animales en milieu rural :quels indices pour quelle caractérisation de cet espacesocio-économique ? Tarek Oueslati 121Caractérisation de la consommation d’origine animale et Sophie Lefebvre,végétale dans une exploitation agropastorale du début de Emmanuelle Bonnaire, Samuel Lacroixl’Antiquité à Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais). et Oscar Reverter-Gil 129La diversité morphologique du porc en tant qu’indicateurdes mécanismes de gestion de l’élevage porcin et del’approvisionnement des villes romaines. Apport de l’analyse Tarek Oueslati,du contour des troisièmes molaires inférieures du porc. Catherine Cronier 151Une économie de marché entre la ville de Tongres etson arrière-pays ? Les exemples de la gestion des ressources animales et de l’approvisionnement en Fabienne Pigière etcéramique. Annick Lepot 155De la viande et des pots dans la proche campagne David Germinet,d’Avaricum (Bourges-Cher) : exemple de la villa Emmanuel Marot,de Lazenay et mise en perspective. Marilyne Salin 171La céramique des quatre habitats du IIIe siècle du« Pôle d’activité du Griffon » à Barenton-Bugny etLaon (Aisne). Amélie Corsiez 181La consommation alimentaire d’après la céramique enChampagne : comparaisons raisonnées entre la capitale Anne Delor-Ahü,des Rèmes et son territoire. Pierre Mathelart 193
La consommation de denrées méditerranéennes dans lesmilieux ruraux de la Cité des Tongres : le témoignage desamphores. Noémie Nicolas 219
Se logerLa circulation des terres cuites architecturales dans lesud-est de l’Entre-Sambre-et-Meuse et zones contiguës, Laurent Luppens etd’après la répartition des estampilles. Pierre Cattelain 227Diffusion des tuiles dans le nord de la Gaule : Guillaume Lebrun,le cas de la région d’Orchies (Nord). Gilles Fronteau 249
Échanger
La monétarisation des grands domaines ruraux de Gaule septentrionale : une problématique nouvelle. Jean-Marc Doyen 267La circulation monétaire dans les campagnes du Languedoc à l’époque gallo-romaine : une première approche. Marie-Laure Berdeaux-Le Brazidec 277
Guillaume Varennes, Cécile Batigne-Vallet, Christine Bonnet,François Dumoulin, Karine Giry,Colette Laroche, Odile Leblanc,Guillaume Maza, Tony Silvino et
Apports de l’ACR Céramiques de cuisine d’époque l’ensemble des collaborateurs deromaine en région Rhône-Alpes et Sud-Bourgogne à l’ACR Céramiques de cuisine d’époque la question des faciès céramiques urbains et ruraux : romaine en région Rhône-Alpes et bilan, limites et perspectives. Sud-Bourgogne 291
Consommer à l’échelle du site et de la régionMatthieu Poux avec la coll. deBenjamin Clément, Thierry Argant,Fanny Blanc, Laurent Bouby,Aline Colombier, Thibaut Debize,Arnaud Galliegue, Amaury Gilles,Lucas Guillaud, Cindy Lemaistre,Marjorie Leperlier, Gaëlle Morillon,
Produire et consommer dans l’arrière-pays colonial de Margaux Tillier, Yves-Marie ToutinLugdunum et de Vienne : étude de cas. Aurélie Tripier 323La Vulkaneifel occidentale comme lieu de consommation et de production du Ier au IVe siècle. Peter Henrich 357
Résumés (français, anglais). 365





























![L'organisation territoriale dans le nord-ouest de la péninsule ibérique (VIIIe-Xe siècle): vocabulaire et interprétations, exemples et suggestions [2009]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631fe5ebfdf36d7df603732f/lorganisation-territoriale-dans-le-nord-ouest-de-la-peninsule-iberique-viiie-xe.jpg)