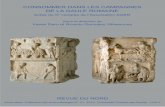2013 c « Les villes suméro-akkadiennes et leur arrière pays : la cité Etat introuvable. Etude...
Transcript of 2013 c « Les villes suméro-akkadiennes et leur arrière pays : la cité Etat introuvable. Etude...
Topoi Suppl. 12 (2013)p. ***-***
Les viLLes suméro-akkadiennes et Leur arrière-pays :
La Cite état introuvabLe études proto-urbaines 2
Il est considéré comme établi que l’essor des premiers États mésopotamiens, au moins dans le Sud mésopotamien s’est accompagné du développement d’un réseau territorial hiérarchisé d’établissements : les prospections d’Adams et Nissen (fig. 2) puis les grandes synthèses d’Adams, d’une part, Nissen d’autre part sont les pierres d’achoppement d’une théorie du développement de l’Etat et de la Cité Etat surtout en Mésopotamie méridionale 1. Cette théorie est ce que j’appelle le second modèle du développement mésopotamien, un second modèle qui a détrôné dans les années 70/80 la théorie de Wittfogel sur la Cité État hydraulique 2. Ce second modèle a permis de montrer que le développement de la « Cité État » mésopotamienne au moins dans le Sud mésopotamien n’était pas lié comme le pensaient Childe ou Wittfogel à la construction ou la maintenance d’un grand réseau hydraulique. Il serait lié, plutôt, à la gestion empirique d’un delta intérieur du Tigre et de l’Euphrate qui aurait connu au cours de la période plusieurs mouvements complexes, combinant changements climatiques, mouvements eustatiques et dynamique sédimentaire des deux fleuves. On le sait, cette dynamique est devenue un enjeu majeur de la recherche au cours des années 80-90 car elle est à la base de toutes les discussions néo-modernistes sur « l’avantage sud mésopotamien » et les développements asymétriques qu’il aurait pu susciter. C’est un point sur lequel je ne reviens pas ici, car je lui ai consacré plusieurs publications 3.
1. AdAms et NisseN 1972, AdAms 1981, NisseN 1986, 2001 et 2002.
2. Wittfogel 1957.
3. ButterliN 2003, 2008, 2010 et 2012 a.
8 p. ButterliN
Ma question ici est de savoir s’il est possible de faire le lien entre ce que nous savons du développement du centre monumental d’Uruk 4 et ce que l’on sait ou croit savoir du développement territorial de la « Cité État » d’Uruk au
4. ButterliN 2012 b.
Fig. 1 – le Sud irakien et la liste des cités, d’après mAttheWs 1995.
les villes suméro-AkkAdieNNes et leur Arrière-pAys 9
IVe millénaire. Notre idée est la suivante : les complexes dégagés depuis les années 30 dans l’Eanna d’Uruk constituent une tête de réseau, ils ne sont en rien des habitats domestiques standard. Ils sont donc l’expression d’un réseau dont l’ancrage spatial est en l’état très difficile à mesurer. L’une des manières d’aborder le problème est de poser la question en terme territorial, en s’appuyant sur les données des prospections, ou éventuellement sur les données textuelles. Sur ce dernier point, aucune étude géographique des textes archaïques d’Uruk n’a pour l’instant été tentée tout simplement parce que les désignations géographiques dans les textes archaïques sont extrêmement vagues. La notion même de cité est une notion qui n’est absolument pas claire dans cette géographie archaïque. Assurément, la fameuse liste des Cités (fig. 1), sans parler du sceau des Cités font référence à des toponymes mais il reste à savoir ce que désignent de fait ces notions 5. Des lieux dits, des sanctuaires, des villes ? Autant de notions qui restent floues et pour le moment pour le moins mal définies. Elles exigent de comprendre les relations entre villes et campagnes au IVe millénaire avant notre ère. C’est une question dont j’ai souvent discuté avec Georges Tate tout au long des années que nous avons passées à Saint Quentin en Yvelines et c’est un plaisir de présenter les résultats des recherches récentes sur cette question dans un volume qui lui est dédié. Cela nous ramène aux prospections réalisées dans le sud irakien, d’abord.
5. Sur cette question, mAttheWs 1993, ButterliN 2003, p. 92-94.
Fig. 2 – Carte des prospections dans le sud irakien, carte de l’auteur.
10 p. ButterliN
uruk et son arrière pays : un environnement à l’évolution discutée
La région d’Uruk et son arrière-pays sont de fait au centre de discussions animées qui ont essentiellement porté sur la fiabilité des données issues des prospections, d’une part, sur leur interprétation d’autre part. Là, plusieurs tendances se sont dessinées dans la recherche : la première est le scepticisme radical, développé essentiellement en France à la suite des recherches de l’équipe de Larsa entre Larsa et Oueili 6. Dans le sud de la Basse Mésopotamie, plus précisément autour du site de Larsa, non loin d’Uruk, la plaine deltaïque, en apparence monotone, présente une micro-topographie complexe. Des buttes de un à deux mètres de hauteurs, à sommet plat, sont les vestiges d’une ancienne surface pléistocène, entaillée à plusieurs reprises, puis remblayée au moment de la transgression flandrienne. Ce processus, bien étudié par Sanlaville dans une étude majeure 7, a fait disparaître de nombreux sites archaïques, surtout ceux de la période d’Obeid, entendue au sens large du terme. Les traces visibles en surface de canaux sont elles beaucoup plus tardives et datent pour l’essentiel, comme le notait déjà Adams, des périodes parthes et sassanides 8. Non seulement, de nombreux sites ont été ensevelis dès le IVe ou le IIIe millénaire, mais la sédimentation subséquente a fait disparaître les vestiges plus récents. Ce fait, combiné à des erreurs de cartographie, a conduit les Français à contester les théories d’Adams ou à les ignorer tout simplement, quand ils travaillent sur la période.
La deuxième manière d’aborder le problème est une étude critique des données d’Adams et Nissen, à la lumière du développement de nouveaux outils critiques. C’est que qu’ont fait, chacune à leur manière et selon des méthodes très différentes Pollock d’une part et Pournelle d’autre part 9. Leur idée est qu’il est possible, moyennant corrections et adaptations, d’utiliser ces données pour réfléchir sur le développement du monde sud mésopotamien. L’exposé qui va suivre combine ces informations nouvelles avec notre propre réflexion, dans le but non d’étudier pour le moment tout le développement de la région d’Uruk mais de se concentrer spécifiquement sur la période proto-urbaine. En substance, Pournelle a avancé des arguments suffisamment convaincants pour estimer qu’au moins dans certains secteurs du survey d’Uruk, beaucoup moins dans le cas du survey de Nippur, il est possible de discerner si ce n’est l’évolution complète du système, tout au moins des tendances claires de développement.
Pour comprendre ce problème, il faut donc revenir aux données de base et à leur évaluation. Rappelons que le survey d’Adams et Nissen repose sur une base
6. geyer et sANlAville 1989.
7. sANlAville 1989.
8. AdAms 1981.
9. pourNelle 2003 et 2007.
les villes suméro-AkkAdieNNes et leur Arrière-pAys 11
documentaire composite. La méthode suivie par Adams et Nissen est une série de prospections, conduites de 1968 à 1975 (Nippur) avec usage de cartes variées (1/50000e arabe et cartes britanniques revues par les Américains dans les années 1960), des photos aériennes commandées dans les années 1950 à la KLM qui ont aujourd’hui disparu, des photos landsat multispectrales des années 1960. Le résultat est un ensemble cartographique composite qui repose sur des relevés faits sur les sites, et sur l’étude et la situation des canaux par dessin sur les photos, l’ensemble ayant fait l’objet de triangulations.
Des erreurs ont été relevées, on l’a vu plus haut, notamment par Geyer et Sanlaville. Vue la méthode utilisée, ces erreurs sont inévitables et peuvent être corrigées au moyen de nouvelles méthodes de télédétection. Pournelle, en s’appuyant sur le fonds des photos Corona a pu reprendre le problème en détail. Elle s’est appuyée sur les observations de Geyer et Sanlaville pour les généraliser à l’ensemble de la plaine alluviale sud. Son idée est la suivante : « For brief periods following floods or rains, the normally uniform, mud-dull deltaic surface appears as variegated as an illuminated manuscript 10 ». Elle a donc fait usage de deux jeux de photos prises en mai, après les crues de printemps et en août, après la dessication estivale. « For this study, one complete image set (mission 1103) was purchased as a 4X paper enlargement, with an additional 1X partial image set (mission 1104) scanned at 600 dpi » 11. Le problème qui s’est dès lors posé a été le géoréférencement des images corona, selon un protocole utilisé à l’OIP ajusté aux données des surveys de Warka, Nippur et Eridu/Ur 12. Elle est ainsi parvenue à corriger les erreurs de la prospection d’Adams et Nissen, notamment en limitant à une dizaine de mètres, là où au départ, elles pouvaient être de plusieurs centaines de mètres. Une fois ces corrections réalisées, elle est revenue sur les problèmes complexes que pose l’étude des mécanismes de sédimentation dans le Sud mésopotamien. Ceux-ci sont fonction des conditions dans lesquelles s’écoulent les eaux de surface dans le bassin inférieur du Tigre et de l’Euphrate. Ces conditions rappelons-le sont la quantité d’eau reçue dans un régime pluvio-nival lié aux neiges du Taurus et du Zagros, la quantité des précipitations reçues dans la plaine, qui est fonction du régime des moussons, la dynamique des affluents et de leurs zones marécageuses, et l’ampleur des phénomènes de remontée des eaux marines au rythme des marées et des transgressions marines surtout. La dynamique sédimentaire que l’on peut observer dans la région comprend trois zones distinctes : la zone tigrine, la zone Euphrate, la zone du Shatt el Arab. Ces trois dynamiques ne poussent pas
10. pourNelle 2003, p. 49.
11. pourNelle 2003, p. 52.
12. « Since the original survey maps were drawn by checking positions triangulated in the field against photo mosaics of unknown (and variable) projection, this allowed me to reduce position errors from (in some cases) greater than 1000 meters, to (in most cases) less than 10 meters » : pourNelle 2003, p. 53.
12 p. ButterliN
exactement dans un seul sens (vers le sud-est) comme on le pense couramment mais selon des axes distincts : d’abord vers le sud-est, puis plein est et enfin plein sud. Ces dynamiques se combinent, comme l’a montré Sanlaville, à une pression exercée par les cônes de déjection des rivières et oueds qui se déversent dans le bassin des deux fleuves de Ramadi à Basra. Ces cônes de déjection jouent un rôle majeur dans la constitution des zones humides périphériques à la plaine alluviale puis deltaïque ; car ils collectent les eaux de pluie de la mousson. Or, les études paléoclimatiques fondées sur les carottes dans l’Océan indien et dans les lacs du Nefud, les données paléobotaniques, et les isotopes coraliens de la mer Rouge ont permis de montrer que l’influence de la mousson était beaucoup plus forte au cours du IVe millénaire. Il en a résulté une charge accrue des deux fleuves (de 15 à 20 %) qui combinaient effets de l’optimum holocène avec ceux de la mousson.
Le dernier facteur essentiel est, on le sait, l’ampleur des variations eustatiques. La publication récente des données des carottages réalisés à la fin des années 80 en Iraq du Sud a permis à Pournelle de modéliser précisément l’ampleur de la transgression flandrienne dans le sud irakien et donc pour parler concrètement de l’incursion du Golfe persique à l’intérieur des terres. Sans entrer dans le détail de son argumentaire, ses conclusions sont les suivantes : « Thence, over several centuries the area remained a transitional zone, until becoming a brackish coastal marsh or intertidal sedimentary bed around 3300 BCE, indicating the onset of marine regression ».
Un autre fait majeur est l’observation dans les forages C et D de dépôts de sable éolien sur 0,5 m vers 3500-3000, où eut lieu la formation de dolomites et palygorskite, qui indiquent la présence dans la région de sabkhas vers –3000. Elles correspondent à un épisode aride dont on ne saurait on s’en doute minimiser l’importance, au vu de ce que l’on sait de l’évolution du centre monumental d’Uruk, à cette époque. Les zones humides du Sud irakien résultent donc d’une combinaison du delta intérieur, identifié par Sanlaville et de ces marges humides côtières. Le delta résulte de la formation en amont du bassin marin, d’un bassin de sédimentation, progressivement remblayé par des nappes alluvionnaires successives qui se sont développées en lobes successifs dans la plaine.
Pournelle a distingué quatre lobes successifs qui se sont formés progressivement et ont chacun connu une histoire différente, selon plusieurs paramètres. Il s’agit d’une part de la formation et l’évolution des grandes levées des deux fleuves bien étudiées en amont de Kish par Gasche et Verhoeven 13, dans un milieu, faut-il le rappeler, très différent de celui de l’extrême sud mésopotamien et d’autre part de l’évolution des grands systèmes d’irrigation, soumis après abandon à de complexes mécanismes de déflation. Ces lobes sont du nord au sud, le lobe IV (la région située au nord de Nippur), dans lequel Adams avait cru pouvoir reconnaître les éléments clefs de la révolution urbaine, le lobe III (région des grands sites sumériens autour de Nippur), le lobe II, entre Nippur et Shuruppak,
13. gAsche et verhoeveN 1990.
les villes suméro-AkkAdieNNes et leur Arrière-pAys 13
et le lobe 1 (région d’Uruk). L’étude des mécanismes décrits plus haut conduit à plusieurs idées essentielles : d’abord les lobes septentrionaux, comme la région de Fallujah/ Baghdad étudiée par Gasche ne présentent pas de vestiges de canaux antérieurs à l’époque d’Ur III au mieux. Plus au sud, ce sont les canaux parthes et sassanides qui constituent au mieux des traces en surface des réseaux anciens. En revanche, comme le notait déjà Adams 14, les levées de ces systèmes d’irrigation sont soumises à des phénomènes d’érosion différentielle qui dégagent les couches sous-jacentes où se trouvent des sites proto-urbains. La carte de ces sites est donc le reflet non d’un peuplement ancien mais d’un décapage de surface qui a mis au jour certains réseaux anciens fossilisés par les réseaux classiques.
Le collier de perles contesté : une nouvelle écologie du sud irakien
Dans la région située au nord d’Uruk, où on le sait Adams et Nissen ont repéré d’importantes concentrations de sites (fig. 4), notamment pour l’Uruk récent, il existerait les vestiges bien visibles d’un système de peuplement partiellement dégagé par la déflation éolienne et préservé de toute nouvelle sédimentation par la translation vers l’ouest de l’Euphrate. C’est ce système qui nous intéresse ici. Là plusieurs idées nouvelles se sont imposées ces dernières années et posent le problème non seulement de l’histoire du peuplement de la région mais aussi de ses caractéristiques. D’une part Pollock 15 a réfuté la thèse classique d’une immigration massive à l’époque d’Uruk Récent dans la région, cela été la première étape. Seconde étape, Pournelle a réfuté la thèse du « collier de perles hollandais », cette idée que l’on doit à Adams d’une mise en valeur par irrigation/assèchement du Sud irakien. Les colons urukéens se seraient installés le long des divers chenaux repérés en surface pour faire de l’irrigation opportuniste de la région et développer la Cité-État agro pastorale à l’époque d’Uruk récent avant de construire- deuxième étape- la fameuse agroville suméro-akkadienne du début du IIIe millénaire. Concentrons nous ici sur le premier problème.
Nous disposons maintenant de toute une série de cartes de la région à l’époque d’Uruk : celle d’Adams et Nissen 16, celle d’Adams 17 puis celle de Nissen 18, celle de Pollock (fig. 3), et enfin celles de Pournelle 19 (fig. 4). Ces cartes, on s’en doute,
14. AdAms 1981.
15. pollock 1999 et 2001.
16. AdAms et NisseN 1972.
17. AdAms 1981.
18. NisseN 2001.
19. pourNelle 2003 et 2007.
14 p. ButterliN
ne coïncident pas entre elles pour les raisons que nous venons d’évoquer plus haut. Le point le plus délicat est, on vient de l’évoquer, la possibilité de reconstituer des traces ou l’intégralité d’un réseau fluvial archaïque dans la région entre Shuruppak et Uruk. Il ne reste de ces réseaux anciens que des bribes très difficiles à analyser, mais il me semble que plusieurs éléments peuvent être bien mis en évidence. En reprenant la carte d’Adams qui reste la plus claire pour évaluer les dimensions des divers sites de la région d’Uruk, au moins au départ, je me suis posé plusieurs questions : d’abord, comment se fait-il que toutes les analyses réalisées sur les modalités du ravitaillement d’Uruk posent pour point de départ une série de cercles concentriques dont le centre est Uruk. Ce type de raisonnement est valable quand on fait une analyse de géographie humaine en milieu de dry farming, où l’essentiel du ravitaillement urbain provient d’un espace circulaire dont le diamètre est environ de 8 à 10 km. Cela suppose du transport terrestre au moyen soit d’animaux de bât soit de chariot, selon des paramètres bien connus. Or, outre le fait que la roue n’existe pas à notre époque, l’une des bases évidentes du ravitaillement
Fig. 3 – Évolution du Sud mésopotamien d’après AdAms 1981, réinterprétée par pollock 1999.
les villes suméro-AkkAdieNNes et leur Arrière-pAys 15
urbain, comme du grand commerce en général est la voie d’eau 20. Le problème pour Uruk n’est donc pas de faire des projections avec des cercles mais de poser les termes d’une étude de logistique fluviale de base.
Tous les villages urukéens repérés en prospection se situent en amont d’Uruk, Larsa ou Bad Tibira, et même si nous ne savons pas ce qui se passe au sud d’Uruk, il nous paraît clair que c’est de là – au nord – que vient le ravitaillement d’Uruk. Si on prend la carte d’Adams, deux faits émergent : le premier qu’il a abondamment exploité, tout comme Pollock est l’absence de grands centres et il en a déduit le rôle prépondérant d’Uruk. Le second point tient à une analyse plus poussée de ces données, selon des lignes initiées par Nissen plus récemment 21. Il existe toute une série de centres « moyens » dans l’espace situé au nord d’Uruk. Si la carte du réseau fluvial d’Adams était valable, on pourrait alors reconstituer toute une série
20. Sur ces questions de logistique, voir ButterliN 2008.
21. NisseN 2002.
Fig. 4 – La région d’Uruk à l’Uruk récent, à droite d’après AdAms 1981 et à gauche d’après NisseN 2001.
16 p. ButterliN
d’auréoles le long de certains chenaux dans lesquelles ces centres moyens sont en aval du système. J’en ai compté au moins quatre et propose simplement une simulation de zones possibles de ravitaillement. Ce noyau de centres urukéens situés au nord d’Uruk présente une autre caractéristique, qui est la répartition de ces centres tous les dix à quinze kilomètres, une chaîne idéale de circulation des informations par voie terrestre. Nous n’avons aucune preuve qu’il existait à cette époque un lien fluvial entre Uruk et cette région.
C’est poser à nouveau ici le problème de l’Iturungal et de son histoire. Pournelle pense avoir identifié les traces de deux chenaux anciens de l’Iturungal mais il faut rester prudent à ce sujet. Elle est en revanche revenue sur cette région centrale du système archaïque urukéen et a proposé une vision dynamique très intéressante de l’évolution de cet ensemble : « during the ‘Ubaid, towns and cities clustered on turtlebacks generally beyond the reach of seasonal flooding. By the Early Uruk, we can see more sprawling sites clustered around distributary junctions propitious foropportunistic basin irrigation. By the Late Uruk, we can see that smaller settlements pushed southeastward into the delta, following prograding sediment fans, and that this process continued into the third millennium BCE » 22. Cette vision du développement sud mésopotamien dans la région d’Uruk repose sur deux bases : d’une part, les plus anciens établissements ont été fondés dans le sud de l’Irak sur des buttes témoins de l’ancienne surface pleistocène identifiée par Geyer et Sanlaville. Ces buttes furent des refuges idéaux comme dans le delta du Nil pour les populations post néolithiques confrontées à la transgression flandrienne. Elles sont le noyau de base des futures Cités Etats.
Le second élément est, à partir de l’ « Uruk ancien », le développement en auréoles sur des lobes sédimentaires de villages qui s’implantent à l’interface entre zones sèches ou asséchées et zones humides, à proximité des principaux chenaux du système. On peut, en s’appuyant sur les cartes publiées par Pournelle, reconstituer cette progression vers le sud est. On constate alors qu’à l’Uruk récent, plusieurs alvéoles de sites se situent en amont d’Uruk, puis que ce système se déplace vers l’est à l’époque de Jemdet Nasr, si tant est que le concept soit utile dans la région d’Uruk. À partir de là, on arrive à une image dans laquelle l’époque récente de la période d’Uruk a été un épisode de l’histoire de la région où se sont constituées une série d’alvéoles de peuplement autour des grands centres identifiés par Adams. Ce système a fonctionné jusqu’à ce que la dynamique du delta conduise ces habitants vers le sud-est : ils ont alors abandonné ces centres, et la substance même de cet ensemble territorial proto-urbain a disparu. Ce déplacement qui se poursuit au Dynastique archaïque fait sortir ces populations de la zone prospectée. Ils n’ont pas disparu, ils sortent du champ de notre caméra.
Ce que je retiens de cette argumentation, c’est d’une part l’explication de l’existence d’une remarquable situation qui a créé un ensemble territorial inédit. Les bases sur lesquelles repose cet ensemble ne sont pas celles que
22. pourNelle 2003, p. 244.
les villes suméro-AkkAdieNNes et leur Arrière-pAys 17
l’on a envisagées jusqu’ici : il ne s’agit pas d’une civilisation d’agriculteurs et pasteurs exploitant par irrigation opportuniste un delta partiellement asséché mais plutôt de populations qui exploitent un delta actif, en cultivant et surtout en exploitant les ressources de ce delta, un fait bien connu des sumérologues, par ailleurs. Les données disponibles ne permettent pas on s’en doute de définir très précisément cette base territoriale, si ce n’est qu’il semble avoir existé au moins trois centres administratifs importants dans ce système. Les sites 125, 201 et 260 de la prospection d’Adams-Nissen (fig. 4) sont les relais d’une autorité dont le seul centre actif paraît avoir été Uruk. Il est difficile de savoir alors si d’autres grands centres sont actifs dans le sud mésopotamien. Il semble qu’Umma est dès cette époque là un centre important puisque des textes administratifs archaïques semblent y avoir été découverts. On ne sait rien de Shuruppak. Il est en tout cas très clair que ces grands centres qui furent par la suite des unités politiques de premier plan se situent à la périphérie de l’ensemble de centres urukéens que nous venons d’évoquer. Quelle que soit la nature du réseau d’irrigation qui fonctionne alors, ces centres situés en amont d’Uruk sont les candidats idéaux pour expliquer le ravitaillement d’un centre comme Uruk dont la taille, rappelons-le est estimée à 250 ha 23.
une topologie de l’état proto-urbain d’uruk ?
Au vu de ces données fort limitées on le concède, il est possible alors de poser deux questions finales : est-ce que les unités monumentales observées à Uruk ont un lien avec ce système de peuplement ? Et, deuxième question, quel est le lien entre l’évolution de ce paysage et la révolution iconographique de la fin du IVe millénaire, révolution qui célèbre la Cité État et son arrière pays rural ?
J’ai pu conduire récemment une analyse détaillée des complexes monumentaux de l’Eanna d’Uruk, grâce à la publication finale de ces édifices parue en 2007 24. Les bâtiments archaïques ont été dégagés à partir des années 30 dans le secteur de l’Eanna (fig. 5). Au sud-est et au sud de la ziggurat bâtie par Ur Nammu, ont été dégagés toute une série d’édifices qui datent pour l’essentiel de la fin du IVe millénaire, de la période dite Uruk Récent (fig. 6). Il apparaît que ces complexes monumentaux répondent à une logique spatiale qui juxtapose des unités qui ont une superficie de 3000 m2. L’ensemble s’inscrit dans un périmètre de 300 m sur 100 m environ. Chacune de ces unités présente à des degrés divers l’articulation de formules architecturales stéréotypées, des bâtiments tripartites, des halles et cours au riche décor de mosaïques de cônes. Chaque unité présente surtout deux types différents d’édifices tripartites, de premier et second rang. En
23. Voir notre analyse reprenant les données de la prospection Finkbeiner, ButterliN 2003, p. 289 et pl. VI.
24. eichmANN 2007, ButterliN 2012 b.
18 p. ButterliN
somme, même si ces unités sont organisées diversement, elles répondent à un schéma récurrent qui unifie la diversité en somme. On a beaucoup discuté sur le rôle que jouaient ces énormes complexes à Uruk. Tout le système est destiné à assurer la réception et la circulation d’une population importante, mais ces édifices ne présentent ni unités de stockage, ni installations de transformation si bien qu’on en a fait des « temples », ou des lieux cérémoniels, lieu de grandes réunions ou de festivals comme le mariage sacré sur lequel on reviendra plus bas. Pour ma part, je m’interroge sur le fonctionnement et la logique spatiale d’un tel ensemble : on ne trouve pas un seul édifice de réunion ou de réception mais au minimum une dizaine de calibres variés. Si chacun de ces lieux était le théâtre d’une réunion ou cérémonie, cela laisse supposer un compartimentage, une division de la communauté en question particulièrement poussée. Il faut en effet supposer que chacun de ces édifices représente d’une manière ou d’une autre une unité sociale distincte de ses voisines. Le rassemblement en un seul point de ces unités de base matérialise l’unité d’une communauté dont Uruk est clairement le centre. Difficile de spéculer sur ces unités sociales. Toutefois, leur grande diversité me conduit à supposer qu’elles pourraient être représentatives des différentes composantes d’un
Fig. 5 – Uruk et son arrière-pays, carte d’après AdAms 1981, plan d’Uruk et de son centre monumental TAVO et photo aérienne du site, EichmANN 1989, taf. 1.
les villes suméro-AkkAdieNNes et leur Arrière-pAys 19
État proto-urbain dont l’arrière pays est connu à travers les prospections que nous venons d’évoquer.
En somme, il est possible que les grandes unités proto-palatines d’Uruk étaient chacune la tête ou la représentation à Uruk d’une fraction d’un territoire qui comprend toute une série de villages et surtout quelques centres de taille moyenne que nous avons évoqués plus haut. Uruk serait alors un centre confédéral où se réunissaient les différentes assemblées émanant des différentes composantes de cet État proto-urbain qui ne répond en rien au modèle de la Cité État classique. Ce n’est qu’une hypothèse qu’il est difficile de démontrer plus avant. Les institutions ou agences mentionnées dans les textes ne sont jamais associées à des noms de lieux, et il est bien difficile de savoir ce qu’ils représentent. Nous avons là des unités sociales concentrées en un seul point, chacune d’entre elles constitue un ensemble monumental très comparable à ce que l’on peut trouver aussi sur le Moyen Euphrate où il s’agit probablement de la capitale d’un petit État proto-urbain 25. Cet État est un ensemble beaucoup moins développé que celui d’Uruk, qui à nos yeux correspond donc à un niveau supérieur d’intégration.
25. Sur cette question, ButterliN 2012 b.
Fig. 6 – Eanna centre monumental, d’après Eichmann, publié in ButterliN 2003, pl. VII.
20 p. ButterliN
La deuxième observation est plus générale. C’est au moment où s’affirme ce système politique que se produit la révolution iconographique de la fin du ive millénaire 26. Celle-ci on le sait depuis longtemps met en avant, notamment les forces productives du pays de Sumer et exalte ce que Winter a appelé récemment une iconographie de l’abondance 27, celle qu’apportent l’agriculture irriguée et l’élevage. Ce binôme bien connu, présent dans le célèbre vase d’Uruk et dans la glyptique proto-urbaine d’Uruk célèbre les vertus de la Cité État agraire suméro-akkadienne. Il célèbre au moment de l’édification des premiers centres proto-urbains l’intégration ville-campagne, la création de ces centres proto-urbains s’accompagnant de la création de campagnes définies dès lors comme telles par opposition et en complémentarité avec la ville. Il faut s’arrêter un instant sur ce point. La mise en scène des activités économiques au cours du IVe millénaire, pour l’essentiel dans la glyptique et le bas relief est une des grandes innovations de l’iconographie proto-urbaine qui invente à proprement parler un homme économique, un producteur qui apporte en offrande les produit de son travail à la divinité et bénéficie d’un complexe système de redistribution de rations. Dans ce domaine, les activités agricoles sont un aspect mais pas le seul d’une iconographie d’une très grande richesse qui livre aussi des scènes artisanales fameuses 28. Élevage et agriculture sont également présents et célébrés, notamment dans le fameux vase d’Uruk qui a donné lieu à une abondante bibliographie tant il constitue un moment crucial de cette iconographie nouvelle 29. Winter a souligné que le vase d’Uruk était la parfaite expression d’une vision du monde ordonnée autour de l’élevage, symbolisé par un défilé de paires productrices et de l’agriculture irriguée à travers l’alternance de plants d’orge et probablement de lin, les deux offrandes par excellence que l’on faisait à Inanna au IIIe millénaire 30. En somme, le vase d’Uruk célèbre tout à la fois un ordre social mais aussi un paysage, celui d’un État agro-pastoral 31. L’État se construit dans la célébration de la sécurité alimentaire garantie par l’entretien d’un réseau d’irrigation et le mariage sacré vient renouveler chaque année le pacte entre la royauté et la divinité pour garantir la fertilité de la terre.
Tout ceci est bien connu, mais on n’a peut-être pas suffisamment insisté sur deux points. Tout d’abord, les recherches récentes conduites sur la néolithisation semblent indiquer que cette question de la fertilité de la terre n’était pas au cœur de l’iconographie néolithique comme on l’a écrit pendant des décennies,
26. ButterliN 2003, p. 74-87.
27. WiNter 2007.
28. Sur ces questions, voir pittmAN 2002.
29
30
31. schmANdt BesserAt 1993.
les villes suméro-AkkAdieNNes et leur Arrière-pAys 21
en suivant un modèle matérialiste qui liait domestication des plantes et déesses mères 32. Si tel est le cas, l’iconographie de l’abondance proto-urbaine est d’autant plus révolutionnaire : c’est en somme au moment où se construisent les premières villes que l’on célèbre la campagne et son lien avec la ville, ce pacte indispensable entre la ville et son arrière-pays. Toutefois, c’est le deuxième point, l’argumentaire de Pournelle, si on le suit, qui nous donne une toute autre image de ce développement proto-urbain. Il s’agit d’un monde en partie amphibie, dans lequel il n’est guère possible d’imaginer comme le faisaient Adams ou Nissen la mise en valeur massive d’un hinterland irrigué dans des polders géants sumériens. L’iconographie de la Cité État naissante célèbre un idéal, non une réalité physique qui est beaucoup plus mouvante et diverse. Jacobsen a tenté de distinguer parmi les Cités États sumériennes des variantes économiques à travers les attributions des différentes divinités poliades 33. Il est depuis longtemps bien connu que d’autres activités jouaient un rôle majeur dans le développement économique de ces centres proto-urbains, au premier chef l’exploitation des marais et lagunes. Pêche, cueillette intensive du roseau font pleinement partie d’une économie très diversifiée et adaptée au milieu que nous avons décrit plus haut. Même si ces activités apparaissent dans l’iconographie de la fin du IVe millénaire, elles ne jouent pas le rôle central que l’on prête à l’agriculture ou l’élevage. En somme, cette iconographie est un choix, elle est une vision sélective de l’économie proto-urbaine et ne saurait être reçue comme une illustration. Le vaste ensemble dégagé à l’Eanna est représentatif de cet ensemble mais aussi de son caractère éphémère. Il a peut-être très ponctuellement existé un grand Etat urukéen mais celui-ci n’a pas résisté à des mutations dont un aspect put être la mutation de l’environnement deltaïque sud mésopotamien. Il y eut certainement des composantes politiques dans ces mutations, comme le montrent l’abandon du complexe de l’Eanna et la liquidation des objets sacrés de l’ensemble. Le seul fait que la seule partie manquante du grand vase d’Uruk soit celle qui représente le fameux roi-prêtre pourrait aller dans le sens d’une véritable damnatio de ce personnage qui disparaît par la suite de l’iconographie.
On ne saurait en tout cas en aucune manière considérer que nous avons là les prémisses de la « Cité État » sumérienne. Celle-ci est introuvable dans le monde proto-urbain et si d’aventure elle a existé, elle s’est développée sur les ruines de ce monde proto-urbain. Celui-ci est clairement un extraordinaire laboratoire, qui ne s’est que très partiellement perpétué au IIIe millénaire.
Pascal ButterliN Université Paris I Panthéon Sorbonne
32. forest hodder 2011.
33. JAcoBseN 1957 et 1976.
22 p. ButterliN
Bibliographie
AdAms R. Mac 1981, Heartland of Cities : Surveys of Ancient Settlements and Land Use on the Central Floodplain of the Euphrates, Chicago.
AdAms R. Mac 2008, « An Interdisciplinary Overview of a Mesopotamian City and its Hinterlands », Cuneiform Digital Library Journal 2008 : 1, http://www.cdli.ucla.edu/pubs/cdlj/2008/cdlj2008_001.html, p. 1-23.
AlgAze G. 1993, The Uruk World System, the Dynamics of Expansion of early Mesopotamian Civilization, Chicago et Londres.
AlgAze, G., 2001, « Initial Social complexity in Southwest Asia : the Mesopotamian Advantage », CA 42/2, p. 199-234.
ButterliN P. 2003, Les temps proto-urbains de Mésopotamie, contact et acculturation à l’époque dite d’Uruk en Mésopotamie, Paris.
ButterliN p. 2008, « Ville et campagnes en Mésopotamie, la logistique des révolutions urbaines », in J. guilAiNe (dir.), Villes, villages, campagnes de l’âge du Bronze, Séminaire du Collège de France, Errance, Paris, p. 28-44.
ButterliN p. 2010, « d’Uruk à Mari, recherches récentes sur la première révolution urbaine en Mésopotamie méridionale et centrale » (Actes table ronde Sophau mai 2008), Revue d’Histoire urbaine, p. 133-161.
ButterliN p. 2012a, « Archéologie et sociologie, le cas de l’Orient ancien », dans S.A. de BeAuNe et H.P. frANcfort (dir.), L’archéologie à découvert, Paris, p. 184-193.
ButterliN p. 2012b, « Les caractéristiques de l’espace monumental dans le monde urukéen, de la métropole aux colonies », Origini XXIV, p. 171-191.
childe v.G. 1950, « The Urban Revolution », Town Planning Review 21, p. 99-115.childe v.G. 1963, La naissance de la civilisation, Paris (1re édition 1957).fiNkBeiNer U. 1991, Uruk, Kampagne 35-37, 1982-1984, Die archäologische Oberflächen-
untersuchung (Survey), Augrabungen in Uruk-Warka Endberichte (AUWE 4), Mayence.
forest hodder 2011XXXXXgAsche et veroehveN, 1990, XXXXXgeyer B. et P. sANlAville, 1996, « Nouvelle contribution à l’étude géomorphologique de la
région de Larsa-Oueili (Iraq) », in J.-L. huot (dir.), Oueili, Travaux de 1987 et 1989, ERC, Paris, p. 391-408.
giBsoN, McG., 1972, The City and Area of Kish, Coconut Grove, Field Research Reports.JAcoBseN T. 1957, « Early Political development in Mesopotamia », ZA 52, p. 91-140.JAcoBseN T. 1976, The Treasures of Darkness, New Haven.NisseN H.J. 1988, The Early History of the Ancient Near East, 9000- 2000 B.C. Chicago.NisseN H.J. 2001, « Cultural and Political Networks in the Ancient Near East during the
Fourth and Third Millennia B.C. », in M.S. rothmAN (dir.), Uruk Mesopotamia and its Neighbors : Cross-cultural Interactions and their Consequences in the Era of State Formation, Santa Fe, School of American Research, p. 149-180.
NisseN H.J. 2002, « Uruk : Key site of the Period and Key Site of the Problem », in J.N. postgAte (dir.), Artefacts of Complexity, tracking the Uruk in the Near East, British School of Archaeology in Iraq, p. 1-16.
les villes suméro-AkkAdieNNes et leur Arrière-pAys 23
pittmAN H. 2001, « Mesopotamian Intraregional Relations Reflected through Glyptic Evidence in Late Chalcolithic 1-5 Periods », in M.S. rothmAN (dir.), Uruk Mesopotamia and its Neighbors : Cross-cultural Interactions and their Consequences in the Era of State Formation, Santa Fe, School of American Research, p. 403-444.
pollock s. 1992, « Bureaucrats and Managers, Peasants and Pastoralists, Imperialists and Traders : Research on the Uruk and Jemdet Nasr periods in Mesopotamia », Journal of World Prehistory 6, p. 297-333.
pollock s. 2001, « The Uruk Period in Southern Mesopotamia », in M.S. RothmAN (dir.), Uruk Mesopotamia and its Neighbors : Cross-cultural Interactions and their Consequences in the era of State Formation, Santa Fe, School of American Research, p. XXXX.
pourNelle J.R. 2003, Marshland of Cities, Delatic Landscapes and the Evolution of Early Mesopotamian Civilization, PHD Dissertation, University of California, San Diego.
pourNelle J.R. 2007, « KLM to Corona : a Bird’s Eye view of Cultural Ecology and early Mesopotamian Urbanization », in E. stoNe (dir.), Settlement and Society, essays dedicated to Robert McCormick Adams, Cotsen Institue of Archaeology, University of California, Los Angeles, p. 29-63.
sANlAville P. 1989, « Considérations sur l’évolution de la Basse-Mésopotamie au cours des derniers millénaires », Paléorient XV/2, 1989, p. 5-29.
schmANdt BesserAt D. 1993, « Images of Enship », in M. frANgipANe et alii (dir.), Between the Rivers and over the Mountains : Archeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri dedicata, Roma, La Sapienza, p. 201-221
steiNkeller P. 2007, « City and Countryside in third Millennium Southern Babylonia », in E. stoNe (dir.), Settlement and Society, Essays dedicated to Robert McCormick Adams, Cotsen Institute of Archaeology, University of California, p. 185-213.
WesteNholz J.G. 2002, « The Sumerian City-State », in M.H. hANseN (dir.), A comparative Study of six City State Cultures, an investigation conducted by the Copenhagen Polis Centre, Royal Danish Academy of Science and Letters, Copenhagen, p. 23-42.
WiNter i. 2007, « Representing Abundance : the visual Dimension of the Agrarian State », in E. stoNe (dir.), Settlement and Society, Essays dedicated to Robert McCormick Adams, Cotsen Institute of Archaeology, University of California, p. 117-139.
Wittfogel k. 1957, Oriental Despotism, a Comparative Study on Total Power, New Haven et Londres.































![Using and Abusing Images in Late Antiquity (and Beyond): Column Monuments as Topoi of Idolatry (2014) [FULL TEXT NOW AVAILABLE]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6319b044d4191f2f9307b89e/using-and-abusing-images-in-late-antiquity-and-beyond-column-monuments-as-topoi.jpg)