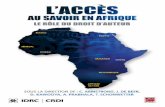Impact de la Bourgogne sur la cour castillane des Trastamare
Entre la cour et la ville. Les gens de savoir au service de l’empereur Charles IV à Prague
Transcript of Entre la cour et la ville. Les gens de savoir au service de l’empereur Charles IV à Prague
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
SEUH
35Studies in European Urban History (1100–1800)
Series Editors
Marc Boone
Anne-Laure Van BruaeneGhent University
La cour et la ville dans l’Europe du Moyen Âge et des Temps Modernes
Edited byLéonard Courbon & Denis Menjot
FH
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
Illustration de couverture: WINCKLER, Georg Gottfried, 1711?-1786? Vuë du palais du roy de Portugal, à Lisbonne / G.G. Winckler sc. - A.V. [Augsburgo] : Georg Balthazar Probst excud [entre 1750 e 1755?] - 1 gravura : buril, aguarelado ; 32,2×43 cm (matriz). Biblioteca Nacional de Portugal
© 2015, Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgium
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the publisher.
D/2015/0095/53ISBN 978-2-503-55343-6 (printed)ISBN 978-2-503-55419-8 (online)
Printed in the EU on acid-free paper
v
Table des matières
Léonard Courbon
Introduction. La cour et la ville dans l’Europe des xive-xviiie siècles : état de la question et perspectives de recherche 1
Bibliographie indicative 11
I. Cours en villes et villes de cour
Denis Menjot
Introduction 21
Rita Costa Gomes
Places of Power: the City and the Court in Late Medieval Iberia 23
Peter Stabel & Luc Duerloo
Du réseau urbain à la ville capitale ? La cour et la ville aux Pays-Bas du bas Moyen Âge aux temps modernes 37
Joan-Lluís Palos
Two Scripts for a Single Stage. Naples, Barcelona and Lisbon in the Spanish Empire: Old Civic Traditions and New Court Practices 53
Ana Maria S. A. Rodrigues
La reine, la cour, la ville au Portugal médiéval 77
Jan Hirschbiegel & Sven Rabeler
Residential Cities in the Holy Roman Empire (1300-1800) Urbanism as a Network of Integrative and Competing Relationships between Seigniorial Rulership and Civic Community 91
II. Pratiques de mobilité et espaces d’interaction et de communication
Denis Menjot
Introduction 103
Roxane Chilà
Espaces curiaux et espaces de la communication politique dans le Royaume de Naples sous le règne d’Alphonse le Magnanime (1442-1458) 105
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER. vi
Table des Matières
Germán Gamero Igea
Mécanismes de communication politique entre la cour de Ferdinand le Catholique et les villes 117
Philippe Trélat
lo recevè con tanta festa et alegrezza, che non si potrebbe scrivere : vie de cour et société urbaine à Nicosie (xive-xve siècles) 131
Olivier Spina
« Pour le divertissement de sa Majesté ». Les spectacles curiaux comme exemple d’interpénétration entre la ville de Londres et la cour des Tudors 149
Matilde Miquel Juan & Olga Pérez Monzón
Feriados días… que son establecidos de los emperadores e de los reyes. Royal Palace, Cathedral and City in the Libro de la Coronación de los Reyes de Castilla y Aragón 165
III. Entre la cour et la ville : médiations, confrontations, collaborations
Denis Menjot
Introduction 185
Florence Berland
La cour de Bourgogne et les circuits économiques parisiens : collaboration et confrontation (1363-1422) 187
Mathieu Caesar
Économie urbaine et dépenses princières. La cour de Savoie au xve siècle 197
Václav Žůrek
Entre la cour et la ville. Les gens de savoir au service de l’empereur Charles IV à Prague 213
Urszula Sowina
The Relations of the Town of Kraków and its Patriciate with the Ruler and the Wawel Court from the Thirteenth Century to the First Half of the Sixteenth Century 225
Patrick Boucheron
Épilogue conclusif. La ville, la cour, la modernité de l’État. Un « modèle européen » au risque de la world history 237
Présentation des collaborateurs du volume 251
La cour et la ville dans l’Europe du Moyen Âge et des Temps Modernes, ed. by Léonard Courbon & Denis Menjot, Turnhout, 2015 (Studies in European Urban History, 35), pp. 213-223.
F H G DOI: 10.1484/M.SEUH-EB.5.103481
Entre la cour et la ville. Les gens de savoir au service de l’empereur Charles IV à Prague
Václav ŽůrekCentre d’Études Médiévales, Prague
Résumé
Sous le règne de Charles IV (1346-1378), Prague devint la capitale de l’Empire et la résidence impériale ce qui influença la vie quotidienne de la ville, surtout pour ce qui est de la coexistence de deux sociétés : curiale et urbaine. Les relations entre les membres de la cour et les habitants de la ville se proje-taient aussi dans un groupe spécifique : celui des érudits. Le nombre de personnes lettrées (voir de clercs) s’accrut surtout avec la fondation de l’université (1348) et celle de nombreux couvents, cloîtres et maisons religieuses intra muros. Avec une politique ambitieuse, l’empereur Charles IV avait un grand besoin de personnes lettrées comme conseillers et d’auteurs capables de rédiger des œuvres historiques, politiques et juridiques. Le souverain chercha les auteurs aussi parmi les membres des institutions religieuses de Prague : les membres de l’université, les clercs des églises pragoises ou les chanoines et les religieux. De plus, l’empereur invita à sa cour pragoise également des érudits étrangers pour écrire sur ou sans sa com-mande directe de différentes œuvres. L’article esquisse sur quelques exemples les formes et les stratégies de l’empereur Charles IV pour attirer les gens de savoir à sa cour.
Mots-clés : Royaume de Bohême, Prague, Charles IV de Luxembourg, ville médiévale, cour royale
Abstract
Under the reign of Charles IV (1346-1378), Prague became the capital of the Empire and the impe-rial residence, which influenced the everyday life of the town, in particular regarding the coexistence of both court and urban society. The relations between the court members and town inhabitants reflected also on a specific group: the scholars. The number of men of letters (or clergymen) increased especially with the foundation of the university (1348) and of numerous convents, cloisters and religious houses intra muros. Given his ambitious policy, Emperor Charles IV was in great need of men of letters as advi-sers and of authors capable of elaborate historical, political and legal writings. The sovereign sought these authors among the members of Prague religious institutions: university members, clergy from Prague churches or canons and monks. Moreover, the Emperor invited to his Prague court also foreign scholars to create, to his direct order or without it, different writings. The present article sketches on several examples the forms and strategies the Emperor used to draw men of letters to his court.
Keywords: Kingdom of Bohemia, Prague, Charles IV of Luxembourg, medieval town, royal court
Prague était la capitale de la Bohême depuis le xe siècle quand les princes de la famille des Přemyslides constituèrent un premier État. Depuis cette époque, les princes et, plus tard, les rois tchèques siégèrent toujours à Prague. Pendant le xive siècle, la ville connut
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
Václav Žůrek
214
de grands changements. Son essor est surtout à mettre au compte de l’aspiration politique de Charles de Luxembourg (1346-1378), le deuxième souverain de la nouvelle famille de Luxembourg sur le trône de Bohême. Prague était toutefois déjà devenue le centre culturel de l’Europe centrale à la fin du xiiie siècle, sous le règne de Wenceslas II (1283-1305) de la dynastie des Přemyslides. Ce dernier soutint la production littéraire des poètes en langue allemande, et il aurait lui-même composé quelques poèmes en allemand. En témoigne aussi son portrait dans le manuscrit Codex Manesse dans lequel il figure parmi les plus grands poètes allemands1.
Malgré sa réputation de « roi étranger », Jean l’Aveugle (1310-1346), le comte de Luxembourg devenu en 1310 roi de Bohême, s’occupa avant tout de la position de sa dynastie et de son royaume sur la scène politique européenne. L’attention qu’il accorda à Prague et à sa résidence demeura en revanche négligeable. Sous son règne déjà, son fils aîné et successeur Charles IV, après avoir passé sept ans de son enfance à la cour royale de France, revint en Bohême et se mit à construire le château de Prague, une nouvelle rési-dence royale destinée à remplacer l’ancienne qui avait été gravement endommagée par un incendie. Son activité s’intensifia encore après son accession au trône de roi des Romains et à celui de Bohême (1346)2. À partir de ce moment, le roi commença à mettre en œuvre une vision ambitieuse et cohérente de Prague en tant que centre culturel et politique. Dès 1347, Charles IV parla de Prague comme de « notre capitale » (vnser hoepstat) et de « la tête et la chaire de notre royaume » (unsers kunigreichs zu Behem stul vnd hoep)3. Dans le même esprit, quand il fonda l’université à Prague, il souligna les qualités de la ville pour accueillir le studium generale4. La vision qu’avait Charles IV de Prague était donc claire dès le début de son règne. Cette fonction résidentielle et centrale de Prague fut notée par un chroniqueur contemporain, Henricus de Diessenhofen, dans sa Chronique : « Et de là (Nuremberg) il (Charles IV) vient à Prague qui est actuellement la capitale de la Bohême et la résidence impériale, ce que fut autrefois Rome, puis Constantinople et maintenant Prague »5.
En ce qui concerne le cadre chronologique de mon étude, il est déterminé par le règne de Charles IV, mais je préfère l’élargir aux décennies 1340-1400, au motif que pen-dant les dernières années de la vie de son père, Jean l’Aveugle, Charles IV exerçait déjà une grande influence sur la politique du pays. Inversement, bon nombre de tendances de sa poli-tique se poursuivirent sous le règne de son fils Wenceslas IV (1378-1419), surtout pendant
1 H.-J. Behr, Literatur als Machtlegitimation. Studien zur Funktion der deutschsprachigen Dichtung am böhmischen Königshof im 13. Jahrhundert, Munich, 1989 (Forschungen zur Geschichte der älteren deutschen Literatur 9) ; V. Žůrek, « Mittelhochdeutsche Dichtung in Böhmen der Přemysliden », in M. Brauer, P. Rychterová et M. Wihoda (éd.), Die mittelalterliche Kolonisation. Vergleichende Untersuchungen, Prague, 2009, pp. 167-194.2 Les informations de base sur la vie et le règne de Charles IV sont proposées par F. Seibt, Karl IV. Ein Kaiser in Europa 1346-1378, Munich, 1978 ; J. Spěváček, Karel IV. Život a dílo (1316-1378), Prague, 1980.3 Codex juris municipalis regni Bohemiae 1: Privilegia civitatum Pragensium, J. Čelakovský (éd.), Prague, 1886, p. 73, no. 48 ; cf. D. Mengel, « Emperor Charles IV (1346-1378) as the Architect of Local Religion in Prague », Austrian History Yearbook 41 (2010), pp. 15-29.4 Citation de la charte de fondation (7 avril 1348), Regesta diplomatica nec non epistoralia Bohemiae et Moravie, t. V (1346-1355), fasc. I (1346-1348), J. Spěváček (éd.), pp. 170-171 : « Sane ut tam salubris et laudabilis animi pareat concepcio fructus dignos, regni ipsius fastigia tripudialibus novitatis volentes primiciis augmentari, in nostra Pragensi metropolitica et amenissima civitate, quam terrene fertilitatis fecunditas et plenitudine rerum amenitas localis reddunt utiliter tanto negocio congruentem, instituendum, ordinandum et de novo creandum consulta utique deliberacione previa duximus studium generale… ».5 [Chronicon], in A. Huber (éd.), Henricus de Diessenhofen und andere Geschichtsquellen Deutschlands im späteren Mittelalter, Stuttgart, 1868, (Fontes rerum Germanicarum, Geschichtsquellen Deutschlands 4) p. 116 : « Et inde Pragam secessit, que nunc metropolis regni Bohemie existit, ubi nunc sedes imperii existit, que olim Rome, tandem Constantinopolim, nunc vero Prage degit ».
215
Les gens de savoir au service de l’empereur Charles IV à Prague
les vingt premières années, c’est-à-dire jusqu’à l’an 1400. Ceci est valable par exemple pour le premier demi-siècle de l’existence de l’université (fondée en 1348), qui fut celui d’un essor progressif. Charles de Luxembourg profita pleinement de la présence de l’université à Prague et de son rayonnement toujours plus important à l’échelle internationale et surtout régionale. C’est la présence à Prague de cette université, la première de tout l’Empire, qui permit à Charles IV d’y recruter de nombreux érudits de valeur.
L’essor de Prague sous les auspices du souverain commença par sa transformation en une résidence royale, puis impériale, après le couronnement de Charles comme empereur en 1355. Dans son esprit, la capitale symbolique de l’Empire restait certes toujours Rome, la Ville éternelle. Prague était plutôt conçue comme une résidence personnelle de l’empe-reur et de sa cour ; en revanche, les institutions impériales n’y résidaient pas et les diètes n’y avaient pas lieu. Mais à ce seul titre, la ville revêtait une grande importance pour la politique quotidienne de l’Empire, comme en témoigne le fait qu’un bon nombre de princes de l’Empire acquirent une résidence à Prague, le plus souvent dans un hôtel particulier, afin de se garantir un contact étroit avec l’empereur et l’accès à sa cour. Quelques-uns reçurent de l’empereur des bâtiments les autres les achetèrent eux-mêmes6.
Le paysage intellectuel de Prague prit une nouvelle dimension quand Charles entreprit la fondation de la Nouvelle Ville en 13487. Ce nouveau « quartier » doubla la superficie de la ville. La fondation fut suivie par l’afflux de nouveaux habitants : la crois-sance démographique fut telle qu’avec ses 40.000 habitants, Prague se hissa au rang des cités les plus peuplées de l’Empire.
Pour mieux comprendre la structure urbaine de Prague, il faut d’abord expliquer la situation administrative de la ville. La Prague médiévale consistait en fait depuis 1348 en trois villes indépendantes les unes des autres et en une ville serve. Dans la vie quotidienne des Pragois, les trois villes semblaient souvent des quartiers d’une même ville, mais admi-nistrativement et dans leurs relations avec le roi ainsi qu’entre elles-mêmes, elles agissaient de façon indépendante.
La Petite Ville s’étendait en contrebas du château sur la rive gauche, tandis qu’au-dessus d’elle, à l’ouest du château, se trouvait la petite ville serve de Hradčany, peuplée avant tout par les serviteurs et travailleurs du chantier du château. Cette rive de la rivière était complétée par le vaste Château royal. La plus peuplée et de loin était toutefois la rive droite, où la Vieille Ville représentait l’agglomération traditionnelle, par contraste avec la Nouvelle Ville fondée par Charles IV en 1348 hors les murs de la Vieille Ville qu’elle englobait.
Malgré l’effort de l’empereur, les villes restèrent indépendantes l’une de l’autre. Le souverain imposa l’unification de la Vieille et Nouvelle Ville en 1368, mais après de nombreuses complications et, semble-t-il, des protestations, il révoqua sa décision en 13778.
6 Pour la place de Prague dans la conception gouvernementale de Charles IV cf. K. Kubínová, Imitatio Romae. Karel VI. a Řím, Prague, 2006 ; J. Spěváček, « Prag zwischen West- und Osteuropa im Zeitalter der Luxemburger », Historica 30 (1990), pp. 5-27 ; P. Moraw, « Zur Mittelfunktion Prags im Zeitalter Karls IV. » in K.-D. Grothusen et K. Zernack (éd.), Europa slavica – Europa orientalis. Festschrift für Herbert Ludat, Berlin, 1980, pp. 445-489 ; Fr. Machilek, « Praga caput regni. Zur Entwicklung und Bedeutung Prags im Mittelalter » in F. B. Kaiser et B. Stasiewski (éd.), Stadt und Landschaft im deutschen Osten und in Ostmitteleuropa, Cologne-Vienna 1982 (Studien zum Deutschtum im Osten 17), pp. 67-125.7 Cf. V. Lorenc, Das Prag Karls IV: die Prager Neustadt, Stuttgart, 1982.8 F. Kavka, « K otázce sjednocení pražských měst v letech 1368-1377 a k místu Prahy v Karlově státní koncepci », Documenta Pragensia, 4 (1984), pp. 100-120 ; I. Hlaváček, « Staré a Nové Město pražské a jejich spojení na sklonku vlády Karla IV. (Několik úvah a poznámek) », Documenta Pragensia, 4 (1984), pp. 84-99.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
Václav Žůrek
216
La situation topographique de la Prague médiévale fut bien décrite par les visiteurs de la Bohême. L’un d’eux, le poète français Eustache Deschamps, qui vint en Bohême en tant qu’ambassadeur de Charles VI de France avant l’année 1397, résume dans un rondeau son impression de la capitale tchèque de façon suivante : « Il a a Prage trois citez / Et mainte grant et noble eglise / Et gens devoz, dont je les prise »9.
La Nouvelle Ville (Civitas nova) retint longuement l’attention du souverain, qui s’occupa avant tout des fondations religieuses. Charles IV y fonda de nombreuses insti-tutions religieuses, qui composèrent une « couronne » de couvents de différents ordres. Quelques-uns eurent une valeur et importance symboliques particulières pour la propa-gande de la cour des Luxembourg. D’après certains historiens, Charles IV voulut faire de Prague une nouvelle Rome, ville sacrée ; voilà pourquoi il invita à venir s’installer à Prague les membres de tous les ordres religieux connus en Occident, même des ordres rares comme par exemple les ambrosiens ou les bénédictins de rite slave10. Quoi qu’il en soit, il aida par ses fondations à peupler Prague de personnes savantes, ce qui n’était pas sans importance pour la ville et pour sa cour. L’empereur s’était rendu compte que pour assouvir ses ambi-tions de mécène littéraire et de souverain savant, il avait besoin de gens de savoir. C’est pourquoi Charles déploya tous ses efforts pour fonder à Prague la première université de l’Empire (1348). Il réussit à obtenir très vite l’autorisation pontificale, de sorte que l’ensei-gnement, confié aux lecteurs des écoles religieuses, commença dès avant 1350. Ces écoles (studia generalia réguliers) jouèrent un rôle important pendant les premières années de l’existence de l’université pragoise11. Charles IV devait garantir que l’université qu’il avait fondée aurait suffisamment de professeurs dans toutes les disciplines, ce qui posait surtout de redoutables problèmes dans le cas de la théologie. La papauté ne permettait que très exceptionnellement de fonder une faculté de théologie, de sorte que jusque-là les maîtres parisiens en détenaient le monopole sur le continent. C’est grâce aux écoles régulières des ordres mendiants déjà existantes à Prague que Charles IV put mettre en œuvre cet enseignement prestigieux. Le roi et l’archevêque de Prague, Ernest de Pardubice, qui était aussi le chancelier de l’université, choisirent les premiers professeurs de théologie parmi les enseignants des écoles régulières et le pape Clément VI, à la demande de Charles IV, les promut maîtres en théologie. Le roi avait choisi un maître de chaque école préexistante à Prague, un dominicain du couvent Saint-Clément (maître tchèque Jean Moravec, collègue du maître Jean de Dambach), un Frère mineur de Saint-Jacques (maître Vojtěch Bludův), tous les deux dans la Vieille Ville, et un ermite de Saint-Augustin du couvent Saint-Thomas dans la Petite Ville (maître Nicolas de Louny). Par la suite, avec le soutien royal, deux autres ordres fondèrent aussi une école à Prague : les Carmes à Notre-Dame-des-Neiges, dans la Nouvelle Ville, fondés par Charles IV après son couronnement en 1347, et l’ordre cister-cien à Saint-Bernard. La coexistence et la symbiose des écoles régulières et de l’université
9 Œuvres complètes de Eustache Deschamps : publiées d’après le manuscrit de la Bibliothèque nationale, t. VII, G. Raynaud (éd.), Paris, 1891, rondeau MCCCXXX, p. 93, v.1-3 ; cf. M. Nejedlý, « La Bohême et ses habitants vus par quatre auteurs français du Moyen Âge (Guillaume de Machaut, Eustache Deschamps, Jean Froissart, Jean d’Arras) », Listy filologické CXXVIII (2005), pp. 21-34, ici p. 29.10 K. Kubínová, Imitatio Romae, op. cit., pp. 221-237.11 J. Kadlec, « Řeholní generální studia při Karlově universitě v době předhusitské », Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 7 (1966), pp. 63-108.
217
Les gens de savoir au service de l’empereur Charles IV à Prague
se perpétuèrent et, à partir de 1371, les membres de ces ordres purent se présenter aux exa-mens à l’université comme tous les autres étudiants12.
L’université se transforma lentement en un vrai studium generale, si bien que son existence finit par influer de façon décisive sur la vie quotidienne de la ville. D’après l’estimation de František Šmahel, le nombre des scholares à Prague augmenta jusqu’à 3000 personnes à la fin du xive siècle qui représentaient alors au moins 5% de la popula-tion, tous au demeurant exemptés de la juridiction des villes de Prague13. En même temps augmenta le nombre d’intellectuels vivant à Prague qui cherchaient du travail après leurs études universitaires et qui étaient susceptibles d’être recrutés pour le service de la cour royale. À en croire le témoignage du chroniqueur de la cour de Charles IV, Beneš Krabice de Weitmile, « la ville de Prague devient fameuse pour son université »14.
L’effort du roi pour promouvoir le studium et pour l’associer étroitement à sa cour se remarque aussi dans le domaine de la médecine : les deux premiers professeurs à la faculté de médecine furent les médecins personnels du roi, les maîtres Walter et Balthasar de Marcellini15. Cette tendance se maintint par la suite, quand une bonne moitié des pro-fesseurs de médecine à l’université soignaient en même temps les membres de la famille de Luxembourg et les autres membres de la cour16.
Bien que l’empereur Charles IV ait passé beaucoup de temps à voyager à travers l’Europe, sa grande cour fut installée à Prague. La cour avait pour cœur le château de Prague, mais bien évidemment le nombre de courtisans présents variait beaucoup en fonc-tion des allées et venues de Charles IV. La cour « pleine » ou complète (curia plena) se trouvait à Prague seulement de temps en temps, surtout pour des raisons politiques ou à l’occasion d’une solennité particulière comme le sacre.
Un élément important de la cour était formé par les gens de savoir au service du souverain. Charles avait besoin de conseillers qualifiés pour l’aider dans l’administration de l’Empire et du royaume, en particulier dans sa chancellerie. En même temps, il cherchait un moyen d’offrir des prébendes à ses conseillers et à d’autres intellectuels à son service. C’est pourquoi Charles, alors qu’il était encore margrave de Moravie et héritier du trône, en concertation avec son père Jean l’Aveugle, fonda en 1339 le chapitre de la chapelle de Tous-les-Saints, au Château de Prague, qui offrait onze bénéfices canoniaux, ainsi que dix places pour les serviteurs. Il voulait faire de cette collégiale castrale un réservoir de clercs à son service. La fondation fut faite probablement sur le modèle des rois de France et de la Sainte-Chapelle, que Charles IV avait bien connue dans son enfance passée à la cour royale de Charles IV de France, puis de Philippe VI, entre 1323 et 1330. Le chapitre fut fondé à
12 M. Svatoš, « Obecné učení 1347/48-1419 » in Id. (éd.), Dějiny Univerzity Karlovy 1347/48-1622, t. 1, Prague, 1995, p. 39 ; en dehors de l’histoire institutionnelle de l’université cf. F. Šmahel, « Die Anfänge der Prager Universität. Kritische Reflexionen zum Jubiläum eines nationalen Monuments’ », in Id., Die Prager Universität im Mittelalter. Gesammelte Aufsätze / The Charles University in the Middle Ages. Selected Studies, Leyde-Boston, 2007 (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance 28), pp. 3-50 ; cf. aussi O. Marin, « Les lieux du savoir : contribution à la topographie universitaire pragoise (1348-1415) », in P. Gilli, J. Verger et D. Le Blévec (éd.), Les universités et la ville au Moyen Âge, Leyde – Boston, 2007, pp. 63-94.13 F. Šmahel, « Scholae, collegia et bursae universitatis Pragensis. Ein Beitrag zum Wortschatz der mittelalterlichen Universitäten », in O. Weijers (éd.), Le vocabulaire des collèges universitaires (xiiie-xvie siècles), Turnhout, Brepols, 1993, (CIVICIMA 6), pp. 115-130, ici p. 116.14 Beneš Krabice de Weitmile, Cronica ecclesie Pragensis, in J. Emler (éd.) Fontes rerum Bohemicarum, t. 4, Prague, 1884, p. 518 : « Et facta est civitas Pragensis ex studio huius modi famosa ».15 P. Svobodný, « Lékařská fakulta », in M. Svatoš (éd.), Dějiny Univerzity Karlovy 1347/48-1622, op. cit., p. 188.16 Ibid., pp. 183-202.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
Václav Žůrek
218
proximité du palais royal. La chapelle de Tous-les-Saints devait aussi discrètement imiter la Sainte-Chapelle de Paris, car le bâtiment était percé de larges verrières17. Cette chapelle royale et le chapitre qui y était adjoint devaient aussi servir de gagne-pain pour les gens de la chancellerie et c’était au fondateur, c’est-à-dire au souverain, et à ses héritiers, qu’incom-baient les nominations aux prébendes canoniales18.
Par ailleurs, après que l’évêché de Prague eut été élevé au rang de métropole ecclésiastique, en 1344, les Luxembourg fixèrent leur attention sur la construction de la cathédrale Saint-Guy et soutinrent la transformation du chapitre cathédral, qui occu-pait cet emplacement depuis le xie siècle. Ce chapitre abritait traditionnellement une école, certes modeste, mais en même temps la plus importante du royaume avant la fondation de l’université19. Cette institution traditionnelle se transforma donc alors en un chapitre métropolitain et à partir de ce moment, l’empereur Charles IV privilégia de plus en plus la cathédrale et la promut en un vrai centre intellectuel, faisant partie intégrante de la cour royale et impériale.
En 1366, pour empêcher la concurrence entre ces deux institutions à la fois proches et semblables, l’empereur profita du fait qu’il venait de fonder un collège universitaire de maîtres à son nom (Collegium Caroli) pour ordonner que les places dans le chapitre de Tous-les-Saints soient désormais exclusivement réservées à ses membres. Les prébendes canoniales favorisèrent considérablement la situation financière des maîtres du collège et contribuèrent aussi au prestige de l’institution. De la même époque date la fondation du collège de Tous-les-Saints, administrativement lié au chapitre. Le collège résida à ses débuts dans la Petite Ville, sous le Château et près du chapitre mère, mais il déménagea très vite sur la rive droite dans la Vieille Ville, à quelques pas du collège Carolinum et des autres bâtiments universitaires, ce qui était plus pratique pour les maîtres aussi bien que pour les étudiants20.
Parallèlement, le chapitre de l’église métropolitaine Saint-Guy devint un centre intellectuel intégré à la cour impériale. Ce chapitre se trouvait à côté de la cathédrale, dans le périmètre du château, ce qui explique sa liaison étroite avec la cour. Les chanoines furent recrutés surtout dans l’entourage du souverain et de l’archevêque21. Dans le milieu érudit du
17 J. Kuthan, « La Sainte-Chapelle de Paris et les épines de la couronne du Christ. Quelques notes concernant les liens entre l’architecture et la sculpture en France et l’œuvre fondatrice et commanditaire des derniers Přemyslides et des Luxembourg en Bohême », in Inspirations françaises. Recueil d’interventions portant sur l’histoire de l’art, Prague, 2006, pp. 11-63, ici pp. 22-23 ; Z. Hledíková, « Karel IV. a církev », in id., Svět české středověké církve, Praha, 2010, pp. 163-190, ici pp. 173-174 ; id., « Počátky kapituly u Všech svatých na Pražském hradě », in T. Borovský et al. (éd.), Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno, 2003, pp. 437-448.18 Beneš Krabice de Weitmile, Cronica ecclesie Pragensis, op. cit., p. 492 : « Eodem anno Karolus, domini regis Boemie primogenitus, marchio Morauie, zelo devocionis accensus, accedente ad hoc assensu patris sui Iohannis, regis Boemie, ac venerabilis patris Iohannis, episcopi Pragensis, et capituli eiusdem Pragensis ecclesie, in capella regali Omnium Sanctorum in castro Pragensi creavit collegium, videlicet prepositum, decanum et XI prebendas ac X ministros, quibus large providit, quorumque ecclesiam multis sanctorum reliquiis et aliis clenodiis largiter decoravit, volens et decernens, ut presentacio prepositure et prebendarum ad ipsum et successores suos, reges Boemie, eleccio vero decani ad capitulum eiusdem collegii debeat spectare. Quam creacionem et ereccionem dominus papa Benedictus XII suis litteris bullatis approbavit et confirmavit ».19 M. Bláhová, « Pražské školy předuniverzitního období », Documenta Pragensia, 11 (1993), pp. 26-39 (ici pp. 27-28).20 M. Svatoš, « Pražská univerzitní kolej Všech svatých », Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 31 (1991), pp. 85-93 ; la topographie universitaire pragoise a été analysée récemment de façon très précise par O. Marin, « Les lieux du savoir », op. cit., pp. 63-81.21 Comme le prouve Dominik Budský, une grande partie des chanoines étaient aussi au service à la cour, et leur demande d’un bénéfice ecclésiastique fut soutenue par l’intervention de l’entourage du roi. Cf. D. Budský, « Metropolitní kapitula pražská jako dvůr v malém. Kariéra a vztahy v prostředí kapituly v letech 1378-1390 », in D. Dvořáčková-Malá (éd.), Dvory a rezidence ve středověku. Mediaevalia historica Bohemica, Supplementum 1, pp. 53-86.
219
Les gens de savoir au service de l’empereur Charles IV à Prague
chapitre métropolitain s’exerça ainsi une certaine rivalité entre le souverain et l’archevêque dans leurs rôles de « patrons ». Cette situation ne fut pas très préjudiciable à l’époque de Charles IV, qui entretint de bonnes relations personnelles avec ses deux métropolitains successifs. Mais sous le règne de son fils Wenceslas IV, quand les relations entre le souverain et l’archevêque dégénérèrent en un conflit féroce, le chapitre se transforma en un champ clos de leur conflit, qu’aggravèrent encore le Grand Schisme et l’ingérence de la papauté.
En raison de la politique ambitieuse qu’il menait en matière de représentation littéraire de son pouvoir et de sa dynastie, l’empereur Charles IV avait un grand besoin de lettrés qui soient capables de le conseiller et de rédiger des œuvres historiques, politiques, théologiques ou juridiques. Une grande partie de ces érudits se trouvaient dans l’entourage direct de l’empereur. Il s’agit dans ce cas surtout de dignitaires ecclésiastiques (l’archevêque de Prague Ernest de Pardubice et plus tard Jean Očko de Vlašim, l’évêque d’Olomouc Jean de Středa (Neumarkt) et l’évêque de Litomyšl Albert de Sternberg, les chanoines de l’église métropolitaine, etc.). Ces hommes exécutaient pour Charles IV des missions diploma-tiques, mais ils constituaient aussi le cœur de son conseil, une sorte de think tank qui assista l’empereur pendant tout son règne. Outre ces dignitaires ecclésiastiques et des membres de la chancellerie, l’appartenance des autres érudits à la cour n’était pas, d’après nos indices, aussi stable. À la différence des dignitaires d’Église mentionnés, Charles IV devait lui-même les recruter à son service.
Le besoin d’attirer des érudits à la cour ne se fondait pas seulement sur la culture personnelle du souverain, mais surtout sur l’ « historisme » idéologique et poli-tique qui constituait l’une des inspirations majeures de son programme monarchique. Dans ce contexte, l’accent fut mis sur la production historique curiale et sur la production d’un art visuel commandité par Charles IV et à l’usage de son entourage22.
Afin de recruter des érudits pour sa cour, Charles IV utilisa les ressources urbaines, qui existaient en partie à Prague déjà auparavant et qui furent partiellement développées avec son soutien. Aussi important fut le rôle de l’université, qui attirait à Prague des intel-lectuels venus aussi bien des pays de la Couronne tchèque que de l’étranger, dont le service pouvait être utile au souverain. Les autres institutions religieuses pragoises pouvaient elles aussi servir de réservoir d’érudits, tout en offrant aussi les prébendes nécessaires à l’entretien de personnes fraîchement arrivées à Prague.
Le clergé pragois et les maîtres et anciens élèves de l’université ne suffisaient cepen-dant pas à répondre à la demande royale. Depuis le début de son règne, Charles essaya en plus d’attirer à Prague des artistes et des savants. L’attraction de Prague augmenta sensi-blement quand la ville devint la résidence du roi des Romains, devenu empereur en 1355. L’intérêt qu’avait Charles à disposer de savants compétents et célèbres à son service l’obli-gea à s’occuper de cette question et à promouvoir la position de Prague en tant que centre culturel et intellectuel.
L’exemple de quelques érudits fameux permet de montrer comment Charles IV les attira à Prague et comment il tenta d’assurer leur existence. L’appartenance à la cour ne signifiait pas qu’ils y trouvaient automatiquement leur gagne-pain. Pour les clercs, qui représentaient la plupart des érudits de l’époque, une possibilité commode se présentait : acquérir une prébende dans quelque église pragoise. Ainsi, pour profiter de leur service,
22 F. Kavka, Am Hofe Karls IV, Leipzig, 1989, pp. 153-155.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
Václav Žůrek
220
l’empereur devait non seulement inviter les intellectuels étrangers et les accueillir à la cour comme conseillers, chapelains, aumôniers ou autre, mais encore leur obtenir un revenu ecclésiastique. Le droit de patronage qu’il exerça en leur faveur fut donc l’un des outils à l’aide desquels Charles IV put attirer des érudits à sa cour.
C’est aussi une des raisons pour lesquelles l’empereur fonda et subventionna de nombreuses institutions religieuses à Prague et ailleurs. Les structures urbaines de Prague en pleine expansion offraient les conditions opportunes pour l’activité de fonda-tion de Charles IV. Le poids relatif du clergé dans la ville augmenta de fait considérable-ment, ce qui ne manqua pas d’influer sur la vie quotidienne de Prague. En plus du clergé paroissial, le nombre de clercs attachés au service de la seule cathédrale se montait à près de 200 personnes. Il y avait de surcroît un grand nombre d’étudiants et des cohortes de religieux répartis dans les 23 monastères et couvents de Prague. Pour autant, la plupart des « lieux de savoir » se trouvaient concentrés dans la Vieille Ville23.
La stratégie de représentation dynastique de Charles IV se réalisa sur la base de deux programmes, impérial et royal. Le souverain était en effet à la fois roi de Bohême et empereur. Les deux dignités exigeaient des approches différentes de la représentation, parce qu’elles ciblaient des publics différents, même si elles se trouvaient réunies autour d’une seule et même cour. La production historique avait donc alors une importance accrue pour Charles IV, qui s’efforça de fonder la légitimité de sa dynastie en Bohême et dans l’Empire sur l’idée de continuité dynastique des Přemyslides et des Luxembourg.
Charles IV mit l’accent sur l’instrumentalisation du passé. En plus d’écrire lui-même, à commencer par sa célèbre autobiographie24, il commanda la rédaction de plusieurs chroniques25. Une œuvre à grand succès et souvent copiée (Cronica Bohemorum) fut écrite à sa demande par Přibík Pulkava de Radenín (+1380). Ce dernier, gradué de l’université de Prague et plus tard directeur de l’école de l’église Saint-Gilles dans la Vieille Ville, repré-sente dans l’entourage de l’empereur l’exemple-type du « cadre » recruté parmi le clergé local. Pulkava travailla longtemps sur sa chronique et la réécrivit plusieurs fois d’après les instructions de Charles IV.
Un bon exemple du « programme impérial » de la production historique à Prague est représenté par la « Chronique des Tchèques », que Charles IV fit écrire par un érudit étranger, le frère mineur Giovanni di Marignolli26. Charles IV rencontra cet évêque de Bisignano et ancien ambassadeur du pape en Orient en 1355, alors qu’il rentrait de Rome où il avait été couronné empereur ; il lui demanda de rédiger une chronique universelle, dans laquelle il devait incorporer l’histoire de Bohême. Marignolli devint le chapelain de l’empereur et séjourna jusqu’à sa mort à la cour impériale, où il écrivit le texte de la Chro-nicon Boemorum (+1358/1359). La chronique souligne l’appartenance des Tchèques au cercle des nations importantes de l’histoire chrétienne et met surtout en valeur le fait que Charles IV était prédestiné au trône impérial par la noblesse et la grandeur de ces ancêtres.
23 Cf. O. Marin, « Les lieux du savoir », op. cit., pp. 63-81 ; A. Petitova-Bénoliel, L’Eglise à Prague sous la dynastie des Luxembourg (1310-1419), Hilversum, 1996.24 Vie de Charles IV de Luxembourg, P. Monnet et J.-Cl. Schmitt (éd.), Paris, 2010 (Classiques de l’histoire au Moyen Âge 49).25 M. Bláhová, « Die Hofgeschichtsschreibung am böhmischen Herrscherhof im Mittelalter », in R. Schiefer et J. Wenta, (éd.), Hofgeschichtsschreibung im mittelalterlichen Europa, Toruň, 2006, pp. 51-73.26 A.-D. von den Brincken, « Die universalhistorischen Vorstellungen des Johann von Marignola OFM. Der einzige mittelalterliche Weltchronist mit Fernostkenntnis », Archiv für Kulturgeschichte 49 (1967), pp. 297-339.
221
Les gens de savoir au service de l’empereur Charles IV à Prague
Ce discours généalogique devait aider Charles à imposer la famille de Luxembourg sur le trône de l’Empire.
L’attention de l’empereur ne se concentra pas seulement sur les œuvres historiques, car des juristes illustres pouvaient tout aussi bien servir ses intentions. En même temps que Marignolli, Charles rencontra le célèbre professeur de droit Bartole de Saxoferrato. Il le chargea de l’aider à préparer certaines lois (surtout la Bulle d’Or de 1356). Dans les sources, Charles IV appelle Bartole son conseiller (« seinem rath »), ce qui signifie qu’il devint membre de la cour. Bartole est un exemple d’érudit qui n’entra que temporairement au service de l’empereur, sans jamais avoir mis les pieds en Bohême27.
Un autre cas est celui du théologien allemand, membre de l’ordre dominicain, Conrad (le Jeune) de Halberstadt qui vint à Prague en 1354 comme professeur de théolo-gie au studium de Saint-Clément et à l’université. La présence de ce personnage à Prague n’échappa pas à l’attention de l’empereur et de ses conseillers. Charles l’accueillit à sa cour et lui accorda la fonction et le titre de chapelain. Nous ignorons combien de temps il resta à Prague, mais en tout état de cause, il acheva là plusieurs ouvrages dédiés à Charles IV et à l’archevêque Ernest de Pardubice28.
C’est même parfois une institution entière, comme centre d’érudition et de production littéraire, que l’empereur soutenait. De ce point de vue, parmi toutes les mai-sons religieuses fondées par Charles IV dans la Nouvelle Ville, le couvent d’Emmaüs, dit aux Slaves, bénéficia d’une faveur spéciale. Avec l’autorisation pontificale, Charles IV y avait invité des moines bénédictins de rite slave et, par la suite, le monastère devint un centre de production littéraire en slavon, ainsi qu’en vieux tchèque. Charles IV et son entourage mirent en effet l’accent sur la production littéraire en langues vernaculaires et sur les traductions du latin en vernaculaire, surtout en tchèque. Les moines du monastère slave produisirent un grand nombre de manuscrits dans cette veine, surtout des traduc-tions de livres religieux en alphabet glagolitique et cyrillique (entre autres, la deuxième partie de l’Évangéliaire de Reims, un manuscrit bien connu pour son rôle dans le sacre des rois de France)29.
L’empereur était aussi en contact avec des humanistes italiens. Le tribun du peuple de Rome, Cola di Rienzo, passa quelques mois à Prague, avant que l’empereur ne doive le rendre à la curie romaine. Charles IV essaya d’attirer à sa cour le compatriote de Rienzo, le célèbre poète Pétrarque. Depuis le début des années cinquante, Charles échangea des lettres avec lui et reçut de lui des conseils sur sa politique en Italie et des encouragements à y intensifier son engagement. Puis Pétrarque passa un mois à Prague en 1356 et resta par la suite en contact épistolaire avec l’empereur, et surtout avec son chancelier féru d’humanisme, Jean de Středa. Charles IV essaya de nouveau, à partir de 1361, de convaincre Pétrarque de s’installer à Prague, mais celui-ci se borna à un acquiescement vague et ne franchit jamais le pas. L’empereur ne réussit donc pas à rehausser le prestige de sa cour avec ce personnage d’une renommée européenne. Néanmoins, Pétrarque fit part dans ses épîtres de la haute estime dans laquelle il tenait l’empereur et son entourage. Il rendit cet hommage
27 F. Merzbacher, « Bartolo di Sassoferrato », in F. Seibt (éd.), Karl IV. und sein Kreis, Munich, 1978 (Lebensbilder zur Geschichte der böhmischen Länder 3), pp. 145-158.28 Konrad von Halberstadt O.P., Chronographia Interminata 1277-1355/59, R. Leng (éd.), Wiesbaden, 1996 (Wissensliteratur im Mittelalter 23), pp. 8-14.29 M. Paulová, « L’idée Cyrillo-Méthodienne dans la politique de Charles IV et la fondation du monastère Slave de Prague », Byzantinoslavica 11 (1950), pp. 174-186, ici pp. 179-184.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER.
Václav Žůrek
222
à la cour de Charles IV à Prague : « Je déclare que je n’ai vraiment vu rien de moins barbare et rien de plus humain que l’Empereur et certains grands hommes autour de lui, dont je tais à dessein les noms »30.
Conclusion
Prague était depuis l’époque des Přemyslides, la ville capitale et en même temps le siège de la cour. La présence de la cour « dans la ville » déterminait traditionnellement la vie de Prague, en ce qui concerne, par exemple, la structure du commerce urbain ou la position des bourgeois de Prague auprès de la cour royale. Au moment de la transformation de la ville sous Charles IV, quand Prague devint la capitale de l’Empire, la cour et la ville
30 Petrarcas Briefwechsel mit deutschen Zeitgenossen, P. Piur (éd.), Berlin, 1933 (Vom Mittelalter zur Reformation VII), p. 21, n. 4. : « Ego vero nichil barbarum minus, nichil humanum magis profiteor me vidisse quam Cesarem et aliquot circa eum summos viros, quorum modo nominibus scienter abstineo, summos, inquam, viros et insignes, dignos maiore memoria; quod ad hec attinet, abunde mites et affabiles, etiam si “Athenis athicis” nati essent. Vale. » ; cf. J. Špička, Petrarca: homo politicus. Politika v životě a díle Franceska Petrarky, Prague, 2010, pp. 161-192.
Figure 1 : Établissements religieux à Prague sous le règne de Charles IV.
223
Les gens de savoir au service de l’empereur Charles IV à Prague
vécurent dans une symbiose profitable aux deux parties. Toutefois une certaine concur-rence existait entre les deux entités qui se développa au moment du déclin du pouvoir royal au xve siècle. Pendant les guerres hussites, les villes de Prague devinrent une puissance politique importante.
La vie intellectuelle de Prague se développa remarquablement au cours de la deuxième moitié du xive siècle. Le règne de Charles IV fut un temps d’essor démographique et écono-mique de la ville. Grâce au soutien de l’empereur et pour satisfaire son ambition et ses besoins, le nombre de gens de savoir non seulement au service de l’empereur et de sa cour, mais aussi parmi les habitants de la ville, s’accrut nettement. C’est pour cette raison que Prague devint sous Charles IV le véritable centre culturel et intellectuel de l’Europe centrale.
Le souverain cherchait des auteurs pour sa cour parmi les membres des institutions religieuses de Prague : les maîtres de l’université, les clercs des églises pragoises ou les cha-noines et les religieux. De surcroît, Charles IV ne cessa jamais d’attirer les érudits étrangers à sa cour de Prague. En plus de compter sur l’université et sur les institutions religieuses présentes dans la ville, il s’employa à former à la cour un think tank de savants qui le conseil-lèrent et travaillèrent pour lui, rédigèrent des œuvres à sa demande et parfois aussi sous son contrôle. Ce groupe comprenait des dignitaires ecclésiastiques importants, des membres de la cour, mais aussi des érudits de la ville.
Dans ce contexte, l’empereur Charles IV invita à sa cour et à Prague des intellec-tuels étrangers afin de se servir de leur érudition et des traités qu’ils écrivaient pour lui. Leur nombre était assez important. Nous n’avons fait qu’esquisser la situation des gens de savoir et citer quelques exemples qui révèlent les formes et les stratégies de l’empereur Charles IV pour les attirer à sa cour, ainsi que leur position entre la cour et la ville31.
31 Cette recherche a bénéficié du financement du Conseil européen de la recherche au titre du Programme de la Communauté européenne septième programme-cadre (FP7/2007-2013) / ERC conventions de subvention n° 263672.
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER. 251
Présentation des collaborateurs du volume
Florence Berland ([email protected])Ancienne élève de l’ENS Ulm, agrégée d’histoire, professeur agrégé à l’Université de Cergy-Pontoise et chercheur associé à l’IRHiS-UMR CNRS 8529 Lille 3, ses recherches portent sur les rapports entre cour et ville à Paris à la fin du Moyen Âge, notamment à travers l’exemple bourguignon. Elle a publié dernièrement : « Arriver, s’établir, repartir : les gens de la cour de Bourgogne à Paris (1363-1422) », dans Cédric Quertier, Roxane Chilà, et Nicolas Pluchot (éd.), « Arriver » en ville : les migrants en milieu urbain au Moyen Âge, (actes du colloque international, Lyon, 24-25 février 2011) Publications de la Sorbonne, 2013, p. 131-144. En préparation La cour de Bourgogne à Paris, 1363-1422, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Patrick Boucheron ([email protected])Professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (LAMOP). Parmi ses dernières publications concernant l’histoire globale : Histoire du monde au xve siècle (direction), Paris, Fayard, 2009, rééd. Pluriel 2012) ; Inventer le monde. Une histoire globale du xve siècle, Paris, La Documentation française, 2012 et Pour une histoire-monde (codirection), Paris, PUF, 2013.
Mathieu Caesar ([email protected])Maître-assistant à l’Université de Genève où il a obtenu son doctorat en histoire médiévale avec une thèse portant sur la Communauté de Genève et ses politiques urbaines. Ses recherches actuelles portent sur les sociétés urbaines et sur les familles au pouvoir à la fin du Moyen Âge et au début de l’Époque moderne. Dans ce cadre, il travaille sur un nouveau projet de recherche concernant les factions et les partis politiques dans les villes de l’Occident médiéval, avec une attention particulière à Genève et au Duché de Savoie. Parmi ses publications principales, Le pouvoir en ville. Gestion urbaine et pratiques politiques à Genève ( fin xiiie-début xvie siècles), Turnhout, Brepols, 2011 (Studies in European Urban History (1100−1800) 25) et Histoire de Genève, t. 1: La cité des évêques (ive-xvie siècle), Neuchâtel, Alphil, 2014.
Roxane Chilà ([email protected])Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, agrégée d’histoire, membre de l’École des Hautes Études Scientifiques et Ibériques – Casa de Velázquez de 2011 à 2013. Sa thèse porte sur Une cour à l’épreuve de la conquête : la société curiale à Naples sous le règne d’Alphonse le Magnanime (1416-1458), sous la direction de Patrick Gilli (Université Paul Valéry – Montpellier III, CEMM EA 4583) et Franc-esco Senatore (Università Degli Studi di Napoli Federico II). Dernière publication, « Alphonse le Magnanime et la discipline des comportements curiaux à Naples » dans Armand Jamme, Laurence Moulinier-Brogi et Marylin Nicoud (éd.), Passion et pulsions à la cour, Florence, SISMEL Edizioni del Galluzzo, à paraître en 2014.
252
Présentation des collaborateurs du volume
Léonard Courbon ([email protected])Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, agrégé d’histoire, membre de l’UMR 5648/CIHAM. Sa thèse de doctorat porte sur la curialisation de la vie politique, sociale et culturelle sous le règne de Jean II de Castille (1406-1454), s’intéressant particulièrement aux relations entre la cour et les villes de la Couronne de Castille sous la direction conjointe de Denis Menjot, Université de Lyon 2 et d’Adeline Rucquoi, directrice de recherche au CNRS. Il est par ailleurs professeur d’histoire-géographie au lycée Jean Perrin à Lyon.
Luc Duerloo ([email protected])Professeur d’histoire à l’Université d’Anvers et membre du Centre d’histoire politique (Power in History). Ses recherches concernent l’histoire politique et la culture politique de l’époque moderne. Dernièrement, il a surtout travaillé sur l’époque des archiducs Albert et Isabelle. Il vient de publier Dynasty and Piety: Archduke Albert (1598-1621) and Habsburg Political Culture in an Age of Religious Wars, Farnham Ashgate, 2012. Sur les stratégies dévotionnelles des archiducs, il a entre autres publié « Scherpenheuvel-Montaigu : un sanctuaire pour une politique emblématique », xviie siècle, 60 (2008), p. 423-439.
Germán Gamero ([email protected])PhD student at the University of Valladolid. He graduated with a degree in History (University of Valladolid – 2010) and MPhil in Historical Studies after finishing the Master Program “Europe and the Atlantic World. Power, Culture and Society”. Nowadays he is a PhD grant holder from the Spanish Ministry of Education. His field of investigation is Ferdinand the Catholic’s Court. He has participated in various conferences, and as a result of his investigations he is author of different articles and book chapters. The latest one related to courts and cities is his book chapter “Las lugartenientes de la Corona de Aragón y su relación con las ciudades en tiempos de Fernando el Católico” in Ser mujer en la ciudad medieval europea, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2013.
Rita Costa Gomes ([email protected])Associate Professor at Towson University, where she teaches Medieval and Renaissance history. A historian of Medieval Portugal with strong interests in Iberian and Mediterranean history, she published the first study of the royal court of Portugal, two volumes on the history of the Portuguese frontiers, and the biography of King Fernando I of Portugal (r. 1367-1383). These works explore the Iberian dimension of Portuguese history by using systematic comparison and setting the historical evolution of the medieval kingdom within larger contexts in medieval Iberia, the western Mediterranean, and the early Atlantic worlds. Some of her recent publications are available at www.academia.edu.
Jan Hirschbiegel ([email protected])Studied Ancient, Medieval and Modern History as well as European Ethnology at the Christian-Albrechts-University of Kiel. From 1995 to 2011 he worked as a
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER. 253
Présentation des collaborateurs du volume
research associate in the research project ‘Hof und Residenz im spätmittelalterlichen Deutschen Reich (1200-1600) / Courts and Residences in the Holy Roman Empire in the Later Middle Ages (1200-1600)’ of the Göttingen Academy of Sciences. His habilitation (2011) is entitled ‘Manifestations of trust? Close relations at princely courts in the Later Middle Ages’. Since 2012 he is working as a research associate in the research project ‘Residenzstädte im Alten Reich (1300-1800) / Court Cities in the Holy Roman Empire (1300-1800)’ of the Göttingen Academy of Sciences. Main publications: Étrennes. Untersuchungen zum höfischen Geschenkverkehr im spätmittelalterlichen Frankreich der Zeit König Karls VI. (1380-1422) (Diss. Univ. Kiel 1997), München 2003 (Pariser Historische Studien, 60). Informelle Struk-turen bei Hof. Dresdener Gespräche III zur Theorie des Hofes, hg. von Reinhardt Butz und Jan Hirschbiegel, Münster 2009 (Vita Curialis, 2).
Denis Menjot ([email protected])Professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Lyon 2 (UMR 5648/CIHAM), président de la Société Française d’Histoire Urbaine, ses recherches por-tent sur les villes castillanes au Moyen Âge et plus particulièrement sur les rapports entre finances et société. Parmi ses dernières publications : Les Espagnes médiévales (409-1474), Paris, Hachette, carré Histoire, rééd. revue et augmentée, 2013 ; en collaboration avec Patrick Boucheron ; La Ville médiévale dans Histoire de l’Europe Urbaine, J.L. Pinol (dir.), Paris, réed, Points Seuil, 2012. ; en collaboration avec Stéphane Boissellier et Bernard Darbord, Langues médiévales ibériques. Domaines espagnol et portugais, Turnhout, Brepols, 2013 (L’ Atelier du médiéviste 12).
Matilde Miquel Juan ([email protected])Docteur en histoire de l’art de l’Université de Valence, elle est actuellement profes-seur assistante à l’Université Complutense de Madrid. Ses recherches portent sur la peinture gothique en Espagne, et la pratique artistique dans les royaumes ibériques. Parmi ses nombreuses publications se distingue notamment Retablos, prestigio y dinero. Talleres y Mercado de Pintura en la Valencia del Gótico Internacional, Valence, Université de Valence, 2008. Elle est le chercheur principale du projet de recherche I+D+i (HAR 2012-32720): La formación del pintor y la práctica de la pintura en los reinos hispanos (1350-1500).
Joan-Lluís Palos ([email protected])Professeur d’Histoire Moderne à l’Université de Barcelone. Ses recherches portent sur les institutions du gouvernement de la Catalogne dans l’Empire espagnol des Habsbourgs et actuellement sur l’histoire culturelle en mettant l’accent sur les relations entre l’Italie et l’Espagne aux xvie et xviie siècles et sur l’usage des images comme source pour les historiens. Parmi ses publications récentes Dynastic marriages and cultural transfers in Early Modern Europe (Ashgate, 2014), L’impero di Spagna allo specchio. Storie e propaganda nei dipinti del Palazzo Reale di Napoli (Arte’m, 2015), A vueltas con el pasado. Historia, memoria y vida (Uni-versitat de Barcelona, 2013), Renacimiento y Reforma (RBA Editores-National
254
Présentation des collaborateurs du volume
Geographic, 2013) y La mirada italiana. Un relato visual del imperio español en la corte de sus virreyes en Nápoles (Publications de l’Université de Valence, 2010).
Olga Pérez Monzón ([email protected])Docteur en histoire de l’art et professeur titulaire à l’Université Complutense de Madrid. Ses recherches sont centrées sur la Castille du bas Moyen Âge et s’ordonnent autour de trois lignes directrices: l’art des Ordres militaires, art et religiosité populaire et l’imaginaire du puissant (scénographies artistiques au bas Moyen Âge). Principales publications : Arte sanjuanista en Castilla y León. Las encomiendas de la Guareña y su entorno geo-histórico (Valladolid, 1999) et Catedrales góticas (Madrid, 2003).
Dr. Sven Rabeler ([email protected])Research associate at the Historical Seminar, University of Kiel (Germany), project of the Göttingen Academy of Sciences: ‘Residenzstädte im Alten Reich (1300-1800). Urbanität im integrativen und konkurrierenden Beziehungsgefüge von Herrschaft und Gemeinde’. Fields of interest: medieval history, especially from social, economic, and cultural perspectives – towns, urbanity, and urbanisation, nobility, courts, and residences, poverty, charity, and hospitals. Doctoral thesis about the lesser nobility of Franconia around 1500 from a biographical point of view: Niederadlige Lebensfor-men im späten Mittelalter. Wilwolt von Schaumberg (um 1450-1510) und Ludwig von Eyb d.J. (1450-1521) (Würzburg: Gesellschaft für fränkische Geschichte, 2006). Further publications concern the research interests mentioned above. Currently, a habilitation thesis, dealing with poor relief and charitable foundations in medieval towns of the southern Baltic Sea area, is being prepared.
Ana Maria S. A. Rodrigues ([email protected])Professeur Associé et membre du Centre d’Histoire à l’Université de Lisbonne, ses recherches les plus récentes concernent le pouvoir au féminin. Elle a notamment pub-lié « The Treasures and Foundations of Isabel, Beatriz, Elisenda, and Leonor. The Art Patronage of Four Iberian Queens in the Fourteenth Century », in Therese Martin (ed.), Reassessing the Role of Women as “Makers” of Art and Architecture, vol. 2, Leiden, Brill, 2012, p. 903-935 et « Private Properties, Seigniorial Tributes, and Jurisdictional Rents: The Income of the Queens of Portugal in the Late Middle Ages », in Theresa Earenfight (ed.), Women and Wealth in Late Medieval Europe, Palgrave Macmillan, 2010, p. 209-228 (avec M. S. Silva). Elle a également co- coordonné la collection des biographies des reines de Portugal publiée par Círculo de Leitores et l’auteur d’un des volumes, As tristes rainhas : Leonor de Aragão, Isabel de Coimbra, Lisbonne, 2012.
Dr hab. Urszula Sowina ([email protected])Professor at the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences in Warsaw. Among her publications are: « Espace urbain des villes polonaises au bas Moyen Âge à la lumière des recherches sociotopographiques » in El espacio urbano en la Europa medieval, Nájera. Encuentros Internacionales del medievo 2005, ed. B. Arízaga Bolumburu, J. Á. Solórzano Telechea, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño 2006, 345-372 and Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym
© BREPOLS PUBLISHERS THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.
IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER. 255
Présentation des collaborateurs du volume
i wczesnonowożytnym. Ziemie polskie z Europą w tle, Warszawa 2009, 488p (English version, Water and People in a Late Medieval and Early Modern Town. Polish Lands with Europe in the Background, Peter Lang Verlag, 2014).
Olivier Spina ([email protected])Ancien élève de l’École Normale Supérieure LSH Lyon, agrégé d’histoire, Maître de Conférences en histoire moderne à l’Université de Lyon 2. Co-organisateur avec M. Bouhaïk-Gironès et M. Traversier du séminaire « Histoire sociale des spectacles (Europe, xve-xviiie siècles) ». Il a publié dernièrement : Une ville en scènes. Pouvoirs et spectacles à Londres sous les Tudors (1525-1603), Paris, Classiques Garnier, 2013 ; en collaboration avec A. Roullet et N. Szczech (dir.), Trouver sa place. Individus et com-munautés dans l’Europe moderne, Madrid, Collection de la Casa de Velázquez, 2011.
Peter Stabel ([email protected])Professeur d’histoire médiévale à l’Université d’Anvers et membre du Centre d’Histoire Urbaine. Ses recherches portent sur l’histoire économique et sociale des villes des Pays-Bas méridionaux. Ses dernières recherches concernent la réglementation des marchés dans le monde occidental et islamique au Moyen Âge, le marché du travail et l’histoire sociale de l’industrie textile en Flandre, Artois et au Brabant aux xiie-xive siècle et la reproduction des identités sociales en milieu urbain aux xve et xvie siècles. Parmi ses publications récentes figurent: « Le goût pour l’Orient. Demande cosmopolite et objets de luxe à Bruges à la fin du Moyen Âge », Histoire urbaine, 30, avril 2011, p. 21-40.
Philippe Trélat ([email protected])Chercheur-associé au laboratoire GRHis (Groupe de Recherche d’Histoire de l’Université de Rouen). Son travail est centré sur les différents aspects de l’histoire urbaine de l’Orient latin (espace urbain, société, économie, alimentation, vie matérielle). Après une thèse intitulée Nicosie, une capitale de l’Orient latin. Société, économie et espace urbain (1192-1474) soutenue en 2009 à l’Université de Rouen, il a publié plusieurs articles sur l’histoire du royaume franc de Chypre, notamment « La présence des Ermites de Saint-Augustin en Méditerranée orientale et leur couvent nicosiate (xiiie-xvie siècles) », Augustiniana 2012/3-4, p. 263-288 et « Le goût pour Chypre. Objets d’art et tissus précieux importés de Chypre en Occident (xiiie-xve siècles) », Cahiers du Centre d’Études Chypriotes 43 (2013).
Václav Žůrek ([email protected])Titulaire d’un doctorat, préparé en co-tutelle de Pierre Monnet (École des hautes études en sciences sociales, Paris) et Martin Nejedlý (la Faculté des Lettres, Uni-versité Charles à Prague). Depuis 2007, il travaille au Centre d’études médiévales à Prague et depuis 2011 il est membre de l’équipe de recherche Origins of the Vernacu-lar Mode, ERC-Starting Grant. Dernière publication : « Sur les traces des grands croi-sés. Le goût pour la croisade de Jean et Charles de Luxembourg et l’inspiration français » dans Martin Nejedlý – Jaroslav Svátek (éd.), Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Âge, Toulouse, Méridiennes, 2012 (Les croisades tardives 3), p. 273-291.