« Annexe : La céramique de la tombe 12 », dans G. Castel, L. Pantalacci, Balat VII. Les...
Transcript of « Annexe : La céramique de la tombe 12 », dans G. Castel, L. Pantalacci, Balat VII. Les...
529
LES CATALOGUES D’OBJETS
9.5.6 ANNEXE:LA CÉRAMIQUE DE LA TOMBE 12 Sylvie MARCHAND
Un ensemble de dix céramiques complètes et une fragmentaire constitue la totalité dumatériel céramique déposé dans la tombe 12. La production est locale en argile rouge desoasis, du moins quand il a été possible de le vérifier pour ces pièces enregistrées par le Csae.À une exception près, la céramique est de qualité très moyenne tant dans le façonnage quedans le choix de la pâte et des traitements de surface. Rappelons que pour les descriptions depâte, le choix des termes utilisés tels que «fine», «moyennement fine» ou «grossière»concerne la texture générale de la pâte, la nature et la taille des dégraissants (minéraux ouvégétaux). Ils restent somme toute assez aléatoires pour caractériser les productions localesen pâte rouge des oasis. En effet, le déterminatif de céramique «fine» s’applique assez malà une matrice qui reste globalement de qualité très moyenne.
Des traces de feu sont fréquemment relevées sur les pots; une lampe-coupelle est le seulobjet découvert dont la fonction soit clairement établie pour ces céramiques à caractèrefunéraire.
Le mode de classification choisi pour cette brève étude est avant tout technologique.La présentation en est un peu synthétique, et elle n’a pour but que de mettre en lumièrequelques faits utiles pour une reconnaissance technique et chronologique des productionsoasiennes pour une période qui sera précisée au fur et à mesure de l’élaboration du catalogue.Quand cela a été possible, des comparaisons ont été établies avec un matériel similairereconnu dans l’oasis de Kharga ou encore dans la vallée du Nil.
CATALOGUE
LA CÉRAMIQUE LOCALE FINE ENGOBÉE fig. 1
Description de la pâte: argile rouge locale fine, sonore à inclusions minérales: sable,engobe rouge mat couvrant sous le décor composé de bandes de couleur alternées rouges etbrunes. Façonnage régulier, parois fines.
C170: la forme de cette jarre à haut col cylindrique munie de deux incisions présente uneliaison continue entre le col et la panse, ce qui est une caractéristique de l’époque saïte 93.
93 Le dépôt de fondation daté d’Amasis découvert à Nebeshehdans le Delta contient des jarres de ce type, du moinspour la forme. Cependant, on notera l’absence du décorde bandes parallèles peintes. W.M.Fl. PETRIE, Nebesheh
(Am) and Defeneh (Tahpanhes), Londres, 1888, 14, pl. V,nº 11 et nº 29 (cet exemple présente au moins une incisionprès de la lèvre).
Compte
oasiennes pour une période qui sera précisée au fur et à mesure de l’élaboration du catalogue.
Compte
oasiennes pour une période qui sera précisée au fur et à mesure de l’élaboration du catalogue.Quand cela a été possible, des comparaisons ont été établies avec un matériel similaire
Compte
Quand cela a été possible, des comparaisons ont été établies avec un matériel similairereconnu dans l’oasis de Kharga ou encore dans la vallée du Nil.
Compte
reconnu dans l’oasis de Kharga ou encore dans la vallée du Nil.
LOCALE
Compte
LOCALE FINE
Compte
FINE ENGOBÉE
Compte
ENGOBÉE
de la pâte: argile rouge locale fine, sonore à inclusions minérales: sable,
Compte
de la pâte: argile rouge locale fine, sonore à inclusions minérales: sable,engobe rouge mat couvrant sous le décor composé de bandes de couleur alternées rouges etCom
pte
engobe rouge mat couvrant sous le décor composé de bandes de couleur alternées rouges etbrunes. Façonnage régulier, parois fines.Com
pte
brunes. Façonnage régulier, parois fines.Compte
C170: la forme de cette jarre à haut col cylindrique munie de deux incisions présente uneCompte
C170: la forme de cette jarre à haut col cylindrique munie de deux incisions présente une
rendu
végétaux). Ils restent somme toute assez aléatoires pour caractériser les productions locales
rendu
végétaux). Ils restent somme toute assez aléatoires pour caractériser les productions localesen pâte rouge des oasis. En effet, le déterminatif de céramique «fine» s’applique assez mal
rendu
en pâte rouge des oasis. En effet, le déterminatif de céramique «fine» s’applique assez mal
Des traces de feu sont fréquemment relevées sur les pots; une lampe-coupelle est le seul
renduDes traces de feu sont fréquemment relevées sur les pots; une lampe-coupelle est le seul
objet découvert dont la fonction soit clairement établie pour ces céramiques à caractère
renduobjet découvert dont la fonction soit clairement établie pour ces céramiques à caractère
Le mode de classification choisi pour cette brève étude est avant tout technologique.
rendu
Le mode de classification choisi pour cette brève étude est avant tout technologique.La présentation en est un peu synthétique, et elle n’a pour but que de mettre en lumièreren
duLa présentation en est un peu synthétique, et elle n’a pour but que de mettre en lumièrequelques faits utiles pour une reconnaissance technique et chronologique des productionsren
duquelques faits utiles pour une reconnaissance technique et chronologique des productionsoasiennes pour une période qui sera précisée au fur et à mesure de l’élaboration du catalogue.ren
duoasiennes pour une période qui sera précisée au fur et à mesure de l’élaboration du catalogue.Quand cela a été possible, des comparaisons ont été établies avec un matériel similaireren
duQuand cela a été possible, des comparaisons ont été établies avec un matériel similaire
530
BALAT VII
Aucun ressaut n’est d’ailleurs présent sur le col, à la différence de ce que l’on trouveà l’époque perse au Ve siècle av. J.-C dans les oasis 94. Cependant, notre exemplaire possèdeune liaison légèrement anguleuse, ce qui tend à le rapprocher de l’époque perse.
Le décor est plus typiquement local, l’alternance de bandes de couleur parallèles, rougeslarges et brunes fines, se retrouve fréquemment à l’époque perse dans les oasis 95. Nosconnaissances sur la céramique saïte de cette région sont encore minces. Il n’est donc pasexclu que ce décor existe dès la période saïte. Il est attesté dans le cours de l’époque perse etce jusqu’au début de l’époque ptolémaïque 96.
LA CÉRAMIQUE LOCALE ENGOBÉE OU À SURFACE CLAIRE
Description de la pâte: argile rouge locale à fortes inclusions minérales et/ou végétales.La taille et la fréquence de ces inclusions déterminent la texture plus ou moins grossière dela poterie. La qualité du façonnage est très moyenne; on note le peu de soin dans le lissage,et la présence des barbules de pâte en surface des pots.
FORMES FERMÉES fig. 2
C172: jarre ovoïde de grande taille sans col à lèvre en bourrelet rentrante. La forme de lalèvre est intéressante à examiner: elle appartient à un type que l’on peut reconnaître dans lavallée du Nil 97.
C173: panse de jarre ovoïde de grande taille. Argile locale grossière, lourde. Façonnageexécuté sans soin.
C169 : jarre munie de deux anses. Argile locale grossière à fort dégraissant végétal ensurface. Engobe rouge mat épais. Façonnage peu soigné.
C171 : bouteille à panse large carénée. Argile locale moyennement fine, dense. Décor dedeux bandes brunes parallèles placé juste au-dessus de la carène. Lissage peu soigné.
94 Le site de ‘Ayn-Manâwir est bien connu à l’époque perse(Ve siècle av. J.-C.) dans l’oasis de Kharga. Dans le corpusdes céramiques non publiées pour le moment, on retrouvedes jarres présentant une même morphologie avec au moinsun ressaut situé au milieu du col et une incision sur lalèvre. Pour une vue d’ensemble du matériel céramiquedaté de la XXVIIe à la XXIXe dynastie, on consulteraS. MARCHAND dans M. Wuttmann et al., «Premier rapportpréliminaire des travaux sur le site de Ayn Manawir (oasisde Kharga)», BIFAO 96, 1996, p. 415-431; S. MARCHAND,«Douch. Ayn Manawir (Oasis de Kharga)», BCE 20, 1997,p. 45-47.
95 Id., BIFAO 96, 1996, p. 428.96 Cette remarque fait référence au matériel daté de l’époque
ptolémaïque (IVe-IIIe siècle av. J.-C.) découvert sur les sites
de Ayn-Manâwîr et de Douch; on consultera S. MARCHAND
«La céramique ptolémaïque» dans M. Wuttmann et al.,«‘Ayn Manâwîr (oasis de Kharga). Deuxième rapport pré-liminaire», BIFAO 98, 1998, p. 437-440 et fig. 59c.
97 Pour le sud de l’Égypte, sur le site d’Éléphantine, on pourrautilement comparer le matériel daté de l’époque saïte pu-blié par D.A. Aston, Pottery from the Late New Kingdomto the Early Ptolemaic Period, Elephantine XIX, Mayence,1999, p. 207, nº 1884. Pour d’autres exemples datés del’époque saïte, accompagnés d’une discussion sur la chro-nologie des céramiques, on se référera à D.A. ASTON,Egyptian Pottery of the Late New Kingdom and ThirdIntermediate Period (Twelfth-Seventh Centuries B.C.),SAGA 13, 1996, p. 41, 203, fig. 101, nº 55 ou p. 206,fig. 104, nº 79.
Compte
C172: jarre ovoïde de grande taille sans col à lèvre en bourrelet rentrante. La forme de la
Compte
C172: jarre ovoïde de grande taille sans col à lèvre en bourrelet rentrante. La forme de lalèvre est intéressante à examiner: elle appartient à un type que l’on peut reconnaître dans la
Compte
lèvre est intéressante à examiner: elle appartient à un type que l’on peut reconnaître dans la
C173: panse de jarre ovoïde de grande taille. Argile locale grossière, lourde. Façonnage
Compte
C173: panse de jarre ovoïde de grande taille. Argile locale grossière, lourde. Façonnage
C169 : jarre munie de deux anses. Argile locale grossière à fort dégraissant végétal en
Compte
C169 : jarre munie de deux anses. Argile locale grossière à fort dégraissant végétal en
Compte
surface. Engobe rouge mat épais. Façonnage peu soigné.
Compte
surface. Engobe rouge mat épais. Façonnage peu soigné.
C171 : bouteille à panse large carénée. Argile locale moyennement fine, dense. Décor de
Compte
C171 : bouteille à panse large carénée. Argile locale moyennement fine, dense. Décor de
deux bandes brunes parallèles placé juste au-dessus de la carène. Lissage peu soigné.
Compte
deux bandes brunes parallèles placé juste au-dessus de la carène. Lissage peu soigné.
Le site de ‘Ayn-Manâwir est bien connu à l’époque perseCompte
Le site de ‘Ayn-Manâwir est bien connu à l’époque perseCompte
siècle av. J.-C.) dans l’oasis de Kharga. Dans le corpusCompte
siècle av. J.-C.) dans l’oasis de Kharga. Dans le corpusdes céramiques non publiées pour le moment, on retrouveCom
pte
des céramiques non publiées pour le moment, on retrouvedes jarres présentant une même morphologie avec au moins
Compte
des jarres présentant une même morphologie avec au moins
rendu
Description de la pâte: argile rouge locale à fortes inclusions minérales et/ou végétales.
rendu
Description de la pâte: argile rouge locale à fortes inclusions minérales et/ou végétales.La taille et la fréquence de ces inclusions déterminent la texture plus ou moins grossière de
renduLa taille et la fréquence de ces inclusions déterminent la texture plus ou moins grossière de
la poterie. La qualité du façonnage est très moyenne; on note le peu de soin dans le lissage,
rendula poterie. La qualité du façonnage est très moyenne; on note le peu de soin dans le lissage,
et la présence des barbules de pâte en surface des pots.
renduet la présence des barbules de pâte en surface des pots.
C172: jarre ovoïde de grande taille sans col à lèvre en bourrelet rentrante. La forme de larendu
C172: jarre ovoïde de grande taille sans col à lèvre en bourrelet rentrante. La forme de la
531
LES CATALOGUES D’OBJETS
FORMES OUVERTES fig. 3
Il existe un fait technologique, un tour de main du potier, que l’on pourrait qualifier demarqueur technique et chronologique 108. On remarque la présence systématique d’un«disque» central, vide de toutes traces de doigts, et l’absence de spire interne qui marquenormalement le travail au tour. De plus, il révèle une concentration anormalement élevée decavités de forme oblongue de grande taille (2 millimètres en moyenne).
Cette marque de fabrique couvre le fond interne des poteries de formes ouvertes,et particulièrement de celles présentant une base annulaire (cf. fig. C166-C165). Le phénomènes’élargit, mais plus rarement, à quelques formes sans base annulaire mais qui possèdent unfond repris par un raclage profond et irrégulier (cf. fig. C168j).
La réponse se situe nécessairement à un stade du façonnage dont les principaux momentspeuvent être reconstitués comme suit: montage de la poterie, temps de séchage, et enfinretournement de la pièce afin de confectionner une base annulaire ou de retravailler le fond.Un mandrin est alors adapté à la taille et à la forme de la pièce. Ensuite le potier place lacéramique à l’envers, en partie sèche, sur le mandrin d’argile posé sur la girelle. Le contactentre le mandrin d’argile et le fond interne de la poterie doit être protégé, afin d’éviterl’adhérence avec le mandrin; pour cela, on utilise soit de la cendre ou encore de la paille.Dans ces conditions, on peut comprendre à la fois la présence de ce «disque» central qui afait disparaître toute trace du travail au tour et des doigts, mais également la concentrationdes cavités, que l’on peut identifier comme les impressions, en négatif, des végétaux déposésau contact du mandrin.
C168: jatte à bord rainuré à fond ovoïde. Argile locale moyennement fine, lourde. Surfaceclaire à rouge diffus, engobée? Raclage profond et irrégulier du fond caréné. Traces de feusous la carène. Fond intérieur à disque central.
C166: bol à base annulaire à lèvre retournée en bourrelet aplati. Argile locale à forteinclusion minérale. Surface claire à rouge diffus, engobe fugitif. Façonnage et lissage peusoignés, raclages externes assez fins marqués. Fond intérieur à disque central. Traces de feuà l’intérieur. Fond intérieur à disque central.
C165: bol à base annulaire à lèvre retournée en bourrelet rond. Argile locale à forteinclusion minérale. Surface claire. Façonnage et lissage peu soignés, raclages externes mar-qués. Fond intérieur à disque central. Croûtes noires à l’intérieur. Fond intérieur à disquecentral.
C164: bol à base annulaire. Argile locale moyennement fine. Surface claire. Façonnageirrégulier. Traces de coulures noires à l’intérieur.
98 Il m’est agréable de remercier Nessim Henein (Ifao) pourson aide dans ces applications techniques. Le même rai-sonnement s’applique au matériel daté de l’époque persedécouvert à ‘Ayn-Manâwir (oasis de Kharga), S. MAR-CHAND, BIFAO 96, 1996, p. 415-431. Il est intéressant de
préciser que cette marque disparaît pour les productionspostérieures à la Basse Époque, comme on a pu claire-ment le remarquer pour le matériel de ‘Ayn-Manâwir quicouvre toutes les périodes de la Basse Époque au Bas-Empire romain inclus.
Compte
ait disparaître toute trace du travail au tour et des doigts, mais également la concentration
Compte
ait disparaître toute trace du travail au tour et des doigts, mais également la concentrationdes cavités, que l’on peut identifier comme les impressions, en négatif, des végétaux déposés
Compte
des cavités, que l’on peut identifier comme les impressions, en négatif, des végétaux déposés
C168: jatte à bord rainuré à fond ovoïde. Argile locale moyennement fine, lourde. Surface
Compte
C168: jatte à bord rainuré à fond ovoïde. Argile locale moyennement fine, lourde. Surface
claire à rouge diffus, engobée? Raclage profond et irrégulier du fond caréné. Traces de feu
Compte
claire à rouge diffus, engobée? Raclage profond et irrégulier du fond caréné. Traces de feusous la carène. Fond intérieur à disque central.
Compte
sous la carène. Fond intérieur à disque central.
C166: bol à base annulaire à lèvre retournée en bourrelet aplati. Argile locale à forte
Compte
C166: bol à base annulaire à lèvre retournée en bourrelet aplati. Argile locale à forte
inclusion minérale. Surface claire à rouge diffus, engobe fugitif. Façonnage et lissage peu
Compte
inclusion minérale. Surface claire à rouge diffus, engobe fugitif. Façonnage et lissage peusoignés, raclages externes assez fins marqués. Fond intérieur à disque central. Traces de feu
Compte
soignés, raclages externes assez fins marqués. Fond intérieur à disque central. Traces de feu
Compte
à l’intérieur. Fond intérieur à disque central.
Compte
à l’intérieur. Fond intérieur à disque central.C165: bol à base annulaire à lèvre retournée en bourrelet rond. Argile locale à forteCom
pte
C165: bol à base annulaire à lèvre retournée en bourrelet rond. Argile locale à forteinclusion minérale. Surface claire. Façonnage et lissage peu soignés, raclages externes mar-Com
pte
inclusion minérale. Surface claire. Façonnage et lissage peu soignés, raclages externes mar-qués. Fond intérieur à disque central. Croûtes noires à l’intérieur. Fond intérieur à disqueCom
pte
qués. Fond intérieur à disque central. Croûtes noires à l’intérieur. Fond intérieur à disque
rendu
La réponse se situe nécessairement à un stade du façonnage dont les principaux moments
rendu
La réponse se situe nécessairement à un stade du façonnage dont les principaux momentspeuvent être reconstitués comme suit: montage de la poterie, temps de séchage, et enfin
rendu
peuvent être reconstitués comme suit: montage de la poterie, temps de séchage, et enfinretournement de la pièce afin de confectionner une base annulaire ou de retravailler le fond.
renduretournement de la pièce afin de confectionner une base annulaire ou de retravailler le fond.
Un mandrin est alors adapté à la taille et à la forme de la pièce. Ensuite le potier place la
renduUn mandrin est alors adapté à la taille et à la forme de la pièce. Ensuite le potier place la
céramique à l’envers, en partie sèche, sur le mandrin d’argile posé sur la girelle. Le contact
renducéramique à l’envers, en partie sèche, sur le mandrin d’argile posé sur la girelle. Le contact
entre le mandrin d’argile et le fond interne de la poterie doit être protégé, afin d’éviter
rendu
entre le mandrin d’argile et le fond interne de la poterie doit être protégé, afin d’éviterl’adhérence avec le mandrin; pour cela, on utilise soit de la cendre ou encore de la paille.ren
dul’adhérence avec le mandrin; pour cela, on utilise soit de la cendre ou encore de la paille.Dans ces conditions, on peut comprendre à la fois la présence de ce «disque» central qui aren
duDans ces conditions, on peut comprendre à la fois la présence de ce «disque» central qui aait disparaître toute trace du travail au tour et des doigts, mais également la concentrationren
duait disparaître toute trace du travail au tour et des doigts, mais également la concentration
des cavités, que l’on peut identifier comme les impressions, en négatif, des végétaux déposésrendu
des cavités, que l’on peut identifier comme les impressions, en négatif, des végétaux déposés
532
BALAT VII
C163: bol à fond plat découpé à la ficelle. Argile locale moyennement fine. Engoberouge. Lissage sans soin. Traces de feu sur les bords.
C162 : lampe-coupelle à fond plat avec la trace de la ficelle. Lèvre pincée aménagée pourrecevoir la mèche. Argile locale moyennement fine. Surface claire. Façonnage moyennementrégulier. Lissage soigné, surface douce. La surface intérieure et le bord extérieur sont totale-ment noirs de fumée.
DATATION DES CÉRAMIQUES DE LA TOMBE 12
L’appartenance de ces céramiques à la Basse Époque est claire. De nombreux indicesmorphologiques et technologiques nous incitent à préciser la chronologie vers la fin de lapériode saïte au VIe siècle av. J.-C.
L’homogénéité de la documentation de la tombe 12 de Balat semble assurée tant parl’archéologie que par les pots eux-mêmes. Il n’est néanmoins pas exclu que l’on ait affaireà deux générations d’inhumation, comme cela a été noté par Georges Castel. Mais l’espacechronologique demeure somme toute restreint.
Cette période reste encore méconnue aussi bien pour l’oasis de Dakhla que pour celle deKharga toute proche. À notre connaissance, les seuls éléments à notre disposition, pour lemoment, sont pour l’oasis de Dakhla les tessons découverts en surface sur le site de Balat 99,mais également la céramique collectée par le Dakhleh Oasis Project étudiée par C. Hope 100.L’oasis de Kharga avec le site de ‘Ayn Manâwir est beaucoup plus riche pour la documenta-tion datée de la Basse-Époque (XXVIIe-XXXe dynasties), mais elle est circonscrite dans lasphère perse et post-perse. Cependant, quelques indices, pour le moment peu nombreux,militent pour la reconnaissance d’une occupation à l’époque saïte 101.
Il faut donc souligner l’importance et la rareté d’un matériel daté de la fin de l’époquesaïte dans cette partie de l’Égypte. En effet, le schéma d’occupation des oasis dans leurensemble, et de celui de Dakhla en particulier, révèle de nombreux hiatus chronologiquesqui s’expliquent essentiellement par la relative jeunesse des recherches archéologiques dansces régions.
Il est nécessaire pour la majorité des céramiques d’établir des parallèles avec le matérielde la vallée du Nil, en attendant un avenir proche où la documentation céramologique datéede la Basse-Époque, issue des oasis, fournira d’elle-même la réponse aux questions d’ordrechronologique et historique que l’archéologue et l’historien se posent.
99 Les céramiques sont encore à l’étude pour le moment; ils’agit des tessons retrouvés essentiellement en surface, ausud du palais de ‘Ayn-Asil. Ils peuvent être datés del’époque saïte et de l’époque perse.
100 C. HOPE, «Pottery Manufacture in the Dakhleh Oasis»,dans C.S. Churcher et A.J. Mills (ed.) Reports from theSurvey of the Dakhleh Oasis Western Desert of Egypt 1977-1987, Oxbow Monographs 99, 1999, p. 229. Les fouillesrécentes du DOP à Mut el-Kharab livrent un important
matériel daté des XXVe et XXVIe dynasties mais égale-ment des périodes postérieures. On consultera, C. HOPE,«The 2001-2002 Excavations at Mut el-Kharab in theDakhleh Oasis, Egypt», The Artefact 26, 2003, p. 51-76,voir également C. HOPE, «A Note on Some Ceramics fromMut, Dakhleh Oasis», CCE 7, 2004, p. 99-122.
101 La prudence s’impose, car le nombre de documentsarchéologiques (céramiques et documents inscrits) restetrès ténu. Il n’en est pas moins vrai qu’ils existent.
Compte
Kharga toute proche. À notre connaissance, les seuls éléments à notre disposition, pour le
Compte
Kharga toute proche. À notre connaissance, les seuls éléments à notre disposition, pour lemoment, sont pour l’oasis de Dakhla les tessons découverts en surface sur le site de Balat
Compte
moment, sont pour l’oasis de Dakhla les tessons découverts en surface sur le site de Balatmais également la céramique collectée par le
Compte
mais également la céramique collectée par le Dakhleh Oasis Project
Compte
Dakhleh Oasis ProjectL’oasis de Kharga avec le site de ‘Ayn Manâwir est beaucoup plus riche pour la documenta-
Compte
L’oasis de Kharga avec le site de ‘Ayn Manâwir est beaucoup plus riche pour la documenta-tion datée de la Basse-Époque (XXVII
Compte
tion datée de la Basse-Époque (XXVIIe
Compte
e-XXX
Compte
-XXXe
Compte
e dynasties), mais elle est circonscrite dans la
Compte
dynasties), mais elle est circonscrite dans la
Compte
sphère perse et post-perse. Cependant, quelques indices, pour le moment peu nombreux,
Compte
sphère perse et post-perse. Cependant, quelques indices, pour le moment peu nombreux,militent pour la reconnaissance d’une occupation à l’époque saïte
Compte
militent pour la reconnaissance d’une occupation à l’époque saïte
Il faut donc souligner l’importance et la rareté d’un matériel daté de la fin de l’époque
Compte
Il faut donc souligner l’importance et la rareté d’un matériel daté de la fin de l’époque
saïte dans cette partie de l’Égypte. En effet, le schéma d’occupation des oasis dans leur
Compte
saïte dans cette partie de l’Égypte. En effet, le schéma d’occupation des oasis dans leurensemble, et de celui de Dakhla en particulier, révèle de nombreux hiatus chronologiques
Compte
ensemble, et de celui de Dakhla en particulier, révèle de nombreux hiatus chronologiquesqui s’expliquent essentiellement par la relative jeunesse des recherches archéologiques dans
Compte
qui s’expliquent essentiellement par la relative jeunesse des recherches archéologiques dansces régions. Com
pte
ces régions.Il est nécessaire pour la majorité des céramiques d’établir des parallèles avec le matérielCom
pte
Il est nécessaire pour la majorité des céramiques d’établir des parallèles avec le matérielCompte
de la vallée du Nil, en attendant un avenir proche où la documentation céramologique datéeCompte
de la vallée du Nil, en attendant un avenir proche où la documentation céramologique datéede la Basse-Époque, issue des oasis, fournira d’elle-même la réponse aux questions d’ordreCom
pte
de la Basse-Époque, issue des oasis, fournira d’elle-même la réponse aux questions d’ordre
rendu
L’appartenance de ces céramiques à la Basse Époque est claire. De nombreux indices
rendu
L’appartenance de ces céramiques à la Basse Époque est claire. De nombreux indicesmorphologiques et technologiques nous incitent à préciser la chronologie vers la fin de la
rendu
morphologiques et technologiques nous incitent à préciser la chronologie vers la fin de la
L’homogénéité de la documentation de la tombe 12 de Balat semble assurée tant par
renduL’homogénéité de la documentation de la tombe 12 de Balat semble assurée tant par
l’archéologie que par les pots eux-mêmes. Il n’est néanmoins pas exclu que l’on ait affaire
rendul’archéologie que par les pots eux-mêmes. Il n’est néanmoins pas exclu que l’on ait affaire
deux générations d’inhumation, comme cela a été noté par Georges Castel. Mais l’espace
rendudeux générations d’inhumation, comme cela a été noté par Georges Castel. Mais l’espace
Cette période reste encore méconnue aussi bien pour l’oasis de Dakhla que pour celle derendu
Cette période reste encore méconnue aussi bien pour l’oasis de Dakhla que pour celle deKharga toute proche. À notre connaissance, les seuls éléments à notre disposition, pour leren
duKharga toute proche. À notre connaissance, les seuls éléments à notre disposition, pour lemoment, sont pour l’oasis de Dakhla les tessons découverts en surface sur le site de Balatren
dumoment, sont pour l’oasis de Dakhla les tessons découverts en surface sur le site de Balat
533
LES CATALOGUES D’OBJETS
C 169-173. Céramique locale engobée rouge ou à surface claire; formes fermées. Éch. 1:4.
C 172 C 173
C 169 C 171C 170
Compte
Compte
Compte
Compte
rend
uren
du
534
BALAT VII
Céramique locale engobée rouge ou à surface claire; formes ouvertes.
C 166C 168
C 164C 165
C 162C 163
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
rend
uren
duren
du
370
BALAT VII
Photo 326. Tombe 12: bracelet de cheville en fer nº 2(PA23).
Photo 327. Tombe 12: bracelets de chevilles en fer nº 76(PA28, a-b).
Photo 328. Tombe 12: terrine en terre cuite nº 61 (C88)fin A.E., réemploi.
Photo 329. Tombe 12: terrine en terre cuite nº 60 (C86)fin A.E., réemploi.
Photo 330. Tombe 12: coupelle en terre cuite (lampe àhuile) nº 90 (C162).
Photo 331. Tombe 12: coupe en terre cuite nº 81 (C163).
Photo 332. Tombe 12: bol en terre cuite nº 86 (C164).
326 327
328 329
330 331
332
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
328 329
Compte
328 329
330 331Compte
330 331Compte
rend
uren
duren
duren
du
371
TOMBES DE LA PÉRIODE 4
333 334
335 336
Photo 333. Tombe 12: bol en terre cuite nº 25 (C165).
Photo 334. Tombe 12: bol en terre cuite nº 29 (C166).
Photo 335. Tombe 12: grande jarre en terre cuite nº 34(C172).
Photo 336. Tombe 12: grande jarre en terre cuite,décolletée, nº 58 (C173).
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
335 336Compte
335 336Compte
rend
uren
duren
duren
duren
duren
duren
duren
du
372
BALAT VII
337 338
339 340
Photo 337. Tombe 12: pot cylindrique en terre cuitenº 66 (C168).
Photo 338. Tombe 12: pot en terre cuite à deux ansesnº 59 (C169).
Photo 339. Tombe 12: bouteille en terre cuite avec décornº 68 (C170).
Photo 340. Tombe 12: flacon en terre cuite nº 87 (C171).
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
rend
uren
duren
duren
du338 ren
du338





















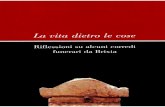




![L'Évangile de Judas, de la tombe au musée. L'épopée rocambolesque du manuscrit damné [2006]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ef3ea0ff042c6110c9cb3/lievangile-de-judasi-de-la-tombe-au-musee-lepopee-rocambolesque.jpg)



