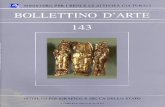Quand texte et image décrivent un même événement. Le cas du jubilé de l’an 30 d’Amenhotep...
Transcript of Quand texte et image décrivent un même événement. Le cas du jubilé de l’an 30 d’Amenhotep...
QUAND TEXTE ET IMAGE DÉCRIVENT UN MÊME ÉVÉNEMENT
LE CAS DU JUBILÉ DE L’AN 30 D’AMENHOTEP III DANS LA TOMBE DE KHÉROUEF (TT 192)
David LORAND
Aspirant du F.N.R.S. Université libre de Bruxelles
L’objectif de cet article est de mettre en lumière – à travers un groupe de scènes appartenant à une tombe thébaine de la 18ème dynastie – les relations qu’entretiennent texte et image dans la structuration du champ iconographique égyptien, et de souligner les points de convergence ou de divergence des deux moyens de communication mis en œuvre. D’un point de vue méthodologique, ma démarche s’inspire des travaux menés par R. Tefnin1 à partir de la fin des années 1970 et, plus récemment, par D. Laboury2 ou V. Angenot3. La tombe thébaine 192 attribuée à Khérouef et, en particulier, les reliefs illustrant une partie des rituels jubilaires du pharaon Amenhotep III sont à cet égard un bon exemple de la complexité des liens tissés entre une représentation « donnée à lire » et une représentation « donnée à voir ». Ce sont avant tout les scènes ayant trait au troisième jubilé du souverain qui ont drainé l’attention des égyptologues – non sans raison puisque l’on y observe une des rares représentations du rituel de « redresser le pilier-djed ». L’optique choisie par les chercheurs est alors principalement chronologique et
1 En particulier R. TEFNIN, Image et histoire. Réflexions sur l’usage documentaire de l’image égyptienne, dans CdE LIV / 108 (1979), pp. 218-244 ; IDEM, Image, écriture, récit. A propos des représentations de la bataille de Qadesh, dans GM 47 (1981), pp. 55-76 ; IDEM, Discours et iconicité dans l’art égyptien, dans GM 79 (1984), pp. 55-69 ; IDEM, Éléments pour une sémiologie de l’image égyptienne, dans CdE LXVI / 131-132 (1991), pp. 60-88. 2 Notamment D. LABOURY, Une relecture de la tombe de Nakht, dans R. TEFNIN, La Peinture égyptienne ancienne. Un monde de signes à préserver, Monumenta Aegyptiaca 7 (Imago n° 1), Bruxelles, 1994, pp. 49-81. 3 Concernant essentiellement les scènes de travail agricole dans les tombes de l’Ancien Empire, mais dont l’approche méthodologique peut être transposable au cas présent. V. ANGENOT, Lire la paroi. Les vectorialités dans l'imagerie des tombes privées de l'Ancien Empire égyptien, dans AHAA XVIII (1996) ; EADEM, La vectorialité de la scène des travaux des champs chez Mérérouka, Étude sur le sens de lecture des parois des mastabas de l'Ancien Empire, dans GM 176 (2000), pp. 5-23 ; EADEM, Discordance entre texte et image, deux exemples de l'Ancien et du Nouvel Empire, dans GM 187 (2002), pp. 11-22.
David LORAND
78
historicisante4. Pour ma part, je m’intéresserai aux rituels effectués lors du premier jubilé du souverain, en l’an 30. Il ne s’agira pas de dégager les éléments qui peuvent servir de jalons à une trame rituelle, ni de proposer un commentaire philologique, encyclopédique ou interprétatif des textes et des scènes, mais de se concentrer sur la composition du champ iconographique et sa structure. J’étudierai donc la disposition des différentes scènes les unes par rapport aux autres, et la manière dont leur description dans le texte égyptien diffère ou – au contraire – s’identifie à la représentation plastique. Khérouef, intendant de la grande épouse royale Tiy, fit aménager une tombe de grande ampleur dans le socle calcaire de l’Assassif, au sud de la voie processionnelle appartenant au complexe funéraire de la reine Hatshepsout. Laissés inachevés peu de temps après l’accession au trône d’Amenhotep IV, les éléments du programme iconographique déjà exécutés firent l’objet d’une première vague de martelage. Celle-ci concerna avant tout les figures et noms du propriétaire de la tombe ainsi que les membres de sa famille. Probablement dues aux zélateurs d’Akhénaton, ces déprédations furent suivies par une seconde phase iconoclaste, après le décès du souverain amarnien, s’attaquant cette fois aux représentations du pharaon « hérétique ». Malgré son inachèvement et ses mutilations, le programme iconographique demeure d’un grand intérêt. D’une part parce qu’il présente des particularités propres à la période de transition entre les règnes d’Amenhotep III et de son fils Amenhotep IV, le futur Akhénaton5. D’autre part parce qu’il illustre une partie des rituels accomplis lors de deux fêtes jubilaires organisées par Khérouef pour Amenhotep III, en l’an 30 et l’an 376. Les deux groupes de scènes figurant les fêtes jubilaires – ou fêtes-sed – du souverain se situent sur la paroi ouest de la cour, sous un portique de piliers quadrangulaires – aujourd’hui ruiné. Le décor est réparti au nord et au sud d’une porte menant vers l’ouest, vers la première salle hypostyle de la tombe.
4 Notamment W. HELCK, Bemerkungen zum Ritual des Dramatischen Ramesseumspapyrus, dans Orientalia 23 (1954), pp. 383-411 ; H. ALTENMÜLLER, Zur Lesung und Deutung des Dramatischen Ramesseumpapyrus, dans JEOL 19 (1965-1966-1967), pp. 421-442 ; C.C. VON SICLEN, The Accession Date of Amenhotep III and the Jubilee, dans JNES 32, n°3 (Juillet 1973), pp. 290-300. 5 Voir P.F. DORMAN, The Long Coregency Revisited : Architectural and Iconographic Conundra in the Tomb of Kheruef, preprint destiné à l’ouvrage en l’honneur de Bill Murnane (P. BRAND et J. VAN DIJK éd.), pour une approche récente de cette problématique (accessible via le site http://oi.uchicago.edu/research/is/). 6 Le lecteur trouvera un large descriptif de l’histoire de la tombe, de son propriétaire et de son décor dans la publication de l’Oriental Institute de Chicago : The Tomb of Kheruef, Theban Tomb 192, OIP 102, Chicago 1980 (ci-après abrégé en Kheruef). Les textes de la tombe 192 ont fait l’objet d’une première publication en 1943 sous la plume de A. FAKHRY, A Note on the Tomb of Kheruef at Thebes, dans ASAE 42 (1943), pp. 449-508, pl. XXXIX-LII.
QUAND TEXTE ET IMAGE DÉCRIVENT UN MÊME ÉVÉNEMENT 79
Les scènes relatives au premier jubilé exécuté en l’an 30 sont disposées sur le pan sud de la paroi ouest, et les scènes du troisième jubilé organisé en l’an 37 se trouvent sur le pan nord de la paroi ouest. Le banc de calcaire local étant de bonne qualité, les artistes purent réaliser le décor à l’aide de la technique du champlevé, décor dont la finesse d’exécution autorise la comparaison avec les reliefs – contemporains – de la tombe du vizir Ramosé (tombe thébaine 55), située plus au sud, au pied de la colline de Cheikh Abd el-Gournah. Originellement polychromes, les reliefs ont subi une intense dégradation, les efflorescences salines ayant partiellement rongé la surface de la paroi – surtout visibles sur le pan sud – ou des fumées les ayant noircis – principalement dans la partie nord7. Une première observation générale de la paroi qui nous intéresse ici, à savoir la paroi sud, permet de distinguer trois ensembles de scènes répartis entre une frise de khekerou au sommet et une bande laissée vierge de tout décor à la base de la paroi8 (fig. 1). Le premier ensemble se situe à l’extrémité nord et est dominé par le dais royal sous lequel se tiennent le roi Amenhotep III, la déesse Hathor – tout deux siégeant sur un trône – et la reine Tiy, debout. La représentation du dais occupe la totalité de la hauteur disponible entre les khekerou et la bande vierge. Devant lui figure un long texte hiéroglyphique disposé en colonnes, de droite à gauche, et décrivant différents rituels du premier jubilé du souverain. Au pied du dais, immédiatement sous le texte descriptif, se trouvent différents hauts personnages de l’État pharaonique et le propriétaire de la tombe, Khérouef, tous largement martelés. Plus loin, vers le sud, mais toujours en relation avec le dais, sont représentées quatre paires de jeunes femmes faisant libation en direction du roi. Elles occupent le registre inférieur de la paroi. Derrière elles, dans un registre subdivisé en deux, figurent – en haut – des danseuses et – en bas – des chanteuses et des musiciennes. Bien qu’occupant la moitié inférieure sud de la paroi, ces deux registres sont à rattacher aux scènes précédentes, comme je le montrerai ci-dessous. Un deuxième ensemble prend place au-dessus des quatre paires de jeunes femmes et illustre la sortie du roi et de son épouse hors de leur palais. Ils sont précédés par 10 personnages répartis en deux registres de cinq. Le troisième ensemble est constitué des scènes liées à la procession nautique du roi et de la reine. Les travaux de la mission épigraphique de l’Oriental Institute de Chicago ont pu rendre une partie de la lisibilité de ce
7 Depuis 2006, une mission de conservation-restauration tente de stabiliser le processus de dégradation des parois et dégage le pan nord des suies qui oblitéraient partiellement la lecture de ses scènes. 8 A. FAKHRY, loc. cit., pl. XL ; Kheruef, pl. 24.
David LORAND
80
groupe de scènes, le plus détruit de la paroi. Occupant la moitié supérieure sud, juste au-dessus des danseuses, l’ensemble est organisé autour de la barque divine portant les deux souverains ainsi que certains dignitaires dont Khérouef. Placée à l’extrémité sud, la barque est surmontée à la poupe et à la proue par un texte descriptif afférant au rituel représenté. Entre la barque et le lieu où se positionne le deuxième ensemble de scènes, la paroi est divisée en deux registres. Le registre supérieur est occupé par des personnages faisant face à la barque processionnelle tandis que le registre inférieur illustre les prêtres et officiels chargés de tracter la barque d’Amenhotep III. Le premier ensemble de scènes : autour du dais royal Le texte principal de ce premier ensemble (fig. 2) est non seulement un descriptif se rapportant aux scènes de ce groupe, mais connaît une portée plus large encore puisqu’il évoque en son sein diverses actions illustrées dans les deuxième et troisième ensembles de scènes. Réparti en onze colonnes, le texte fourni une date9 suivie de la titulature d’Amenhotep III et des rites accomplis, avant de se terminer par la mention des sources écrites utilisées pour l’organisation de la fête-sed. Le texte dit10 :
(1) An 30, le deuxième mois de la saison de Chémou, le 27e jour, sous la Majesté de l’Horus Taureau-puissant-apparaissant-en-vérité, doué de vie (2), le Roi de Haute et Basse Égypte, le Maître du Double Pays, Nebmaâtrê, le fils de Rê qui l’aime, Amenhotep-prince-de-Thèbes, doué de vie, lors de la célébration du premier jubilé de Sa Majesté. (3) Glorieuse apparition du Roi à la Grande Double Porte en son palais de [la Maison] des Réjouissances (pr-ḥ‘y, c’est-à-dire le palais de Malgatta11). Introduction des officiels, (4) des [amis] du roi, du chambellan, des hommes du palais (litt. de la porte), des connus du roi, de l’équipage (5) de la barque, des courtisans et des dignitaires du roi. Des présents ont été faits, consistant en Or de la Récompense, en canards et poissons en or (6) ; ils reçurent des rubans de lin vert, et on les fit tous se tenir selon leur rang. Ils furent nourris (7) du déjeuner du roi (consistant en) pains, bières, bœufs et volailles. On les fit se diriger vers le lac de Sa Majesté pour naviguer dans la barque du roi. Ils saisirent (8) les cordes de halage de la barque du soir et les cordes de la barque du matin et ils tractèrent les barques sur la grande place (st wrt, peut-être le lac de la procession à Birqet-Habou). Ils se tinrent (9) au pied du trône. C’est Sa Majesté qui a accompli cela en accord avec les écrits anciens. (10) Les générations (passées) (litt. de gens) depuis le temps des ancêtres n’ont jamais célébré de tels rites de jubilé. (11) Cela fut décrété pour Celui-qui-apparaît-en-vérité, le fils d’Amon, celui qui jouit du [leg de son père], doué de vie, comme Rê, éternellement.
9 Pour les problèmes de chronologie des différentes phases des jubilés royaux sous Amenhotep III, voir l’article de C.C. VON SICLEN, loc. cit. 10 A. FAKHRY, loc. cit., § 26, pl. XL ; Kheruef, pp. 43-45, pl. 28
David LORAND
82
Outre la date de l’an 30, 2e mois de Chémou, jour 27, correspondant à la célébration du premier jubilé d’Amenhotep III, le texte mentionne plusieurs éléments importants pour mon propos : (1) l’apparition du roi à la Grande Double Porte de son palais de Malgatta, (2) l’introduction auprès du souverain de hauts personnages participant au jubilé, (3) la récompense de ceux-ci (ou d’une partie à tout le moins), (4) un banquet, (5) une procession nautique impliquant la barque du soir et la barque du matin, (6) une étape de la procession est située à proximité du trône. La question des écrits anciens (sšw iswt) mentionnés dans le texte dépasse quant à elle le propos de cet article. Le premier élément retenu pose problème. La glorieuse apparition d’Amenhotep III à la Grande Double Porte en son palais de la Maison des Réjouissances (ḫ‘.t nswt r rwty wrty m pr-ḥ‘y), par sa position initiale dans le descriptif, invite à y voir l’entrée du souverain dans la salle où seront ultérieurement introduits les notables, première étape indispensable dans l’évocation des cérémonies accomplies. Cependant, ce serait ignorer que les Égyptiens ne sont en rien tenus de décrire et représenter la totalité des rituels ayant lieu lors de la fête-sed du roi, et donc toutes les étapes de celle-ci – les scènes de la tombe de Khérouef en sont d’ailleurs un bon exemple. D’autre part, la description s’accorde parfaitement avec la scène d’apparition du souverain représentée au-dessus des quatre paires de jeunes femmes, et appartenant au deuxième ensemble iconographique. On aurait dès lors un chiasme entre l’ordre du texte et l’ordre des représentations (apparition du roi – récompense des notables [texte] vs. récompense des notables – apparition du roi [image]), ce qui ne semble pas être une pratique inhabituelle. La présentation de l’Or de la Récompense, des canards et poissons en or, et des rubans de lin vert est illustrée immédiatement sous le texte descriptif, au pied du dais royal12. Le titre de la scène est : « récompenses du chancelier, du scribe royal, l’intendant [de la grande épouse royale Tiy, Khérouef] … main (?) du roi ». Le martelage de la scène autorise tout juste la reconnaissance des contours des personnages, et n’a laissé intact que la mention des amis du roi (smrw nswt) et des dignitaires du roi (s‘ḥw nswt). Les objets offerts sont en revanche clairement lisibles et correspondent parfaitement à l’énumération du texte. On distingue en effet, posés sur deux tables basses, quatre colliers assimilés à l’ « Or de la Récompense », ainsi que des rubans végétaux (pour signifier le lin ?), des canards et des poissons.
11 Pour l’identification du palais de la Maison des Réjouissances d’Amenhotep III avec le palais de Malgatta, voir l’abondance des mentions sur briques et jarres de ce nom sur le site même de Malgatta. W.C. HAYES, Inscriptions from the Palace of Amenhotep III, dans JNES 10 (1951), pp. 84, 163-164 et 177-178. 12 A. FAKHRY, loc. cit., § 26, pl. XL et La ; Kheruef, p. 45, pl. 30.
QUAND TEXTE ET IMAGE DÉCRIVENT UN MÊME ÉVÉNEMENT 83
Le repas, pourtant décrit à la suite dans le texte principal, est oblitéré dans les reliefs, tandis que deux groupes de scènes, occupant près du tiers de la surface de la paroi, sont représentés sans être mentionnés dans le descriptif. Il s’agit des quatre paires de jeunes femmes faisant libation et des deux registres de danseuses, chanteuses et musiciennes. Les quatre paires des jeunes femmes, toutes vêtues d’une longue robe s’évasant à la base, sont placées derrière la scène de récompense des nobles – c’est-à-dire immédiatement au sud de celle-ci13. Une colonne de texte devant le groupe puis une ligne le surmontant décrivent l’action de ces huit personnages : « Introduction des enfants des Grands [qui sont venues portant] des vases-nmst en or et des aiguières en électrum dans leurs mains en vue d’accomplir les rituels jubilaires » et « Pures sont tes vases-nmst en or et tes aiguières en électrum. La fille du Mentiou, elle te donne de l’eau fraîche. Ô souverain, V.S.F., tu vivras grâce à cela ». Au-dessus d’elles, mais au sein du champ iconographique et réparti entre leurs coiffes, est noté l’emplacement occupé par les huit jeunes femmes lors de la libation offerte à Amenhotep III : « Faire en sorte qu’elles se tiennent au pied du trône, en face du dais, en présence du roi ». L’image donnée de la libation par le texte correspond à celle illustrée par le relief ; on y retrouve les deux types de vases, placés dans leurs mains ou sur de petites tables basses. Par ailleurs, elles figurent – presque – au pied du trône, elles se tiennent face au dais et sont bel et bien en présence du roi à en croire le face-à-face créé sur la paroi. Plus au sud et disposés en deux registres, sont représentés deux groupes de femmes14. Au registre supérieur, il s’agit de danseuses, adoptant des postures d’un grand dynamisme et scandant un chant d’exaltation à un personnage non explicitement mentionné. Dans le registre inférieur, chanteuses et musiciennes entonnent une longue prière à la déesse Hathor afin que cette dernière veille à la régénération des forces du souverain au cours de sa fête-sed. Une colonne de texte unit les deux registres à leur extrémité nord, juste dans le dos de la dernière paire de jeunes femmes. Le texte définit le rapport de proximité entre le dais royal et les chanteuses, danseuses et musiciennes : « Introduction des femmes en présence du roi en vue d’accomplir les rituels jubilaires en face du dais ». D’autres textes, plus courts, accompagnent l’un ou l’autre groupe de chanteuses, rendant compte de leur enthousiasme à accomplir les cérémonies auxquelles elles prennent part. Le texte associé au premier groupe nord du registre inférieur – deux paires de femmes affrontées – se distingue des autres
13 A. FAKHRY, loc. cit., § 29, pl. XL et LI ; Kheruef, pp. 45-46, pl. 32. 14 A. FAKHRY, loc. cit., § 30, pl. XL, Lb et LII ; Kheruef, pp. 46-49, pl. 34-36-38-40. Pour cette scène en particulier et ses parallèles, voir le commentaire développé par E.F. WENTE, Hathor at the Jubilee, dans Studies in Honor of John A. Wilson, SAOC 35, Chicago, 1969, pp. 83-91.
David LORAND
84
puisqu’il ne présente pas de liens avec la performance musicale des femmes : « Ouvertes sont les Doubles Portes de sorte que le dieu puisse sortir pur ».
Au terme de cette rapide présentation des scènes appartenant à ce premier ensemble thématique de rites effectués autour du dais royal, plusieurs conclusions s’imposent. Tout d’abord, ce premier ensemble est celui qui doit être le premier abordé dans une lecture de la paroi, que ce soit du texte – y figure en effet le descriptif principal des scènes de la paroi et la date la plus ancienne – ou des représentations figurées – puisque le dais royal occupe une place de choix, et ce sur toute la hauteur du champ iconographique. Ensuite, le texte descriptif principal de la paroi semble n’évoquer qu’une partie des rituels jubilaires exécutés en l’an 30, indiquant un processus de sélection dans le chef du (ou des) compositeur(s) du programme iconographique de la tombe15. On ne constate en outre qu’une coïncidence partielle entre ce que décrit le texte et ce qu’illustre l’image : non représentation du repas des notables, ainsi qu’absence de mention des scènes de danse et de chant par exemple. Cependant, malgré ces divergences ponctuelles entre le texte et l’image, un phénomène de convergence fait office de contrepoint dans la présentation littéraire et graphique des différents personnages autour du dais royal. D’un point de vue graphique – pour cet ensemble de scènes –, plus on s’éloigne du dais où se tiennent le couple royal et la déesse Hathor, plus on va vers l’extrémité sud de la paroi, plus la taille des personnages se réduit et plus les registres diminuent de taille et se subdivisent. Je pense pouvoir interpréter ce jeu comme une volonté de rendre manifeste sur un espace bidimensionnel (la paroi) la relation spatiale des différents intervenants lors des cérémonies jubilaires réelles (éloignement ou proximité des acteurs par rapport à la personne du roi et à son dais). Schématiquement, on aurait ceci :
Sud
Autres scènes Texte
descriptif Dais royal avec Amenhotep III, la déesse Hathor
et Tiy
Nord Récompense des
nobles Danseuses Paires de
jeunes femmes Chanteuses et musiciennes
15 La question de la composition du programme décoratif se pose dès lors, mais la réponse à y apporter dépasserait les limites fixées pour mon propos. Il apparaît néanmoins probable que les deux pans nord et sud de la paroi ouest, ceux qui illustrent les fêtes-sed de l’an 30 et de l’an 37, ont été conçus ensemble afin de répartir, selon une logique qui reste à déterminer, les différentes scènes jugées pertinentes – puisque représentées – dans le cadre d’un programme décoratif plus ample (celui de la tombe toute entière).
QUAND TEXTE ET IMAGE DÉCRIVENT UN MÊME ÉVÉNEMENT 85
Ce jeu graphique se double d’un jeu littéraire puisque cet éloignement progressif des personnages est également rendu par les descriptifs propres à chacune des scènes de cet ensemble. Les différents notables récompensés par le souverain sont placés au pied du dais royal, et l’on peut raisonnablement penser à une grande proximité de ces dignitaires et du roi si l’on se base sur leurs titres (amis du roi et dignitaires du roi) et sur la mention – en lacune – de la « main (?) du roi ». Un peu plus loin sur la paroi, les quatre paires de jeunes femmes sont présentées comme « se tenant au pied du trône, en face du dais, en présence du roi », tandis que les deux registres de danseuses, chanteuses et musiciennes sont simplement « en présence du roi en vue d’accomplir les rituels jubilaires en face du dais » et non « au pied du trône ». Soit une évolution de la proximité textuelle qui peut être rendue comme suit :
Le dais royal
> Les nobles Proximité supposée
> Les jeunes femmes Au pied du trône, En face du dais, En présence du roi.
> Les danseuses, chanteuses et musiciennes En face du dais, En présence du roi.
En outre, si l’on constate une forte structuration de ces scènes par le biais d’un jeu graphique et littéraire, il faut aussi souligner l’ouverture de cet ensemble vers les autres représentations, tant au sein de la paroi sud que vers le pan nord illustrant les cérémonies du troisième jubilé de l’an 37 d’Amenhotep III. Ainsi, le texte principal fait non seulement référence à des éléments de ce premier ensemble, mais également à la sortie du couple royal : « Glorieuse apparition du Roi à la Grande Double Porte en son palais de [la Maison] des Réjouissances », et à la procession nautique : « On les fit se diriger vers le lac de Sa Majesté pour naviguer dans la barque du roi. Ils saisirent les cordes de halage de la barque du soir et les cordes de la barque du matin et ils tractèrent les barques sur la grande place », respectivement deuxième et troisième ensembles de scènes de cette paroi sud. De même, le texte accompagnant quatre chanteuses du registre inférieur, à savoir « Ouvertes sont les Doubles Portes de sorte que le dieu puisse sortir pur », est certainement une référence à l’apparition d’Amenhotep III et Tiy à la porte de leur palais de Malgatta, illustrée par le deuxième ensemble de scènes. Les appels vers la paroi nord sont plus discrets et se retrouvent dans les deux montants inscrits du dais royal, et en particulier dans les épithètes d’Amenhotep III. Sur le montant gauche (sud), le roi est « dieu parfait, célébrant les jubilés comme son père Horus-Tanen » et « aimé de Ptah le Grand, qui-est-au-sud-de-son-mur », tandis que sur le montant droit (nord), il est « aimé de Celui-qui-se-lève-intact, qui réside dans la Demeure de Sokar ». Ces trois épithètes peuvent être mises en relation avec la thématique
David LORAND
86
développée dans la paroi nord, qui a trait à l’érection du pilier-djed et à son culte dans la Demeure de Sokar auquel il est assimilé (à Ptah-Sokar plus précisément). Par ailleurs, le roi y est aussi présenté comme le fils d’Horus-Tanen lors de ce rituel. Le deuxième ensemble de scènes : l’apparition du couple royal Le deuxième ensemble (fig. 3) n’est, en réalité, constitué que d’une seule scène illustrant l’apparition d’Amenhotep III en vêtement de jubilé et de Tiy16. L’édifice dont ils émergent est réduit à sa plus simple expression graphique : deux vantaux de porte délimités par une frise de khekerou. Le nom du palais est mentionné au sommet de la porte. Il s’agit du « palais de la Maison des Réjouissances », c’est-à-dire Malgatta. Le couple royal est précédé d’une dizaine de personnages répartis en deux registres. Dans le registre supérieur figurent trois porte-enseignes vêtus d’une peau de félin (enseignes d’Oupouaout de Haute Égypte, d’Oupouaout de Basse Égypte et du Tekhenou du roi), un prêtre et le ritualiste en chef. Dans le registre inférieur sont représentés deux porte-enseignes (enseignes d’un Ibis et d’un Faucon), suivis par trois personnages sensiblement plus grands, un porteur d’insigne et deux prêtres. Cet ensemble se caractérise par l’absence de référence temporelle explicite (pas de date ou d’ancrage temporel d’un autre genre). La scène apparaît avant tout comme une phase de transition entre deux ensembles, celui des rituels exécutés en présence du roi sous son dais (à l’intérieur du palais de Malgatta), et celui lié à la procession nautique du roi (probablement sur le lac de Birqet Habou). On remarquera néanmoins la cohérence graphique dans le positionnement des portes et de la procession ; c’est bien adossées au dais royal (compte non tenu du texte descriptif) que sont figurées les portes, permettant de rendre compte d’une sortie du roi à partir de l’intérieur de son palais. Le troisième ensemble de scènes : la procession nautique du couple royal Au sein de ce troisième ensemble de scènes (fig. 4), la figure du couple royal, debout dans la barque processionnelle, fixe l’attention et induit une première perception de ce groupe à partir de leur endroit et des textes descriptifs qui y figurent, tant au-dessus de la proue qu’au-dessus de la poupe de l’embarcation. Signalons d’emblée que cette focalisation ne correspond pas à la logique « narrative » proposée par la disposition des scènes au sein de cet
16 A. FAKHRY, loc. cit., § 27, pl. XL ; Kheruef, pp. 49-51, pl. 42-44.
QUAND TEXTE ET IMAGE DÉCRIVENT UN MÊME ÉVÉNEMENT 87
ensemble, puisque plutôt que d’y voir la scène initiale, il faudrait plus volontiers en faire une deuxième étape dans un parcours chronologique de cette section de la paroi. Amenhotep III est figuré en vêtements de jubilé, suivi de son épouse, et accompagné de divers dignitaires de la cour, dont Khérouef, placé à l’avant de l’embarcation. La barque, comme ses occupants, est dirigée vers la droite de la paroi, c’est-à-dire qu’elle regarde vers le nord, vers l’emplacement du dais royal appartenant au premier ensemble de scènes17. Un premier texte descriptif est disposé en huit colonnes au-dessus de la proue du navire. Son contenu consiste en une date, différente de celle fournie dans le texte principal de la paroi, une titulature du souverain et, enfin, un bref descriptif de l’action :
(1) An 30, troisième mois de la saison de Chémou, jour […], sous [Sa Majesté l’Horus] Taureau-puissant-apparaissant-en-vérité, [doué] de vie, (2) les Deux Maîtresses, Qui a établi les lois et pacifié le Double Pays, [l’Horus d’Or, puissant] de bras, Qui a battu les Asiatiques, (3) le Roi de Haute et Basse Égypte, le Maître du Double Pays, Nebmaâtrê, le fils de Rê, Amen[hotep-prince-de-Thèbes], … (4) puissant … le fils d’Amon, pour occuper le dais de celui qui l’engendra (5) lors du jubilé qu’il célébra à l’Ouest de Nê. Début du voyage par (6) [Sa Majesté au moment] du haut Nil en vue de transporter les dieux du jubilé sur l’eau (7) …, aimé d’Amon. Faire la procession nautique [de] ceux de Pé (8) … la barque du soir et la barque du matin….
Plusieurs éléments doivent être soulignés. D’une part la date est postérieure de quelques jours par rapport à la date indiquée dans le texte principal. D’autre part, malheureusement en lacune et donc d’interprétation délicate, il est question de l’occupation d’un dais – divin – par Amenhotep III (colonnes 4 et 5). Enfin, le texte fait référence au début du voyage en barque, et aux deux barques utilisées à cette occasion, celle du soir (mskt.t) et celle du matin (m‘nḏ.t).
Le second texte descriptif de ce groupe est placé au-dessus de la poupe de l’embarcation et occupe cinq colonnes. Le texte dit :
(1) [A l’a]ube, les tracter et [faire] en sorte qu’ils se dirigent vers [leurs] (2) stations. Exécuter pour eux « L’Ouverture de la Bouche » et sacrifier … (3) … du bétail à longues et courtes cornes, un millier de… [pour] (4) … [à qui Amon-Rê], Maître des Trônes du Double Pays, et tous les dieux [décrètent] (5) de très nombreux jubilés, doué de vie comme Rê, éternellement.
Si l’on peut aisément intégrer la « traction de la barque » dans la représentation du couple royal installé dans le navire processionnel, force est de constater que le rituel d’Ouverture de la Bouche et le sacrifice du bétail ne
17 A. FAKHRY, loc. cit., § 28, pl. XL ; Kheruef, pp. 53-54, pl. 46.
David LORAND
88
sont pas illustrés sur la paroi, proposant un nouveau cas de divergence entre la représentation « donnée à lire » et la représentation « donnée à voir ». Directement associés à la procession rituelle, puisque tractant la barque du soir, dix paires de haleurs – très largement martelés – figurent à l’avant de la proue18. Visuellement, ils se dirigent à la rencontre des porte-enseignes précédant le roi lors de sa sortie du palais. La ligne de texte qui les surmonte – martelée au même titre que les figures des haleurs – rend compte de leur action : « Les compagnons du Palais, V.S.F., les officiels et les grands de … [A]mon, lorsqu’ils tirent le roi dans la barque du soir … ».
Au registre supérieur se tiennent différents personnages féminins, dont les filles du roi réparties en quatre paires et jouant du sistre, ainsi que les chanteuses d’Amon Rouiou et Hénoutnofret, probablement mère et sœur de Khérouef. Toutes se dirigent vers la gauche de la paroi, c’est-à-dire vers le sud, à la rencontre des occupants de la barque processionnelle. Les différents textes en colonnes situés devant les personnages les identifient et définissent les actions rituelles qu’ils accomplissent auprès du roi. Un texte de plus grande ampleur se place entre la dernière des quatre paires de princesses et les chanteuses d’Amon. Couvrant sept colonnes, le texte énumère les femmes prenant part à la suite royale et décrit leurs performances ainsi que le moment de celles-ci19 :
(1) La principale [des concubines d’]Amon-Rê et les chanteuses … [quand] (2) elles … le Dieu Parfait dans les rites de jubilé de Sa Majesté. La mélodie (3) de la musique qu’elles entonnent : Musique … (4) les maîtres du jubilé. Gardant le rythme … (5) … Le Roi de Haute et [Basse] Égypte, le Maître du Double Pays, Nebmaâtrê, doué de vie, quand il prend sa place dans la ba[rque] (6) … Maître de [l’Univers], … (7) … l’horizon … comme Rê, éternellement à jamais.
Une longue ligne de texte surmontant la totalité des personnages féminins transcrit le chant du clergé d’Amon, encourageant le roi Amenhotep III lorsqu’il se saisit des cordes de halage des barques du soir et du matin, puis quand il participe au transport des dieux du jubilé sur les flots du lac.
Au terme de cette rapide présentation de ce troisième groupe de scènes liées à la procession de la barque jubilaire, plusieurs conclusions s’imposent. La première concerne l’ordre de lecture induit par la seule approche visuelle de ce groupe. L’attention est d’emblée attirée sur le couple royal se tenant dans la barque du soir, figuration occupant la totalité du registre en hauteur, et près de la moitié de l’espace consacré à cet ensemble de scènes. Le roi, depuis 18 A. FAKHRY, loc. cit., § 28, pl. XL ; Kheruef, pp. 51-53, pl. 44-45. 19 A. FAKHRY, loc. cit., § 28, pl. XL ; Kheruef, pp. 51-53, pl. 44-45.
QUAND TEXTE ET IMAGE DÉCRIVENT UN MÊME ÉVÉNEMENT 89
l’extrémité sud du champ iconographique, regarde vers le nord, soit vers la représentation de son dais situé à l’extrémité nord de la paroi. C’est également autour de la personne du roi que figurent les deux parties du texte descriptif de ce groupe, fixant la date de cette procession et définissant les rituels exécutés à cette occasion. Ce n’est qu’ensuite que l’on passe aux deux sous-registres, celui des haleurs de la barque et celui des princesses et des chanteuses d’Amon. Cet ordre de « lecture » des scènes – le couple royal dans sa barque puis les deux sous registres de processionnaires – ne correspond pas au mode de lecture plus « chronologique » que l’on peut faire de ces scènes. En effet, dans une perspective plus « narrative » c’est par le groupe de personnages féminins qu’il convient d’entamer la lecture. Non seulement ceux-ci constituent la continuation iconographique de la scène d’apparition du couple royal à la Grande Double Porte du palais de la Maison des Réjouissances, mais, en plus, les textes descriptifs qui leur sont liés indiquent que c’est bien à leur endroit qu’il faut placer les premiers moments de la procession nautique. Il y est question du souverain « quand il prend sa place dans la barque », de même qu’il y est encouragé à se saisir des cordes de halage des deux barques rituelles, action qui ne peut intervenir qu’au début de la procession. Ce n’est qu’après cela que la trame « narrative » aborde la représentation d’Amenhotep III et de Tiy, en évoquant le début du voyage – dans la barque du soir – puis les rituels d’Ouverture de la Bouche ayant lieu à l’aube. La lecture s’achève avec le groupe de haleurs, placé en toute logique à l’avant du bateau comme l’exige leur fonction, se dirigeant – visuellement – vers le dais royal. Cette disposition n’est sans doute pas le fruit du hasard puisqu’on se rappellera que le texte descriptif principal de la paroi indique que « [les haleurs] se tinrent au pied du trône ».
Pour rendre plus perceptible cette double lecture possible de ce groupe de scène, on pourrait la schématiser comme suit :
Lecture hiérarchique
Le couple royal dans la barque du soir Le texte descriptif des rituels accomplis lors de la procession nautique
> Le groupe des haleurs de barques Le groupe des princesses et des chanteuses d'Amon
Lecture narrative
Sortie du palais >
Le groupe des princesses et des chanteuses d'Amon "Quand il (le roi) prend sa place dans la barque"
> Le couple royal dans la barque du soir "Début du voyage par Sa Majesté"
> Le groupe des haleurs de barques
> Se tenir au pied du trône
David LORAND
90
Conclusions Au regard des quelques remarques formulées ci-dessus, force est de constater la grande structuration et organisation du décor illustrant une partie des scènes jubilaires de la première fête-sed d’Amenhotep III en l’an 30. On conclut en effet à une profonde réflexion dans le chef du (ou des) compositeur(s) de ce programme iconographique tant le texte et l’image s’interpénètrent afin de donner une cohérence unitaire à des rites exécutés en des lieux et à des moments différents. Cette cohérence se manifeste – pour les scènes ayant trait aux réjouissances près du dais royal, au sein du palais de Malgatta – par le positionnement des différents intervenants sur la paroi et leur taille. Plus on s’éloigne du roi, plus les personnages diminuent de taille, plus les registres iconographiques se réduisent voire se subdivisent. Cet éloignement graphique s’adjoint d’un descriptif textuel qui rend également compte de cette perte de proximité des acteurs vis-à-vis du souverain. De même, c’est cet aspect unitaire de la composition qui est – à mon sens – à l’origine de la place laissée à la scène d’apparition d’Amenhotep III et de Tiy, permettant de rendre compte de la sortie du souverain hors de son palais. Enfin, malgré une divergence entre la lecture « hiérarchique » (via l’image) et la lecture « narrative » (via le texte), la procession nautique se branche directement sur la sortie du roi, par l’intermédiaire de l’orientation des princesses et des chanteuses. La procession opère ensuite un « retournement » à l’extrémité sud de la paroi pour pouvoir, visuellement, se diriger vers le trône, but de la procession tel que le mentionne le texte descriptif principal. Enfin, si l’on tente de définir les rapports que texte et image entretiennent dans la composition, on ne peut que conclure à l’absence de primauté de l’un ou de l’autre, absolue ou non. Ainsi, le texte n’est pas un simple descriptif identificatoire des représentations iconographiques, de même que l’image n’est pas une simple illustration des propos du texte. En suivant l’expression de P. Vernus, texte et image fonctionnent ici en osmose20. Texte et image sont en effet à la fois supplémentaires puisque l’un et l’autre expriment les mêmes données relatives aux rituels jubilaires, et complémentaires puisque parfois ils évoquent chacun des éléments que l’autre n’exprime pas. NB : Le choix de présenter le relevé de la paroi sud exécuté par A. Stoppeläere et M. Rif’at Nasr et publié par A. Fakhry dans les Annales du Services des Antiquités égyptiennes (ASAE 42 [1943], pl. XL) plutôt que celui réalisé par la mission épigraphique de l’Oriental Institute de Chicago tient en un seul argument : sa lisibilité à petite échelle. Malgré les quelques erreurs épigraphiques – notamment dans les paires de princesses de la procession nautique – le relevé des Annales s’imposait naturellement eu égard aux contraintes posées par le format de la présente publication.
20 P. VERNUS, Des relations entre texte et représentation dans l’Égypte Pharaonique, dans A.-M. CHRISTIN (éd.), Ecritures II, Paris, 1985, pp. 45-66, part. 61-66.
QUAND TEXTE ET IMAGE DÉCRIVENT UN MÊME ÉVÉNEMENT 91
Fig.
1. R
elev
é de
s scè
nes i
llust
rant
une
par
tie d
es ri
tuel
s exé
cuté
s lor
s du
prem
ier j
ubilé
d’A
men
hote
p II
I en
l’an
30.
Tom
be d
e K
héro
uef -
TT
192.
D
’apr
ès A
. FA
KH
RY
, A N
ote
on th
e To
mb
of K
heru
ef a
t The
bes,
dans
ASA
E 42
(194
3), p
l. X
L A
ssem
blag
e nu
mér
ique
: A
. STO
LL
David LORAND
92
Fig. 2. Localisation des scènes se rapportant au roi sous son dais
Fig. 3. Localisation des scènes se rapportant à l’apparition d’Amenhotep III à la Double Porte de son palais de la Maison des Réjouissances
Fig. 4. Localisation des scènes se rapportant à la procession nautique et sens de lecture proposé