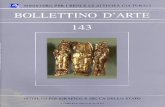Neuromárketing: La diada de la emoción y la razón en la toma de ...
La tombe d'Arégonde.
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of La tombe d'Arégonde.
Résumé : Ayant repris en 1957 les fouilles d’Edouard Salin dans le sous-sol de la basilique de Saint-Denis, Michel Fleury mit au jour en 1959 un sarcophage (N° 49) contenant une inhumation féminine exception-nelle par la qualité de son mobilier funéraire et la conservation des restes organiques correspondant à ses vêtements. Grâce à une bague en or portant le nom ARNEGVNDIS et un monogramme central lu comme REGINE, la défunte fut identifiée à la reine Arégonde, mentionnée par Grégoire de Tours comme l’une des épouses de Clotaire Ier (511-561) et la mère de Chilpéric Ier. Compte tenu de la date de naissance de ce dernier, placée en 539 (en réalité en 534), et d’une esti-mation anthropologique vers 45 ans de l’âge de décès de la défunte, sa mort fut fixée vers 565/570. Cette data-tion ne s’accordant pas à celle du mobilier funéraire, sensiblement plus récent, plusieurs chercheurs doutèrent que la défunte ait bien été le personnage historique cité par Grégoire de Tours. La redécouverte récente du sque-lette de la défunte de la tombe 49 ainsi que des restes organiques végétaux et animaux qui l’accompagnaient, disparus depuis une trentaine d’années, a permis de
La tombe d’Arégonde. Nouvelles analyses en laboratoire du mobilier métallique et des restes organiques de la défunte du sarcophage 49 de la basilique de Saint-DenisPatRick PERiN* et thomas caLLiGaRo** avec la collaboration de L. BUchEt, J.-J. cassimaN, Y. DaRtoN, V. GaLLiEN, J.-P. PoiRot, a. Rast-EichER, c. RUckER et F. VaLLEt****** Musée d’Archéologie nationale (Saint-Germain-en-Laye).*** Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (Paris).*** L. BUCHET (CNRS-UNSA, Sophia Antipolis), Prof. J.-J. CASSIMAN (Center Human Genetics de l’Université de Louvain), Dr Y. DARTON (CNRS-
CEPAM, Sophia Antipolis), V. GALLIEN (INRAP), J.-P. POIROT (Gemmologue), A. RAST-EICHER (Archéo Tex, Ennenda, Suisse), Dr C. RUCKER (CNRS-CEPAM, Sophia Antipolis), F. VALLET (MAN). Les auteurs tiennent également à remercier très vivement Alain DIERKENS, René LEGOUX, Max MARTIN pour leur avis précieux, ainsi que le Dr Uta von FREEDEN, pour son aimable documentation et le Pr Bailey Young.
rouvrir ce dossier. Ainsi, il est désormais acquis que la défunte, âgée de 61 ans (plus ou moins trois ans) est morte vers 580, ce qui correspond mieux à la datation archéologique du mobilier funéraire et donc à l’identi-fication historique de la défunte. Pour sa part, le réexa-men des restes organiques met largement en cause la reconstitution du costume d’Arégonde par Michel Fleury et Albert France-Lanord. Enfin, les analyses menées au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) sur les objets métalliques en or et en argent de la tombe d’Arégonde, ainsi que sur les grenats pouvant les orner, ont considérablement modifié les acquis antérieurs, qu’il s’agisse des alliages utilisés ou de la provenance des grenats.
Abstract: Michel Fleury, who reopened in 1957 Edouard Salin’s excavations underneath the basilica of Saint-Denis, in 1959 came upon a sarcophagus (#49) containing a remarkable burial, both by the exceptional quality of the feminine grave-goods it contained, and by the conservation of organic materials deriving from her costume. Thanks to a gold ring bearing the name ARNEGVNDIS and a central monogram deciphered as
antiquités nationales
2005, tome 37 : pages 181 à 206
étUD
Es E
t RE
chER
chEs
À Martin Heinzelmann à l’occasion de son 65e anniversaire
182 ANTIQUITÉS NATIONALES, 37, 2005 : 181-206.
reading REGINE, the woman was identified as Queen Aregonde, mentioned by Gregory of Tours as one of the wives of Clotaire I (511-561), and the mother of Chilperic. Considering that the latter had been born in 539 (the true date is now believed to have been 534) and arguing from an anthropological estimate that the lady died at about the age of 45, the burial was dated to the years 565/570. Since this date did not fit with the chronology of the funerary ensemble, which appeared rather later, some scholars expressed doubts that the woman buried there was the queen mentioned by Gregory. The recent re-discovery of the skeletal remains of sarcophagus #49, along with the vegetal and animal vestiges in the grave (their location was lost for thirty years) has allowed us to re-open these questions. It now appears that the subject was around 61 (plus or minus three years) when she died about the year 580, a date that fits better with the artefacts and thus strengthens the case for identifying her with the historical queen. A re-examination of the organic remains, however, chal-lenges the reconstruction of her costume advanced by Michel Fleury and Albert France-Lanord. Finally, metallurgical analyses of the gold and silver artefacts in this grave by the Center for Research and Restoration of the Museums of France, and also of the garnets thought to belong to their decoration, have considerably modified earlier conclusions, regarding both the alloys used and the origin of the garnets.
RaPPEL histoRioGRaPhiqUE
C’est en mars 1957 que les fouilles de la basilique de Saint-Denis, menées jusqu’alors par Édouard Salin (en novembre 1953, de mars à juin 1954, puis en janvier-
février 1957)1, furent confiées à Michel Fleury en tant que correspondant de la Direction des Antiquités histo-riques de la Région parisienne2 (Fig. 1). Au bout de cinq ans les recherches de terrain, effectuées de façon dis-continues, furent interrompues en raison de la construc-tion d’une crypte archéologique destinée à protéger les vestiges mis au jour (édifices antérieurs à l’actuelle basi-lique et sépultures, mérovingiennes pour la plupart). Les fouilles ne purent reprendre qu’en 1973, pour être peu après interrompues à nouveau, à la suite d’une fouille clandestine perpétrée durant les fêtes de fin d’année. C’est seulement en 1976 que les recherches purent à nouveau avoir lieu, pour cesser définitivement en 1980, le Ministère de la Culture ayant alors décidé de faire du sous-sol de la basilique de Saint-Denis une réserve archéologique. De fait, il importait, avant de poursuivre de telles fouilles, de définir de nouveaux protocoles d’investigation pour des sarcophages qui, toujours pré-servés des eaux d’infiltration puisqu’ils avaient été enfouis dès l’origine dans le sous-sol d’un lieu de culte, renfermaient pour la plupart des restes organiques exceptionnellement conservés mais particulièrement difficiles à fouiller ou à prélever pour une fouille en laboratoire3.
Découvert en 1959, le sarcophage de pierre n° 49, inviolé, fut immédiatement identifié par Michel Fleury comme celui de la reine Arégonde, épouse de Clotaire Ier (511-561) et mère de Chilpéric Ier (né vers 535 et roi de 561 à 584), mentionnée par Grégoire de Tours dans ses Dix livres d’histoire4 (Fig. 2). En effet, parmi de nom-breux restes de vêtements et à côté d’objets de parure et d’accessoires vestimentaires métalliques d’une grande richesse figurait une bague en or sur le chaton de laquelle était gravé le nom ARNEGUNDIS, développé autour d’un monogramme central lu comme le qualificatif REGINE5 (Fig. 3). Bien que la lecture de ce mono-gramme ait fait l’objet de réserves de la part de certains
Fig. 1 : Les vestiges archéologiques antérieurs à l’actuelle basilique de Saint-Denis (fouilles de Édouard Salin, Michel Fleury et Albert France-Lanord, et Sumner McKnight Crosby) : A, mausolée primitif (IVe siècle) ; B, premier agrandissement par sainte Geneviève (fin du Ve siècle) ; C, second agrandissement par Dagobert (deuxième quart du VIIe siècle ; D, la reconstruc-tion de Fulrad (775). Document J. Prim et M. Wyss, Unité d’Archéologie de Saint-Denis. PERIN et WYSS 2004, p. 21.
La tombe d’Arégonde. Nouvelles analyses en laboratoire de la défunte du sarcophage 49 de la basilique de Saint-Denis 183
chercheurs6, l’identification de la défunte du sarcophage 49 avec la reine AREGUNDIS mentionnée par Grégoire de Tours fut largement acceptée par la communauté scientifique, de même que la datation de la sépulture vers 565-570 (voir ci-dessous)7. Plusieurs auteurs, néan-moins, attribuant au mobilier funéraire une datation archéologique plus récente, contestèrent pour leur part le fait que la défunte ait pu être le personnage historique cité par l’évêque de Tours8.
Dès 1961, la tombe d’Arégonde bénéficia d’une publication très complète dans la revue Art de France9, reprise en allemand dans la revue Germania en 196210. Des informations complémentaires, concernant notam-ment les travaux de laboratoire menés sur certains objets métalliques ainsi que sur les restes organiques, furent publiées en 1979 dans les Dossiers de l’archéologie11. En 1998 enfin, toutes les données concernant la tombe d’Arégonde, de même que les autres sépultures de la basilique de Saint-Denis, ont été rassemblées dans le
Fig. 2 : a) Le sous-sol de la basilique de Saint-Denis avant la construction de la crypte archéolo-gique. b) Vue du sarcophage d’Arégonde (n° 49) à l’issue de son ouverture, en 1959 (au milieu, avec couvercle relevé). Cliché Commission du Vieux-Paris.
Fig. 3 : La bague d’Arégonde : inscription ARNEGVNDIS et monogramme lu comme REGINE par Michel Fleury. D’après FLEURY et FRANCE-LANORD 1998, p. 210.
184 ANTIQUITÉS NATIONALES, 37, 2005 : 181-206.
monumental et luxueux ouvrage de Michel Fleury et Albert France-Lanord (ce dernier décédé en 1993), Les trésors mérovingiens de la basilique de Saint-Denis12.
LEs DoNNéEs NoUVELLEs
Longtemps dispersés et inaccessibles aux chercheurs (à l’exception du mobilier funéraire d’Arégonde, exposé au Louvre à partir de 1981), les objets, souvent presti-gieux, des tombes mérovingiennes de la basilique de Saint-Denis ont été en définitive affectés en 1994 par le Ministère de la Culture au Musée des Antiquités natio-nale (MAN, dénommé musée d’Archéologie nationale depuis 2005), où ils sont exposés depuis 1998. Quant au mobilier funéraire d’Arégonde, il a été lui aussi affecté au MAN en 1996, tout en demeurant présenté au Louvre, comme l’avait souhaité Michel Fleury.
À l’occasion de l’inventaire du matériel archéolo-gique de la basilique de Saint-Denis effectué au MAN par Françoise Vallet, conservateur en chef, celle-ci constata qu’un certain nombre d’objets signalés dans les diverses publications d’Édouard Salin13 et de Michel Fleury14 manquaient15. Questionné à ce sujet, Michel Fleury, suggéra que ces objets et restes organiques, étu-diés et restaurés par Albert France-Lanord dans son laboratoire personnel de Nancy, avaient été transférés par la suite au Laboratoire d’Archéologie des métaux de Jarville. Tel n’était pas en fait le cas, comme le confirmèrent la conservation du musée du Fer et la famille d’Albert France-Lanord. L’inventaire des archives de Michel Fleury, réalisé après sa disparition en 2002, n’apporta pas d’informations sur le sort du matériel archéologique manquant, jusqu’à ce que celui-ci réapparaisse de façon inespérée en 2003.
La quasi-totalité des objets métalliques et des restes organiques manquants furent alors retrouvés au labora-toire de restauration de la Commission du Vieux Paris, à la Rotonde de la Villette, où ils étaient soigneusement rangés dans des placards qui n’avaient pas été ouverts depuis au moins une vingtaine d’années. Quant aux restes organiques de la tombe d’Arégonde, ainsi que son flacon de verre, ils se trouvaient dans un coffre-fort qui, lui non plus, n’avait pas été ouvert depuis que Michel Fleury avait quitté dans les années 1975 les bureaux qu’il occupait dans le Marais à l’Hôtel d’Aumont, siège du Tribunal administratif de la Ville de Paris. Grâce à la diligence de la Commission du Vieux Paris et du Service régional de l’Archéologie d’Île-de-France, ces objets et restes organiques oubliés furent aussitôt dépo-sés au MAN.
L’intérêt de ce recouvrement est manifeste, qu’il s’agisse des objets mobiliers manquant jusqu’alors, mais aussi de l’ensemble des restes organiques, consi-dérés comme perdus. On dispose désormais de tous les restes osseux prélevés dans les sarcophages, une dizaine de squelettes, avec celui d’Arégonde, pouvant se prêter, du fait de leur état de conservation, à des examens anthropologiques et à des recherches d’ADN. En ce
qui concerne les nombreux restes organiques animaux et végétaux, la plupart sont dans l’état où ils ont été prélevés in situ, une partie d’entre eux n’ayant pas été apparemment étudiée et ne figurant donc pas dans Les trésors mérovingiens de la basilique de Saint-Denis16.
C’est ainsi que, parallèlement au programme d’étude des objets métalliques cloisonnés ou sertis de grenats de la basilique de Saint-Denis, que le MAN mène depuis 2000 avec le Centre de Recherches et de Restauration des musées de France (C2RMF) (voir ci-dessous), a été mis en place avec d’autres institutions scientifiques un double programme de recherche, l’un portant sur les restes organiques humains et l’autre sur les restes orga-niques animaux et végétaux.
À l’issue de ces recherches, le MAN envisage la publication d’un nouveau catalogue, tombe par tombe, de tous les objets et restes organiques découverts dans la basilique de Saint-Denis17. En effet, il a semblé néces-saire d’apporter un certain nombre de compléments et de correctifs au catalogue des sépultures donné dans Les trésors mérovingiens de la basilique de Saint-Denis, qu’il s’agisse de la composition des assemblages funé-raires eux-mêmes, de la détermination des gemmes, de l’identification de techniques d’orfèvrerie, des modalités de restauration de certains objets et de leur étude typo-chronologique, totalement absente18.
PREmiERs RésULtats DEs NoUVEaUx ExamENs aNthRoPoLoGiqUEs
Et BioLoGiqUEs
RéExamEN DEs REstEs ossEUx
Peu après leur découverte en 1959, les restes osseux d’Arégonde ont fait l’objet d’une première étude anthro-pologique de la part du Dr Beau, Professeur d’Anatomie à la Faculté de Médecine de Nancy, et du Dr Huguin, Directeur de l’Institut dentaire de Nancy19. Ils ont établi que la défunte, aux os menus, était de petite taille (envi-ron 1,55 m), proposant d’après l’état de sa dentition que sa mort était survenue vers 45 ans. Compte tenu de l’an-née de naissance de son fils Chilpéric Ier, alors fixée en 539, et d’un âge au mariage estimé à 15 à 20 ans (Arégonde serait donc née vers 520-525), Michel Fleury en a conclu qu’Arégonde était morte dans les années 565-570.
Comme nous l’avons exposé en son temps20, cette estimation de la date de décès d’Arégonde s’avérait trop précoce pour être compatible avec la datation archéolo-gique des constituants les plus récents de son mobilier funéraire, en l’occurrence la grande garniture de ceinture d’orfèvrerie et les boucles de chaussures à décor en “ style animalier II évolué ”, types d’objets n’apparais-sant pas avant la fin du VIe siècle21. C’est ce qui d’ailleurs avait conduit certains chercheurs à douter que la défunte ait pu être Arégonde, proposant d’y voir une autre femme de haut rang qui aurait hérité de la bague
La tombe d’Arégonde. Nouvelles analyses en laboratoire de la défunte du sarcophage 49 de la basilique de Saint-Denis 185
d’Arégonde ou porté le même nom qu’elle et serait morte dans les premières décennies du VIIe siècle22.
Considérant cependant comme d’autres, que la conjonction d’un lieu d’inhumation prestigieux, d’un mobilier funéraire de qualité exceptionnelle et d’une bague à l’inscription significative plaidaient en faveur de l’identification de la défunte du sarcophage 49 comme la reine Arégonde, nous avons suggéré que le seul moyen de faire coïncider les données historiques et archéologiques était d’augmenter sensiblement l’âge au décès de la défunte23. Nous avons ainsi proposé que si la reine était morte non pas vers 45 ans, mais vers 60 ans, sa date de décès vers 580 pouvait alors être compatible avec la première datation archéologique pos-sible de la tombe. Les restes osseux d’Arégonde ayant alors disparu, notre hypothèse était malheureusement invérifiable.
Contestant cette proposition, et donc une datation sensiblement plus récente de la tombe d’Arégonde, pourtant acceptée par une partie de la communauté scientifique, Michel Fleury demanda alors au Dr Pierre Thillaud, chargé de conférences de paléopathologie à la IVe section de l’École pratique des Hautes Études, une nouvelle expertise ostéo-archéologique des restes osseux d’Arégonde24. Celle-ci se limita en fait au seul examen, à partir de photographies et de radiographies, de sa man-dibule, de l’extrémité proximale de son fémur gauche, ainsi que de son rachis lombaire in situ. Cette étude, tout en confirmant la taille de la défunte entre 1,50 et 1,60 m d’après la “ seule donnée approximative ” fournie par un tibia de 33 cm de longueur, concluait à son âge au décès entre 35 et 45 ans.
Cette expertise ostéo-archéologique n’ayant pu porter sur les restes osseux eux-mêmes, alors disparus, les conclusions du Dr Pierre Thillaud sur l’âge au décès d’Arégonde furent accueillies avec réserve par plusieurs paléo-anthropologues, et notamment par le Dr Joël Blondiaux, celui-ci considérant qu’à partir de la docu-mentation iconographique utilisée, on devait accepter une “ fourchette plus large de 30 (ans) à oméga qui tien-drait mieux compte des biais d’échantillonnage, des variations probabilistes et des incertitudes méthodolo-giques actuelles ”25.
La redécouverte récente de l’ensemble des restes osseux d’Arégonde, inaccessibles depuis plusieurs décennies, vient enfin de permettre la réouverture de ce dossier, confié au Laboratoire d’Anthropologie physique de Sophia-Antipolis à Valbonne (Var), dirigé par Luc Buchet. Un premier remontage du squelette a été effec-tué en novembre 2005 dans le laboratoire de restauration du MAN par Véronique Gallien, anthropologue à l’Ins-titut national de Recherches archéologiques préventives (INRAP, UMR 6130) et chercheur associé au CEPAM, auteur d’une thèse en archéologie funéraire et anthro-pologie sur le cimetière mérovingien situé au nord de la basilique de Saint-Denis (Fig. 4)26. Il a permis de constater que malgré des lacunes (une partie de la calotte crânienne, humérus gauche, tibias), liées au mode par-ticulier de décomposition du corps dans un sarcophage
toujours épargné des eaux d’infiltration, près de la moitié du squelette était conservée, notamment la mandibule, la colonne vertébrale, une partie du membre supérieur gauche, le bassin, la partie proximale des fémurs, enfin les pieds. La taille de la défunte a été à nouveau estimée entre 1,50 et 1,60 m d’après la longueur restituée du fémur27 et la gracilité de son squelette confirmée. L’exa-men des anneaux cémentaires, effectué sur une canine
Fig. 4 : Remontage du squelette du sarcophage 49 au labora-toire de restauration du musée d’Archéologie nationale (novem-bre 2005). Cliché Véronique Gallien.
186 ANTIQUITÉS NATIONALES, 37, 2005 : 181-206.
mandibulaire par le Dr Claude Rücker (CEPAM, CNRS-UNSA), a conduit à la détermination d’un âge au décès de 61 ans, plus ou moins 3 ans (Fig. 5 et annexe). Il a été également possible de constater que la défunte présentait un terrain hyperostosique avec des sites d’en-thèses très développés sur tous les os disponibles. Une arthrose cervicale et lombaire y est associée. Au niveau des anomalies des os des pieds, le Dr Yves Darton (CEPAM, CNRS-UNSA) a montré qu’il s’agissait d’une différence de taille, par hypoplasie du pied droit. Une hypoplasie corticale du fémur homologue est également visible. Cette différence segmentaire et harmonieuse de développement ne peut correspondre qu’à une séquelle de paralysie survenue durant l’enfance, dont la cause, de loin la plus probable, est une poliomyélite. L’exis-tence d’un stress biologique vers 4 ans, détecté par l’hy-poplasie de l’émail dentaire étudiée par le Dr Rücker, est cohérente avec cette hypothèse.
DétERmiNatioN DE L’aDN
L’une des questions soulevées par la nécropole méro-vingienne de la basilique de Saint-Denis est la compo-sition effective du recrutement des inhumés. En effet, sur un total de 81 tombes fouillées par Édouard Salin, puis par Michel Fleury28, 32 renfermaient un mobilier funéraire correspondant dans 4 cas à des hommes29 et dans 17 à des femmes30, les objets découverts dans 12 autres tombes n’offrant pas de caractérisation sexuelle assurée31. Il convient d’ajouter que des fils d’or ornant des vêtements ont été rencontrés dans 2 sépultures mas-culines32 et 13 sépultures féminines33, sans que l’on puisse proposer une attribution sexuelle dans 13 autres cas, faute de mobilier funéraire caractéristique ou tout simplement du fait de l’absence d’accessoires vestimen-taires34. Même si la présence de fils d’or semble beau-coup plus fréquente à Saint-Denis dans les tombes fémi-nines, on ne peut cependant exclure qu’une partie des défunts de sexe indéterminé accompagnés de fils d’or aient été des hommes, comme l’attestent ailleurs diverses
découvertes35. Néanmoins, il convient de souligner l’absence d’armes, à une exception près, dans les tombes mérovingiennes de la basilique de Saint-Denis, ce qui peut refléter une sous-représentation masculine effective36.
Le recours à des détermination ADN s’est donc imposé, non seulement pour l’identifications sexuelle des inhumés indéterminés, mais aussi pour la recherche de liens de parentés possibles entre ceux-ci, sans doute en partie issus de la Cour mérovingienne de Paris37.
Les premiers tests ont porté sur les restes osseux d’Arégonde. Ils ont été entrepris à partir de novembre 2005 par le Pr Jean-Jacques Cassiman (Center Human Genetics de l’Université de Louvain). Huit échantillons osseux (une molaire, deux vertèbres, un fragment de coccyx, un fragment d’os long, deux phalanges et un métatarsale), susceptibles de permettre l’extraction de l’ADN, ont été ainsi analysés. Outre la confirmation du sexe de la défunte (amplification de la séquence amelo-genine), il a été possible de mettre en évidence une séquence mitochondriale ayant son origine en Europe (haplo groupe U5a1).
Sur la base de ces résultats positifs – malgré les mani-pulations dont les ossements d’Arégonde avaient fait l’objet depuis leur découverte –, il est donc envisagé en 2007 de tenter de déterminer les profils de l’ADN mito-chondrial des restes osseux provenant d’une dizaine de sarcophages mis au jour dans le voisinage de celui d’Arégonde.
LEs acqUis DEs étUDEs DE LaBoRatoiRE PoRtaNt sUR
LE moBiLiER FUNéRaiRE38
Dans le cadre du programme “ grenats ”, qui est mené depuis 2000 au C2RMF39, tous les mobiliers métalliques concernés issus des tombes mérovingiennes de la basi-lique de Saint-Denis ont fait non seulement l’objet de caractérisations géochimiques à l’aide de l’accélérateur de particules AGLAE40, mais également d’analyses de composition des métaux supports. Des acquis significa-tifs ont ainsi été obtenus, notamment pour plusieurs des objets de parure et accessoires vestimentaires de la tombe d’Arégonde.
La qUEstioN DEs PaiREs D’oBJEts
Dès leur découverte en 1959, Michel Fleury mit en évidence les disparités techniques et stylistiques existant entre les constituants de trois paires d’objets de parure d’Arégonde, d’une part ses boucles d’oreille en or, d’autre part ses fibules discoïdes en or cloisonnées de grenats et enfin ses grands ferrets de jarretière en argent. La moindre qualité d’exécution d’une des boucles d’oreille et d’une des fibules suggéra alors à Michel Fleury que ces objets étaient sans doute des copies loca-les des exemplaires de bonne facture, la plus belle des
Fig. 5 : Sarcophage 49. La mandibule. Cliché Véronique Gallien.
La tombe d’Arégonde. Nouvelles analyses en laboratoire de la défunte du sarcophage 49 de la basilique de Saint-Denis 187
deux fibules pouvant être une pièce d’importation41. Celui-ci nota également de légères variantes dans l’or-ganisation du décor des deux ferrets, “ d’une ferme exé-cution ” et d’une usure égale42.
En 1980, à l’occasion de l’exposition La vie mysté-rieuse des chefs-d’œuvre. La science au service de l’art, le mobilier funéraire d’Arégonde a fait l’objet d’une série d’analyses au Laboratoire de Recherche des musées de France (LRMF), effectuées essentiellement par micro-fluorescence X43. On a pu ainsi établir que la composition de l’or des différentes parties constitutives des deux boucles d’oreille variait considérablement (83 à 90 % d’or, 5 à 12 % d’argent et 2 à 4 % de cuivre44), ce qui accréditait le fait, selon Michel Fleury, que la boucle d’oreille de moindre qualité était bien la copie de l’autre exemplaire. En ce qui concerne les fibules cloisonnées, la composition de l’or était en revanche identique (91 % d’or, 7 % d’argent et 1,5 % de cuivre), ce qui semblait curieux pour des objets apparemment issus d’ateliers différents45. Les deux ferrets d’argent à décor zoomorphe, enfin, avaient la même composition, avec 93,5 % d’argent, 4,5 % de cuivre, 0,8 % d’or et 0,6 % de plomb46, ce qui pouvait sembler logique pour une paire d’objets vraisemblablement réalisés dans un même atelier et en même temps. Christian Lahanier, cependant, souligna à juste titre la nette différence de traitement des deux ferrets, considérés comme ciselés dans des plaques d’argent, l’exemplaire B ayant été tra-vaillé avec plus de soin que le A, avec des “ traits angu-leux de la ciselure et (un) manque de symétrie du tracé du dessin ”47.
Les analyses par méthode PIXE48 auxquelles nous avons récemment soumis ces mêmes objets n’ont en fait pas toujours confirmé les résultats des analyses publiés en 1980 dans le catalogue de l’exposition La vie mystérieuse des chefs-d’œuvre… Les divergences constatées ont probablement une double origine. D’une part, la méthode d’analyse par micro-fluorescence X, tout à fait pionnière pour l’époque, n’était alors qu’une méthode semi-quantitative permettant la comparaison qualitative du métal des objets, mais ne pouvant en aucune manière donner une composition avec précision. D’autre part, faute de temps, seules quelques-unes des 190 analyses effectuées dans les mois qui précédèrent l‘exposition ont pu être exploitées et publiées dans son catalogue, avec parfois des erreurs. La confrontation de ces mesures anciennes, conservées dans les archives du C2RMF, avec les résultats des analyses récemment effectuées par PIXE, nous conduit donc à réviser en partie les données publiées dans le catalogue en 1980 et reprises en 1998 dans l’ouvrage de Michel Fleury et Albert France-Lanord.
Il a tout d’abord été possible d’établir que l’or du boîtier des deux fibules discoïdes cloisonnées (Fig. 6) présentait en fait de sensibles différences de composi-tion, l’exemplaire A se différenciant de l’exemplaire B par un or à teneur plus importante en cuivre (entre 90 et 90,5 % d’or, cuivre variant entre 1,6 % et 3,7 % et argent entre 6,3 % et 8 %), alors que la fibule B présente
un or plus pur (entre 92,5 et 95 % d’or, cuivre variant entre 0,4 et 0,8 % et en argent entre 4,4 et 6,7 %) (Fig. 7). Ces discordances de composition doivent être mises en corrélation avec la présence dans les cloisons de chacune des fibules de populations différentes de grenats (cf. ci-dessous). Il est donc probable, comme le proposaient Michel Fleury et Albert France-Lanord, que ces deux fibules n’ont pas été réalisées par un même atelier, l’exemplaire de moindre qualité étant de toute évidence la copie locale d’une pièce importée. En effet, comme nous l’avions proposé, ce type de fibule à cloisonné en résille est caractéristique de la vallée du Rhin et sud-ouest de l’Allemagne à la fin du VIe siècle et au tout début du VIIe siècle où, habituellement, il n’est pas porté par paire49. Il est donc possible que pour satisfaire à la mode locale encore vivace du port de fibules par paire, Arégonde ait fait copier sur place la fibule qui était entrée en sa possession en un seul exem-plaire.
Fig. 7 : Composition de l’or des fibules cloisonnées (nous avons conservé les désignations A et B figurant dans La vie mysté-rieuse des chefs-d’œuvre… 1980, p. 116). Analyses Thomas Calligaro, C2RMF.
Fig. 6 : La paire de fibules discoïdes en or cloisonné de grenats (avers et revers). Photo RMN © Jean-Gilles Berizzi.
188 ANTIQUITÉS NATIONALES, 37, 2005 : 181-206.
En ce qui concerne les boucles d’oreille (Fig. 8), dont les corbeilles, les bâtes et les anneaux ont fait l’objet d’analyses distinctes, on a pu vérifier que la composition des corbeilles varie considérablement (89 et 90 % d’or, 4,1 et 8,2 % d’argent, 6,8 et 1,7 % de cuivre) (Fig. 9). Il en est de même pour l’or des bâtes, retrouvées vides mais qui avaient dû sertir une matière organique péris-sable, telle une perle de nacre. En revanche, les diffé-rences de composition des anneaux sont apparues moins marquées, avec un pourcentage d’or, d’argent et de cuivre très voisin. Si il est désormais établi que la cor-beille de la boucle d’oreille B, de médiocre qualité, est bien la copie de l’exemplaire A, en revanche il est pos-sible que les deux anneaux soient bien d’origine. On pourrait ainsi envisager que la corbeille de la boucle d’oreille B, endommagée ou perdue (les soudures ayant cédé ?), ait été remplacée par un orfèvre local peu talentueux50.
Les nouvelles analyses des deux grands ferrets de jarretière à décor zoomorphe (Fig. 10) ont montré que leur composition n’était pas en fait identique, comme on l’avait proposé en 198051. En effet, nous avons mesuré des différences notables au niveau des pourcen-tages d’argent et de cuivre de ces deux pièces, la plaque du ferret B présentant moins de cuivre (0,9 %) que celle du ferret A (3,2 %), les taux d’or et de plomb étant qua-siment identiques (Fig. 11). Nous avons également constaté que la patine noirâtre incrustée dans les creux du décor des deux ferrets était de nature différente (sul-fure d’argent pour le ferret A et du bromure d’argent pour le ferret B). On ne peut manquer de corréler ces différences de composition de ces deux objets avec celles de leur longueur (6,7 et 6,9 cm), ainsi que de sensibles variations dans l’organisation de leur décor, comme Michel Fleury et Albert France-Lanord l’avaient noté dès leur publication de 1962, sans que ces points soient cependant interprétés52. Enfin, l’examen macros-copique de ces deux pièces montre que l’exemplaire B (présumé l’original), de section arquée et avec une ligne de fracture révélée par la radiographie, porte au revers un réseau de filandres verticales convexes et quelques filandres perpendiculaires plus nettes, avec à l’avers un décor imitant la taille biseautée à relief mou et d’impor-tantes traces d’usure. En revanche, l’exemplaire A, plus massif, présente à son revers plat et empâté des filandres verticales peu visibles, mais recoupées par des incisions perpendiculaires bien marquées, les creux du décor
imitant la taille biseautée à l’avers étant profonds et vifs, avec des traces de poinçon. Toutes ces divergences excluent que ces deux ferrets aient été moulés à la cire perdue à l’aide d’une même matrice, comme c’est habi-tuellement le cas pour les paires d’objets en argent ou en alliage cuivreux de la première partie de l’époque mérovingienne53, telles les fibules ansées asymé-triques54. Apparemment, nous sommes donc bien en
Fig. 11 : Composition de l’argent des grands ferrets de jarretière (nous avons conservé les désignations A et B figurant dans La vie mystérieuse des chefs-d’œuvre… 1980, p. 118). Analyses Thomas Calligaro, C2RMF.
Fig. 8 : Les boucles d’oreille en or. Photo RMN © Jean-Gilles Berizzi.
Fig. 9 : Composition de l’or des boucles d’oreille (nous avons conservé les désignations A et B figurant dans La vie mystérieuse des chefs-d’œuvre… 1980, p. 115). Analyses Thomas Calligaro, C2RMF.
Fig. 10 : Les grands ferrets de jarretière en argent. Cliché Frédéric Lontcho.
La tombe d’Arégonde. Nouvelles analyses en laboratoire de la défunte du sarcophage 49 de la basilique de Saint-Denis 189
présence, à nouveau, d’une “ fausse ” paire d’objets dont l’interprétation demeure conjecturale. L’hypothèse la plus vraisemblable, qui n’est cependant pas totale-ment étayée par les analyses métallographiques, du fait de la faible variation des taux d’argent et de cuivre et d’un taux identique d’or et de plomb entre les deux objets, serait que l’un des ferrets, brisé ou perdu, ait été remplacé par une copie, ce qui expliquerait les diffé-rences constatées55.
aUtREs aNaLYsEs métaLLoGRaPhiqUEs
D’autres objets de la tombe d’Arégonde, en or ou offrant des parties en or, ainsi qu’en argent, ont également fait l’objet d’analyses, aussi bien en raison de problématiques particulières, que pour enrichir la base données du C2RMF concernant les ors et argents du très haut Moyen Âge.
Il en a été ainsi de la bague nominative de la défunte (Fig. 12). Qu’il s’agisse de son chaton, de son jonc ou des globules qui le cantonnent, l’or qui la compose se révèle très homogène, ce qui est logique, avec un taux moyen de 90 % (dont 9 % d’argent) (Fig. 13). Ce type d’alliage est assez similaire a l’or des boucles d’oreille, de la fibule cloisonnée A et du polyèdre médian de la grande épingle, mais s’avère sensiblement supérieur au pourcentage d’or des manchons de cette dernière et des appliques en tôle d’or de la garniture de ceinture.
Par référence à des analyses récemment effectuées au C2RMF sur des bagues du très haut Moyen Âge, on peut constater que si la bague d’Arégonde s’insère bien dans la série mérovingienne analysée56, elle se distingue assez nettement des bagues byzantines57 et d’une bague lombarde, celles-ci présentant un taux nettement plus élevé d’or (93 à 96 %) et un taux moindre d’argent (3 à 5 %) (Fig. 14). Un autre critère distingue également le petit groupe de bagues mérovingiennes étudiées (ainsi que d’autres types d’objets dont les fibules d’Arégonde) des exemplaires de provenance byzantine ou lombarde, en l’occurrence la présence d’étain à l’état de traces qui, pour les premières, est supérieur dans la plupart des cas à 0,10 %, alors que pour les secondes il est systémati-quement inférieur à 0,05 %. Il importera évidemment d’élargir l’échantillonnage des objets étudiés afin de vérifier si cette présence d’étain constitue un critère per-tinent et si elle permet une certaine distinction entre les ors présumés byzantins ou mérovingiens. En tout cas, la présence d’étain dans les bijoux mérovingiens suggère qu’ils ont été réalisés avec un or d’origine alluvionnaire, c’est-à-dire issu d’orpaillage en rivière, alors que les bijoux byzantins auraient été réalisés avec un or direc-tement extraits de mines dont les filons ne comportaient pas d’étain, ou ayant subi un affinage particulièrement poussé.
Les divers constituants de la grande épingle (Fig. 15) ont fait l’objet d’analyses beaucoup plus précises que celles effectuées en 1980, où les manchons en tôle d’or et les trois polyèdres gainant sa tige d’argent étaient
censés offrir une composition homogène de 79,5 % d’or, 15,5 % d’argent et 4,5 % de cuivre58. C’est ainsi que les manchons en tôle d’or à décor de filigranes accusent un pourcentage relativement faible d’or (80,8 %) et un taux élevé d’argent (12,5 %) et de cuivre (6,7 %), ce qui est normal pour ce type d’orfèvrerie réalisée à partir de tôles d’or59 (Fig. 16). Il en est de même pour les deux poly-èdres à grenats en bâte situés de part et d’autre du gros polyèdre médian. Ce dernier en revanche, façonné à partir d’un véritable flan en or martelé dans les évide-ments duquel sont directement inclus de petits grenats, présente un taux d’or plus élevé (92,6 % d’or, 6,6 % d’argent et 0,8 % de cuivre), ce qui le rapproche des ors byzantins (voir ci-dessus à propos de la bague). Ces différences de composition des ors utilisés peuvent confirmer l’hypothèse que nous avons avancée d’un objet composite. En effet, si les petits polyèdres à gre-nats en bâte s’apparentent à des productions occidenta-les classiques du VIe siècle, notamment illustrées par des pendants de boucles d’oreille60, le polyèdre médian, avec des grenats directement sertis dans les évidements d’une épaisse tôle d’or, relève d’une technique bien dif-férente qui échappe au monde mérovingien. En effet, si l’on se réfère aux travaux de Noël Adams, qui (Classe II) rattache ce polyèdre à des productions des IIe et IIIe siècles de notre ère qui caractérisent l’est de la Mer noire et le Caucase, une sphère facettée de Cihisdziri, en Géorgie, étant actuellement le meilleur parallèle pour le polyèdre de la grande épingle de Saint-Denis61. S’il
Fig. 12 : La bague nominative en or. Photo RMN © Jean-Gilles Berizzi.
Fig. 13 : Composition de l’or de la bague d’Arégonde. Analyses Thomas Calligaro, C2RMF.
190 ANTIQUITÉS NATIONALES, 37, 2005 : 181-206.
Fig. 16 : Composition de l’or des décors de la grande épingle d’argent. Analyses Thomas Calligaro, C2RMF.
Fig. 17 : Les petites épingles de coiffure en or. Photo RMN © Jean-Gilles Berizzi.
Fig. 14 : Analyses de comparaison de la composition de diverses bagues en or du très haut Moyen Âge. Document et analyses Thomas Calligaro, C2RMF.
Fig. 15 : La grande épingle. Photo RMN © Jean-Gilles Berizzi.
La tombe d’Arégonde. Nouvelles analyses en laboratoire de la défunte du sarcophage 49 de la basilique de Saint-Denis 191
est donc très probable que celui-ci soit un objet antique réutilisé62, on notera cependant des particularités tech-niques communes aux trois polyèdres, qu’il s’agisse de leur remplissage avec du gypse, déjà reconnu en 1980, de l’utilisation, observée sur les deux polyèdres infé-rieurs, des mêmes tôles d’argent placées sur le remplis-sage de gypse et servant de supports aux grenats63 ou encore des mêmes populations de grenats (types IV et V, voir ci-dessous). Ces similitudes conduisent à propo-ser que, lors de sa réutilisation, le gros polyèdre avait perdu ses inclusions d’origine64, leur remplacement par de petits grenats sertis ayant été effectué, sans doute par le même orfèvre ou le même atelier, avec la technique utilisée pour les petits polyèdres.
Les analyses effectuées sur les deux épingles de coif-fure en or (Fig. 17) ont montré que leur tige était assez riche en argent (45 % et 20 % d’argent) (Fig. 18). En revanche, leurs têtes, formées de deux tôles hémi-sphériques soudées, se sont révélées de composition homogène (93 %, 4 % argent, 3 % cuivre) et non diffé-rentes, comme on l’avait proposé en 198065.
Des analyses métallographiques ont enfin été faites sur la garniture de ceinture d’Arégonde (Fig. 19), qu’il s’agisse de son armature en argent (93 % argent, 4 % de cuivre, 1 % d’or et 2 % de plomb) ou des tôles d’or à décors de filigranes et grenats et verroteries en bâte (Fig. 20). Placées sur la feuille de cuivre qui se trouvait aux revers des plaques et maintenues grâce à l’armature d’argent de celles-ci, ces appliques présentent un pour-centage d’or relativement bas (86,4 et 85,1 %) et au
contraire élevé en argent (13,9 et 11,9 %), ce qui a été également constaté pour les manchons de la grande épingle et semble bien correspondre au type de décor en tôle d’or, bien distinct de celui des objets d’or moulés ou travaillés à partir de flans. Les bossettes ornementales
Fig. 18 : Composition de l’or des petites épingles de coiffure. Analyses Thomas Calligaro, C2RMF.
Fig. 20 : Composition de l’armature en argent et des appliques en or de la garniture de ceinture. Analyses Thomas Calligaro, C2RMF.
Fig. 19 : La garniture de ceinture. Photo RMN © Jean-Gilles Berizzi.
192 ANTIQUITÉS NATIONALES, 37, 2005 : 181-206.
en tôle d’or, au nombre de cinq sur chaque plaque, ont également fait l’objet d’analyses dans la mesure où elles posaient un certain nombre de problèmes. En effet la comparaison de la garniture de ceinture en son état actuel avec des photographies publiées à diverses époques montre que de façon curieuse certaines bos-settes ont changé de place au cours du temps, sans doute lors de restaurations successives de l’objet66. Si la plaque et la contre-plaque sont bien conformes aux photogra-phies publiées en 1979 et 198067, avec huit bossettes décorées de quatre oves68, les deux bossettes d’extrémité des plaques étant lisses, des divergences apparaissent en revanche par rapport aux photographies publiées en 1962 (pas de bossette lisse à l’extrémité de la plaque, à la différence de la contre-plaque)69 et 1998 (pas de bos-sette lisse à l’extrémité de la plaque, mais deux bossettes lisses voisines sur la contre-plaque, dont une à l’extré-mité)70. Les analyses ont permis d’identifier aisément la bossette “ unie ” en or de 22 carats (92 % d’or) qu’Albert France-Lanord signale avoir substituée sur la contre-plaque à un exemplaire original en partie détruit et déjà réparé71. Cette bossette lisse ne figure plus aujourd’hui sur la contre-plaque, mais se trouve à l’extrémité de la plaque. La composition des neuf autres bossettes est homogène, avec un taux d’or classique variant de 78 à 85 % d’or.
LE PRoGRammE “ GRENats ”72
L’un des points forts du programme pluriannuel d’étude des mobiliers funéraires mérovingiens de la basilique de Saint-Denis, mis en place en 2000 et qui est toujours en cours, a porté sur l’analyse des grenats présumés qui, en réseau couvrant ou en bâtes isolées, ornent une série d’objets de parure ou d’accessoires vestimentaires jalonnant l’ensemble de la période mérovingienne.
En effet, il est apparu évident que ce remarquable échantillonnage d’objets de grande qualité était suscep-tible de permettre une intéressante contribution à la question, toujours d’actualité, de l’origine des grenats, indissociable de celle du “ style cloisonné ” qui, dans tout l’Occident, a caractérisé une grande partie du très haut Moyen Âge. Outre l’analyse chimique des grenats par méthode PIXE, on a également utilisé la caractéri-sation de leurs inclusions par micro-spectrométrie Raman et micro-faisceau en mode PIXE, ces deux méthodes particulièrement performantes et également non destructives offrant une grande facilité et rapidité de mise en œuvre73.
Grâce à ces technologies de pointe, des résultats tout à fait significatifs ont été rapidement obtenus. Il s’est donc bientôt avéré nécessaire d’élargir l’échantillonnage constitué par les grenats de Saint-Denis. Outre des objets d’autres provenances conservés au musée d’Archéologie nationale, il a été ainsi possible, grâce à la précieuse collaboration d’archéologues et de conservateurs de plusieurs musées français, d’analyser de nombreux
objets porteurs de grenats provenant du sud-ouest, de l’ouest et du nord-est de la France, pour la plupart récemment découverts74. C’est donc 1290 grenats issus de 131 objets archéologiques de provenance connue75 qui ont été analysés, ce qui constitue à l’heure actuelle la plus importante base de données en la matière et auto-rise à coup sûr une meilleure connaissance de la composition et de l’origine des grenats utilisés par les orfèvres mérovingiens.
La méthode PIXE a permis de mesurer une large gamme d’éléments chimiques dans les grenats étudiés : Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Zr et Y. Dans cette liste, les éléments majeurs Mg, Al, Si, Ca, Mn et Fe ont permis de déterminer les pro-portions de pôles purs (almandin, pyrope, spessartite, grossulaire…). Parmi les autres éléments présents à l’état de traces (moins de 0,1 %), le titane (Ti), le chrome (Cr) et l’yttrium (Y) se sont révélés particulièrement significatifs. Les autres éléments n’ont été observés qu’à une très faible teneur, généralement trop proche de la limite de détection (de l’ordre de quelques parties par millions ou ppm) pour que leur mesure soit significative.
Le diagramme de la concentration en CaO en fonc-tion de celle en MgO s’est avéré déterminant pour la mise en évidence de cinq types de grenats (Fig. 21), ce qui a été confirmé par leur teneur en yttrium et en chrome, éléments chimiques présents à l’état de traces qui n’avaient pas été pris en compte jusqu’à présent dans les analyses qui ont porté sur les grenats du très haut Moyen Âge.
Ces cinq groupes reconnus sont les suivants : deux groupes d’almandins (dénommés types I et II) qui se démarquent par une teneur légèrement différente en MgO et CaO et des teneurs en titane distinctes, un groupe de pyraldins (dénommé type III) et deux groupes de pyropes (dénommés types IV et V), qui se distinguent par la présence ou l’absence de chrome. À l’aide de la même méthode PIXE, la composition géochimique des grenats archéologiques a d’abord été comparée avec les données publiées, puis avec des mesures effectuées sur un ensemble de grenats de référence de provenance géo-graphique et géologique connue (Fig. 22). On a pu ainsi établir que les grenats des types I et II (almandins) étaient originaires de l’Inde, ce qui est confirmé par la datation de leurs inclusions radioactives, les exemplaires du type I provenant sans doute du Rajasthan. L’origine des grenats du type III (pyraldin) a pu être sans conteste située à Ceylan. Quant aux grenats de type IV (pyrope non-chromifère), non identifiés jusqu’à présent, leur origine n’a pu encore être déterminée à partir du maté-riel de référence disponible, à la différence des exem-plaires de type V (pyrope chromifère), tout à fait com-parables aux grenats originaires de Bohême.
La répartition chronologique des cinq types de gre-nats, qui découle de la datation des objets-supports, s’est avérée très instructive (Fig. 23) : tandis que les types I et II (qui sont majoritaires) et III sont présents aux Ve et VIe siècle, les types IV et V (le type IV évoquant une
La tombe d’Arégonde. Nouvelles analyses en laboratoire de la défunte du sarcophage 49 de la basilique de Saint-Denis 193
Fig. 22 : Comparaison des grenats archéologiques étudiés avec des spécimens géologiques de provenance connue. Document Thomas Calligaro, C2RMF (diagramme de droite d’après QUAST et SCHÜSSLER 2000).
Fig. 23 : Répartition chronologique des cinq types de grenats étudiés. Document Thomas Calligaro, C2RMF.
Fig. 21 : Tableau récapitulatif des analyses de composition des grenats mérovingiens étudiés, mettant en évidence l’existence de cinq types. Document Thomas Calligaro, C2RMF.
194 ANTIQUITÉS NATIONALES, 37, 2005 : 181-206.
transition, avec des incertitudes sur sa provenance) n’apparaissent qu’à partir de la fin du VIe siècle. On peut y trouver la confirmation de l’hypothèse de U. von Free-den selon laquelle l’approvisionnement de l’Occident en grenats provenant du sous-continent indien s’est tari vers 60076. On aurait alors tenté de leur substituer des grenats européens, déjà connus, mais sans succès durable du fait des difficultés de leur taille en lames de grandeur suffisante pour la réalisation commode de cloisonnés couvrants ou de montages en bâte. On s’expliquerait alors le succès de l’orfèvrerie à pierres en bâtes, promise
à un bel avenir, avec prédominance de cabochons et de plaquettes de verre de couleur verdâtre, bleuâtre et jaunâtre, la couleur rouge devenant alors rare sur les bijoux, avec une utilisation de plus en plus exception-nelle des grenats que du verre rouge ne remplace alors qu’exceptionnellement.
C’est dans ce contexte qu’il convient de situer les objets cloisonnés ou sertis de grenats de la tombe d’Arégonde (Fig. 24).
L’étude des deux fibules discoïdes cloisonnées s’est avérée particulièrement intéressante en raison des
Fig. 25 : Les types de grenats utilisés pour orner les trois polyèdres de la grande épingle. Analyses Thomas Calligaro, C2RMF.
Fig. 24 : Les différents types de grenats utilisés pour orner les fibules, la grande épingle et la plaque-boucle. Analyses Thomas Calligaro, C2RMF.
La tombe d’Arégonde. Nouvelles analyses en laboratoire de la défunte du sarcophage 49 de la basilique de Saint-Denis 195
types de grenats qui les ornent. Tandis que l’exem-plaire A, comporte un panachage équilibré de grenats de type I et de type II (38 et 25, respectivement), l’exemplaire B (copie) est incrusté d’une très grande majorité de type I (63 grenats) et de quelques grenats de type II. Cette variation significative de la popula-tion des grenats employés, que corroborent les diffé-rences de qualité d’exécution et de composition de l’or des deux fibules (voir ci-dessus), permet de vérifier l’hypothèse selon laquelle l’exemplaire de moindre qualité est bien la copie, sans doute locale, d’une fibule importée de la vallée du Rhin ou du sud-ouest de l’Allemagne77.
La composition des grenats montés en bâte sur la grande garniture de ceinture est assez voisine de celle de la plus belle des deux fibules, avec une majorité de grenats de type I (13 exemplaires). S’y ajoutent deux grenats de type II, un de type III et un de type IV, sans compter sur chaque plaque deux verroteries brun-rouge qui remplacent sans doute des grenats perdus (deux sur la plaque, deux sur la contre-plaque)78. La présence de grosses bulles et la composition sodo-calcique de la pâte de ces verres colorée au manganèse laissent à penser qu’il s’agit bien de réparations d’époque.
La composition des grenats de la grande épingle, en revanche, est fort différente (Fig. 25), avec une majorité de grenats de type IV (26 exemplaires), six grenats de type III et deux grenats de type I, ce qui plaiderait en faveur de la datation relativement tardive de cet objet puisque les grenats des types IV et V semblent se diffuser au moment où les grenats des types I à III, de provenance orientale, ne sont pratique-ment plus utilisés. La répartition des types de grenats selon les polyèdres montre une prédominance des exemplaires de type III (6) sur le polyèdre supérieur (qui comporte en outre quatre grenats de type IV et un de type I), et en revanche une très nette prédominance des exemplaires de type IV (7) sur le polyèdre inférieur (qui comporte en outre un grenat de type I), et enfin la seule présence de grenats de type IV (15) pour le polyèdre médian.
LE PRoGRammE D’étUDEs DEs REstEs oRGaNiqUEs VéGétaUx Et aNimaUx
Laissées en l’état après leur redécouverte, les nom-breuses boîtes contenant les restes organiques prélevés par Michel Fleury et Albert France-Lanord dans les sarcophages de la basilique de Saint-Denis ont fait l’ob-jet d’une couverture photographique systématique, d’un inventaire préliminaire de ce qui était visible et enfin d’un classement tombe par tombe79. Après un premier examen de cette documentation par Antoinette Rast, spécialiste reconnue des textiles du haut Moyen Âge80, celle-ci a considéré qu’il était possible d’envisager à son propos un programme d’étude d’autant plus justifié qu’un certain nombre de ces restes organiques ne
semblaient pas avoir fait l’objet de manipulations depuis leur prélèvement, ce qui expliquait qu’ils ne soient pas mentionnés dans les publications de Michel Fleury et Albert France-Lanord.
Menée en septembre 2006 au laboratoire de restau-ration du MAN par Antoinette Rast-Eicher, une pre-mière campagne d’étude a porté sur la tombe d’Aré-gonde81. S’il n’est pas encore possible d’en donner les résultats définitifs, des analyses de laboratoire étant encore en cours et ne permettant pas encore de finaliser le rapport d’expertise, on ne peut cependant manquer de signaler quelques acquis significatifs, tirés de l’exa-men de fibres végétales ou animales qui étaient encore solidaires de restes osseux d’Arégonde ou d’objets l’ac-compagnant (une des fibules, du cuir de la ceinture, le flacon de verre). De plus, quelques fragments intacts conservaient une remarquable stratification de restes textiles.
Il est ainsi probable que la défunte était enveloppée dans un linceul de toile claire, sans doute d’origine végétale, et qu’il était fermé par au moins une des fibules discoïdes (qui conservait à son revers des restes de fibres fixées par les sels de cuivre du ressort de l’ardillon). Sous cette toile se trouve une étoffe “ pelucheuse ” (tex-tile foulé) dont on ne peut encore déterminer si elle correspondait à un manteau ou à une cape, ou bien encore à un matelas. En dessous de cette étoffe a été identifié un tissu de soie à motif géométrique tissé aux planchettes dont il a été possible d’établir qu’il bordait l’ouverture sur le devant du vêtement identifié par Albert France-Lanord comme une “ tunique de soie ayant l’ap-parence du satin ”, avec aux emmanchures en soie (un samit d’après les nouvelles analyses) des galons brodés de fils d’or. C’est sous cette “ tunique ” que, toujours selon Albert France-Lanord, se trouvait la “ courte robe d’ottoman de soie violette ”, sur laquelle était portée la garniture de ceinture82. Antoinette Rast-Eicher a en fait pu établir que la bordure verticale à motifs géométriques du vêtement ouvert sur le devant était en fait cousue au tissu « violet », qu’on ne pouvait donc plus interpréter comme une “ robe ”. De plus, la présence de fragments de cette bordure sous la grande ceinture montrait à l’évi-dence que celle-ci était en fait portée sur le vêtement ouvert sur le devant. Enfin, il apparaissait qu’un tissu en armure toile situé en dessous, souvent d’apparence rougeâtre, devait sans doute être mis en relation avec la tunique (le terme de “ robe ” étant anachronique) de la défunte.
D’autres questions sont en cours d’examen, telle la longueur du vêtement ouvert sur le devant et de la tuni-que, l’existence réelle, en tant que telle, d’une seconde ceinture simplement nouée, la reconstitution des jarre-tières, ou encore l’interprétation d’autres restes textiles, non identifiés par Albert France-Lanord, qu’il n’est pas possible de localiser par rapport au corps d’Arégonde. En tout cas, il est d’ores et déjà certain qu’il conviendra d’apporter d’importants correctifs à la reconstitution du costume de la défunte par Michel Fleury et Albert France-Lanord83 (Fig. 26).
196 ANTIQUITÉS NATIONALES, 37, 2005 : 181-206.
La DatatioN histoRico-BioLoGiqUE DE La tomBE D’aRéGoNDE
À l’issue de cette présentation de données nouvelles, anthropologiques et archéométriques, concernant la tombe d’Arégonde, une nouvelle réflexion s’impose au sujet de sa datation elle-même. Celle-ci découle, comme on l’a vu, de trois paramètres.
Le premier est la date de naissance de Chilpéric Ier. Celle de 539, retenue initialement par Michel Fleury, a été sensiblement modifiée par les travaux du regretté Eugen Ewig. Celui-ci, à partir d’une argumentation convaincante, a proposé en définitive que Chilpéric ait été sensiblement plus âgé que son demi-frère Sigebert, fils de Clotaire Ier et d’Ingonde, sœur d’Arégonde, né en 535. Chilpéric serait donc sans doute né en 534, l’union de sa mère avec Clotaire étant placée en 533/534, et la date de naissance de celle-ci, liée à l’estimation
de son âge au mariage, pouvant être située vers 515/52084.
Le second paramètre, dont il est possible de déduire la date de naissance d’Arégonde, est l’âge auquel elle a eu son fils de Clotaire Ier (Fig. 27). Toujours selon Eugen Ewig, Arégonde devait être nubile et capable de porter un enfant quand Clotaire se l’associa par mariage, ce qui implique une tranche d’âge de 15 à 20 ans, avec une meilleure probabilté vers 18 ans85.
Le troisième paramètre est enfin l’âge au décès d’Arégonde, que les études biologiques récentes ont permis de fixer non plus vers 45 ans ou même vers 35-45 ans, selon les déterminations anthropologiques antérieures, mais à 61 ans, plus ou moins 3 ans, comme on l’a vu ci-dessus (voir Annexe).
Si l’on se réfère à la date naissance de Chilpéric et à l’âge probable de sa mère à sa naissance, tels que Eugen Ewig les proposent, c’est donc vers 577, plus ou moins 3 ans (c’est-à-dire entre les années 574 et 580), qu’il
Fig. 26 : Reconstitution du costume d’Arégonde d’après Michel Fleury et Albert France-Lanord. FLEURY et FRANCE-LANORD 1979, p. 176. Les nouvelles analyses des restes organiques re-mettent largement en question ces propositions.
La tombe d’Arégonde. Nouvelles analyses en laboratoire de la défunte du sarcophage 49 de la basilique de Saint-Denis 197
convient désormais de situer le décès d’Arégonde (Fig. 28). Cette date, sensiblement plus récente que celle de 565/570 donnée par Michel Fleury, est néanmoins susceptible de variations notables à l’intérieur d’une fourchette plus large (entre les années 572 et 583), selon qu’on attribue à Arégonde un âge plus ou moins élevé à la naissance de Chilpéric et qu’on opte pour une esti-mation haute ou basse de son âge biologique au décès.
En définitive, le fait qu’Arégonde soit morte sensi-blement plus âgée que Michel Fleury le proposait ne permet pas pour autant d’aboutir à de plus grandes cer-titudes quant à la date de sa mort, du fait des variables incontournables qui viennent d’être évoquées.
La DatatioN aRchéoLoGiqUE DE La tomBE D’aRéGoNDE
On ne peut manquer, à nouveau, de confronter la datation historico-biologique de la tombe d’Arégonde à la datation archéologique qu’on lui aurait accordée s’il s’agissait d’une inhumation anonyme86. Sans reprendre ici la totalité du dossier87, il convient de réexaminer succinctement la datation des constituants du mobilier funéraire du sarcophage 49.
De tradition byzantine, les boucles d’oreille doivent être considérées comme une variante d’un type italo-lombard largement diffusé de la Pannonie à la Gaule, avec une concentration significative dans le sud-ouest de l’Allemagne et la vallée du Rhin moyen. Caractéri-sées par des corbeilles semi-ovoïdes faites de fils d’or
à motifs de palmettes accolées, elles sont datables du Mérovingien ancien (MA) 3 ou du Mérovingien récent (MR) 188, l’exemplaire de Saint-Denis ayant été consi-déré par Gerhard Fingerlin comme le plus ancien de la série, du fait de la datation historico-biologique de la tombe d’Arégonde par Michel Fleury89.
Pour leur part, les fibules discoïdes à fin cloisonné couvrant en résille sont caractéristiques de la vallée du Rhin et du sud-ouest de l’Allemagne, quelques exem-plaires ayant été découverts en Italie Lombarde. Appar-tenant au MA 3, leur existence est relativement brève, des années 580 aux années 600 selon Katrin Vielitz, l’exemplaire de Saint-Denis, pour les mêmes raisons que les boucles d’oreilles, s’avérant également le plus ancien de la série90.
La bague nominative à chaton circulaire à pourtour perlé et trilobes à la jonction des extrémités du jonc est d’un type courant au Mérovingien récent 1 et 2, l’exem-plaire de Saint-Denis apparaissant à nouveau, et toujours pour les mêmes raisons, comme le plus ancien de la série91.
Rappelons pour mémoire que les grenats de la grande épingle, montés en bâte sur les polyèdres supérieurs et inférieurs ou sertis à vif sur le gros polyèdre médian, appartiennent à nos types IV et V, dont nous avons pu confirmer qu’ils ne furent utilisés en Gaule mérovin-gienne qu’à partir de la fin du MA 3, quand l’approvi-sionnement en grenats indiens cessa92 (Fig. 23).
Exceptionnelle par la richesse de ses matériaux et l’originalité de sa composition, la garniture de ceinture, avec plaque-boucle et contre-plaque légèrement trapé-zoïdales à cinq bossettes ornementales93, boucle ovale à coque profilée et ardillon à large bouclier scutiforme, n’est cependant pas isolée typologiquement. Elle se rat-tache en effet à une série de garnitures de ceinture de bronze qui sont caractéristiques de la moitié ouest de la Gaule, de l’Aquitaine à la Picardie94, et appartiennent au MR. Des parallèles exacts n’ont cependant pas été trouvés pour la forme subrectangulaire des plaques à cinq bossettes, la présence d’une contre-plaque évoquant plutôt la Picardie et la Normandie95. L’armature même des plaques, avec deux paires de compartiments scuti-formes affrontées par leurs pointes et sertissant des tôles d’or à décor de filigranes et pierres en bâte, est une composition jusqu’à présent totalement originale, mais qui s’inspire cependant de motifs bien connus au MA 2 et 3, comme Michel Fleury l’avait noté96. Associées à des boucles de ceinture de bronze, dont elles servent à riveter, le plus souvent au nombre de trois, le retour du cuir, ces appliques scutiformes sont parfois solidaires par deux, voire trois, et constituent alors les plaques de “ fausses plaques-boucles ”, pour reprendre l’expression de Claude Lorren97. Il est donc vraisemblable que l’or-fèvre ayant réalisé la garniture de ceinture d’Arégonde s’est inspiré de telles compositions. Faute de mieux, on a également rapproché l’armature des plaques de cein-ture d’Arégonde d’une plaque-boucle rectangulaire ajou-rée de Glems (Württemberg) qui, si elle comporte sur ses bords des saillies zoomorphes comparables à celles
Fig. 27 : Dates possibles de naissance d’Arégonde en fonction de son âge à la naissance de Chilpéric (date la plus probable 534, selon E. Ewig).
Fig. 28 : Estimation de la date de décès d’Arégonde en fonction des variations de son âge au décès et de celles de son âge au moment de la naissance de Chilpéric.
198 ANTIQUITÉS NATIONALES, 37, 2005 : 181-206.
des plaques de Saint-Denis, est néanmoins d’une com-position bien différente98. En revanche, les têtes anima-les très stylisées qui sont affrontées de part et d’autre de la bossette d’extrémité des plaques rappellent les motifs analogues qui figurent sur des plaques-boucles de type aquitain99, et plus généralement sur les plaques à extré-mités en queue d’aronde ou à crochet qui sont les rémi-niscences bien connues de chefs d’oiseaux à bec crochu. Quant aux têtes animales stylisées à “ bec de canard ” et mâchoire inférieure anguleuse qui, opposées, prolongent sur les bordures d’extrémité des plaques des corps ser-pentiformes en arcade, il convient de les comparer à des motifs analogues figurant sur les plaques-boucles et pla-ques de châtelaine de bronze ajourées de Avrechy
(Oise)100, Criel-sur-Mer (Seine-Maritime)101, Cugny (Aisne), Marchélepot et Templeux-la-Fosse (Somme)102, qui apparaissent au MA 3 et sont encore présentes au MR 1. On notera encore que le bord supérieur de la plaque ajourée de Templeux-la-Fosse, avec deux têtes animales très stylisées et affrontées et des cannelures saillantes sur ses bords latéraux, est comparable à celui des plaques de ceinture d’Arégonde. Toutes ces plaques ajourées de ceinture ou de châtelaine portent encore un motif de masque humain encadré d’un animal bicéphale à bec crochu103 et corps serpentiforme, de même que sur le bouclier d’ardillon de la boucle de ceinture d’Aré-gonde. Ce motif en “ Style II ”104, que l’on retrouve éga-lement sur la plaque-boucle ajourée de la tombe 9 de Saint-Denis105, est largement répandu du Rhin à la Garonne, mais plus fréquent dans le nord-ouest de la France où il apparaît au MA 3106. Si, pour sa part, le large bouclier de l’ardillon de la boucle de ceinture attri-buée à Arégonde est d’un type classique pour les pla-ques-boucles de type aquitain, datées du MR107, on le rencontre également en Neustrie à partir du MR 1, plus rarement au MA 3. On peut enfin ajouter que si la tech-nique des pierres montées en bâtes est bien connue aux MA 2 et 3 pour orner les polyèdres de pendants de bou-cles d’oreille ou d’épingles, il faut attendre la fin de la période pour que cette technique, combinée avec des filigranes, soit couramment utilisée en aplat sur des fibu-les discoïdes recouvertes d’une tôle d’or108. En conclu-sion, il est évident que l’orfèvre ayant réalisé la garni-ture de ceinture d’Arégonde, création totalement originale et pour l’instant isolée, s’est inspiré en les combinant de modèles dont il avait connaissance. Si la forme même des plaques et de la boucle de la garniture de ceinture d’Arégonde caractérisent le MR, la compo-sition à base de motifs scutiformes de l’armature des plaques correspond au MA 2 et 3. Il convient donc d’en-visager un objet “ précurseur ”, tout à fait compatible avec l’innovation que sous-tend souvent l’art de Cour, avec une datation pouvant se situer à la fin du MA 3.
Quant aux garnitures de chaussure de la défunte du sarcophage 49 (Fig. 29), avec plaques-boucles, contre-plaques et ferrets en argent doré et niellé à contour mou-vementé et décor zoomorphe, elles s’insèrent dans une série d’objets de même type, mais qui sont habituelle-ment réalisés en alliage cuivreux ou en fer damas-quiné109. Les exemplaires les plus anciens apparaissent au MA 3, où le rebord mouvementé des plaques épouse le contour de têtes d’animaux affrontées en “ Style ani-malier II précoce ”, selon la classification du regretté Helmut Roth110, style magnifiquement illustré à Saint-Denis par les grands ferrets de la tombe 49 (Fig. 10), mais souvent médiocrement imité ailleurs111. Cepen-dant, il faut attendre le MR 2 et la généralisation de la damasquinure bichrome pour rencontrer, à l’instar de ceux des garnitures de chaussure de la tombe 49 de Saint-Denis, des entrelacs filiformes en cartouche cen-tral, avec intégration de têtes animales “ à bec de canard ” et mâchoire anguleuse, avec des motifs zoomorphes périphériques dont le bord des plaques épouse le profil112.
Fig. 29 : Les garnitures de chaussure en argent. Photo RMN © Jean-Gilles Berizzi.
La tombe d’Arégonde. Nouvelles analyses en laboratoire de la défunte du sarcophage 49 de la basilique de Saint-Denis 199
Pour Helmut Roth, qui l’avait définie comme “ classi-que ”, cette forme du “ Style animalier II ” apparaissait seulement au MR 1, c’est-à-dire au début du VIIe siècle113. Néanmoins, l’exemple de la tombe 9 de Saint-Denis peut plaider en faveur de l’apparition de ce style dès le MA 3, peut-être en relation avec la précocité pos-sible d’un art de Cour (Fig. 30). Ainsi, la magnifique plaque-boucle de ceinture en argent, à plaque ajourée, reproduit, de même que la garniture de ceinture de la tombe 49, des motifs zoomorphes dont on a vu qu’ils figuraient sur les plaques ajourées de ceinture ou de châtelaines datables du MA 3. Si les volutes ornant les plaques des garnitures de chaussure de la tombe 9 peu-vent résulter de l’interprétation de motifs zoomorphes, elles ne sont cependant pas comparables à ceux des plaques de garnitures de chaussure de la tombe 49. Néanmoins, on ne peut manquer de noter des similitudes dans l’élégant traitement des entrelacs figurant sur les ferrets provenant des deux tombes, même si les entrelacs des ferrets de la tombe 9 n’intègrent pas des détails zoomorphes.
Quant au flacon de verre verdâtre trouvé aux pieds de la défunte, avec une panse piriforme et un col court, il s’insère dans le type 20 de Jean-Yves Feyeux, plutôt daté du milieu du Ve au milieu du VIe siècle, l’exem-plaire de la tombe de Saint-Denis plaidant en faveur d’une datation possible plus tardive114.
En définitive, si la défunte du sarcophage 49 de Saint-Denis avait été anonyme, on aurait situé son inhumation
à la charnière du MA 3-MR 1, sinon même à la fin du MA 3, c’est-à-dire les années 580-600115.
RécaPitULatiF
En l’état actuel des connaissances, l’écart qui existait initialement entre la datation historico-biologique de la défunte du sarcophage 49 de Saint-Denis et sa datation archéologique a sensiblement diminué, ce qui permet d’aborder dans de meilleures conditions la question de son identification possible avec la reine Arégonde (Fig. 28).1. Comme on l’a vu, la détermination historico-biolo-
gique de la date de décès de la défunte dépend d’une part de son âge au mariage, qu’il convient de situer de façon plausible entre 15 et 20 ans, et d’autre part de son âge au décès, désormais fixé à 61 ans plus ou moins 3 ans (Fig. 28). C’est donc entre 572 et 583 que la défunte est probablement décédée.
2. Il convient naturellement de se demander si cette fourchette chronologique historico-biologique est compatible avec la datation strictement archéologi-que de la tombe par son mobilier funéraire. Ainsi que nous l’avons proposé, celle-ci peut être située dans les années 580/600. Il y a donc un recoupement pos-sible des deux types de datation si l’on opte pour un âge précoce d’Arégonde à la naissance de Chilpéric
Fig. 30 : Plaque-boucle de ceinture et garnitures de chaussure en argent de la tombe 9 de la basilique de Saint-Denis. Photo MAN © Loïc Hamon.
200 ANTIQUITÉS NATIONALES, 37, 2005 : 181-206.
et une estimation haute de son âge au décès, c’est-à-dire vers 580.
3. L’identification de la défunte du sarcophage 49 avec la reine Arégonde étant de ce point de vue autorisée, on ne peut néanmoins éluder la question de l’exis-tence possible avant vers 580 des objets les plus récents de la tombe, en l’occurrence la garniture de ceinture et les garnitures de chaussure. En effet, toutes deux offrent des traces d’usure et de répara-tions témoignant qu’elles ont sans doute été beau-coup portées, sans évidemment qu’on puisse en esti-mer la durée. En un mot, peut-on envisager l’existence de ces objets dans la décennie précédente, c’est-à-dire les années 570/580.
4. Partant du postulat, partagé par beaucoup, que la tombe 49 de la basilique de Saint-Denis n’a pu être que celle d’Arégonde, qu’il s’agisse se son emplace-ment privilégié, du caractère exceptionnel de son mobilier funéraire et de la bague nominative, il faut certainement préférer ici sa datation historico-bio-logique, même si celle-ci peut sembler précoce à l’intérieur du MA 3. En fait, si la chronologie relative des objets mérovingiens est solidement assise, leur datation absolue, qui procède de démarches complexes, ne saurait être aujourd’hui considérée comme définitivement arrêtée116. D’autre part, il faut tenir compte de la précocité toujours possible de l’art de Cour, par principe inventif.
qUELqUEs coNsiDéRatioNs sUR La tomBE D’aRéGoNDE Et soN coNtExtE
histoRiqUE Et cULtUREL
Le sarcophage 49 de Saint-Denis étant bien celui d’Arégonde, par qui la continuité en ligne directe de la dynastie mérovingienne a pu être assurée, il convient, pour conclure, de tenter de replacer dans son contexte historique et culturel possible la sépulture de la mère de Chipéric Ier.
Notre seule source historique sur Arégonde est Gré-goire de Tours. D’une part, il se borne à énumérer trois des épouses de Clotaire Ier – Ingonde, sa soeur Aré-gonde, et Chunsina – et donne le nom de plusieurs de leurs enfants, dont de futurs roi. D’autre part, il relate les circonstances de son union avec Arégonde, après que Ingonde ait sollicité auprès de son époux un mari “ bien doué et fortuné ” pour sa sœur117. Il n’est plus ensuite question d’Ingonde ni d’Arégonde, pas plus que de ses autres épouses Audovère118 et Chunsina, à la différence de Radegonde, du fait de son destin d’abbesse et de sainte119. Ce mutisme de Grégoire à propos de la vie et de la mort de la plupart des reines mérovingiennes n’a en fait rien de surprenant, l’auteur des Dix livres d’his-toires ne s’intéressant guère, sauf exception (les régen-tes et les saintes), qu’à celles dont les origines sociales ou le comportement le choquaient120. En ce qui concerne Arégonde, il n’est donc pas possible de tenter de situer sa date de décès par rapport à des faits historiques. On
ignore ainsi si elle mourut avant son fils Chilpéric (+ 584), qui alors aurait certainement organisé lui-même les funérailles de sa mère, ou après l’assassinat de celui-ci, où les conditions familiales et politiques devinrent particulièrement troublées, Frédégonde se plaçant sous la protection de son beau-frère Gontran et s’efforçant de protéger son seul fils survivant, le futur Clotaire II. La qualité relative du mobilier funéraire d’Arégonde (voir ci-dessous), avec des objets d’apparat, mais usés ou dépareillés, pourrait plaider en faveur de funérailles postérieures à la mort de son fils Chilpéric.
On ne sait pas non plus quels motifs présidèrent au choix de la basilique de Saint-Denis pour la sépulture d’Arégonde. En effet, si Clotaire Ier (+ 561), puis son fils Sigebert Ier furent enterrés à Saint-Médard de Sois-sons, c’est dans la basilique Sainte-Croix-et-Saint-Vin-cent de Paris (Saint-Germain-des-Près), fondée par son oncle Childebert Ier (+ 558), que devait être enterré Chil-péric Ier (+ 584). C’est là que devaient reposer par la suite Frédégonde (+ 597) et peut-être son fils Thierry, ainsi que Clovis et Mérovée, que Clotaire avait eus d’Audovère, puis plus tard Clotaire II (+ 629), fils de Chilpéric et de Frédégonde, et son épouse Bertrude. Pourtant, c’est à Saint-Denis que le petit Dagobert, fils de Clotaire et de Frédégonde et petit-fils d’Arégonde, mort de la dysenterie à la villa de Berny en 580, reçut sa sépulture, de même qu’Arégonde. Cette coïncidence, alors que la basilique de Saint-Denis n’allait apparem-ment plus recevoir de sépultures de la famille royale mérovingienne avant celles de Dagobert Ier (639) et de Clovis II (+ 657), ne fut sans doute pas fortuite. Il est ainsi tentant d’envisager qu’Arégonde ait pu prendre elle-même en charge les funérailles de son petit-fils, alors que Chilpéric, touché par la même maladie, était en convalescence et que son fils Chlodobert, qu’il avait eu de Frédégonde, agonisait dans le même temps, à moins qu’on ait choisi d’enterrer l’enfant près d’une grand-mère qui le chérissait. En tout cas, il est probable qu’Arégonde, de même que d’autres membres de l’aris-tocratie mérovingienne, ait eu une dévotion particulière pour saint Denis. L’importance de son culte est alors considérable, comme en témoigne un fait divers san-glant, rapporté par Grégoire de Tours et mêlant des “ hommes de haute naissance ” de Paris à l’occasion d’un plaid tenu dans la basilique de Saint-Denis121. D’autre part, comme on peut l’établir, même si les données anthropo-archéologiques sont de médiocre qualité, le recrutement de la population inhumée dans la basilique Saint-Denis apparaît majoritairement féminin122. C’est ce qui nous a conduit à envisager qu’à l’image de sainte Geneviève, des femmes de l’aristocratie mérovingienne de Paris aient pu avoir une même dévotion pour saint Denis et souhaiter reposer au plus près de son tombeau. À en juger par au moins deux tombes féminines (nos 23 et 50)123, cette tradition possible était sans doute déjà établie dès la seconde moitié du Ve siècle et les années 500.
Une dernière réflexion doit porter sur la qualité même du mobilier funéraire d’Arégonde, dont deux constituants,
La tombe d’Arégonde. Nouvelles analyses en laboratoire de la défunte du sarcophage 49 de la basilique de Saint-Denis 201
la garniture de ceinture et la grande épingle, sont des créations tout à fait originales et pour l’instant isolées. Michel Fleury et Albert France-Lanord avaient en effet déjà noté l’usure de plusieurs des objets de parure (bou-cles d’oreille, fibules, revers des grands ferrets), ainsi que les “ grossières réparations ” au revers de la garniture de ceinture, dont des grenats, sans doute perdus, avaient été remplacés par des verres de diverses couleurs. Les examens complémentaires auxquels nous nous sommes livrés confirment et complètent ces observations : c’est ainsi que le grand ferret B et les garnitures de chaussure présentent également de nettes traces d’usures, et que les polyèdres de la grande épingle avaient déjà perdu plusieurs de leurs grenats quand ils ont fait partie du mobilier funéraire de la défunte. D’autre part, comme on l’a vu, celle-ci portait trois “ fausses paires ” d’objets, en l’occurrence les boucles d’oreille, les fibules discoï-des et les grands ferrets, avec sans doute le remplace-ment d’objets cassés ou perdus dans le cas des boucles d’oreille et des ferrets. S’il n’est pas possible de juger de la qualité – mais elle fut sans doute grande comme les études sur les restes textiles le suggèrent – des vête-ments dont Arégonde était revêtue lors de ses funérailles, il est indéniable que plusieurs des bijoux et accessoires vestimentaires qui la paraient étaient passablement usés, ce qui ne pose pas en soi de problème pour des objets beaucoup portés, mais surtout dépareillés pour plusieurs,
ou témoignant de réparations ou au contraire de lacunes (grenats manquants).
Il est loisible de s’en étonner si l’on se réfère aux véritables “ trésors ” d’orfèvrerie (au même titre que les vêtements faits d’étoffes précieuses) que Grégoire de Tours prête à plusieurs reprises à la famille royale méro-vingienne124 et qui suggèrent qu’Arégonde ait naturel-lement possédé bien d’autres objets précieux que ceux avec lesquels elle fut enterrée. En tout cas, il est possi-ble que celle-ci, peut-être par “ économie ” de la part de ceux qui l’inhumèrent125, ait été parée d’objets large-ment portés et usagés, mais qui pouvaient faire illusion de loin, lors de l’instant fugitif des funérailles. En l’état actuel de la documentation archéologique sur les fouilles de la basilique de Saint-Denis, on est incapable de véri-fier si d’autres tombes – toutes à l’évidence moins bien dotées que celle d’Arégonde – pourraient corroborer une telle éventualité126. De même, dans l’ignorance de la date de décès d’Arégonde, on ne peut cependant man-quer de se demander si la qualité de son mobilier funé-raire aurait été la même selon que ses funérailles aient été conduites par son fils Chilpéric ou au contraire opé-rées après sa mort en 584. Mais une autre explication est peut-être tout simplement qu’Arégonde ait choisi de se faire enterrer avec des objets qu’elle avait beaucoup porté et qui lui étaient particulièrement chers.
NotEs
1. SALIN 1957 et 1958.2. FLEURY 1979 ; FLEURY et FRANCE-LANORD 1998.3. Sur la chronologie des églises primitives, voir PERIN 1992b et PERIN et WYSS 2004. Le sarcophage d’Arégonde ne pouvant de toute évidence être fouillé sur place, du fait de la configuration des lieux (en 1959, la crypte archéologique n’était pas encore construite et la zone de fouille était encombrée d’une forêt d’étais soutenant le sol de la basilique, Fig. 2a), Michel Fleury et Albert France-Lanord optèrent pour des pré-lèvements effectués à l’aide de tôles d’aluminium glissées sous le “ magma de restes organiques ”, puis transférés à Nancy pour être radio-graphiés et fouillés en laboratoire (en l’occurrence le laboratoire person-nel d’Albert France-Lanord) (voir ci-dessous fig. 26). À coup sûr inno-vante pour l’époque, cette technique n’était pas en fait totalement satisfaisante puisque les prélèvements ne pouvaient concerner la totalité du “ magma ”, mais certaines zones choisies et découpées. De plus, le glissement des tôles sous le “ magma ” n’était pas aisé, du fait des aspé-rités du fond de la cuve du sarcophage, et était susceptible de provoquer de légers déplacements au sein des prélèvements. Michel Fleury et Albert France-Lanord ont également noté qu’avant les prélèvements ils avaient “ retiré un certain nombre d’objets ou de bijoux dont la présence était immédiatement décelable ”. FLEURY et FRANCE-LANORD 1979, p. 66 et ss.4. GRÉGOIRE DE TOURS, IV, 3, p. 136-137.5. FLEURY 1963 a et b.6. Notamment GAUERT 1972.7. ALFÖLDI 1963 ; WILSON 1964 ;AMENT 1965 ; WERNER 1967/1968.8. ROTH 1986. Ce fut également le cas de Helie ROOSENS, Directeur du Service national des Fouilles de Belgique (ses courriers à P. P. en date des 5 et 25 avril 1982).9. FLEURY et FRANCE-LANORD 1961.10. FRANCE-LANORD et FLEURY 1962.11. FLEURY et FRANCE-LANORD1979.12. FLEURY et FRANCE-LANORD 1998.13. SALIN 1957 et 1958.14. FLEURY 1958 et 1979 ; Gallia, t. 17, 2, 1959, p. 271.
15. Notamment, en ce qui concerne les fouilles menées par Édouard Salin en 1953/1954, les céramiques gallo-romaines des tombes 1 et 2, l’anneau bouleté de bronze de la tombe 6, la rouelle de bronze de la “ tombe du narthex ” ; pour les fouilles de 1957, les galons en fils d’or de la tombe 4, l’éperon de fer de la tombe 9, les garnitures de chaussures en “ laiton doré ”, les forces et l’éperon de la tombe 13, la boucle de ceinture, le couteau pliant et l’éperon de la tombe 18, la céramique gallo-romaine de la tombe 19, les appliques de coffret en os découverts près de la tombe 28. En ce qui concerne les fouilles menées par Michel Fleury de 1957 aux années 70, outre la plaque-boucle de bronze de la tombe 28 et le flacon de verre de la tombe d’Arégonde (n° 49), la quasi-totalité des restes organiques à caractère vestimentaire (notamment ceux des tombes 49 et 50, objet d’études approfondies par Albert France-Lanord), signalés dans les publications, faisaient également défaut, de même que les restes osseux humains, dont le squelette d’Arégonde. En revanche, la plupart des galons en fils d’or, prélevés et remontés sur des supports, faisaient partie de l’ensemble du matériel archéologique transféré au MAN après le décès d’Albert France-Lanord.16. FLEURY et FRANCE-LANORD 1998, p. 152-164.17. Coordonné par Françoise Vallet et Patrick Périn (MAN) et par Tho-mas Calligaro (C2RMF), ce catalogue bénéficiera d’un certain nombres de contributions, notamment dues à Antoinette Rast-Eicher (textiles), Jean-Paul Poirot (gemmologie), Luc Buchet, Yves Darton, Véronique Gallien et Claude Rücker (anthropologie), Jean-Jacques Cassiman (ADN), etc.18. L’ouvrage ne comporte pas d’étude typochronologique du matériel archéologique, sinon une série très incomplète de références bibliogra-phiques, souvent mal citées, qui correspondent à des datations dans l’ensemble peu fiables (FLEURY et FRANCE-LANORD 1998, p. 261-268).19. FLEURY 1979, p. 89-90 ; FLEURY et FRANCE-LANORD 1998, p. 177-183.20. PERIN 1991a.21. Voir notamment ROTH 1986.22. GAUERT 1972 ; ROTH 1986 ; Héli ROOSENS, cf. note 8.23. PERIN 1991a, p. 36 et ss.
202 ANTIQUITÉS NATIONALES, 37, 2005 : 181-206.
24. THILLAUD 1993.25. Note inédite adressée à P. P. (septembre 1993).26. GALLIEN 1992.27. OLIVIER et AARON 1978 ; VIGNAL 1998.28. Ce chiffre, qu’il est difficile d’établir avec exactitude, ne tient pas compte des tombes gallo-romaines, en sarcophage ou en cercueil, au nombre d’une vingtaine, ni de quelques sépultures médiévales ou non datées. Ajoutons que ce calcul n’est pas aisé, notamment en ce qui concerne les fouilles de Michel Fleury, du fait de numéros de tombes non utilisés ou affectant des structures non funéraires, sans compter le recours, vers la fin des fouilles, à des lettres dotées d’un exposant et qui n’ont pas toutes été utilisées ou ont pu correspondre à des numéros de tombes.29. Tombes 9, 13 et 18 des fouilles d’E. Salin en 1957, avec des éperons en fer. Tombe 11 des fouilles de M. Fleury avec un adolescent doté d’un scramasaxe.30. Tombes 3, 6 et 8 des fouilles d’E. Salin en 1953-1954. Tombes 16, 23 et 32 des fouilles de 1957. Tombes 13, 14, 28B, 38, 42, 47 à 50 et 62-63 des fouilles de M. Fleury.31. Tombes 9, 28A, 36, 37, 41, 44, 60, 61, A7, A9, A10 des fouilles de M. Fleury.32. Tombes 9 et 18 des fouilles d’E. Salin en 1957.33. Tombes 6 des fouilles d’E. Salin en 1953/1954. Tombes 16 et 32 des fouilles d’E. Salin en 1957. Tombes 14, 28B, 38, 42, 47-50, 62 et 63 des fouilles de M. Fleury.34. Tombes 1, 2, 4, 22, 27, 35 des fouilles d’E. Salin en 1957. Tombes 9, 37, 41, 60, 61, A9 et A10 des fouilles de M. Fleury.35. Voir par exemple, parmi d’autres, les tombes masculines de Famars (Nord) (LEMAN et BEAUSSARD 1978) ou encore de Metzervisse (Moselle), tombe 3006 (publication en cours par R. LANSIVAL). On peut encore ajouter les exemples des tombes masculines de Straubing-Alburg (MOESLEIN 2005 ; BARTEL 2005) et de Groshoebing, tombe 143 (BARTEL et NADLER 2005).36. En réalité, le nombre élevé de sépultures partiellement ou totalement violées (une sur deux), soit anciennement, soit à l’occasion des travaux de Viollet le Duc ou de Formigé dans la “ crypte impériale ” interdit toute statistique sûre des déterminations sexuelles des inhumés par leur mobi-lier funéraire. De plus, comme nous l’avait dit Aimé Thouvenin, qui exécutait les fouilles pour Édouard Salin, et ainsi que le signale à plu-sieurs reprises Michel Fleury, un certain nombre de sarcophages avaient été dégagés, voire même ouverts avant leur fouille. On peut y trouver l’explication de mobiliers funéraires curieusement incomplets, même quand les sarcophages n’avaient apparemment pas été violés (30 % des tombes tout ou partie violées renfermaient encore du mobilier, dont 16 % avec la présence de fils d’or, 5 % de ces tombes ne contenant plus que des fils d’or).37. Exception faite d’Arégonde, seuls deux rois mérovingiens ont été enterrés à Saint-Denis : Dagobert Ier (+ 639) et son fils Clovis II (+ 657), auxquels il convient d’ajouter Pépin le Bref (+ 768), au seuil de l’époque carolingienne.38. Les résultats exposés sont tirés des analyses effectuées au C2RMF depuis 2000 par Thomas Calligaro, ingénieur, dans le cadre du pro-gramme “ grenats ”.39. Ce programme ayant été encouragé et soutenu par Jean-Pierre MOHEN, alors directeur du C2RMF.40. CALLIGARO et al. 2001, p. 41-48.41. FRANCE-LANORD et FLEURY 1962, p. 348-350 et 355 ; FLEURY 1979, p. 33 et 35-36 ; FLEURY et FRANCE-LANORD 1998, p. II-135-141.42. FRANCE-LANORD et FLEURY 1962, p. 348 ; FLEURY 1979, p. 32-33 ; FLEURY et FRANCE-LANORD 1998, p. 149.43. La vie mystérieuse des chefs d’œuvre… 1980, p. 111-120.44. Ibid., p. 115-116. Malheureusement, le catalogue ne précise pas ces compositions objet par objet.45. Cf. note 41.46. La vie mystérieuse des chefs d’œuvre… 1980, p. 118.47. Ibid., p. 118. Nous pensons en fait que ces deux ferrets n’ont pu être directement réalisés par ciselure d’une plaque d’argent, mais sont venus de fonderie, de même que les paires de fibules ansées asymétriques en argent ou en bronze si courantes dans la moitié nord de la Gaule au VIe siècle. Cf. KOCH 1998.48. DRAN 2000, p. 135-16649. PERIN 1991a, p. 26. La fin du VIe siècle voit entre Seine et Rhin et dans le sud-ouest de l’Allemagne la disparition de la mode “ germanique ” classique du port de deux paires de fibules, les unes ansées asymétriques à la taille et les autres rondes ou zoomorphes au cou. C’est alors que s’impose progressivement la mode “ méditerranéenne ”, avec le port d’une seule fibule circulaire au cou, caractéristique des trois premiers
quarts du VIIe siècle : CLAUSS 1987 ; SCHULZE 1976. Les fibules discoïdes cloisonnées de la tombe d’Arégonde appartiennent au type H3 de K. Vielitz, dont la durée de vie est courte (v. 580/v. 600) : VIELITZ 2003, p. 50 et ss, p. 80 et ss., p. 94 et carte de répartition p. 89.50. Ce type de boucles d’oreille, d’origine italo-byzantine, n’était pas alors commun en Gaule mérovingienne : voir FINGERLIN 1974.51. Avec 93,5 % d’argent, 4,5 % de cuivre, 0,6 % de plomb et 0,8 % d’or (La vie mystérieuse… 1980, p. 46).52. FRANCE-LANORD et FLEURY 1962, p. 348. Voir également FLEURY et FRANCE-LANORD 1979, p. 32-33, et 1998, p. II-149.53. Avec en l’occurrence le recours à une matrice destinée à réaliser des positifs secondaires en cire portant l’ébauche du décor, repris ensuite avant fonte à la cire perdue : voir PERIN 1985, p. 766 et ss.54. KOCH 1998.55. Rappelons que la radiographie a révélé une fissure à la base du ferret B, fragilisé.56. Il s’agit des bagues de Louviers (Eure) et de Saint-Dizier (Haute-Marne).57. Musée du Louvre, Antiquités grecques, romaines et étrusques, inv. Bj 1261 et 2374 ; une troisième bague d’origine byzantine provient d’une collection privée, de même que la bague lombarde.58. La vie mystérieuse… 1980, p. 117.59. Ces compositions ne doivent pas surprendre et d’ailleurs se retrou-vent sur les tôles d’or ornant la garniture de ceinture d’Arégonde, ainsi que sur celles d’autres fibules. Il est ici clair que ce type d’alliage riche en argent a été préféré pour la réalisation de ces fines tôles d’or, plus faciles à façonner et de meilleure tenue mécanique.60. Von FREEDEN 1980.61. ADAMS 2000, p. 19, fig. 1, p. 55 et Pl. II, 4, p. 57. Nous remercions vivement Michel Kazanski (CNRS) de nous avoir signalé ce parallèle.62. Un autre exemple, célèbre, de remploi d’une pièce d’orfèvrerie anti-que relevant de la même technique (classe II de Adams) est celui de la plaque de pectoral en or serti de grenats découverte dans la tombe d’homme de Wolfsheim, non loin de Mayence, avec au revers l’inscrip-tion Artachschatar, identifiée au nom du roi perse Ardashir Ier, mort en 241 : L’Or des princes barbares… 2000, p. 130 et ss.63. La radiographie a permis de vérifier que ce polyèdre ne comportait pas de structure interne et n’avait apparemment jamais été solidaire de la tige de l’épingle qui le traverse (il est aujourd’hui mobile et n’est maintenu que par les manchons adjacents en tôle d’or qui gainent l’épin-gle en argent).64. Sans doute déjà des grenats : cf. note 61.65. La vie mystérieuse… 1980, p. 115.66. Les protocoles des restauration qu’Albert France-Lanord n’avait pas manqué de rédiger nous manquent à nouveau cruellement à propos de ces choix de restauration successifs. Les photographies publiées de la garniture de ceinture, démontée et avant restauration, ne permettent pas de décider de la position originelle de chacune des dix bossettes, non identifiables : FLEURY et FRANCE-LANORD 1979, p. 78 ; FLEURY et FRANCE-LANORD 1998, p. 151.67. FLEURY et FRANCE-LANORD 1979, p. 59. La vie mystérieuse des chefs d’œuvre… 1980, p. 11268. Malgré des observations macroscopiques, il n’a pas été possible de déterminer si le décor des bossettes à quatre peltes était estampé (des traces répétitives n’ont pas été mises en évidence), repoussé, voire venu de fonderie. L’une des bossettes à décor de la contre-plaque étant endom-magée et portant une sorte d’incision en π.69. FRANCE-LANORD et FLEURY 1962, pl. 32.70. FLEURY et FRANCE-LANORD 1998, p. II-138. Ajoutons que sur une photographie d’archive de la Commission du Vieux-Paris (un “ plan-film ” noir et blanc des années 70), la contre-plaque porte deux bossettes lisses qui ne sont pas voisines, à la différence du cliché couleur publié en 1998.71. FLEURY et FRANCE-LANORD 1998, p. II-148.72. Les résultats ici présentés ont été obtenus par Thomas CALLIGARO (C2RMF) et doivent faire prochainement l’objet d’une publication exhaustive CALLIGARO, PERIN, VALLET et POIROT, à paraître dans Antiquités nationales t. 38, 2006.73. CALLIGARO et al. 2002, p. 320-327.74. Nos plus vifs remerciements s’adressent en particulier à Jean-Luc BOUDARTCHOUK : objets de l’Isle-Jourdain (Gers), Cabaret (Aude), Tabariane (Ariège) et du musée Saint-Raymond de Toulouse ; à Florence CARRE : objets de Louviers (Eure) ; à Michel CHOSSENOT : objet de Francheville (Marne) ; à René LEGOUX : objets de Cutry (Meurthe-et-Moselle) ; à Françoise STUTZ : objets de Chasseneuil-sur-Bonnière (Cha-rentes) et Sergeac (Dordogne) ; à Pascal ROHMER: objets d’Erstein (Bas-Rhin) ; à Marie-Cécile TRUC : objets de Saint-Dizier (Haute-Marne).75. À fin septembre 2006.
La tombe d’Arégonde. Nouvelles analyses en laboratoire de la défunte du sarcophage 49 de la basilique de Saint-Denis 203
76. Von FREEDEN 2000, p. 119 et ss. L’auteur explique ce phénomène par des raisons géopolitiques, les Byzantins ayant perdu en 570, sous le règne de Khusro Ier (531-579), le contrôle de la mer Rouge et du com-merce international. En effet, le Yémen devient alors un état vassal des Sassanides après l’expulsion des Ethiopiens, alliés de Byzance. Voir également : Les Perses sassanides. Fastes d’un empire oublié (224-642), cat. d’exposition du musée Cernuschi, Paris-Musées, 2006, p. 26.77. Cf. note 49.78. S’y ajoutent les sept perles de verre bleu en bâte qui complètent l’ornementation de chaque plaque.79. Cette tâche a été effectuée par Cristina Concalvès (Service archéo-logique départemental de la Seine-Saint-Denis). Les contenants, de nature très diverse (en général des boîtes de récupération), portaient toutes des indications de provenance renvoyant à la liste complexe des tombes fouillées par Michel Fleury (FLEURY et FRANCE-LANORD 1979), où des numéros doublent ceux des fouilles d’Édouard Salin, d’autres n’étant pas utilisés ou bénéficiant d’un autre système de réfé-rence (“ point A ”, etc.).80. Archeo Tex, Büro für archäologische Textilien, Ennenda, Suisse.81. Une seconde campagne d’étude portera en 2007 sur les restes orga-niques provenant des autres tombes de la basilique de Saint-Denis.82. FLEURY et FRANCE-LANORD 1979, p. 38-39, et 1998, p. II-132 et 133.83. Id.84. EWIG 1991, p. 55-56.85. Ibid.86. PERIN 1991a.87. ROTH 1986 ; MARTIN 1991 ; PERIN 1991.88. Nous utilisons désormais les notions de Mérovingien ancien (ma 1-3) et de Mérovingien récent (mR 1-3), qui correspondent aux niveaux AM 1-3 et JM 1-3 de la classification chronologique de Hermann Ament : cf. LEGOUX, PERIN et VALLET 2006.89. FINGERLIN 1974 : de PIREY 1988, type 523.90. VIELITZ 2003, p. 53-54.91. PERIN 1991a, p. 27-28.92. Von FREEDEN 2000, p. 119 et ss.93. La fixation des plaques au cuir de la ceinture n’était pas assurée par des tenons à œillets, comme pour les exemplaires de bronze, le cuir étant serti par des rivets entre la résille en argent et la platine sous-jacente en tôle de bronze, celle-ci supportant les feuilles d’or insérées dans la cloi-son de la résille.94. MARTIN 1991, p. 58-59.95. LORREN 2001, pl. XXVIII-XXXIII ; FREY 2006, p. 44-59.96. FLEURY et FRANCE-LANORD 1998, p. II-142.97. LORREN 2001, p. 203 et ss.98. ROTH 1986, p. 274 ; MARTIN 1991, p. 45 ; FREY 2006, p. 33.99. LERENTER 1991, type G2, vol. 1, p. 61. Nous préférons citer la thèse inédite de S. LERENTER et non son article paru en 1991, qui correspond à un état antérieur de ses recherches : LERENTER (Sophie), “ Nouvelle approche typologique des plaques-boucles mérovingiennes en bronze de type aquitain ”, dans PERIN (Patrick), éd., Gallo-Romains, Wisigoths et Francs en Aquitaine, Septimanie et Espagne, Fléville, Association française d’Archéologie mérovingienne, 1991, p. 225 et ss. (Actes des VIIes Journées internationales d’Archéologie mérovingienne, Toulouse, 1985).
100. LEGOUX (René), “ Plaque-boucle mérovingienne à figuration humaine d’Avrechy (Oise) ”, dans Revue archéologique de l’Oise, 1975, n° 5, p. 22.101. LORREN 2001, pl. XL et XLI .102. BOULANGER 1902-1905, p. 179, fig. H, I et K.103. De tels chefs d’animaux, souvent affrontés à des têtes de sangliers bien reconnaissables à leur défense, sont habituellement interprétés comme ceux de rapaces, sans qu’on puisse conclure de façon définitive. En effet, des exemples montrent que dans plusieurs cas il s’agit en fait de têtes de chevaux. Cf. par exemple les ferrets provenant des tombes de Saint-Denis pillées en 1973 : FLEURY et FRANCE-LANORD 1998, p. II-237.104. SALIN 1904.105. FLEURY et FRANCE-LANORD 1998, p. II-7.106. AUFLEGER 1997, pl. 78.107. LERENTER 1991.108. THIEME 1978, Groupe I, 1, p. 412 et ss. Voir également LEGOUX 2005, t. 921, p. 332.109. LEGOUX, PERIN et VALLET 2006, type 138.110. SALIN 1904 ; ROTH 1986.111. Nous remercions vivement René Legoux de nous avoir signalé les garnitures de chaussure inédites de Goudelancourt-lès-Pierrepont (Aisne), tombes 63 et 248B, exposées au musée des Temps barbares de Marle (Aisne) et issues des fouilles d’Alain Nice.112. LEGOUX, PERIN et VALLET 2006, types 188 ou 190.113. ROTH 1973 et 1986. L’un des critères du “ style animalier II évo-lué ” est l’intégration dans l’entrelacs des têtes animales stylisées qui en mordent les brins, alors que jusqu’alors elles demeuraient à la périphérie de l’entrelacs.114. FEYEUX 2003, p. 51 et ss. Les meilleurs parallèles sont les exem-plaires 47, 51 et 54.115. C’est ce que, parallèlement à André Dasnoy qui proposait les années 580/590 (DASNOY 1986, p. 44 et ss.) et Max Martin avec vers 580 (MARTIN 1991, p. 82), nous avions déjà proposé en 1991 les années 590/600 (PERIN 1991, p. 50).116. PERIN 1980 ; PERIN 1998 ; LEGOUX, PERIN, et VALLET 2006.117. GRÉGOIRE DE TOURS IV, 3.118. Ibid. IV, 28 et VI, 34.119. Ibid. III, 4-7 ; VI, 29, 34 ; VII, 36 ; IX, 2 ;120. Voir KRÜGER 1971 pour les lieux de sépultures connus des rois mérovingiens, de leurs épouses et de leurs enfants.121. GRÉGOIRE de TOURS, V, 32.122. Cf. p. 3 et ss.123. FLEURY et FRANCE-LANORD 1998, p. II-271 et ss., et II-161 et ss.124. GRÉGOIRE de TOURS, VI, 35 et 45, par exemple.125. Voire les inquiétudes de Chilpéric quand Frédégonde dote Rigon-the de biens dont il est pourtant dit qu’ils lui appartenaient en propre : GRÉGOIRE de TOURS, VI, 45.126. Si la présence d’objets usagés ou réparés n’est pas rare dans les cimetières ruraux de l’époque mérovingienne, on a néanmoins l’impres-sion d’un soin particulier apporté au mobilier funéraire, qu’il s’agisse des armes ou des objets de parure et accessoires vestimentaires, suffi-samment attractifs pour qu’ils aient été à l’origine de nombreux pillages contemporains.
aNNExE
DétERmiNatioN DE L’âGE D’aRéGoNDE, éPoUsE DE cLotaiRE ier, PaR La méthoDE DEs aNNEaUx cémENtaiREs
DR CLAUDE RÜCKER (CNRS, CEPAM, SOPHIA-ANTIPOLIS)
Méthode des anneaux cémentaires
Cette méthode est basée sur le décompte du nombre de couches de cément déposées sur la surface radiculaire des dents, augmenté de l’âge d’apparition sur l’arcade de la dent examinée. Cet âge d’apparition est, chez
l’homme actuel, relativement constant pour chaque dent. Un certain nombre de tables de correspondances a été établi par plusieurs auteurs dans le but de chiffrer les variations d’apparition sur l’arcade de chaque dent, ainsi qu’une évaluation pour chaque dent des écarts possibles par rapport à cet âge de référence.
204 ANTIQUITÉS NATIONALES, 37, 2005 : 181-206.
Application à la mandibule d’Arégonde
Dans le cas d’Arégonde, la dent choisie a été la canine mandibulaire gauche (33). Ce choix a été motivé par un bon état apparent de la racine de cette dent. Le fait que les dents maxillaires étaient absentes, que les autres dents présentes montraient une dégradation des zones cervicales des racines (post ou ante mortem), ou que les diamètres réduits des racines incisives pouvaient engendrer des perturbations pour une bonne observation des couches cémentaires, a également fixé ce choix.
Après avoir extrait la canine de son alvéole et l’avoir soigneusement débarrassée des couches de vernis qui la recouvraient, il a été procédé à une prise d’empreinte de la racine au moyen d’un silicone à usage dentaire. Il a ensuite été procédé à un enrobement de la racine par une résine époxy. Une série de coupes de 100μ perpen-diculaires à l’axe de la racine a été réalisée avec une scie Buehler à basse vitesse. Quatre coupes ont donné lieu à une suite d’observations (9 par coupe), soit un total de 36 observations. Le chiffre le plus fréquent obtenu a été de 44 (9 ×) suivi de 42 (6 ×).
Les tables de Quatrehomme, de Parner et de l’école de Louvain ont été appliquées et ont permis de chiffrer l’âge d’Arégonde à 54 ans plus ou moins trois ans. Pour cela, il a été ajouté au chiffre 44 (nombre d’anneaux cémentaires le plus souvent relevé dans les différentes coupes) l’âge moyen d’émergence sur l’arcade de la canine mandibulaire.
La formule établie par U. Wittwer-Backofen (WITTWER-BACKOFEN, GAMPE et VAUPEL, 2003) est Yij = Cij + μη, où Yij est l’âge TCA/Tooth Cemental Annulation (selon la méthode des anneaux cémentaires) du sujet étudié, cij le nombre d’anneaux cémentaires, et μη l’âge d’émergence de la dent servant de base de décompte. Cet âge d’émergence est établi en fonction de tables de références qui font état d’une possibilité de variation de x années selon les auteurs des tables.
Résultats
Dans le cas de la denture soumise à examen, il convient de noter que la déhiscence osseuse du rempart alvéolaire vestibulaire pourrait induire une sous-estima-tion de l’âge de 44 + 10 +/- 3 ans, en raison d’un nombre d’anneaux cémentaires plus réduit vers la zone cervi-cale. Si les coupes plus apicales sont seules prises en considération, 44 reste le chiffre le plus fréquent, mais avec une tendance plus marquée vers le haut (48 ou même 50) selon la région considérée (zones linguales et proximales où le tissu alvéolaire est moins résorbé). Cet aspect de la question pourrait faire tendre l’âge réel du sujet vers 50 + 10 = 60 +/- 3 ans.
En raison de la possibilité d’une incertitude d’éva-luation de l’âge de ce sujet, identifié comme Arégonde, il a été procédé à une observation sur la dent 42. Mal-heureusement l’état de la dentine et des couches cémen-taires de cette dent étant profondément détérioré, il a été procédé à deux autres coupes sur la dent 33. Ces coupes viennent confirmer la tendance décrite plus haut. En ne prenant en compte que les coupes 3-4-5 et 6, le chiffre le plus souvent obtenu passe à 51 auquel, selon la for-mule utilisée dans la méthode TCA, il apparaît que l’âge du sujet serait de 61 +/- 3 ans, toujours selon les tables utilisées.
Il convient d’observer que selon les chiffres obtenus à l’examen de ces quatre dernières coupes, l’âge de ce sujet peut être évalué au minimum à 51 ans et au maximum à 64 ans, avec une très forte probabilité à 61 ans. Ce résultat reste également lié à l’évolution éventuelle de la méthode utilisée en fonction des connaissances sur les conditions de formation des anneaux cémentaires.
Après avoir reconstitué la racine de la dent 33, celle-ci comme la dent 42 a été remise en place sur l’arcade grâce à l’empreinte préalablement réalisée.
BiBLioGRaPhiE
ADAMS N. (2000) – “ The development of early garnet inlaid orna-ments ”, dans BALINT (Csanad), dir., Kontakte zwischen Iran, Byzanz und der Steppe im 6.-7. Jahrhundert, Budapest-Naples-Rome (Varia Archaelogica Hungarica, X), p. 13-70.
ALFÖLDI M. R. (1963) – “ Zum Ring der Königin Arnegunde ”, dans Germania, 41, p. 56 et ss.
AMENT H. (1965) – “ Zum Ring der Königin Arnegundis ”, dans Germania 43, 2, p. 324-327.
AUFLEGER M. (1997) – Tierdarstellungen in der Kleinkunst der Merowingerzeit im westlichen Frankenreich, Mayence (Archäo-logische Schriften des Instituts für Vor- und Frühgeschichte der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Bd. 6).
BARTEL A. (2005) – “ Die Goldbänder des Herrn aus Straubing-Alburg. Untersuchungen einer Beinbekleidung aus dem frühen Mittelalter ”, dans Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege, 43/44, 2002/2003, p. 261-272.
BARTEL A., NADLER M. (2005) – “ Der Prachtmantel des Fürsten von Höbing. Textilarchäologie Untersuchungen zum Fürstengrab 143 von Grosshöbing ”, dans Bericht der Bayerischen Bodenden-kmalpflege, 43/44, 2002/2003, p. 229- 249.
BOULANGER C. (1902-1905) – Le mobilier funéraire gallo-romain et franc en Picardie et en Artois, Paris.
CALLIGARO T., DRAN J.-C., DUBUS M., MOIGNARD B., PICHON L., SALOMON J., WALTER P. (2001) – “ Les objets de musée sous le projecteur d’AGLAE ”, Techne, 13/14, p. 41-48.
CALLIGARO T., COLINART S., POIROT J.-P., SUDRES C. (2002) – “ Combined external-beam PIXE and µ-Raman charac-terisation of garnets in Merovingian jewellery ”, Nuclear Instru-ments and Methods in Physics Research section B189, p. 320-327.
CALLIGARO T., PERIN P., VALLET F., POIROT J.-P. (2006) – “ Nouvelles analyses gemmologiques et géochimiques effectuées
La tombe d’Arégonde. Nouvelles analyses en laboratoire de la défunte du sarcophage 49 de la basilique de Saint-Denis 205
au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (basilique de Saint-Denis et autres collections du musée d’Archéo-logie nationale, ainsi que diverses collections publiques et objets de fouilles récentes) ”, à paraître dans Antiquités nationales, 38.
CLAUSS G. (1987) – “ Die Tragsitte von Bügelfibeln. Eine Unter-suchung zur Frauentracht im Frühen Mittelalter ”, dans Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, t. 34, 2, Mayence, p. 491-603.
DRAN J.-C., CALLIGARO T., SALOMON J. (2000) – “ Particle Induced X-ray Emission ” in Modern Analytical Methods in Art and Achaeology, Vol. 155, E. Ciliberto and G. Spoto ed., John Wiley, New York, p. 135-166.
EWIG E. (1974) – “ Studien zur merowingischen Dynastie ”, dans Frühmittelalterliche Studien, 8, p. 15-59.
EWIG E. (1991) – “ Die Namengebung bei den ältesten Frankenkö-nigen und im merowingischen Königshaus ”, dans Francia, 18, 1, p. 21-69.
FEYEUX J.-Y. (2003) – Le verre mérovingien du quart nord-est de la France, Paris, De Boccard (Collections de l’Université Marc Bloch, Strasbourg. Études d’archéologie et d’histoire ancienne).
FINGERLIN G. (1974) – “ Imitationsformen byzantinischer Körb-chen-Ohringe nördlich der Alpen ”, dans Fundberichte aus Baden-Württemberg, 1, p. 597-627.
FLEURY M. (1958) – “ Nouvelle campagne de fouilles de sépultu-res de la basilique de Saint-Denis (mars 1957-mai 1958) ”, dans Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, p. 137-150.
FLEURY M. (1963a) – “ L’anneau sigillaire de la reine Arnégonde, femme de Clotaire Ier ”, dans Annexe aux Procès-verbaux de la Commission municipale du Vieux Paris (séance du 11 février 1963), Paris, p. 5-14.
FLEURY M. (1963b) – “ L’anneau sigillaire d’Arégonde, femme de Clotaire Ier, découvert à Saint-Denis, dans Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France (séance du 20 février 1963), p. 34-42.
FLEURY M., FRANCE-LANORD A. (1979) – “ Bijoux et parures d’Arégonde ”, Dossiers de l’Archéologie, n° 32, janvier-février 1979.
FLEURY M., FRANCE-LANORD A. (1984) – “ Les sépultures mérovingiennes de la basilique de Saint-Denis. Sarcophage n° 50 ”, dans Cahiers de la Rotonde, 7, p. 37-69.
FLEURY M., FRANCE-LANORD A. (1998) – Les trésors méro-vingiens de la basilique de Saint-Denis, Woippy, Klopp.
FRANCE-LANORD A., FLEURY M. (1961) – “ Les bijoux méro-vingiens d’Arnégonde ”, dans Art de France, 1, p. 7-18.
FRANCE-LANORD A., FLEURY M. (1962) – “ Das Grab der Arne-gundis in Saint-Denis ”, dans Germania, 40, 2, p. 341- 359.
FREEDEN Von U. (1980) – “ Untersuchungen zu merowingerzeitli-chen Ohrringen bei den Alamannen ”, dans Bericht der römisch-germanischen Kommission, bd. 60, 1979 (Mayence), p. 231-441.
FREEDEN Von U. (2000) – “ Das Ende engzelligen Cloisonnés und die Eroberung Südarabiens durch die Sasaniden ”, Germania 78, p. 97-124.
FREY A. (2006) – Gürtelschnallen westlicher Herkunft im östlichen Frankenreich. Untersuchungen zum Westimport im 6. Und 7. Jah-rhundert, Mayence (Monographien des Römisch-Germanischen Zentralsmuseums, Bd. 66).
GALLIEN V. (1992) – “ Deux populations du haut Moyen Âge à Saint-Denis ”. Archéologie et anthropologie, Université de Paris IV (thèse de doctorat inédite).
GAUERT A. (1972) – “ Der Ring der Königin Arnegundis aus Saint-Denis ”, dans Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburts-tag, 3, Göttingen, p. 328-347.
GRÉGOIRE DE TOURS – Libri historiarum decem, éd. Br. KRUSCH et W. LEVISON, M.G.H., S.R.M., t. 1 (Hanovre, 1937-1951).
KOCH A. (1998) – “ Bügelfibeln der Merowingerzeit im westlichen Frankenreich ”, Mainz, 2 vol. (Römisch-Germanisches Zentral-museum, Monographien 6, Bd. 41, 1-2).
KRÜGER K. H. (1971) – Königsgrabkirchen der Franken, Angel-sachsen und Langobarden bis zur mitte des 8. Jahrhunderts. Ein historischer Katalog, Wilhelm Fink, Munich (Münstersche Mit-telalter-Schriften, Bd. 4).
LEGOUX R., PERIN P., VALLET F. (2006) – “ Chronologie nor-malisée du mobilier funéraire mérovingien entre Manche et Lor-raine ”, Condé-sur-Noireau, 2e éd. (n° hors série du Bulletin de l’Association française d’Archéologie mérovingienne).
LEGOUX R. (2005) – La nécropole mérovingienne de Cutry (Meurthe-et-Moselle), Saint-Germain-en-Laye (t. XIV des Mémoires publiés par l’Association française d’Archéologie mérovingienne).
LEMAN P., BEAUSSART P. (1978) – “ Une riche tombe mérovin-gienne à Famars (Nord) ”, dans FLEURY M. et PERIN P. (dir.), Problèmes de chronologie relative et absolue concernant les cime-tières mérovingiens d’entre Loire et Rhin, Paris, Champion (Actes du IIe Colloque archéologique de la IVe section de l’École pratique des Hautes Études, Paris, novembre 1973), Paris, Honoré Cham-pion, p. 145-1256.
LERENTER S. (1991) – “ Les plaques-boucles en bronze de style aquitain à l’époque mérovingienne ”, Université de Paris 1-Pan-théon Sorbonne (thèse de doctorat inédite).
LORREN C. (2001) – “ Fibules et plaques-boucles à l’époque méro-vingienne en Normandie. Contribution à l’étude du peuplement, des échanges et des influences de la fin du Ve au début du VIIIe siècle ”, Condé-sur-Noireau (t. VIII des Mémoires publiés par l’Association française d’Archéologie mérovingienne).
MARTIN M. (1991) – “ Zur frühmittelalterlichen Gürteltracht der Frau in der Burgundia, Francia und Aquitania ” dans L’art des invasions en Hongrie et en Wallonie (Actes du colloque de 1979), Musée royal de Mariemont, p. 31-84.
MÖSLEIN S. (2005) – “ Ein einzigartiger Goldtextil-Befund der späten Merowingerzeit aus Straubing-Altburg (Niederbayern). Vorbericht ”, dans Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege, 43/44, 2002/2003, p. 251-259.
OLIVIER G., AARON G. (1978) – “ New Estimations of Stature and Cranial Capacity in Modern Man ”, dans Journal of Human Evolution, 7, p. 513-518.
L’or des princes barbares. Du Caucase à la Gaule, Ve siècle après J.-C., cat. de l’exposition du Musée des Antiquités nationales, Saint-Germain-en-Laye, septembre 2000-janvier 2001, Paris, Réunion des Musées nationaux, 2000.
PERIN P. avec une contribution de R. LEGOUX (1980) – La data-tion des tombes mérovingiennes. Historique, méthodes, applica-tions, Genève, Droz (IVe section de l’École pratique des Hautes Études, Hautes Études médiévales et modernes, V, 39).
PERIN P., avec la coll. de VELAY P. et RENOU L. (1985) – Col-lections mérovingiennes ”, Paris, Imprimerie municipale (Cata-logues d’Art et d’Histoire du Musée Carnavalet, t. II).
PERIN P. (1991a) – “ Pour une révision de la datation de la tombe d’Arégonde, épouse de Clotaire Ier, découverte en 1959 dans la basilique de Saint-Denis ”, dans Archéologie médiévale, t. XXI, p. 21-50.
PERIN P. (1991b) – “ Quelques considérations sur la basilique de Saint-Denis et sa nécropole à l’époque mérovingienne ”, dans
206 ANTIQUITÉS NATIONALES, 37, 2005 : 181-206.
Villes et campagnes dans l’Occident médiéval. Mélanges Georges Despy, Liège, p. 599-624.
PERIN P. (1998) – “ La question des « tombes-références » pour la datation absolue du mobilier funéraire mérovingien ”, dans La data-tion des structures et des objets du haut Moyen Âge (Actes des XVes Journées internationales d’Archéologie mérovingienne, Rouen, 1994), Condé-sur-Noireau (Mémoires publiés par l’Association française d’Archéologie mérovingienne, t. VII), p. 189-206.
PERIN P., WYSS M. (2004) – “ La nécropole du haut Moyen Âge du quartier de la basilique et son cadre architectural ”, dans Saint-Denis, de sainte Geneviève à Suger. Les découvertes archéologi-ques et les témoignages historiques, Dossiers d’archéologie, n° 297, octobre 2004, p. 38-49.
PIREY de D. (1988) – Les boucles d’oreille à l’époque mérovin-gienne en Gaule du nord, thèse inédite de l’Université de Paris X-Nanterre.
QUART D., SCHÜSSLER U. (2000) – “ Mineralogische Untersu-chungen zur Herkunft der Granate merowingerzeitlicher Cloison-néarbeiten ”, Germania 78, p. 75-96
ROTH H. (1973) – Die Ornamentik der Langobarden in Italien (Antiquitas, Reihe 3).
ROTH H. (1986) – “ Zweifel an Aregunde ”, dans Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte, t. 7, p. 267-276.
SALIN B. (1904) – Die altgermanische Thierornamentik. Typolo-gische Studie über germanische Metallgegenstände aus dem IV. bis IX. Jahrhundert, nebst einer Studie über birische Ornamentik, Stockholm.
SALIN É. (1957) –“ Sépultures gallo-romaines et mérovingiennes dans la basilique de Saint-Denis ”, dans Monuments et mémoires Piot, Paris, P.U.F., t. 49, p. 93-128.
SALIN É. (1958) – “ Les tombes gallo-romaines et mérovingiennes de la basilique de Saint-Denis (fouilles de janvier-février 1957) ”, dans Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, t. XLIV, p.1-88.
SCHULZE M. (1976) – “ Einflüsse byzantinischer Prunkgewänder auf die fränkische Frauentracht ”, dans Archeologisches Korres-pondanzblatt, 6, 1976/2, p. 149-161.
THIEME B. (1978) – “ Filigranscheibenfibeln der Merowingerzeit aus Deutschland ”, dans Bericht der Römisch-Germanischen Kom-mission, Bd. 59, p. 383-497.
THILLAUD Dr P.-L. (1993) – “ L’âge au décès de la reine Aré-gonde, épouse de Clotaire Ier, d’après une nouvelle expertise ostéo-archéologique ”, dans Cahiers de la Rotonde, n° 14, p. 169-172.
VALLET F., PERIN P. (2004) – “ La nécropole mérovingienne de la basilique de Saint-Denis ”, dans Saint-Denis, de sainte Gene-viève à Suger. Les découvertes archéologiques et les témoignages historiques, Dossiers d’archéologie, n° 297, octobre 2004, p. 20-33.
La vie mystérieuse des chefs-d’œuvre… 1980 – “ La vie mystérieuse des chefs-d’œuvre. La science au service de l’art ”, Réunion des Musées nationaux, Paris, p. 111-120.
VIELITZ K. (2003) – “ Die Granatscheibenfibeln der Merowin-gerzeit ”, Montagnac, éd. Monique Mergoil (Europe médiévale 3).
VIGNAL J.-N. (1998) – “ Application de la méthode de Steele pour l’estimation de la taille à partir d’os longs fragmentaires. Exposé de trois cas concrets ”, dans Biométrie Humaine et Anthropologie, 16 (3-4), p. 151-158.
WERNER J. (1967/1968) – “ Namensring und Siegelring au dem gepidischen Grabfund von Apahida (Siebenbürgen) ”, dans Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte, 9, p. 120-123.
WILSON D. M. (1964) – “ A ring of Queen Arnegunde ”, Germania, 42, p. 265 et ss.
WITTWER-BACKOFEN U., GAMPE J., VAUPEL J. W. (2003) – « Tooth cementum annulation for age estimation: Results from a large know-age validation study », dans American Journal of Phy-sical Anthropology, vol. 123, 2, p. 119-129.


































![L'Évangile de Judas, de la tombe au musée. L'épopée rocambolesque du manuscrit damné [2006]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ef3ea0ff042c6110c9cb3/lievangile-de-judasi-de-la-tombe-au-musee-lepopee-rocambolesque.jpg)