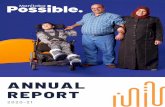Une possible scène d'arpentage dans la tombe du chef des Medjaou Mahou, GM 241, 2014 (A possible...
Transcript of Une possible scène d'arpentage dans la tombe du chef des Medjaou Mahou, GM 241, 2014 (A possible...
GM 241 (2014) 37
Une possible scène d’arpentage dans
la tombe du chef des Medjaou Mahou
Franck Monnier
La tombe de Mahou1 (Tombe n° 9) est l’une des rares sépultures de la nécropole
de Tell El-Amarna à s’être vue décorée et illustrée de scènes légendées. Ces dernières
ont été décrites et reproduites en détail tout d’abord par U. Bouriant, G. Legrain et G.
Jéquier2, ensuite par N. De Garis Davies
3. Une traduction intégrale des textes a été
proposée récemment par W. J. Murnane4.
Diverses scènes, réparties en plusieurs registres sur les murs de la première chambre,
illustrent Mahou dans l’exercice de ses fonctions et de ses charges au sein de la cour.
On y voit le chef des policiers escortant la famille royale avec sa garde (paroi nord-
est), assumant ailleurs des activités liées au contrôle et à l’entreposage de denrées
(paroi sud-ouest), ou encore présentant au vizir des maraudeurs faits prisonniers à la
lisière du désert (paroi sud- ouest).
Le dernier niveau du registre inférieur qui s’étend de la paroi nord-est à la paroi sud-
est (détail B, figure 1) et le registre supérieur de la paroi sud-est (détail A, figure 1)
affichent tous deux des lignes droites dont le tracé est régulièrement interrompu par de
gros points. Dans le registre A (fig. 2), celles-ci sont disposées à la verticale et par
groupes de quatre, enserrant de part et d’autre une bâtisse fortifiée représentée en
élévation, tandis que dans le sous-registre B (fig. 3), une ligne semblable, mais
horizontale, relie successivement sept petits édifices en forme de tours. Un individu se
poste près de chacun d’eux et s’incline devant le passage du souverain. Nous nous
proposons d’identifier la nature de ces lignes en vue d’offrir une vision globale
cohérente des thèmes représentés.
1 Il nous est agréable de remercier Gwil Owen qui a eu la gentillesse de communiquer des
photographies pour illustrer le présent article, et Richard Lejeune qui a bien voulu effectuer une
relecture du manuscrit. 2 U. BOURIANT, G. LEGRAIN et G. JEQUIER, Monuments pour servir au culte d’Atonou en Égypte, Le
Caire, 1903, p. 94-105, pl. XLI-LI. 3 N. DE GARIS DAVIES, The Rock Tombs of El Amarna. Tombs of Penthu, Mahu, and Others, IV,
1906, p. 12-18, pl. XIV-XXIX. 4 W. J. MURNANE, Texts from the Amarna Period in Egypt, Atlanta, 1995, p. 147-151.
38 GM 241 (2014)
Fig
. 1
– S
cèn
es f
igu
ran
t su
r le
s p
aro
is d
e la
pre
miè
re s
alle
de
la t
om
be
TA 9
de
Mah
ou
(d’a
prè
s N
. D
E G
AR
IS D
AV
IES, T
he
Rock
Tom
bs
of
El
Am
arn
a. T
om
bs
of
Pen
thu, M
ah
u,
an
d O
ther
s, I
V,
19
06
, p
l. X
IV-X
XIX
)
GM 241 (2014) 39
Fig. 2 – Détail A de la figure 1
(Superposition d’un dessin au trait de N. DE GARIS DAVIES, The Rock Tombs of El Amarna.
Tombs of Penthu, Mahu, and Others, IV, 1906, pl. XXI et d’une photographie de Gwil Owen)
Fig. 3 – Détail B de la figure 1
(Photographie de Gwil Owen)
40 GM 241 (2014)
Selon N. De Garis Davies, ces lignes seraient des clôtures, ou plus précisément des
rangées de poteaux reliés par des cordes5, établies autour des ouvrages pour appuyer
leur défense6. Dans le registre A, celles-ci seraient donc représentées en plan, tandis
que l’édifice le serait en élévation, selon un procédé relativement commun dans l’art
amarnien. Ce point de vue s’est vu entériné sans réserve par la plupart des
commentateurs7.
Cependant, ces présumées « clôtures » sont aussi représentées en B, liant les uns aux
autres une chaîne d’édifices vus en élévation. Bien que la vue diffère, la ligne ponctuée
correspond point par point à celles du registre A. Si nous avions effectivement affaire
à des poteaux connectés, leur représentation serait immanquablement en élévation et la
lecture, de ce fait, indiscutable. Mais ça n’est pas le cas8. Il y a donc tout lieu de penser
que, vus en élévation ou en plan, ces éléments possèdent la même apparence.
D. O’Connor a raison d’affirmer que des cordes tendues pour faire obstacle sont d’une
utilité dérisoire au regard d’une muraille9. Il ne faut donc certainement pas les entendre
comme des éléments de défense. La conception abstraite d’une frontière ou de
chemins de patrouille qu’il suggère à son tour10
n’est toutefois guère plus satisfaisante
puisqu’elle n’explique aucunement la présence de points régulièrement espacés sur
chaque ligne.
Selon nous, l’iconographie égyptienne apporte des parallèles indéniables à ce que l’on
observe chez Mahou11
.
Une composition de la tombe thébaine de Menna illustre des harpédonaptes12
dans
l’exercice de leur fonction (fig. 4). L’instrument utilisé est une corde étalonnée avec
5 N. DE GARIS DAVIES, op. cit., p. 16.
6 Ibidem.
7 A. BADAWY, Le dessin architectural chez les anciens Égyptiens, Le Caire, 1948, p. 147 ; B. J. KEMP,
« The Window of Appearance at El-Amarna », JEA 62, 1976, p. 97-98 ; B. J. KEMP, Ancient Egypt :
Anatomy of a Civilization, Londres et New-York, 1989, p. 274-275, fig. 90 ; B. J. KEMP, The City of
Akhenaten and Nefertiti. Amarna and its People, Londres, 2012, p. 159. 8 N. De Garis Davies a bien perçu le problème. Mais l’explication qu’il en donne pour ne pas
contrarier sa lecture du registre A est bien peu convaincante : « The device is shown again in Pl. xxii.,
where truly one would have expected the posts to have appeared in elevation rather than in plan. It is a
little more easy to explain if the obstruction was set low down » (N. DE GARIS DAVIES, op. cit., p. 16,
n. 3). 9 D. O’CONNOR, « Demarcating the Boundaries: an Interpretation of a Scene in the Tomb of Mahu, El-
Amarna », BES 9, 1987/1988, p. 45-46. 10
D. O’CONNOR, op. cit., p. 45. 11
S. CLARKE et R. ENGELBACH, Ancient Egyptian Masonry, Londres, 1930, fig. 62 ; S. BERGER, « A
Note on Some Scenes of Land-Measurement », JEA 20, 1934, p. 54-56 ; N. DE GARIS DAVIES, The
Tombs of Mencheperrasomb, Amenmose and Another, Londres, 1933, pl. 17. 12
Au sujet de ce terme, le lecteur est invité à consulter C. ROSSI, Architecture and Mathematics in
Ancient Egypt, Cambridge, 2007, p. 157.
GM 241 (2014) 41
des nœuds régulièrement espacés, dont la représentation est indubitablement similaire
aux lignes décrites ci-dessus. Ces dernières seraient donc selon nous des cordes à
nœuds, dont l’emploi n’est jusqu’à présent attesté que dans des scènes d’arpentage à
caractère agricole13
. Cette interprétation offrirait ainsi une parfaite illustration de la
méthode ayant permis de tracer au sol quelques grands édifices d’Akhetaton14
. Ce
document exceptionnel attesterait dans ce cas un usage que l’on soupçonnait
seulement jusqu’à maintenant avoir été étendu à l’architecture et à l’urbanisme15
.
La place de ce que nous estimons être des cordes à nœuds dans la série de scènes
narrant les activités terrestres de Mahou est, nous allons le voir, tout à fait signifiante.
Dans le premier registre de la paroi nord-est, le roi Akhenaton, Néfertiti et leur fille
Mérytaton quittent un temple (peut-être le gm-pA-Jtn16) sur leur char, escortés par la
garde de Mahou, et se dirigent vers un établissement apparemment fortifié (figure 1-A,
figure 2). Ce dernier, cerné de cordes à nœuds, est souvent identifié au palais fluvial
nord17
. Le registre inférieur montre le même cortège se dirigeant cette fois vers six
13
S. BERGER, loc. cit. 14
J. D. S. PENDLEBURY, The City of Akhenaten, III, Londres, 1951, p. 6. 15
B. H. HANSEN, « The construction of the Cheops Pyramid by Means of a Rope », dans S. SCHOSKE
(éd.), Akten des vierten internationalen Ägyptologen Kongresses, Münich, 1985, vol. 2, Hambourg,
1989, p. 45-52 ; D. ARNOLD, Building in Egypt, New-York/Oxford, 1991, p. 252-253 ; J.Cl. GOYON et
al., La contruction pharaonique, Paris, 2004, p. 229 ; C. ROSSI, op. cit., p. 154-156. 16
S. PASQUALI, « Un jardin au petit temple d’Aton de Tell el-Amarna », ENIM 6, 2013, p. 213. 17
Dernièrement B. J. KEMP, op. cit., 2012, p. 152, 159, fig. 5-5.
Fig. 4 – Scène d’arpentage avec corde à nœuds représentée dans
la tombe TT69 de Menna (dessin de l’auteur).
42 GM 241 (2014)
portails. Le sous-registre inférieur (figure 1-B, figure 3), qui trouve une extension dans
le registre inférieur de la paroi sud-est, affiche une chaîne de sept édifices en forme de
tours, tous reliés par une corde à nœuds, et auxquels sont associés des individus se
courbant devant la famille royale.
Le souverain effectue une tournée d’inspection dans le domaine d’Aton selon un
itinéraire qui demeure la source de nombreuses spéculations, notamment en raison de
l’abstraction extrême des édifices représentés. Récemment par exemple, D. O’Connor
a suggéré de voir en la stèle fausse-porte la matérialisation d’une borne-frontière du
domaine d’Aton, et en les structures du sous-registre B, sept bornes visitées par le
souverain18
.
Les scènes de la tombe devant glorifier les hauts faits de son propriétaire, il n’est pas
surprenant de voir Mahou en charge de veiller aux bons déplacements de la famille
royale, montrant par là sa position privilégiée au sein de la cour. Ses autres fonctions
sont également illustrées : le contrôle des biens à entreposer et destinés aux cultes
d’Aton (registre supérieur de la paroi sud-ouest), la surveillance des frontières du
domaine (registre inférieur de la paroi sud-ouest).
La représentation des cordes à nœuds près d’édifices fortifiés met selon nous en
lumière l’un des rôles fondamentaux de la garde lors de l’établissement du domaine
d’Aton : celui d’assurer la protection des ouvriers et du personnel en charge d’établir
les fondations et d’ériger les constructions de la ville. Il ne fait nul doute que les
casernes et les postes de garde furent parmi les premiers édifices à être établis sur le
site. Et c’est au sein de la cité en gestation, et donc des bornages et arpentages, que
devaient se situer les corps garants du bon déroulement des opérations.
L’importance des hommes en armes accordée par le souverain à la fondation de la ville
– ils sont cités aux côtés des responsables des travaux - est clairement exprimée dans
le premier décret de fondation qui date du 13e jour du 4
e mois de Peret de l’an 5 :
Sa Majesté dit alors : « Que l’on m’amène les Compagnons du roi et les
grands du palais, les responsables des soldats et les directeurs des travaux,
[les fonctionnaires et la cour] tout entière. (…)
Sa Majesté leur dit ensuite : « Voyez l’Aton (ou le soleil) ! Aton veut que
[l’on] agisse pour lui, en (réalisant) des monuments au nom durable pour
l’éternité. »19
18
D. O’CONNOR, op. cit., p. 48-49. 19
W. J. MURNANE et C. C. VAN SICLEN III, The Boundary Stelae of Akhenaten, Londres /New-York,
1993, p. 37.
GM 241 (2014) 43
Il ne fait aucun doute que la place majeure alors octroyée au responsable et ses gardes
au sein de cet immense projet a dû représenter l’un des points culminants d’une
carrière hautement honorable, ce qui expliquerait aisément en quoi Mahou tint à faire
figurer cet épisode dans sa tombe.
L’utilisation des deuxième et troisième noms d’Aton (protocole IIb et III) dans les
textes de Mahou20
permet de présumer que la décoration de cette partie de la tombe est
postérieure à l’an 11 du règne d’Akhénaton21
. Pourtant, bien que la progéniture du
couple royal se compose à l’époque de six filles22
, seule l’aînée Mérytaton est
représentée aux côtés d’Akhénaton et Néfertiti23
. Cela ne peut raisonnablement
s’expliquer par un manque d’espace dans la composition comme a pu l’exprimer N.
De Garis Davies24
, mais plutôt, comme l’a parfaitement montré M. Gabolde, par la
référence à une réalité plus ancienne25
. Mérytaton étant née vers l’an 426
, sa seule
présence dans ces scènes trouve tout son sens au regard des évènements représentés.
Dans ce cadre, nous ne pensons pas que l’édifice fortifié de la paroi sud-est puisse
évoquer le palais royal dit « le palais fluvial nord ». Ce dernier possédait en effet un
mur extérieur épais de seulement de 1,5 m27
, ce qui ne correspond à aucun standard en
matière de fortification. Les redans relevés sur le site devaient plutôt agir en tant que
contreforts stabilisateurs – comme au petit temple d’Aton28
ou au Marou-Aton29
-, et
non représenter des tours de flanquement.
Le « fortin » de Mahou pourrait plus simplement symboliser l’une des casernes qui
abritaient les nombreux soldats en garnison dans la ville. Les petits édifices du sous-
registre B pourraient figurer des postes de garde répartis sur l’étendue du territoire à
urbaniser.
En définitive, sur les parois de la tombe de Mahou, le déplacement de la famille royale
vise peut-être tout simplement à inspecter et apprécier l’évolution des multiples
chantiers de l’horizon d’Aton, parcours ponctué par divers cultes rendus au dieu
solaire devant chaque borne-frontière, comme l’a soumis D. O’Connor30
.
20
M. GABOLDE, D’Akhénaton à Toutankhamon, Lyon, 1998, p. 106, 113. 21
M. GABOLDE, op. cit., p. 116-117. 22
D. LABOURY, Akhénaton, Paris, 2010, p. 314-315. 23
À ce sujet, lire J. CAPART, Leçons sur l’art égyptien, Liège, 1920, p. 424-425. 24
N. DE GARIS DAVIES, op. cit., p. 14. 25
M. GABOLDE, op. cit., p. 113. 26
M. GABOLDE, op. cit., p. 13. 27
B. J. KEMP, op. cit., 2012, p. 152. 28
N. DE GARIS DAVIES, The Rock Tombs of El Amarna. Tombs of Parennefer, Tutu and Aÿ, VI, 1908,
pl. XX ; J. D. S. PENDLEBURY, op. cit., pl. 16. 29
T. E. PEET et C. L. WOOLEY, The City of Akhenaten, I, 1923, pl. 29. 30
D. O’CONNOR, op. cit., p. 45.
44 GM 241 (2014)
A. R. Schulman a démontré l’importance accordée aux soldats durant l’essor de la cité
d’Akhetaton31
. Ce qui, selon nous, est une représentation égyptienne unique d’un
arpentage en contexte urbain, souligne une nouvelle fois la place essentielle occupée
par les gardes et policiers dès l’avènement de l’ère amarnienne. Elle illustre le décret
de fondation gravé sur les stèles frontières de l’an 5, qui exhortent les responsables des
soldats et les chefs des travaux à se mobiliser de concert pour mener à bien l’ambitieux
projet de Pharaon.
31
A. R. SCHULMAN, « Some Observations on the Military Background of the Amarna Period »,
JARCE 3, 1964, p. 51-69.