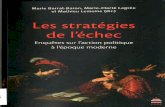(XI) BARKER, Richard - Mostrar a bandeira, em 1521: a viagem da Infanta D. Beatriz para Sabóia
# 737 "PARTICIPATION DE STRASBOURG A LA DEFENSE DE LA HONGRIE PENDANT LES GUERRES TURQUES...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of # 737 "PARTICIPATION DE STRASBOURG A LA DEFENSE DE LA HONGRIE PENDANT LES GUERRES TURQUES...
lq f u'\-v\
/JutVYfrci4-Y3*
ETUDESFINNO.OUGRIENNES
TOMES VI-VII re6e- ts70.EDITIONS KLINCKSIECK
PARIS
?ffi^T'thlrKJ
St"^{rqd,tfT3 !-L/r, W t l'*{PARTICIPATION DE STRASBOURG A LA OPTBNSBDE I,A HOI\GRIE PENDANT LES GUERRES TUROUES
(r521-1555)
Le p6ril ottoman se manifesta au d6but du xvre sidcleavec une acuit6 toute nouvelle pour I'Europe occidentale.Il existait d6jd depuis la fin du xrve, quand il submergeales Balkans aprds avoir r6duit d sa merci I'Empire Byzantin.La d6faite de la croisade d Nicopolis en 1396, fit d6finitivementla r6putation de I'arm6e ottomane (r).
Par la suite, l'avance turque fut contenue tant bien quemal. Le bruit de ces luttes confuses n'impressionna pasparticulidrement l'Europe. Les combats prirent petit d petitla place que les Croisades occupaient autrefois, d'autantplus que les Papes cherchaient de temps i autre d enrayerles progrds des Ottomans en mettant sur pied de nouvellescroisades. Soit par conviction, soit par calcul, ,les princesprojetaient d'aller combattre les Turcs, sans d6passer souventle stade des bonnes intentions et m6me lorsqu'ils passaientaux actes, il n'y avait gudre de r6sultats durables. Touteune litt6rature tentait de tenir en 6veil I'int6rdt de I'opinioneurop6enne sur cette question (2). Mais comme les bataillesse d6roulaient d une trds grande distance, sans constituerune r6elle menace, I'opinion s'y habitua. Il n'en resta qu'uneambiance de merveilleux et d'6pop6e.
(1) Pour I'histoire de I'Empire Ottoman au xvre sidcle, voir: J. v. Ha.uuon-Puncsur,r, : Geschichte des Osmanischen Reiches. PesL,1827 .
- J , W. ZrNr<prssN:
Geschichte des Osmanischen Reiches. Gotha, 1840-63. -
A. Fnupu.a,N : TfteOttoman Power in Europe, 1877.
- R. B. Mpnnrul't't: Suleiman the Magnificent.
Cambridge, 1944. -
A. H. Lvevnn : Gouernment of the Ottoman Empire in theTime of Suleiman the Magnificenl. Cambridge, 1913.
(2) Pour le d6tail de cette litt6rature, voir : S. A. Frscnon-Gtrttr : OttomanImperialism and German Protestantism. Cambridge, 1959. Voir en particuliersa bibliographie, pages 125.
- K. Gonr-r.Nsn : Turcica. Bucuresti, 1961,
t72 I. HUNYADI
Des pol6mistes et moralisateurs s'empardrent du sujet,,pour glorifier tel prince combattant les piiens et stigmatiserles fautes et ambitions de ses ad.versaires. Les pr61"t* d"croisade mis sur pied pour combattre le p6ril, ou bien furentfranchement chim6riques ou bien d6passaient, res possibilit6sfinalcidres et < logistiques I de l'6poque et il n,en r6sultapratiquement rien.
La croisade- spirituelle : pridres collectives, processions,sonneries de cloches, collectes de dons furent des d6rivatifspour les Ames inquidtes (1).
Cependant, toutes ces manifestations, sans 6tre e{ficaces,6taient conformes d la conception du monde de l'6poque.Elles maintenaient en 6veil I'in[6r6t pour la question turque etelles fournissaient des subsides au* papes, qui soutenaientpar des sommes consid6rables les princei r6eliement engag6sdans le combat, en particulier les rois de Hongrie (2).
Au x_vre sidcle, l'6croulement brusque de la Hoigrie modifiaprofond6ment la situation : les Turci envahissanil'Arrt"i.lr",11.T?.i".* _turque constituant une menace permanente pourl'Italie et I'Espagne, I'alliance cle Frangoi. i"t
"t de Soliman(laquelle scandalisa la chr6tient6 qui p"it
"1o". conscience du
eg..il ottoman) furent les principaux facteurs du regaind'int6rdt pour cette question.
Les habitants de I'Empire portdrent un int6r6t croissantd la question et contribudrenl en hommes et en argent dla d6fense de ce qui restait de la Hongrie. Malgr6 les [ertes,les retards inadmissibles, les d6touriements "de
fonds, lacontribution de I'Empire fut capitale et, sans elle, la d6fensede la Hongrie etrt 6t6 quasiment impossible.
- Et c'est pr6cis6ment cette aide que nous voudrions 6tudierdans le pr6sent article. Nous avoni choisi un exemple rimit6certes, mais nous croyons particulidrement, rep16sentatifau moins en ce qui concerne l'Europe du nord. Norrs ovons
- (1) En 1522 I'empereur s'est adress6 par une proclamation d <, tous lesEtats de I'Empire, officiers et communaut6s r, < pour inviter et amener toutprOtre r6gulier ou s6culier, de c6l6brer messe, organiser procession et assurerla plus grande assistance d ces manifestations, afin que re Tout-puissant permetteune r6sistance victorieuse contre les entreprises lurques en Hongrie ,r. (ArchivesMunicipales de Strasbourg. Liasse : AA 877 lI lJ).(2) Ainsi Mathias Corvin regut en 146b, 100.000 florins; Vladislav II, entre1501-1505, 200.000 florins ; Louis II, en 1b26, regut 2b.000 florins. Durantle xvre el, le xvrre sidcle, les subsides pontilicaux continuaienr. voir d ce sujet :B. HouaN-Gv. Szerr(i : Maggar tdrtenet, Budapest, Ig3b, t, III, pages 146_4g,
srttAsBouuc Er LA DiiFENSE DE LA HoNGurE (f5zl_f555) 173
effectivement choisi d'6tudier I'aide apport6e par la R6publiquede Strasbourg d la
.Ho.nS1ie, en parficulier pendant i" pn"."la p.lus critique de la lutte, c'es[-d-dire pendant l" p".'-i0""moiti6 du xvre sidcle.
. Ville imp6riale, li6e par des obligations pr6cises aux autresgtlt de -.I'Empire, riche cit6 commeigante, m6tropoleintellectuelle, ralli6e d la R6forme en rb24, str".bou"g
"ti"itabsolument pas menac6e par les Turcs, mais elle Jvait lesToy"T_ mat6riels pour faire face d ses obligations financidreset militaires (r).
Suffisamment ind6pendante vis-d-vis des Habsbourg, elleaurait pu trouver des echappatoires pour n'accord*, q'rr,rrrreaide symbolique. Pourtant,-elle tint une place honn6te dansI'aide a.ccord6e par l'Empire au roi de Hongrie
Son int6rdt pour la question fut certain : il est illustr6par le fait que durant les 3b ans de notre p6riode, plusieurslivres ou brochures concernant les Turcs en g6n6rali ou prusparticulidrement, leurs ravages en Europe, iurent i-pri-e,d Strasbourg. Parmi eux, 10 peuvent 6tre identifi6s de nosjours (z). Ce mdme int6r6t esf refl6t6 par les sermons despr6dicateurs et par des-passages de coriespondances priv6esdes notables de la ville ar,ec cres amis habitant djautres16gions.
..Y"ll de ld d passer. aux actes, il y avait un gouflre que laville 6tait peu encline d franchir, ."rf d"rr. le cadie d'une vastegpej_atiol englobant I'Empire ou m6me de pref6rence, toutela Chr6tient6.
De cette attitude_ Strasbourg ne se d6parLira pas, saufdans des cas exceptionnels, quand elle aura f
,irirpr"..io"qu'une g6n6rosit6 pourrait 6tri payante. < Suivre les' autres,attendre et voir > seront les consignes permanentes auxd6put6s d ]a Didte. Nous aurons l,occa"sion de constater a q""fpoint la ville 6tait r6serv6e dans ce domaine
"n "o-p"i"rrt(1) Pour I'histoire de s[rasbourg, voir: E. v. Bonnrns: Geschichteder stadtStrdssburg, Strassburg, Igl0.
- U. Cn;inaen : Verwaltung und. Verfassung
strassburgos 15zl-16s1, Frankfurt, tgBl. -
u. cnAnnn : wehrmacht strassburgs1521-1681 (Zeitschrift fiir die Geschichte des Oberrheins, N. F. Bd. 4b). _Ph, Dor,r-rxcea: Strasbo,rg du passe au pr6sent. Strasbourg, 1962, _ R. REUSS :Histoire de Strasbourg. Strasbourg lgzb. _ K. SrpNzsr- : Strassburg, Baselund Reich (Zeilschrift fiir die Geschichte des Oberrheins, U. n. ea."bS). _Ph. Dor.r,rNcnn: Viltes Allemandes au Mogen,4ge. Strasbourg, 19b4.(2) Voir Goer,r,Nen : Turcica, documents : no,
-47, fn, Oa.,2A1,,366, 44g, bgg,596, 736,89l.
174 r. HUNyADT
son attitude d celle qu'elle prendra en tant que protestante,pour la d6fense de sa foi.
La r6serve s'explique non par une avarice ou un 6goismesordides, mais plutdt par le scepticisme quant aux r6sultats,c'est-d-dire une d6fense efficace contre les Turcs. Elle n'6taitpas strre que les fonds qu'elle verserait ne seraient pas utilis6sd d'autres fins, voire empoch6s tout bonnement par unpercepteur sans scrupules. Elle cherchera donc, comme les
iutres, d prendre des garanties de bon emploi et i obteniren plus, des avantages ou des contreparties.
Dans I'attitude de Strasbourg, - comme dans celle des
habitants de l'Empire en g6n6ral, - vis-d-vis du p6ril turc,on peut distinguer 3 p6riodes :
1) avant le sidge de Vienne, lorsque la menace restait trdslointaine (1521 -1529) ;
2) entre le sidge de Vienne et la prise de Bude par les
Ottomans quand les Allemands sentirent qu'il fallait, fairequelque chose; ils accorddrent des subsides en cherchant des
Contreparties, notamment dans le domaine religieux (1b29-15at);
3) aprds la chute de Bude, les 6tats firent eux-mdmes des
propositions d I'empereur concernant les mesures d prendre ;
cette p6riode atteignit son point culminant par l'6crasementdes Protestants et par le r6gime int6rimaire (1541-1552).
Aprds une brdve description de la situation dans laquellese tiouvait la Hongrie au d6but du xvre sidcle, nous 6tudieronsla contribution de Strasbourg aux guerres turques, dans le
cadre chronologique que nous venons de d6finir. Notre 6tudeest bas6e essentiellement sur la correspondance politiqueentretenue par un magistrat de Strasbourg (1)' que nousavons d6pouill6e pour la p6riode de 1521-1b55.
a*t
(l) Le rouage ccntral du magistrat 6tait Ie < Petit Conseil t (Kleiner Rat)avec ses comitds permanents, appelos t Chambres Secrdtes I : celui pour les
affaires ext6rieures, le r conseil des XIII. r (Die Herren Dreizehner) et celuipour les affaires int6rieures, le <r Conseil des XV. t (Die Herren Filnfzehner)'Le Petit Conseil se composait en tout de 51 personnes, en tenant compte des
cumuls. (Voir : Criimer : Verw' u. Verf. Stbg., pages l0-35.)
srRAsBouuc Er LA D6FENSD DE LA HoNcnrE (l5ZI-f555) 175
L SlruerroN DE LA HoNcnrn
La vocation de la Hongrie 6tait de faire obstacle dans lesBalk_ans.d I'expansion ottomane. Ses confins s'avangaientsur_les Alpes dinariques depuis les possessions adriaiiquesde Venise et, faisaient pont jusqu'd la Valachie sur laquelleelle avait des droits de suzerainete, de m6me que sur laMoldavie. Par cela elle verrouillait la p6ninsule balkaniquesur toute sa largeur. Ses droits de suzerainet6 6taient contesi6spar les Ottomans et les Polonais (qui en avaient de semblables)et de toute fagon, l'anarchie s'6tait install6e chez elle enpermanence depuis la mort du roi Mathias Corvin.
La noblesse r6agit avec turbulence contre les tendancescentralisatrices du roi d6funt, et d6mantela toutes les institu-tions qui assuraient un gouvernement eflicace et des financesregulieres. Elle assista avec insouciance aux cons6quences :d6labrement complet des fortifications d la frontidre, clissolu-tion de I'arm6e permanente. Par ses actes irr6fl6chis, elleemp6cha toute politique coh6rente, provoqua une terriblejacquerie en 1514 puis la mata sauvageme.tt. Les dirigeantsdu pays ne prirent pas les mesures qui s'imposaient, ni pourempdcher I'affrontement social, ni pour pr6voir les moyenspropres d faire face au danger ottoman (1).
Avec la terrible menace turque d ses frontidres, le royaumese divisa en deux couches superpos6es qu'une haine mbrtelles6parait.
_ Dans ce pays en proie d I'anarchie se posait le probldmede la succession : en effet, le roi Louis II n;avait pas d,enfantet ne pouvait pas en avoir (2).
En principe, l'6lection du roi etait du ressort de la Didte.Bien entendu, d la {in du Moyen Age, l,6lection du fils du roid6funt 6tait pratiquement assur6e. En I'absence d,un fils,le mari de la fille du roi 6tait,6lu : 6ventuellement un collat6ral.La Didte ne devait reprendre son libre choix qu'en casd'extinction compldte de la lign6e royale.
(l) Pour I'histoire de la Hongrie au xvre sidcle, voir: S. Szrr_Acvr : Maggarnemzet ti;rtenete, tome V. Budapest 1896.
- B. Holra,x_Gy. Sznxr6, op. cit.,
t. III. - tr. Mor,u,tn : Maggarorszdg tdrtenete, t. L Budapest 1964. _ F. Ecx.q.nr :
Introduction d I'htstoire hongroise, paris lgz8. -
K. und M. uur,rnrz : Geschichteoeslerreichs und seiner Nachbarltinder Biihmen und. (Jngarn. wien, 1g27.
(2) Les contemporains eJtimaient que ra reine Marie de Hongrie ne pourraitpas avoir des enfants (voir : Houax-Szexrii, III, page l2).
176 I. HUNYADI
Ce principe fut combattu par un autre : celui du libre choixdu candidat par la Didte, lors de chaque 6lection. Ce principefut appliqu6 deux fois au xve sidcle ; lors de l'6lection deWladislaw Ier en 1440, au m6pris des droits de Ladislas Vle Posthume, qui n'avait que quelques mois d l'6poque ;et plus tard, lorsqu'd la mort du mdme Ladilas le Posthume,Mathias Corvin fut 6lu en 1458, bien que I'empereurFr6d6ric III ftrt, un parent - 6loign6, il est vrai - du roi d6funt.
Mathias, n'6tant pas de sang royal, fit une propagande enfaveur de la libre 6lection royale, par souci de renforcer sespropres droits d la couronne. Les deux tendances furentconcili6es par les trait6s de succession, ratifi6s par la Didte.Le premier en date fut conclu entre I'empereur Fr6d6ric IIIet Mathias Corvin en 1463, renouvel6 entre Wladislaw IIJagellon et Maximilien par deux fois : en 1495 et 1515 (Trait6sde Pozsony et de Vienne). Sous cette dernidre forme, ilpr6voyait le mariage des enfants Jagellon Louis et Anne avecles Habsbourg Marie et Ferdinand, et la succession mutuelleen cas d'extinction sans enfants de I'un des int6ress6s (1).
Le trait6 de Vienne ne fut que difficilement ratifi6 par laDidte, laquelle avait, adopt6 10 ans plus t6t le principe del'6lection libre. L'opposition au trait6 se regroupait autourde Jean Z|polya, voivode de Transylvanie et propri6taireterrien le plus riche du royaume qui, d la faveur de I'id6e duroi national et grAce d une l6gende de sa Iiliati cr66e detoute pidce - lsrn6nf,snt d Mathias Corvin, esp6rait monterlui-mdme sur le tr6ne (2).
Les Habsbourg ne prenaient pas toute cette agitation tropau s6rieux et consid6raient les pays de Louis - la Hongrie,la Bohdme et la Moravie - comme un h6ritage d terme. Ils6taient, bien d6cid6s, dans certaines limites, d soutenir leuralli6 contre une attaque ottomane, sachant que ce royaume,dans la situation of il se trouvait, ne pourrait r6sister d unecampagne militaire d'envergure.
(l) Pour le trait6 de Vienne et ses cons6quences, voir : Szrr,.A.cvr, op. cit.,IV, page 411 et V, pages 15-16; Houa,x-Sznrti3, op. cit., III, pages 13-17.
(2) La famille des Zdpolya, d'humble origine, devait son ascension d lafaveur de Mathias Corvin. En 1505 Ggdrgg (Georges), le frdre cadet de JeanZdpolya, se fianga avec Elisabeth, fille du b$tard du Mathias Corvin. Quoiqueles fiangailles furent rompues en 1507, les Zdpolya se consid6rdrent d6sormaiscomme les h6ritiers du roi Mathias et les d6positaires du principe de la libre6lection royale. (Voir : Szrr-Acyr : V, page 305, Honrln-Szan<ri3,ll, page 579et III, pages 13-15).
STRASBOURG ET LA DEFENSE DE LA HONGRIE (1521-1555) 177
En fait, l'aide des Habsbourg 6tait limit6e. Les guerresd'Italie, auxquelles pratiquement toute l,Europe fut"m6l6e,se ramendrent bientdt d un aflrontement entre les Habsbourget les valois-- Les premiers avaient des possessions 6parpill6eiet un parti de supporters dans la plupart des pays
"rrrop6.rr, ;les
- seconds, pour 6chapper d la menace h'nege-o.rie de
I'adversaire, pratiquaient, les alliances d revJrs (1). UneHongrie, adversaire de la Maison d'Autriche 6tait un morceaude choix dans ces alliances et les Valois soutenaientn6cessairement les ambitions des pr6tendants rivaux desHabsbourg, d la couronne de saint-Etienne. De m6me, lesrois de France faisaient tout pour empdcher Charles Quintd'avoir les mains libres afin de pouvoir intervenir e{IicacJmentdans les affaires hongroises.
_ Le Pape et Venise, alli6s traditionnels de la Hongrie contreles Turcs, avaient alors des int6r6ts contradictoires : aiderefficacement une Hongrie alli6e des Habsbourg contre lesOttomans, revenait d soutenir les ambibions de la Maisond.'Autriche d I'h6g6monie ; abandonner la Hongrie i son sort,signifiait tout de m6me laisser venir les Ott6mans jusqu'dJienle et aux portes de Venise ; une telle attitude pouvaitjustifier I'accusation de pratiquer I'alliance avec les ennernisde la foi. Ils accordaient donc une aide intermittente d lad6fense contre les Turcs, en particulier, lorsqu'ils avaientint6rdt d _se .rapprocher du camp des Habsbburg. Venise6tait, particulidrement vuln6rable aux pressions d"es Turcs,par son commerce et ses possessions levantines (z).
En face de cette Elrope d6chir6e, grandissait I'Empireottoman. Il englobait d6jd les peuples orthodoxes, d l,excep_tion des Russes, et les Musulmans du Levant. Il s'agrandissaltd'ann6e en ann6e (3).
- Les facteurs principaux de ses progres rapides sont connusdepuis longtemps : administration cent"aiis6e, finances enordre, arm6e disciplin6e quoique fanatique et pillarde d lamoindre occasion ; tol6rance religieuse e[ souci d'un certainbien-dtre d l'6gard des vaincus.
(l) Pour le d6tail, voir E. Funron : Geschichte d.es Europtiischen staaten-sgstems, Miinchen, lglg, pages 69-78, ZB4-297, 800_J06. _ J. Unsu : Iapolitique orientale de Frangois 1"", paris 1909, pages 7-22.
(?) Fun:rrn, op. cit., pages 168-170. - Bnluoor_, La Mdditenanni.e et Ie
Monde Miditenanden, Paris 1g48, t. II, pages 172-174.(3) Bneuonr-, op. cit., t. II; pages 10-16 el ll2_11g. _ FuErER, op. cit.,
pages 175-182.
178 r. HUNyADT
Le tableau offert par l'Empire ottoman avait aussi sesombres, propres d limiter lei succds et d augmenter lar6sistance des peuples attaqu6s : ainsi I'absence de"promotionsociale et culturelle pour les chr6tiens
- sauf au prix d'uneconversion d I'Islam
- les mesures administratives vexatoiresd.leur_endroit, l'orgueil des spahis turcs et l,exploitatio' sanspiti6 des sujets chr6tiens par ces derniers, enfin, la stagnation6conomique d un niveau inf6rieur d celui de l'Europe o"cciden-tale.. Il y a plus. Les bienfaits de la conqudte ne se faisaientsentjr que dans les r6gions pacili6es par les Turcs ; maisla plupart des voisins tr* conniissaient que reur c6t6 gr.rri...Pour eux, les Turcs 6taient surtout des voisins irr.,rpp8.t"fi"r,constamment en qudte de pillages, de massacres et-d,esclaves.cette vision d'horreur compl6t6e par la crainte de la domirra-tion d'6trangers ennemis de la religion, constituaiL un mobilesullisant pour pousser les gerrs I une r6sistance extr6me
"y3lt d'envisager une in6vitable soumission. L'appartenancereligieuse 6tait en e.ffet d'une importance p.i-ordiale porr.I'homme du xvre sidcle.
_ L'inrportance de .la foi explique aussi la conqudte rapided": Balkans par les Ottomans. En effet, I'arrtagorri.meentre catholiques et orthodoxes fut trds vif. Les off.e"s cl,aide49. catholiques 6taient souvent assorties de clauses oud'arridre-pens6es visant d ramener les orthocloxes sousI'ob6dience du_pape ; et m6me lorsque, ce n'6tait pas le cas,les orthodoxes le supposaient. En fin de compte, ils pr6f6raientles Musulmans aux catholiques, sans envisager "". io"rr.t.ro'd l,Jslam (1).
La R6forme fut un facteur suppl6mentaire de querelles enFurope. Les Lutherie_ns, en -poursuivant, lerr"s p.of.",desseins, onl, compliqu6 les taches de la d6fense contre' resTurcs. Leur d6fiance d l'6gard des Catholiques et leur int6r6tnaturel d-monnayer leur aide contre des gaianties ont souvent,annihil6 les efforts ,des autres, sans q,r;on puisse di"e qu;itseussent 6t6 pro-ottomans.
Les peuples catholiques de I'Europe centrale n,avaienflpas de telles craintes et sollicitaient le s6cours de la chr6tient6entidre. Ils surestimaient plut6t les possibilit6s et I'esprii desolidaritd des autres.
". llest- pourquoi les Hongrois n'ont pas h6sit6 d solliciterI'aide des autres puissances chr6tiennes, qui pouvait revdtir
(l) Fuoron, op. cit., page 182.
STITASBOUITG ET LA DEFENSE DE LA HONGRIE (152T.1555) 179
deux formes : I'octroi de subsides ou I'envoi de contingentsmilitaires sur les champs de bataille (1).
II. L',q.rns nrNe.Ncrinn (1521-1529)
Durant cette p6riode I'aide fut financidre. A la suite dela chute de Belgrade (juillet 7521),la Didte de Worms d6cidade d6lib6rer I'ann6e suivante sur la fagon d'aider la Hongriemenac6e. Cette m6me Didte avait vot6 la lev6e de I'escorted'honneur du couronnement, < I'exp6dition romaine > dansl'6ventualit6 de la c6r6monie. litant donn6 qu'entre tempsla guerre avait recommenc6 entre Charles Quint etFrangois Ier, le couronnement fut remis i plus tard.L'empereur proposa d la Didte de Nuremb€rg, - r6unie en1522 - de mettre cette arm6e de 24.000 hommes d ladisposition des Hongrois (2).
Cependant, le sultan s'6tait tourn6 contre la forLeresse deRhodes et I'assi6geait avec toute son arm6e. La Didte,consid6rant qu'il n'y avait pas danger irnmediat, n'en< d6bloqua > qu'un sixidme : 4.000 hommes. La Didted'automne de la mdme ann6e rajouta 3.000 hommes. Cessubsides minimes - vers6s en espdces permettaientpas d'en tirer profit. La Didte d6cida de garder le restantdes hommes pour l'6ventualit6 d'une attaque s6rieuse desOttomans (3).
Les subsides imp6riaux furent organis6s dans le cadre de< I'aide romaine t> ( Rdmerhilfe) appel6e aussi < exp6ditionromaine > (Riimerzua,/. Autrefois, pour le couronnement deI'empereur d Rome, la Didte votait la lev6e d'une escorted'honneur, dont I'entretien 6tait d la charge des 6tats. Apartir du xrve sidcle, I'effectif en fut fix6 i 20.000 fantassinset 4.000 cavaliers ; la dur6e de l'exp6dition 6valu6e d six mois.Les frais en representaient, environ 800.000 fl. rh6nans. LaDidte, en d6clarant la lev6e, r6partissait aussi les contingents.
(l) Les auires puissances chr6tiennes ont aussi consenti des subsides en1526, pour Ia d6fense de la Hongrie ; les sommes envoydes ne sont jamaisarriv6es d Bude. Ainsi Henri VIII envoya 25.000 pidces d'or, le roi duPortugal 50.000 (voir : Szrr-Acvr, V, page 38). La Didte de I'Empire Germaniqueen promit aussi, sans que nous ayions la preuve que les sommes furent r6unies.
(2) Frscurn-GAlArr, op. cit., page 20. -
HonrN-Sznrrii, op. cit., t. lI,pp. 603-605.
(3) rbid.
180 r. HUNYADI
Les villes 6taient le plus fortement impos6es, au point qu'uneville comme Strasbburg avait un contingent presque aussi
important qu'un 6lecteur. Les protestations des villes ne
servaient pratiquement d rien (1).
Quand I;effori de guerre d fournir 6tait trds grand, la DidteaeJiaait de lever lJ Pfennig Commun (Gemeine Pfennig)'C'6tait un impdt d,e 1 o/oo sur le revenu ; les 6tats 6taientcharg6s de Ie percevoir slrr leurs sujets; en cas d'urgence,
ils 6taient mdme oblig6s de verser un acompte important sur
les sommes d Percevoir (2).
Il fut 6videnf d la Didte de l'Empire Germanique que les
subsides vot6s d'urgence n'6taient qu'un palliatif i qu'ilfaudrait organiser des subsides permanents (beharrliche
Tiirkenhilfej por.r pr6voir des travaux de fortification ou
un effort de guerre prolong6. Autrement dit, il fallait pr6voirdes lieux dtntrep6t, oir I'argent aurait 6t6 disponible le
moment venu. La biOte d6cida de d6signer 4 villes d'Empire (a)
pour garder les sommes r6unies. En effet, seules les villesavai"n"t ,ne administration capable de g6rer les grosses
sommes et elles pr6sentaient des garanties en vue de larestitution et mdme du transfert rapide des fonds (a)'
En 1522, il ne fut exig6 de Strasbourg que Ia premidre
tranche, t.380 florins, dont elle s'acquitta int6gralement (5)'
Cette promptitude tranche avec son attitude des ann6es
suivantes.En 1b23, une demi-exp6dition fut lev6e en < espdces r,
mais Strasbourg ne s'en icquitta que partiellement, ou du
(1) Houax-Szrxrii, op. cit.,1ll, pp. 138-I46' - S' K'lr6, Idegen katonastig
Maggarorszagon. Gy6r, 1906' - Le florin rh6nan 6tait une monnaie de compte'
Savaleurfutfix6eenlSSlparordonnanceimp6riale,pr6cisantqueleflorind'argent 6quivaut d I florin d'or ( Gulclen ), ot 72 kreutzers soib 27,563 g. d'argent
fin. "(Hanauer, Iitudes Iiconomiques 1876 ; t' I' Mommaies pages 444-45)'
1Z; eour organisation du Pfennig Commun voir : G' Ecnr-n'la'n' Deutsche
Geschichte im XVI. Jahrhunderl, Stuttgart, 1892, pages 88-90'
(3) Nuremberg, Augsbourg, Francfort et Esslingen (par la suite Esslingen
fut remplac6e Par Ratisbonne).( ) Les bourgeois 6taient solidairement responsables des engagements
de la ville et inversement. Les princes pouvaient facilement contraindre les
villes d respecter leurs engagements par la capture de bourgeois et leur maintien
en captivit6 d titre d'otages. Cette pratique conduisait 6videmment d de graves
abus.Les transferts de fonds s'op6raient par lettres de change, en d6bitant le
partenaire commercial dans la ville, ou il fallaiL disposer de I'argent'(5) Archives Municipales de Strasbourg : Liasse : A'A' 377 13'
STRASBOURG ET LA DEFENSE DE LA HONGRIE (T52T-T555) 181
moins, n'avons-nous que I'attestation d'un regu pour2.250 florins, au lieu des 4.140 florins exig6s.
Pour I'ann6e suivante, aucun versement (1).
Il est vrai que le p6ril semblait contenu par la d6faitede I'arm6e turque op6rant en Hongrie.
D'autre part, I'attention de la ville 6tait concentr6e ailleurs :
sur la dramatique question religieuse dans la ville mdme.En 1523, press6e par I'opinion publique, la municipalit6
autorisa les prdtres d prdcher en toute libert6. L'6vdque etle chapitre protestdrent, mais en vain. Au d6but de lhnn6esuivante, l'6v6que somma les pr6tres dont les discours6taient suspects de luth6ranisme, de se r6tracter. Ceux-cirefusdrent et la ville les soutint, et exigea mdme que leseccl6siastiques 16sidents contribuassent aux charges publiques,comme les laics : ceux parmi eux qui refuseraient de se sou-mettre, 6taient libres de partir. Leurs biens furent confisqu6s.
L'attaque du Couvent Saint-Arbogast, pill6 et, endommag6par le peuple, cr6ait une situation trds p6nible (2). La villene s'arrdta pas ld ; en empdchant d6sormais les voies de fait,elle continuait ses s6cularisations : des 16 couvents, seulstrois se montrdrent irr6ductibles. A la fin de 1525, Ia villeavait un caractdre nettement protestant, en lutte acharn6econtre les eccl6siastiques spoli6s et la R6gence d'Empire quiavait pris position en leur faveur. Le pillage de Saint-Arbogastdonna aux tenants du catholicisme un argument de choix.Mais la ville fit face, et chercha des alli6s parmi les autresvilles et 6tats qui 6taient dans le mdme embarras. L'empereur,occup6 par la guerre en Italie, ne put intervenir ; il secontenta de menacer les Protestants. Sa victoire sur lesFrangais d Pavie, ne le lib6ra pas pour autant, car la guerrecontinuait. Pour comble de malheur, une r6volte paysanne6clata.
Tous ces 6v6nements 6loigndrent dvidemment Strasbourgdu probldme turc. Lors de la convocation de la Didte d Spire,
- mai 1526 -, elle cherchait avant tout d consolider sasituation en tant que Protestante et dans ses instructionsii ses d6put6s, - parmi lesquels figure pour la premidre
(1) En 1525 la ville Ieva un subside extraordinaire contre les Turcs enimposant la fortune et les revenus d un taux progressif. CnAlran, Verwaltunqund Verfassung Strasbourgs 1521-1681, Frankfurt, 1931. Page 131 r6f. IX.(Aucune information concernanI I'emploi de ce subside).
(2) Reuss, op. cit., pages 121-12p,
182 I, HUNYADI
fois le c6ldbre Jacques Sturm, - on trouve, concernantle danger turc, le conseil classique t d'agir de concert avecles autres u (1).
Durant l'invasion de la Hongrie par les Ottomans, on netrouve que trois allusions dans la correspondance entred6put6s : le 30 juin, audition de I'ambassade hongroise venuedemander avec insistance l'arm6e de secours de 24.000 hommespromise en principe 4 ans plus t6t, ; le B juillet, I'archiducFerdinand insistait pour qu'on en d6lib6rAt de toute urgence ;
le 30 juillet : les Hongrois veulent une r6ponse, la sessionn'a rien donn6 (2). Aucun avis concernant I'arm6e de secours,lev6e par le vote du 27 aotrt, mais non employ6e par suite dela d6faite hongroise, connue dds le d6but de septembre.
Pourtant, I'ann6e mdme fut imprim6 d Strasbourg - enm6me temps qu'en d'autres villes - le r6cit de la bataillede Moh6cs, la mort du roi et la fuite de la reine (3). S'il y avaitdonc curiosit6, elle n'allait pas jusqu'd d6lier les bourses.
Le d6sastre de MohScs ne fut pas ressenti comme teld Strasbourg, malgr6 les nouvelles plus ou moins d6taill6esqui y parvinrent : d'ailleurs les Hongrois eux-mdmes ne leressentirent pas ainsi, ni les diverses chancelleries euro-p6ennes, qui continudrent encore pendant quelque temps iconsid6rer la Hongrie comme facteur de politique inter-nationale.
On ne trouve aucun commentaire dans la correspondancede Strasbourg sur la double 6lection royale hongroise. Parla suite, les efforts de Ferdinand pour chasser son adversairetrouvdrent peu de soutien. En effet, d'une part Jean Z6polyafut consid6r6 comme un prince chr6tien, d'autre part, laconqudte de la Hongrie par Ferdinand, fut interpr6t6e commeun accroissement de la puissance 6crasante des Habsbourg,ennemis des Protestants. Au fur et i mesure que les intentionsde Ferdinand apparaissaient - d savoir de faire financercette conqudte en la faisant passer pour une phase de laIutte contre le Turc - I'attitude strabourgeoise se durcissait.
L'archiduc Ferdinand, - roi de Bohdme et de Hongriedepuis 1526 - fut un correspondant infatigable, qui nen6gligea aucun effort pour informer, solliciter, v6ritablement
(l) Politische Corcespondenz der Stadt Strassburg im Zeitalter der Reformation.Strasbourg 1890-1931. (Abr6g6 par la suite par : Pol. Corr.) I, document :
no 450.(2) Por. Corr., doc. I, 456, 362 et 468.(3) Goellner, op. cit., doc.262.
STRASBoURG Er LA DfFENSE DE LA HoNGRTE (l5Zf_15S5) lg3assieger par ses lettres les 6tats ou les princes, desquels iles.perait secours, ou du moins compr6iension. Aiirsi ned6.daigna-t-il pas Stra.sbourg, I'une d". pf". i-po"i"rrt.,villes de I'Empire d l'6poquJ.
, D6jd, en. janvier lb[7,-il 6crivit, d la ville _ comme dbeaucoup d'autres ''- pour lui faire I'historique de ta carrrp"g.returque de I'ann6e pr6c6dente et lui d6peindre les prei.itior*inadmissibles de son rival Jean Zdpoiya; il lui i;p;;; ""peu naivement de lever de la cavalerie ou d'6nvly".
"r,Hongrie - d leurs frais
- des artilleurs et cle la poudre oudes armes. Au bout de six mois ces troupes pourraient passerau service de I'Empereur (r).
. ^Les r€ponses durent 6tre 6vasives car en mars il ne demanda
d.Strasbourgque deux artilleurs ; que cette modeste demandeaitrcu des suites, il n'y.en_a pas la moindre trace. pourtant,le. 21 aotrt, le lendemain de son entr6e triomphale i BuOe,d'oir son rival fuyait 6perdument, Ferdinand ne s,aband*rr"pas aux rdves ; il informa ses fiddles 6tats et alli6s _ dontStrasbourg.- qu'il comptait sur leur aide pour .orr.."rr""la Hongrie (z), comme s'il pressentait d quel point ses .orrq.rCt..6taient fragiles.
De leur c6t6 les protestants 6taient trds perplexes :charles Quint tout comme Ferdinand refusait avec obstinationde leur accorder des garanties qui les auraient mis d l'abride la menace 6ternelle d'une action en justice ou d,uneattaque arm6e des -Catholiques. D'autre part, I,attitudecomplaisante de Ferdinand d-ra Didte de spire et le Sac- cle
IoTg pouvaient 6veiller I'espoir d'une' 6volution desHabsbourg en leur faveur ; il s'agissait, donc de ne rien fairequi prit entraver une telle 6volutiJn. En r6alit6, les Habsbourgne firent jamais rien qui aurait pu profiter aux protes{,ants,sauf quand ils ne pouviient pas faire autrement. Ils refusaientsouvent des concessions mineures qui auraient d6sarm6 lam6fiance des Protestants. Et Ferdinand pr6f6rait p""0."des subsides et un soutien plutdt que de c6der dans uneaffaire ou il consid6rait que la foi catholique 6tait
"rrg"te" ir,.
(t) Pol. Cor., doc. I, 485.(2) Ibidem.
, !3-) ul exemple frappant en fut l'affaire Mieg : Danier Mieg 6[ait assesseur
de Strasbourg au Conseil de R6gence; iI en fut expuls6 en 1b26 par l,archiducFerdinand parce que la vile avait embrass6 le protestantisme. La vilre consid6raI'incident comme un affront et insista auprds Ferdinand durant des ann6espour faire r6int6grer ce poste par son nrsei.err. Ferdinand restail inflexible ;ses relations avec Sbrasbourg restdrenf, tendues trds longtemps. (Voir aussi :Pol. Corr. I, doc. b93).
184 r. HUNyADT
Il est vrai que le Protestantisme 6tait encore en pleineeffervescence et inspirait aux Catholiques plus d'antipathieque de respect ; nombre de pr6dicateurs s'engageaient surla pente antisociale de I'anabaptigme, au point qu'en denombreux 6tats, - dont Strasbourg, - la libert6 du sermon,proclam6e pompeusement quelques ann6es auparavant, dut6tre de nouveau r6glement6e (1527). Les grands du protestan-tisme, Luther et Zwingli, ne purent que constater leurd6saccord complet (1529) (1).
Le p6nible probldme des biens eccl6siastiques confisqu6spar les 6tats protestants auxquels les procds devant letribunal d'Empire n'apportaient aucune solution, faute depouvoir ex6cutif, achevait de dresser les Catholiques contreles R6form6s.
Le moindre geste de Ferdinand en faveur de ces derniers,risquait de d6clencher une r6action incontrdlable de la partdes Catholiques qui accusaient d6jd Ferdinand d'une faiblessecoupable d l'6gard des <r h6r6tiques (2) rr. S'ils ne passaient pasaux actes, c'6tait par crainte que les Habsbourg ne profitentde I'occasion pour consolider un peu mieux encore leurh6g6monie.
III. L',s.rrn MrLrrArRE (1529-1541)
La Didte de Spire (1529) r6unie pour r6tablir I'ordre dansI'Empire et pour organiser la d6fense contre I'attaque desOttomans, 6voluait vers la rupture entre les camps religieux.On s'acheminait donc vers la guerre civile, lorsque tombala nouvelle de la marche des Ottomans sur Vienne. Il fallaitd6lib6rer. Les Protestants exigeaient une tr6ve religieuse surla base du statu quo avant toute discussion de subsides contreles Turcs ; les Catholiques par contre, proposaient une aide< substantielle r d Ferdinand s'il consentait d abandonnerles Protestants d leur sort (3).
Ferdinand se refusa d d6clencher la guerre civile au momentoir les Turcs assi6geaient Vienne ; il avait des doutes quantd la valeur effective des subsides accord6s. Il proposa deremettre le d6bat religieux d I'ann6e suivante et de discuter
Reuss, op. cil., page 130.Fischer-Galati, op. cit., page 34-35.Ibidem.
(l)
trl
sTRASBouRG Er LA DTiFENSE DE LA HoNGRTE (1521-f555) 185
d'urgence des subsides, notamment la lev6e imm6diate d'unearm6e de 24.000 hommes, en eflectifs cette fois-ci 6quivalantd < I'exp6dition romaine >. La proposition fut vot6e, et les6tats catholiques, consid6rant qu'ils avaient sauv6 I'Empire,d'une part d6clardrent qu'il s'agissait bien d'un secoursexceptionnel et non pas du d6but d'une aide permanente,d'autre part en tant que majoritaires, ils r6voqudrent lesdispositions des Didtes pr6c6dentes jug6es favorables auxProtestants.
Ld-dessus les Protestants annuldrent leurs subsides. Menac6sde sanctions fiscales par Ferdinand, ils annoncdrent qu'ilsenverraient une ambassade d Charles Quint.
La municipalit6 de Strasbourg ne prit pas les menaces aus6rieux : elle prescrivit d ses d6put6s d la Didte de protestercontre les actions en justice et contre le maintien i I'ordredu jour de l'6ternel probldme turc qui ne permettait pas auConseil des XIII de s'occuper d'autre chose (1). Elle 6crivitaussi d des villes amies (surtout d Augsbourg, Nuremberg,Francfort et Ulm) pour savoir ce qu'elles comptaient faire.Quelle ne fut pas sa surprise en constatant que ses d6put6sd la Didte la mettaient bien en garde de refuser les subsides (2) !
Les villes amies r6pondirent aussi qu'elles honoreraient leursengagements et feraient peut-dtre m6me davantage : ellesaflirmaient que si les Protestants voulaient b6n6ficier deI'indulgence imp6riale, ils devaient le m6riter par une g6n6ro-sit6 dans le domaine des subsides. L'expression << gebdhrlicheHilfe an Kaiser und Reichr (aide due d llEmpereur et dI'Empire) revenait dans ces lettres comme un leitmotiv.
Devant I'amplification du p6ril turc, l'Empire fut bienoblig6 de passer des simples subsides d l'octroi de contingentset de mat6riel de guerre.
D6sormais, les deux sortes de contributions, financi,ires etmilitaires, seront envisag6es alternativement et souventm6me simultan6ment par la Didte.
Strasbourg devait donc lever son contingent en hommes :
225 fantassins et 40 cavaliers. Quoique le service militaireffit encore obligatoire pour les bourgeois qui devaient s'armerd leurs frais, le service e{Tectif ne consistait depuis longtempsqu'en rondes de nuit et guet. Le restant fut confi6 d desmercenaires faciles d recruter, tant I'offre 6tait grande dans
Pol. Corr., doc. 567.Ibidem, doc. I, 634 et doc. 636.
(1)(2)
186 r. HUNyADT
les ,environs, sauf les chevaux de selle. L,engagement dessoldats se faisait souvent par les soins d'un < entiep'rens,r y (r).
., Strasbourg 6tait bien pourvue de canons et de poudre etil y avait, des bourgeois connaissant le maniement, des bouchesd feu. La ville fut souvent sollicit6e en vue d'un empruntd'artillerie ou d'artilleurs par I'empereur ou les princes'. Lesn6gociations d'octroi 6taient de bonnes occasions pours'assurer des avantages ou des m6nagements.
La lev6e effective du contingent siaccompagnait, de fauxfrais de toute sorte, rendant impossible un caitul pr6alable.
Chaque soldat avait droit, d une prime d'engagement6quivalant a la solde d'un mois ; il fallait encadrer ia"troupepar des ofliciers, messagers, hommes de transport. La plus_value atteignait, souvent b0 %. Et pourtant,, les villes tenaientd subvenir elles-mdmes d leur cl6fense, plut6t qu'd s'end6charger sur l'empereur ou un prince.
On comprend que Strasbourg etrt ete peu encline A recrutersans 6tre -sfire que sa troupe ftrt emp1oy6e. Il est difliciled'6valuer le fardeau financiei que repr6ientait le recrutementcar, comme toutes les villes, Strasbourg gardait jalousementle secret du montant de ses revenusT d'.'-C-a que ceux deses bourgeois. Toute curiosit6 en ce sens 6taif consid6r6ecomme une indiscr6tion. I-es recettes municipales se compo_saient de taxes pergues sur la vente des marchandises, surles charges, sur les revenus fonciers et, de la douane du transit.Les bourgeois faisaient la d6claration de leurs revenus surl'honneur et 6taient assujettis d un imp6t direct de Z o/o,
au-deld de la fortune minimum, fix6e a iOO fl. Les p"rr.,..,se _groupaient pour atteindre le seuil d'imposition (z-).
..{-es r9c9-ttes d6passaient de loin les d6penses et devaients'6lever n 25.000 florins par an au moins (g) car durant la guerre
(1) Voir pour organisation militaire de Strasbourg: Cremer: WehrmachtStrassburgs. Pour I'offre de recrutement, voir lettre du 22 juillet 1b32, pol.Corr. II, doc. no 160, page 170. Sur la notion d'<r entrepreneur militaire rr voirI'ouvrage de Fritz Reor,rcn, The German Militarg Enlerprisers I, II, panten compl6ment du vierteljahrschrift fiir sozial- und wirtschaftsgeschiehte,1963-64.
(2) La taxe sur les ventes 6tait l-2 o/o (Ungeltl. L'imp6t sur le revenu( stallgelt ) fut fix6 d'abord d r ,8 yo (z schillinngs pour une fortune de 1 00 florins)relevd aprds 1532 i\2,5 lo (3 schiuigs sur 100 fl.) cette augmentation fut motiv6edevant les bourgeois par les subsides contre res Turcs ; en r6arit6 elre couvraitaussi les contributions pour la Ligue de Smalkalde. (Voir Criimer, Verw. u.Verf. Stbg., pages 131-t82).
(3) Peut-dtre mome re doubre. voici un incidenl caract6ristique. En 1bbI,
sTRAsBoURG ET LA DfFENSE DE LA HoNGRIE (1521-1555) 187
turque quand Strasbourg dut, d6bourser 10-12.000 florins,elle le fit en protestant, mais sans le moindre signe de difficult6financidre (1).
Tout en d6cidant de s'acquitter des subsides, les XIII setenaient au courant des bonnes dispositions des autres etprirent acte de ce que tout le monde n'avait pas une attitudeaussi patriotique que les villes franconiennes (z). Ferdinand,en tant que R6gent d'Empire et en tant que roi de Hongrie,devait multiplier ses lettres de rappel et envoyer des commis-saires aux 6tats r6calcitrants pour leur arracher I'aide. Sesappels d6sesp616s contrastaient singulidrement avec lessommations hautaines de la R6gence, enjoignant aux 6tatsd'envoyer imm6diatement toute aide prescrite et, si possible,davantage.
Strasbourg arrdta ses subsides i un bataillon de lansquendtsd lever pour le d6but d'octobre, d l'envoi dds juillet de2 artilleurs et au prdt de 50 q. de poudre (a). C'6tait d6jd bienhonorable pour une ville qui pouvait craindre pour sonexistence d cause de la querelle religieuse, mais esperait bien,en levant le contingent le plus tard possible, diminuer lad6pense (a).
Les secours arrivaient au compte-gouttes sous Vienne etn'osaient pas forcer le blocus. Les nouvelles du sidge 6taientde plus en plus dramatiques, les raids turcs pillaient sous
I'empereur tentait d'emprunter 120.000 florins auprds de Strasbourg. La villerefusait I'emprunt, pr6textant d'dtre compldtement endett6e. Le projet motiv6du refus, base de d6lib6ration du <r Petit Conseil rr est conserv6 : il en ressortque la ville a refus6 par crainte de voir venir d'autres sollicitations et parressentiment. (Voir Pol. Corr. V, doc. 143.)
Le fait que la ville avait les moyens financiers pour accorder le pr6t, troisann6es aprds la prestation des formidables rdpartitions de 1548, exclut desrevenus aussi bas. II est caract6ristique que le Conseil de la ville 6vitait m6medans un pareil cas de chiffrer ses revenus. Pourtant ce montant devait 6treconnu de chacun, car les pr6pos6s au Trdsor (Milnzherren) 6taient membresdu Conseil.
(1) Voir plus loin les allusions dans la correspondance des XIII et l'opinionde Criimer dans Verw. u. Verf. Strbg., p. 134.
(2) La ville de Spire avisa les XIII le 11 octobre qu'elle sollicitait und6lai pour s'acquitter des subsides. (Voir Pol. Corr. I, doc. 661.)
(3) Les subsides furent votds par Ia Didte le 22 avril; les XIII d6cidaientI'envoi imm6diat des artilleurs et de Ia poudre encore le 20 avril. Mais le contin-gent ne fut lev6 qu'aprds Ia visite du commissaire imp6rial Fiirstemberg, les2O eI 24 septembre. (Pol. Corr. I, doc. 633, 637, 655-58.)
(4) C'6tait plus que prescrit : en effet, en soldes effectives le bataillonrevenait A 2.000 florins contre les 1.380 fl. pr6vus par la matricule de Worms.
188 I' HUNYADT
Linz (d 180 km. d I'ouest de Vienne) tt,l'1:t-l1l1tt r1::Allemands tourna lentement i la panique' IIs voyarenf, deJa
les Turcs, maitres de Vienne, continuer leur progresslon au
prinbemPs (1).
Les 6tats rh6nans se r6unirent le 15 octobre pour d6liberer
des mesures d prendre en vue de chaque^6ventualit6' Les
Ji"t. p"oposaient de nouveaux subsides : Strasbourg p' ex'
i* i""d. diun deuxidmebataillon pour le B novembre, et l'envoi
imm6diat du premier. Ce dernier partit le lendemain (2)'
En r6alit6, ie siege fut lev6 dds le 14 octobre devanL la
r6sistance h6roique ies d6fenseurs et d cause du froid pr6coce'
auquel les Turci furent trds sensibles'
Cette nouvelle coupa court aux projets de "defense;
et
po,r"i"rrt, Ies Alleman&. t" "'oy"ient pas que ce fo.' YlT:*
fini. Les Viennois Ccrivirent d tous les 6tats en leur demandant
J. g"ta." leurs contingents ; l'6vdque de Strasbourg convoqua
t..i".."r" pour le 2"6 octobre et v'e de discuter de I'aide
contre les Turcs, "6union
d laquelle la ville fut aussi invitee'
Le premier .o"Uttgl"t strasbourgeois (un bataillon . de
l"nsqrrirrets) partiLle i6 octobre < d pltite vitesse >' puisqu'il
t*-p'*"i"t 'to". Uf- que le- 4 rtovembre (210 km' couverts
"r, iO 1o.r"*) ; c'est
"1orr'qn" les.bourgeois d'Ulm Ie pr6vinr-ent
ou'il nouvoif "entre, chez lui, Ia guerre etant finie' ['es
lii"ti r*."iiJ nt."t le chemin dti retour en B jours' on
p;;t ." demander, pourquoi Ia ville n'avait pas- rappel6. son
iontingent plus tdi ; Ct"ii-"t-par^ce qu'un mois de solde 6tait
aiii p'"Ve de toute'fagon? -L" 2" bataillon' dont le depart
eiiit'pt6"" pour Ie B novembre' ne se reunit mdme pas (3)'
N6anmoins, Ferdinand remercia Strasbourg .- comme les
autres -, d'avoiJ "pp"ttO
son aide et il exprima I'espoir
qo;.tt. ferait de meme en cas de nouveau danger (a)'
(1) Pol. Corr. I, doc. 650, 654, 659'
(2) Ibidem, doc. 664.(3) Le d6put6 strasbourgeois d la rdunion du Cercle Rh6nan 6crivait d6jd
le 2l octobre aux XIII, que Ie sidge de Vienne 6tait lev6' Les nouvelles parve-
naient d Strasbourg * i+;ott"''"Donc au 24 octobre au plus tard les XIII
6taient au courant. t-",, *"""g"" rencontra les soldats seulement Ie 8 novembre'
lorsqu'ils 6taient d6jd ,r" f" '"nt*itt
de retour (Pol' Corr' I' doc' 667)' II est
trds frappant de constater ir quel point les nouvelles circulaient vite d cetle
dpoque : les lettres parvenaie'nt e Strasbourg de Spire (130 km) et d'Ulm
(210 km) en aeut-troislot'"' ; tu pri'" de Bude fut connue d Nuremberg 8 jours
plus tard. En effet, tes villes ei les grandes maisons commerQant'es avaient
unr6seautrds6tendudemessagers,toujoursprOtsApartirddsquel'urgenced'unc lettre I'exigeait.
( ) Pol. Con. I, doc. 666' Les artilleurs strasbourgeois restaient d Vienne
jusqu'en decembre 1529 (Pol' Corr' I, doc' 687)'
srttAsBoulic Er LA D6FENSE DE LA HoNGurE (1521-1555) 189
Parmi ces nouvelles rassurantes tomba comme une foudrecelle de l'arrestation par I'empereur de I'ambassade envoy6epar les Protestants pour sonder ses intentions d leur 6gard.En r6alit6 l'ambassade ne fut que retenue d la cour,Charles Quint voulait avant tout di{T6rer sa r6ponse jusqu'ila fin du sidge de Vienne.
Les Protestants r6unis d'urgence pour examiner cettesituation preferdrent 6crire d l'empereur en le priant de bienvouloir reldcher les ambassadeurs, invoquant leur parfaiteloyaut6 durant le danger turc. Entre eux les Protestantsadmirent que malgr6 cet affront, il leur serait trds difficilede refuser leur aide en cas d'attaque turque (r).
L'6chec de Soliman sous Vienne renforga la position deCharles Quint : la Ligue de Cognac, cette coalition anti-Habsbourg, 6tait 6puis6e et la propagande trds active del'empereur pouvait la pr6senter d I'opinion europeenne commepoignardant la d6fense de l'Europe. Le pape se reconciliaavec Charles Quint, le couronna empereur et excommuniatoutes les personnes ayant favoris6 l'attaque turque contreVienne. Aprds le pape, les autres membres de la Ligueconclurent la paix avec Charles Quint (z).
Il revint donc en Allemagne bien d6cid6 d r6gler la questionprotestante, d organiser la d6fense - il comptait sur la bonnevolont6 des 6tats de I'Empire aprds la secousse produite parle sidge de Vienne -, €t enfin, d aider son frdre d reconqu6rirla Hongrie, car par suite de la campagne ottomane, Ferdinandne tenait plus qu'une mince frange du pays d la frontidreautrichienne. Le reste 6tait tomb6 entre les mains deJean Zdpolya (a).
Ce programme ambitieux tr6bucha d6jd sur le ler objectif :
la paix religieuse. Les Allemands tenaient fermement d leursconvictions religieuses et se refusaient d toute concessionmutuelle.
La Didte d'Augsbourg (1530) se trouva dans I'impasse :
les Protestants voulaient obtenir le droit pour tous les 6tatsde pouvoir passer librement au Protestantisme, sans obligationd'indemniser les eccl6siastiques ; les Catholiques n'exigeaientrien de moins que la r6duction des < h6r6tiques D par la force :
(1) Pol. Corr. I, doc. 718.(2) BnaNor, Deutsche Geschichte im Zeitalter der fteformation und Gegenre-
formation, Leipzig 1941. Pages 204-205.(3) Szrr,a,cvr, op. cit., page 78.
190 r. HUNYADT
ils cherchaient aussi d empdcher une nouvelle augmentationde la puissance imp6riale.
_ L'empereur m6nagea donc les Protestants et chercha plut6td les user par l'intimidation, par les menaces et par 6talagedes incoh6rences entre leurs tendances religieuses. Ceux-citenaient bon : leurs th6ologiens 6labordrent vite la fameuseConfession d'Augsbourg qu'acceptaient tous les th6ologiensluth6riens. Les 6tats Zwingliens I'acceptdrent par prudence.Les Protestants se rendirent vite compte que I'empereur lesm6nageait mais ne purent surmonter leurs complexes.Ils surveillaient jalousement leurs adversaires : tout concilia-bule entre princes catholiques ou tout mouvement de troupesimp6riales fut consid6r6 comme dirig6 contre eux. Ils secommuniquaient ces nouvelles dans une ambiance de<< grande peur D, grdce d laquelle nous sommes bien renseign6ssur cette p6riode (r).
La discussion de tout autre probldme fut subordonn6e auprobldme religieux, car les 6tats int6ress6s refusaient des'occuper d'autre chose. Pour arriver d d6lib6rer sur les autresquestions, il fallait attendre chaque fois que la question reli-gieuse soit au point mort.
Parmi les autres questions en suspens il y avait celle duperil turc, dont personne n'osait plus pr6tendre qu'il ftrt6loign6. La convocation de la Didte proposait l'organisationd'une aide urgente (eilende TiirlrcnhilfeJ en cas d'attaquebrusque et celle d'une aide permanente, (beharrliche Ttir-kenhilfe) destin6e i 6liminer le p6ril.
Les propositions strasbourgeoises 6taient dict6es par le bonsens mais irr6alisables dans le contexte politique : < voterI'aide urgente, si les autres faisaient de mdme, - pour 6viterla m6disance
- ne voter I'aide permanente, que si d'autrespuissances chr6tiennes y contribuaient aussi et, si la questionreligieuse 6tait r6gl6e, car avec la m6fiance entre Catfiohqueset, Protestants, personne ne pouvait se sentir en s6curit6 I (z).
Par cette attitude le probldme des subsides fut li6 au cerclevicieux du probldme religieux.
Les instructions de Strasbourg pr6voyaient aussi la lev6edes subsides par le Pfennig commun et demandaient desgaranties pour que les sommes collect6es ne tombassent pas
(1) Pol. Corr. I, doc. 756, 76? et 810.(2) Ibidem, doc. 718.
srRAsBouitc Er LA DTiFENSE Dn LA HONGIiIE (fszf -1555) 191
dans les poches des princes qui les utiliseraient d d'autresfins (r).
Les commissaires imp6riaux d la Didte, en examinant lesinstructions des d6put6s strasbourgeois, furent irrit6s parces clauses, qui selon eux tendaient purement, et simplement,d retarder la d6lib6ration. Ils exigeaient de nouvelles instruc-tions au sujet de la proposition imp6riale (2). Celle-ci consistaitd r6unir et d tenir pr6te la somme n6cessaire d la lev6e d'unedouble exp6dition romaine (soit 48.000 hommes).
La ville, comme les autres 6tats protestants, ne voulaits'engager d rien sans garanties religieuses substantielles;ce que I'empereur ne pouvait leur accorder, press6 commeil l'6tait par les Catholiques. Il essaya donc les bonnes paroleset les apaisements, mais ce fut peine perdue. Devant I'hostilit6ouverte des Catholiques, les Protestants deciddrent de se
liguer et de se soutenir le cas 6ch6ant par les armes (3). Lessubsides contre les Turcs furent pour eux un souci mineur.Ils convinrent entre eux de se r6unir dds la fin de la Didte.
Finalement, la Didte d'Augsbourg, aprds de longs d6bats,ne d6cida rien au sujet des subsides. Charles Quint ne cachapas son irritation (a).
Les villes - catholiques et protestantes - r6clamaientd6jd depuis longtemps la diminution de leur quote-part,trds 6levee par rapport d celle des princes. Pour les villesprotestantes c'etait une raison de plus de refuser le recbset elles estimaient que si toutes les villes se joignaient ice refus, ils pourraient faire fl6chir I'empereur et les princes.Mais plusieurs villes crurent plus sage d'accepter le recds(les princes catholiques leur promirent des all6gementsfiscaux s'ils se montraient raisonnables). En {in de compte,ils n'obtinrent rien mais il fut prouv6 une fois de plus, queles villes ne parvenaient pas d s'unir, donc encore moins ds'imposer aux autres (5). Strasbourg en tirera la conclusionqu'elle devra s'appuyer plutdt sur des princes protestantsque sur la ligue unie des villes. EIle basera d6sormais sapolitique sur cette alliance.
(t) Ibidem.(2) Ibidem, 751,(3\ Ibidem, d,oc.(4) Ibidem, doc.(5) Ibidem, doc.
856.810.828.839.
I92 J. HUNYADI
Charles Quint estimait que la guerre contre la France et
ses alli6s ilaliens pourrait recommencer bient6t, et qu'en
ce cas il devrait laisser d nouveau le gouvernement de I'Empire
entre les mains de Ferdinand. Pour renforcer I'autorit6 de
".f"i-"i, Charles Quint d6cida de le faire 6lire Roi des
Romains (1).
Pour obtenir l'6lection, il fallait apaiser les factions reli-
gieuses, donc mettre sur piedlne trdve, si boiteuse qu'elle ftt'" L" ,6nrrion des princJs (Filrstentagl d Nuremberg aboutitd ce r6sultat : Ies protesiants promirent de s'abstenir des
s6cularisations forc6es, les Catholiques s'accommoddrent
d'une suspension cles actions judiciaires contre les Protes-
tants (2).
En r6alit6, cette tr6ve 6tait plus fragile que ne le croyait
Charles Quint.En ce-qui concerne Strasbourg, Ia joie caus6e par la forma-
tion ae la Ligue de Smalkalds (s) st' par Ia paix^de Nuremberg'
aegetrO"a "rr"
I'"tt"qr-re et la d6molition du Couvent Saint-
Arbogast (c) (en janvier 1531).---i'-C?Cq". de dtrasbourg le signala imm6diatement d la
ne*"", soulignant la mauvaiie foi des protestants (5) ;
te*"et"t. catho-liques en g6n6ral y voyaient une attaque
d6lib6r6e contre ia paix ieligieuse. Les 6tats protestants
prirent 6videmment pTti pour.la ville'' Cha"les Quint et Ferdinand h6sitaient d engager- la proc6-
dure contrJ la ville, comptant sur son aide contre les Turcs'
Strasbourgnecrutp"'.''6c".."irederepondredl'indulgenceimp6riale pa"r de la g6n6rosit6. La mission d'un premier l6gat
i-ie"i"f q,_ri d.-"trlait des < subsides particuliers I (c'est-A-
dire convenus entre empereur et ville) 6choua (Ie 15 mars) t0)'
(1) Ibiilem, doc. 789. < Roi des Romains rr signifiait roi d'Allemagne ;
c,Oiait te titre de I'h6ritier du trdne imp6rial. Jusqu'alors, Ferdinand n'avait
d,autres titres que ceux de roi de Bohome ayant le rang d'6lecteur de I'Empire
et d'archiduc d'Autriche, rang inf6rieur au prdc6dent' Le titre de roi de Hongrie
6tait un titre 6tranger ; ne'rdinand ne I',employait vis-d-vis des Etats de
I'Empire que jusqu'd son 6lection comme <r Roi des Romains rr.
1Zj Wrxcxttr*lixx, Der Schmalkaldische Bund und der Niirnberger Religion'
friede. SLrasbourg, 1892, Page 60'(3) La l-igue de Smatt<ata1 fut une alliance ddfensive arm6e des protestant's
contre une menace de guerre religieuse de la part des catholiques' Conclue
en f6vrier 1531, mais virtuellement acquise dds ddcembre 1530' EIle donna
imm6diatement de I'assurance, voire de la combativit6 aux alli6s'
(4) Pol. Corr. II, Pr6face.(5) Ibidem, doc. 16.
(6) Ibiilem, doc. 26.
STRASBoURG ET LA DfFENSE DE LA HONGRIE (I52T-T555) 193
Nos informations ne nous permettent pas d'apporter desp16cisions.
Mais bient6t des rumeurs circurdrent, selon resqueiles lesOttomans attaqueraient, la Hongrie ou I'Italie du Sud oumdme les deux d la fois. Effectivement, Ferdinand avait tent6des la fin de 1530 de reprendre Buda, mais son arm6e avait6chou6 lamentablement. Le sultan consid6ra ce sidge commeune provocation et voulut se venger ; mais d cause d"e troublessurvenus d la frontidre persane, il reporta ses projets d I'ann6esuivante (1).
-I.'impression faite par le sidge de Vienne 6tait encoretellementvive que, par exemple d Ulm, le peuple, en apprenantla nouvelle menace, exigea de ra municipalitc'q.,'etie versatd l'Empire les subsides contre les Turcs.
- Strasbourg de son c6t6 fut sollicit6e par Ferdinand quidemandait 10.000 florins en vue de la remise en 6tat desfortifications de vienne. Le conseil des xIII I'accordaen principe et d6bloqua imm6diatement 1.000 florins (s)
(le .B .mai 1531). Le versement du reste n'est pas attest6,mais il est probable qu'une partie au moins .tr fr.t vers6eencore.
Dans les instructions pour la didte protestante d Francfort,les XIII pr6conisdrent de voter l'aide urgente contre lesTurcs
- ils- proposaient aux autres protesiants de corrigerentre eux les injustices du taux de contribution. Celteproposition n'aboutit pas
-.- A cette didte protestante, le landgrave de Hesse fit lectured". .9tr- 6change de lettres avec I'arihevdque de Mayence ausujet des subsides : I'archevdque demanda une aidl accrueaux protestants ; le landgrave de Hesse y rdpondit quela g6n6rosit6 des,protestants 6tait d6courag6e p"r 1.. tracas-series des procds fissxux (a).
_ Ce m6me landgrave de Hesse
- temp6rament bouillantet cerveau fertile - proposera aux protesiants de s'organisermilitairement et d'entrer en alliance avec des puiJsances6trangdres ennemies des Habsbourg telles que la France,I'Angleterre, Jean Z|polya, afin de r" g"""rrli, contre uneattaque par surprise de I'empereur. Il y-ajouta qu'ils pour_raient mdme s'appuyer le cas 6ch6ant, suidei 6tats catholiques
(r)(2)(3)
Szilagyi, op, cit., V, pages 87-88.Pol. Corr. II, doc. 46.Ibidem, doc. 52.
I94 r. HUNyADT
jaloux de la Maison Autriche tels que les duch6s de Bavidre,de Gueldre et de Lorraine (1). L'id6e ne fut pas retenue.
De toute fagon I'ann6e 1532 s'ouvrit sur une autre pers-pective, celle de la mar6e turque. Les Allemands savaientque Soliman avait d6fi6 Charles Quint de le rencontrer surle champ de bataille.
En f6vrier la nouvelle d'importants pr6paratifs turcsparvint d Strasbourg via Ulm et fut confirm6e en avril'EfTectivement, une ambassade de Ferdinand, porteuse d'uneproposition de paix, croisa I'arm6e ottomane d Nich, d'oirle sultant ne voulait plus rebrousser chemin.
En avril, les Protestants se r6unirent d nouveau pourexaminer leurs probldmes de d6fense. Ld, ils regurent unelettre du < voivode (2) > dans laquelle il les assurait < que si
les princes allemands n'appuyaient pas le Roi des Romainscontre lui et Ie laissaient en paix dans son royaume' il seraitbien prdt d obtenir du sultan une paix de 10 d 20 ans pourl'Empire r.
Pour les Protestants, cette offre aurait pu 6tre le pointde d6part du projet grandiose de I'alliance anti-Habsbourg'selon les conceptions du landgrave de Hesse. Mais ils n'osdrentpas s'engager sur cette voie et laissdrent I'offre sans r6ponseen depit de la crainte que leur inspirait la Maison d'Autriche'Dans cette attitude intervenait aussi la loyaut6 vis-d-visde I'Empire, une sorte de patriotisme. La Hongrie par contre6tait pour eux un royaume 6tranger, dont les complicationsdynastiques ne les regardaient pas (3). Ils Qtaient prdts icontribuer d la d6fense de ce pays contre les Ottomans maisleur bonne volont6 6tait bien moindre que lorsqu'il s'agissaitde d6fendre I'Empire.
(l) Ibidem, doc. 119.(2) Znpolya fut voivode de Transylvanie, avant d'0tre 6lu roi. Puisque
Charles Quint et Ferdinand ne reconnaissaient pas la validit6 de son 6lectionroyale, ils le firent appeler ( voivode ,r. Les princes allemands I'appeilaiententre eux indiff6remment <,roi Jeanrr ou <voilvode (Waida).
(3) Voir A ce sujet la d6claration du chancelier du duc de Saxe, Briicker,d Ia Didte protestante de Schweinfurt, le 23 avril 1532. (Pol. Corr. II, page 133.)
Le chancelier du duch6 de Saxe r6suma la position protestante en ces termes :
<...nonobstant des bons droits de Ferdinand d la couronne de la Hongrie,c'est un fait que le sultan prend parti pour I'adversaire et cr6e toutes sortes
de menaces d l'Empire par sa puissance irrcommensurable. La guerre en
Hongrie entrave le commerce aussi ; si le roi Jean peut apaiser les Turcs,I'empereur devra servir de m6diateur entre les rivaux de fagon que I'Empirene soit pas d6vast6... I (Pol. Com. II' doc. 140.)
STRASBOURG ET LA DfFENSE DE LA HONGRIE (1521.1555) 195
Ce sentiment loyal 6tait en contradiction avec leur m6fiance
i l'6gard de I'empereur : certains 6tats protestants- s'inqui6-tdren]t de savoir si les pr6paratifs militaires de ce dernier ne
se dirigeraient pas contie eu* ; comme si c'6tait le moment (1)'
La Didte, convoqu6e d Ratisbonne (mai 1532)' devaitprendre des mesures pour qu'une invasion par les Turcs ne
puisse avoir lieu, comme trois ans auparavantLa proposition imp6riale 6tait de lever une double c exp6di-
tion rbmaine I de 48.000 hommes, c'est-i-dire un contingent,et qu'en outre chacun fasse I'effort maximum, notammenten fournissant de l'artillerie.
Les d6put6s strasbourgeois notaient ces d6tails avec une
certaine perplexit6 : ils conseillaient aux XIII de refuser
toute aidl ti ,ttt. paix r6elle ne leur 6tait accord6e; si oui,iI y aurait lieu de r6unir le contingent de B0 reitres et
50d lansquenets qui devraient 6tre d Vienne le 15 aotrt'Les villes amies, t-elle que Ulm, Francfort, etc., contribue-raient de toute fagon ; comme on recrutait partout, il faudraits'assurer du contingent dds maintenant. Les Catholiquesfourniraient I'aide ; les Protestants devraient faire de m6me,
sinon, ils seraient rendus responsables de la d6faite (2)'
La nouvelle de I'amiv6e du Sultan d Belgrade d6clencha
une ambiance de panique d la Didte : Ies 6tats votdrentrapidement I'aide urgenfe de 48.000 hommes et s'engagdrent
d iecruter les effectifs imm6diatement (le 22 juin). Ils avaientI'impression que les ottomans seraient d la frontidre avantque les -".,r".. les plus 6l6mentaires n'aient 6t6 prises (3)'
Outre les rapports des d6put6s, la ville de Strasbourg futinform6e de ces d6cisions par rescrit imp6rial du 24 juin ;
son aide fut fix6e d B0 cavaliers et 450 fantassins pour6 mois : ces troupes devraient faire partie du contingent du
Cercle Rh6nan. A la r6union du Cercle, pr6vue pour Ie
15 juillet, devraient 6tre d6sign6s le capitaine et les officiers
des troupes (a).
En -bttt" temps parvenait un autre rescrit imp6rial,indiquant que I'aide vot6e serait insu{fisante pour contenir
(1) PoI. Corr. II, doc. 138.
(2) lbidem' doc. 146.
(3) Ibidem, doc. 148.
iA) Le rescrit impdrial imprim6 contenait m6me la recommandation d'orga-
niser une messe solennelle pour Ia victoire des armes chretiennes. Le fait de
I'avoir adress6 ir des protestants, constitue une singulidre b6vue. (Pol. corr. II,doc. 149-50.)
196 r. HUNyADT
la mar6e turque ; I'empereur demandait d la ville une < aideparticulidre >> (sondere Purtikularhilfe) LottL comme aux autres6tats : elle devrait lever 2 d 3 bataillons (1 bataillon:500 hommes) pour occuper les cols et d6{il6s des frontidresjusqu'A l'arriv6e de I'arm6e imp6riale. L'empereur les assuraqu'il n'oublierait jamais un tel service et en tiendrait comptelbrs de toute autre affaire de la ville dont il serait saisi (1).
Mais, il parut dangereux aux XIII de proposer un march6ouvert d I'empereur et de demander des garanties religieusesformelles en 6change de subsides suppl6mentaires. IIspr6f6rdrent, charger leurs d6put6s d la Didte de protestercontre le principe obligatoire des subsides, d'annoncer que des
n6gociations 6taient en cours et de lui demander de
patienter (z).
La r6union du Cercle du Rhin Sup6rieur (3) eut lieu le14 juillet. Les ofliciers furent nomm6s, la solde fix6e.Strasbourg s'accorda encore huit jours de r6flexion - quoi-qu'elle strt d'avance qu'elle contribuerait, -.Le recrutement commenga le 22 juillet, et les fantassinspurent partir pour Vienne le 29 juillet. Les cavaliers furentplus difliciles d r6unir du fait de la raret6 des chevaux : ilsne furent prdts que le 12 aofrt. Le capitaine de la cavaleriefut le commandant du contingent entier : le stettmeister (a)
Bernard Wormser.L'effectif 6tait incomplet : 75 reitres et 388 lansquendts,
en plus officiers et train ; en tenant compte des double-
(l) Pol. Corr. II, doc. 150. Lettre de I'empereur aux XIII. du 29 juin 1532.
En r6alit6, l'empereur avait d6jd demand6 d Strasbourg, Ie 12 juin, de Iuipr0ter canons el, munition pour la ddfense des frontidres. La ville ne donnapas suite d cette premidre demande. Elle ne voulut pas faire davantage au sujetde la deuxidme lettre non plus, sauf si des garaniies s6rieuses 6taient accord6esaux protestants.
(2) Pol. Corr. II, doc. 155.(3) L'Empire 6tait divis6 cn dix Cercles depuis Maximilien Ie", pour per-
mettre aux 6tats d'une m6mc r6gion de discuter de leurs probldmes particuliers'Les contributions en argent et en contingents 6taient r6unies par Ies Cercles.
Le terme < Oberrheinischer Kreis r est traduit par les auteurs frangais part Cercle Rh6nan ) ou par < Cercle du Rhin Sup6rieur. r
(4) Le stettmeisler avait le rang d'un maire. II devait €tre bourEleois de souchenoble; ses fonctions 6taient au xvr" sidcle surtout repr6sentatives; mais ilparticipait activement aux affaires de la ville en lant que membre du PetitConseil. La d6signation d'un stettmeister pour ce poste de commandement,tout en soulignant I'importance de Ia participation de la ville, avait encoreun but pr6cis : empdcher l'emploi de la troupe d toute aulre fln que celle ducombat contre les Paiens.
STRASBOURG ET LA DfFENSE DE LA HONGRIE (T52T-1555) I97
soldes, courantes d l'6poque, le contingent repr6sentait499 soldes d'infanterie et 92 de cavalerie, donc au-dessus des
exigences. La note municipale envoy6e avec \Mormser rappelleque les subsides s'entendaient en solde et pas en effectif ;
donc la ville avait rempli ses obligations au-deld de ce qui6tait prescrit (r). Les inspecteurs imp6riaux par contrer6clamdrent toujours des contingents aux effectifs completssans tenir compte des double-soldes.
Aucun d6tail n'est connu quant aux 6tapes de marche ducontingent ; en se basant sur celle de I'ann6e 1542 elle devaitdurer 20-22 jours au moins. D'aucune fagon les Strasbourgeoisne pouvaient 6tre sous Vienne avant le 20 aotrt. De m6mebeaucoup d'autres contingents. Heureusement pour I'Empire,les Ottomans au lieu de longer le Danube pour faciliter les
transports, pr6f6rdrent avancer entre la Drave et le lacBalaton et connurent des grandes difiicult6s de transport etde ravitaillement. Un petit, chAteau d la frontidre autri-chienne, K6szeg (Grins) r6sista au sultan et se d6fendith6roiquement du 5 au 28 aofit avant de capituler. Ce retardpermit d I'arm6e imp6riale de se r6unir sous Vienne etd'avancer vers le sud jusqu'd Wienerneustadt au momentoir Soliman levait le camp. (Ils 6taient d moins de 60 km.I'un de I'autre.) Le Sultan 6vita la bataille en se tournant versle sud-ouest et, aprds avoir d6vast6 Ia Styrie, iI reprit le
chemin de Constantinople, en d6clarant qu'il avait cherch6Charles-Quint mais ne I'avait pas trouv6 (z).
Il est vrai que seules ses troupes pillardes furent mises en
d6route par les imp6riaux, Charles Quint fut probablementcontent de s'en tirer d si bon compte et ne risqua pas une
poursuite i travers la Hongrie ; il arrdta ses troupes .d lalrontidre de l'Empire et d6clara la campagne termin6e,malgr6 I'avis de Ferdinand et des o{Iiciers d6sireux d'allerplus avant (s). Il faisait d6jd trds froid et les pluies torrentiellesont sirement refroidi les ardeurs belliqueuses des deuxcdt6s (a). Par contre il est certain que les effectifs allemands
(l) Il y avait 388 lansquenots, dont 51 d double-solde, un capitaine, 3 cadets,
I aum6nier, 2 charretiers, Parmi les reitres il y avait un capitaine, un cadet
et 7 cuirassiers I le nombre des courriers, des charretiers et celui des charrettes
n'est pas pr6cis6. (Pol. corr. II, doc. 160 et Archives Municipales de strasbourg:r6sum6 des liasse : A.A. 436-37.)
(2) Ha.rulrnn-PuRGSTALL' op. cit., II, page 94.
(3) SzIr-AcvI, op. cit., V, Page 95.
(4) H.tltunn-PuRGSTALL' op. cit.,II, pages 86'96, description de la campagne'
198 r. HUNYADT
s'6taient r6unis trop tard pour tenter un d6gagement de
K6szeg. L'arm6e imp6riale lut dissoute Ie 15 octobre, mais
en r6a'iit6 les contingents commencdrent i rentrer chez eux
dds le 15 septembre, quand I'empereur lui-m6me quittal'61m[g (r).
La d6monstration militaire cotrta tout de mdme, d
Strasbourg, la somme coquette de 12.050 florins, selon le
d6compte du 2 d6cembre, au lieu de 9'300 fl' en calculanten sold'es, sans qu'on puisse pr6ciser la raison du suppl6ment''
Et encore 2 reitres -se
plaignirent de n'avoir pas touch6
leur solde en totalit6 (2) !
Cette campagne fut pleine d'enseigneme.nts- qo-Yt. l"tcontemporaini : I'Empire d6montra q''il 6tait d6cid6 i se
d6fendre, mais pas d entreprendre une action militaire en
Hongrie ; les Otiomans se rendirent compte qu'il 6tait tropt6t p"our envisager des conqudtes au-deld de la Hongrie, car
les resistan"". j' 6taient trop vives (g) et Ie temps propice
d la conqudte etait tellemenl r6duit que-.la r6sistance.d'unpetit chAi,eau pouvait rendre impossible d'autres op6rations'bes co-plications dans ce pays encourageraient les Italiensd attaquer la Grdce, ce qui arriva (en Mor6e) en 1532'
En ilongrie, les partisans des rois rivaux purent mesurer
I'aide de l6nts ptotecteurs allemands ou turcs i leur juste
valeur ; la camplgne avait finalement consacr6 le statu quo'
Aprds Ie double 6chec turc d trois ans d'intervalle, le p6rilapparut moindre aux Allemands. Ils avaient le sentiment que
.i ,-,tr ar.tger existait, ils en viendraient d bout pal gl.efTortnotoire. Pbur eux la situation en Hongrie 6tait I'affaire de
Ferdinand : s'il voulait en chasser son rival, qu'il en payAt
le prix en complaisance ou en espdces' Ils refusaient de
financer les projets dynastiques er Hongrie d titre $'a1deimp6riale po"" la d6fense de Ia foi. N6anmoins cette rivalit6ne leur plaisait Pas
(4)'
Chez les Protestants, la crainte des Habsbourg et le d6sir
d'obtenir des garanties 6tendues diminuaient encore davan-
tage la volontE de soutien. Le landgrave de Hesse imagina
(1) Pol. Corr. II, doc. 165.
iz! arcftives Municipales de Slrasbourg, r6sum6 des liasses : A'A' 436-37'
concernant Ia participation strasbourgeoise A la campagne de 1532' - Pol'
Corr. II, doc. 160.(3) SzrlAcvr, oP. cit., V, Page 37.
iaj Voi" plus haut (page tOa, note 3) la ddclaration du chancelier de Saxe'
sTRASBouRG Er LA D6FENSE DE LA HoNGRTE (152I-1555) 199
de combiner les offres de subsides avec le renforcement ducamp protestant ; lorsque le nombre des 6tats protestantsinqui6ta les Catholiques au point de faire d6border le vase,il engagea vite la n6gociation avec Ferdinand au sujet dessubsides.
La plus c6ldbre occasion en fut celle du duch6 de Wurtem-berg. Le duc fut mis au ban de I'Empire en 1512 eLI'empereur Maximilien r6ussit d s'assurer I'int6rim. Le duc,desesp6rant de rentrer en possession de ses biens, cherchaappui chez les Protestants et se convertit. Une coalition pro-testante le r6installa dans son duch6 par la force et avanttoute r6action des Habsbourg, le landgrave de Hesse leur pro-posa des subsides substantiels contre les Ottomans s'ils ac-ceptaient le fait accompli tt) (Trait6 de Cadan 1534).
Ferdinand eut la faiblesse de I'accepter, quoique par lasuite les subsides protestants s'av6rassent assez maigres,sous pr6texte que le Roi des Romains interpr6tait les clausestrop 6troitement. Charles Quint, engag6 dans une nouvelleguerre d'Italie contre la France, Venise et I'Angleterre nepouvait pas intervenir.
On se souvient qu'avant le sidge de Vienne, Ferdinand serefusa d de bien moindres concessions dans le domairrereligieux. Si Ferdinand accepta ce march6 ce fut parce qu'ilvoulait forcer la d6cision en Hongrie. Il fit d6jd de son mieuxpour organiser ses 6tats, y compris la partie de la Hongriequi restait en sa possession, cr6a un gouvernement central(Hofrat) appel6 d prendre les mesures concernant d la foisla Hongrie, la Bohdme et I'Autrichs (z). Par des effortssoutenus il parvint A cr6er une arm6e permanente modeste.GrAce d la fortification du chAteau de Gy6r (Raab) commenc6en 1437, il verrouilla le Danube et mit Vienne d I'abri d'uncoup de main des Ottomans. Par contre son rival Jean Z6polyalaissait aller son pays d la d6rive : il ne pouvait pas s'imposeraux seigneurs, et il ne fit rien pour I'entretien des chdteaux,sauf Bude. Son int6rdt pour l'arm6e moderne resta au stadede curiosit6 theorique (a).
Les seigneurs hongrois, comprenant I'effet catastrophiquede la double 6lection, cherchdrent d rem6dier d la situation :
certains 6taient partisans de d6poser les deux rivaux et
FrscnBn-Gar,llr, op, cit., page 58.Horra,rs-Szsxnt, op. cit., III. pages 63-74,Ibidem, page 116.
(1)(2)
\o/
200 I. HUNYADI
d'en 6lire un troisidme plus capable i leur place' Cette
exlr6mit6 fut 6vit6e, mais ce fut un argument de.plus pour
Ferdinand de chercher les moyens de s'imposer' Finalernent'
Ies deux rois se mirent d'actord dans le trait6 de V6rad
iiEgSi porr" qr'd la mort de Jean, Ferdinand ftrt seul h6ritier
du trdne ; I'empereur se porterait garant de la d6fense du
roy""-. et les hbritiers de Zfpolya- seraient d6dommages'
Ferdinand obtint m6me I'hommage du voivode de Moldavie
en 1535 : cette alliance aurait pu 6tre utile au moment
d6cisif (1).- -S"nt.-.nt,
Ferdinand ne d6daignait pas les coups bas ;
if ".fe""it par Id abattre son adversaire' En pleine paix
4".d. il vtulut s'emparer -d'Esz.6k, point- de passage des
Turcs sur la Drave : Ie Loup de main 6choua lamentablement'
mais irrita Soliman. Le de-uxidme coup bas fut de d6noncer
il p;;. de V6rad au sultan mdme, en esp6rant que celu,ici
abandonnerait Jean ZSpolya par d6pit' Le sultan se doutait
ilil ;; qrrelque chose'et, "" tng8, iI r6duisit la Moldavie
d Ilob6issancel I'annee suivante, il d6vasta le pays de Zdpolya
"i i* "o"t"aignit
d payer le tribut, dont celui-ci avait 6t6
exemPt jusque-li (z).
Dans ce contexte on comprend mieux que Ferdinand,. peu
pourvu de moyens financieis, ait accept6 des subsides d un
iri" orre".nx. il sollicitait les 6tats pour des subsides parti-'culiers
- en I'absence de p6ril turc caract6ris6' iI 6tait
difficile de solliciter la Didte -l' L"t 6tats profitdrent- de- cette
situationetr6pliqudrentdsesdemandesr6it6r6esend6clarantq". .i le. provinces autrichiennes 6taient tellement menac6es'
ii faudrait en pr6venir la Didte (s)' Comme ces pro.vinces
6taient inqui6t6es par des incursions rapides et impr6visibles'p""ai.r"tta pr6f6ra - plutdt que d'avoir recours i une Didte
alourdie par tes lenteurs administratives .- utiliser son
arm6e permanente, qui occupait les d6fil6s, et des subsides
n6goci6s directement.Le, plns g6n6reuses 6taient encore les villes du sud' et du
sud-e.L (Nu"remberg, Augsboutg, -UlT., etc'),, celles
9"^11 t"
commerce avaib le-plus b"esoin fe la bienveillance des AuLri-
chiens. Strasbourg 'et"it ptrr. r6ticente; souvent' elle c,acha d
p"in. .o" indiff6rJnce, po.r" l'6quip6e hongroise de Ferdinand'
(l) Szrr-Acvr, oP' cit.' V, Page 130'
izj uo*o*-srixri3, op. cit., III, pages 20 et 45-46'
(3) Pol. Corr. II, doc. 438-439'
200 r. HUNyADT
d'en 6lire un troisidme plus capable d leur place. Cetteextr6mit6 fut 6vit6e, mais ce fut un argument de plus pourFerdinand de chercher les moyens de s'imposer. Finalement,les deux rois se mirent d'accord dans le trait6 de V6rad(1538) pour qu'd la mort de Jean, Ferdinand ffit seul h6ritierdu trdne ; I'empereur se porterait garant de la d6fense duroyaume et les h6ritiers de Z6polya seraient d6dommag6s.Ferdinand obtint m6me l'hommage du voivode de Moldavieen 1535 : cette alliance aurait pu 6tre utile au momentd6cisif (1).
Seulement, Ferdinand ne d6daignait pas les coups bas ;
il esp6rait par ld abattre son adversaire. En pleine paixturque il voulut s'emparer d'Esz6k, point de passage desTurcs sur la Drave : le coup de main 6choua lamentablement,mais irrita Soliman. Le deuxidme coup bas fut de d6noncerle pacte de V6rad au sultan m6me, en esp6rant que celui-ciabandonnerait Jean Z6polya par d6pit. Le sultan se doutaitd6jd de quelque chose et, en 1538, il r6duisit la Moldavied I'ob6issance ; l'ann6e suivante, iI d6vasta le pays de Z6polyaet le contraignit A payer le tribut, dont celui-ci avait 6t6exempt jusque-ld (z).
Dans ce contexte on comprend mieux que Ferdinand, peupourvu de moyens financiers, ait accept6 des subsides d unprix on6reux. Il sollicitait les 6tats pour des subsides parti-culiers - en I'absence de p6ril turc caract6ris6, il 6taitdiflicile de solliciter la Didte -. Les 6tats profitdrent de cettesituation et r6pliqudrent d ses demandes reit6r6es en d6clarantque si les provinces autrichiennes 6taient tellement menacties,il faudrait en pr6venir la Didte (3). Comme ces provincesdtaient inqui6t6es par des incursions rapides et impr6visibles,Ferdinand pr6f6ra - plut6t que d'avoir recours d une Didtealourdie par les lenteurs administratives - utiliser sonarm6e permanente, qui occupait les d6fil6s, et des subsidesn6goci6s directement.
Les plus g6n6reuses 6taient encore les villes du sud, et dusud-est (Nuremberg, Augsbourg, Ulm, etc.), celles dont lecommerce avait le plus besoin de la bienveillance des Autri-chiens. Strasbourg 6tait plus r6ticente; souvent, eIIe cacha d
peine son indiff6rence, pour l'6quip6e hongroise de Ferdinand.
Szrr,Acvr, op, cit., V, page 130.Hon.q.x-Szsrli3, op. cit., III, pages 2o el 4b-46.Pol. Corr. II, doc. 438-439.
(l)
(3)
STRASBOURG ET LA DEFENSE DE LA HONGRIE (152I-1555) 201
La prise de Tunis par I'empereur fut not6e avec joie etla ville consentit i vendre d cr6dit 100 q. de poudre etquelques milliers de lances - elle devait 6tre pay6e par lasuite, car la ville n'avait pas r6clam6 (1) (1536).
L'ann6e suivante, Ferdinand sollicitait de nouveauxsubsides : de la poudre et des effectifs. Le Conseil des XIIIs'enquit auprds des villes amies s'il fallait I'accorder ou non :
presque toutes I'avaient accord6 et ld-dessus Strasbourgavait aussi donn6 une promesse de principe, lorsque la r6uniondes 6tats protestants demanda ri tous d'annuler les subsidessauf s'ils I'avaient d6jd formellement promis. En effet,Jean Zipolya les pr6vint qu'il n'existait aucun dangerturc : la paix 6tait en vigueur, I'attaque 6tait destin6e contrelui. Strasbourg avait 6videmment annul6 son offre, sonengagement n'6tant encore que de principe (2). Les Protestantsfirent savoir d Ferdinand que I'octroi des subsides relevaitde la Didte (s), ce qui 6tait inexact et contredisait le trait6de Cadan.
L'ann6e d'aprds, ce fut la paix de Charles Quint avecFrangois Ier et la r6conciliation d'Aigues-Mortes. Lesprotestants sentaient qu'il serait recommandable de semontrer plus g6n6reux. L'6lecteur de Saxe proposa au nomdes Smalkaldiens une aide substantielle si l'empereur leurconc6dait des garanties s6rieuses (le 9 juillet 1538) (4). Lespourparlers eurent lieu d Francfort. Les instructions stras-bourgeoises pr6voyaient I'offre des subsides en cas d'attaqueturque impr6visible ; sinon la convocation de la Didte (b).
Les Protestants qui croyaient pouvoir imposer leursconditions d l'empereur - qui 6tait mdl6 d une nouvelleguerre contre les Ottomans (0)
- exigdrent I'admission aub6n6fice de la tr6ve future tout 6tat passant au protestan-tisme par la suite.
L'empereur ne c6da pas et enfin la trdve fut, conclue pour15 mois aux conditions suivantes :
(1) Ibidem, doc. 362.(2) Il s'agissait du coup de main autrichien sur Esz6k, qui tourna au d6sastre.
La d6faite ne fit pas autrement impression d Strasbourg. (Voir aussi pol.Corr. II, d.oc. 479.)
(3) Pol. Corr. II, doc. 509,(4) Ibidem, doc. 533.(5) Ibidem, doc. 494, 536.(6) Guerre de Charles Quint, de Venise et de G6nes contre les Ottomans
en Mor6e. (Hammer-Purgstall, op. cit., II, pages 160-162.) Nouvelles commu-niqu6es par Ulm aux XIII, le 19 juin 1538. (pol. Corr. II, doc. 520.)
I, HUNYADI
1) les 6tats passant au protestantisme par la suite neseront pas inclus ;
2) durant la tr6ve, aucun nouveau prince ne sera admisdans la ligue catholique ;
3) si les Protestants admettent de nouveaux membres,la tr€ve expirera au bout de 6 mois, sauf si I'empereurI'accepte (20 avril 39).
L'empereur ajouta la promesse d'organiser un colloquereligieux pour r6tablir I'unit6 de la foi, voyant que le concilene se r6unissait pas (r).
Les villes - Strasbourg en t6te - 6taient pour I'acceptationet promirent m6me des subsides d deux conditions : extensionde la trdve aux nouveaux protestants, diminution desquotes-parts des villes, fix6es depuis 1521. Les princes leurr6pondirent assez vertement qu'elles devaient accepter leursd6cisions. Les villes protestdrent, mais les choses en restdrentld.
Par son attitude conciliante Charles Quint cherchaitvisiblement d se donner de I'air car il s'attendait d de nouvellescomplications internationales. Il savait que la paix reposaitsur des bases bien fragiles.
La r6conciliation avec la France avait pour prix la cessiondu Milanais au duc d'Orl6ans. Cette perte aurait coup6 de
I'Allemagne les possessions italiennes de' Charles Quint.Il h6sita et perdit ainsi la confiance de Frangoit 1er quirenoua imm6diatement I'alliance turque (z).
L'Espagne 6tait m6contente des absences prolong6es de
son roi et soufTrait des pillages des Barbaresques. Les Cortdsrefusaient d6jd en 1539 I'emploi du produit des impdts en
dehors de la p6ninsule. Pour les apaiser Charles Quint leurpromit de chAtier les Barbaresques en prenant leur nidprincipal : Alger (e).
Les Pays-Bas 6taient au bord de la r6volte d cause des
imp6ts de plus en plus lourds, profitant d des pays 6trangers.Finalement, selon le trait6 de V6rad I'empereur se portait
garant de l'ex6cution des clauses. Il devait donc pr6voirdes forces sullisantes, pour d6courager une attaque turque
(l) Bn-lxor, op. cit., page 249. Pol. Corr. II, doc. 608.(2) Bn,a.Nnr, op. cit., page 254, pour les d6tails : CnnoauNs : Von Nizza
bis Crdpg, 7877. Urstt, op. cit., pages l14-45.(3) Szrr,.6,cvr, op. cit., V, page 230, Pol. Corr, II' 595'
sTRASBouRG E'r' LA DIiTENSE DE LA HONGRIE (f521-1555) 203
sur la Hongrie, lorsque Jean Z6polya ffrt mort' Par suite de
ses soucis dans les "nltes
r6gions, il ne put rien faire jusque-ld ;
et il 6tait 6vident qu'en cas de nouvelles complications,c'est encore la question hongroise qui glisserait d I'arridre-plan (t)'-
Du cdt6 de Ferdinand ce n'6tait gudre brillant non plus'Juste avant de mourir, Jean ZSpolya eut un fils. Il cherchabien strr i sauvegarder le trdne pour lui, en d6pit, du trait6'Aprds sa mort ses conseillers poursuivirent cette politique'Pour les faire fl6chir, il aurait fallu au moins leur rendre les
possessions familiales des Z6polya, dans lesquelles Ferdinandavait autrefois install6 ses propres fiddles, qui ne voulaientpas en sortir. Or il fut bientdt clair, que le parti des Z6polyane c6derait pas le chAteau de Bude avant d'obtenir satis-faction (2).
Ainsi, le dessein de Ferdinand 6tait de retarder I'attaquedu sultan par n'importe quel moyen jusqu'au moment oir
il aurait ass-ez de forces pour d6fendre la Hongrie efficacement'Ses chances d'y parvenir 6taient bien faibles : il avait vendului-m6me la m6che d Soliman au sujet du trait6 de V6rad'Ce qu'il ne savait pas, c'est que Frangois Ier n6gociait d6jdd Constantinople le renouvellement de I'alliance ottomane'Il d6cida donc de donner le change au Sultan par I'envoid'une ambassade d la Sublime Porte d Constantinople et de
s'emparer entre temps de Bude par un coup de main' Dansce but, il sollicita des subsides particuliers d I'Empire'
Prenons I'exemple de Strasbourg : Ferdinand 6crivit au
Conseil des XIII en aotrt 1540, leur annongant le d6cds du
< voivode I Jean ZSpolya. Par la m6me occasion, iI leurdemanda I'envoi d'un bataillon en Hongrie pour s'assurerla possession de ce royaume. Il leur proposa' afin de gagner
du temps, de recruter des soldats en Autriche (3).
Le ionseil des XIII jugeant imprudent de soutenirFerdinand - snnsrni des Protestants - et supposant mdme
que la demande visait d d6munir la ville en argent et en
rnercenaires, r6pondit n6gativement ; il promit vague-m91t'qu'il serait pr6t a fournir son aide dans le cadre des subsides
d'Empire (ni. Les XIII 6taient quand m6me inquiets de
(l) SzrlAcvt, op. cit., V, Page 214'(2) lbidem.(3) Pol. Con. III, doc. 82.(4) Ibidem, doc. 89.
204
s'attirer la coldretions en vue dunpas.
I. HUNYADI
de l'empereur et ils engagdrent cles n6gocia_pr6t sur gages mais celes_ci ,'"bor?i".rrtLes nouvelles rassu.rantes, provenant de la cour imp6rialeA Anvers, y contribudrent certairrernerrt ; la ville apprlt queles Turcs ne chercheraient pas a-"iinq"". et que l,empereuressayait de s'entendre avec les protlstants en o"g;;rir"rrtdes colloques religieux. Il projet*""it
"r, pf"r-'r"""!.""a"campagne I'ann6e suivante por" tile"e, t" Horrgrir"(riLe projet, de Ferdinand, de mettre la main ,rri lu Hongriepar ruse et par dissimulation, 6choua : son arm6e ne parvintpas d s'emparer de Bude --'seulement de pest, et d,Eszte_gom
-; et son ambassadeur d Constantinople qui J."ritdemander I'investiture du tr6ne t orrg"oi* pour son maltre,-- moyennant tribut _ faillit 6tre ex6"cut6 par te ;;ld;;"""cette t6m6rit6 (z).
Soliman avait d6sormais toutes les raisons de se hAterp_our empdcher que la. Hongrie ne tombe .rrtr. t", ,'"irr.i".Habsbourg. II n'avait phis ";;fi;;" dans le parti desZipolya. Le renouvellement d; i;;lii;".e avec Franssis 1er(sign6 en d6cembre
.1b40) rui ao""J],;;;;;;J"[l'J ,",forces de Charles euint "".t.""iJ-Jii,rr"...Les Italiens. ayant de bons agents d Constantinople,apprirent et repandlr"rt r" ""r"}e fri?ntot d bravers'Eurbpeque, Soliman parLirait au prinLemp, J t, conqu6Le d. B;;..Seul.le parti des Zlpolya crrt qui les Trrcr rr. p".na[i.ntpas le chAteau ou.tout- au. plus'q,r,ii. le .endraidni-""."-it",comme en 1b29. Ils apprirent avec soulagement, l" ;;""prochaine du sultan, l,entree dans le p"y."d" I,a.rarrt_ga"deottomane dds d6cembre et sa ma""he su1 fifuflg (a).Les 6chos de ces .luttes parvinrent jusqu,d Strasbourg.Par les soins d'Augsbourg, i.. iifJ- npprirent la prise dePest et d'Esztergom par FerdinanJ et le sidge infructueuxde Bude (r). Sel6n des te-oins verrir. ae ld_bas, sans le< Frdre y (s), le chAteau se serait d6jd rendu d Ferdinand ;
(7) Ibidem, doc. 91(2) Frscurn-GAlArr, op. cit., page 77.(3) HouaN-Szaxrfi, op. cit., ill, pages 42_43.(1) Pot. Corr. III, doc. 128.(5) Le pdre augustinien GT,"g": Ufesenovii, d,origine croate, 6tait connuaussi sous le nom de .u -9":., Martinuzzi,
"t .oua *o surnom, celui de <r Frdre rou < Frdre Georges r. Il 6tait depuis l5?i uu ,urui* de Jean Zdpolya. Il fut
srnAsBouRc Er LA D6FENSE DE LA FI0NGRIE (1521-1555) 205
d'ailleurs le sidge serait men6 mollement. D'autres nouvellessignalaient qu'avec les subsides avanc6s par les villes franco-niennes et par les ducs de Bavidre, Ferdinand pouvait engagerhuit bataillsns (r) (novembre 1540).
Au printemps, les nouvelles continudrent d affluer : celledu sidge 6galement infructueux de Pest par I'arm6e r6uniedes Turcs et des Hongrois du parti des Zipolya (mars-mai).Finalement, celle du d6part de la grande arm6e turqr-re deConstantinople (z).
L'ouverture de la Didte de Ratisbonne, pr6vue pourf6vrier 1541 ne se fit qu'en avril, d cause de la lenteur des6tats. La tension entre Catholiques et Protestants 6tait sivive que I'empereur, pr6sent personnellement, d6cida des'occuper d'abord de la question religieuse. Il avait de bonnesraisons de se hAter pour cr6er une ambiance propice auxdiscussions, car les afTaires de Ferdinand n'avangaient pasen Hongrie. Soliman approchait et I'empereur lui-mdme 6taitpris ailleurs, par son exp6dition contre Alger. Il calculaitqu'avec I'aide de la Didte, Ferdinand pourrait s'emparerde Bude et tenir jusqu'd I'ann6e suivante ; peut-dtre alorsserait-il plus libre. Ferdinand r6unit effectivement unedeuxidme arm6e, plus importante que la premidre, et tentaencore une fois de s'emparer du chAteau (a) (mai t54L).
Une ambassade hongroise et une autre autrichienne vinrenti la Didte pour solliciter son aide.
Les nouvelles en provenance de Bude signalaient que lesidge 6tait men6 trds mollement : elles n'incitdrent pas laDidte d la g6n6rosit6. N6anmoins, les subsides urgents furentI'un des sujets principaux des d6bats (a).
Si les 6tats catholiques 6taient favorables d I'octroi d'uneaide urgente et d la discussion imm6diate d'une aide perma-nente, les Protestants refusaient, toute aide avant d'avoirobtenu une assurance de paix, valable pour plusieurs ann6es(te 17 juin).
d'abord intendant, ensuiLe Lr6sorier, finalemenL principat ministre du roi.A la mort de celui-ci, il garda ses pouvoirs et fut I'un des tuteurs de I'enfantJean-Sigismond. (Houan-Sznxr,i, op. cit., lll, pages 48-50 et Szrr.Acvr, op. cit.,V, pages 158-59, 307-3f6.)
(1) Pol. Corr. III, doc. l8l.(2) Ibidem, doe. 187.(3) Szrr-i.cvr, op, cit., Y, page 227.(4) Pol. Corr. III, doc, 196.
206 r. HUNyADT
La proposition imp6riale 6tait de voter une aide urgented'une demi-exp6dition (12.000 hommes) et une tr6ve reli-gieuse de 6 mois. Elle fut accept6e le l9 juillet (1). L,empereurpartit aussit6t pour I'Italie, afin d'achever les pr6paratifscontre Alger. Ferdinand, sachant que le sultan
-6tait, d6jd
en Hongrie, insistait, pour que les subsides fussent vers6simm6diatement, mais les 6tats gaspillaient un temps pr6cieuxavec leurs h6sitations (2).
L'arm6e austro-hongroise de sidge s,attardait passivementsous Bude ; elle fut taill6e en pidces par les Turci. Le sultan,n'ayant plus confiance dans le parti des Z6polya s'emparadu chAteau et de la cit6 par ruse, en prit posiession au nomdu prohdte et, les transforma en ville musulmane (a).
La province de Jean-Sigismond (fils du roi Jean Z6polya)fut d6limit6 d I'est de la Tisza - contre tribut -. A l-'oulstFerdinand ne pouvait, esp6rer conserver des territoireshongrois qu'autant que sa force ou sa ruse le lui permettraientdans I'avenir.
Les Ottomans 6taient bien d6cid6s d poursuivre leursattaques. Soliman, avant de quitter Bude, annonga ( sonprochain retour I ; d'ailleurs, pour garantir la possesiion duchAteau, il devait conqu6rir un territoire asse, vaste entreBude (4) et Belgrade.
Les Ottomans en s'emparant de Bude avaient fait uneprise de taille. C'6tait la r6sidence principale des rois hongrois,le lieu de r6union de la Didte, la ville li plus importanie duroyaume. En plus, Bude 6tait un chAteau facile d d6fendre,dominant le Danube, grand fleuve navigable ; il 6tait ais6d'y placer une garnison consid6rable (u), "il etait d 200 km.
(l) Ibidem, doc. 198.(2) Ibidem, doc. 201.(3) Selon la coutume musulmane, une ville, ou le culte islamique 6tait
d6jd c6l6br6' ne pouvait plus 0tre rendue aux r Inflddles,r, mais devait 6tred6fendue jusqu'ir la dernidre extr6mit6.
Si Soliman le Magnifique avait jur6 sur son sabre de rendre Bude d Jean_sigismond d la majoritd de celui-ci, ce ne pouvait 6tre qu'une mise en scdnepour abuser la bonne foi des Hongrois. (voir description de la scdne chezHaunpn-PuncsrAll, op. cit., lI, page 173.)
(4) Szrr,Acvr, op. cit., V, pages ZZI-24.(5) La population de Bude 6tait de 8-10.000 habitants, cele de pest de
2-3.000 habitants. (voir population des vilres hongroises dans MaggarorszagTiirti'neti Demogrdfidja, Budapest 196b.) Les ottomans placdrent une garnisonde 12.000 hommes d Bude et 4.000 hommes d pest. (Szrr_Acvr, op. cit., V,page 234.) Ces chiffres paraissent exag6r6s. Le fait qu'entre lb26 et lb4l lechateau de Bude erlt 6td pris quatre fois sans coup f6rir 6tait plutdt un indiced'anarchie et.de d6sarroi chezles Hongrois.
STITASBOUITG ET LA DfFENSE DE LA IIONGRIE (I52I.I555) 207
d peine des frontieres de l'Empire. Celui-ci, pour garantirla s6curit6 de ses habitants, devait ou bien en chasser lesOttomans ou, du moins, par des fortifications ad6quates,empdcher que leurs raids ne d6peuplent d'abord les provincesautrichiennes et ensuite le reste. Les Allemands ne sous-estimaient pas le danger, mais n'6taient pas organis6s pourde tels efforts. Nous verrons quelles mesures ils pensaientprendre pour parvenir d leur but.
Mdme des Etats aussi 6loign6s que Strasbourg comprirentla gravit6 de la menace et un nouveau changement apparutdans I'attitude de tous : des charges beaucoup plus grandesqu'auparavant furent accept6es en hommes et en argent,non sans diflicult6, bien sir. Mais la Didte envisageaitd6sormais I'aide permanente dont elle ne voulait pas autrefois,de peur qu'elle ne se transformAt en imp6t r6gulier.
Deux facteurs importants ioudrent en faveur de la d6fensede l'Empire. D'abord la tradition ottomane voulait que sescombattants puissent retourner dans leurs foyers d chaqueautomne. Compte tenu des distances, ils ne pouvaient 6trede nouveau d la frontidre qu'd la fin de l'616 ; leurs campagnesdevaient 6tre fatalement, trds courtes (1).
Ensuite, la chute de Bude divisa la Hongrie en trois parties.Le pays avait maintenant le choix entre l'acceptation de ladomination des Turcs, ou la continuation du combat. Ilchoisit la deuxidme alternative ; il se r6veilla de ses d6sordres,accepta d'6tre le champ de bataille de deux Empires et grdced ses territoires 6chappant d la conqu6te ottomane, renforgala digue qui defendait le reste de I'Europe.
IV. L'e.rnr IERMANENTa l5a1-$52)
La prise de Bude causa la consternation partout en Europe.Les Hongrois en particulier 6taient comme abasourdis parle choc et admettaient diflicilement que leurs divisions etleur passivit6 en fussent la cause principale. Les premiersd r6agir furent Ferdinand et le Frdre Georges, adversairesd'hier, mais d6cid6s tous les deux, d travailler ensemble poursauver le reste et pr6server I'avenir (z).
(l) Pnn.ros G6za, Az ozman birodalom europai hdboruinak kutonai kerdisei,Article paru dans, Szigettvfri Eml6kk0nyv, Budapest, 1966.
(2) Ferdinand et le Frdre Georges renouvellaient les stipulations du Trait6de Vdrad par le pacte de Gyalu en d6cembre 1541.
208 I' HUNYADI
Ferdinandfitfortifierlesfrontidresetsollicitales6tatsde I'Empire en vue de nouveaux subsides'
Le Frire Georges organisa les territoires i I'est de la Tisza
"t . "fpriq"a
d soutenii la conscience nationale et la nostalgie
d'une Hongrie unifi6e.- l. fO ociobre Ferdinand annonga aux 6tats de I'Empire
la chute de Bude et convoqua Ia Didte pour-jan-vier 1542
d Sp;." vue de d6lib6rer det -et"t"s d prendre (1)'-
fi" petif 6tait vivement ressenti dans I'Empire^et-les princes
se r6unirent d Naumburg en novembre' Le 18 du mois ils
annoncdrent aux autres 6iats qu'ils proposeraient' i la. Didte
i" t".re. de 48.000 hommes pour la iepiise de Bude et si la
OiCt" la refusait, les subsides particuliers seraient auto-
ris6s (2).
L6lecteur de Saxe et le landgrave de Hesse le confirmaient
pou" Strasbourg ; or, durani -Ia p6riode pr6c6dente' ils
d6conseillaient aux Protestants d'accorder de subsides parti-
culiers d Ferdinand'--tl Conr"il des XIII, estimant la p6riode en cours parti-
culidrement favorable pour tentef d'arracher certaines
"oo""rriorr. d I'empereur - r6clamees depuis longt'em.ps -
nrescriviL aux deput6s de la ville de piotester contre la
;;;ttq";"a"t pti"i.. de ne pas tenir compte dl vote.des
i,iti".. A,, "".
oi la Didte passe-rait outre, les d6put6s devraient
refuser des subsides de ioute nature, sauf ceux contre les
Trr"". (s). cette clause seule suffit d d6montrer I'importance
attach6e au P6riI ottoman.Consid6rant que les d6put6s 6taient pusillanimes dans leurs
revendications, les XII1 leur rappeldrent imp6rieusement
ces directives (iettre du 4 mars) en-terminant par une phrase
qui en dit long sur leur pensee I o "' .ti nous ne parvenons if'aire passe, ceite exigence mainte""l!,""oy.t ne I'ontiendrons
i;;;il... >. Mais s'ilJ obtenaient satisfaction' ils devraient
Lhercher i faire aboutir les autres revendications aussi :
1) Paix religieuse pendant 18 mois au moins ;
2) R6forme du Tribunal Cam6ral ;
3) Am6nagement de Ia matricule de Worms par la
diminution du taux de contribution des villes'
(1) PoI. Corr. III, doc. 208.
Ibidem, doc. 211.Ibiclem, doc. 216'
STRASBoURG Er LA DIiFENsE DE LA HoNGRTE (152l_1555) Z0g
loy. ces- probldmes furent effectivement les thdmesprincipaux des d6bats d la Didte.
Les princes proposaient que la reconqudte de la Hongriegoit, ti.nan_g6e par la lev6e du pfennig commun, au taux de?
o/oo (au lieu de 4 %o) et I o/, pour les"artisans. frn attendantla rentr6e des fonds, res 6tati-devraient avancer le montantestrm6, tout comme en 1b32 (1).
Les villes r6agirent imm6diatement : toutes consid6raient,en.effet, que le taux 6tait-trop 6lev6. D,autanf plus, quele taux de lev6e du_p,fennig l6sait leurs nor.g.oir.
- r-*"' Y
. A 9. sujet les XIII 6crivirent exprds d leilrs d6put6s, pourleur faire remarquer que.le pfennig commun ,r"
"o,rrrr"iiqrr"3 mois de soldes du.contingent strisbourgeois (4b0 faniass'inset B0 cavaliers) 6valu6s a |Z.OOO R. <a.
Cette missive est. trds importante, puisqu,elle permetd'estimcr trds grossidrement lis revenus'de ia popuiatiorr;soit, 2.000.000 d 3.000.000 florins par an, repr6sentant unrevenu de B-12 florins mensuels p"" t6t" d,habitant, d
-rrr"6p_oque of un lansquenet,
"r, ."-p"gne devait, vivre avec4-8 .fl. de solde par mois ; c'6tait dor,-. ,rrr. ville trds riche,quoique les couches basses de la population f"*r."i-pn""."r.
proposition imp6riale contenait aussi la lev6e duPfennig commun.I,es municipalit6s y 6taient hostiles, pour une raison bienparticulidre : elles appr6hendaient de
'fournir a la Didte des6l6ments de calcul de leurs revenus et de ceux de leurs
bourgeois. Dans leurs instructions d leurs d6put6s, a""."J",lettres d des villes amies, res XIII de Strasbdurg ie"l"""i."tsans ambage qu'ils consid6raient comme une indiscr6tionde publier les revenus de la ville (a). Or, d6clarer le montantdu Pfennig lev6 aurait 6quivalu A cela. Ceite attitud;;;;;il"":-"_ "ppl"."ce, s'explique .par leur exp6rience : les princls ettes nobles, constamment A court d'argent les harcelaient afinde leur arracher des emprunts qu'irs'remboursaient dirficile-ment ou pas du tout. Les villes croyaient, pouvoi, y 6"h;;f"le..plys facilement, en se p.r6sentant pt", p"rrr"ir-;;til",n'6taient en r6alit6. Les piinces n'en et"irrrt p"s a"p..--"tinsistaient
- cela po,.rriit prendre les prop'ortiorrr'- J,.r,
(l)(2)(3)
Ibidem, doc. 22b-27.Ibidem, d.oc, 228-29.Ibidem.
210 r. HUNYADT
chantage -. Mais en I'absence de chiffres permettant le calculci-dessus, ils ne pouvaient se baser sur rien de concret dansleurs tentatives d'emprunt.
Les villes avaient encore un autre grief au sujet duPfennig : c'est que I'imp6t sur les terres fut lev6 sur placeet non pas au domicile du propri6taire ou de I'exploitant.Cette disposition 6tait favorable aux seigneurs terriens etpr6judiciable aux villes. En effet, le montant de I'imp6tallait dans la poche du seigneur terrien, m6me s'il habitaitdans une ville ; il en 6tait de m6me pour I'imp6t des terresafferm6es d des bourgeois. Les villes voulaient que Ie PfennigCommun ffit lev6 au domicile permanent du propri6taireou de I'exploitant (r).
Ce vmu leur parut d'autant plus 6quitable qu'elles avaientdes contingents trds grands d fournir par rapport aux princes ;
le produit du Pfennig 6tait insu{fisant pour en assurer la
couverture et la diff6rence etait d pr6lever sur la caisse
municipale.C'est par ce souci que s'explique leur insistance.
L'importance de la campagne projet6e en Hongrie futsoulign6e aussi par la venue d la Didte de l'ambassadeur de
France, le duc d'Alengon. Il chercha i dissuader la Didte de
cette campagne par toutes sortes d'arguments, parmi lesquelsles allusions au courage des Turcs, d la richesse inepuisabledu sultan, d I'antipathie mutuelle entre Allemands etHongrois firent beaucoup d'impression.
Les d6put6s strasbourgeois noti{idrent aussi i leursmandants que I'ambassadeur frangais conseillait de chercherla paix avec les Turcs. Il pr6conisait de ne rien faire qu'encas d'attaque directe des Ottomans. En ce cas' la Francen6gocierait avec les 6tats. La Didte remercia le duc de sonintervention et promit d'y r6fl6chir (2).
L'assiduit6 frangaise s'expliquait 6videmment par I'allianceturque : I'attaque conjugu6e franco-ottomane devait 6tred6clench6e au printemps suivant, et une aide substantielle,voire enthousiaste, des 6tats de l'Empire d l'empereur 6taitd 6viter.
S'il 6tait quelqu'un pour rnettre d profit les bonnes disposi-tions des 6tats, ce fut Ferdinand. Il mit tout en Guvre pour
Ibidem.Ibidem, doc. 220.
(l)(2)
STRASBOURG Er LA D6FENSE DE LA HoNGltrE (f5zf_1555) ZIIque la
-campagne r6ussisse et essaya d'obtenir de tout lemonde le maximum de concoups (r).
,, Il chercha A persuader son frdre de prendre la t6te deI'arm6e -- qui aurait 6t6 ainsi renforc6e par des "o"ti"l."*espagnols, et la discipline y aurait 6t6 garantie ; les ?i"t,auraient aussi montr6 plus d;empresse-.ri q,r" d'habitude -.Mais I'empereur, bien Aecide au d6but,
""rro.rgn .or. il"n"tde la guerre imminente contre la France.
Ferdinand s'adressa aussi aux 6tats pour obtenir dessubsides suppl6mentaires : il sollicita StrasLourg p"". inO q.de poudre et pour 4 artilleurs (z).
, . Les villes r6pondirent en commun par I'envoi d,uned6putation de leurs d6l6gu6s, qui d6montra au Roi desRomains. que trds peu de villes'_ les plus p"urrr".-_-r.
contentaient d'offrir .le pfennig Commun, -les
autres yajoutaient la lev6e .de leur contin"gent d reurs t""i. po,r, t"oi,
mois. Malgr6 I'insistance du roi ettes princes, eiles "ef,-r.aierrtde proposer plus (a).
Le nonce apostolique intervint dans les d6bats et annongaque le. pape enverrait 5.000 hommes en Hongrie ,i f;.*f"r.u"prenait la t6te de ses troupes ; sinon, il n'e"n to"r"i"n'ii qrr"la moiti6. C'6tait destin6
- bien strr _ d .;;;;;#""I'empereur et, les 6tats d plus de g6n6rosit6.
La discussion tourna bientdt, "r.io.r,
du probleme de savoirce qui se_passerait lorsque-le produit du'pfennig C;;;;"n'arriverait plus d cou.rii. les irais du contingen[ des Ofatsmoins riches. Il leur serait aussi impossibre de i" r"""" "".*"une _fois que de fournir les suppl6ments par l"rrr, "".r.r,r,16guliers.
La Diete s'arrdta finalement d une solution bAtarcle quifut fatale d la campagne : il fut d6cid6 que les 6tats verseraieltleurs parts dans Ia caisse du cercle comp6tent lequel payeraitfes llgunes ; le cas 6ch6ant les cercles fortun6s
"o*p"rr."i"i.rrtle d6ficit des plus pauvres. I-e 13 juillet, ,.rr. Didt" .*"ritconvoqu6e d Nuremberg pour d6cidei dss sulfgs (c).
(1) Ibidem, doc. 282.(2) Pour la pr6paration el le d6roulemenL de
Ki.nor,vr A., A Nemet Birodalom nagg katonai1880.
-(3) Pol' corr' III, doc. 238. Le quintar de poudre valait 200 florins. Sur repr6t de 50 q en 1529, Ferdinand avait d6jd remlours6800 florins. (pol. corr. III,doc. 242.)(.4) Ibidem, d,oc. 241.
la campagne de lb42, voir :udllalata 1 542-ben. Budapest
212 r. HUNyADT
Le Conseil des XIII fut trds m6content en apprenant cettesolution. Il la consid6rait comme une concession qui condui-rait, selon lui, d de nouveaux impdts. Il insistait en particulier,pour que d'autres contributions (Tribunal, etc.), ne soientpas vot6es sans paix religieuse. Au sujet de la poudre, iIofTrait de prOter ou vendre 25-50 q. sur hypothdque. Ceprojet fut abandonn6 (1) (le 30 mars 1542).
En r6alit6, la solution adopt6e par la Didte 6tait dangereuse,mais pour une toute autre raison : elle encourageait les6tats d ne rien payer, esp6rant que le d6ficit serait couvertpar la g6n6rosit6 des autres, et comme les moyens de contr6leet de coercition faisaient d6faut, les 6tats honndtes payaientpour les malins.
Une nouvelle discussion s'6leva entre les princes et lesvilles, au sujet de Ia valeur des voix des di{T6rents 6tats, etFerdinand fit savoir aux villes que les princes sans lereconnaitre exprds, tiendraient, compte de leurs voix (2).
Encourag6s par ce demi-succds, les d6put6s municipauxd6clardrent d Ferdinand que leur acceptation du rdces nepr6jugerait pas de celle de leurs mandants, qu'ils d6sap-prouveraient le systdme de compensation entre caisses deCercles; que les troupes ne seraient pas pay6es au-deld du13 juillet ; que les villes ne payeraient rien du tout sansobtenir une assurance de paix et enfin elles demandaientque les eccl6siastiques r6sidant dans les villes contribuassentavec elles (3).
Ferdinand fut encore conciliant : il accorda une trdvereligieuse de 5 ans et promit mdme de suspendre le ban deGoslar (ville protestante de l'6tat de Brunswick). Les etatsprotestants en prirent acte en d6clarant que si n6cessit6 en6tait, ils soutiendraient Goslar par les armes (4). Li encorela faiblesse de Ferdinand eut des effets funestes.
En v6rit6 le conflit de Goslar 6tait une querelle religieuse,donc un baril de poudre d cette 6poque (5). La ville avaitembrass6 le protestantisme ; son prince territorial, le duc deBrunswick le lui avait interdit et, par suite du refus d'obtem-p6rer de la part de la ville, il cherchait d la r6duire par un
(l) Ibidem, doc. 242.(2) Ibidem, doc. 246.(3) Ibidem.(4\ Ibidem, doc. 247.(5) Bn.lNor, op. cit., page 260.
STRASBOURG ET LA DiFENSE DE LA HONGRIE (1521-1555) 213
blocus. En plus, le duc avait fait mettre la ville au ban deI'Empire, rendant une intervention lrds difficile aux p"ot..-tants' Ils I'auraienf pourtant fait mais ra levee Ju;;;]",,,"facilita notablement la tAche. Le duc s,oppose e i" i"*. a,ban ; les .Catholiques r6pliqudrent aux menaces des princesprotestants en les_acc,ri"rr1 de propager la R6forme d lapointe de l'6p6e. Devant les passidns soulev6es il 6tait dcraindre qu'en cas, de conflit arm6, les beau"-erg;gir;.rrt,
concernant le p6ril turc fussent vite oubli6s. o o-----
, Lorr une fois, la Didte.s'occupait du d6tail de l,organisationde I'arm6e. Ses interventions ,re'fu.enipas toujours heureuses.S'il n'6tait pas mauvais cle sp6cifi". q,r" seuls les f"rrrqr.rr.t.arquebusiers pouvaient avoir doubie solde (B florins parmois), par contre re m6me rdgrement
"endaii-pl*^-aim"it.le recrutement des piquiers qui n"e touchaient qu" iota" ri_of".Il 6tait. trds sage de pr6voir tOO sola"s":;;il;;;;i..,par bataillon (nour iouvrir Jes primes d,ing"g*;nt,d'aLtaque,,"t..,.tii). rur;.-",ei"it ;;" rcomplicabion
superfluepar exemple d'interdire.a Strasbourg de f"""r Jl" ;f;1._cavaliers des fantassinsr2) (les chevaix 6taient, torjo.urc aussirares) de prescrire de lever un demi_canon par bataillon :aucun 6tat n'avait..d ,lgyer _l,6quivalent de Z f"t"lf-f*r;donc personne n'6tait oblig6. de p.e.*t." cles canons. Erfirr,
l1_oT:,..""iPtion, .que les,cipitaini. ,r" ,."aient plus "o-*0.par t'etat recruteur mais par re cercle ult6rieuiement 6tait"..j*lll l!"s trds pr6judiciable. Certains 6tats protestaientrmmedtatement en
. demandant, comment peut_on imaginerde faire traverser l,Empire par des t-rp.. sans ofliciers etde quel droit on destitueraii les officiers nomm6s par l,6tatrecruteur ; mais c'6tait d6ja ra cldture des travaux
"ip"".orr.r"ne r6pondit d la question, qui 6tait pourtant de bon sens (s)(le 15 avril 1542).
I,e contingent, strasbourgeois fut, pr6t, le 7 mai lb4| eLpartit aussit6t; il 6tait a v-ienne re li' juin. Il ".i"rri-[u,iln'y.avait pas la cavalerie que le margrave de Brandenbouroavait promis de lever dans ses 6tats"pour t" "o_pt. a.- ilville. A leur arriv6e d Vienne its y i"o',rvdrent assez peu demonde : 20.000 hommes en tout sur 48.000, q";i;;;_';.;"
(l)(2)(3)
Pol, Corr. III, doc. 2b0.Ibidem.Ibidem, d.oc. 252.
2L4 r. HUNYADI
canons et pas de poudre. Le margrave de Brandenbourg n'y6tait pas
"it"ot", donc la cavalerie strabourgeoise non plus (t)'
La promptitude de Strasbourg peut surprendre : elle
s'explique par deux raisons :
1) Vue I'imminence de la guerre de la Ligue de Smalkalde
"orrir" le duc cle Brunswick, les protestants crurent prudent
de fournir une aide substantielle pour d6sarmer la coldre de
Ferdinand, si le conflit 6clatait. L'id6e venait 6videmmentdu Landgrave de Hesse, et il voyait juste. La guerre 6clatale 6 juin ('?)
;
2) Strasbourg avait des dol6ances permanentes i exprimerd la Didte, qui tenaient surtout au cceur de son grand poli-ticien Jacques sturm : 6galit6 des voix des villes avec celles
des princes, alldgement des taux de contribution, etc' (a)'
Son illusion fut de croire que cette politique fut realisablesans un soutien prompt et g6n6reux de la politique imp6rialepar les villes. Or, les villes ne voulaient pas d'un-renforcementhe la puissance imp6riale, soit par esprit de clocher, soit d
cause de I'antagoniime religieux. C'est une justice d rendreld Jacques Sturm, que les frdres Habsbourg n'excellaient pas
trott pl.t. par la largeur de leurs vues politiques, ni par leurs
g6n6iosites ; c'6taif plut6t le contraire. Pour cette raison,le dessein de Sturm 6tait vou6 d l'6chec.
Entretemps, l'6tat de I'arm6e imp6riale sous Vienne,ne s'am6liorait pat. C'6tait aussi la faute du commandement'Depuis la renonciation de Charles Quint,, il fallait trouver unautre candidat, puisque Ferdinand n'osait jamais commanderdevant I'ennemi (4). Le Roi des Romains avait song6 au
landgrave de Hesse, croyant le flatter et en mdme tempsI'avoir sous sa surveillance ; mais celui-ci se d6roba, escomp-
tant la guerre contre le duc de Brunswick et aussi Ie discr6ditqui pouirait rejaillir sur lui par le fiasco d'une carnpagne trdsmal-engag6e (5). Un seul candidat se pr6senta : le margrave
(l) Le trdsorier du contingent strasbourgeois, Simon Franck, envoya des
rapports bimensuels aux XIIL II fut trds frappo par I'indifference des viennois
d l'6gard de Ia campagne. (Voir d6tails dans Pol. Cor. 258')
(2) Pol. Coru. III, doc.26'7. Frscnrn-G-a'r-r'rt, op. cit', page 88'
(3) Pol. Corr. III, doc. 269.(4) Szrr,Acvr, op. cil., V, page 16 et, A. Kirnor-tr, op' cit'
151 Arielwechsel, Landgraf Phitipps des Grossmiltigen uon Hessen mit Bucer'
I-III, Leipzig 1880-91, t. III, page 450.
STRASBOURG ET LA DfFENSE DE LA IIONGRIE (I5ZI-1555) 2I5
de Brandenbourg, mauvais soldat et ivrogne ; il fut retenuquand m6me (1).
Le d6sordre s'installait dans I'arm6e. La solde arrivaitmal ; les ofliciers nomm6s par les 6tats recruteurs furentdestitu6s par le commandement et se mirent i couver leurranceur (z) ; les soldats inactifs buvaient, les ofliciers consi-d6raient I'exp6dition comme un voyage d'agr6ments. Enjuillet, la moiti6 des effectifs, i peine 28.000 hommes, 6taientarriv6s et il fallut quand m6me partir (g). L'arm6e compldtefut d'environ 60.000 hommes, dont environ 25.000 Hongrois.Malheureusement, malgr6 leur nombre 6lev6, leurs chefsn'obtenaient pas de postes de commandement importantset ne pouvaient influencer la conduite des op6rations (a).
Cette arm6e disparate manquait d'Ame.A la Didte de Nuremberg, r6unie entre temps, I'ambiance
ne fut pas gaie. La d6claration de guerre de la France A
I'empereur, la guerre de Brunswick, termin6e en quelquesjours par la d6faite des catholiques, cr6aient un malaise.Beaucoup d'6tats, comme Strasbourg, ne levdrent le Pfennigque trds p6niblement, car ils y pr6levdrent les sommesn6cessaires d la campagne de Goslar (s). Ils exigeaient d'autantplus bruyamment de verser sans compter les contributionsdans les caisses du Cercle. (Afin d'6viter des indiscr6tions,disaient-ils.) N6anmoins, il fut bientdt, certain que de nouvellescontributions deviendraient n6cessaires. Les 6tats du sud-est :
les Cercles souabe, franconien et bavarois avaient de I'argentet 6taient pr6ts d de nouveaux sacrifices. Les Rh6nans parcontre 6taient muets 101. Il y avait pire. Les Allemands duNord montraient en g6n6ral peu d'empressement pourparticiper d la guerre turque. La ville de Lubeck fit savoird la Didte qu'elle n'avait pu y envoyer des troupes maisqu'elle 6tait prdte d verser le Pfennig Commun. Les princesfurent, tellement r6volt6s par cette d6sinvolture qu'ilsexigdrent que Lubeck s'ex6cutdt imm6diatement par I'envoides troupes et de l'argent. Les villes par contre prirentv6h6mentement parti pour les Hans6atiques, invoquant
III, page 44.(l)(2)
lJl(4)(5)(6)
216 r. HUNYADT
le refus des princes de reconnaitre le droit de vote des villes ;
de toute fagon il serait trop tard pour l'envoi des troupes (1).
Les Smalkaldiens, victorieux en Brunswick, proposaientd'envoyer leurs troupes en Hongrie si I'empereur 6tait dispos6d leur verser leur solde. Le plan 6tait strrement ing6nieux :
tout en occupant leurs soldats aux frais des Habsbourg (les
troupes seraient rest6es sous leur commandement) ils auraientpu se pr6senter comme les sauveurs de l'Empire, se vanterde la complicit6 de Ferdinand et de la Didte et porter un coupgrave au parti catholique (2). Ferdinand n'osait pas accepter,malgr6 le secours eflectif que cette offre aurait repr6sent6pour la campagne en Hongrie. En l'6cartant, il obligea laDidte d chercher la solution dans un nouvel efTort financier.
Tout d'abord il fallait que les Cercles annongassent leur6tat financier. Il apparut que seuls ceux du sud-est avaientun exc6dent. Les autres Cercles n'osaient pas annoncer leur6tat financier (3). Les Rh6nans finirent par protester contrela r6partition des charges qui leur imposait 20 o/o d,e I'effectifde I'arm6e d eux seuls (a). Il apparut aussi que beaucoup deprinces n'avaient encore rien vers6 du tout,.
Ferdinand proposa que les Cercles exc6dentaires levassentun contingent suppl6mentaire et que les autres assurassentla solde de leurs troupes jusqu'd ce que le d6compte decompensation ftt fait (5). Les Rh6nans furent 6videmmentau d6sespoir ; comme ils ne levaient pas le Pfennig en sa
totalit6, ils devaient verser la diff6rence de leur poche.Strasbourg dut emprunter 2.700 florins d Nuremberg' pourque son tr6sorier ne ftt pas molest6 par les soldats furieux (6).
Pendant que duraient ces d6bats d la Didte de Spire,I'arm6e se comportait peu glorieusement, comme il ressortaussi du rapport strabourgeois au Conseil des XIII, parvenuesous Bude - dont la garnison de 12.000 hommes ne pouvaitattendre de secours de nulle part - le sidge de Pest futd6cid6 : il paraissait plus facile et aurait dtr galvaniser les
(lJ lbidem, doc. 288.(2) Pol. Corr. III, doc.288.(3\ Ibidem.(4) En effet, ce Cercle avait d lever 1.838 cavaliers et 8.850 fantassins.
Ce trds grand contingent s'explique par le morcellement politique de la r6gion,ghaque 6tat devant fournir un contingent.
(5) Pol. Corr. III, doc. 294.(6) Ibidem, doc. 289.
STRASBOURG ET LA DEFENSE DE LA HONGRIE (I52T.I555) 2I7
qorlage! <t). (La rive de Pest 6tait plate et la garnison turquede 4.000 h. seulement.)
Les Turcs combattirent h6roiquement, indiff6rents auxballes et boulets des Chr6tien..
-pa"mi ceux_ci le rapport,
signalait les hussards hongrois comme trds audacieux ettrds eflicaces s'ils se sentaient soutenus. par contre lesAllemands furent dds le d6but d6moralis6s et en pl.,s, ladysenterie s6vissait parmi eux. Au bout d'une semaine' detir-d'artillerie, une brdche fut ouverte dans l" ,"*p"ittrtet I'assaut tent6. Elle 6choua dans la brdche et la-dessus lesiege fut lev6,_malgr6 I'avis de nombreux ofliciers, notammentde ceux des Hongrois et des ltaliens.
L'arm6e parvint d Vienne compldtement d6compos6e.. Le rapport strabourgeois se terminait ainsi : o ... Voitad quoi a men6 d'avoir voulu prenclre pest d peu de frais... > (B).
A la r6union du cercle Rh6nan d worms le conseiler deguerre r6clama de I'argent, notant qu,il avait dtr avancerd6jd 14.000 florins d des soldats. L" Cercle envoya sesdernidres r6serves :.40.000 florin1, lesquels ,re
"orrr""iJJ pn.un mois complet de soldes (c). L'argent, parvenu trop tarde_n Hongrie, fut renvoy6 d Francfort.
'fluand la nouvelle
de la retraite fut connue, le Cercle refusa tout nouveauversement.
Les soldats revenus r6clamdrent leur argent partout.Strasbourg donna d ses mercenaires I florin i
"n".ii" o p""compassion r, en les envoyant r6clamer leur dfr d la Caissedu Cercle (5). Bient6t, toutes les didtes et r6unions furentassaillies par des soldats qui harcelaient litt6rarement les6tats recruteurs pour toucher leur solde. Les d6put6s, trdsembarrass6s, leur versaient de petites .o--... SelonJacques Sturm, un colonel s'6tait acliess6 d la Didte d'Empirepour r6clamer une solution d'ensemble des arri6r6s dessoldes ; le d6put6 conseilla d la ville de prdvoir les sommesrequises (e).
(l) Szrr--4,cvr, op. cit., V, pages(2) Pol. Corr. III, doc. 310.
pendant la canonnade, pest 3-10(3) Pol. Corr. III, doc. 310.(4) Ibidem, doc. B2t.(5) Ibidem.(6) Ibidem, doc. 330.
Un artilleur strasbourgeois s'est distingu6octobre 1542.
218 r. HUNyADT
La Didte, r6unie en janvier 1543 d Nuremberg, devait faireface ir une bien sombre situation : les r6ves lrandioses dechasser les ottomans au-deld de Belgrade s'6taient 6vanouisdans la boue du sidge de Pest, le sultan pr6parait une nouvellecampagne, pour chAtier les Chr6tiens de leur .tr attaquet6m6raire >. cette campagne risquait d'atteindre les proviniesh6r6ditaires d'Autriche. Il s'agissait de parer au plus press6.La Didte se contenta de voter une <i exp6dition romainesimple >, donc 24.000 hommes (1).
^ ^Qe subside reprdsentait pour Strasbourg la somme cle
8.280 fl. en calculant les soldes au taux ofliciel, mais bien12.000 florins, en cas de lev6e effective.
Les XIII, d6sesp6rant, d'obtenir la r6duction du contingentqar la Didte, proposa A l'assembl6e des protestants, r6irnied Smalkalde, de r6partir plus 6quitablement, au moins entreles 6tats protestants, les charges de la guerre contre lesTurcs. Mais les princes ne se montrdrent pas plus g6n6reuxen tant que Protestants qu'ils ne le furent en tant, queconf6d6r6s de I'Empire. Finalement, Strasbou"g
"rrrrorrEuqu'elle verserait 11.040 florins de subsides pour fiire plaislrd I'empereur (2).
I,'arm6e imp6riale ne se r6unissait pas, car les Ottomans nesemblaient pas menacer I'Empire. Le but de leur campagneen Hongrie 6tait efTectivement d'assurer les alentours de-Budeet ses liaisons avec Belgrade. Dans une campagne de dixsemaines, I'arm6e du sultan conquit une vingtaine d'e chAteauxet se rendit maltre du tiers de la Transdanubie. L'arm6e desecours de Ferdinand, compos6e de Hongrois, d'Autrichienset de Tchdques se r6unissait p6niblement sous Gy6r, sansoser attaquer les d6tachements turcs qui op6raient d quelqueskilomdtres d'sux (s).
. Nurer,nberg qui communiqua ces nouvelles d Strasbourg
ajouta que la chute d'Esztergom (Gran, Strigonie) (a) avail6t6 caus6e par la reddition des soldats pontificaux, malgr6
(I) Ibidem.(2) Voyant I'opposition des Allemands du Nord A I'id6e de subsictes, Ies
d6l6gu6s strasbourgeois n'ont mdme pas lanc6 l,id6e de la r6partition. Levergement de la somme d l'empereur n'est pas attest6, mais probable, vu lesbonnes dispositions des 6tats d'Empire m6ridionaux. (Voir, pol. Corr, III,doc. 392,409.)
(3) Szrr,.1,cvr, op. rit., V, page 24b.(a) Pol. Corr. III, doc. 410. (Gran est le nom allemand d'Esztergom; les
textes frangais du xvr" et xvrre sidcles I'appellent Slrigonie.)
sTRASBouRG Er LA DfFENSE DE LA HoNGRIE (1521-1555) 219
les Allemands. La ville protestante en conclut un peu viteque le pape 6tait d'accord avec les Turcs (1).
La nouvelle Didte r6unie d Spire en f6vrier 1544, devaitprendre les mesures pour enrayer les progrds des Turcs.Elle fut en efTet inquidte de leurs conqudtes en Hongrie,mais elle fut encore davantage scandalis6e par leur venued Toulon et leur participation aux c6t6s des Frangais au sidgede Nice. Le toll6 soulev6 par cette alliance permit d
Charles Quint, de d6clarer la France ennemie de I'Empire (2).
La Didte d6cr6ta la lev6e d'une < exp6dition romainesimple r, dont Ie 1/3 serait envoy6e contre les Turcs ; le restantcontre la France. Les soldats'en service contre Ia Francedevaient 6tre rappel6s par les 6tats d'ot ils 6taient originaires.Les villes protestdrent pour la forme, de n'avoir pas 6t6consult6es pr6alablement (3).
Les 6tats moins fortun6s auraient voulu faire couvrir les
frais du contingent par le Pfennig ; la Didte d6cida finalementde le laisser d la charge de chaque 6tat.
Par la suite, sous I'influence d'une nouvelle campagneottomane en Hongrie, conduite par le grand vizir Roustem,la Didte proposa de lever une deuxidme arm6e, 6galement de
24.000 hommes, pour prendre I'offensive en Hongrie au prin-temps prochain. Cette arm6e qui aurait dfr op6rer durantdeux ans, aurait 6t6 financ6e par le Pfennig Commun ; latranche pour I'ann6e en cours aurait dtr 6tre lev6e avantd6cembre, et gard6e pr6te contre les Turcs (a).
La nouvelle de la paix de Cr6py et celle annongant queCharles Quint prendrait la t6te de ses troupes laissaientesp6rer une campagne d'envergure contre les Ottomans.Mais bient6t de nouvelles rumeurs circuldrent, selon lesquellesI'empereur chercherait plutdt la paix avec le sultan (5).
La Didte de Worms, rdunie en ianvier 1545, ne crut qu'dmoiti6 aux d6mentis de I'entourage de I'empereur, car lesrumeurs persistaient. Il est vrai que Charles Quint, surI'instigation de Frangois Ie', n6gociait une paix de plusieursann6es avec les Ottomans, mais n'6tait pas strr de l'obtenir ;
il ne voulait pas en d6voiler le secret, de peur de d6couragerles bonnes volont6s. Pourtant, les rumeurs se maintenaient ;
(1) Pol. Corr. III, doc. 410.(2) Ibidem, doc. 44I el 442.(3) Ibidem, doc. 44L.(4) Ibidem, doc. 442, 443, 482.(.5\ Ibidem, doc, 552, 559.
220 r. HUNyADT
elles provenaient de la pologne et de Venise, toutes les deuxbien inform6es des affaires de la Sublime porte (1).
Les 6tats de I'Ernpire 6taient, perplexes : ils soupgonnaientI'empereur de ne chercher qu'-d dntre"
"r, po.J"ision clessubsides pour annoncer ensuite la conclusion ie l'armistice ;par contre, en refusant les subsides, ils fourniraient eux_mdmesd I'empereur.le pr6texte d cet armistice. Les nombrer,
"pf.f,pour leur faire voter les subsides ne purent, faire fl6chir leurm6fiance. Finalenent, sur Iintervlntion personnelle deCharles Quint, ils acceptdrent de lever et de garder le pfennigCommun pr6t pour l'6ventualit6 d'une atta{ue des Turcs (2).
. Bxceptionnellement, les 6tats protestants furent favorablesd cette lev6e ; et Strasbourg, contrairement d sa positionant6rieure, n'y voyait pas d'inconv6nient. C'6tait parcequ'ils avaient, des desseins particuliers en ce qui concernaitles _sommes, comme il ressoit de la circulaire que les XIIIde Strasbourg adressdrent aux Smalkaldiens :
< ... l'affaire de Brunswick risque cle provoquer la guerred tout moment, il ..ne.-faut p". .r"r.." t" et"rr.rig Coirmunmais le garder et l'utiliser pour la d6fense .o-rir.ru, ,i l"guerre 5"1"1"i1... ; (a).
Ils proposaient a rssi que Nuremberg, Augsbourg, etc.,se renseignent en Italie pour savoir si li' TurEs comltaient,prolonger la tr€ve. Les protestants pourraient en d6duireles plans 6ventuels de I'empereur.
En d6cembre, I'information vint d'Italie : la paix 6tait,conclue pour 5 ans (erreur de I'information au ,uj.t .1" l"dur6e : la tr6ve ne le fut que pour lB mois d'abord : latransformation en une paix ae n ans n'intervint qu'en lb47 e).
Les Protestants pensaient que la guerre reprendraitbient6t entre l'empereur et la France ; -ais c'est toute autr.e:h9." _g".r se produisit : I'empereur, ayant les mains libresd I'ext6rieur, se d6cida d meitre de lbrdre dans l,Empire.Le protestantisme n'avait pas cess6 de progresser, malgr6les efTorts d6ploy6s. Les nrinces luth6rien. ,r"'h6.it"i.;t;".d soutenir leurs amis parles armes. Maintenant il s'agisJaitd'une chose plus grave : l,archev6que de Cologne, p'ri-"t
(l) FrscHon-GALArr, op. cjl., pages 94-96.(2) Pol. Corr. III, doc. b9l.(3) Ibidem, doc. 620.(4) Ibidem, doc. 645.
srRASBouuG Er LA D6FENsE DE LA HoNGRTE (f52f-1555) 2Zlde I'Empire,_ projetait de se convertir et envisageait, detransformer I'archev6.L.. 9" principaut6 t._por.it?- j" ,"famille' Il comptait sur l'aide ;-;;a la Ligue de Smalkalde.Cette conversion, si elle 16ussissait, aurait d6mantel6l'Eglise catholique, en.Allemagne.-il"-pr.",rr et les princescatholiques 6taient d6termin6"s a rempecn"" p""-r"'ro""..Les pr6paratifs bruyants des deu" camps, destin6s avant toutd intimider I'adversaire,._remplireni t;n_pi.. ; bient6t ce futI'affrontement sanglant (r).
_ Bien^entendu, dins cette ambiance, les subsides contre lesTurcs furent de nouveau compldtement oubli6s.La missive de Ferdina.ra "a".*e" a to didle protestante
d Francfort, en d6cembre lb4b,rig;;i; aux d6put6s le nouveaup6ril pesant sur la Hongrie .l .;; ie"triche, et reur besoinurgent de subsides pour assurer la d6fense des r"",,ii*.. .tla construction de fbrteresses (4. --- *-
Les Protestants promirent des subsides, sauf Strasbourg,Ulm et Ie duch6 de.Wurteml..g.-i,lou.r_ne connaissons pasIes raisons du refus de c_es a".ni.i. ri,-., r.. auLres donndrenbsuite d leur promesss (a).
Il est certain crrr,en face du danger pesant sur la Ligue desmatkalde res ktrr J;" ail;;'""g r" monrrdrenb biend6termin6s d subordonner tout a t",r"-ro,r"i p"irrc;p"ia"."iroi"la d6fense du nrotestantisme. Its insistaient auprds de leursallig.s pour ne verser. re.efe"nif u-ul C.""t.s, qu,en cas dep6ril turc imm6diat, (a) ; d'autre i,"rt _ ef, c,est ce qui donnela mesure de leur richesse et'Ae leur d6vouement _ ilsoffraienb d'auEmenber leur "o"ti"g""i dans l,arm6e de Ia
!-tg". Leur cJnrrib;;jo;;e"r".il."itrrt de 4.000 florins (5).N6anmoins, les XIII offraieni A;y
"jort., en cas de dangerun bataillon de b00 lansq-uen6t*, ,rlir"'Jeu* d 400, si les autresfaisaient un effort simiiaire. i_ ;;; incrovable sue celaparaisse, la vi'e 6tait donc ti"" ."p"tt" ;;i;i;;;;.;il_;"_rairement, une charge mensuelle Ae O.OOO d g.200 florins (6).
(l) Bnaror, op. cit., pages 226_269.(2) Pol. Corr. IV, doc. b.(3) Ibidem' Dans .ambiance d'incertitude et d'armements Ie versementn'est pas probable.(4) Ibidem, doc. 8.(5) Proposition des d6l6gu-6s strasbourgeois aux smalkaldiens, d Francfort,le.5 f6vrier lb46 (voir, pol. corr. rv, a"lr. zsf- La contribution smalkal_Aie11e3e fut vers6e probablement q". prrra*j 6 mois. _(6) Pol. Corr. IV, doc. 49,
222 r. HUNYADI
En juin 1546, la concentration des forces arm6es de
l'empereur 6tait dejd telle que les Protestants ne pouvaientplus avoir aucune illusion quant i leur destination. Ilssavaient aussi que I'arm6e de la Ligue ne pourrait leur tenirtdte que si une puissance 6trangdre obligeait I'empereur d
diviser ses forces (1). Tant que durera l'6preuve, les Protestantsse communiqueront comme de bonnes nouvelles les informa-tions relat"ttt 1.. pr6paratifs guerriers de la France ou de
I'Empire Ottoman (z). Mais personne ne vint d leur secours.En avril 1547 la guerre 6tait pratiquement termin6e.
Pour la premidre fois, Charles Quint n'6tait menac6 paraucun ennemi ext6rieur ni int6rieur. Il pouvait r6aliser ses
plans de r6forme de I'Empire. Ce qui nous y int6resse, c'estle chapitre de la d6fense contre les Turcs.
Sa conception 6tait grandiose : iI projeta une < LigueImp6riale t ( Reichsbund). Tous les 6tats de I'Empire auraientdtr entrer en alliance avec lui individuellement, s'engagerde ne pas le combattre. Il pensait 6tendre cette ligue d toutesses possessions comme d celles de son frdre' S'il y r6ussissait,il aurait pu nouer des liens entre I'Empire, I'Italie, I'Espagneet la Hongrie et fonder la monarchie universelle. Le mariagede Philippe II avec Marie Tudor y etrt, joint I'Angletene.Selon ses projets, ses sujets se devaient aide et solidarit6,en cas de danger, en soldats et en argent' Mais ces peuplesque la guerre de la Ligue de Smalkalde 6loignait plutdt qu'ellene les rapprochait, ne s'enthousiasmaient pas pour I'id6e ;
ils y voyaient surtout un gouffre ot) I'empereur les invitaitd jeter leurs 6conomies (3).
Dans la correspondance des XIII avec les d6put6s d laDidte d'Augsbourg (L547),la terreur perga i travers le stylehabituellement si impersonnel (4) de leurs lettres.
(1) Strasbourg plia bientdt sous le fardeau de la guerre : en septembre 1546
il fallail encore une fois lever le Pfennig et ensuite, emprunter auprds des
Suisses. (Pol. Corr. IV, doc. 442-472.)(2) Voir Lettres du landgrave de Hesse aux XIII. (Pol. Corr. IV, doc. 70,
551, 560.) Nouvelles de Baden par Geiger, bourgeois de Strasbourg (ibidem,doc. 202), lettre de Jean Sturm, -
humaniste strasbourgeois, fondateur du
Gymnase -, au landgrave de Hesse. (Ibidem, doc. 513.) Lettre de Burckhart,
vice-chancelier de l'6lecteur de Saxe, i Jean Sturm, Compidgne, le 24 d6cembre
1546. (Ibidem, doc. 496.)(3) L'idee grandioee ne fut pas r6alis6e. Les 6tats allemands parlaient avec
antipathie des soldats 6trangers de I'empereur, en particulier des Espagnols'(4) Instruction des XIII du 7 juillet 1547 : s...il semble que I'empereur
voudrait etendre I'alliance d I'Autriche Inf6rieure : ceci signi{ierait qu'elle
srIiASBoutiG Er LA DfFENSE DE LA HoNGltlE (i521-I555) 223
C'est la premidre fois que Strasbourg jugeait la d6fensecontre les Turcs d6sesp6r6e. Probablement d6moralis6e parles 6checs des ann6es pr6c6dentes, la ville fut prise de paniquedevant l'6tendue des engagements. Il aurait 6t6 di{ficiled'expliquer ces soucis d la d6putation autrichienne, venuedeux semaines plus tard demander I'aide des villes d'Empirecontre les ravages des Ottomans. Jacques Sburm leur r6ponditau nom de toutes. Il pr6f6rait formuler onctueusementles veux pour que I'Autriche et avec elle toute la Chr6tient6soit d6gag6e de ce fl6au ; les villes voudront que I'Empirepuisse fournir une aide substantielle et e{licace (1) (le15 novembre).
C'est justement cela que I'empereur cherchait d organiser.l)ans un premier temps, il ne demanda des subsides qu'auxprinces, mais pour 3 ans cons6cutifs. Les princes acquiescdrent.Le mdme jour, toutefois, ils laissaient comprendre d l'empereurqu'ils ne voulaient pas de la Ligue Imp6riale (z).
En mai 1548 furent discut6s les probldmes relatifs d I'ordrepublic et au p6ril ottoman. L'empereur proposa de voterune ( Provision lmp6riale t> (Reichsuorrat) en espdces alinde pouvoir maintenir la paix et le droit public dans I'Empireet de prendre les mesures imm6diates en cas d'attaque parune puissance 6trangdre (3).
Sur demande de la d6putation autrichienne, Ferdinandexpliqua aux 6tats qu'il faudrait faire fortifier la frontidreautrichienne. Les < Frais de Construction I ( Baugeld) s'6ldve-raient d 500.000 florins, r6partis par semestres, durant5 ans (a).
impliquerait I'aide lurquc. Or, les Turcs sont un ennemi de taille d occuperIa Chr6tientd entiere. Nous nous engagerions dans une guerre sans fin, qui6puiserait I'Empire, sans faire de dommage d l'ennemi. Nous n'aiderions pasl'empereur. Cette alliance est destinde avant tout d garantir la paix d'Empire(Landfriede) et chaque signataire doit savoir ce qu'il peut attendre des autres.Si on I'6tend d la d6tense contre les Turcs, elle ne r6pondra plus e sa destination.Si les 6tats d'Empire doivent porter secours d toutes localitds de la Chr6tient6,ils ne sufliront pas ir la tAche... r (PoI. Corr. IV, doc. 637.) Jean Sturm, danssa d6claral,ion en comitd de la Didle, r6suma la position strasbourgeoise en cestermes : <...1'Empire devrait obtenir des secours des autres pays aussi, en casde guerre contre la France ou la Turquie, sinon, il faudrait exclure de I'allianceIes pays hdr6ditaires de I'empereur et du roi... r (Pol. Corr. IV, doc. 692.) -Sont vis6s : Espagne, Hongrie et la Bohdme.
-(1) PoI. Corr. IV, doc. 694.(2) Ibidem, doc. 695.(3) Ibidem, d,oc. 771, 774, 776.(4) Ibidem, d,oc. 774-775.
,qAI. HUNYADI
Les .villes appr6hendaient de devoir, encore une fois,;upporter une part disproportionn6e. Leurs craintes 6taientfond6es : le 14 juin, les prinies votaient les < Frais de Construc_tions > et s'en d6chargeaient fortement sur les villes : seronle taux de contribution au Tribunal Cam6ral., j"^"i Strasbrurg c'6tait, l,68 o/o; sa part fut arr6t6e d1.540 florins. En m6me temps le montant de la provisionImp6riale fut fix6 d_ une exp6dition romaine
"., ..pJ".r,d verser au taux de la matricule de Worms de 1b21 El.
-
(Elle restait donc a 8.280 fl.) ce n'6tait pas tout : re pfennigCommun 6tait d lever et les 6tats qui n'aurai""t p".
""r.el" 1""":9. d.u Pfennig de 1b44, devaient le faire a"".- i", fi".brefs delais.Les d6l6gu6s, atterr6s demanddrenL 24 heures de r6flexion
et aprds s'6tre consult6s introduisirent une supplique auprdsde I'empereur demandant la diminution A"'i",ri.-"h;;..par am6nagement des taux de contribution (z).
Les- charges des villes s'6taient accrues d'une fagon insup_portable. Les obligations de strasbourg se dressaiJnt commesuit pour I'ann6e en cours :
Pfennig Commun lev6Provision (exp6ditionFrais de Construction.Frais de Tribunal.
deux fois. . .
romaine). . . .
24.000 fl.8.280 fl.1.540 fl.
344 415 n.
34.164 415 fi.Il y avait encore d verser les r6parations de guerre, les
dommages et int6r6bs aux eccl6siastiques, I'empruit a" inaOA rembourser aux Suisses ; tout ""ti "p""s ia disparition
complete - des liquidit6s municipales durant la guerre. Les
charges des autres villes 6taient analogues. On" comprendleur action acharn6e afin de voir diminu-er leurs oltigalions.Mais leurs d6marches et supplications aboutirent "d
rien.Charles Quint et Ferdinand leur firent savoir qu'ils netol6.reraient _plus que les villes fissent perdre du iemps dtout le monde par leurs n6gociation, ,"rrr'fir, (le 22 juin f da8t.
(l) Ibidem, doc. 776, 786. - La proposition des villes, de nommer un
commissaire pour contrdler l'emploi des fonds, fut rejet6e par Ferdinand avecm6pris.
(2) Pol. Corr. IV, doc. 786.
STRASBOURG ET LA DfFENSE DE LA HONGRIE (1521.1555) 225
Ferdinand leur promit,Ie jour m6me qu'il interviendrait parla suite pour diminuer les charges (r).
cette Didte s'est termin6e, pour res villes en g6n6rar et pourles villes protestantes en particulier, sur dei pur.p""ii.r".trds sombres ; il fallait-se prier d la volont6 de l'&npereur, etd.. celle_
. des princes. En plus des charges linancidres, les
stipulations religieuses peiaient lourdem-ent. A Strasbourgla r6sistance des bourgeois et des corporations fut, si fortequ'un souldvement populaire fut d craindre (z).
Toutefois la raison l'emporta et re nouver ordre fut accept6,du.moins_ en apparence.. L_es impdts semblent avoir 6t6 p"jre.,d I'exception du Pfennig commun.
- En l'absence de ieti.esde rappel, mais aussi d'attestations de versement, nous nepouvons qu'6mettre des hypothdses. La fortification de laligne de d6fense h_o:rgroise en face des Turcs progressait,rapidement entre lb47-b2 ; c,est un indice indirect" de Iarentr6e r6gulidre des imp6ts. Les raids turcs d travers ra<r Hongrie royale I (ce qui 6tait rest6 d Ferdinand) conti_nuaient d inqui6ter I'Autriche, mais nettement moinsqu'auparavant : avant Ib47 seul le chAteau de Gy6r 6taitd6fendable, 5 ans plus tard, 26 6taient d6jd en etat trl._ Il est significatif qu'entre 1b4B et lbb1 aucun raid turc enHongrie ne fut signal6 d Strasbourg; par contre les d6m6r6sd la cour de Transylvanie furent hentionn6s, ainsi que lan6cessit6 de r6unir une arm6e consid6rabre pour r6sisteraux Ottomllp q"i projetteraient une
""-pagrr" d'envergure(Nouvelles d'Augsbourg du ler octobre lbEb;"ot. o
^ En effet, le probldme de Transylvanie devenait brtrlant.Cette principaut6, vassale du sultan depuis 1b41, semblaitd'abord un havre de paix par rapport au reste du royaume.Mais re.n'6tait qu]un-9 apparence. A la place du"princeJean-Sigismond, qui n'6tai1- A96 que de l0 ans, gouvlrnaitle Frdre-Gegrges, dont le but,6tiit de r6parer la perie ae Buaeet r6tablir I'unit6 de la Honglis (s).
Sa politique fut contrecarr6e par la << reine veuve D
(l) Ibtdem, doc. 289. Les contributions et r6parations d verser par strasbourgs'6levdrent e 221.300 florins. (Crdmer, op. cit., page l4l.)
(2) Reuss, op. cit., pages 141-144(3) Hou.a.N-Szrrnii, op. cit., III, pages ll6_121.(4) Pol. Corr. V, doc. 49, 61,(5) Szrr,,{cvr, op. cit., V, pages 2gb_917. HoiraaN_Szsrrii, op. cit., lII,
pages 50-59.
l5
226 I' HUNYADI
Isabelle (r), aussi incapable que frivole et imbue d'elle-mdme
"l o", sa coLerie compos6e' de quelques grand.s seigne,urs'
i',.It* a" """""ir du < Frdre r' Leur ressentiment allait
i""",ia t"orrin"ta"r le Frdre A Ia Sublime Porte' La tradition'"ffi;;;"
-;;tii qr. Ie sulLan nc se mdlal' pas. des affaires
int6rieures d'un pays vassal ; mais si celui-ci s'enhardissait
d se lier d des e,,nemis des ottomans Sa punition, etait
J""-pt"ir" (2). Le sultan, absorb6 par sa guerre contre la
p"''.' d,e |547 d 1b49, d6cida d son retour de campagne'
a" ,"^.ttte de I'ordre et de destituer le Frdre' Il exigea la
"...io" de deux chetea"* qui commandaient I'entree de la
it"*Vf"-"ie. Le Frdre comprit de quoi il s'agissait et r6agit
trds vite : il donna "r, .rrit"r, autant d'apaisements.qu'il
o,ri. or".rint Ferdinand du danger et offrit de lui c6der la
5;#"il;;;"=li t"i."it vite ; pa*r deux campagnes rapides'
il';;;iJ; i.. p""ti.""s de'la < reine-veuve I et le pacha de
bude, .r.rr,, po,rf le destituer (fin 15b0)'- n"i,t. temps Ferdinand r6unissait des troupes pour
nrendre po,,",.io,'- d. la Transylvanie ; Jean-Sigismond
i;;;;;[ ;;;;l".ipaut6 sil6sien'" pbu' prix de son abdicabion'
Au printemps lbbl, l'annexion eut lieu'
Comme toujours' d Ia veille de campagnes' Ferdinand
s'adressait aux etals de I'Empire pour obtenir des subsides'
Il sollicita aon" J'i" DiCt", laquelie se r6unissait en janvier
1551 d Augsbourg, de nouveaux subsides contre les Turcs'
;;;;;t".p?"t"t*i?nt plus la.tr6ve conclue b ans auparavant
et chercheraient mdme i s'emparer de Ia Transylvanie (le
10 janvier 1551) (3)'
Les 6tats etaient assez perplexes' Les uns proposdrent de
.roie. des subsides, d'autres de lever le Pfennig, mais au
cas seulement, or) Ies Turcs attaqueraient r6ellement'
Ferdinand l"rr rlpo"dit que s'iis continuaient d se consulter
(1) Selon la coutume hongroise, la veuve du roi assurait la r6gence jusqu'd
l'dlection du nouveau roi' L1s reines Marie de Hongrie (veuve de Lo.uis II)
et lzabelle (veuve de Je'an zdpotyal ont jou6 leur rdle politique d ce titre ei'
se faisaient appeler < reine-veuve D, terme courant pour les historiens hongrois'
(Voir ir ce sujet: HoIrteN-SzerriJ, op' cit'' III' pages l5-16' et Szrr-'lcvr' op' cit''
V, pages 210-11 et ?20') Aprds t'election du,nouveau roi' Ia <reine-veuver
continuait d porter "*iiii* ;-i,"i"e-mere I n'est pas employ6 en historiographie
hongroise.(2) Voir les expdditions similaires des Ottomans contre la Moldavie en 1b38
et contre Jean ZAPolYa en 1539'
(3) Pol. Corr. V, doc' 67'
STITASB0URG ET LA DfFENSE DE LA HONGRIE (152I.1555) 227
ainsi, jusqu'd I'entr6e des Turcs en Hongrie, les secoursarriveraient sfirement trop tard. Il ajouta que la lev6e duPfennig Commun 6tait d6jd prescrite par la Didte de Spire en1544, au point que certains 6tats qui I'auraient effectivementlev6 I'avaient d6jd d6pens6 d d'autres fins. Il fallait le restituerou lever encore une fois pour qu'il soit prdt quand les Ottomansviendraient (le 24 janvier 1551) (r).
Dans ses instructions d la Didte, en date du 28 janvier 51,le Conseil des XIII insista encore une fois pour faire diminuerla quote-part de la ville, sans se prononcer sur le mode definancement.
Comme les princes 6taient aussi divis6s d ce sujet queles villes, Ferdinand obtint que le Pfennig Commun ftrtlev6 en deux tranches: la premidre pour le ler aotrt de lam6me ann6e, la deuxidme au printemps suivant. Si les Turcsattaquaient entre temps, le tout serait d verser au ler aotrt51 (2).
Ferdinand n'informa les 6tats de ses projebs d'occuper laTransylvanie qu'une fois le fait accompli. Il en informaStrasbourg le 3 novembre, quand tout fut termin6. Il signalaaussi I'approche d'une forte arm6e turque et prescrivit deverser le Pfennig Commun qui aurait di 6tre d6pos6 pourle ler aotrt pass6 (B).
C'6tait trds embarrassant pour la ville qui avait lev6I'impdt encore en 1545 et l'avait d6pens6 pour la guerre dela Ligue de Smalkalde. Pour donner le change, elle affirmaI'avoir verse d temps et s'associa trds vite avec d'autres 6tatsqui avaient vers6 efTectivement en 1547 : I'evdque deStrasbourg, l'6lecteur Palatin, le comte de Hanau. Aprdsla r6union, les XIII r6pondirent d Ferdinand qu'ils collecte-raient le Pfennig... (a).
Bient6t, le 20 f6vrier 1552, par Augsbourg, parvint aux XIIIle mandat imp6rial :< ... de verser la moiti6 du Pfennig dansles 30 jours, le reste au ler aofit, comme I'a pr6vu la Didte.En efTet le beglerbeg de Roum6lie avait, envahi la Hongriel'6t6 pass6 ; au printemps prochain il faudrait s'attendre
(l) L'allusion de Ferdinand concernait, aussi Strasbourg, qui avait levele Pfennig en 1545 et 1546 et avait depens6 pour la guerre de la Ligue deSmalkalde. (Pol. Corr. V, doc. 67.)
(2) Pol. Corr. V, doc. 76.(3) Ibidem, doc. 164.(4) Ibidem.
228 I. HUNYADI
d une attaque plus massive encore' qui serait conduiteprobablement par le sultan m6me.'. u (1).
' La ville d'Augsbourg, Qui avait transmis Ie mandat yavait joint une lJttre, otr ele demandait un avis confidentielconcernant la levee du Pfennig Commun.
Les XIII r6pondirent que Strasbourg ferait comme les
autres 6tats : si les autres collectaient les fonds, Ia ville ne
trainerait pas non plus. Et les XIII enchaindrent - on peut
se demandlr i quel point ils furent sincdres : -( "' Strasbourgpayerait mdme sani s'occuper des autres si elle n'avait pas
d craindre que les princes ne fassent le contraire et que par
cons6quent, la OiOte prochaine n'ordonne une nouvellelev6e..-. I Ils ajoutaient, exasp6r6s : ( ... en fin de compte,
les malins s'en tireront toujours, pendant que les autres
payent : Strasbourg ne payera que s'il y a assurance que les
autres feront de m6me... u (2).
Ils 6taient encore inquiets que I'empereur et les princes
n'apprissent le montattl des versements' Ils demandaientconieil d Augsbourg sur la faEon de faire, pour ne pas se
trahir.Leurs questions 6taient tellement pu6riles, qu'elles.-.ne
pouvaient que refl6ter l'embarras et la volont6 de s'acquitterde leurs charges : < ... Ne faudrait-il pas verser les montantsdans les caisses communesr sans compter?
<r Les villes de d6pdt pourraient-lles a{lirmer devantl'ernpereur avoir regu le versement, sans pour autant d6taillerles sommes regues de chaque 6tat? ... I (3).
II n'y a pas trace que le Pfennig ait 6t6 -vers6. par
Strasbourg. Entretemps eut lieu le souldvement des princesprotestanti, soutenus par certains catholiques -
jaloux de
ia puissance de I'empereur -. La lev6e ne pouvait gudre
6tre r6alis6e avant que la nouvelle de la r6volte ne ftrt connue.De toute fagon, en avril et en mai, I'arm6e frangaise 6tant
dans les environs, la ville avait d'autres soucis que de leverle Pfennig. Ensuite, d'attente en attente, elle constataitque l'empereur ne pouvait plus r6tablir sa situation pr6-pond6ranle et qu'il n'y avait plus de sanctions i craindre (a)'
(r) Ibidem.(2) Ibidem.(3) Ibidem.(4; Rrut", op. cit., pages 147-156. - Bonntns, op. cit., pages 131-132'
STRASB0URG ET LA DfFENSE DE LA HONGRIE (I5zI-1555) 229
Entre temps, la situation en_Hongrie s'6tait compldtementrenvers6e au d6triment de Ferdinand : d I'issue de la campagnede 1551, soupgonnant le Frere Georges de collusion avic lespttopals,-ses g6n6raux l,assassindint en d6cembre lbbl.Priv6s de fappui,de celui-ci, ils perdirent compldtement pieden Transylvanie (1).
. Cette province, au lieu, AIO!1e un appoint, pour Ferdinand,devint une charge, otr il fallait
"r.fo- ., des renforts. Les
Ottomans^a_ttaqudrent en force et 6largirent leurs """q"Ct"r.Il aurait fallu envoyer des renforts cJnsid6rabl.* , o"l--"rr""les princes allemands en r6volte ouverte. il ne pouvaii e.,6_!"9 question. Ainsi le coup de force en f"'"^yi"".ri.
d6clencha-t-il une catastrophe : Ferdinana ". io"""itaider son frdre avec ses.troupes stationn6es ." Ho"i"i", .tI'e.ppergur ne pouvait intervenir contre les Ottom"a.r.. ttfallait lAcher du lest. Ferdinand fit des concessions auxprinces allemands,.dans I'espoir qu'il pourrait les apaiser etavec leur aide, r6tablir sa situatio.t.n Fiongrie. par t,""-i.li."d,",Pn::"y,. les princes obtinrent I'aboflion de I,Int6rim,et le r6tablissement,g* lq libert6 rerigieuse jusqu'd r" niotuprochaine. Ensuite Maurice de Saxe ac""pta d. mener ses
l.g.yp.: en Hongrie, oir les Ottomans faisaient d.. .orrqr6t"r,tailla.nt, e1 pidces _les troupes allemandes et espag"oi;r-a"Ferdinand. Mais Maurice de Saxe s'arr6t" e 'Cy?" -"i ,"contenta d'escarmouches sur lesqueiles il r6digea des rapportsmi16b6lsnfis (z).
Les villes se tenaient au courant de l'6volution de ra situa-tion de.l'empereur : Ulm 6crivit aux XIII de Strasbourg,le 12 juin, que les tractations de passau, entre Ferdinand etles princes r6volt6s avangaient, eue l,empereu", f"eri,attendait des secours d'Espagne (a).
t
^ De BAle, le maire (c,eit- un fiddle corresponclant desStrasbourgeois) enchaina, le 14 juillet : Maurice de Saxeirait probablement, en Hongrie, l",empereur a 6b bataillons
(1) Hon,LN-Sznxrii, op. cit., IIl, pages bg_62. _ Szrr,Acvr, op. cit., y,pages 317-330.
(2) Ses lettres envoy6s aux 6tats de I'Empire grossissaient notablement,ses victoires et firent croire que son intervention avait contraint les Turcs ela retraite. Ses tractations t6n6breuses avec res seigneurs hongrois et boh6miensainsi que sa publicit6 tapageuse, laissent *rppor." plutdt qu,il cherchait dsupplanter Ferdinand sur les trdnes de la Hongrie et ae la notrdme. (Szrlacvr,op. cit., V, pages 328.)
(3) Pol. Corr. V, d,oc. 2b2,
230 r. HUNyADT
dans I'Empire, mais 6parpill6s ; il doit rester sur ses r6serves,car les Ottomans sont en Hongrie avec une trds forte arm6e (1)
(le 29 juillet).Le 2 aott, le conseiller royal Zasius annonga d Strasbourg
que I'accord de Passau 6tait ratifi6 par I'empereur et queles chefs captifs (l'6lecteur de Saxe et le landgrave de Hesse)
etaient lib6i6s. Que Maurice de Saxe n6gociait avec Ferdinand,afin de faire une campagne en Hongrie. Ses capitaines refu-saient tout d'abord de combattre en Hongrie, mais il put les
persuader. Selon une autre source, dat6e du m6me jour,il avait d ce moment 12.000 hommes prdts d marcher (2)-
Le 15 aotrt, I'Int6rim fut abrog6 d Strasbourg, mais la villeavait peur d'un renversement de la situation et elle tol6rales c6remonies catholiques jusqu'd 1555.
Le 4 novembre, la nouvelle fut connue, Que Mauricede Saxe 6tait encore en Hongrie ; il avait d6fait une troupeturque, 6valu6e d 3.000 hommes (3).
D'une fagon g6n6rale, l'int6rdt des villes se d6tourna des
affaires hongroises d partir de 1552. Il s'attacha d l'6volutionde la lutte entre Charles Quint et les princes. Le sidge de Metz,tent6 dans de mauvaises conditions atmosph6riques, i l'entr6ede I'hiver, passionna I'Empire : son succds aurait pu amorcerun renversement de la situation en faveur de Charles Quint,ce qui etrt 6t6 grave pour les protestants. Mais en eux-m6mes,la perte de Metz - pourtant prix de I'alliance frangaise -ne les laissa pas indiff6rents.
Strasbourg 6tait bien plac6e pour fournir des nouvellesdu sidge ; Ulm en demandait fr6quemment, et communiquaiten 6change les nouvelles de Hongrie (nl-
Nouvelles d'Ulm du 3 janvier 1553 : < Ferdinand a cong6di6les troupes allemandes de Hongrie I ; celles du 9 mars :
< F'erdinand est trds inquiet, car malgr6 des pourparlersd'armistice, les Turcs se pr6parent d attaqu < dds que
I'herbe aura pouss6 D -. < Ils projeteraient aussi d'envahirla Transyl.ranie. I Un armistice fut finalement conclu (5)'
Connu d Strasbourg le 27 juin, il fut jug6 on6reux pourFerdinand.
(t\ Ibidem,(2) Ibidem,(3) Ibidem,(4) Ibidem,(5) Ibidem,
doc. 267.doc. 280.doc. 305.doc. 320, 327.doc. 327, 355.
srRAsBouttc Er LA DfFENSE DE LA HoNcRrE (l5Zl_1S55) zZL
_ Pgy aprds, survint la brouille entre Charles Quint etFerdinand' contrairement aux arrangements p16c6dents,Charles Quint d6cida de laisser d sa mort I,Empire non pasd Ferdinand, mais d.son fils philippe. C"tte "ou.rifii "rr.itOtconnuc, passionna l,opinion : leJ villes 6changeaie"i f"u*informations (1). Mais Llles n'utilisaient cette crise ;;; ;"",faire trainer le versement des imp6ts ou ne pas les verser dutout.
Un incident, caract6ristique pour le renversement du3pport, des forces entre empereu-r et 6tats, survint entreI'empereur et Strasbourg. il esfl aussi .igrrin"";ii ;or"I'inter6t
- que Strasbourg "montrait d |egard a" i"--g,i""."
]t:-:ly"^, ,lorsqu'eile n'r.riit rien d craindrE a" t;u_f".Er. .tlorsque l'|,-pi." n'6tait pas directement menac6.
Lorsqu'en automne 1b-b2 Charles Quint marcha sur MetzP:."" li reprendre
1ux ._frangais, il passa par Strasbourg.Il loua la fermet. cle la ville a.nani les Lxigences o" He.oi it ;il promit de ne pas oublier., .L.: Strasbourgeois-essayerent de le prendre au mot, etlui demanddrent d,all6ge. 1.r.. cha"ges, remontant d lacapitulation de 1b47. (R6parations au-x eccl6siastiques, auduc de Brunswick et d'd'autres princes). 1----'
., !'.TP""eur r6lo.ndit le 26 "r,"it tnEg. Aprds une d6clara_Iron de grAce, il dispensa la ville de pa.yer les dommaEes_int6rdts d ses adversaires, sauf au air" i.
- e"",',*i.i.l' afo,rdre
.Teutonique, aux couvents sainte-claire et saint-Arhogast. Au sujet du pfennig, il promit d'en toucher un motau roi Ferdinand. Mais celii_ci refusa cat6goriquement :il trouvait inadmissible qu'une ville aussi "i.frE ""'.r";;;".du toub le Pfennig (z).
,-Bienb6b l'empereur essaya de monnaver sa 916ce : Ic B iuin1554 il sonda ta viile pr" r'iob..-eoilire- a"- ;;; .;;;"'ill",Pollweiler, pour savoi" ii elle 6tait dispos6e d lui prdter deI'argent. La ville refusa, en 6num6rant toutes les' charge.qu'elle avait. Le Pfennig ne figurait, pas dans l,6num6ratio? ;c'est un_indice qu'elle ne I'a pas-vsrs6 iri., L:-?!_octobre, Ferdinand intervenait encore une fois chezles XIII au sujet du_ pfennig ; il demanda qu,on l,informe,sur le montant que la ville pouvait verser. ia r6ponse est
(1)(2)(3)
I bidem.Ibidem,Ibidem,
doc.339,doc. 434.
232 I. HUNYADT
introuvable, mais eIIe fut strrement 6vasive' En effet' dans
Ies instructions pour la Didte de 1555, dat6es du 15 f6vrier 55'
i;; -iiii
pt"sciivaient de refuser le Pfennig' sous pr6texte
d'avoir beaucouP i PaYer (t)'
- ; l; Didie, p&aina"d se fit pressant ; la v-ille d'Augsbourg
intervint finalement et conseilla aux XIII de Strasbourg
de verser une somme modique pour en 6tre quitte' Strasbourg
remercia cle I'intervention et offrit de lever Ie Pfennig au taux
d;"iit0bO "" 1/3000; toutefois,.-Ie. versement n'esL pas
attesi6. L'imp6t'se serait alors chiffr6 d 4-6.000 florins (2).
L'6poque of I'empereu-r commandait 6tait r6volue' Les
successeurs de Cha'rles-Quint pouvaient encore obtenir
a.*"."n.ia"s, mais uniqueirent par la persuasion' au prix de
i"C. gt""a.s diflicult6s. I'empiie s'engageait sur la voie de
la desagr6gation.
CoNcl,usroN
En examinant le comportement de Strasbourg en Jace de
t* Grr."r" Turque duraninotre p6riode, il apparait clairement
qu'il n'6tait Pas uniforme.Pour Strasbourg il y avait une distinction fondamentale
i faire selon que I'E"mpire 6tait menac6, ftrt-ce dans sa
-oinar" parcelle ou dans sa province la plus eloign6e' telle
Ia Carinthie ou la Styrie, ou que la menace ne concernait
qu'un pays 6trang"t, i" Hongrie' En faveur de ce royaume'
tjfr"lit"rri de I'E-rnpire n'6p"rouvait pas d'autre obligation
;;;-;;l; de la solidarit6 chr6tienne' Ici encore' le fait que
IL reste de I'Europe ne se montrait pas g6n6reux.6tait une
tentation de suivre cet exemple commode. L'id6e que .lefrdre et I'h6ritier de I'emper""i 6t'"it aussi roi de Hongrie'
,re c"6a pas de liens affectifs. Nous avons vu, d I'exemple de
i;Lig""i;p6riale de 1548, la stupeur et I'6pouvante l',:ltf."taes ittl de Strasbourg i I'id6e de l'6tendue des obltgatlons
il;; comportait. frais, au ful.et. d mesure qu'il appanrt
dul" Jct*"dant Ia Hongrie, les Etats d6fendaient I'Empire
lui-meme, les bourses se d6lidrent un peu'
(l) Ibidem, doc. 461.Pol. Corr. V, remarque jointe au doc' 461'
STRASBOURG ET LA DIiFENSE DE LA HONGRIE (1521.1555) 233
Vis-d-vis de l'Empire, I'aide strasbourgeoise fut condi-tionn6e durant toute Ia p6riode par ses int6r6ts de villelibre et de cornmunaut6 protestante.
En tant que ville libre, elle 6tait expos6e d des pressions etsollicitations de toutes sortes (subsides, contingents etarmements) et elle souffrait dans son amour-propre d'6tred la Didte un 6tat de deuxidme classe que l'empereur et lesprinces pouvaient charger i volont6 de fardeaux, sans tenircompte de son avis. Elle estimait quelquefois que I'empereurou Ferdinand, roi de Hongrie, agitaient le p6ril ottomansous ses yeux pour tirer d'elle de I'argent i des fins purementdynastiques.
En tant que communaut6 protestante, elle se sentaitmenac6e dans ce qu'elle consid6rait comme le plus pr6cieux,sa foi ; et elle risquait de connaitre les horreurs d'une guerrede religion.
Elle tentait d'6chapper d cette ins6curit6 et i cette subor-dination par des n6gociations acharn6es et la recherched'alli6s strrs. Ces alli6s 6taient en fin de compte des 6tatsprotestants ; les villes ne purent s'aflirmer en tant que forceind6pendante d la Didte.
L'absence d'un climat de sinc6rit6 et de confiance entre laville protest ante et I'empereur catholique, - esprits calcula-teurs I'un comme I'autre, - fit que I'attitude loyale, presquepatriotique, de la ville au d6but changea vers 1546-47 d telpoint qu'elle attendit la d6livrance des protestants d'une actionguerridre des Frangais ou des Ottomans contre I'empereur.
Pendant de longues ann6es, Strasbourg contribua donc dI'effort de I'Empire, souvent dans I'espoir de voir aboutir ses
revendications, ou par peur de repr6sailles, ou en consid6rantque le p6ril menagant I'Empire devait faire taire les querellesint6rieures.
En fait, elle n'a obtenu de Charles Quint ou de Ferdinanden 6change de sa loyaut6 que de bonnes paroles. Les conces-sions, les remises de dettes vinrent trop tard, lorsquel'empereur n'avait plus la force de se faire ob6ir.
N6anmoins, le sentiment de solidarit6 chr6tienne jouaittoujours en faveur de la contribution, car personne dansla ville n'6tait turcophile : les sermons des pr6dicateurscomme les lettres du magistrat ou de particuliers le prouventabondamment (1).
(1) Supplication de Bucer contre les Turcs en 1532. (Archives Municipalesde Strasbourg, Archives St. Thomas. Liasse ; 38120-21.)
234 r. HUNyADT
La question se pose de savoir quelle 6tait au juste la contribu-tion r6elle de Strasbourg et ce qu'elle aurait pu faire de plus.
Elle a vers6 de I'argent, dont 34.940 florins sont attest6s,soit 1/5 environ des sommes vot6es, donc exigibles, s'6levantd 156.328 florins sauf omission. (Voir tableau en annexe.)Probablement, Strasbourg a vers6 plus que ce qui est attest6.La disparition des comptes 16guliers, d6truits en grandepartie en 1789-90 ne permet pas, de toute fagon, d'en retrouverle total. Les prdts furent des pertes d'argent au moinsmomentan6es, car avant le remboursement effectif, la villen'6tait jamais strre de rentrer dans ses frais.
En outre, des bourgeois, des eccl6siastiques en particulier,ont contribu6 encore par des sommes notables (1).
J'ai accept6 le versement comme certain quand il est soitattest6 par un regu, soit a{Iirm6 comme tel dans une lettreadress6e d I'empereur ou d une ville amie. Bn efTet, entreelles les villes ne faisaient point de sentiment, elles n'avaientnulle honte d'avouer qu'elles n'avaient pas envie de payer ouqu'elles cherchaient une compensation pour leurs sacrifices.
Strasbourg fournit encore une aide militaire : contingents,artilleurs, canons et poudre, dont seul le premier peut 6tre6valu6, faute d'6lements chiffr6s.
Pour retrouver Ie poids relatif de la contribution strasbour-geoise, il serait trds int6ressant de la comparer i celle d'uneville 6minemment loyale, telle Nuremberg ou Augsbourg,et d celle d'une autre, indiff6rente, telles que les villeshans6atiques, Lribeck ou Hambourg.
Les guerres turques continudrent encore durant 150 ans;et par la force des choses, les subsides finirent par devenirpermanents, une fois la question religieuse retir6e de I'ordredu jour. C'est ce qui arriva en 1555, lorsque la DidteAugsbourg y apporta sa solution, aussi discutable qu'elleparfrt aux partis religieux.
Le d6pouillement d fond des quelque B0 liasses dedocuments - in6dits dans leur majeure partie - s'6tendantsur les xvre et xvrre sidcles apportera sans doute beaucoupde lumidre sur cette question.
Charles Quint, au bout de 36 ans de rdgne, abdiqua,6puis6 par la maladie et les 6checs. Il 6choua dans sa gigan-tesque entreprise de 16aliser la monarchie universelle. Iln'6tait pas parvenu non plus d refouler le p6ril ottoman.
(l) Imposition du Chapitre de Strasbourg contre les Turcs. (ArchivesMunicipales de Strasbourg, Archive St, Thomas. Liasse : l6/13, f .)
STRASBOURG ET LA DiFENSE DE LA IIONGRIE (1521-1555) 235
La Hongrie 6tait encore un lambeau sanglant, mais I'Espagneet l'Italie n'6taient pas non plus d I'abri des raids desBarbaresques ; I'Empire souflrait aussi des ravages desOttomans.
Les divers th6Atres d'op6rations militaires 6taient encorr6lation constante, leurs r6percussions mutuelles emp6-chaient une action soutenue of qu'elle ftrt. Lorsqu'il fallutchoisir entre plusieurs actions simultan6es, ce fut toujourscelle contre les Turcs qui fut, remise d une date ult6rieure.L'action de Charles Quint 6tait surtout profitable d I'Espagne :
lorsqu'il la l6gua d son fils Philippe II, elle 6tait la puissancepr6pond6rante en Europe. Le Saint Empire germanique qu'illaissa d son frdre Ferdinand 6tait par contre d6jd organis6en une marqueterie de principaut6s, amput6e des possessionsespagnoles, d laquelle seule la lutte contre les Turcs donnaitencore un semblant de coh6sion. Le d6tachement progressif desteruitoires autrichiens transformera I'Empire en Allemagne.
En face de cet Empire sur la pente, se dressera pendantlongtemps, pendant 150 ans, I'autre empire, celui desOttomans,.parvenu i son apog6e sous Soliman le Magnifique.Mais, tiraill6 entre les champs de batailles de Hongrie et dePerse, entrav6 par les traditions rigides du combattantottoman, la rapacit6 des spahis, il entrera d son tour, ddsla mort du grand sultan, dans une longue d6cadence.
La grande perdante de ce sanglant afTrontement fut laHongrie. Le royaume, qui sombra dans I'anarchie nobiliaireau d6but du xvre sidcle, connut un d6sastre militaire en 1526,en face de son ennemi s6culaire, I'Ottoman. La mort du roi,celle d'une grande partie des dignitaires du pays dans cettebataille, en aggrava singulidrement la port6e ; la double 6lectionroyale fut une catastrophe nationale irr6parable.
En effet, au-dessus d'une paysannerie r6duite d unecondition trds dure, la noblesse se divisa en deux camps.L'un estimait que sans I'aide de la Maison d'Autriche, laHongrie ne pourrait pas r6sister aux assauts des Ottomans ;
I'autre par contre a{Iirmait que les malheurs du pays pro-venaient de la domination 6trangdre (1). La plus mauvaisesolution d ce dilemme fut d'essayer les deux remddes d la fois,sous les yeux de I'ennemi ; c'est justement ce qui arriva.
(l) Hou.r,N-Szorrti, op. cit., lII, page 12-14. -
Szrr-Acvr, op. cit., IY,pages 213-14 et V, pages 10-15.
- S. Suor-r<1, Ferdinand I Bemiihunges um
die Krone von Ungarn. (1876). (Archiv fiir Oesterreichische Geschichtsquellen,LVII,)
236 r. rruNyADr
Les h6sitations entre les deux solutions, les changements{9 camp 6veilldrent la suspicion de Ferdi"""a, q"i""y"rrtd'autres peuples d gouverier alrssi, pouvait ," '1r"rr.i
a,,concours des seigneurs hongrois. Ir s'enloura de resilrtissantsd'autres pays, et lorsque le"s. Hongrois r6agirent, il 6tait troptard : les places 6taient prises.
,^f","TTrrd, p"l ses efforts surhumains de pers6v6rance,.reta les bases de la Monarchie Autrichienne. Il unifiait, pourlongLemps des pays qui, depuis un sidcle, onb6t6 "er.ririlr.ct'une lors sous Ie m6me sceptre : I'Autriche, la Boh6m. .t t"Hongrie. Parmi ses traits de caractdre et parmi ceux de ses
:l:ces?eur,s, les peuples qu'ils seronL
"pp"l6. d gouve"ner ,rererlendront comme essentiels * injustement d,ailleurs _que l'esprit m6thodique, la t6nacit6 et re machiav6lismemaladroit et d courte-vue, et s'en serviro"t ";;;;a,rrs"_ments dans leurs accusations contre la pofitiq".--h".
Hahsbourg. Des Hongrois s,accommoderont particuliirementmal de cette atmosphdre. Suspect6s d'inconstan"" et eclrte.des postes de commindement
"rr"a ,rrra pers6v6ran"" *.aqrirr",ils y.r6pondront par des insurrections'que les ff" lo.ig ,r.parviendront d dominer.
.gue _partiellernent. Les Hong'roisy acquerront une r6putation de rebelles incorrigibles. "- Lorsque I'heure de Ia lib6ration du joug ottom?n-rorr."ru,le combat, lib6rateur n'attachera p", iu roi et la nation |und I'autre. Chacun estimera avoir iait plus que i,""t."-.i
""pas 6tre pay6 de retour. La cour ae Vienne pr"rrdi* -d.,
pr6cautions d I'encontre des Hongrois, "orrr*. "utG
-A"
peupler les confins r6occup6s par des" peuples venus de tousles .horizons, d I'exclusion aL Horrgiois, cr6ant "irrri
-0",probldmes suppl6mentaires de minorlt6s nationales.
E1fil, du point de vue europ6en, la conclusion des tour_ments du xvre sidcle fut la disparition d6finitiv" a" r" Ho"gri"gn t-ant_ que puissance internationale et l,apparition,;; pfi;",de la Monarchie Autrichienne,- d'aspeci
"t a" f""g""'t""_maniques, qui fit avancer tes iimites de l,Empir"
"'fi.*l"apresque j9gU,r'a I'embouchure du Danube, avant, A, Jirp"_raitre en lgl8. C'est-d ce moment que I'Europe ".Je"o".i"itque.l'Autricle, qu'elle consid6rait
"o.rr-. un pays allemand6tait' en r6alit6 'n-e mosaique de peuples het6ro"tii".
- a*cult,ures et de civilisations disparatLs, dress6s hostilernent
les uns contre les autres.
Istv6n HuNyeor.
STRASBoURG Er LA DIiFENsE DE LA HoNGRTE (I5Z1-15S5) 232
ANxrxn:
Tableau des contributions de Strasbourg pour la guerre contre les Turcs
Ann6e
1522 lExp. rom.-sixieme 1.380 fl. I 1.380 fl
Subsidesvot6s
1523 lB*p. rom.-demie1526 ltrxp. rom.-simple1529 ltrxp. rom.-simple
I bataillon
poudre
l53t I Subsides pourVienne
1532 lExp. rom.-douArtilleurs, canons,
transportI536 ll00 q. de1537 1100 q. de poudre1541 lExp. rom.-demie1542 lPfennig commun1542 lExp. rom.-double
Artilleurs, canons,poudre
100 chevaux
1543 lExp. rom.-simple1544 ltrxp. rom.-l/3
Pfennig Commun1548 lPfennig Commun
Provision1548-51 lFortification Laux
annuel 1.540 fl.1552 lFortification1555 lPfennig Commu
Total :
(Abr6viation,Exp. rom. : Exp6dition
romaine.)
parL de I Verse- | Verse-
Srrasbourg I #;H. lrffi:il
I ;.i;o- l;;;;"I a.zso I
I s.zso I z.zooI I a.ooo
L.ooo I'.nnn
I ,o,o L,*
| ',.,,
I
"...
I z.ooo I
I as+o I
I rz.ooo I
I ro.roo I s.ooo
tl;:;::I +.gos I z.ooo
| '1,*: I
I rz.ooo II rz.ooo I
I s.zeo I
I u,on I
1.540 I
12.000 It_lb6.3z8 n.
I s+.s+o n.
a""trt-a"r r"-"attest6e et probable :
Total..
Remarques
contribution en espdces
solde du bat. (2 mois)solde pas indiqu6e
Dont 800 fl. rembours6s
Sous l'impression du sidge
Pas de pr6cisionsRembours6s ?
Rembours6s ?
Moiti6 retenue pour - la
guerre contre Brunswick2 mois de soldes (l mois
vers6 au recrutementVersds d Brandenbourg
Emprunb d NurembergVerses e Brandenbourg
Annonc6s aux alli6s luriens
2/3 contre la France
Pas vers6
Versements probables, vumoyens de coercition de
I'empereur
Levd au taux de 1/3000
4.000
2.000
6.0003.6001.860
2.968
11.4004.000
8.280
6.1 60
4.000
53.848 fl.
53.848
34.940
88.788 florins














































































![TAXONOMY AND BIOLOGY OF SIPUNCULANS, WITH EMPHASIS ON THE MORPHOLOGY OF PHASCOLION STROMBUS (MONTAGU, 1804). ANNOTATED BIBLIOGRAPHY 1555-1995 APPENDED AS ANNEX. [1995]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322f412050768990e10167c/taxonomy-and-biology-of-sipunculans-with-emphasis-on-the-morphology-of-phascolion.jpg)