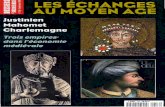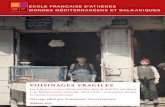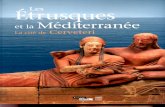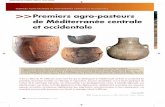VENISE ET LA MédITErrANéE
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of VENISE ET LA MédITErrANéE
Impossible d’être indifférent à Venise. Le spectacle qu’elle offre aujourd’hui aux foules de visiteurs du monde entier qui envahissent les rues et les places de la Lagune, et qui en ont chassé en l’espace d’un demi-siècle la moitié de ceux qui y résidaient, s’impose à nous comme le symbole même de l’impact destructeur du tourisme de masse sur ce que nous appelons le patrimoine. Au point qaue le projet est régulière-ment évoqué d’établir un droit d’entrée sur la Lagune, dans l’intention, sans doute illusoire, de freiner une marée qui ne cesse de monter. Et qui porte avec elle ces énormes palaces flottants qui viennent s’amarrer pour vingt-quatre heures le long des Zattere. Mieux vaut sans doute nous faire à l’idée que Venise est devenue aujourd’hui le plus grand mu-sée du monde, mais un musée très différent de tous les autres, un musée sans murs, à l’air libre, peuplé d’hommes et de femmes qui continuent à y vivre, à y travailler, à entretenir une façon de vivre particulière avec laquelle ils s’identifient, à en maintenir les règles et les codes: un musée aussi qui n’existe que par référence à l’histoire d’une ville d’exception, une histoire qui couvre tout le second millénaire, dont les cinq siècles qui en constituent la partie centrale ont été ceux de sa plus grande puis-sance et de son rayonnement économique sur l’ensemble du monde mé-diterranéen et européen.
Mais il est nécessaire de nous faire à au moins deux autres idées. La première est que Venise n’a pas été une victime involontaire du touris-me culturel. Sans forcer les termes, il faut reconnaître qu’elle a joué une part active dans son invention à l’échelle européenne – invention dont elle a partagé la responsabilité avec rome –, et qu’elle a été sans doute la première ville du monde à proposer dès le xviiie siècle aux visiteurs tout l’éventail des distractions, des spectacles, des plaisirs plus ou moins avouables, des luxes et des curiosités qui pouvaient apparaître de nature
Maurice ayMard
L’EUrOPE, VENISE ET LA MédITErrANéE
MAUrIcE AyMArd�
à les attirer et à les faire rester, sans autre motif que le divertissement et le loisir. Elle se distinguait ainsi de la rome pontificale, sa concurrente dans la même entreprise, pour laquelle jouait toujours – vraie motiva-tion ou pieux alibi? – le prétexte du pèlerinage, stimulé depuis le milieu du xve siècle par les Jubilés. Venise a ainsi créé, entretenu et exporté dans toute l’Europe, comme un modèle inimitable, l’image d’elle-même dont elle s’est retrouvée ensuite prisonnière, même si cette image visait également à faire oublier une réalité tout autre, qui s’imposait à tous les esprits lucides, et qui était celle du déclin de son influence politique et de sa puissance économique. cette même influence, cette même puis-sance avaient longtemps constitué le cœur même de la représentation mythique d’elle-même et des institutions que ses élites avaient élaborée au cours des siècles, et à laquelle elles avaient fini par croire, comme ont d’ailleurs longtemps continué à y croire nombre d’historiens.
La seconde idée qu’il nous faut accepter est que, malgré l’exception-nalité de son site et de son cadre, la Venise à laquelle nous nous référons toujours quand nous en parlons – ce groupe d’îles au cœur de la Lagune – est aujourd’hui devenue le «centre historique», isolé et protégé par les eaux de façon infiniment plus tranchée que par de simples boulevards, d’une agglomération urbaine infiniment plus vaste mais aussi plus ba-nale. celle-ci s’étend, si l’on s’en tient aux limites administratives de la commune de Venise, du Lido à la terre ferme, et englobe aussi bien les quartiers industriels et portuaires de Porto Marghera que les quartiers résidentiels de Mestre ou Favaro: c’est-à-dire à peine plus que l’ancien dogado, qui avait jusqu’au milieu du xive siècle (Trévise et son territoire sont conquis en 1336) constitué le seul territoire placé sous l’autorité directe de la ville, et n’en regroupait au début de l’époque moderne que 10 ou 15% des habitants, alors qu’elle en fixe aujourd’hui plus des trois quarts. Mais la dynamique des territoires urbanisés, chère aux géogra-phes, est telle qu’il nous faut, pour relativiser la chute de la population enregistrée depuis le début des années 1970 (plus d’un quart de la po-pulation totale) situer désormais ce même centre historique de Venise par rapport à un ensemble plus large encore, densément peuplé et urba-nisé, qui s’étendrait au moins jusqu’à Padoue ou Trévise, ces anciennes villes sujettes de la Seigneurie. Toute ville vit avec son temps, et Venise n’échappe pas à la règle: pour en parler, il nous faut sans cesse changer d’échelle, et suivre les dynamiques de l’expansion spatiale des phéno-mènes considérés.
Parmi ces différentes échelles, le sujet même de ce colloque, orga-nisé dans le cadre des rencontres européennes du patrimoine de l’Inp, nous invite à en retenir trois, différentes, mais complémentaires, et bien
L’EUrOPE, VENISE ET LA MédITErrANéE 5
adaptées à l’époque dont nous avons choisi de parler: celle où Venise a conquis et occupé durablement une position privilégiée, au cœur même de ce que Fernand Braudel aimait à appeler «la grande histoire».
La première échelle est celle de la cité qui établit sur la Lagune un pouvoir politique et économique à la fois original, efficace et fort, ca-pable de concurrencer en position d’égalité ou de supériorité ses rivaux de l’époque, y compris l’énorme Empire ottoman, de se créer un état double, «de mer» et «de terre» au tournant du xive et du xve siècle, et d’en défendre l’indépendance jusqu’à la fin du xviiie siècle.
La seconde est celle de la Méditerranée: Venise ne l’a jamais ni domi-née, ni même contrôlée dans son entier. Elle y a toujours eu des rivaux, mais ses navires et ses galères marchandes en ont parcouru pendant des siècles toutes les routes. Et elle a réussi à la fois à y créer un réseau très ramifié de comptoirs et de «colonies» et à se tailler entre les xiiie et xve siècles au Levant, de l’Adriatique à chypre, à la mer Egée et à la mer Noire, un véritable empire, constitué d’une suite d’îles et de ports, qui servaient de points d’appui à ses trafics maritimes et aux mouvements de sa flotte militaire: celle-ci y était en effet toujours présente même en temps de paix pour y garantir la sécurité de la circulation maritime contre les attaques des pirates et, en temps de guerre, contre les mena-ces de ses ennemis, mais aussi pour y imposer à tous ses concurrents commerciaux, avec d’ailleurs des résultats très inégaux, le respect des règles que la république avait établies à son avantage.
La troisième enfin est celle de l’Europe, à laquelle la relie d’un bout à l’autre de la période envisagée ici tout un faisceau de routes qui tra-versent les Alpes en direction des Pays-Bas et de l’Angleterre, via l’Alle-magne du Sud et la vallée du rhin ou la France, ou gagnent au contraire l’Autriche, la Hongrie et le sud de la Pologne: ces routes, les marchan-dises qui partent de Venise ou lui sont destinées ne sont pas les seules à les emprunter, et l’on y retrouve aussi bien celles de ses concurrents de l’Italie du Nord, Milanais, Génois, Florentins, Pisans et autres. dès les xiiie-xive siècles, celles qui relient les deux pôles les plus densément urbanisés de l’Europe d’alors, l’Italie du Nord et les Pays-Bas, consti-tuent l’axe majeur du commerce européen, et préfigurent la « banane bleue » dans laquelle roger Brunet et son équipe ont, au milieu des années 1970, proposé de voir la mégalopole ou la dorsale structurant l’espace de l’Europe occidentale à l’époque en cours d’unification, et dont les photos du satellite Spot ont par la suite confirmé par l’image l’existence. Mais ces routes de terre, dans le contexte technique de la fin du Moyen Âge et de l’époque moderne, ne peuvent servir à acheminer sur d’aussi longues distances – plus d’un millier de kilomètres – que des
MAUrIcE AyMArd6
marchandises de faible poids et de valeur élevée, dont les épices dans un sens, et les draps de prix dans l’autre, ont longtemps constitué le sym-bole: Venise, encore elle, tentera pendant plus d’un siècle l’expérience de la route de mer, qu’empruntent ses galères di mercato, pour gagner, via le détroit de Gibraltar, Bruges et Southampton, afin d’en rapporter aussi les laines anglaises alors classées parmi les plus fines, mais elle fi-nira par y renoncer dans les années 1530. Et il faudra alors attendre les toutes dernières décennies du xvie siècle pour voir cette fois les navires d’abord anglais, à la fin des années 1570, puis hollandais et hanséates, à partir de 1590-1591, gagner à leur tour la Méditerranée, pour y apporter cette fois des produits pondéreux comme le blé et l’étain, ou des étoffes plus communes, destinées à une clientèle plus large, les « kerseys », re-baptisés en italien carisei.
ces trois échelles nous permettent de dresser un premier tableau et de prendre la mesure du rôle joué par Venise dans la construction d’un espace économique qui associe étroitement la Méditerranée et l’Europe. cet espace, Venise en est l’un des centres, et pour une pé-riode d’un siècle ou deux qui a marqué, entre xve et xvie siècle, l’apogée de sa puissance, le centre dominant mais jamais exclusif. Il constitue le cadre géographique d’une première économie-monde, qui a précédé les découvertes maritimes de la fin du xve siècle, et son élargissement à l’Atlantique et à l’Océan Indien, puis dans une seconde étape au Paci-fique que celles-ci ont rendu possible à partir de Lisbonne et de Séville d’abord, puis des ports de la mer du Nord et de la façade atlantique de l’Europe ensuite.
Fondée vers la fin du vie siècle par des populations réfugiées fuyant les invasions, indépendante depuis le début du second millénaire, la vil-le s’est construite sur un groupe d’îles progressivement stabilisées de la Lagune et elle a développé ensuite ses activités commerciales au rythme même de la reprise des échanges à longue distance en Méditerranée. Elle a su valoriser, aux dépens d’Aquilée, située plus à l’est au débou-ché des routes conduisant au danube, qui l’avait précédée à l’époque romaine et gardera son statut de métropole religieuse jusqu’en 1751, sa position au fond de l’Adriatique: celle-ci lui a permis de s’imposer comme l’étape la mieux placée entre, d’un côté, les routes maritimes qui conduisaient vers le Levant, partagé entre Byzantins et Arabes et, entre le xiiie et le milieu du xve siècle, à la Mer noire, et, de l’autre, les routes terrestres et fluviales permettant de gagner aussi bien l’Ita-lie du nord que l’Europe du nord-ouest. Entrepôt marchand d’abord, exportant vers la Méditerranée orientale les produits des manufactures européennes (textiles et métaux surtout), important et redistribuant en
L’EUrOPE, VENISE ET LA MédITErrANéE 7
Europe les produits de luxe (épices, parfums, pierres précieuses et soie) mais aussi pondéreux (le sel, le blé, la laine, le coton, les cuirs, et les matériaux de construction navale) provenant non seulement du Levant mais de toute la Méditerranée.
Elle a pu longtemps se contenter de vivre de ce rôle, comme en témoignent les célèbres harangues du doge Mocenigo qui en 1�22-1�23 avait tenté, en vain, de détourner le Sénat d’entrer en guerre contre Mi-lan pour s’emparer d’une partie de la Lombardie: comptabilisant dans le détail le volume des importations et des exportations, le bénéfice mo-nétaire que Venise en retirait en termes de solde positif de sa balance des paiements, les profits de ses marchands, le nombre de ses habitants engagés dans les activités de transport terrestre, fluvial et maritime, le doge se permettait de conclure, parlant de la Lombardie, «c’est notre jardin, mais un jardin qui ne nous coûte rien: il nostro giardino, senza spesa». Et il répètera plus loin le même calcul à propos de la Toscane, donnant ainsi les premières analyses quantifiées de régions économiques au sens moderne du terme. Mais sa conclusion importe ici bien plus que la validité de ses chiffres, sur laquelle les historiens ont longuement débattu, et qui semblent fondés sur les informations dont disposaient les différents services de l’administration vénitienne: inutile d’affronter les coûts de la guerre, car, même si Venise en sort victorieuse, la guerre ne modifiera en rien une situation à elle seule extrêmement favorable, et elle engendrera en revanche des coûts supplémentaires, et destinés à s’accroître, de gestion et de défense.
Menacée par la concurrence dans sa prééminence commerciale, qu’elle avait défendue en y engageant toutes ses ressources dans ses guerres contre Gênes, Venise a su aussi se doter des activités manufactu-rières capables de soutenir ses échanges. Elle s’était longtemps conten-tée de l’Arsenal (de plus en plus réservé à la construction, à l’entretien et au stockage des galères de sa flotte de guerre, la seconde en importance après celle de l’Empire ottoman au milieu du xvie siècle) et des chantiers privés de construction navale, dont les derniers squeri de construction de gondoles, comme celui de San Trovaso représentent le dernier témoi-gnage. Elle avait même fait de l’Arsenal un quartier clos de murs, im-mense à l’échelle de l’époque, et en fait la plus grande entreprise indus-trielle de la Méditerranée avec, à partir xvie siècle, celui d’Istanbul qui y ajoutait les fonctions de bagne: une curiosité que l’on fait visiter au futur Henri III, passant par Venise pour aller occuper le trône de Pologne, et auquel on montre la première chaîne de montage de l’histoire – une coque de galère progressivement équipée de ses mats, de ses voiles, de ses rames en parcourant, d’un atelier à l’autre, les canaux de l’Arsenal.
MAUrIcE AyMArd�
Et un modèle encore à la fin du xviie siècle, que visite avec attention le frère de colbert, colbert de croissyn, et qui servira de référence pour les arsenaux dont la monarchie française décide alors de se doter sur toute la façade atlantique du royaume, de rochefort, avec sa grande corderie calquée sur l’exemple de la Tana, jusqu’à cherbourg.
A ce secteur traditionnel, situé au centre de circuits importants pour l’approvisionnement en matières premières, et capable d’attirer et de fixer aussi bien les constructeurs grecs de navires et surtout de galè-res que des artisans spécialisés jouissant du statut privilégié d’ouvriers de l’Arsenal, et une population flottante de travailleurs moins qualifiés, Venise ajoute à partir de la seconde moitié du xve siècle, d’autres pro-ductions plus diversifiées. Elle mise alors aussi bien sur des secteurs traditionnels, comme les draps de laine destinés à l’Empire ottoman, ou de luxe, comme la soie, que sur des technologies nouvelles, comme l’imprimerie et le verre, pour lesquelles elle va occuper longtemps une position centrale en Europe. Pour ces dernières elle joue aussi bien sur des productions de haut prix, destinées à une clientèle privilégiée, que sur toute une gamme de produits infiniment moins chers et susceptibles d’atteindre un très large public: ainsi les livres populaires, dont l’éditeur remondini, né à Bassano mais établi à Venise, s’impose, au milieu du xviiie siècle, comme le premier producteur et distributeur d’Europe1, ou les perles de verre, fabriquées par caisses entières à Venise même, et non à Murano, et qui seront aussi, au xviiie siècle, l’un des grands arti-cles servant à tous les marchands européens engagés dans ces voyages triangulaires, de monnaie d’échange pour les achats d’esclaves sur les côtes africaines – trafic auquel Venise ne participe pas directement.
Le patrimoine que représente aujourd’hui Venise, et dont la partie la plus ancienne date précisément des derniers siècles du Moyen Âge, mais qui n’a pas cessé de s’enrichir entre xvie et xviiie siècle, est d’abord le résultat direct de cette première accumulation exceptionnelle de ri-chesses d’origine commerciale, dont un pourcentage impossible à chif-frer a été investi dans la construction même de la ville: stabilisation des îles sur lesquelles est bâtie Venise, drainage de ses canaux et de la lagune elle-même, aménagement du port, travaux énormes comme les
1 de Lalande signale en 1769 que cette entreprise emploie un millier d’ouvriers, 1500 cor-respondants en Italie et une cinquantaine en Europe, et qu’elle possède sa propre fabrique de papier, ce qui lui permet d’imprimer en masse des ouvrages peu coûteux qu’un réseau de 2000 vendeurs ambulants provenant tous de la vallée du Tessin écoule ensuite dans toute l’Europe, de la péninsule ibérique, d’où ils gagnent l’Amérique, à la Hollande, à la Pologne et à la russie, en passant par la péninsule italienne, J.-J. de LaLande, Voyage en Italie, Genève 1790.
L’EUrOPE, VENISE ET LA MédITErrANéE 9
digues de Malamocco au xviiie siècle, rues et places, pont du rialto, édifices religieux et civils, palais des riches familles, maisons des simples citadins. A quoi s’ajoute le financement des innombrables œuvres d’art (sculptures, peintures, tapisseries et tentures, meubles, etc.) qui font des églises et des palais autant de musées, ainsi que celui des fêtes et des ac-tivités de loisirs, comme le théâtre. Aux ressources retirées des activités marchandes et financières sont, il est vrai, venues rapidement s’ajouter les revenus des propriétés foncières acquises en Terre ferme par les ri-ches Vénitiens dès avant la conquête de celle-ci, mais à une plus grande échelle encore après: sur ces terres d’importants et coûteux travaux de bonification (irrigation et drainage) promus et programmés par le Sénat et l’administration de Venise, mais pris en charge par les propriétaires, ont permis d’intensifier l’agriculture, et les plus riches d’entre ces der-niers y ont affirmé leur présence et leur pouvoir en y construisant les villas qui font elles aussi partie, pour nous, du patrimoine de Venise, tout comme s’y rattachent également nombre des transformations et des constructions réalisées dans les villes de la Terre ferme à l’initiative des élites dirigeantes locales, encouragées en ce sens par le provéditeur vé-nitien. Le lion de Saint-Marc tend à imposer partout sa marque, comme une signature apposée sur les monuments. N’y voyons pas pour autant une pétrification de la richesse accumulée qui aurait détourné les Véni-tiens d’activités plus productives: Marx avait déjà noté qu’au xviie siècle ceux-ci avaient commencé à investir leurs capitaux à Amsterdam, où les rendements leur apparaissaient plus rémunérateurs dans l’immédiat et plus prometteurs pour l’avenir. Au xviiie siècle encore, Venise regorge de capitaux disponibles, au point de s’imposer comme l’une des capi-tales européennes du luxe: entendons de la dépense ostentatoire. Mais elle a laissé à Gênes le rôle de place financière où se négocient une part importante des emprunts d’état européens: Gênes y perdra, avec les victoires de Bonaparte, l’essentiel des sommes qu’elle avait engagées dans ce secteur. En choisissant les loisirs et le plaisir de vivre, Venise aurait-elle fait, sans le savoir, un meilleur choix?
Le patrimoine artistique et culturel vénitien c’est donc la ville et sa terre ferme où monuments urbains et villas rurales témoignent de la concurrence et des compromis lentement élaborés et acceptés entre le patriciat de la dominante et ses homologues des villes sujettes, attentives à défendre leur quant à soi. Mais c’est aussi toutes les petites cités de la côte dalmate, de Zadar et Split jusqu’à Kotor, c’est corfou, Leucade (Santa Maura), Zante et céphalonie, c’est la canée et une part de la crète, c’est coron, Modon et Nauplie dans le Péloponnèse, partout où Venise a imposé sa marque architecturale et urbaine durable, et où le visiteur ne
MAUrIcE AyMArd10
se sent jamais totalement dépaysé. c’est encore, au cœur de la mer Egée, une petite île comme Tinos, dernière possession conservée par Venise au milieu de l’Archipel, perdue seulement en 1715 et longtemps parta-gée entre catholiques et orthodoxes. c’est enfin la vieille ville et les mu-railles de Famagouste, avec sa tour Othello. Même raguse-dubrovnik, pourtant attachée à son indépendance, n’a pas échappé au modèle de cet encombrant voisin qui avait décidé une fois pour toutes que l’Adriatique était son Golfe, à elle et à elle seule. Ailleurs, comme à Istanbul ou à la Tana, en crimée, les traces de la présence vénitienne ont été en parties re-couvertes par celles des dominations qui ont suivi son élimination. Mais leur souvenir persiste dans les mémoires et dans les traditions.
Mais Venise ne serait pas Venise sans l’attraction qu’elle a exercée sur des populations venues de toute la Méditerranée: esclavons, dal-mates et crétois, arméniens et grecs, turcs qui y ont obtenu de créer leur propre Fontego, moins prestigieux mais aussi significatif que ce-lui des Allemands (le Fontego dei Tedeschi, auprès du pont du rialto, aujourd’hui occupé par la Poste centrale, signe et symbole de la liaison étroite qu’assurait Venise entre commerce maritime et commerce ter-restre), Flamands, Juifs chassés de presque toute la péninsule italien-ne mais protégés à Venise dans le cadre de leur Ghetto – formule de quartier communautaire fermé qui sera imitée par plusieurs villes de terre ferme, et dont donatella calabi a démontré qu’elle n’avait pas eu à l’époque la signification négative que nous accordons aujourd’hui à ce terme. ces présences multiples, dont les Médicis s’inspireront lors de la refondation de Livourne dans la seconde moitié du xvie siècle, mais pour en faire une Livourne «auprès de la Toscane», comme l’avait été l’Alexandrie «ad Aegyptum» de l’Antiquité, constituent l’une des dimensions les plus originales de la ville. Observant Venise avec son re-gard d’historien de l’Asie du Sud-Est, denys Lombard m’avait invité à y voir l’exemple le plus occidental d’un modèle d’organisation politique et économique que les sultanats portuaires musulmans avaient généra-lisé le long des côtes de l’Océan indien, avec leurs minorités marchan-des ethniques et religieuses regroupées sous la protection d’un sultan qui participait lui-même au commerce. Nous étions à Malacca, où il m’avait fait visiter, presque côte à côte, la mosquée construite par des ar-chitectes chinois avec son minaret et sa salle de prières coiffés d’un toit en pagode, un temple chinois juxtaposant Tao, confucius et Bouddha, et un temple indien, tous les trois réunis dans la ville basse, alors que la cathédrale portugaise puis hollandaise occupait la citadelle, et avait conservé, au milieu de sa nef, deux magnifiques pierres tombales de riches marchands arméniens morts au milieu du xviie siècle.
L’EUrOPE, VENISE ET LA MédITErrANéE 11
Mais Venise, c’est enfin pour nous à la fois les visiteurs européens du Grand Tour, qui en ont fait une étape obligée de leur périple, et les pein-tres qui, comme Guardi et canaletto en ont popularisé l’image et l’ont diffusée dans toute l’Europe, avec une mention spéciale pour le neveu de ce dernier, Bernardo Bellotto, qui a choisi de peindre Vienne, dresde et Varsovie, et dont les toiles ont servi à reconstruire, après 19�5, la place du Marché de cette ville. Lui aussi a bien mérité du patrimoine européen. Tout comme en ont bien mérité Lorenzo da Ponte, librettiste à l’Opéra de Vienne, et mort à New york, ou Goldoni, appelé à Ver-sailles en 1761, et mort à Paris en 1793, sans y avoir, à son grand regret, rencontré le succès qu’il espérait. Grâce à eux, Venise garde pour nous la fascination de la vie et de sa puissance de création. Exception? Sans doute. Mais il est des exceptions qui ont la vie dure, et résistent à l’usure du temps: Venise est de celles-là. Elle a contribué à créer à la fois l’Eu-rope où nous vivons, et la Méditerranée dont nous nous réclamons: un monde de l’échange et de la circulation des marchandises, des hommes, des idées et des biens culturels, que nous ne nous résignons pas à voir fragmenté par des frontières infranchissables.
L’un des signes de cette exceptionnalité, c’est que nous parlons tou-jours de Venise comme d’une personne. Sans doute a-t-elle eu, comme tous ses rivaux et concurrents, ses responsables politiques et militaires, ses diplomates et ses hommes d’église, ses banquiers et hommes d’affai-res, ses artistes et ses intellectuels. Et elle a su en mobiliser les services et les compétences. Mais le jeu de ses institutions lui a permis de rester la Sérénissime, en contraignant tous ces grands personnages de son histoi-re à mettre leurs compétences au service d’une action collective. L’unité et la cohésion de sa classe dirigeante, et son adhésion à une tradition exaltée au rang du mythe, distinguent Venise, qui ne peut sur ce plan être comparée qu’à Gênes, de ses rivales d’Italie du centre nord, comme Milan ou Florence, qui ont suivi la route conduisant à l’établissement d’un pouvoir personnel et héréditaire. Elles ont fondé l’identité durable de la ville, appropriée, intériorisée, vécue et transmise à tous les niveaux de la société, des cittadini aux travailleurs de la dalmatie et de la Terre ferme venus s’employer dans la construction navale, et à tous les immi-grés de tous les niveaux sociaux venus des quatre coins de l’Europe et de la Méditerranée. Et cette identité a résisté, dans les esprits, dans les mémoires et dans les façons de vivre, à la fin de la république voulue et imposée par Bonaparte – un corse, donc, à sa façon, un Génois.