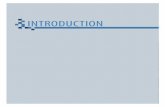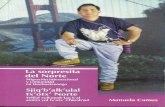C. Hugues._Le Gard à travers l'Histoire : Préhistoire et Protohistoire. 1973 2eme éd
Terral J.-F., Newton C., Durand A., Bouby L. et Ivorra S., 2012 La domestication de l’olivier en...
-
Upload
univ-lemans -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Terral J.-F., Newton C., Durand A., Bouby L. et Ivorra S., 2012 La domestication de l’olivier en...
La domestication de l’olivier en Méditerranée
nord-occidentale révélée par l’archéobiologie
Jean-Frédéric Terral, Claire Newton,
Aline Durand, Laurent Bouby et Sarah Ivorra
La domestication de l’olivier en Méditerranée nord-occidentale
Exempla
ire au
teur
Histoire de l’olivier
74
La domestication de l’olivier a eu lieu indépendamment, en de nombreuses régions et non exclusivement depuis un unique
foyer proche-oriental. Il apparaît tout de même que les origines de sa culture et de sa domestication sont bien antérieures à l’Antiquité. Elles émergent cinq millénaires avant notre ère, avec de nouvelles variétés, des savoirs et des techniques provenant de nombreuses contrées de la Méditerranée. Les approches éco-anatomiques sur bois et morphométriques sur les noyaux d’olive reconsidèrent l’« histoire dogmatique » de l’olivier selon laquelle les civilisations antiques introduisirent l’olivier en Méditerranée occidentale. Les résultats ne remettent toutefois pas en cause l’importance de l’influence des Phéniciens, des Étrusques, des Grecs et des Romains sur le rayonne-ment de l’olivier, à travers les âges et le Bassin méditerranéen, et par ailleurs, ils sont en accord avec les données de la biologie moléculaire.
Principales voies de
diffusion de l’oléiculture en
Méditerranée datées d’après
les sources archéologiques
(AEC : avant l'ère commune).
Ci-dessus :
Mise à fruit. Ribes, Ardèche.
© Thierry Ruf
À droite :
Oliveraie et mazets.
Saint Jean-de-la-Blaquière,
Hérault. © Catherine Breton
Photo page précédente :
À Sousse, en Tunisie, ruines
et olivier. © Catherine Breton
Exempla
ire au
teur
La domestication de l’olivier en Méditerranée nord-occidentale
75
Une histoire et des scénarios amplement débattus
L’histoire de l’olivier, en particulier des origines (géographique et
chronologique) de sa culture, de sa domestication et de sa diffusion
en Méditerranée a toujours été un sujet sensible et controversé.
La « thèse classique » de la domestication de l’olivier
La « thèse classique » de la domestication de l’olivier situe en
Palestine du Chalcolithique (période de la protohistoire appelée
aussi, mais de manière trop restrictive, « âge du Cuivre »), au qua-
trième millénaire avant l’ère chrétienne ou l’ère commune (AEC), le
passage de l’olivier sauvage à l’olivier cultivé (Zohary et Spiegel-Roy,
1975). La mise en évidence de restes d’oliviers (bois carbonisés et
noyaux d’olive) dans une région où l’arbre n’était pas indigène per-
mettait indirectement de dater les origines de sa mise en culture.
Depuis le Proche-Orient, une lente diffusion de formes domesti-
quées, de savoirs et de pratiques s’ensuit, d’abord vers l’Égée au troi-
sième millénaire AEC puis vers la Méditerranée centrale et occiden-
tale. Sa présence est attestée à l’âge du Bronze final vers 1200-1000
AEC, en Italie et en Espagne, et finalement au cours du premier mil-
lénaire AEC dans le sud de la France. L’introduction de l’olivier est
datée par la palynologie (étude du pollen) entre le IIIe et le IIe siècle
AEC en Provence et entre le Ie siècle AEC et le IIe sièclede l’ère com-
mune (EC) en Languedoc en raison de l’augmentation significa-
tive de la fréquence en pollen fossile d’Olea par rapport aux autres
espèces forestières. L’extension depuis le foyer proche-oriental de
domestication est favorisée par les mouvements de navigation,
d’échanges et de migration qui caractérisent les civilisations proto-
historiques et antiques, notamment des Phéniciens, des Étrusques,
des Grecs et des Romains.
La controverse
Les données paléoécologiques attestent que l’olivier est bien indi-
gène à l’ouest de la Méditerranée (Terral, 1996 ; Terral et al., 2009),
mais l’arbre emblématique reste pour nombre de spécialistes,
inféodé aux cultures antiques. Depuis des décennies et jusqu’à
aujourd’hui, il est en effet répété que les populations autoch-
tones ne connaissaient pas l’olivier avant son introduction en
Méditerranée nord-occidentale lors de la création de comptoirs
commerciaux ou la fondation de colonies. Cette histoire est large-
ment répandue dans les publications.
Exempla
ire au
teur
Histoire de l’olivier
76
L’hypothèse d’une domestication autochtone et de l’existence de foyers indépendants, et l’émergence de l’exploitation de l’olivier dès le NéolithiqueCompte tenu de l’indigénat de l’olivier en Méditerranée occidentale, la mise au jour de charbons de bois et de noyaux d’olives lors de fouilles archéologiques à des périodes bien antérieures à l’introduc-tion de l’oléiculture, l’hypothèse d’une protoculture et d’une exploi-tation de l’olivier antérieure à l’Antiquité fut posée (Terral, 1996).
Cependant, il était impossible de tester et de valider cette hypo-thèse car on ne disposait pas des méthodes permettant de distinguer l’olivier sauvage (ou oléastre) de l’olivier cultivé. Jusqu’à la fin du xxe siècle, les recherches archéobotaniques étaient isolées par zone géographique, par période chronologique ou encore sans référen-tiel actuel, et ne pouvaient donc pas embrasser la complexité des déterminismes abiotiques ou biotiques impliqués dans la variabi-
Les données paléobotaniques
Les archéobotanistes et les paléoécologues ont reconstitué les fluc-
tuations géographiques des végétations passées avant et après
les glaciations, notamment d’après les données obtenues sur des
charbons de bois (discipline appelée anthracologie) conservés dans
quelques sites. Les sites de localisation de quelques-unes des popu-
lations ancestrales (Péninsule ibérique et Proche-Orient) coïncident
avec des sites archéologiques qui ont été datés, ce qui conforte l’hy-
pothèse de deux grandes zones refuges pour l’oléastre. Pour cer-
taines populations, il n’y a, en l’état actuel des recherches, pas de
coïncidence avec un site archéologique ou un gisement paléobota-
nique, par exemple en Provence ou en Corse.
L’oléastre était donc présent à l’est et à l’ouest du Bassin méditerra-
néen bien avant les glaciations. Lorsque le réchauffement s’est mani-
festé, les fruits des différentes populations d’oléastres de chaque
zone refuge ont été dispersés essentiellement par les oiseaux. Les
espaces entre populations (formation ou renforcement de corridors
écologiques) ont donc été colonisés. Les données paléobotaniques
montrent que l’oléastre s’est propagé le long des zones côtières tout
autour de la Méditerranée dès 8 000 AEC.
Exempla
ire au
teur
La domestication de l’olivier en Méditerranée nord-occidentale
77
lité morphologique ou anatomique des vestiges étudiés. Grâce aux progrès de l’analyse d’image, l’éco-anatomie et la morphométrie permettent non seulement une étude conjointe et comparative de matériels actuel et archéologique mais également l’observation à un niveau de résolution inégalé (voir pour revue Marguerie et al., 2010).
Procédure simplifiée de
l’analyse éco-anatomique
de bois carbonisés d’olivier
(Terral, 1996 ; Marguerie
et al., 2010).
Pour qu’ils soient comparables
à des charbons de bois
archéologiques, les échantillons
prélevés sont séchés puis
carbonisés à 450 °C en conditions
réductrices jusqu’à réduction
de taille et enrichissement
maximal en carbone.
Des caractères anatomiques
préservés à la carbonisation
sont mesurés en section
transversale des charbons
de bois à l’aide d’un système
d’analyse d’image.
Notions d’éco-anatomie
La croissance et le développement du bois, tissu de soutien et de
conduction, sont influencés par tous les événements, intrinsèques
et extrinsèques, qui interviennent dans la vie des végétaux ligneux.
Le climat et les activités humaines sont des facteurs dont l’incidence
sur le fonctionnement cambial et donc sur la structuration du bois,
sont majeurs.
L’analyse fine de la structure anatomique du bois, consistant en la
mesure des éléments vasculaires du bois et de leurs variations, à
l’échelle du cerne (dendrochronologie) ou à un niveau de résolution
intra- et interannuel (éco-anatomie quantitative), permet de révéler
les contraintes au développement
Exempla
ire au
teur
Histoire de l’olivier
78
Résultat de plusieurs missions scientifiques, une collection de réfé-rence comprenant des centaines d’échantillons d’arbres de régions différentes poussant sous diverses conditions écologiques a été éta-blie au Centre de Bio-Archéologie et d’Écologie (Montpellier). Dans cet ensemble, à l’aide des analyses d’éco-anatomie quantitative on a pu différencier l’oléastre de l’olivier cultivé. Les individus sauvages possèdent des cernes de croissances étroits, les individus cultivés des cernes plus larges, en réponse à des conditions de croissance plus propices, et un nombre de vaisseaux par groupe significative-ment plus faible. Cette caractéristique anatomique a été interpré-tée comme une réponse aux conditions écologiques de croissance : produire des vaisseaux groupés en files radiales confère à l’arbre une sécurité de conduction élevée. En effet, les conditions estivales du milieu méditerranéen caractérisées par un déficit hydrique impor-tant peuvent induire la pénétration de fines bulles d’air obstruant le réseau conducteur de sève pouvant mener à la mort de l’arbre ou de la partie innervée (phénomène de cavitation appelée aussi embolie gazeuse) ; or les vaisseaux connectés radialement assurent des relais en cas de d’embolie : si un vaisseau se bouche, la sève sera réorientée vers les vaisseaux contigus. Ainsi, le bois des individus cultivés, en réponse à des conditions de croissance facilitées, privilégie l’efficacité plutôt que la sécurité de conduction de la sève. C’est pour cela qu’en
De plus, l’arbre est soumis à un ensemble de forces (poids des
branches, vent par exemple) qui détermine son état de contrainte
mécanique. Si ces forces sont intenses, il réagit en produisant un
bois que l’on qualifie de bois de réaction. Les cellules du bois formées
chaque année prennent leur structure définitive et subissent la matu-
ration cellulaire ou phase de lignification. Au cours de cette phase de
maturation, les cellules ont tendance à se déformer. Ces déforma-
tions sont appelées déformations de maturation. Ces phénomènes
sont observés dans le bois émis par le tronc, mais surtout dans le bois
des branches qui ont une direction de croissance oblique ou hori-
zontale. C’est à partir de ces déformations que peut être tentée la dis-
crimination des bois entre ceux provenant de branches jeunes (bois
immature), de branches charpentières ou de troncs (bois mature). Sur
des échantillons archéologiques, des pratiques telles que la taille et
l’émondage peuvent alors être mises en évidence.
Exempla
ire au
teur
La domestication de l’olivier en Méditerranée nord-occidentale
79
moyenne, les bois des oliviers cultivés possèdent moins de vaisseaux accolés que le bois des oléastres.
L’existence d’une exploitation différentielle de l’olivier au cours du temps et de l’émergence de sa culture au Néolithique a été révélée grâce à la connaissance des variations anatomiques du bois d’oliviers modernes et à l’analyse comparée de matériel archéologique de dif-férentes périodes (Terral, 1996).
Dans certaines régions de Méditerranée occidentale (en Espagne, au Portugal et en France), la sédentarisation et l’acquisition de l’agri-culture coïncident parfaitement avec le déclin des formations végé-tales mises en place au début de l’Holocène, dominées par les chênes caducifoliés et sempervirents et corrélativement avec l’extension de l’olivier. Ainsi, l’ouverture de la forêt à des fins agricoles aurait-elle induit une compétition entre les végétaux de recolonisation (essen-tiellement des espèces fruitières) et les plantes cultivées jusqu’à l’intégration au sein du système agricole de certains ligneux dont l’olivier.
Ce processus, initié dès le Néolithique (environ 6000 AEC) et présidant aux destinées de l’olivier, se subdivise en deux phases. La première correspond à la période du Néolithique au Chalcolithique. Elle est marquée par une exploitation intensive de l’olivier pour son bois très probablement utilisé comme combustible. D’un point de
Modèle éco-anatomique
de référence établi sur des
échantillons actuels révélant
la discrimination des oliviers
en fonction de leur statut
sauvage ou cultivé.
Cette représentation
schématique des deux
premiers axes d’une analyse
discriminante montre que les
critères « largeur de cernes »
et « nombre de vaisseaux
par groupe » permettent de
discriminer les deux groupes
d’olivier avec un taux supérieur
à 95 % et fournit un référentiel
permettant d’identifier
le statut des charbons de bois
archéologiques d’olivier.
Exempla
ire au
teur
Histoire de l’olivier
80
vue paléo-écologique, cette phase correspond à l’expansion de for-mations végétales méditerranéennes à olivier les plus adaptées à un climat chaud. La seconde phase, couvrant le Chalcolithique et l’âge du Bronze, période durant laquelle les végétations à olivier sont bien installées, semble caractérisée par un changement de mode d’ex-ploitation de l’olivier (Terral et al., 2009). L’exploitation de l’arbre devient raisonnée, assimilable à une pratique de taille. Cette gestion maîtrisée aurait pu contribuer au maintien d’arbres cultivés à matu-rité sexuelle, producteurs de fruits.
Finalement, l’augmentation de la fréquence en pollen d’Olea, considérée auparavant comme une preuve formelle de l’origine de sa culture, témoignerait plutôt de nouvelles pratiques agricoles intro-duites par les peuples antiques. Les données palynologiques date-raient la mise en place d’oliveraies, c’est-à-dire l’avènement d’une oléiculture intensive.
En Méditerranée nord-occidentale, l’olivier est domestiqué 2 000 ans avant l’intervention des sociétés antiquesMalgré les problèmes de conservation des restes végétaux en contexte archéologique (décomposition, fragmentation ou défor-mation des échantillons), de nombreux noyaux d’olive carbonisés en parfait état ont été mis au jour lors de fouilles archéologiques de sites divers (Espagne, Italie, France).
Noyaux archéologiques
antiques datés de 275-350 EC
(Puits du site de la Roquette,
Cavillargues, Gard).
© J.-D. Strich
(UMR CEPAM, CNRS)
Procédure de l’analyse
morphométrique géométrique
(étude de la forme)
du contour de noyaux d’olive.
Exempla
ire au
teur
La domestication de l’olivier en Méditerranée nord-occidentale
81
Aucun argument scientifique ne permettait d’affirmer s’ils pro-venaient d’oliviers sauvages ou de formes domestiquées. Dans le but de répondre à une telle interrogation, une approche morphologique à haute résolution a été engagée.
Étude des noyaux. Les analyses morphométriques de plus de 3 000 noyaux d’olives de populations sauvages, de variétés cultivées d’origines diverses et de noyaux issus de plusieurs sites archéolo-
Méthodologie
La distinction des individus sauvages et des individus cultivés d’une
même espèce est souvent impossible par simple observation ou par
la mesure de ses dimensions. S’il est vrai que les mensurations des
fruits et des graines varient en fonction du statut sauvage ou cultivé
et de la position taxonomique de la plante (sous-espèce ou variété
botanique), la dimension des graines est tributaire de paramètres
écologiques, anthropiques, pathologiques et liés au développement.
Ces facteurs que l’on peut tester sur du matériel vivant ne sont pas
toujours contrôlables sur le matériel archéologique. La distinction
des formes sauvages et des formes domestiquées exige donc des
méthodes appropriées et performantes que fournit la morphométrie
géométrique. Un des intérêts majeurs de ces méthodes réside dans
la possibilité de caractériser la géométrie (ou forme) d’une struc-
ture quelconque, en nous affranchissant ou non de ses dimensions.
L’analyse de cette composante morphologique, indépendamment
des mensurations, permet ainsi un contrôle optimal des facteurs liés
au développement et des paramètres environnementaux de varia-
bilité morphologique.
La variabilité d’un caractère peut être expliquée par trois compo-
santes essentielles : génétique, environnementale et ontogénétique.
La composante ontogénétique est elle-même dépendante des deux
premières, elle correspond à la croissance et au développement. À
l’aide de tels critères géométriques et, à condition que l’indépen-
dance entre la forme, l’environnement et le développement soit
démontrée, la comparaison de plusieurs individus en terme de dis-
tance morphologique (appelée aussi divergence morphologique ou
déviation phénotypique) revient approximativement à étudier les
relations de parenté entre ces individus. Cette analyse abordant donc
le déterminisme génétique de la variabilité de caractères potentiel-
lement héritables est néanmoins à nuancer, car elle est traduite par
l’expression de systèmes de gènes qui est souvent inconnue.
Exempla
ire au
teur
Histoire de l’olivier
82
giques (Espagne, Italie, France) apportent des résultats importants aux différentes échelles taxinomique, géographique et chronolo-gique (Terral, 1996 ; Terral et al., 2009).
Les oléastres se distinguent des cultivars par des critères mor-phométriques fondés sur la structure géométrique des noyaux avec un taux de discrimination supérieur à 90 %. Depuis les origines de la domestication, les pressions de sélection furent telles qu’elles ont grandement affecté la structure morphologique du noyau. Originellement, le noyau est plutôt de petite taille (< 1 cm), ce qui est un critère non exclusif, et surtout relativement global.
D’un point de vue géographique, les divergences morpholo-giques entre les populations sauvages (individus spontanés) occi-dentales (voir figure groupe 1) et orientales (voir figure groupe 2) témoignent d’une différenciation antagoniste, probablement liée à une ségrégation de leur distribution géographique en deux zones distinctes et donc, la rupture des flux géniques entre l’est et l’ouest. Fondée sur des facteurs climatiques, écologiques, historiques et socioculturels, le Bassin méditerranéen peut être divisé en une zone orientale et une zone occidentale de part et d’autre d’un axe reliant la mer Adriatique au désert libyque (Blondel et Aronson, 1995). Cette concordance entre la différenciation morphologique des oléastres mise en évidence et leur situation biogéographique apparaît com-parable aux résultats d’études entreprises sur le polymorphisme de l’ADN cytoplasmique à l’échelle de la Méditerranée ou régionales.
Les convergences et divergences de forme du noyau entre popu-lations sauvages et cultivars d’origines diverses témoignent de la complexité des échanges entre les populations humaines à l’origine de la diffusion de la culture de l’olivier dans le Bassin méditerranéen. Cependant, certains groupes morphologiques possèdent une unité géographique, comme les oliviers du groupe 3 (voir figure) (Terral, 1996).
Du fait de leur proximité morphologique par rapport au groupe constitué d’oléastres occidentaux et, de par leur divergence mor-phologique vis-à-vis des oléastres et des cultivars de Méditerranée orientale, il est donc très probable que les cultivars du groupe 3 (voir figure) dérivent d’un pool génétique occidental, indépendamment du pool oriental. La convergence morphologique de cultivars de l’est et de l’ouest semble quant à elle s’opposer à un modèle bio-géographique de ségrégation des populations sauvages entre l’est et
Exempla
ire au
teur
La domestication de l’olivier en Méditerranée nord-occidentale
83
l’ouest. Cette convergence résulterait donc des migrations humaines qui, au fil du temps, ont favorisé le croisement entre formes orien-tales et formes occidentales, modèle corroboré par les approches génétiques.
Les noyaux archéologiques de 21 sites archéologiques sont confrontés au modèle de différenciation morphologique (selon une procédure statistique multivariée comparative et décisionnelle). Leur affiliation au groupe phénotypique le plus convergent permet de dater les origines de la domestication de l’olivier et de retracer l’histoire biogéographique de la diversification variétale de l’olivier en Méditerranée nord-occidentale.
Les premiers échantillons appartenant à une forme domestiquée proviennent d’un site chalcolithique espagnol daté à 2300-2000 avant notre ère. Ils sont mis au jour sous la forme d’un morpho-type (groupe 3) composé de cultivars originaires de Méditerranée occidentale. En Espagne, du Chalcolithique à la période romaine, il semble que de nouveaux types morphologiques d’olivier domesti-qué apparaissent graduellement, en commençant par des formes très probablement affiliées d’abord au monde colonial phénicien puis à l’Empire romain.
Au regard des données acquises, l’âge du Bronze semble donc être une période clé dans l’histoire de l’olivier. La domestication a
Structuration de la diversité
morphologique de l’olivier
saisie à partir de l’analyse de
noyaux d’oliviers spontanés
(ou subspontanés)
et de variétés cultivées
d’origine diverses.
Les résultats mettent en lumière
une ségrégation « est - ouest »
des formes sauvages et la mise
en évidence en Méditerranée
nord-occidentale de formes
cultivées présentant
une affinité géométrique
à des formes occidentales, dès le
Chalcolithique et l’âge du Bronze.
Exempla
ire au
teur
Histoire de l’olivier
84
commencé avec la sélection de caractères remarquables, tel le calibre des fruits ou leur quantité d’huile, jusqu’à ce que des populations migrantes introduisent en Méditerranée occidentale de nouvelles variétés cultivées et des modes agricoles plus performants au milieu du dernier millénaire avant notre ère. La domestication aurait donc débuté bien plus tôt que ce qui a été admis jusqu’au début des années 2000 par les archéologues et historiens.
L’irrigation médiévale de l’olivier mise à jour par de l’éco-anatomie quantitativeLa mise au jour de charbons de bois d’olivier datés du Moyen Âge présentant des vaisseaux d’un diamètre très élevé suggérait, en réfé-rence au modèle éco-anatomique explicité précédemment, une dis-ponibilité élevée en eau dans le sol.
Comme aucune donnée textuelle ou paléoclimatique n’a été découverte sur la survenue au Moyen Âge central d’un épisode humide, l’hypothèse d’une intervention humaine fut posée.
La littérature agronomique médiévale est effectivement féconde sur les pratiques culturales héritées de la civilisation romaine et du monde arabo-musulman, la taille, la greffe et l’irrigation par exemple. L’irrigation, documentée indirectement au travers des actes de la pratique et des cartulaires médiévaux, est décrite de manière détail-lée dans les traités savants (Durand, 1998). Bien que les informa-tions transcrites soient très précises d’un point de vue technique et pratique, on ne sait pas si les paysans de l’époque ont appli-qué les recommandations agronomiques. Les conseils prodigués concernent l’ensemble des arbres fruitiers et des recommandations spécifiques à des arbres comme l’olivier sont exceptionnelles. Par exemple, P. de Crescent, agronome bolonais du xiiie siècle suggérait d’utiliser l’eau de pluie ou de citerne pour irriguer l’olivier plutôt que l’eau de rivière. Ibn Al’-Awwâm proposait d’arroser tardivement les oliviers récemment greffés. L’hypothèse de la présence historique d’une culture irriguée de l’olivier était donc à tester.
Le référentiel établi pour la recherche de critères quantitatifs de discrimination entre olivier sauvage et olivier cultivé a été amendé à l’aide d’échantillons modernes prélevés sur des individus sauvages poussant en condition ripicole et sur des individus cultivés irrigués exclusivement de manière traditionnelle, c’est-à-dire au moyen de techniques gravitaires. Le modèle obtenu après les analyses éco-ana-
Exempla
ire au
teur
La domestication de l’olivier en Méditerranée nord-occidentale
85
tomiques, les calculs de conductivité hydraulique et les traitements statistiques affiche un pouvoir de discrimination supérieur à 90 %. Il différencie, quel que soit le statut, sauvage ou cultivé, les oliviers poussant sous influence hydrique de ceux en conditions de séche-resse. Dans les zones semi-arides comme dans le sud de l’Espagne et en Afrique du Nord, les oléastres peuvent être rencontrés sur les rives de cours d’eau temporaires (oueds dans le Maghreb ou barran-cos dans la péninsule ibérique). Cette situation écologique atypique offre aux arbres un apport d’eau leur permettant, au printemps, de se développer dans des conditions optimales. L’été, les cours d’eau sont totalement asséchés et, la croissance des arbres est stoppée.
Les oliviers mis en culture croissent plus rapidement que leurs congénères sauvages. Même s’ils sont cultivés en sec, un espace-ment des individus et l’élimination des compétiteurs ou des amen-dements suffisent à expliquer des différences de cinétique de crois-sance. Néanmoins, les régions sèches et semi-arides dépendent de l’irrigation en vue de garantir une production agricole suffisante. Dans d’autres régions où les conditions climatiques sont moins dras-tiques, l’irrigation peut être tout de même employée dans le but d’augmenter la productivité, le rendement et la qualité des récoltes.
Modèle éco-anatomique
de référence établi sur des
échantillons actuels révélant
la discrimination des oliviers
en fonction de leur statut
sauvage ou cultivé
et de la disponibilité
en eau du milieu.
Il s’agit de la représentation
schématique des deux premiers
axes d’une analyse discriminante
(Durand et Terral, 2005-2006).Exempla
ire au
teur
Histoire de l’olivier
86
D’un point de vue biologique, une relation significative entre les caractéristiques anatomiques et la disponibilité de l’eau dans le milieu est mise en évidence, à la fois chez l’olivier sauvage et chez l’olivier cultivé. La conductivité hydraulique, liée directement au caractère de la surface des vaisseaux conducteurs du bois augmente fortement en réponse à un apport d’eau. Il semble donc qu’une sur-face de vaisseaux élevée et donc de conductivité hydraulique, peut être interprétée comme une réponse éco-physiologique de l’arbre à une meilleure disponibilité en eau. Ces changements correspondent donc à une grande efficacité de transport de sève.
La confrontation des résultats des mesures pratiquées sur les charbons médiévaux au modèle éco-anatomique de discrimina-tion vérifie notre hypothèse de départ, à savoir que l’irrigation était appliquée aux cultures d’olivier depuis la période carolingienne en Languedoc (Lunel-Viel), puis en Corse et en Catalogne espagnole à la fin de la période médiévale. En effet, la grande majorité des char-bons de bois archéologiques sont classés dans le groupe des spé-cimens cultivés (Durand et Terral, 2005-2006). Quelques indivi-dus toutefois appartiennent au groupe des oliviers sauvages, sans que l’on puisse dire si ces arbres sont réellement sauvages ou si ce sont des individus féraux ou issus d’un verger abandonné. Parmi le groupe des oliviers cultivés, hormis un nombre non négligeable de charbons de bois non identifiables possédant des caractéristiques anatomiques intermédiaires, la plupart sont affiliés au groupe des oliviers cultivés irrigués.
Pour la première fois, grâce aux analyses éco-anatomiques, l’exis-tence de la pratique de l’irrigation de l’olivier est attestée au Moyen Âge. Les résultats montrent qu’en Méditerranée nord-occiden-tale, cette pratique est courante, au moins dès le début ou après le xiie siècle. L’irrigation ne doit plus être considérée comme une pra-tique culturale mineure pour cet arbre. L’irrigation de l’olivier ne peut être considérée comme un palliatif ; elle participe sans aucun doute à accroître le rendement et la qualité de production. Ainsi, sous de telles conditions, la culture de l’olivier au Moyen Âge ne doit plus être considérée comme extensive aux marges des terroirs, mais comme une oléiculture maîtrisée et parfaitement ancrée dans la tradition de l’arboriculture médiévale.
Exempla
ire au
teur
La domestication de l’olivier en Méditerranée nord-occidentale
87
Pour en savoir plusBlondel J., Aronson J., 1995. Biodiversity and ecosystem function in the Mediterranean Basin : human and non-human determinants. In Mediterranean-type Ecosystems. The function of biodiversity, G. W. Davis and D. M. Richardson (ed.), p. 43-119. Berlin, Springer-Verlag.Durand A., 1998. Les paysages médiévaux du Languedoc (xe-xiie siècle). Toulouse, France, Presses universitaires du Mirail.Durand A., Terral J.-F., 2005-2006. Regarder autrement le charbon de bois archéologique : l’exemple de l’irrigation des plantations d’oliviers (ixe-xve siècle). Archéologie du Midi médiéval, 23-24 : 75-92.Marguerie, D., Bernard V., Bégin Y., Terral J.F., 2010. Anthracologie et dendrologie. In Payette S., Filion L. (eds.) Dendroécologie, concepts, méthodes et applications. Presses de Laval, Canada, p. 311-346.Terral J.F., 1996. La domestication de l’olivier (Olea europaea L.) en Méditerranée nord-occidentale : approches morphométriques et implications paléoclimatiques. Thèse de doctorat, Université Montpellier 2.Terral J.-F., Durand A., Newton C., Ivorra S., 2009. Archéo-biologie de la domestication de l’olivier en Méditerranée occidentale : de la remise en cause d’une histoire dogmatique à la révélation de son irrigation médiévale. In : Le retour de l’olivier, l’olivier de retour. Numéro spécial de la revue Études sur l’Hérault (éditée par le conseil général de l’Hérault), coordonné par P. Laurence et A. Rossel. p. 13-26.Zohary D., Spiegel-Roy P., 1975. Beginning of fruit growing in the Old Word, Science, 187: 319-327.
Jarres de stockage de l’huile
d’olive. Moulin du XVIIIe siècle,
chez Autrans à Nyons.
© Inra – Jean Weber
Exempla
ire au
teur