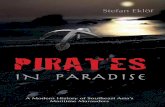Uppsats - DiVA Portal
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
10 -
download
0
Transcript of Uppsats - DiVA Portal
Uppsats Kandidatexamen Une analyse contrastive de l’adjectif dans la traduction suédoise de L’Amant de Marguerite Duras
Författare : Susanne Magnusson Handledare : Monika Stridfeldt Examinator : André Leblanc Ämne/huvudområde : Franska Kurskod : GFR27F Poäng: 15 hp Ventilerings-/examinationsdatum : 2020.12.17 Vid Högskolan Dalarna har du möjlighet att publicera ditt examensarbete i fulltext i DiVA. Publiceringen sker Open Access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Du ökar därmed spridningen och synligheten av ditt examensarbete.
Open Access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten Open Access.
Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, Open Access):
Ja ☒ Nej ☐
Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00
2
Résumé Notre étude se propose d’analyser les changements dans les adjectifs qui surviennent dans la
traduction suédoise de l'œuvre L'Amant de Duras (1984). Le français est un langage analytique
où de nombreuses constructions analytiques peuvent être découvertes. La langue suédoise a à
la fois des caractéristiques analytiques et synthétiques et, comme les deux langues ont des
structures différentes, il faut employer des stratégies et des méthodes pour obtenir une
équivalence aussi exacte que possible dans une traduction. L'étude aborde les regroupements
de composantes de sens (selon Ingo), des cas sémantiques spéciaux tels que l'action explicite et
implicite, la transposition, où un changement de classe de mot a lieu mais le sens demeure, ainsi
que les ajouts et omissions sémantiques. L'analyse de la traduction des adjectifs de L'Amant
montre qu'il y a un usage fréquent des transpositions et des regroupements synthétiques et
analytiques. Elle montre également que les lexèmes suédois ont généralement une grande
complexité sémantique où les adjectifs avec le suffixe -ig se distinguent comme un groupe. Les
lexèmes français en comparaison sont plus généraux et dépendent d'autres lexèmes pour
exprimer une signification exacte. Le cadre théorique est basé sur les recherches de Tegelberg,
qui sont présentées dans son livre Kontrastiv lexikologi i praktiken (2000) et d’Ingo, dans les
deux livres Från källspråk till målspråk (1991) et Konsten att översätta (2011).
Abstract Our study aims to analyze the changes in adjectives that occur in the Swedish translation of
L’Amant (the Lover) of Duras (1984). French is an analytical language where many analytical
constructs can be discovered. Elisabeth Tegelberg (2000) states that French lexemes (in this
study concerning adjectives) generally have a lower semantic complexity than Swedish lexemes
(Tegelberg, 2000 : 13). The Swedish language has both analytical and synthetic characteristics,
3
and since the two languages have different structures, strategies and methods are needed to
achieve as exact an equivalence as possible in a translation. The study addresses the regroupings
of components of meaning (Ingo, 1991 : 186-187), special semantic cases such as explicit and
implicit action, transposition where a change of word class takes place but the meaning remains,
and semantic additions and omissions. The examination of the translation of the text of Duras’
L'Amant shows that there is a frequent use of transpositions as well as synthetic and analytical
regroupings. It also shows that Swedish lexemes generally have a great semantic complexity
where the adjective group with the suffix -ig stands out as a group. French lexemes in
comparison are more general and depend on other lexemes to express an exact meaning. The
theoretical framework is based on the research of Tegelberg, which is presented in her book
Kontrastiv lexikologi i praktiken (2000) and by Ingo, in the two books Från källspråk till
målspråk (1991) and Konsten att översätta (2011).
Mots-clés : Études de traduction, lexicologie contrastive, complexité sémantique, adjectif,
transposition
4
Table des matières
1.Introduction ................................................................................................................................................. 5
1.1. Le point de départ ....................................................................................................................................... 5
1.2 But et problématique ................................................................................................................................... 7
1.3. Le plan de mémoire .................................................................................................................................... 7
2. Cadre théorique ......................................................................................................................................... 7
2.1. Complexité sémantique .............................................................................................................................. 8
2.2. Les paraphrases .......................................................................................................................................... 9
2.3. Équivalence sémantique ........................................................................................................................... 10
2.4. Quatre aspects de base de traduction ....................................................................................................... 10
2.5. Des cas particuliers sémantiques selon Ingo ........................................................................................... 12
2.6. Méthodes indirectes, traduction oblique de Vinay et Darbelnet. ............................................................ 13
3. Méthode et matériel ................................................................................................................................. 14
3.1. Méthode .................................................................................................................................................... 14
3.2. Le matériel, le roman et l’auteur ............................................................................................................. 17
4. Résultats et analyse ................................................................................................................................... 18
4.1. Regroupement synthétique ....................................................................................................................... 19
4.2. Regroupement analytique ........................................................................................................................ 24
4.3. Un seul lexème d’une complexité générale à un seul lexème d’une complexité sémantique élevée ..... 27
4.4. Un lexème d’une complexité sémantique élevée traduit par un lexème d’une complexité sémantique générale ou par plusieurs lexèmes d’une complexité sémantique générale .................................................. 31
4.5. Résumé du résultat et de l’analyse ........................................................................................................... 31
5. Discussion et conclusion ............................................................................................................................ 33
7. Annexes ..................................................................................................................................................... 38
7.1. Glossaire ................................................................................................................................................... 38
7.2. Exemples supplémentaires ....................................................................................................................... 40
5
1.Introduction 1.1. Le point de départ Des textes ont été traduits dès le 1 000 av. JC. Par exemple Cicéron a utilisé des traductions du
grec vers le latin pour améliorer ses capacités rhétoriques (Munday, 2008 : 19) et Saint
Hieronymus a discuté de la traduction de la Bible comme point de départ des avantages de la
traduction libre et littérale (Munday, 2008 : 19). Mais malgré le fait que la traduction ait été
pratiquée il y a plus de 2000 ans, la traduction en tant que champ de recherche est relativement
nouvelle. La science de la traduction, domaine interdisciplinaire où sont étudiées la traduction
et l'interprétation, est en constante évolution (Munday, 2008 :19). Newmark (1916-2011) est
considéré comme l'un des fondateurs en termes d'études de traduction. Il préconise deux
méthodes : La traduction communicative orientée vers la langue cible, c'est-à-dire centrée sur
le contenu d'une traduction, et la traduction sémantique où le texte cible doit être aussi proche
du texte source et donc de la voix de l'auteur que possible (Newmark, 1988 :49-50). Deux autres
linguistes importants qui ont été pionniers dans les études de traduction étaient Vinay et
Darbelnet (1958/1977). Ils se sont engagés dans la traduction stylistique et l’ouvrage Stylistique
comparée du français et de l'anglais (1958/1977) explique leur méthodologie pour identifier et
analyser les méthodes de traduction entre le français et l’anglais. En plus, cette œuvre s’est
également avérée très utile dans les études comparatives entre le français et les langues
germaniques (par exemple Edh, 2010, Hagström, 2002, Tidström, 1999) (Axelsson, 2011 : 1).
Les langues ont des constructions différentes et pour cela les traductions directes ne sont
souvent pas possibles. Tegelberg (2000) écrit :« si on exige un accord exact (une équivalence)
en termes de forme et de contenu lors de la traduction d'une langue à une autre, la traduction ne
devrait guère être possible » (Tegelberg, 2000 : 202) (notre traduction). Ingo (1991) souligne
conformémant à Tegelberg (2000) qu’ « une traduction n'est presque jamais un reflet à la fois
formel et sémantique du texte original » (Ingo,1991 : 19) (notre traduction) et estime qu'en
transférant le contenu sémantique du texte source au texte cible, la traduction est rendue
6
possible. Vinay et Darbelnet (1977), pour leur part, soulignent comme Newmark (1987)
l'importance de rester aussi proche que possible de la langue source (Vinay et Darbelnet, 1977 :
268).
Tegelberg (2000) cartographie et analyse les différences entre le français et le suédois et décrit
les stratégies à appliquer pour résoudre les problèmes de traduction. Tegelberg (2000) souligne
que le français est une langue analytique distincte où de nombreux lexèmes français sont moins
complexes, plus généraux qu’en suédois (Tegelberg, 2000 : 13). Étant donné que de nombreux
mots français ont peu de composants de signification, ils dépendent d'autres lexèmes pour avoir
une signification spécifique (Tegelberg, 2000 : 209), tandis que la langue suédoise, qui possède
de nombreuses propriétés d'une langue synthétique, a des lexèmes sémantiquement complexes
qui ne dépendent pas d'autres mots pour spécifier un sens. Ingo (1991, 2011), comme Tegelberg
(2000), a étudié la linguistique contrastive où les stratégies de traduction sont clarifiées ainsi
que les comptes rendus des problèmes que vous pouvez rencontrer en tant que traducteur. Ingo
explique qu'une traduction nécessite parfois des regroupements de deux ou plusieurs lexèmes
sémantiquement moins complexes vers un seul lexème plus complexe sémantiquement -
regroupement synthétique et vice versa - regroupement analytique (Ingo, 1991 : 186-187), un
processus auquel nous reviendrons. Le domaine de la lexicologie contrastive en pratique entre
le suédois et le français dont traitent Tegelberg (2000) et Ingo (1991) existe mais est
relativement inexploré (Axelsson, 2011 : 1) et il est donc intéressant de le prendre en compte.
Cette étude portera sur la traduction du roman de Marguerites Duras L’Amant (1984) traduit
par Madeleine Gustafsson (1985). L’analyse contrastive de l'adjectif est au centre de notre
mémoire. Från källspråk till målspråk (1991), Konsten att översätta (2011) de Rune Ingo et
Kontrastiv lexikologi i praktiken (2000) d’Elisabeth Tegelberg constitueront le cadre
méthodologique où l’étude est basée sur le processus de regroupement analytique et synthétique
(Ingo, 1991 :186-187) et la traduction d'adjectifs à faible complexité sémantique dans la langue
source en adjectifs à forte complexité sémantique dans la langue cible (Tegelberg, 2000 :197-
198). Egalement Analysmodell för översatta texter (Modèle d'analyse pour les textes traduits)
d’Yvonne Lindqvist sera utile, notamment le chapitre 4.2. sur l’analyse linguistique au niveau
lexical. L'étude est une étude qualitative (Denscombe, 2016 :383) et descriptive dans un projet
à petite échelle.
7
1.2 But et problématique Le but de l'étude est d'étudier et d'expliquer les changements qui se sont produits concernant
les adjectifs dans la traduction suédoise de L’Amant de Duras.
1 / Dans quelle mesure la traductrice utilise-t-elle le regroupement synthétique et analytique
dans sa traduction de L'Amant de Duras ?
2 / De quelle manière les composantes de signification du texte original sont-elles transférées
vers le texte cible lorsque la traduction directe n'est pas possible ?
1.3. Le plan de mémoire Pour répondre aux questions de recherche nous étudierons les lexèmes adjectifs sélectionnés
séparément et les regrouperons selon les stratégies d'Ingo (1991) et Tegelberg (2000). Les
exemples tirés du corpus rendent visible le changement du lexème adjectif entre les deux
langues. Après la présentation du but et de la problématique, nous continuerons avec les points
de départ théoriques. Viendra ensuite la partie portant sur la méthode choisie pour cette étude
et le matériel. Les résultats seront analysés par rapport aux recherches antérieures et la
discussion et la conclusion concluront notre étude.
2. Cadre théorique Pour étudier et expliquer les changements qui se produisent dans les adjectifs dans la traduction
de L'Amant par Gustafsson, nous utilisons l'analyse de Tegelberg (2000), qui met en avant des
différences linguistiques et des solutions stratégiques pour résoudre les problèmes de traduction
(Tegelberg, 2000 : 13). L'explication par Ingo (1991, 2011) des regroupements de composants
sémantiques, des problèmes de traduction où il part des quatre aspects de base : la structure
grammaticale, la variation linguistique, la sémantique et la pragmatique fera également partie
de notre cadre. En outre Ingo (1991, 2011) aborde l’ouvrage Stylistique comparée du français
8
et de l’anglais de Vinay et Darbelnet (1977) et leurs sept méthodes dont nous utiliserons les
quatre dernières qui appartiennent à la traduction indirecte. En plus de Tegelberg (2000), Ingo
(1991, 2011) et Vinay et Darbelnet (1977), Newmark (1987) fera partie du cadre de notre étude.
2.1. Complexité sémantique Comme nous l'avons indiqué précédemment, l'étude de Tegelberg (2000) montre que le lexème
français est généralement caractérisé par une complexité sémantique moins élevée que le
lexème suédois. En termes simples, un lexème avec une faible complexité sémantique a un
large spectre et peut être utilisé pour de nombreuses significations différentes. Par exemple le
lexème « oväsen » peut être utilisé pour plusieurs termes par rapport au mot « skrammel » qui
est un mot plus spécifique. « Skrammel » a donc une grande complexité sémantique. À travers
plusieurs comparaisons de dictionnaires et de traductions, Tegelberg (2000) déclare qu'un seul
lexème suédois avec une complexité sémantique élevée correspond souvent à plusieurs lexèmes
français ou à un lexème moins complexe (Tegelberg, 2000 : 13). Après un certain nombre de
comparaisons via des dictionnaires et des traductions, il s'est avéré qu'un lexème sémantique
complexe suédois correspond souvent à deux ou plusieurs lexèmes français sémantiquement
moins complexes (Tegelberg, 2000 : 14), alternativement comme nous l'avons mentionné
précédemment, à un seul lexème français sémantiquement plus général.
Ingo (1991) décrit, tout comme Tegelberg (2000), que les structures linguistiques diffèrent entre
les langues et qu’elles ont besoin d’un nombre différent de composants de signification pour
exprimer un sens. Dans une traduction, cela aboutit souvent à ce que l'on appelle des
regroupements (Ingo, 1991 : 186). Ingo décrit le processus comme un regroupement analytique
où la traduction a lieu d'un lexème sémantiquement complexe vers plusieurs lexèmes moins
sémantiquement significatifs, et un regroupement synthétique où la relation est le contraire - de
plusieurs lexèmes moins complexes sémantiquement à un seul lexème sémantiquement
complexe. Ce processus se produit lorsque les lexèmes des deux langues ont des extensions
différentes, ce qui est courant lorsque les langues source et cible ont respectivement des
propriétés analytiques et synthétiques (Ingo, 1991 : 187) :
Les abondantes possibilités de dérivation de mots du langage synthétique créent des dérivés
expressifs qui, lorsqu'ils sont traduits dans une langue plus analytique, doivent souvent être
reproduits avec des paraphrases à plusieurs mots. De plus, un langage synthétique préfère
généralement des solutions avec de longs mots composés qui, dans un langage analytique,
semblent très maladroits (Ingo 1991 : 187) (« notre traduction »).
9
Ingo (1991) décrit comment un texte traduit a généralement tendance à gonfler et qu'il est
important de créer un équilibre en compressant parfois le message, notamment pour le caractère
lexical de la langue cible (Ingo, 1991 : 187).
En suédois, nous trouvons un grand nombre d'adjectifs avec des suffixes et des préfix en le plus
grand groupe est constitué des adjectifs avec le suffixe -ig. Ils sont souvent très complexes sur
le plan sémantique et un seul lexème peut ainsi fournir un équivalent de plusieurs lexèmes
moins complexes en français. Bien sûr, il existe aussi des lexèmes spécifiques en français avec
une grande complexité sémantique, par exemple « terreux » (jordig), mais ceux-ci se retrouvent
dans une moindre mesure dans un texte littéraire (Tegelberg, 2000 : 193). Il existe deux types
du lexème avec le suffixe -ig. D'une part, ceux qui sont formés sur des adjectifs (par exemple
« barnslig » - formés sur le nom « barn ») et d'autre part ceux qui contiennent un adjectif
composé (par exemple « slutgiltig ») (Tegelberg, 2000 : 192).
2.2. Les paraphrases Les paraphrases dans les traductions sont débattues, car de nombreux chercheurs pensent que
l'utilisation de la paraphrase dans une traduction ne correspond pas stylistiquement au texte
original. La traduction a également tendance à être trop longue en raison de sa nature
explicative. Cela signifie que la traduction paraphrastique par nature devient souvent naïve
(Ingo 1991 : 69). Ingo (1991) et Newmark (1987) estiment que la traduction paraphrasée n'est
pas à recommander, mais qu'elle peut être en place dans certaines situations, par exemple
lorsque des termes difficiles à comprendre du texte source au texte cible doivent être expliqués
pour rendre un texte de traduction compréhensible. (Newmark, 1987 : 90), (Ingo 1991 : 69).
Ingo estime en outre que les paraphrases dans une traduction peuvent être le signe d'un manque
de professionnalisme et de négligence d'un traducteur.
On peut dire que les regroupements synthétiques et analytiques sont une sorte de paraphrase et
Tegelberg (2000) souligne que la reformulation en tant que stratégie n'est pas un dispositif
stylistique mais un moyen d'atteindre une conformité sémantique aussi élevée que possible
(Tegelberg, 2000 : 212). Dans le livre de Tegelberg (2000) la paraphrase signifie une stratégie
de traduction et Tegelberg souligne que dans ce cas ce n'est pas une variante stylistique. Cela
signifie qu'un lexème de langue source spécifique est traduit avec au moins deux lexèmes
généraux pour exprimer la signification du lexème de la langue source. Par exemple : « sörpla »
en suédois est un terme qui manque directement d'équivalence en français, et pour clarifier ce
10
mot une paraphrase peut être utilisée, par exemple : « boire en faisant du bruit » (Tegelberg,
2000 : 208). Lorsque nous utilisons le terme paraphrase dans notre étude, nous voulons clarifier
que la paraphrase est ici conçue comme une stratégie de traduction afin d'arriver à un accord
sémantique le plus proche possible de la langue source.
2.3. Équivalence sémantique Ingo (1991) souligne que la tâche du traducteur est de transférer les composantes sémantiques
du texte source au texte cible aussi précisément que possible (Ingo, 1991 : 186) mais il trouve
comme Tegelberg (2000) que la traduction d'une langue à une autre en formulant un texte
cohérent dans la langue cible pose souvent de nombreux problèmes car le traducteur doit
s'écarter des solutions du texte original. (Ingo, 1991 : 168). Pour que la traduction soit possible,
nous devons faire des exceptions à l'exigence selon laquelle la forme et le sens sont transférés
inchangés (Ingo, 1991 : 20).
Tegelberg (2000) estime que lorsqu'il s'agit de textes de fiction, il est important d'éviter les
phrases lourdes et les répétitions. Les exigences de variation affectent les choix et les solutions
que fait le traducteur (Tegelberg, 2000 : 208). Les différences structurelles entre les langues
existent à tous les niveaux - en particulier lexicalement et pour que la traduction soit
idiomatique, le traducteur doit prendre en compte ce phénomène et trouver une expression dans
la langue cible avec le contenu correspondant (Tegelberg, 2000 : 208). Être fidèle au texte
source dépend donc des choix que le traducteur fait à chaque occasion (Tegelberg, 2000 : 206).
2.4. Quatre aspects de base de traduction Ingo aborde les quatre aspects de base de la traduction : la structure grammaticale, la variété
linguistique, la sémantique et la pragmatique, qui sont les domaines de responsabilité d'un
traducteur dans son travail (Ingo, 1991 : 7 ; 2011 : 64).
Structure grammaticale : Les langues ont des conditions préalables de base différentes et le
traducteur utilise une structure de texte adaptée à la langue cible (Ingo, 1991 : 226). Le plus
simple dans l'analyse grammaticale est d'identifier les classes de mots et de découvrir ce qui
détermine quoi (Ingo, 1991 : 95). Les caractéristiques structurelles des langues de traduction
sont prises en compte, mais la traduction est formulée selon les termes des langues cibles (Ingo,
2011 : 65). Un autre aspect important à prendre en compte est les différences entre les langues
11
concernant la nature analytique ou synthétique du vocabulaire (morphologie). Le suédois
bénéficie, par exemple, d'adjectifs composés (Ingo, 2011 : 69), qui peuvent entraîner une
transposition, c'est-à-dire un changement de classe de mots sans changer le sens (Ingo, 2011 :
71).
Variétés linguistiques : Le choix des mots est un facteur important lorsqu'il s'agit de préserver
le style d'un texte (Ingo, 2011 : 82). Il est également important de voir un texte dans son
intégralité, le type de mot, la valeur stylistique du mot que l'auteur a utilisé. Les trois mots
suédois avec la signification « fille » (« mö », « flicka » « tjej ») sont souvent utilisé dans trois
environnements différents. Le mot plus ancien « mö » n'est pas utilisé souvent dans le langage
quotidien, « flicka » est un mot plus neutre, tandis que « tjej » est populaire et proche de l'argot
(Ingo, 2011 : 81).
Il est important d'analyser quel type de mot est utilisé dans le texte. En général, les textes
représentent un seul style, mais des styles de niveaux différents peuvent apparaître. (Ingo, 2011
: 81). Le choix des mots dans le texte cible doit correspondre au style du texte source (Ingo,
2011 : 82).
Sémantique : Les éléments porteurs de sens dans un texte sont avant tout des expressions
individuelles, des mots et des morphèmes. L’investigation par une analyse sémantique des
éléments porteurs de sens est importante dans une traduction pour pouvoir rechercher un
équivalent de traduction.
Le mot est généralement divisé en deux éléments de base - la dénotation (sens de base) et la
connotation (contenu de l'association). Un autre facteur à prendre en compte est le milieu de
vie et les expériences des personnes, qui peuvent créer différentes manières de lexicaliser pour
le même sens. Dans un environnement où le phénomène est inhabituel, le phénomène présente
un faible degré de lexicalisation, ce qui signifie que les mots des deux langues ne correspondent
pas sémantiquement (Ingo, 2011 : 88-89). L'équivalent d'un mot avec de nombreuses
significations est choisi au niveau du sémème, c'est-à-dire les parties de sens d'un lexème
polysémique. Afin de déterminer quels éléments de sens (nuances de sens) sont inclus dans la
signification du mot dans chaque cas individuel, le contexte joue un rôle majeur (Ingo, 2011 :
99).
Pragmatique : Aucune langue ne se ressemble, tout comme peu de sociétés et de cultures sont
pareilles. En tant que traducteur, il est important de se demander si le texte dans la langue cible
12
fonctionnera pour le destinataire. Un traducteur doit parfois adapter la traduction, par exemple
si les cultures décrites dans le texte sont très différentes, pour que le texte de la langue cible soit
compréhensible pour le destinataire (Ingo, 2011 : 127).
2.5. Des cas particuliers sémantiques selon Ingo Ingo (2011) décrit environ huit cas particuliers sémantiques dont notre étude prendre en compte
cinq.
Ajouts sémantiques : Ici des composants de sens significativement nouveaux sont ajoutés, qui
peuvent être justifiés pour créer un équilibre dans la langue cible. Les ajouts sont faits
principalement pour des raisons pragmatiques (Ingo, 2011 : 123), c'est-à-dire pour que le texte
remplisse son but et sa fonction dans le nouvel environnement linguistique et culturel (Ingo,
2011 : 126).
Pertes sémantiques : Pertes sémantiques signifie que les composants significatifs du texte
source sont omis. Il y a une perte d'information. Cela peut parfois être nécessaire pour des
raisons de rythme, pour des raisons pragmatiques (pareille comme dans le cas des ajouts
sémantiques), mais souvent ce phénomène se produit en raison de l'insouciance et la paresse du
traducteur (Ingo, 2011 : 124).
Action explicite : De nouveaux mots mais aucune émergence de nouvelles informations n'existe.
Le traducteur énonce ainsi explicitement ce qui dans le texte source peut être lu entre les lignes,
lu hors contexte. Une action explicite peut faciliter la compréhension des lecteurs de la langue
cible (Ingo, 2011 : 123).
Action implicite : Il s’agit du contraire du faire explicite. Les mots et expressions sont omis,
mais le contenu sémantique peut être lu entre les lignes, compris par le contexte (Ingo, 2011 :
124).
Dénotation et connotation : Ces deux aspects sont importants à prendre en compte lors de la
traduction des mots (Ingo, 2011 : 125). Beaucoup de mots sont chargés émotionnellement, ils
évoquent des réactions émotionnelles positives ou négatives. Un même référent peut avoir
plusieurs équivalents de mots, dont certains sont neutres et d'autres fortement chargés
13
émotionnellement (Ingo, 2011 : 109). Par exemple : « Barn utom äktenskapet » (« enfant hors
mariage ») est neutre tandis que le terme plus ancien « oäkting » (« enfant illégitime ») a une
charge émotionnelle négative et « kärleksbarn » (« enfant d’amour ») a une charge émotionnelle
positive (Ingo, 2011 : 125).
2.6. Méthodes indirectes, traduction oblique de Vinay et Darbelnet. Ingo (1991, 2011) aborde les sept méthodes de traduction centrales de Vinay et Darbelnet
(Stylistique comparée du français de l’anglais, 1977) dans son livre. Cette étude utilisera les
quatre dernières qui traitent des méthodes indirectes.
Les méthodes indirectes sont utilisées lorsqu'une méthode directe signifierait un autre sens, un
manque de sens, une impossibilité structurelle, s'il n'y a pas d'équivalent linguistique dans la
langue cible, et lorsqu’il y a un équivalent dans la langue cible mais pas du même niveau de
style (Axelsson, 2011 : 12).
Transposition : Changement de classe de mots mais pas de signification. La relation équivalente
peut être à la fois nouvelle et déjà établie. Par exemple l’expression :
« dès son lever »
« as soon as he gets up »
(Vinay et Darbelnet, 1977 : 50).
Modulation : Variation du message qui signifie que l’on regarde la même chose d'un point de
vue différent. On trouve la modulation au niveau lexical, grammatical et contextuel, p. ex. au
niveau lexical : « Peu profond « - « Grund » (Ingo, 1991 : 182).
Équivalence : Description de la même situation à l'aide d'autres dispositifs stylistiques,
sémantiques, structuraux. Le même phénomène existe dans les deux cultures mais s'exprime
avec des expressions linguistiques différentes. Il s'agit souvent d'images, par exemple lorsque
des proverbes doivent être traduits (Vinay et Darbelnet, 1977 : 52).
Adaptation : Utilisation de deux solutions différentes pour décrire le même phénomène.
L’adaptation est nécessaire lorsque la situation décrite est inconnue dans la langue cible et qu'il
faut trouver une situation correspondante avec la même valeur de symbole. Le même concept
14
n'existe pas dans la langue cible et il faut chercher quelque chose de similaire qui est enraciné
dans la culture de la langue cible (Ingo, 1991 : 178-184) (Vinay et Darbelnet, 1977 : 46-55).
Comme mentionné précédemment, Newmark (1987) préconise deux méthodes différentes.
Traduction sémantique (orientée vers la langue source) où le traducteur s'efforce d'atteindre une
équivalence totale avec le texte source en ce qui concerne sa valeur esthétique et crée en même
temps un texte idiomatique dans la langue cible en ce qui concerne la structure de la langue
cible, et la traduction communicative (orientée vers la langue cible) où une plus grande
importance est accordée à l'explication du texte source pour que le lecteur comprenne le texte
cible (Newmark, 1987 : 48-49). Dans les méthodes de Vinay et Darbelnet (1977) la pratique
est au centre ainsi que l’explication comment un traducteur choisit de traduire un texte
(Axelsson, 2011 : 9). Dans le travail de Vinay et Darbelnet Stylistique comparée du français de
l’anglais (1958/1977) certaines similitudes peuvent être trouvées avec les méthodes de
traduction de Newmark (1987), qu'il a développées dans le livre Approaches to translation
(1981), où il présente différentes manières de traduire sous la forme d'un V (Axelsson, 2014 :
9). La partie gauche (semantic translation) présente des similitudes avec la traduction directe
de Vinay et Darbelnet (1977) et la partie droite (communicative translation) correspond à la
traduction oblique (comparer Newmark 1987 : 45).
3. Méthode et matériel Nous présentons ici la manière dont nous avons examiné les lexèmes adjectifs. En plus nous
présentons le corpus du mémoire et un bref résumé du roman et l'auteur.
3.1. Méthode Avant de commencer une analyse comparative des adjectifs, nous avons lu le texte cible et le
texte source et marqué tous les adjectifs que nous avons pu trouver. De tous les adjectifs trouvés,
nous avons sélectionné 59 exemples pour notre étude. Ensuite, l'adjectif du texte cible inséré
dans son contexte a été comparé à celui correspondant dans le texte source. De nombreux
lexèmes sont dépendants de leur contexte, (Ingo, 2011 : 99). Ce n'est qu'après avoir analysé les
éléments significatifs, tels que la structure grammaticale, les mots, les morphèmes et les
expressions individuelles, qu'une traduction équivalente peut être recherchée (Ingo, 2011 : 86-
87), dans ce cas une traduction des adjectifs.
15
Les lexèmes adjectifs qui ont une traduction directe et qui sont également idiomatiques dans le
texte cible sont supprimés car notre étude examine les adjectifs traduits où la traduction directe
n'est pas choisie par la traductrice. Les adjectifs dans le texte source et cible sont examinés afin
d’observer comment les deux textes expriment les adjectifs différemment. Les lexèmes qui
modifiaient l'expression, la classe de mot et la sémantique de la traduction ont été sauvegardés
puis catégorisés. De la même manière, nous avons procédé avec les expressions adjectivales du
texte source. Pour examiner la signification des mots, des dictionnaires tels que Le Petit Robert,
Le Robert Expressions et locutions, Fransk ordbok (Nordstedts 2012) et Modern fransk
grammmatik (Holmberg, Klum, Girod, 2011) ont été utilisés.
En général, les lexèmes français ont une plus grande extension, c'est-à-dire une signification
plus générale que les lexèmes suédois. Tegelberg (2000 : 13) écrit :
Un certain nombre de linguistes ont noté le niveau d'abstraction plus élevé du dictionnaire français
par rapport aux langues germaniques, par exemple Brondal 1936, Bally 1944, Malblanc 1968,
Vinay et Darbelnet, 1977 (« notre traduction »).
Nous avons commencé l'analyse en examinant quels adjectifs ont abouti à un regroupement
synthétique (plusieurs mots qui constituent ensemble une signification dans la langue source
sont compressés en un seul mot dans la langue cible) et regroupement analytique (les
composantes de signification d’un seul mot du texte source sont regroupées et réparties entre
plusieurs mots différents dans la langue cible) (Ingo, 1991 : 186-187). Nous enquêtons
également sur des mots spécifiques ancrés dans la culture de la langue source et de la langue
cible, respectivement, avec des valeurs émotionnelles. Quant aux mots ancrés dans la culture à
haute valeur émotionnelle dans le texte source, nous n'avons trouvé que deux mots. Dans la
langue cible, nous avons trouvé de nombreux mots ayant une valeur émotionnelle, mais aucun
mot spécifiquement enraciné dans la culture de la langue cible.
Voici un exemple de regroupement synthétique :
Le scandale était à l’échelle de Dieu (p. 122).
Skandalen var i gudomlig storleksordning (s. 105)
16
Voici un exemple de regroupement analytique:
Ce que je fais ici est différent, et pareil (p.14)
Vad jag gör här är annorlunda, och samma sak (s. 11)
Ensuite, nous avons catégorisé les occurrences d’un seul lexème de complexité sémantique
faible traduit par un seul lexème de complexité sémantique et vice versa. (Tegelberg, 2000 :
197).
Voici un exemple d’une traduction d’un lexème plus général à un lexème spécifique :
(…) ses cheveux sont tirés et serrés dans un chignon de Chinoise (…) (p.31).
(…) hennes hår är slätkammat och hopsnurrat i en knut som hos de kinesiska kvinnorna.
(s. 26).
Voici un exemple d’une traduction d’un lexème spécifique à un lexème moins complexe. Le
mot « cardinal » est ancré dans la culture du langue source, et il n'y a pas de lexème
correspondant ayant la même signification en suédois.
(…) parce qu’il ne sait pas qu’il porte en lui une élégance cardinale (p. 54).
(…) för han vet inte vilken ojämförlig elegans som finns hos honom (s. 46).
Voici un exemple d’une traduction d’un lexème sémantiquement général à un lexème
spécifique avec une connotation. La connotation est signifiée par des mots qui évoquent des
émotions. Le mot suédois « tarvliga » évoque des émotions fortes tandis que le mot français
« pauvre » est plus neutre. L'exemple montre également une traduction d'un lexème d’une
complexité sémantique faible, un lexème avec une grande extension (Tegelberg, 2000 : 13) vers
un lexème avec une complexité sémantique élevée.
Rien ne manque à la pauvre vaisselle (p. 35).
Ingenting fattas av den tarvliga servisen (s. 29).
Nous avons également examiné les adjectifs où le changement de classe de mot, la
transposition, a eu lieu.
17
Elles auraient dû être au même âge toutes les deux (p. 134).
Antagligen var hon jämnårig med henne (s. 116)
Puisque la langue suédoise se caractérise par des propriétés synthétiques avec des adjectifs
spécifiques sémantiquement complexes avec des suffixes, nous les avons étudiés et regroupés
séparément (Tegelberg, 2000 : 192-195).
Il existe également de nombreux types de modulation dans notre enquête. Une modulation peut
être expliquée comme une variation du même message dans une traduction (Ingo, 1991 : 181).
On peut dire qu’on voit le lexème d'un point de vue différent. Souvent une modulation est aussi
une transposition (changement de classe de mot) ou une action explicite (ajout de nouveaux
mots mais pas de nouvelle information). Afin de ne pas confondre des concepts avec en partie
le même sens, nous n'avons donc pas compté le nombre de modulations mais notons qu'elles
sont nombreuses et sont souvent incluses dans les transpositions et les actions explicites.
Après avoir catégorisé tous les adjectifs, nous avons analysé chacun selon le modèle d'analyse
de Lindqvist (2004 : 6-7), ainsi que les méthodes indirectes, traduction oblique de Vinay et
Dalbernet (1977), et les cas particuliers sémantiques d’Ingo (1991,2011).
3.2. Le matériel, le roman et l’auteur Le corpus du mémoire se compose de sections sélectionnées où la traduction des adjectifs du
texte source français vers le texte cible suédois est analysée dans l'ouvrage L’Amant de M.
Duras (1984). Les adjectifs sélectionnés que nous avons trouvés intéressants pour notre étude
sont au nombre de 59. Ils sont présentés dans leur contexte et ont été regroupés selon leurs
caractéristiques. Les phrases dans lesquelles le texte source et les adjectifs du texte cible sont
inclus sont numérotées pour trouver facilement les lexèmes dans le corpus. Ils sont également
alignés ensemble pour les comparer facilement.
Le roman raconte l'histoire d'une jeune fille qui, lors d'un voyage à travers le Mékong, rencontre
un riche Chinois avec qui elle entame une histoire d'amour. Quelque chose de très inapproprié
dans le groupe social auquel appartient la fille. Le livre se déroule dans les années 30 en
Indochine française. Le personnage principal est une fille de 15 ans vivant dans une famille
dysfonctionnelle. La mère est une veuve qui balance au bord de la folie, le frère aîné est violent
18
et le frère cadet qui est proche de la jeune fille, meurt, ce qui est un coup dur pour elle. Le
roman est de nature fictive mais a les caractéristiques d'une autobiographie car une grande partie
de ce que Duras elle-même a vécu est repris dans le roman.
Marguerite Duras (1914-1996) a grandi en Indochine française où ses parents travaillaient à
l'école. Son nom d'origine était Donnadieu mais a changé pour Duras quand elle a commencé à
écrire (nom de plume). Après la mort prématurée du père, la mère est restée seule avec
Marguerite et ses deux frères et la vie est devenue difficile pour la famille. La mère a été bientôt
ruinée après avoir été amenée à acheter des terres impossibles à cultiver. Après le baccalauréat,
Marguerite quitte sa famille en Indochine et s'installe en France pour étudier les mathématiques
et le droit. En 1942, elle travaille pour le gouvernement de Vichy en même temps qu'elle est
membre du mouvement de résistance comme son mari Robert Antelme qu'elle a rencontré six
ans plus tôt. Son premier roman, Les impudents a été publié en 1943 et quatre ans plus tard en
1947 elle est devenue membre du Parti Communiste Français. La dernière partie de sa vie a été
considérablement fragilisée par des problèmes dus à la consommation d’alcool. Elle a écrit
jusqu'au dernier moment même si elle ne pouvait pas saisir le stylo elle-même à cause de ses
tremblements. Duras est décédée à l'âge de 81 ans.
Le roman L'Amant, dont est tiré le corpus pour notre étude des adjectifs, se trouve dans 57
traductions et est le texte le plus traduit de Duras. En Suède, il a été réédité six fois depuis la
première édition suédoise en 1985. L'œuvre de Duras a reçu le prix Goncourt en 1984
(Aronsson, 2015 : 144-145).
4. Résultats et analyse Cette section présente les résultats obtenus en étudiant les adjectifs traduits où la traduction
directe a été rejetée au profit d'autres solutions.
Nous avons précédemment déclaré que la langue française est une langue essentiellement
analytique (Tegelberg, 2000 : 212) tandis que la langue suédoise a des caractéristiques à la fois
analytiques et synthétiques (Ingo, 1991 : 192). Par exemple les adjectifs suédois sont souvent
caractérisés par des suffixes, des préfixes et des adjectifs composés avec une complexité
sémantique élevée, contrairement à la langue française où un lexème est en général
19
sémantiquement plus faible (Tegelberg, 2000 : 13) et dépend souvent de son contexte pour
exprimer une signification spécifique. Les deux langues ont des structures différentes, qui
peuvent être vues dans la façon dont elles expriment les adjectifs.
Nous avons catégorisé les adjectifs en :
1/ regroupement synthétique
2/ regroupement analytique
3/ un seul lexème sémantiquement général traduit par un seul lexème sémantiquement
complexe
4/ un seul lexème sémantiquement complexe traduit par un seul lexème sémantiquement
général ou par plusieurs lexèmes sémantiquement généraux.
L'étude traite également d'autres phénomènes qui surviennent lors d'une traduction tels que la
transposition (changement de classe de mot), la modulation (le lexème traduit vu d'un autre
point de vue) et l'ajout et la perte sémantique (des composants de sens significativement
nouveaux ont été ajoutés / supprimés). Les mots à connotation (mots chargés d'émotion) dans
la traduction qui n'ont pas une correspondante émotionnelle dans la langue source sont
commentés. De nombreux mots spécifiques sont chargés d'émotion mais nous avons choisi de
ne donner que quelques exemples clairs. Nous avons appelé action explicite les ajouts de
nouveaux mots dans le texte cible mais où des informations peuvent être lues entre les lignes
dans le texte source. Inversement, nous avons appelé action implicite les omissions de mots
dans le texte cible par rapport au texte source mais où le contenu sémantique peut se lire entre
les lignes dans le texte cible. Celles-ci sont également commentées et nous présentons ici une
analyse des adjectifs que nous comparons entre les deux langues.
4.1. Regroupement synthétique Ici sont présentés des exemples de regroupement synthétique du lexème de la langue source
avec plusieurs mots à faible complexité sémantique (n° 1a, 1b, 2) et plusieurs mots à haute
complexité sémantique (n° 3, 4, 5) en un seul lexème de langue cible à haute complexité
sémantique avec le suffixe -ig. Comme nous l'avons dit précédemment les adjectifs suédois
avec des suffixes expriment une complexité sémantique élevée et le groupe d'adjectifs avec le
suffixe -ig constitue le plus grand groupe de cette catégorie. Ces adjectifs aboutissent souvent
20
à plusieurs lexèmes français sémantiquement moins complexes dans une traduction (Tegelberg,
2000 : 192).
Ci-dessous sont des exemples de regroupement synthétique où l'adjectif de la traduction est
formé sur le suffixe -ig :
1a/ (…) sous le chapeau d’homme, la minceur ingrate de la forme, ce défaut de l’enfance,
est devenue autre chose ( p. 19).
(…) i denna hatt blev formernas kantiga magerhet, denna barnsliga ofullkomlighet, till
något annat (s. 16).
1b/ (…) Il mange les seins d’enfant (…) (p. 53).
(…) Han äter mina barnsliga bröst (…) (s. 45)
Dans ces deux exemples, « enfance » (barndom) et « enfant » (barn) ont été traduits par
« barnslig » (enfantin). Le point commun aux exemples est que le traducteur change la classe
de mot d'un nom avec une construction génitive « de » (qui en suédois correspondrait à un s-
génitif) en un adjectif. Dans les deux cas, la traduction du lexème « l’enfant » devient plus
spécifique dans le texte cible. Une traduction directe serait « denna barndomens
ofullkomlighet » et « barnets bröst ». Avec l'adjectif « barnslig » / « enfantin » (petit, non
développé avant la puberté) le lexème obtient une valeur descriptive qui n'est pas dans le lexème
de la langue source. Implicitement, (ce qui est compris mais qui ne s'écrit pas), il est sous-
entendu dans le texte source que le sein d'un enfant n'est pas développé. Des informations ne
sont pas ainsi ajoutées car le lexème « enfantins » peut se comprendre dans le contexte. (Ingo,
2011 : 123).
Il y a une transposition d’un substantif à un adjectif et une action explicite.
2/ Elle est devenue, tout à l’opposé, un choix contrariant de celle-ci, un choix de l’esprit.
Soudain, voilà qu’on l’a voulue (p. 19).
Tvärtom, den blev ett val, ett andens val som motsade naturen. Plötsligt var den avsiktlig
(s. 16).
21
Une traduction directe de « qu'on l'a voulue » serait « det man har velat », ce qui, en termes de
sens, peut être assimilé à « avsiktlig ». Au lieu d'une traduction directe, la traductrice a choisi
un lexème sémantiquement complexe avec une signification correspondante. Voici un exemple
typique d'une expression à plusieurs mots où le lexème dans la langue source a une faible
complexité sémantique qui se traduit par un regroupement synthétique dans la langue cible.
Il y a un changement de classe de mots d’un verbe à un adjectif, une transposition et une action
explicite.
3/ Elle prend la direction du tournoiement du monde, celle toujours lointaine,
enveloppante, de l’est (p. 104).
Hon går i den riktning dit världen snurrar, den alltid avlägsna, omslutande,
östliga (s. 89).
Il y a une transposition d’un substantif à un adjectif.
4/ (…) et voici que cette épouvante se défait encore, qu’ils lui cèdent encore, dans
les larmes, le désespoir, le bonheur (p. 119).
(…) och nu löser sig förfäran igen, de ger efter för den igen, gråtande, förtvivlade
lyckliga (s. 102).
Il y a une transposition d’un substantif à un adjectif.
5/ Le scandale était à l’échelle de Dieu (p. 122).
Skandalen var i gudomlig storleksordning (s. 105)
Il y a une transposition d’un substantif à un adjectif.
Ci-dessous sont des exemples de regroupement synthétique où l'adjectif de la traduction est
formé sur un adjectif composé +suffixe -ig :
6/ Que c’est aussi faux de dire qu’elle est sans commencement ni fin que de dire qu’elle
commence et qu’elle finit avec la vie de l’esprit du moment que c’est de l’esprit
qu’elle participe et de la poursuite du vent (p. 124).
22
Att det är lika falskt att säga att den är utan början eller slut som att säga att den
börjar och slutar med andens liv, eftersom det är anden den är delaktig av och jagandet
efter vind (s. 107).
Il y a une transposition d’un verbe à un adjectif.
7/ Elles auraient dû être au même âge toutes les deux (…) (p. 136).
Antagligen var hon jämnårig med henne (…) (s. 116)
Il y a une transposition d’un substantif à un adjectif
8/ (…) ils ne se quittaient plus (p. 134).
(…) de var oskiljaktiga (s.115
Il y a une transposition d’un verbe à un adjective et une modulation, un autre point de vu.
9/ (…) ce genre de peine adultère (…) (p. 136).
(…) denna utomäktenskapliga sorg (…) (s. 116).
La traduction d´ « adultère » pose problème car selon Le Petit Robert – « l’adultère est le fait
d’avoir volontairement des rapports sexuels en dehors des liens du mariage ». Or l’homme
n'est pas infidèle à sa femme car son histoire d'amour a eu lieu avant le mariage, mais il a un
chagrin et un désir ardent pour la jeune fille. Le traducteur a choisi les lexèmes
« utomäktenskapliga sorg » (chagrin hors mariage) au lieu d’une traduction directe de « peine
d'adultère » qui peut avoir à voir avec le sens exact du mot dans une culture (cela dépend de ce
que l'on entend par un mot spécifique dans des cultures différentes). Le lexème « genre »
(« sorts ») a disparu dans le texte cible mais reste caché dans le contexte et dans le lexème
choisi. Il y a un nouveau mot mais pas de nouvelle information car le sens se comprend dans le
contexte (Ingo, 1991 : 86).
Il y a une action explicite.
Ci-dessous sont des exemples de regroupement synthétique où l'adjectif de la traduction est
formé sur d’autre suffixe que - ig ou des préfixes :
23
10/ La mer sans forme, simplement incomparable (p.48).
Havet, formlöst, helt enkelt ojämförligt (s.41).
Il y a une transposition d’un substantif à un adjectif, un adjectif avec un suffixe et également
un adjectif composé.
11/ Pourquoi toutes ses robes avaient en commun un je ne sais quoi qui échappait,
qui faisait qu’elles n’étaient pas tout à fait les siennes, (…) (p.79).
Varför alla hennes klänningar hade något gemensamt, ett ogripbart jag vet inte
vad som gjorde att de inte var helt och hållet hennes (…) (s.68).
Il y a un suffixe (-bar) et une transposition d’un verbe à un adjectif.
Ci-dessous sont des exemples de regroupement synthétique où l'adjectif de la traduction est
formé sur un adjectif composé sans le suffixe -ig :
12/ (…) il paraît être à la merci d’une insulte, souffrant (p.48).
(…) han är som utlämnad åt en kränkning (s. 41).
Définition de l’expression ”à la merci” dans Le Grand Robert : Locution prépositive, à la valeur
de préposition.
Il y a une transposition.
13/ (…) cette personne de bonne foi, notre mère, que la société a assassinée (p.67)
(…) denna godtrogna människa, vår mor, som samhället har mördat (s.58).
Dans Expression et locution, (Petit Robert, 2003), l'explication de « de bonne foi « est « plus
fidèle », « honnête », mais le contexte montre que la mère est « godtrogen », c'est-à-dire qu'elle
fait confiance à tout le monde et est facilement trompée par les gens. La traduction de
« godtrogen » dans Nordstedts est : « crédule, naïf ». Il y a donc une différence nuancée dans
la traduction du lexème mais la signification se comprend dans le contexte.
Il y a une transposition d’un substantif à un adjectif et une action explicite.
24
14/ À ses traits tirés, à un certain désordre de sa tenue, à la somnolence de son regard, je
sais qu’il fait chaud, qu’elle est exténuée, qu’elle s’ennuie (p.21).
På hennes trötta drag, på en viss oordning i hennes klädsel, på den sömndruckna blicken
ser jag att det är varmt, att hon är utmattad, att hon leds (s.17).
Le lexème « sömndruckna » est un mot suédois spécifique qui ne peut avoir qu'une seule
signification.
Il y a une transposition d’un substantif à un adjectif.
4.2. Regroupement analytique Le regroupement analytique a souvent lieu lorsque la langue cible n'a pas un seul mot qui peut
transmettre toutes les unités de sens en question (Ingo, 1991 : 187). Dans les cas où le texte
source est un langage synthétique et le texte cible analytique, le regroupement analytique a
souvent lieu d'un lexème sémantiquement complexe vers plusieurs lexèmes moins complexes
sémantiquement pour exprimer la même signification (Tegelberg, 2000 : 192). Dans notre étude
où le langage source est un langage analytique, nous avons trouvé des regroupements
analytiques à partir d’un lexème sémantiquement complexe aussi bien qu’à partir d’un lexème
sémantiquement général. Dans les deux cas, n° 15, et n°19, les lexèmes ont été traduits en un
sens plus complexe, en plus le n° 19 exprime une valeur émotionnelle plus élevée que le lexème
plus général de la langue source. Ingo (2011) estime qu'il est souhaitable d'imiter la valeur
émotionnelle de la langue source dans la traduction (Ingo 2011 : 110) en même temps que
Tegelberg (2000) estime que la structure différente des langues et la manière dont les langues
sont utilisées dans différentes cultures signifient que le degré d'expression émotionnelle peut
varier entre les langues d'une traduction. De nombreux adjectifs suédois sémantiquement
complexes sont chargés émotionnellement et les paraphrases françaises (lors de la traduction
du suédois au français dans le cas de Tegelberg) n’ont pas cette dimension, et étant de nature
objectivement analytique, les paraphrases françaises créent une distance plutôt que la proximité
qui est caractéristique pour l'adjectif suédois (Tegelberg 2000 : 196).
Dans les exemples suivants, le processus de regroupement analytique a lieu parfois d’un lexème
sémantiquement complexe à plusieurs lexèmes moins significatifs, parfois d'un lexème
25
sémantiquement plus général à plusieurs lexèmes où la signification est sémantiquement plus
élevée que le seul lexème du langage source :
15/ (…) je vois que tous les champs sont ouverts (…) (p. 15)
(…) jag ser att fältet ligger öppet åt alla håll (…) (s. 12)
Le mot « ouvert » est un lexème sémantiquement général et la traduction contient une
sémantique plus élevée. Il y a un ajout sémantique et action explicite. L’expression « åt alla
håll » (dans toutes les directions) clarifie ce qui peut être lu entre les lignes du texte source mais
qui est imprimé explicitement dans le texte cible. La traductrice a choisi un regroupement
analytique où cela aurait pu fonctionner aussi bien avec une traduction directe d’« ouvert »
(öppet).
Il y a une transposition d’un adjectif à un adjectif + substantif.
16/ (…) ces yeux cernés en avance sur le temps (…) (p.15)
(…) dessa ögon som fått ringar i förtid (…) (s.12)
Il n'y a pas de mot sémantiquement équivalent en suédois pour « cernés » qui est un mot
sémantiquement élevé. Une paraphrase est nécessaire dans la langue cible pour inclure tous les
composants significatifs.
Il y a une transposition d’un adjectif à un verbe +substantif et une paraphrase.
17/ (…) il dit une phrase très courte, cinglante, définitive (p. 64).
(…) han säger någonting kort, bitande som en pisksnärt, slutgiltigt (s.55).
L’explications du lexème « cinglante » selon Le Petit Robert sont les suivantes : « blessant,
cruel, sévère, vexant ». Le lexème est sémantiquement élevé et la traduction utilise un langage
figuré pour clarifier l’image. Dans une traduction directe, la traductrice n'aurait inclus que
« cinglante » (« bitande «).
Il y a une paraphrase, un ajout sémantique, une action explicite, une transposition d’un adjectif
à un adjectif + substantif et un langage figuratif.
26
18/ Mon mari est déporté. Il compatit (p.92).
Min man är deporterad. Han är full av medkänsla (s.79).
L’explication du lexème « compatit » selon Le Petit Robert est la suivante : « souffrir avec ».
Il y a un regroupement d’un seul lexème sémantiquement élevé à plusieurs lexèmes où le
lexème « medkänsla » également obtient une sémantique élevée.
Il y a une transposition de l’adjectif à l’adjectif + substantif et une action explicite.
19/ L’amant de Cholen s’est fait à l’adolescence de la petite blanche jusqu’à s’y perdre
(p.116).
Älskaren från Cholen har vant sig vid den lilla flickans ungdom till den grad att han
låter sig uppslukas av den (s. 100).
Voici une traduction d’un lexème sémantiquement général à plusieurs lexèmes où le lexème
suédois « uppslukas » obtient une valeur sémantique élevée. Ici la traductrice a choisi un
lexème sémantiquement élevé où cela aurait pu fonctionner aussi bien avec une traduction
directe du lexème sémantiquement plus général « perdre » (förloras). Le lexème choisi
« uppslukas » (« être avalé ») ajout d’un sentiment plus fort qui décrit la passion insensée que
l'amant éprouve pour la fille.
Il y a un ajout sémantique, une paraphrase pour clarifier la signification et une langue figurée.
20/ (…) nous mangions, parfois, il est vrai, des saloperies, des échassiers (…) (p. 13).
(…) vi åt äcklig smörja ibland, vadarfåglar (…) (s. 10).
Le lexème suédois « äcklig » (dégoûtant) est ajouté. Il n’existe pas dans le texte source, mais il
n’y a pas un ajout sémantique car c'est dégoûtant de manger des saloperies. « Äcklig » peut
ainsi être compris dans le contexte.
Il y a une transposition de substantif à l’adjectif et une action explicite.
27
4.3. Un seul lexème d’une complexité générale à un seul lexème d’une complexité sémantique élevée Les traducteurs s'efforcent de reproduire le plus fidèlement possible le message du texte source,
mais le texte traduit doit correspondre en partie au cercle culturel et en partie à la langue du
lecteur que le traducteur représente. Les langues ont des conditions préalables de bases
différentes et il est donc parfois nécessaire que les catégories sémantiques de la langue source
soient remplacées par celles requises par la langue cible (Ingo, 1991 : 226). Le but du traducteur
est que les lecteurs du texte source et du texte cible réagissent de la même manière malgré les
différences de structure linguistique et de culture (Ingo, 1991 : 227). Une traduction directe d'un
lexème français peut parfois être trop peu nuancée. Le lexème suédois est dans de nombreux
cas plus détaillé sémantiquement. Ingo illustre ce phénomène par un exemple où il compare le
lexème anglais « be » dans des contextes différents traduits en suédois (Ingo, 2011 : 192) et
estime que les mots français et anglais sont très souvent polysémiques, c'est-à-dire qu'ils ont de
nombreuses significations (Ingo, 2011 : 212) et dépendent fortement du contexte pour que le
sens spécifique soit rendu visible.
Ici des exemples d’un seul lexème avec une faible complexité sémantique dans le texte source
traduit en un seul lexème correspondant avec une complexité sémantique élevée dans le texte
cible. Les exemples s'appliquent aux adjectifs traduits avec le suffixe -ig :
21/ (…) ses cheveux sont tirés et serrés dans un chignon de Chinoise (…) (p.31).
(…) hennes hår är slätkammat och hopsnurrat i en knut som hos de kinesiska kvinnorna.
(…) (s. 26).
Nous voyons ici comment la traductrice donne des informations sur l'apparence du nœud de
cheveux en remplaçant les mot ”tirés” et ” serrés » par le lexème spécifique « slätkammat » et
« hopsnurrat ». Une information qui ajoute des informations qui ne figurent pas dans le texte
source.
Il y a un ajout sémantique.
22/ Que s’il avait voulu ç’aurait été lui le plus intelligent des trois. Le plus ”artiste”.
Le plus fin (p.94)
28
Att om han hade velat skulle han ha varit den mest intelligenta av de tre. Den mest
« konstnärliga ». Den känsligaste (s.81).
« Le plus fin » a de nombreuses significations et doit être replacé dans un contexte pour avoir
une sémantique spécifique. Les deux lexèmes dans les deux langues sont des adjectifs au
superlatif.
« Le plus fin » est lexicalisé cela veut dire que les mots « plus » et « fin » ensemble constituent
un seul lexème.
23a/ L’objet était trop mince pour la provoquer (p. 16).
Föremålet var alltför obetydligt för att uppmana till det (s.13).
23b/ (…) ses causes étaient minces (p.93).
(…) hans rättssaker var obetydliga (s.79).
Les deux lexèmes « mince », ici avec la traduction « obetydliga » sont plus généraux que les
lexèmes suédois. Une de plusieurs explications du mot « mince » selon Le Petit Robert :
« médiocre / peu d'importance ».
À partir du contexte, ces mots généraux sont compris, tandis que le lexème suédois est plus
spécifique et peut être plus indépendant que le lexème français.
24a/ Rien ne manque à la pauvre vaisselle (p.35).
Ingenting fattas av den tarvliga servisen (s. 29).
24b/ Il dit encore que la nourriture pauvre des tropiques, faite de poissons, de fruits, y est
aussi pour quelque chose (p. 116).
Han säger också att den torftiga födan i tropikerna, som består av fisk, av frukt, också
har betytt något (s. 99).
Les lexèmes suédois « tarvliga » (exemple 24 a) et « torftiga » (exemple 24 b) ont des
significations spécifiques. Ici, ils sont traduits de « pauvre », un lexème aux multiples
significations. Par exemple « torftiga » ne pouvait pas être utilisé dans l’exemple 24b, tandis
que le lexème « pauvre » peut être utilisé sans problème dans les deux cas. Malgré cela, il existe
une équivalence car le lexème français acquiert sa signification spécifique dans son contexte.
29
25/ (…) il est très faible. Il paraît être à la merci d’une insulte, souffrant (p. 48).
(…) han är mycket svag. Han är som utlämnad åt en kränkning, tålmodig (s. 41).
Le lexème « souffrant » est ambigu. Explications du lexème « patient » selon Le Petit Robert
: « patient » « qui souffre de sa situation ». Le lexème suédois « tålmodig » a un ton plus
spécifique, cela veut dire qu’on a le courage d’attendre mais ne souffre pas nécessairement.
Dans ce contexte dans le texte cible, il est entendu que l'homme souffre si le lexème suédois
précédent « kränkt » est inclus dans le contexte. Par conséquent, il y a une sémantique
équivalente, une signification égale dans les deux phrases. Les lecteurs de la langue source et
de la langue cible réagissent probablement de la même manière au sens de la phrase. Il y a une
action implicite (omission du lexème « souffrant ») (Ingo, 2011 : 124). La souffrance peut se
comprendre entre les lignes dans le texte cible.
Ici des exemples d’un seul lexème avec une faible complexité sémantique dans le texte source,
traduit en un seul lexème correspondant avec une complexité sémantique élevée dans le texte
cible avec un autre suffixe que -ig ou un préfixe :
26/ (…) ses robes lamentables (…) (p.31).
(…) hennes hopplösa klänningar (…) (s.26).
La traduction du lexème « lamentable » selon Nordstedts : « Jämmerlig, beklaglig, bedrövlig ».
Des synonymes de « lamentable » selon Le Petit Robert : « Déplorable, désolant, navrant,
triste ».
Il y a une équivalence sémantique et un suffixe : - lös.
27/ Les mains sont expertes, merveilleuses, parfaites (p.53).
Hans händer är kunniga, underbara, fulländade (s. 45).
Il y a un préfixe : full-
28/ (…) les âges les plus jeunes, les plus célébrés de la vie ( p. 10).
(…) i de yngsta, de mest besjungna åren i livet (s.8).
30
Dans le texte suédois, le lexème « besjungna » (un lexème lié au « chant de joie ») ajoute une
valeur émotionnelle, une connotation, qui n'apparaît pas dans le mot français « célébrée ». Ingo
décrit comment les mots peuvent donner des associations et créer des réactions émotionnelles
chez l'utilisateur de la langue (Ingo, 1991 : p.144). De plus, il décrit le danger qu'une unité de
traduction soit embellissant ou plus négative parce qu'un traducteur doit s'efforcer d'obtenir une
équivalence aussi exacte que possible. (Ingo, 1991 : 145). Dans l'exemple, la composante de
signification n'est pas perdue, mais une valeur émotionnelle est ajoutée dans la langue cible
avec le mot suédois choisi « besjungna ».
Il y a un préfixe : be-
29/ (…) mis dans la circulation des villes (…) (p.20)
(…) inlemmad i städernas kretslopp (…) (s.16).
Il y a un préfixe : in-
30/ Il devient un endroit brûlé (p.64).
Han blir en förkolnad plats (s.55).
31/ (…) d’être démunie devant celle-ci, perdue, solitaire (p.71).
(…) att stå inför det utblottade, förtappad, ensam (s.60).
Il y a un préfixe: för-
Voici des exemples d’un seul lexème avec une faible complexité sémantique dans le texte
source, traduit en un seul lexème correspondant avec une complexité sémantique élevée dans
le texte cible où l'adjectif de la traduction est formé sur un adjectif composé.
32/ Elle a cessé d’être une donnée brutale, fatale, de la nature (p.19).
Den upphörde att vara en brutal, ödesbestämd naturens ordning (s.16).
33/ Je lui dis que son séjour en France lui a été fatal (p.60).
Jag säger att hans vistelse i Frankrike har varit ödesdiger för honom (s.52).
31
34/ (…) on était des enfants rieurs (…) (p.75).
(…) vi var skrattlystna barn (…) (s.64).
4.4. Un lexème d’une complexité sémantique élevée traduit par un lexème d’une complexité sémantique générale ou par plusieurs lexèmes d’une complexité sémantique générale
35/ (…) parce qu’il ne sait pas qu’il porte en lui une élégance cardinale (…) (p. 54).
(…) för han vet inte vilken ojämförlig elegans som finns hos honom (…) (s. 46).
Explication du lexème « cardinale » selon Le Petit Robert : « Une dignité de cardinal ». Ce
lexème est spécifique, lié à la culture de la langue source. Il n’y a pas un lexème équivalent en
suédois mais le traducteur a trouvé un lexème avec une signification correspondante.
36/ (…) vêtue de grisaille comme une défroquée (…) (p.32).
(…) klädd i gråtoner som en före detta nunna (…) (s. 27).
Explication du lexème « défroquée » selon Le Petit Robert : (…) qui a abandonné l’état de
moine ou de prêtre.
Tout comme dans l'exemple ci-dessus, il s'agit d'un mot spécifique enraciné dans la culture dont
l'équivalent n'existe pas en suédois. Le lexème est traduit par une paraphrase, un regroupement
analytique.
Il y a une transposition d’un substantif à un adjectif+ substantif.
4.5. Résumé du résultat et de l’analyse
Sur les 59 lexèmes adjectifs examinés, nous avons trouvé :
Nombre d’exemples de regroupements synthétiques : 20
Nombre d’exemples de regroupements analytiques : 13
Les structures linguistiques diffèrent entre les langues et pour exprimer un sens, elles ont besoin
de nombreux et différents composants de signification (Ingo, 1991 : 186). L'application du
regroupement synthétique et analytique est un exemple de ce phénomène. A travers les
32
nombreux regroupements synthétiques que nous avons découverts dans notre étude, la
traductrice a conservé le caractère spécifique de la langue cible (Ingo, 1991 : 187) et on constate
qu'il existe un équilibre relatif entre les regroupements synthétiques et analytiques (Lindqvist,
2004 : 6)
Nombre d’exemples d’un seul lexème d’une complexité générale à un seul lexème d’une
complexité sémantique élevée : 23
Nombre d’exemples d’un seul lexème d’une complexité sémantique élevée à un seul lexème
d’une complexité sémantique générale : 3
Les résultats montrent que la langue suédoise a des mots sémantiquement plus complexes que
la langue française (Tegelberg, 2000 : 13).
Nombre d’exemples de transpositions: 31
La manière d'exprimer des adjectifs dans une traduction via un changement de classe de mots
dépend de la structure grammaticale et des règles des langues (Ingo, 1991 : 169) et le résultat
de notre étude montre que les structures grammaticales différentes entre les deux langues
entraînent des transpositions.
Nombre d’exemples d’ajouts sémantiques : 5
L'ajout sémantique dépend souvent de motifs pragmatiques (Ingo, 2011 : 123). Notre étude
montre des exemples de mots français qui n'avaient pas d'équivalent en suédois et la traductrice
a dû ajouter des nouveaux mots pour expliquer le sens. Ingo explique qu’il peut y avoir un
besoin d’ajout sémantique pour expliquer un contexte plus en détail, par exemple dans le cas
de différences culturelles, mais aussi pour obtenir un équilibre dans la langue cible (Ingo, 2011 :
123).
Nombre d’exemples de pertes sémantiques : 0
Ingo souligne que si des omissions se produisent, cela doit être fait pour des raisons
pragmatiques. Il écrit que les omissions sont souvent dues à la négligence (Ingo, 2011 : 124).
Nombre d’exemples d’actions explicites : 23
33
Nombre d’exemples d’actions implicites : 2
La surreprésentation de l'action explicite montre que ce qui est lu entre les lignes dans le texte
source est clarifié en exprimant le sens explicitement dans le texte cible et qu'il s'agit rarement
d'un phénomène opposé où les mots du texte source sont omis pour être lus entre les lignes du
texte cible (Ingo, 2011 : 123-124).
Nombre d’exemples de lexème suédois sémantiquement élevé avec le suffixe -ig : 27
Nombre d’exemples de lexème suédois sémantiquement élevé avec d’autre suffixes ou
préfixes : 16
Nombre d’exemples de lexème suédois sémantiquement élevé composé : 14
Nos résultats concernant les adjectifs suédois avec des suffixes ou préfixes et les adjectifs
composés corroborent la conclusion de Tegelberg (2000) qui dit que les adjectifs suédois avec
des suffixes / préfixes et des adjectifs composés ont souvent une complexité sémantique élevée
dont les lexèmes avec le suffixe -ig constituent la plus grande partie de ces lexèmes (Tegelberg,
2000 : 192, 194).
5. Discussion et conclusion
Dans cette section, nous tentons de répondre à nos questions de recherche à travers une
discussion du corpus que nous avons rassemblé.
1 / Dans quelle mesure la traductrice utilise-t-elle le regroupement synthétique et analytique
dans sa traduction de l'ouvrage L'Amant de Duras ?
Le résultat montre 20 exemples de regroupements synthétiques à comparer avec les 13
exemples de regroupements analytiques, ce qui peut être dû à la structure différente des deux
langages. La langue analytique française a généralement un lexème avec une complexité
sémantique plus faible que les lexèmes de la langue suédoise plus synthétique (Tegelberg, 2000
: 13), ce qui est clairement visible dans notre étude. Les langues synthétiques ont d'abondantes
possibilités de dérivation de mots telles que des suffixes et des préfixes, contrairement à un
langage analytique qui reproduit plutôt la même signification avec des paraphrases à plusieurs
34
mots. La nécessité de regroupements synthétiques et analytiques est donc liée à la question des
propriétés analytiques et synthétiques des deux langues (Ingo, 1991 : 187).
Il n’y a que sept exemples d’écart entre les deux différents regroupements, ce qui crée un
équilibre relatif dans le texte. Le texte de la langue cible ne déborde pas et il n'a pas non plus
rétréci (Lindqvist, 2004 : 6). Ingo (1991) décrit l'importance de préserver le caractère lexical de
la langue cible, ce qui implique dans notre étude un regroupement synthétique. En outre, Ingo
dit qu'un texte traduit a tendance à gonfler et qu'il est donc également important de compresser
le message pour obtenir un texte équilibré (Ingo 1991 : 187). Dans ce cas, la traductrice semble
avoir créé un équilibre en ne laissant pas le regroupement synthétique prendre le dessus. Parfois
la traductrice a choisi un regroupement analytique lorsqu'un mot général correspondant au
lexème français avait fonctionné, par exemple le n ° 15, « ouvert » - « öppet åt alla håll », là où
une traduction aurait tout aussi bien pu être une traduction directe (« öppet »), sans ajout
sémantique.
2 / De quelle manière les éléments de signification du texte original sont-ils transférés vers le
texte cible lorsque la traduction directe n'est pas possible ?
Lors de l'examen de la traduction des lexèmes simples, il s'est avéré que le plus grand groupe
était lors de la traduction d'un lexème sémantiquement général en un lexème sémantiquement
complexe, dont nous avons trouvé 23 exemples, contre seulement 3 exemples de lexèmes
trouvés dans le groupe où un lexème d’une complexité sémantique élevée dans la langue source
a été traduit par un lexème d’une complexité sémantique générale. Comme indiqué
précédemment, la langue française a généralement des lexèmes avec une faible complexité
sémantique, ou en d'autres termes - une plus grande extension (Tegelberg, 2000 : 13) que les
lexèmes suédois. Les résultats de notre enquête confirment ce phénomène. Lorsqu'un lexème
unique dans la langue cible pouvait exprimer une signification spécifique, le lexème de la
langue source dépendait d'un contexte pour spécifier la signification spécifique du mot. Par
exemple
n° 32, « Elle a cessé d’être une donnée brutale, fatale, de la nature » ( p.19).
”Den upphörde att vara en brutal, ödesbestämd naturens ordning” (s.16).
35
Un autre phénomène intéressant que nous avons découvert était le changement fréquent de
classe de mots dans la traduction, ce que l'on appelle des transpositions (Vinay et Darbelnet,
1977 : 50). Dans notre étude nous en avons trouvé 31 exemples. Comme nous l'avons déjà
mentionné, une transposition qui implique un changement de classe de mots ne signifie pas que
le sens change. Le fait que l'on choisisse d'utiliser des transpositions dépend souvent des
différentes préconditions grammaticales de base des langues. Le traducteur adapte le formulaire
à la langue cible. Nous pouvons affirmer ici que la traduction a eu lieu selon les catégories
grammaticales de la langue cible, c'est-à-dire que le destinataire doit expérimenter le texte de
la traduction comme un texte original dans sa propre langue maternelle (Ingo, 1991 : 225-226).
Notre enquête n'a révélé aucune perte d'information, perte sémantique, dans la traduction. Ingo
écrit que les omissions sont souvent dues à la négligence ou à la pure paresse (Ingo, 2011 :
124). L’étude montre ainsi que la traductrice est fidèle au contenu sémantique du texte source
en termes d'adjectifs.
Il y avait 23 exemples d’actions explicites, ce qui indique que la traductrice clarifie au lecteur
de la langue cible les informations qui peuvent être lues entre les lignes dans la langue source,
ici en ce qui concerne les adjectifs examinés. Il s'agit rarement du phénomène opposé (3
occurrences), que nous avons appelé « action implicite », où les mots du texte source sont omis
pour être lus entre les lignes du texte cible (Ingo, 2011 : 123-124), ce qui montre que la
traduction est orientée vers la langue cible.
Le fait que le lexème à faible complexité sémantique ait été traduit avec un lexème à forte
complexité sémantique a souvent contribué à une valeur émotionnelle plus élevée, une
connotation. Ingo décrit qu'en plus de sa signification fondamentale, de nombreux mots ont une
valeur émotionnelle qui suscite en nous des émotions positives ou négatives (Ingo, 2011 : 109).
Dans notre étude, par exemple le n° 28 « besjungna » peut être associé à l’hymne, à la joie, à
l'espoir, tandis que le n° 32 « ödesbestämt » peut être associé à une obscurité imminente
inévitable. Ces exemples sont tous les deux traduits d’un lexème plus neutre sans grande valeur
émotionnelle. De nombreux mots spécifiques ont un certain degré de valeur émotionnelle, mais
il est difficile de cartographier la connotation d'un mot car le degré de connotation varie
considérablement même chez ceux qui parlent la même langue (Ingo, 2011 : 109). Une
expérience émotionnelle est fortement enracinée dans un environnement, les expériences
personnelles et les croyances (Ingo, 2011 : 110).
36
Des paraphrases ont également été utilisées lorsque la traduction ajoutait une langue figurée qui
n'a pas été trouvée dans la langue source. Par exemple le n° 19 : « (…) låter sig uppslukas av
den » à comparer avec le lexème de la langue source « (…) jusqu’à s’y perdre » montre
comment une paraphrase dans le texte cible transmet une sensation d’un sentiment plus fort que
le lexème dans le texte source. Ingo estime que l'idéal est de trouver un mot dans la traduction
qui correspond émotionnellement à la langue source (Ingo, 2011 : 110). Le fait que le lexème
de traduction ait une valeur émotionnelle plus forte que celui de la langue source peut avoir son
explication dans la manière dont la langue est utilisée dans la langue cible. Tegelberg (2000)
estime que la langue française avec son caractère analytique objectif crée une distance plutôt
que la proximité qui caractérise les lexèmes suédois (Tegelberg, 2000 : 196).
Notre étude traite également des lexèmes suédois sémantiquement complexes avec suffixes, ce
qui est intéressant à examiner vu les caractéristiques différentes du français et du suédois. Tout
comme nous l'avons mentionné dans le premier paragraphe de l'analyse, la langue suédoise a
de fortes caractéristiques synthétiques, qui se traduisent entre autres par un lexème avec un
suffixe. Après avoir regroupé tous les adjectifs avec des suffixes nous avons noté que les
adjectifs avec le suffixe -ig étaient les plus représentés. Un adjectif suédois avec un suffixe est
souvent sémantiquement complexe et un lexème avec un équivalent sémantique est difficile à
trouver en français (Tegelberg, 2000 : 192). D'autres lexèmes sémantiquement complexes avec
d'autres suffixes ou préfixes tels que « -lös », (exemple n° 10 « formlöst »- « sans forme », n°
26 « hopplösa »- « lamentables »,) « full- » (exemple n° 27« fulländade » - « parfaites ») et des
adjectifs sémantiquement complexes composés ont également été trouvés (par exemple n° 6-9
et n° 32-34). Tous ont été traduits d'un lexème français plus général qui dépend d'un contexte
pour exprimer une signification spécifique, à un seul lexème suédois sémantiquement
complexe.
Dans l'avenir, il serait intéressant de compléter cette étude des adjectifs traduits du français au
suédois dans L'Amant en comparant les adjectifs traduits dans l'une des œuvres d’Honoré de
Balzac (1799-1850), puisque les deux auteurs diffèrent stylistiquement. Balzac, qui a souvent
un langage descriptif, brodé et détaillé, diffère de Duras dont l'expression est plus concise, claire
et distincte.
37
6. Références bibliographiques
Aronsson, M. (2015) « Traduire dit-elle » : Marguerite Duras en traduction suédoise (1947-
2013). In : Cedergren, M. et Briens, S. (eds) Méditations interculturelles entre la France et la
Suède. Trajectoires et circulations de 1945 à nos jours. P 141-158. Stockholm : Stockholm
University Press.
Axelsson, M. (2011) En kat ved navn pluskvamperfektum : En jämförande studie av de
skandinaviska översättningarna av L’élégance du hérisson. Mémoire de Master. Tolk- och
översättarinstitutet, Stockholms universitet.
Ingo, R. (1991) Från källspråk till målspråk. Introduktion i översättningsvetenskap. Lund :
Studentlitteratur.
Ingo, R. (2011) Konsten att översätta. Lund: Studentlitteratur.
Le grand Robert de la langue française
https://grandrobert.lerobert.com/robert.asp [consulté le 27 novembre 2020].
Le petit Robert de la langue française (1984). Paris : Le Robert.
Lindqvist, Y. (2004) Analysmodell för översatta texter för examensarbetet på
översättarutbildningen. Stockholm: Stockholms Universitet.
Munday, J. (2008) Introducing Translation Studies. London/ New York : Routledge.
Newmark, P. (1988) A textbook of translation. Hemel Hempstead Hertfordshire : Prentice Hall
International.
Nordstedts. (2012) Fransk ordbok , Falun : Nordstedts förlagsgrupp AB.
Rey, A. et Chantreau, S. (2007) Dictionnaire des expressions et locutions, Paris : Le Robert.
Tegelberg, E. (2000) Kontrastiv lexikologi i praktiken. Lund: Studentlitteratur.
38
Vinay, J-P. et Darbelnet, J. (1958/1977). Stylistique comparée du français et de l’anglais.
Paris : Didier.
7. Annexes 7.1. Glossaire
Action explicite : De nouveaux mots sont ajoutés sans nouvelle information (Ingo, 2011 : 123).
Action implicite : Des mots ont été supprimés mais l'information demeure. (Ingo, 2011 :123).
Ajouts sémantiques : nouveaux composants de signification qui sont ajoutés en plus de ceux
trouvés dans le texte source. Peut être motivé pour créer un équilibre dans la langue cible (Ingo,
2011 : 123).
Complexité sémantique élevée : Des lexèmes avec des composants de signification
spécifiques.
Composants sémantiques - Nuances de sens.
Connotation : Association subjective à un mot (Tegelberg, 2000 : 9) qui évoque des émotions
(Ingo 2011 : 109).
Dénotation : Signification de base qui est plus neutre que la connotation.
Explicite : Quelque chose qui est clarifié, par opposition à implicite.
Équivalence : Conformité, mais on peut utiliser un style et une structure différents pour
exprimer ce conformité (Ingo. 1991 : 182).
Faible complexité sémantique : Des lexèmes sans beaucoup de composants significatifs.
Lexical : Propriétés au niveau du mot.
39
Modulation - Variation d'un message vu d'un autre point de vue (Ingo 1991: 181).
Paraphrase : « Développement explicatif d’un texte. Expression de plusieurs mots synonyme
d’un mot » (Le Petit Robert 1984). Dans cette étude ; la réécriture d’un lexème vise à atteindre
l’équivalence.
Pragmatique : Utilisation du langage, langage comme moyen de communication, comment
une opinion est perçue (Tegelberg, 2000 : 11).
Regroupement synthétique – Expression de deux ou plusieurs mots d’une complexité
sémantique faible traduite en un seul mot complexe qui peut transmettre toutes les unités de
sens contenues dans l'expression multi-mots dans la langue source.
Regroupement analytique : Dans notre étude le regroupement analytique signifie un
regroupement d’un seul mot, soit sémantiquement élevé soit sémantiquement plus général dans
la langue source traduite à la langue cible avec plusieurs mots pour obtenir la même
signification ou une signification plus élevée dans la langue cible.
Selon Ingo : Regroupement d’un seul mot avec un complexité sémantique élevé du texte source
où les éléments de signification sont séparés pour les répartir entre plusieurs mots différents
avec un complexité sémantique général de la langue cible (Ingo 1991 : 186-187).
Sémantique : « Étude du langage considéré du point de vue du sens » (Le Petit Robert 1984).
Sème : Signification partielle.
Texte cible : Le texte traduit.
Texte source : Le texte original sur lequel la traduction est basée.
Transposition - ici - traduction d'un matériel textuel qui implique un changement de classe de
mots mais n'implique pas de changement de sens (Ingo, 1991 : 180).
40
7.2. Exemples supplémentaires Exemples supplémentaires de regroupement synthétique
a/ La façon qu’a ce frère aîné de se taire et d’ignorer l’existence de mon amant
procède d’une telle conviction qu’elle en est exemplaire (p. 63).
Det sätt på vilket min äldre bror tiger och ignorerar min älskares existens är
sprunget ur en sådan övertygelse att det blir förebildligt (s. 54).
b/ L’histoire d’une toute petite partie de ma jeunesse je l’ai plus ou moins écrite déjà,
enfin je veux dire, de quoi l’apercevoir, je parle de celle-ci justement, de celle de la
traversée du fleuve (p.14).
Historien om en mycket liten del av min ungdom har jag redan mer eller mindre
beskrivit, det vill säga, tillräckligt för att låta den skymta, jag menar just den här,
historien om färden (s. 11).
c/ C’était quelqu’un de sincère (p. 82)
Han var en uppriktig människa (s. 70).
d/ Des sociétés de hasard se formaient (…) (p. 127).
Där bildades tillfälliga sällskap (…) (s. 109).
e/ À ses traits tirés, à un certain désordre de sa tenue, à la somnolence de son regard, je
sais qu’il fait chaud, qu’elle est exténuée, qu’elle s’ennuie (p.21).
På hennes trötta drag, på en viss oordning i hennes klädsel, på den sömndruckna blicken
ser jag att det är varmt, att hon är utmattad, att hon leds (s.17).
Exemples supplémentaires de regroupement analytique
f/ Ce que je fais ici est différent, et pareil (p.14).
Vad jag gör här är annorlunda, och samma sak (s. 11).
41
g/ Elle est de ce bistre que prend la soie naturelle à l’usage (p.18).
Den har den rostbruna skiftningen som råsiden får efter lång användning (s.15).
h/ Non seulement elle admet cette pitrerie, cette inconvenance (p.32).
Inte bara så att hon tillåter detta clowneri, detta brott mot all konvenans (s.27).
i/ (…) les vieilles chiqueuses de bétel des places arrière(…) (p.43).
(…) de gamla gummorna som tuggade betel på platserna längst bak (…) (s. 37).
j/ (…) surtout cette population pauvre (…) (p.59).
(…) i synnerhet dessa fattiga människor (…) (s, 51).
k/ Devait la croire inintelligible, incommunicable à quiconque ne connaissait pas son fils
Comme elle le connaissait (…) (p. 94).
Måste ha trott det omöjligt att förstå, omöjligt att förmedla till någon som inte kände
hennes son som hon kände honom (…) (s. 81).
Exemples supplémentaires d’un seul lexème avec une faible complexité sémantique dans le
texte source, traduit en un seul lexème correspondant avec une complexité sémantique
élevée dans le texte cible.
l/ Le secondaire et puis une bonne agrégation de mathématiques (p. 11).
Först studenten sedan en ordentlig examen i matematik (s. 9).
m/ Le petit frère est devenu un petit comptable à Saigon (p.12).
Min lillebror blev en obetydlig bokhållare i Saigon (s.9).
n/ Je reconnais bien comme elle se tient mal (…) (p.21).
Så väl jag känner igen hennes ovilliga hållning (…) (s. 17).
o/ À voix basse, qui se voudrait intime, il dit qu’il aimerait bien être seul avec
moi pendant un moment (p.64).
42
Med låg röst, en röst som vill låta förtrolig, säger han att han gärna skulle
vilja vara ensam med mig en stund (s.55).
p/ Ma mère n’ignore pas ce dessin de mon frère aîné, obscure, terrifiante (p.72).
Min mor är inte okunnig om denna min storebrors avsikt, dunkel, förfärande (s.62).
q/ Le frère aîné souffre de ne pas faire librement le mal, de ne pas régenter le mal, pas
seulement ici mais partout ailleurs. Le petit frère d’assister impuissant à cette
horreur, cette disposition de son frère aîné (p. 73) .
Min äldre bror lider av att inte kunna skada så mycket han vill, inte ha makt att skada
inte bara här men överallt. Min lillebror lider av att maktlös bevittna denna ohyggliga
vilja hos sin äldre bror (s. 62).
r/ Il discerne de moins en moins clairement les limites de ce corps, celui-ci n’est pas
comme les autres, il n’est pas fini, dans la chambre il grandit encore (…) (p. 117).
Han urskiljer allt mindre klart var gränserna går för denna kropp, den är inte som andra,
Den är inte avgränsad, i rummet växer den fortfarande (…) (s. 100).
Exemples supplémentaires d’un seul lexème avec une complexité sémantique élevé dans le
texte source, traduit en un seul lexème correspondant avec une complexité sémantique faible
dans le texte cible.
s/ Je suis la préférée de sa vie (p.76).
Jag är det viktigaste i hans liv (s.65).