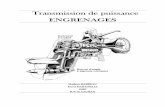Une puissance un peu materielle
Transcript of Une puissance un peu materielle
1
« Une puissance un peu matérielle » : lectures de Balzac dans Jean Santeuil
Dans le premier roman inachevé de Proust, trois modèles littéraires occupent de
façon évidente le devant de la scène et relèguent au second plan toute autre trace et
présence. Il s’agit du modèle stendhalien, exploité surtout pour l’analyse
psychologique du phénomène amoureux1, du modèle flaubertien de L’Éducation
sentimentale2 et de la voix d’auteur à la George Eliot, qui, en interrogeant et en
apostrophant sans cesse le lecteur, l’implique activement dans une réflexion paisible
sur le destin historique et moral des personnages3. Dans un tel contexte, Balzac ne
peut que jouer un rôle secondaire ; rôle déjà signalé – Annick Bouillaguet l’a
pertinemment souligné 4– par un détail tout autre qu’indifférent dans le récit-cadre
introduisant la narration. Avec la plage bretonne de Beg-Meil en toile de fond,
l’écrivain C. (ou B.), le futur auteur de Jean Santeuil, est présenté dans le récit-cadre ;
le narrateur anonyme et son ami le consultent comme une sorte d’oracle littéraire.
Voulant tirer le célèbre romancier de sa discrétion naturelle et le pousser à formuler
des jugements critiques significatifs, les deux jeunes gens lui montrent les volumes
qu’ils ont emportés à la plage, pour les lire dans les dunes. Reflétant une prédilection
profonde et constante de Proust, le narrateur a choisi La Chartreuse de Parme ; son
ami, personnage anodin aux traits plutôt vagues, Le Curé de village de Balzac.
« Balzac se voit ainsi relégué aux mains d'une comparse 5», commente Bouillaguet ;
c’est là le premier indice du destin qu’il connaîtra dans les pages de Jean Santeuil,
beaucoup moins marquées que celles de Contre Sainte-Beuve par la réflexion sur le
style et l’esthétique de La Comédie humaine.
1 Voir Alma Saraydar, Proust disciple de Stendhal. Les avant-textes d’”Un amour de Swann” dans “Jean Santeuil”, Paris, Minard, 1980. 2 Voir Annick Bouillaguet, Proust lecteur de Balzac et de Flaubert. L’imitation cryptée, Paris, Champion, 2000, p.92. 3 Voir Emily Eells, “George Eliot et Proust”, Bulletin d’Informations Proustiennes (BIP) n° 24, p.21-30. 4 A. Bouillaguet, op. cit., p. 92-93. 5 Ibid., p.93.
2
Pourtant les années de Jean Santeuil – de septembre 1895 aux alentours de
19006 – constituent une étape décisive dans ce que l’on pourrait appeler l’« éducation
balzacienne » de Proust, une approche progressive de l’imaginaire et de la technique
de celui qu’en 1878 Paul Bourget avait défini « notre père à tous 7». L’auteur de la
Comédie humaine était absent dans l’horizon de Proust adolescent, lycéen à
Condorcet. C’est ce qu’atteste la correspondance du futur romancier, ses premiers
essais d’adolescent ainsi que les pages qui, en 1895-96, convergeront dans Les
Plaisirs et les Jours. Cette situation se modifie toutefois en 1894 à cause de facteurs
concomitants. A l’École des Sciences politiques, il y a parmi les professeurs dont
Proust suit les cours avec le plus grand intérêt, l’historien Albert Sorel, balzacien
fervent qui, justement dans cette période, fait paraître des pages importantes sur Une
ténébreuse affaire dans ses Lectures historiques8. Dans d’autres milieux, à
l’enthousiasme communicatif de Sorel répondent en écho des connaissances,
nouvelles et prestigieuses, du jeune Marcel : Alphonse Daudet, avec ses fils Léon et
Lucien ; la comtesse Aloyse de Brantes, confidente pour les progrès dans la rédaction
des Plaisirs et les Jours et propriétaire de ce château du Fresne que Proust – à tort ou
à raison – imagine très semblable à ceux que Balzac a fréquentés et décrits 9 ; et
encore l’illustre cousin de la comtesse, le poète dandy Robert de Montesquiou, dont
l’érudition inspirera l’érudition non moins fétichiste et esthétisante du baron de
Charlus. Par ailleurs, un événement important intervient à la même époque, qui
alimente l’attention croissante d’ intellectuels, critiques, écrivains et nobles dames à
la mode envers Balzac : la publication des lettres, jusqu’alors quasiment inédites, de
Balzac à madame Hanska. Lorsqu’en 1876, le tome XXIV des Œuvres complètes de
Balzac, parues chez Lévy, avait offert pour la première fois au public un recueil
organisé des lettres du romancier, la correspondance avec « l’Étrangère » tenait en
6 Voir Philip Kolb, “Le premier roman de Proust” , Saggi e ricerche di letteratura francese, vol. IV, Torino, Bottega d’Erasmo, 1963, p. 217-277. 7 Dans la Préface de son poème Edel, Paris, Lemerre, 1878, p. 4. 8 Albert Sorel, Lectures historiques, Paris, Plon, 1894, p. 136, 141, 150-1. 9 Voir Marcel Proust, Correspondance, Texte établi, présenté et annoté par P. Kolb (abrégé désormais: Corr.), t. II, Paris, Plon, 1976, p.459.
3
trente-cinq lettres : manifestement gêné, l’éditeur expliquait dans une note que le
reste de cet extraordinaire monument épistolaire avait été détruit à Moscou, lors d’un
incendie10. Le soi-disant incendie n’était en fait qu’une excuse improvisée pour
justifier les hésitations de la veuve du romancier, fort peu désireuse de dévoiler quels
avaient été ses rapports avec Balzac alors que son premier mari, le comte Hanski,
était lui, bien vivant. Après la mort d’Ève de Balzac en 1882, Charles Spoelboerch de
Lovenjoul s’était patiemment consacré à déchiffrer et à classer les lettres de Balzac à
sa bien-aimée. Réunies, celles-ci constituaient une sorte d’autobiographie singulière
et émouvante. Une première série de textes, recopiés et épurés des « variantes »
fantaisistes que la destinataire n’avait pas hésité à introduire pour « améliorer » la
prose de Balzac là où bon lui semblait et rendre encore plus hyperboliques les
compliments que lui adressait son futur mari, ont paru dans la Revue de Paris entre le
1er février 1894 et le 1er mars 189511. Ces lettres passionnées – que même madame
Proust lit à ce moment-là12 -modifient l’image que le public se fait de l’auteur de la
Comédie humaine ; les pages biographiques très réservées de Laure de Surville et de
Théophile Gautier l’avaient jusqu’alors présenté comme un ascète d’une chasteté
quasiment superstitieuse13. Un Balzac plus réel et moins mythique sort de l’ombre,
tandis que l’intérêt pour son œuvre et sa vie ne cesse de se répandre et de se
renforcer.
En parfaite harmonie avec cette tendance, de 1895 à 97, Proust multiplie les
lectures de Balzac. Lorsque le 6 septembre 1895, il s’installe à Beg-Meil avec
Reynaldo Hahn, pour un séjour qui fournira de nombreux détails au récit-cadre de
Jean Santeuil, il a emporté Splendeurs et misères des courtisanes, un roman qu’il
juge – d’après ce qu’il écrit à son ami Robert de Billy – « stupide14 » ; ce qui n’est
pas en désaccord avec l’esprit d’une époque qui tend à mésestimer le Balzac 10 Voir Honoré de Balzac, Correspondance, Paris, Calmann-Lévy, 1876, p. 217. 11 1er et 15 février, 1er mars et 1er décembre 1894; 1er janvier, 1er février et 1er mars 1895. 12 Voir Corr., t. II, p.135. 13 Sur la légende de la chasteté de Balzac insistait aussi Paul Flat dans ses Essais sur Balzac , Paris, Plon, 1893. Voir David Bellos, Balzac criticism in France 1850-1900 The Making of a Reputation, Oxford, Clarendon Press, 1976, p. 169-171.
4
« romantique » au profit du « réaliste » et à ne voir dans les vicissitudes de Vautrin
que des « histoires noires de forçats étranges 15». Cette lecture est bientôt suivie par
celle de La Cousine Bette, où Proust trouve « des choses étonnantes» ; les
observations de Sainte-Beuve sur cet ouvrage le frappent ; c’est la première fois16. Il
les discutera dans Contre Sainte-Beuve. D’autre part, la dure critique qu’il émet en
septembre 95 sur Splendeurs et misères n’est pas définitive ; un an plus tard, madame
Proust a lu le roman et confie à Marcel, en septembre 96 : « la mort de Rubempré m'a
touchée moins que celle d'Esther 17». Une comparaison qui suppose une certaine
familiarité avec les personnages et quelques discussions préalables entre la mère et
son fils, apparemment captivés par un récit « stupide » peut-être, dans son
invraisemblance mélodramatique, mais certainement très prenant. Dans le dialogue
épistolaire entre Marcel et sa mère, toujours teinté d’humour et de complicité
intellectuelle, une nouvelle référence balzacienne affleure quelque temps plus tard, le
22 octobre 1896 : Marcel, qui s’est réfugié à l’Hôtel de France et d’Angleterre à
Fontainebleau pour travailler en paix sur Jean Santeuil, a perdu (ou s’est fait voler)
plus de trente francs ; il se décrit à sa mère « courant comme le père Grandet après
son argent 18». Balzac est une présence centrale durant le séjour à Fontainebleau, très
marqué par les conseils de lecture de Léon Daudet : Proust a demandé à sa mère de
lui envoyer Le Curé de village – qui, nous l’avons vu, figurera dans le récit-cadre de
Jean Santeuil et sur lequel Marcel voudra connaître, quelques mois plus tard,
l’opinion de Robert de Montesquiou19 –, Un ménage de garçon en province – titre
14 Corr., t.I, p.426. 15 Émile Faguet, Balzac, dans Dix-neuvième siècle. Études littéraires, Paris, Lecène et Oudin, 1887, p.415. En 1894, on pouvait également lire dans l’Histoire de la littérature française de Gustave Lanson qui venait de paraître chez Hachette: “Balzac est déplorablement romanesque: la moitié de son œuvre , appartient au bas romantisme, par les invraisemblables ou insipides fictions qu’il développe sérieusement ou tragiquement. Mélodrame, roman-feuilleton, tous les pires mots sont trop doux pour caractériser l’écœurante extravagance des intrigues que combine lourdement la fantaisie de Balzac.” (p. 988) 16 Voir Corr., t.II, p.118-9. 17 Ibid., p.133. 18 Ibid., p.147. 19 Ibid., p.170.
5
original de La Rabouilleuse, l’une des œuvres de Balzac les plus admirées par Taine
et la critique du XIXe siècle en général – et Les Chouans20. Il voudrait lire également
La Vieille Fille, qui aura une place remarquable dans Contre Sainte-Beuve, mais
madame Proust a sans doute eu quelques difficultés à se le procurer et ne parvient pas
à l’ajouter au colis postal qu’elle expédie le 23 octobre. L’été suivant, l’imprégnation
balzacienne a fait des progrès évidents. De Kreuznach, où il a accompagné sa mère
en villégiature, Proust écrit à Lucien Daudet :
Si vous vouliez me conseiller de beaux Balzac (dans le genre Vieille Fille et Curé de Tours et Cabinet des Antiques – ou dans le genre Goriot et Bette – je suis en train de lire La Muse du Département) vous me feriez bien plaisir21.
Les deux « genres » auxquels Proust fait allusion semblent désigner d’une part
les romans portant sur l’aristocratie de province où les aspects ironiques et
caricaturaux sont très accentués, d’autre part les grandes scènes de la vie privée ou de
la vie parisienne, telles que Le Père Goriot et La Cousine Bette que, dans le sillage de
Taine, on considérait à l’époque comme les réalisations artistiques les plus parfaites
de Balzac. C’est encore en fonction de Jean Santeuil que Proust projette à l’époque
d’augmenter et d’approfondir ses connaissances quant à la Comédie humaine. Cela
ressort explicitement d’une lettre à la comtesse de Brantes, datant du 1er septembre
1897, où Proust, toujours en villégiature à Kreuznach, se console de ne pouvoir
rejoindre son amie à Marienbad avec des lectures et des citations de Balzac :
Hélas Marienbad est à 18 heures de Creusnach et il ne me reste d'autre espoir que de pouvoir un jour écrire comme Balzac. « Oh ! si vous saviez ce que c'est que la Touraine. On y oublie tout... Ma maison sise près de Saint-Cyr-sur-Loire à mi-côte, près d'un fleuve ravissant, couverte de fleurs, de chèvrefeuilles et d'où je vois des paysages mille fois plus beaux que ceux dont ces gredins de voyageurs embêtent leurs lecteurs. » (Lettre à Victor Ratier datée de la Grenadière) J'ai lu parce que vous m'aviez dit l'aimer La Duchesse de Langeais, mais je ne l'ai pas trouvé si bien. Et je viens de finir Une ténébreuse affaire. J'ai trouvé dans Gobseck de ces portraits de vieux nobles comme il m'en faut pour mon
20 Ibid., p. 144. 21 Ibid., p. 211.
6
roman et pour lequel je glane des mots « à la Aimery de La Rochefoucauld », et des traits de caractère, bien entendu non pour les copier mais pour m'en inspirer22. Proust a bien sûr emporté le volume XXIV des Œuvres complètes de Balzac de
1876, d’où il tire la citation de la lettre de l’été 1830 à Victor Ratier avec la
description de la Grenadière. La rédaction du passage de Jean Santeuil que l’éditeur a
intitulé « Dans la bibliothèque de Réveillon.- Réflexions à propos de Balzac » est
probablement toute proche ; ce dernier s’inspire en effet de quelques lieux cités dans
la correspondance de Balzac et mentionne également la Grenadière. Avec le temps, la
délusion éprouvée en lisant La Duchesse de Langeais cédera la place à un jugement
très différent, que Proust exprime dans Contre Sainte-Beuve23. Enfin, La lecture
d’Une ténébreuse affaire introduit le jeune écrivain dans l’atelier du Balzac historien,
qu’Albert Sorel admire sans réserve pour sa capacité à réssusciter les menus détails
de la vie publique et privée à l’époque napoléonienne. Pour qu’Une ténébreuse
affaire se révèle dans toute sa portée aux yeux de Proust, il faudra toutefois – on le
verra – que la France traverse un moment tout aussi « ténébreux » que celui que
décrit Balzac : les phases les plus dramatiques et mouvementées de l’affaire Dreyfus,
de janvier 1898 à septembre 1899.
Naturellement, les références disséminées dans la correspondance n’épuisent pas
l’ensemble des lectures balzaciennes accomplies par Proust durant la seconde moitié
des années 90. On trouve par exemple cités dans les pages de Jean Santeuil, Le Lys
dans la vallée, Le Médecin de campagne24, et aussi Les Illusions perdues25, dont nous
ignorons à quel moment il a été lu par Proust. Citée implicitement, apparaît aussi
22 Ibid., p. 214. 23 Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve précédé de Pastiches et mélanges et suivi d’Essais et articles, édition établie par Pierre Clarac avec la collaboration d’Yves Sandre, Paris, Gallimard, 1971 (abrégé désormais CSB), p.289. 24 M. Proust, Jean Santeuil, précédé de Les Plaisirs et les Jours , Édition établie par Pierre Clarac avec la collaboration d’Yves Sandre, Paris, Gallimard,1971 (abrégé désormais JS), p.488. 25 Ibid., p. 427-430. Sur la présence d’Illusions perdues dans la Recherche, voir Francine Goujon, “Morel ou la dernière incarnation de Lucien”, BIP, n°32, 2001-02, p.41-62.
7
Étude de femme26. Ce qui est certain, c’est que Proust opte plutôt, dans des choix qui
ne sont pas toujours conventionnels, pour les Études de mœurs et néglige les Études
analytiques – d’ailleurs assez peu fréquentées à l’époque – et les Études
philosophiques. Le Balzac penseur et théoricien, cher à Barbey d’Aurevilly et faisant
l’objet d’un intérêt croissant à la fin du XIXe siècle, semble laisser Proust totalement
indifférent ; son attention se concentre exclusivement sur le témoin de la vie
aristocratique, sur le romancier des phénomènes sociaux en voie d’extinction (un
certain traditionalisme extrême de la noblesse, par exemple) ou en transformation
rapide (le snobisme). Ce qui explique que, ni dans la correspondance de Proust ni
dans Jean Santeuil, nous ne retrouvions les deux grandes polémiques qui se sont
abattues sur la mémoire de Balzac dans les deux dernières années du siècle : au sujet
du Balzac de Rodin et sur les célébrations du centenaire dans la ville natale du
romancier, Tours. La première affaire a agité le monde des artistes au printemps
1898. Rodin expose au Salon la statue de Balzac qui lui a été commandée sept ans
auparavant par la Société des Gens de Lettres ; malgré l‘enthousiasme de Monet,
Cézanne, Mallarmé, le public est convaincu qu’il se trouve face à une ébauche
informe et considère avec défiance une œuvre que même la Société des Gens de
Lettres finalement refuse27. Le second scandale a un caractère plus ouvertement
politique. Le comité chargé de célébrer le centenaire de Balzac a choisi Ferdinand
Brunetière comme orateur à envoyer à Tours, en mai 99 ; c’est l’un des dirigeants de
la Ligue de la Patrie française, nationaliste et anti-dreyfusarde. La municipalité
socialiste de Tours refuse de contribuer financièrement à la manifestation et même
d’accueillir, dans son théâtre, la mise en scène de Mercadet, que la Comédie
26 “Si je pouvais avoir cela, dit Balzac dans une de ses nouvelles, je n’écrirais pas de romans, j’en ferais.” (JS, p.490). Dans cette phrase, au début du fragment L’art et la vie, Proust fait allusion, à un passage d’Étude de femme: “Oh! avoir les pieds sur la barre polie qui réunit les deux griffons d’un garde-cendre, et penser à ses amours quand on se lève et qu’on est en robe de chambre, est chose si délicieuse, que je regrette infiniment de n’avoir ni maîtresse, ni chenets, ni robe de chambre. Quand j’aurai tout cela je ne raconterai pas mes observations, j’en profiterai.” H. de Balzac, Étude de femme; la Comédie Humaine, édition publiée sous la direction de Pierre-Georges Castex (abrégé désormais CH), t. II, Paris, Gallimard, 1976, p.176. 27 Voir Antoinette Le Normand-Romain et alii, 1898: le Balzac de Rodin, Paris, Éditions du Musée Rodin, 1998.
8
française a préparée pour l’occasion28. Continuellement cité dans les journaux, brandi
– non sans raisons – par la droite comme par la gauche, le Balzac qui suscite d’aussi
violentes batailles n’est pas celui qui peut passionner Proust : il est otage de factions
idéologiques opposées, aussi insensible l’une que l’autre à la vérité artistique de son
œuvre, la seule qui compte pour le futur auteur de la Recherche.
La première apparition de Balzac dans les pages de Jean Santeuil date de mars
96. Comme l’a établi Philip Kolb, c’est alors que Proust rédige le récit-cadre du
roman qu’il a commencé au mois de septembre29. Laissant de côté le récit de
l’enfance et de la première adolescence de Jean Santeuil, dont il a déjà écrit plus de
cent pages, Proust met en scène dans le récit-cadre un jeune narrateur qui, en
compagnie d’un ami, rencontre le romancier C. (ou B.) à Beg-Meil en Bretagne, en
1895. Quelques années plus tard, l’écrivain C. (ou B.) sur le point de mourir fait
appeler le narrateur et son ami, pour leur remettre le manuscrit d’un roman
autobiographique, à la troisième personne, dont le héros porte le nom de Jean
Santeuil. L’imminence de la mort révèle une parenté évidente entre C. (ou B.) et les
héros de deux récits datant de 1894 qui convergeront dans Les Plaisirs et les Jours :
La Mort de Baldassare Silvande et La Fin de la jalousie. Les traits autobiographiques
que Proust attribue au romancier sont tout aussi manifestes : il lui fait évoquer les
grands tourments de sa vie – la jalousie et l’asthme – dont il a été miraculeusement
guéri, respectivement par l’oubli et l’approche de la mort.
C’est donc à un véritable alter ego – partagé, de plus, entre la tentation du snobisme
et les élans vivifiants de l’inspiration – que Proust confie, dans le récit-cadre de son
premier roman, la charge de commenter Le Curé de village et de situer Balzac sur la
scène littéraire, en définissant son public avec une attention sociologique et en faisant
allusion à un jugement d’ensemble sur son œuvre.
28 Voir D. Bellos, op. cit., p.176-184; Stéphane Vachon, Balzac, Collection Mémoire de la critique, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1999, p.46-48. 29 Voir P.Kolb, art. cit.; Yasué Kato, “ Le cahier disparu de Jean Santeuil: les esquisses de la préface du roman inachevé”, BIP, n° 27, 1996, p. 7-15.
9
Pour ce qui est du Curé de village, apparemment, C. (ou B.) se limite à répondre
à la sollicitation de l’ami du narrateur par un bref résumé :
Au bout d'un instant mon ami lui montra Le Curé de village. « Est-ce que vous avez lu cela, lui dit-il. – Ah ! oui, autrefois, c'est bien beau n'est-ce pas ? Le roman commençait par des crimes épouvantables dans le fond de la ville, et au fur et à mesure l'âme des personnages s'élevait, montait les pentes, s'arrêtait au village et finissait à une grande altitude dans une sorte de campagne idyllique à la Fénelon où les crimes de l'héroïne étaient pardonnés, tandis qu'elle assainissait le pays par des défrichements. Mais je ne me rappelle plus bien. » 30 Un résumé à la fois suggestif et extrêmement partiel. L’atmosphère du roman et
sa dynamique sont placées en avant, alors que l’intrigue, les physionomies singulières
des personnages et toute l’épaisseur de l’analyse psychologique et sociale, qui va des
secrets de l’amour coupable de Véronique à la tragédie de la peine de mort examinée
dans ses détails les plus atroces, sont délibérément laissées dans l’ombre. L’accent est
mis de façon exclusive sur l’organisation de l’espace de narration, considéré comme
une transposition, en termes tangibles, du destin de l’héroïne. C’est une lecture très
proche de celle du Rouge et le Noir et de La Chartreuse de Parme, que Proust
ébauchera dans une note à la date incertaine 31 avant de la reprendre, presque
identique, aussi bien dans La Prisonnière32 que dans l’essai de 1920, Pour un ami
(remarques sur le style) :
[…] Si l'on considère comme faisant partie du style cette grande ossature inconsciente que recouvre l'assemblage voulu des idées, elle existe chez Stendhal. Quel plaisir j'aurais à montrer que, chaque fois que Julien Sorel ou Fabrice quittent les vains soucis pour vivre d'une vie désintéressée et voluptueuse, ils se trouvent toujours dans un lieu élevé (que ce soit la prison de Fabrice ou celle de Julien, dans l'observatoire de l'abbé Blanès)33.
30 JS, p.199. 31 Voir CSB, p. 654. 32 Voir M. Proust, La Prisonnière; À la recherche du temps perdu, Édition publiée sous la direction de Jean-Yves Tadié (abrégé désormais RTP), Paris, Gallimard, t. III, 1988, p. 879. 33 CSB, p.611.
10
En 1896, l’écrivain C. (ou B.) ne dispose certes pas, contrairement au Proust de
la maturité, d’une théorie personnelle du style ni de la méthode critique qui permettra
au narrateur de caractériser, dans La Prisonnière, le « monde unique » de Barbey
d’Aurevilly, de Thomas Hardy, de Dostoïevsky, en fonction d’images récurrentes et
de parallélismes obsessifs34. Il a pourtant déjà lu Le Curé de village, non pas pour en
assimiler – comme Bourget ou Barbey – la haute leçon morale et religieuse ni pour
évaluer la vraisemblance historique d’un « document sur la nature humaine » –
comme Taine, Faguet et Brunetière – mais plutôt pour saisir l’organisation
symbolique de l’espace, en technicien de la narration, attentif aux correspondances
instaurées par Balzac entre la réalité matérielle et la réalité spirituelle.
Ce que ce résumé néglige volontairement est tout aussi significatif que ce qui en
ressort ; la lecture de C. (ou B.) ne tient pas compte de la nature composite, hybride,
impure du texte balzacien, où l’intrigue à sensation d’un feuilleton policier est
juxtaposée aux savantes analyses d’un roman de mœurs attentif à la vie privée ainsi
qu’à de longues digressions politico-philisophiques, des intrusions parmi les plus
lourdes de toute la Comédie humaine. Toute trace d’hétérogénéité a disparu de la
version que C. (ou B.) donne du roman : la dynamique ascensionnelle que Balzac a
imprimé à la progression des événements semble conférer à l’ensemble un caractère
harmonieux et unitaire. Nous nous retrouvons face à un Balzac épuré de toutes ses
scories, de tout élément gênant et irrégulier. Le motif stendhalien de l’altitude semble
l’ennoblir, le racheter des accusations de matérialisme et de vulgarité qui
accompagnaient constamment son nom à l’époque ; accusations consacrées par
l’autorité de Sainte-Beuve et capillairement répandues par des œuvres extrêmement
populaires comme le Grand Dictionnaire Universel de Pierre Larousse et l’Histoire
de la littérature française de Gustave Lanson.
Le romancier C. (ou B.) « sauve » Le Curé de village en l’adaptant, par une
transposition attentive, au goût d’une génération conditionnée par l’esthétique
flaubertienne ; ce sauvetage ne peut toutefois s’étendre à l’ensemble de la Comédie
34 Voir M. Proust, La Prisonnière; RTP, t.III, p. 877-883.
11
humaine. L’œuvre de Balzac, massive et monstrueuse, résiste à tous les escamotages.
C’est donc bien « dans son ensemble », en valorisant ce « retour des personnages »
que Sainte-Beuve refusait, que C. (ou B.) la proposera à ses jeunes interlocuteurs. La
dynamique interne du Curé de village est remplacée par celle des personnages qui
circulent inlassablement d’un roman à l’autre :
« Pourriez-vous encore nous en parler ? demanda d'un ton de voix timide et pressant mon ami. – Non, je vous dis, je ne me rappelle plus bien. Moi, je ne peux pas beaucoup vous parler de Balzac, je ne le connais pas bien. Et vous savez, lui, il faut bien le connaître. Cela a l'air d'une naïveté : les gens à qui on demande ce qu'il faut lire de Balzac, disent : "Tout". Hé bien, c'est vrai, la beauté n'est pas dans un livre, elle est dans l'ensemble. Chaque roman lu séparément n'est pas bien bon, et pourtant les personnages qu'on retrouve dans tous sont vraiment très bien. C'est curieux, n'est-ce pas ? Je ne m'explique pas bien cela35.
Grâce à l’apparition furtive d’une catégorie privilégiée de lecteurs, ceux qui
« connaissent bien » la Comédie humaine, et que des lecteurs occasionnels et
inexperts consultent, les propos de C. (ou B.) s’éloignent peu à peu de l’œuvre de
Balzac pour se focaliser sur son public. Un public formé moins de gens de lettres et
d’artistes que de personnes riches en expérience, attirées par la capacité de Balzac à
recréer la réalité, à en donner une contrefaçon parfaite :
Non, les gens qu'il faut faire parler de Balzac ce sont les gens qui le connaissent bien, je ne veux pas dire surtout les gens de lettres. Non, plutôt toute une certaine génération, vous savez, des vieux préfets, des financiers un peu liseurs autrefois, quand ils avaient [le] temps, des militaires intelligents. Tenez, le général de S. connaît admirablement Balzac. Chez la princesse de T. qui le connaît très bien, je les entends quelquefois en parler, j'aime bien les entendre comme cela. – Mais ils ne doivent pas avoir de goût en littérature, dit mon ami avec vivacité. – Mon Dieu, je ne vous dis pas, non, certainement, dit B., mais pour Balzac si, c'est comme cela, c'est une puissance, voyez-vous, seulement aussi c'est une puissance un peu matérielle ; il plaît à plus de gens et jamais il ne plaira autant aux artistes. Mais vous savez qu'ils l'aiment bien tout de même. Et
35 JS, p.199.
12
au fond c'est bien curieux, car il semble que rien ne devrait nous sembler plus bas. Car au fond, tout le temps, ce n'est pas par l'art que cela nous prend. C'est un plaisir qui n'est vraiment pas très pur. Il essaye de nous prendre comme la vie par un tas de mauvaises choses et il lui ress[emble][...] 36
Les fonctionnaires, militaires ou aristocrates, les passionnés de Balzac mis en
scène dans ce développement semblent préfigurer M. de Guermantes dans Contre
Sainte-Beuve, un exemple typique de ces lecteurs « qui ne cherchaient pas dans (les)
romans (de Balzac) une œuvre littéraire, mais de simple intérêt d’imagination et
d’observation 37» . C’est sur eux et, à un degré moindre, sur les artistes qu’agit la
« puissance » de Balzac : une expression qui est un véritable passe-partout pour la
critique de l’époque, migrant des pages de Taine à celles de Faguet et de Lanson,
jusqu’à se transformer en une sorte de mantra, un écho liturgique qui résonne d’un
bout à l’autre du monde littéraire et que l’on retrouve aussi bien sous la plume du
chroniqueur le plus obscur que sous celle de l’illustre Anatole France38. Dans
l’improvisation critique de C. (ou B.), cette « puissance un peu matérielle » semble à
l’origine d’une confusion entre l’art et la vie, à laquelle l’artiste, voué à une pureté
supérieure, devrait se soustraire. Le romanesque impur de Balzac oppose toutefois,
dès maintenant, à la pureté célébrée par les symbolistes, une fascination dont on
pressent la force irrésistible, destinée à marquer en profondeur l’esthétique d’À la
recherche du temps perdu, non sans contradictions avec la théorie qui sous-tend le
roman.
Récrire Balzac en le corrigeant et en l’adaptant au goût du jour. Si le romancier
C. (ou B.) cède à cette tentation en résumant Le Curé de village, le narrateur de Jean
Santeuil – qui devrait d’ailleurs être une émanation de C. (ou B.), même si Proust ne 36 Ibid., p.199-200. 37 CSB, p.279. 38 Dans son article du Temps du 29 mai 1887, recueilli en 1888 dans la première série de La Vie littéraire, Anatole France décrit sa réaction devant le Répertoire de la Comédie humaine de Anatole Cerbferr et Jules Christophe: “En feuilletant ce Vapereau d’un nouveau genre, je suis confondu de la puissance créatrice de Balzac “ ( C’est moi qui souligne). Et un peu plus loin: “Quand Balzac me ferait un peu peur, et si même je trouvais qu’il a parfois la pensée lourde et le
13
semble pas se le rappeler souvent – se livre à une opération en quelque sorte analogue
dans le passage, certainement postérieur, que l’éditeur a intitulé « Le Rubempré et le
Rastignac d’aujourd’hui ». Alors que le romancier de la préface travaillait au moyen
de censures et retouches non déclarées, implicites, la voix qui raconte dans « Le
Rubempré et le Rastignac d’aujourd’hui » fonde son analyse subtile du snobisme et
de l’arrivisme – occasionnée par le personnage d’Antoine Desroches, véritable
artiste de la réussite moderne – sur une dénonciation explicite et systématique de la
représentation que donne Balzac de ces phénomènes ; une représentation beaucoup
trop simpliste, à son avis. À la détermination très consciente de Rubempré dans Les
Illusions perdues, la voix oppose les sophismes de la passion qui orientent
insensiblement le snob vers le but qu’il s’est fixé ; aux calculs de l’arriviste sans
scrupules de Balzac, elle oppose le tropisme qui gouverne non seulement les actions
mais aussi les désirs les plus intimes et secrets du snob de Proust :
Le désir étant dans le snobisme comme dans l'amour le principe et non l'effet de l'admiration, il ne s'éprendra pas des duchesses parce qu'il les aura froidement jugées plus désirables que d'autres, mais il les jugera plus désirables parce qu'il en est instinctivement épris39. Cette même voix soumet ensuite à une critique tout aussi sévère la tactique –
que Balzac jugeait d’ailleurs plutôt maladroite – du jeune Rastignac qui, dans Le Père
Goriot, se lance à la conquête de l’aristocratie parisienne : on nous suggère ainsi
qu’une feinte indifférence, un désintérêt affiché, voire une certaine brusquerie ou une
attitude distante adoptée au bon moment, sont des moyens beaucoup plus efficaces
pour pénétrer dans la citadelle aristocrate que les pressions directes et insistantes des
héros balzaciens. Entraîné sur un sujet qui lui tient à cœur et sur lequel il a déjà
longuement réfléchi dans Les Plaisirs et les Jours, Proust n’hésite pas ici à
superposer sa propre version, remodelée à partir d’une psychologie plus complexe et
subtile, à des scènes archicélèbres de la Comédie humaine, qu’il évoque de mémoire, style épais, il faudrait bien encore reconnaître sa puissance.” (La Vie littéraire, Paris, Calmann-Lévy, t. I, 1926, p.140).
14
sans le moindre scrupule quant à la conformité à l’original. Son Rastignac, Antoine
Desroches, loin de vouloir dissuader Delphine de Nucingen d’aller au bal alors que
son père est à l’agonie, l’aiderait plutôt à justifier son comportement :
« Ce pauvre père, dirait-il, vous devez tâcher de faire ce qu'il vous ferait faire si vous pouviez lui demander conseil. Croyez-vous qu'il voudrait vous voir rester à pleurer, à vous faire mal, dans une chambre viciée par une respiration de malade, et manquer un des grands succès de votre vie ? D'ailleurs vous n'êtes pas assez forte pour veiller ainsi près d'un malade. Il ne faut pas abuser de ce qu'il n'a plus la force de vous le défendre, pour faire ce qui l'aurait chagriné par-dessus tout. 40» Ensuite, à la place de Lucien Rubempré, Desroches adopterait une attitude de
complicité hypocrite envers l’écrivain Nathan :
Il ne dirait pas à Nathan : « Comment pouvez-vous être si plat avec un journaliste qui ne vous vaut pas », mais « C'est presque amusant de voir les nécessités de la vie vous rapprocher d'hommes si au-dessous de vous. Mais vous avez bien raison, il le faut bien. 41» En fait, dans la scène à laquelle Proust fait allusion ici, Lucien de Rubempré ne
dit strictement rien à Nathan ; il s’en tient à un monologue intérieur :
« Me conduirais-je jamais ainsi ? faut-il donc abdiquer sa dignité ! se dit-il. Mets donc ton chapeau, Nathan ! tu as fait un beau livre et le critique n'a fait qu'un article. » Ces pensées lui fouettaient le sang dans les veines. 42 (C'est moi qui souligne) Dans le souvenir de Proust, les pensées de Lucien se sont transformées en mots ;
c’est ainsi qu’est né un texte balzacien imaginaire, très différent de celui des Illusions
perdues ; un texte dont il est particulièrement facile et gratifiant de corriger les
ingénuités, les maladresses, les grossières invraisemblances psychologiques. Encore
39 JS, p.428. 40 Ibid., p.430. 41 Ibid. 42 H. de Balzac, Les Illusions perdues; CH, t.V, p. 365.
15
une fois, comme dans le résumé du Curé de village de la préface, l’original de Balzac
a été esquivé, effacé : dans ces conditions, vouloir le récrire n’a rien de bien productif
car c’est une tentative qui n’en affronte pas vraiment l’altérité irréductible, qui ne se
l’approprie pas dans une confrontation rapprochée, dans un véritable corps à corps
dans les méandres de l’écriture, de l’énonciation, de la langue. Ce n’est que lorsque
ce corps à corps aura lieu, après une laborieuse « assimilation » de la Comédie
humaine dans toute son hétérogénéité outrageuse et singulière, que pourront naître les
pastiches balzaciens de Proust : depuis la première tentative, encore timide, de 1902,
qui ne s’aventure pas hors du terrain de la description43, jusquà la somme géniale de
1908, voire aux micro-pastiches disséminés dans la Recherche , où Annick
Bouillaguet a vu avec justesse un élément fondamental de l’esthétique proustienne44.
Dans les pages de Jean Santeuil, le fantôme de Balzac, sur lequel pèsent les
jugements négatifs de Flaubert et d’Anatole France45, est encore tenu à distance ; un
interdit de représentation pèse sur ses particularités linguistiques, ses tics, ses clichés,
sa rhétorique. C’est comme si le jeune Proust craignait une sorte de contagion. Le
pastiche marquera le dépassement d’une telle crainte et la conquête d’une poétique où
l’impureté et l’hétérogénéité de Balzac trouveront une place de plus en plus
importante au sein d’un rapport conflictuel complexe avec le modèle de Flaubert et
l’hérédité symboliste.
43 Il s’agit du début de l’article La cour aux lilas et l’atelier des roses. Le salon de Mme Madeleine Lemaire; CSB, p. 457-58. 44 A. Bouillaguet, op.cit., p. 42-52 et passim. 45 Pour ce qui concerne la correspondance de Flaubert, citée dans Jean Santeuil (p.486, 488), Proust connaissait sans aucun doute l’édition Charpentier en quatre volumes qui avait paru entre 1887 et 1893. À côté d’autres jugements plus nuancés, le t. II (1850-1854) de cette édition contenait la célèbre exlamation du 17 décembre 1852: “Quel homme eût été Balzac, s’il eût su écrire! Mais il ne lui a manqué que cela. Un artiste, après tout, n’aurait pas tant fait, n’aurait pas eu cette ampleur.” (G. Flaubert, Correspondance, Paris, Charpentier, t. II, 1889, p.157. ) Les appréciations d’Anatole France dans l’article de 1887 cité à la note 38 vont dans le même sens: “Je ne veux pas me faire plus balzacien que je ne suis. J’ai une préférence secrète pour les petits livres. Ce sont ceux-là que je reprends sans cesse. Mais, quand Balzac me ferait un peu peur, et si même je trouvais qu’il a parfois la pensée lourde et le style épais, il faudrait bien encore reconnaître sa puissance. C’est un dieu. Reprochez-lui après cela d’être quelquefois grossier: ses fidèles vous répondront qu’il ne faut pas être trop délicat pour créer un monde et que les dégoûtés n’en viendraient jamais à bout.” (La Vie littéraire, t. I, 1926, p.140)
16
Souvent évoqué, mais filtré par des citations tendancieuses, déformées,
instrumentalisées, le Balzac de Jean Santeuil est une présence aux contours
incertains, aux traits imprécis. Cette constatation est confirmée par le long passage
que l’éditeur a intitulé « Dans la bibliothèque de Réveillon. – Réflexions à propos de
Balzac46 ». Il s’agit d’un développement qui s’inspire de la correspondance de Balzac
(le volume XXIV des Œuvres complètes, déjà cité) pour réfléchir sur les rapports
entre l’écriture et la conversation dans la vie quotidienne des grands écrivains, sur le
rôle de la sensualité et du snobisme dans leur existence47, sur le manque de sincérité
de bon nombre de leurs lettres. Balzac est exclu pour ce qui est des considérations sur
le manque de sincérité épistolaire : les exemples sont tirés d’écrivains plus proches de
Proust (Flaubert, Daudet, Renan) et se terminent par une troublante allusion
autobiographique. Il est cité, par contre, sur les autres sujets, selon un processus qui
revient. La curiosité aiguisée par le nom du lieu où une lettre a été écrite ou par un
passage qui le frappe particulièrement, Proust bâtit autour de cela une intrigue toute
en conjectures, où l’auteur de La Comédie humaine interprète le personnage typique
de l’écrivain avec ses moments de distraction, la sensualité qui ne l’éloigne pas de la
création artistique et la tentation surmontée du snobisme. Son discours a toutefois une
focalisation au plus haut point instable et contradictoire. Aux séjours à la campagne
de Balzac – dont Proust semble ne pas savoir grand-chose – se superposent, sous le
voile d’une forme impersonnelle qui alterne avec un « nous » plus transparent, ceux
du narrateur, qui dissimule mal une certaine urgence de se confier à ses propres
lecteurs. Lorsque les anecdotes sur la sensualité de Balzac manquent, la lacune est
comblée par un recours désinvolte à Victor Hugo, comme si on pouvait en quelque
sorte considérer les grands du roman réaliste comme interchangeables.
Nous voyons Balzac ainsi à la Grenadière ou à Frapesles. L'hiver autour d'un château est l'hiver qu'il n'est pas à Paris et, d'être ainsi plongé dans la vérité de la nature, on garde cette vive intuition de la réalité qui fait que le pouvoir des hommes ne s'exerce pas sur nous, et que nous avons à tout moment besoin de
46 JS, p. 485-88. 47 Ibid., p. 488.
17
monter dans notre chambre écrire, de confus mouvements se faisant dans notre cerveau. C'est tout entier qu'on se met au travail, avec un corps chaste mais caressé de désirs dont on remet la satisfaction pour plus tard et qui vous font envisager avec plus de gaieté et de confiance la réalité. Le vieux Victor Hugo suivait encore les bonnes dans la rue. Et souvent je suis sûr que la fréquentation de tel château pendant l'hiver vient de ce qu'y séjournent de belles filles qui se laissent caresser et auxquelles pense peut-être un instant avant d'écrire l'écrivain, comme il pense au dîner qui sera copieux et gai après les heures de sobriété et de silence dans lesquelles il s'embarque, comme il tisonne le feu et va à la fenêtre regarder le temps, et va bien s'assurer que la porte est fermée avant de se mettre au travail. Gourmand, sensuel, surtout s'il sait les garder comme des désirs, un grand écrivain peut bien l'être. Snob, Balzac l'était aussi, mais le travail lui faisant passer tellement plus d'heures avec des personnages imaginaires, c'est-à-dire avec lui-même qu'avec des personnages réels, cela n'avait pas pour lui grande importance. 48(C'est moi qui souligne)
Lecteur avide mais pressé et assez superficiel de la correspondance de Balzac, le
Proust de Jean Santeuil cherche ici à en tirer profit pour illustrer la vie de l’homme
de lettres, ses rapports personnels avec la réalité, sans parvenir toutefois à résister à la
tentation de se substituer au romancier évoqué, de projeter sur lui des images et des
souvenirs qui ne lui appartiennent pas. Qui est « l’écrivain » qui, attiré au cœur de
l’hiver dans un château ami, a l’avant-goût des plaisirs sexuels et gastronomiques qui
l’attendent tout en attisant le feu ? Ce n’est certainement pas Balzac à la Grenadière –
qui n’était pas un château et où il n’a séjourné qu’en été – ni même à Frapesles, dans
l’entourage sympathique mais plutôt sévère de son amie Zulma Carraud, une
républicaine fervente qui aimait à l’exhorter à la cohérence et à des principes
hautement moraux. À l’intrigue d’un Curé de village décantée et stylisée dans la
préface, aux phrases de Rastignac et de Rubempré librement adaptées correspond ici
un Balzac à l’identité fuyante, dont tantôt les traits se confondent avec ceux de Jean
Santeuil, tantôt semblent devoir représenter le caractère exemplaire de « l’écrivain »
par excellence. Une fois de plus, un Balzac fantomatique et méconnaissable profile
48 Ibid., p. 486.
18
son ombre sur les pages de Jean Santeuil ; ce qui permet de mesurer toute la distance
entre ce que le jeune Proust aimerait savoir de lui et ce qu’il en sait réellement.
En septembre 1898, peu après les confessions et le suicide en prison de l’un des
principaux accusateurs de Dreyfus, le colonel Henry, Proust écrit à madame Straus,
dont le salon a été l’un des centres les plus actifs du parti dreyfusard :
Je ne vous ai plus vue depuis que l'affaire de si balzacienne (Bertulus le juge d'instruction de Splendeurs et misères des courtisanes, Christian Esterhazy, le neveu de province des Illusions perdues, Du Paty de Clam, le Rastignac qui donne rendez-vous à Vautrin dans des faubourgs éloignés) est devenue si shakespearienne avec l'accumulation de ses dénouements précipités49.
Aux yeux de Proust, en se coupant la gorge en prison après avoir révélé tous les
faux qu’il avait commis, Henry a fait évoluer le feuilleton de l’ « affaire » vers un
finale de tragédie historique : un finale qui va durer longtemps, jusqu’à la
condamnation, un an plus tard, de l’innocent Dreyfus, « avec les circonstances
atténuantes », immédiatement suivie par la grâce. Les références balzaciennes
demeurent toutefois les plus efficaces pour lire le drame judiciaire qui a divisé la
France de 1897 à 1898. Comme le juge Camusot, dans Splendeurs et misères, faisait
saisir la correspondance entre Lucien de Rubempré et ses maîtresses aristocratiques,
de même le juge Bertulus, fin 97, fait saisir les lettres d’Esterhazy à madame de
Boulancy50 . Esterhazy, endetté et débauché comme Lucien de Rubempré, affirme
qu’il a été escroqué par un proche ; c’est peut-être la raison pour laquelle il est
qualifié ici de « neveu »51. Quant au commandant Du Paty de Clam, bien décidé à
sauver Esterhazy, il a rencontré ce dernier en secret une première fois au parc
Montsouris, le 22 octobre 1897 ; rencontre à laquelle il s’est présenté affublé d’une
fausse barbe noire , tandis que l’archiviste Gribelin, qui l’accompagnait, se cachait
derrière une paire de lunettes bleues52 , tout comme Vautrin qui, dans Splendeurs et
49 Corr., t. II, p. 252. 50 Jean-Denis Bredin, L’Affaire, Paris, Fayard-Julliard, 1993, p. 313. 51 Voir à ce propos la note de P. Kolb dans Corr., t.II, p. 253. 52 Voir J.-D. Bredin, op. cit., p. 264-266.
19
misères, avait recours à des « lunettes à verres verts » pour se déguiser en magistrat 53. Grâce à l’ « affaire », le monde judiciaire de Balzac – avec ses déguisements, ses
suicides en prison, les machinations complexes des agents secrets – devenait
beaucoup plus vrai et actuel de ce qu’auraient pu penser ses critiques. La
« puissance » de l’auteur de La Comédie humaine se révélait en quelque sorte
prophétique, certes « un peu matérielle » pour les critères de Flaubert ou d’Anatole
France, mais capable de pénétrer dans la réalité et d’en mettre à nu les secrets avec
une lucidité sans égal. C’est probablement cet aspect qui a poussé Proust à envisager
un finale singulièrement « balzacien » pour les chapitres consacrés à l’affaire Dreyfus
dans Jean Santeuil ; finale ambigu, ironique et déconcertant, dont il est difficile
d’évaluer la portée et la signification véritable. Il s’agit du chapitre de la section
« Autour de "l’Affaire" » que l’éditeur a intitulé « Révélations ? ». La scène se situe
dans un avenir plutôt vague, après la fin de l’ « affaire », et se déroule dans le salon
d’une certaine Mme Xiron, lors d’une soirée mondaine à laquelle assiste Jean
Santeuil. L’un des invités, le général T., qui a joué un rôle politique important durant
l’ « affaire », révèle à un public de mondains éblouis la vérité sur le mystère Dreyfus.
L’officier juif était innocent, tout comme son accusateur Esterhazy, que Picquart a
voulu perdre par des moyens illégaux et malhonnêtes, mais dans une bonne intention.
Le général répond de façon évasive à la question sur la véritable identité du
coupable :
Permettez-moi de ne pas vous répondre. [...] C'était quelqu'un d'assez connu [...] et dans quelques années, si nous nous voyons encore, je vous dirai son nom. Mais ne cherchez pas, car il n'a jamais été nommé à propos de cette affaire et je suis le seul avec le duc de…, président du Conseil du cabinet où j'avais le portefeuille de la Guerre, qui l'ait su. Mais nous l'avons su trop tard pour pouvoir faire quoi que ce soit54.
53 H. de Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes; CH, t. VI, p. 633. 54 JS, p. 655.
20
Ce passage a bien sûr été rédigé avant le 3 juin 1899, date à laquelle Esterhazy a
confessé sa culpabilité dans une interview au Matin.
Proust a-t-il voulu présenter ces révélations comme étant dignes de foi ? Le
contexte vaguement caricatural laisserait supposer que non : auteur de romans
d’aventures dont les titres relèvent d’une éloquence péremptoire et banale (Cœur et
Volonté, Vers l’île des Mouettes55), le général aime pontifier et jouer le rôle de
l’oracle. Sa solennité , qui fascine les Xiron et leurs invités, ne garantit guère la
véridicité de ses affirmations. La voix qui raconte commente toutefois cette version
imprévisible des faits en des termes qui semblent la prendre très au sérieux.
Jusqu’alors, la culpabilité d’Esterhazy paraissait aux gens de bonne foi une
« certitude », que soutenaient des raisonnements sans faille. Et pourtant
La réalité de l'histoire (et qui fait son charme ambigu et spécial, qui la fait toujours différer de l'actualité en ce qu'elle n'est jamais connue sur la seule apparence, mais qui la fait différer aussi de la vérité, œuvre du raisonnement, en ce qu'elle ne peut se déduire et flotte entre la vérité et l'apparence, et qui fait qu'elle n'habite ni la rue ni le cerveau de l'homme de génie, mais la tête penchée [au] regard usé d'un diplomate expérimenté) peut démolir une telle certitude56.
Cette considération a, sans équivoque possible, un accent balzacien : dans le rôle
de Carlos Herrera, c’est exactement ce que Vautrin a voulu démontrer à Lucien de
Rubempré, autrement dit que la réalité secrète et invisible de l’histoire est l’apanage
de l’expérience et de l’absence de scrupules de ces diplomates qui en ont vécu les
bouleversements dans les coulisses. Pourtant, la présence de Balzac dans ces pages,
où il n’est jamais cité explicitement, va bien au-delà de ses maximes de philosophie
de l’histoire. L’épisode a incontestablement une matrice balzacienne : il suit un peu
maladroitement les traces du finale grandiose d’Une ténébreuse affaire, où un de
Marsay vieilli et désormais proche de la mort révèle en pleine Monarchie de Juillet,
dans le salon de la princesse de Cadignan, les dessous insoupçonnés des événements
de 1803, qui ont constitué la matière de la première partie du roman. La « ténébreuse 55 Ibid., p. 656.
21
affaire », l’enlèvement de Malin de Gondreville, explique de Marsay, cachait en
réalité une conspiration politique, au cours de laquelle la police de Fouché avait
réussi à faire condamner des aristocrates innocents.
Albert Sorel, dans ses Lectures historiques de 1894, avait déjà insisté sur la
profondeur historique d’Une ténébreuse affaire – que Proust a lu en septembre 189757
–, avec des arguments que Brunetière, sans le citer, reprendra plus tard58. L’affaire
Dreyfus toutefois, en faisant ressortir des analogies troublantes, donne une dimension
nouvelle au texte balzacien, que l’on pourrait qualifier d’hyperréaliste : l’habileté de
Fouché et de son bras droit Corentin à enfermer les innocents Cinq-Cygne dans un
réseau de fictions diaboliques préfigure de façon impressionnante les machinations de
Du Paty de Clam et de Henry contre le prisonnier de l’Île du Diable et de son
défenseur, Picquart. « Révélations ? », né manifestement d’une réflexion implicite de
Proust sur cette dimension, ne peut être considéré un pastiche au sens strict car il
n’imite en aucun cas l’énonciation balzacienne. Mais c’est aussi une tentative de
s’inspirer de Balzac, un hommage à sa vision de l’histoire et un clin d’œil aux
lecteurs de la Comédie humaine, du moins à ceux qui sont plus avisés que le pauvre
Émile Faguet, pour lequel Une ténébreuse affaire n’était qu’un « drame de cour
d’assises », analogue en tous points à ceux de Gaboriau59 . Dans Jean Santeuil,
« Révélations ? » est le moment le plus intense et le plus direct de la présence
balzacienne. La « puissance un peu matérielle » de Balzac trouve son véritable terrain
d’élection dans l’Histoire: ce n’est pas un hasard si un passage d’un autre chapitre
montre le romancier de La Comédie humaine capable de « se pencher sur un
appartement comme pour le déchiffrer et, d’après la forme des choses, ressusciter les
56 Ibid., p.655. 57 Voir Corr., t. II, p.214. 58 “Voici encore Une ténébreuse affaire, qui n’est pas le plus connu des romans de Balzac, mais qui n’en est pas moins l’un des plus achevés. Tous les documents que l’on a mis au jour depuis quelques années sur l’époque du Consulat sont venus confirmer ce qu’il y avait de souvenir et de divination mêlés dans cette peinture de l’état des partis, des esprits et des mœurs, à la veille de la proclamation de l’empire.” Ferdinand Brunetière, Conférence prononcée à Tours le 7 mai 1899 et publiée dans Le Temps le 8 mai 1899. Le texte de cette conférence est reproduit dans S. Vachon, op. cit., p.367-382. 59 É. Faguet, op. cit., p. 419.
22
générations des hommes60 » . Le Proust de Jean Santeuil ne peut mieux faire dans son
appréciation de l’art balzacien : ce n’est que lorsque son attention se déplacera de
Rubempré et de Rastignac pour se diriger sur le personnage gigantesque et
énigmatique de Vautrin, qu’il pourra se considérer comme étant véritablement initié
aux mystères les plus secrets de La Comédie humaine. Vautrin, destiné à se
réincarner un jour dans le baron de Charlus61, est encore absent du premier roman de
Proust. Lorsque sa silhouette se découpera dans les pages critiques les plus hautes de
Contre Sainte-Beuve, Proust aura saisi toute la portée de la « puissance un peu
matérielle » de Balzac. Il se préparera alors à en suivre, à sa façon, les traces, écartant
définitivement tout ce qu’il y avait de trop vaporeux, impalpable et immatériel dans
les personnages et les toiles de fond de ses œuvres de jeunesse, des Plaisirs et les
Jours à Jean Santeuil.
60 JS, p.435. 61 Voir Lucette Finas, Le toucher du rayon. Proust Vautrin Antinoüs, Paris, Nizet, 1995.