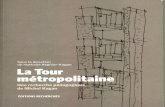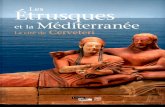Nédroma : une cité en mutation
-
Upload
univ-tlemcen -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Nédroma : une cité en mutation
1
Nédroma : une cité en mutation.
EL GHAOUTI BESSENOUCI
Départements d’Archéologie et de Culture populaire
Université Abou Bekr Belkaïd – Tlemcen - Algérie
Avant-propos :
A l’heure où l’Algérie balance entre des références culturelles, politiques et économiques souvent
contradictoires et où l’exploitation forcenée des ressources énergétiques (et autres richesses du
sous-sol) invective les esprits avertis, le retour à des choix inspirés du terroir s’avère nécessaire.
Dans ce cadre, de plus en plus de spécialistes reconnaissent que la croissance économique - si elle
veut s’inscrire dans la durée - doit chercher de nouveaux modes de développement qui tiendraient
compte des incidences environnementales.
La source pourrait s’en trouver ainsi dans la valorisation du patrimoine culturel, symbolisé par des
lieux communs de la mémoire auxquels les individus s’identifient.
Le thème de cette étude serait donc de réfléchir aux questions que pose, en Algérie, une croissance
démographique et économique accélérée et à ses incidences sur le patrimoine culturel, dans un
contexte d’interrogation sur le développement durable.
Dans cette optique, l’exemple de la ville de Nédroma, située dans l’ouest algérien peut être
particulièrement pertinent. Cette cité, en effet, a bien conservé sa touche médiévale de cité d'Islam
occidental avec, au centre, la grande Mosquée dont le minaret domine de haut les maisons
d'alentour, une petite place « la tarbi’a » autour de laquelle s'ouvrent le vieux bain almoravide et
les souks, et de laquelle partent des rues étroites qui vont s’insinuer dans les divers quartiers de la
ville. Dans le paysage urbain de l’Algérie, Nédroma ferait donc partie de la grande famille des
médinas telles que Tlemcen et Constantine, ou telles que Fès et Meknès au Maroc ou encore
Kairouan, Sfax et Tunis en Tunisie. Sans avoir l’envergure de ces grandes métropoles, elle leur
ressemble inévitablement en ce qu’elle en présente les caractéristiques profondes (structurales,
esthétiques, fonctionnelles, etc.).
Toutefois, tandis qu’au Maroc les villes européennes furent édifiées à côté des médinas pour
épargner ces dernières, en Algérie un tel souci n’exista pas et beaucoup d’empreintes de ce passé
prestigieux ont été singulièrement gommées par l’urbanisation outrancière coloniale. Nédroma
souffrira considérablement de cette mutilation que d’autres épreuves (liées aux multiples
contraintes qu’engendre une mutation sociale hâtive et souvent forcée) viendront accentuer après
l’indépendance
Ainsi, travailler sur cette ville - qui offre un cadre de recherche riche en raison de l’importance de
ses ressources paysagères et culturelles - nous permettra de prendre conscience de la grande
dimension patrimoniale de la médina mais aussi des problèmes socio-économiques liés aux
profondes pratiques mutationnelles ; et la question qui s’offre subséquemment à l’entendement est
donc de savoir si Nédroma devrait se contenter aujourd’hui du souvenir de la gloire d’antan ?
Certes, s’il est fondamental pour les générations actuelles et futures de protéger la mémoire et de
garder une conscience vive de l’importance du patrimoine dans la construction de l’identité
présente, il est non moins fondamental de songer à intégrer ce patrimoine dans un processus de
développement durable, en appréhendant les relations complexes qui déterminent cette relation
trinômique : patrimoine – environnement - pratiques socio-économiques (passées, actuelles et à
venir) et d’en découvrir les outils et méthodes.
2
Mots-clés Patrimoine, environnement, culture, développement durable, revalorisation, mondialisation, stratégies d'acteurs, innovations sociales
« Un patrimoine n’est vivant que s’il est plongé dans une pratique sociale et
s’il est occasion de créativité, c'est-à-dire de liberté. Il doit aider les
contemporains à découvrir, dans les temps accordés aux données
technologiques et sociales d’aujourd’hui et demain, ce qu’il y a de meilleur
dans notre héritage culturel »
J. Lang.
3
Nédroma : une cité en mutation.
Avant-propos
I. Présentation générale
A. Etymologie
B. Géographie
C. Climat
D. Histoire :
1. Avant les Almohades
2. La période almohade
3. Entre Abdalwadîdes et Mérinides
II. Architecture et Urbanisme
A. Nédroma dans l’armature urbaine
1. Configuration spatiale de Nédroma
2. Configuration spatiale de la Médina
B. Cadre Bâtie : les éléments structurants de la Médina
1. La grande Mosquée
2. Le souq
3. Le hammâm
4. Dâr
5. Les remparts
C. Espaces verts
III. Evolution de Nédroma
A. Evolution de la Médina à travers les périodes
B. Analyse socio-économique et démographique
IV. Développement Durable et Patrimoine
A. L’ambigüité
B. Durabilité et patrimonisation
1. Le contenu d’une politique urbaine de DD.
2. Acteurs de la politique de DD.
V. Conclusion
4
I. Présentation générale
A. Étymologie
Nédroma (ندرومة) : c'est entre le IX' et le XIe siècle que la ville de Falousen (ou Fallaousen) a dû
prendre le nom de Nédroma.
Selon Ibn Khaldoun, ce nom serait celui d'une tribu berbère, branche des Koumia, descendants de
Faten.
B. Géographie
Site
Nédroma vue par le satellite Earth
La ville de Nédroma est assise sur le versant Nord du Djebel Filaoucen, le plus élevé des Monts
Traras (1136 m). Ce replat d’interfleuve se trouve au pied du col de Taza, le long d'un lit de rivière
plutôt boisé. À quelques lieues de la mer, cet emplacement présente le double avantage d’occuper
un site défensif et de dominer une plaine fertile, sillonnée par plusieurs cours d’eau (Agrouch,
Sbair, Amar et Tlela).
Sa population, estimée à environ 22000 hab, connaît un taux d’accroissement global de 2,15 %.
C. Climat
Le climat nédromi appartient au climat méditerranéen, caractérisé par une saison fraîche et
pluvieuse et une saison chaude et sèche. Il doit ses traits essentiels à la latitude de la ville, à
l’influence modératrice de la Méditerranée et au relief du Tell septentrional.
Il s’agit donc là d’un site classique avec un climat modéré où l’hiver est la saison la plus humide de
l’année : il tombe ainsi environ 500 mm, soit plus du tiers des précipitations annuelles. Cette
pluviométrie permet, grâce à la nature des sols, de pratiquer une agriculture intensive.
5
D. Histoire
1. Avant les Almohades :
Il n'y eut certainement pas de ville romaine à l'emplacement de Nédroma. Léon l'Africain est à
l'origine de cette légende, de même qu'il est à la source de la fausse étymologie du nom de Nédroma
: "Ned-Roma", "rivale de Rome" car, jusqu’à l’heure actuelle, il ne fut jamais découvert de vestiges
ni d'inscriptions pouvant l’attester.
Selon René Basset, l'emplacement de Nédroma aurait été d'abord occupé par la ville berbère de
Falousen dont parle Al-Ya'koubi dans son livre "Kitâb-albuldân" (278H/891-892), ce qui nous
réfère à la chaîne de montagnes à laquelle est adossée la ville et qui porte aujourd'hui encore le nom
de Fillaoussène.
On remarquera que la ville et le nom de Nédroma existent déjà à l'époque almoravide,
probablement même avant.
Le nom de Nédroma est en effet mentionné pour la première fois par Al-Bekri (1 068), qui le situe
« au pied d'une grande montagne, le Fillaoussène. "Au nord et à l'occident de la ville s'étendent des
plaines fertiles et des champs cultivés. Elle est à dix milles de la mer ; c'est une ville considérable
entourée de murailles et possédant une rivière bordée de jardins qui produisent toute espèce de
fruits ».
Toujours selon Al-Bekri, Nédroma était reliée à la mer par la vallée de l'Oued Masin qui aboutissait
au port de Masin, On ignore cependant si ce port correspond à la baie de Ghazaouet ou à celle de
Sidna Youcha. Alfred Bel, lui, penche pour cette dernière hypothèse du fait du rapprochement avec
le nom de la montagne qui domine la baie de Sidna Youcha du côté de Est (Djebel Masil).
Une autre description de Nédroma nous est fournie par Al-Idrissi, vers l'an 1164 (559 H) :
« Nédroma, ville considérable, bien peuplée, ceinte de murailles, pourvue de marchés et située sur
une hauteur à mi-côte... Des champs ensemencés et arrosés par une rivière en dépendent. Sur la
hauteur, du côté de l'orient, on trouve des jardins, des vergers, des habitations et de l'eau en
abondance ».
2. LA PERIODE ALMOHADE:
Abd Al Mûmin, le premier des princes almohades, est généralement sacré « fondateur de
Nédroma » par la tradition populaire, qui en a fait le « héros fondateur » de la cité. Issu de la tribu
des Koumia, dont les nédromas étaient une branche, son lieu d'origine est généralement fixé au pied
du Tadjra. Il l’aurait peuplée dès l’origine d’otages pris dans les grandes tribus du Maroc. Ces
traditions sont difficiles à vérifier aujourd’hui, mais il faut bien admettre que certains noms de
familles sont ceux de grandes tribus marocaines : les Ghomara, les Zerahana, les Sanhadja, entre
autres. Par ailleurs la prise d’otages pour s’assurer la fidélité de partenaires politiques était
couramment pratiquée à l’époque.
Comme le note Ibn Khaldoun, Abd Al Mûmin s'appuya principalement dans son gouvernement sur
sa tribu d'origine et il est hors de doute que Nédroma connut avec lui un temps de célébrité. La ville,
déjà précédemment entourée de murailles, fut transformée en véritable place forte, dominée par une
Qasba : les restes de remparts que l'on voit encore aujourd'hui remontent très certainement à cette
époque.
On ne sait rien d'autre sur cette période, bien que les légendes abondent. On peut supposer que se
produisirent alors de grands bouleversements dans la structure de la population, et la fixation dans
la ville de familles dont les noms évoquent des origines du Maghreb Al Aqsâ.
Il semble que, vers la fin de l'époque almohade, Nédroma ait bénéficié d'un statut d’indépendant.
C'est ce que suggère néanmoins l'épisode rapporté par Ibn Khaldoun, dans son Histoire des
6
Berbères, et situé au temps où Djâbir Ibn Yousouf était gouverneur de Tlemcen et de sa région au
nom du sultan almohade Al-Mâmoun : " Djâbir établit son autorité sur le Maghreb Central, et posa
les premiers gradins d'une échelle qui devait servir à ses enfants pour monter sur le trône.. Etant
allé, l'an 629 (1231-32) à Nédroma pour en faire le siège, il fut blessé à mort par une flèche tirée au
hasard" (III, p. 331).
Dans son Histoire de Nédroma, Al Hadj Hamza Ben Rahal précise plutôt « qu’une pierre fut lancée
des remparts par l'un des assiégés, Yousef al Chaffari, originaire de Tlemcen » qui mit ainsi fin aux
jours du tyran et fit lever le siège à l'ennemi. La ville demeura indépendante.
3. ENTRE ABDELWADÎDES ET MERINÎDES:
La tribu zénata des Béni 'Abd-El-Wâdd avait été installée par Abd Al Mûmin dans la partie
occidentale de l'Oranie, en récompense de son ralliement et dans le but d'y maintenir l'autorité du
souverain. La fortune des Abdel-Wadîdes commence en 1235 par le long règne de Yaghmorasan
Ibn Zeyyâne (1235-1283), qui crée un état indépendant ayant pour capitale Tlemcen. On sait que les
Abdel-Wadîdes furent en conflit quasi-permanent avec leurs cousins germains, les Merinîdes de
Fès. C’est au cours d'un conflit entre Yaghmorasan et le Mérinîde Abou Yousouf Ya'qoub (1258-
1286) que Haroun Ben Moussa, chef des Matghara de Taount, prit parti pour le mérinîde et
s'empara de Nédroma. La ville fut bientôt reprise par Yaghmorasan, puis par Abou Yousouf qui la
rendit à Haroun Ben Moussa. Enfin, elle fut reprise par Yaghmorasan vers 1268-1269 (667 H). Il
semble qu'elle ne fut pas reprise par Abou Yousouf lorsque ce prince vainquit les Abdalwadîdes
près de l'Oued Isly (16 février 1272) et qu'il vint assiéger Tlemcen sans résultat. Il bâtit en effet
cette même année une forteresse avancée à Taount, près de l'actuelle Ghazaouet.
II. Architecture et urbanisme
A. NEDROMA DANS L’ARMATURE URBAINE :
Nédroma est bâtie sur l’extrémité occidentale du massif granitique des Traras, seul épointement
rocheux intrusif du littoral oranais.
Les agglomérations marocaines
d’Oujda et Ahfir en sont distants
de 56 et 54 km tandis que
Maghnia, Ghazaouet et Tlemcen
(chef lieu de wilaya) sont
respectivement à 34, 17 et 64
km. Le nouvel axe Tlemcen-
Ghazaouet, passant à 8 km au
nord, facilite ses relations avec
les deux villes.
La ville de Nédroma n’est traversée par aucune route nationale de la région. Elle reste cependant
reliée à son arrière-pays par un réseau dense de voies secondaires (des chemins de wilaya).
En arrivant à Nédroma par le chemin de wilaya n° 38, l’attention du voyageur ne manque
certainement pas d’être retenue par ce paysage de montagne inhabituel en Oranais, la région des
espaces ouverts. Douars et jardins restent accrochés aux versants montagneux.
7
Nédroma apparaît dans toutes ses dimensions : la vieille ville ramassée autour de la Grande
Mosquée, l’ex quartier européen et les nouveaux lotissements, les unités industrielles (SNLB et
SONITEX), les différents chantiers et le village socialiste de Khoriba.
Nédroma n’est plus la cité médiévale que de nombreux auteurs décrivaient récemment encore : le
paysage urbain s’est fortement modifié, la ville et sa région connaissent depuis quelques années les
mutations les plus profondes de leur histoire.
1. Configuration spatiale de Nédroma :
La configuration spatiale du grand Nédroma découvre trois parties dissemblables :
- Sidi Abderrahmane
- La vieille ville
- La nouvelle ville.
L’analyse de la structure urbaine de cette grande agglomération montre qu’il y a déséquilibre dans
les fonctions fondamentales de la Médina.
A une ville organique, unitaire et solidaire, a succédé un ensemble désormais aléatoire de formes
socio-spatiales éclatées, marquées par des processus de territorialité prépondérante, non seulement
coupées les unes des autres mais campées dans une sorte de retranchement social et politique. C’est
ainsi que la division spatio-temporelle de la cité devient une sorte de raccourci de l’évolution
problématique et négative de l’urbain et de la société.
La vieille ville y apparaît comme un espace de transition entre deux gros bourgs : Sidi
Abderrahmane et la ville nouvelle. Certes, le développement décousu de la structure urbaine,
l’abandon des terrains vierges au Nord et les contraintes physiques du Sud, ont amené le secteur
d’Etat à s’installer sur les terrains vides du quartier européen ou à sa périphérie.
La cause de cette fragmentation de la vieille ville, de ses fonctions et de ses espaces n’est autre que
la résultante de causes physiologiques relatives aux nécessités et aux modalités de croissance ; elle
est aussi le produit de la dualité de la société et de l’économie qui a caractérisé d’une part l’histoire
de la colonisation, et d’autre part la rapidité des processus d’urbanisation enregistrés ces dernières
années ; elle est surtout conséquence de l’incapacité des gouvernements à y faire face.
La notion de fragmentation se caractérise par la multiplication des registres d’appartenance. Elle est
à l’origine liée aux transformations du marché du travail, dans le cadre de la globalisation des
8
structures économiques, à la question de la pauvreté croissante et des différentiations socio-
économiques ; elle apparaît alors comme le résultat spatialisé des « effets de la globalisation, de la
restructuration économique et de l’ajustement structurel sur la pauvreté, en un temps où les
modalités de régulation politique antérieures étaient en crise ».
C’et donc la médina qui intègrera les ruraux venus des quartiers périphériques ou directement de la
campagne. L’économie urbaine fera le reste : elle fera de ces nouveaux migrants de « néo-
citadins ».
2. Configuration spatiale de la médina :
Si l’on fait une lecture de la configuration spatiale de la vieille ville, l’on discernera aisément que
sans être l’égale des grandes métropoles telles que Fès, Kairouan, Constantine ou même Tlemcen -
sa voisine et rivale - Nédroma fait partie de la famille des médinas. Elle répond en effet à
l’organisation de toute ville arabo-musulmane du Maghreb et en présente les caractéristiques
essentielles. Celles-ci sont concrétisées principalement par les indices suivants :
Une muraille fortifiée ceinturant la médina.
Des voies principales pénétrant la médina à partir de portails monumentaux (tels que
Bâb al Kasbah et Bâb al Médina).
Des voies secondaires (moins larges et plus sinueuses) desservant les différents quartiers
de la cité.
Des derbs en culs-de-sac accédant aux demeures privées.
Une agora centrale (telle que la Tarbiaa) et des placettes de quartiers.
Un noyau autour duquel gravitent les différents quartiers de la ville.
Il reste toutefois malaisé de cerner la notion
de « quartier » dans un contexte ayant subi
une profonde transmutation dans sa
composante humaine et qui a vu ses
structures urbaines et sociales fortement
bouleversées.
Le quartier naît de l’utilisation en commun des équipements et c’est donc l’influence de ces derniers
qui fait la cohésion et l’unité d’un groupe de constructions. Partant, il est indéniable que les
changements économiques conjugués aux mouvements des populations ont engendré des
perturbations dans l’identification de ces quartiers et leur gestion.
Quant à la « place » qui jouait un rôle prépondérant dans la structure de la ville - grâce aux
échanges économiques et culturels qu’elle générait - elle a singulièrement perdu son rôle
symbolique d’agora carrefour au sein de la médina. La mutation de la structure urbaine, avec
l’implantation récente de nouveaux équipements, a vu le centre de la ville échapper à la Tarbiaa et
glisser irrémédiablement vers d’autres zones.
Les activités artisanales sont ainsi transposées vers le Nord. Les ateliers de menuiserie, de
confection et autres prestations, sont localisés au delà de la périphérie de la vieille ville, à savoir
dans les nouveaux lotissements. Dans la médina, néanmoins, la fonction commerçante et
boutiquière, l’activité de service, sont restées vivaces. Une bonne partie des épiciers et des
bonnetiers, la quasi-totalité des coiffeurs, les bains maures ont su résister à cette expatriation forcée.
9
D’un autre côté, les fonctions cultuelle et culturelle ont su résister au démembrement chaotique du
développement urbain. Leur survie demeure sans doute subordonnée à des référentiels communs
aux individus formant des collectivités de type variable mais porteuses d’une identité commune -
quelle que soit l’origine de celle-ci : sociale, culturelle, ethnique, religieuse ou autre - reconnue
dans des espaces qui consacrent l’absence de référence à la société urbaine comme globalité.
La médina est de manière exclusive un lieu d’étude et d’enseignement des sciences religieuses.
L’enseignement y est centré sur la mosquée et ses annexes éventuelles (les madrasas, les zaouïas et
les mausolées). Ces dernières représentent autant d’espaces appropriés, capables d’outrepasser le
paradigme de la fragmentation socio-spatiale.
B. CADRE BÂTI : LES ELEMENTS STRUCTURANTS DE LA
MEDINA
1. La grande Mosquée :
Destination privilégiée de la Médina et lieu fondamental
de la prière du Vendredi, la grande mosquée existait dès
le XI° siècle, puisqu’un fragment d’une plaque de cèdre,
ayant fait partie d'une chaire de mosquée (minbar) daté de
1090 y fut découvert en 1900. L’inscription en caractères
coufiques dit : « Ceci est le présent de l’émir le Sid…ben
Yousef ben Tachfin, qu’Allah le maintienne dans le droit
chemin… a eu lieu l’achèvement de ceci par les soins du
jurisconsulte le cadi Abou Mohammed ‘Abdallah ben
Saïd, le jour du jeudi 17 du mois de… » (Les deux
dernières lignes sont effacées).
Le minaret de la mosquée est plus récent ; il fut construit en 1348
(749 H), comme l’indique l’inscription arabe gravée sur le marbre
à l’intérieur de la mosquée : « Au nom d’Allah, le clément, le
miséricordieux. Bénédiction d’Allah sur notre seigneur
Mohammed. Les gens de Nédroma ont construit ce minaret avec
leur argent et de leurs propres mains. Toute récompense vient
d’Allah. Il fut construit en cinquante jours. Il fut bâti par
Mohammed ben ‘Abdelhaqq ben ‘ Abderrahmane ech-Chisi, l’an
749. La miséricorde d’Allah sur tous. »
La ville comprend, d’autre part, un nombre important d’édifices religieux : des mosquées de
quartier, des lieux saints et des écoles coraniques.
2. Le souq :
Les souks constituaient, dans le passé, de véritables agoras au centre de la vie religieuse, politique
et économique de la médina. Ils étaient le poiréseau de ruelles couvertes et bordées de boutiques de
commerçants et d’artisans groupées par spécialités. Les métiers « propres » sont situés près de la
grande mosquée car ils ne suscitent aucune nuisance par l’odeur, le bruit ou l’usage de l’eau. Les
marchands d’étoffes, les parfumeurs, les marchands de fruits secs, les libraires et les marchands de
laine sont concernés au contraire des tanneurs, poissonniers, potiers et forgerons qui sont relégués à
la périphérie. Il existe ainsi une hiérarchie codifiée des métiers : le commerce des chéchias, celui
des parfums, le tissage de la soie, la sellerie, la confection des vêtements, la fabrication des
babouches, le tissage, la poterie et enfin les forgerons et les teinturiers.
10
Au Nord-Est de la mosquée almoravide, qu’elle longe en
partie, s’ouvre l’esplanade de la Tarbi’a. Si, aujourd’hui,
celle-ci surprend par son immobilité désertique, elle
devait surprendre autrefois par l’animation criarde et
active qui la couvrait. On y vendait toutes sortes de
tapis, de couvertures et autres tissages, des étoffes, de la
maroquinerie, une grande diversité d’essences et de
parfums. Ce souk, auquel se rallie l’ensemble du réseau
urbain par le biais d’une multitude de ruelles étroites,
mais anciennement bordées d’échoppes regorgeant des
produits les plus variés, débouche sur d’autres placettes
qui desservaient les quartiers et qui abritaient chacune
une corporation spécialisée : El Blaghgia, El Kébabgia, En Nhas (cuivre), Es Sarragine (selliers),
etc. La division en quatre quartiers : Béni-Affâne, Béni-Zid, Kherba et Souq fut longtemps
l’articulation urbaine essentielle.
3. Le hammâm :
Le bain maure (ou El-hammâm el-bâli) qui jouxte la
grande mosquée est un autre témoin de l’époque
almoravide.
4. Dar : La raison fondamentale de la ville est de faire
habiter les familles de la communauté dans
l’espace bâti, formé de plusieurs cellules,
s’organisant autour de la cour avec ou sans
arcades (selon les classes sociales). Tous les
bâtiments sont obtenus par la combinaison de
cellules élémentaires en série ou en parallèle.
11
5. Les remparts :
Dès les premiers temps de sa fondation, Nédroma est considérée
comme une importante base militaire. Le géographe El Ya’koubi
affirme qu’au début du IXe siècle « Nédroma était entourée d’un mur
de briques et d’argile ». Souvent endommagée, voire totalement
détruite, au cours du Moyen Âge, l’enceinte conserva toujours son
tracé d’origine. Elle était parsemée de différentes portes (Bâb el
Casbah).
Les remparts ont disparu des côtés Nord et Est mais ils subsistent
encore du côté Sud et à l’Ouest. Ces murailles sont utilisées, dans
beaucoup d’endroits comme mur de clôture ou mur de soutènement.
En dépit de sa tendance à s’excentrer - suite à ce processus
d’urbanisation - la vieille ville conserve encore quelque vivacité du
fait qu’elle concentre en son sein la Grande Mosquée, des commerces,
des services et des souqs.
C. ESPACES VERTS
Nédroma est un endroit privilégié qui se distingue par
le caractère naturel de son paysage et de sa végétation.
Les terrains naturels, formés de bois ou de garrigues,
dans lesquels elle baigne constituent des espaces
propices à la chasse, à la promenade ou à l’agrément.
III. Évolution de Nédroma
Nédroma, considérée à travers l’histoire comme
capitale des Traras, a connu depuis les années
soixante-dix une extension urbaine anarchique et
très rapide. En moins d’une décennie, elle a doublé
de dimensions en s’établissant sur les meilleures
terres de la plaine de Mezaourou et a vu son activité
artisanale décliner brutalement. Cette extension non
contrôlée a entraîné fatalement la déstructuration de
l’environnement immédiat.
12
La dégradation de l’ancien tissu de la médina est
accentuée par le vieillissement du bâti et sa
désaffectation souvent volontaire ; ainsi les ruelles
perdent leurs fonctions, leurs activités, leurs rôles
et de ce fait leur dynamisme. Aujourd’hui, nous
remarquons que les quartiers de la vieille ville
jouent un rôle prépondérant dans le processus
d’intégration des ruraux (nouveaux citadins)
pendant que nombre de propriétaires abandonnent
les lieux pour rejoindre la nouvelle ville ou les
grandes métropoles telles que Tlemcen, Oran ou
Alger. Cette « substitution communautaire », loin
de préserver l’équilibre de la cité, va engendrer un
désordre social et urbain qui ne manquera de l’affecter dans ses structures les plus profondes (cadre
bâti, voiries et réseaux divers, activités commerçantes, surpeuplement des habitations, etc.)
Nédroma, carrefour multifonctionnel et à vocation régionale, enregistre ainsi de fortes pressions
dues à diverses contraintes, essentiellement de nature géotechnique, agricole, archéologique et
juridique ; ces dernières ont engendré un énorme retard de développement de la région.
Dans ce contexte, l’agglomération de Nédroma doit maîtriser son urbanisation future et rattraper le
retard et le déficit cumulé en matière d’aménagement et d’équipement afin de redéfinir sa vocation
et jouer pleinement son rôle dans l’armature urbaine locale et régionale en tant que capitale
régionale (c-à-d ville de commerce, de services, d’artisanat et de tourisme).
A. EVOLUTION DE LA MEDINA A TRAVERS LES PERIODES :
Comme dans la plupart des anciennes villes du Maghreb qui se sont formées autour d’un noyau
historique, la médina de Nédroma - même
franchement érodée par le tissu moderne -
continue à apparaître comme un espace
fragmenté des autres : compacité du tissu dont
la typo-morphologie d’habitat est composée
d’unités introverties malgré de nombreuses
altérations, infrastructures, équipements et
services quasiment sous normalisés par
comparaison à la ville nouvelle et aux actuels
règlements d’urbanisme (parfois même
assimilables aux niveaux de quartiers
périphériques « spontanés »). L’habitat illicite
est, lui-même, spasmodique et contribue indifféremment à la dislocation apparente du tissu.
Cette discontinuité du paysage urbain nédromi s’inscrit singulièrement dans les limites de
l’évolution de l’urbanisation en Algérie. Ainsi, il serait possible d’y distinguer plusieurs étapes :
1 - Dans les années 30, la paupérisation conséquente à la crise agricole et à la montée
démographique, a amorcé un exode important vers les villes et entraîne l’émergence des premiers
bidonvilles. L’on notera que l’intervention coloniale s’est basée sur la création d’une ville
européenne prenant possession de la médina s’agglutinant à elle, la ceinturant, captant ses
principales activités pour enfin la juguler.
13
2 - Cet urbanisme colonial, de style militaire au départ, fait place ensuite à des préoccupations
économiques et spéculatives. Il est fondé sur le principe d’accessibilité et de pénétration : larges
avenues fendant les villes anciennes, vastes places déstabilisatrices, bâtiments monumentaux,
constructions en front de mer.
3 - À l’indépendance, une forte population s’installe dans les villes, suite au départ massif des
Européens, générant un accroissement notable du taux d’urbanisation. Toutefois, les programmes de
développement engagés essentiellement dans les zones urbaines ont donné un second souffle à
l’exode rural, soutenu par l’arrêt de l’émigration vers la France à partir de 1973.
4 - De 1966 à 1987, la population habitant les grandes villes s’est multipliée par 2,69. Les premières
migrations se sont fixées dans les anciens centres pour s’acheminer ensuite vers les marges des
villes donnant naissance à des périphéries urbaines submergées de bidonvilles, d’habitat auto-
construit et de cités de recasement. Aujourd’hui, ces périphéries semblent être dépassées par les
implantations réalisées par les pouvoirs publics pour faire face aux besoins du développement,
lesquels nécessitent plus d’espace particulièrement dans les anciens centres déjà étroits. Il en résulte
un sérieux décalage entre les programmes d’habitation et le développement des secteurs secondaire
et tertiaire.
La médina de Nédroma, comme partout en Algérie, présente la projection de cet éclatement urbain
et ses extensions spatiales se traduisent le plus souvent par des formes urbaines différenciées qui
témoignent de l’hétérogénéité des classes sociales et de leur répartition géographique (voir cartes).
B. ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE
Nédroma, une des notables médinas du Maghreb, est une ville traditionnelle dont l’économie fut
basée essentiellement sur la production artisanale, le commerce et l’exploitation des terrains
agricoles environnants.
Le fait colonial marque la rupture avec l’équilibre traditionnel des échanges entre la ville et la
campagne. L’introduction des produits manufacturés, la spoliation des terres, l’extension coloniale
et citadine, entraîneront une prolétarisation des petits artisans, un exode rural ininterrompu et une
émigration vers la métropole coloniale.
Après la guerre de libération nationale, les quartiers périphériques à la médina se trouveront gonflés
de ruraux sans emploi.
14
Une analyse socio économique nous permet de décortiquer la composante humaine de la population
de la Médina, à savoir : le nombre d’habitants, leur distribution et leurs caractéristiques générales.
Confrontée à celle du tissu urbain, cette analyse met en évidence l’étroite et franche relation qui unit
l’espace socio économique à l’espace physique. Ainsi donc, le mouvement de la population a
généré trois zones dissemblables :
Zone I :
C’est l’ancien noyau de Nédroma, regroupant un certain nombre
d’équipements et de services qui a permis d’entretenir la population. Avant l’indépendance,
cette zone était occupée essentiellement par des ressortissants locaux. A partir de 1962 (date
de l’indépendance du pays), commence un exode rural qui se maintient encore de nos jours,
tandis que se poursuit la migration des natifs vers la ville nouvelle ou vers d’autres cieux.
Zone II :
Cette zone est composée de constructions coloniales et post-coloniales
surtout. Certains îlots, occupés jadis par des jardins potagers, ont été convertis par
l’administration coloniale en îlots constructifs et habitables pour développer la ville et
répondre aux exigences du nouveau processus d’urbanisation.
Zone III :
Cette zone est considérée comme lotissement illicite, vu la disposition des
constructions et sa viabilisation non-conforme aux normes. Située en dehors de la médina,
elle n’en demeure pas moins une excroissance dont l’influence est indéniable.
On peut interpréter cette dynamique sociale par la dynamique économique. En effet, la
désarticulation des structures agraires induite par le rythme de l’accumulation du capital dans le
secteur industriel ainsi que celui des services et commerces s’est accompagnée d’une
transplantation de la population rurale auprès des villes. (Médina : 41,2 % de natifs pour 58 % de
ruraux).
IV. Développement durable et patrimoine
A. L’AMBIGUITE
La problématique du développement durable est devenue une préoccupation essentielle, que ce soit
au niveau international, régional ou local.
Il s’agit de proposer une stratégie globale pour gérer des territoires considérés comme des
systèmes, par opposition aux approches sectorielles de l’urbanisme traditionnel. Dans son
acception la plus communément admise, le développement durable se définit comme la satisfaction
des besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres
besoins. La notion de durabilité impliquant nécessairement une action sur le long terme, c’est en
s’efforçant de trouver dès aujourd’hui une harmonie et un équilibre entre comportements humains
et potentiel environnemental que ce dernier pourra être préservé pour demain.
La consommation parcimonieuse de matières premières non renouvelables est l’un des préceptes
fondamentaux du développement durable. L’entretien du patrimoine pour assurer la pérennité des
monuments et sites de valeur ainsi que leur transmission aux générations futures vise lui aussi, par
définition, le long terme. Développement durable et conservation apparaissent donc, à l’évidence,
comme deux alliés pour la même cause : une réhabilitation fonctionnelle du patrimoine dans ses
15
multiples dimensions. Il faut pourtant constater que la conservation du patrimoine est encore trop
souvent considérée comme accessoire, voire futile, et non comme la pierre angulaire d’un
développement durable intégré.
La réhabilitation fonctionnelle correspond à une évolution volontaire des fonctions d’un édifice
choisi par les acteurs publics pour être revalorisé et considéré comme un héritage bâti. Tout au long
du XX ème siècle, les usages des monuments et des maisons traditionnelles présents au cœur des
quartiers des villes anciennes sont modifiés, sélectionnés et inventés afin de répondre à des
impératifs idéologiques, économiques ou sociaux. Depuis le début des années 90, la réhabilitation
fonctionnelle en Algérie s’affirme comme un véritable outil d’aménagement étatique, oeuvrant au
nom de la sauvegarde patrimoniale et surtout du développement touristique, façonnant peu à peu
l’espace urbain. Mais certaines réticences, sensibles à la sacralité des lieux, nous rappellent que ces
derniers sont porteurs de valeurs parfois en contradiction avec celles que l’Etat propose ; cela
suscite indubitablement la question de « l’économie » de l’échange entre les principaux acteurs d’un
champ politico social, c'est-à-dire l’anthologie d’un choix façonné sur un parcours millénaire à
partir de prétentions idéologiques et esthétiques. Autour de ce choix gravite une série de questions
relatives aux variantes des sources dans leur revendication multidimensionnelle, au contexte
colonial, au conflit des langues et des cultures, au concept de l'indépendance, à celui de la
mondialisation, etc.
D’un point de vue urbain, réhabiliter désigne « l’ensemble des procédures visant la remise en état
d’un patrimoine architectural et urbain longtemps déconsidéré et ayant récemment fait l’objet d’une
revalorisation économique, pratique et/ou esthétique », ce qui consiste à lui « donner à nouveau
droit de cité ». Un droit de cité accordé à un patrimoine dévalorisé mais qui, réhabilité, retrouve une
place, un rôle, un usage au cœur de la ville. Mais alors qui réhabilite ? Qui met en œuvre ces
« procédures » ?
La réhabilitation est une action délibérée, encadrée, contrôlée. Elle est initiée par des acteurs
publics : l’Etat choisit les constructions qu’il faut revaloriser ou pas. La réhabilitation est donc un
acte sélectif et politique qui permet à l’Etat de marquer le territoire de son empreinte. La protection
du patrimoine serait ainsi une opération ségrégative qui tend à privilégier, à soumettre à une règle
spécifique des espaces déterminés en fonction des intérêts de l’Etat. Elle serait vraisemblablement
le moyen pour l’Etat d’imposer selon ses propres logiques sa définition du patrimoine, de l’héritage
qu’il faut conserver ou pas ? Car en choisissant de préserver certaines constructions jusqu’alors
déconsidérées, l’Etat leur reconnaît à la fois un « droit de cité », mais aussi un « droit à
l’historicité », un droit à exister et à perdurer en tant qu’héritage.
La connaissance des conditions de vie sur le plan social, économique, culturel et politique d’une
société ou d’un groupe de population donné, de leurs comportements, de leurs aspirations etc. est
d’une nécessité impérieuse en vue d’établir des politiques judicieuses et efficientes. Depuis Rio, les
gouvernements, les organisations internationales, les autorités locales, les entreprises, les groupes
de citoyens et les individus ont consenti d’énormes efforts pour une meilleure mise en œuvre des
mécanismes de développement durable afin d’équilibrer d’une part, les besoins économiques et
sociaux, et d’autre part le potentiel des ressources terrestres et des écosystèmes.
La plupart des activités économiques nécessitent un certain niveau d’emploi des ressources
naturelles et laissent inévitablement des traces indélébiles sur les écosystèmes. La surexploitation
des ressources naturelles a atteint un tel niveau rendant de nombreux écosystèmes incapables de se
régénérer et de survivre. Ceci démontre combien toute réflexion urbanistique sur un développement
durable du patrimoine bâti doit impérativement prendre en compte une gestion économe des «
matières premières », qu’il s’agisse d’espace (formes urbaines, densité d’occupation), de matériaux
(constructions existantes), d’énergie (réduction des déplacements), etc.
16
La préservation de la morphologie urbaine, l’utilisation pertinente des potentialités spatiales et
techniques des bâtiments existants – en d’autres termes la gestion adéquate et rationnelle du
patrimoine urbain, pris dans sa définition la plus large de matière première non renouvelable – sont
autant de principes s’inscrivant parfaitement dans la notion de développement durable. Dans cette
réflexion, la conservation du patrimoine acquiert une signification qui transcende les enjeux
historiques ou esthétiques, pour intégrer les grands défis de la ville future en opposition avec la
préservation d’un « décor urbain » qui a trop souvent mené à des dérives, comme le «façadisme »
ou le « syndrome Disney », niant complètement la valeur « matérielle » du patrimoine. Cette
réflexion exclut néanmoins toute conservation strictement muséale. L’attrait d’une ville émane de la
diversité de ses architectures, de ses espaces verts et non bâtis. Les intégrer dans la vie
contemporaine signifie aussi les continuer. Cette continuation se construit par la différence, à
condition que la juxtaposition des signes relève d’une juste articulation. Les éléments
contemporains, construits ou plantés, réputés valorisants pour la ville, le deviennent effectivement à
condition de respecter ce principe et les règles morphologiques que sous-tend celui-ci. Ils ne
peuvent l’être lorsqu’ils sont fichés dans le tissu urbain comme des objets indépendants et
autonomes. La remarque vaut encore davantage pour les interventions sur le patrimoine protégé
auquel la collectivité a conféré un statut rare et particulier. Toute articulation pertinente s’inscrit
également en faux contre l’exclusion mutuelle : elle suppose le dépassement des antagonismes et
des contradictions. La recherche de la coexistence et de la compatibilité passe par l’établissement,
au cas par cas, d’une hiérarchie des priorités refusant l’assimilation ou l’amalgame – c’est-à-dire
toute banalisation.
Trouver le juste rapport entre une tradition urbaine millénaire et les mutations rapides de notre
environnement, de nos mentalités, de nos comportements, devrait être au centre des préoccupations
quotidiennes des décideurs et de leurs interrogations à tous les niveaux. La capacité d’une société de
se ressourcer, de se renouveler en portant plus loin les valeurs culturelles et sociales qui font sa
spécificité et sa richesse se mesure à la manière critique et inventive dont elle préserve son passé
pour y fonder son avenir.
L’Algérie, exemple d’Etat qui s’est profondément transformé, passant d’un modèle de
développement autocentré et urbano-industriel à une libéralisation masquée en œuvre depuis les
années 80, ce pays dont l’économie est prospère mais où les citoyens se sont appauvris, attend une
relance économique efficace et territorialement rééquilibrée.
Ce pays à la riche histoire, aujourd’hui décru par l’intensité de l’émigration de ses jeunes du fait des
faibles opportunités locales, compte une population rurale encore importante et peu productive, un
tissu industriel au bilan modeste. Le secteur des services se porte bien mieux, et le pays parie sur un
éveil touristique, s’appuyant sur une amélioration notable des infrastructures, notamment routières.
B. DURABILITE ET PATRIMONISATION :
Inverser le processus de dégradation qui affecte les centres historiques est une entreprise difficile :
elle nécessite des modifications importantes dans l’appréciation sociale du patrimoine urbain, des
politiques et des pratiques des gouvernants. Les interventions pour la réhabilitation du patrimoine
urbain, afin qu’elles soient effectives et utiles, ne doivent pas seulement réhabiliter la structure
physique des centres historiques (espaces publiques et bâtiments emblématiques). Elles doivent
aussi dynamiser les processus sociaux et économiques en vue d’une utilisation efficace de
l’ensemble des édifices et structures et pour les entretenir de façon adéquate.
Cependant, lorsqu’il s’agit de définir des stratégies pour promouvoir la reviviscence du patrimoine
architectural urbain, on s’interroge beaucoup sur la part des responsabilités.
17
Une réflexion sur les expériences internationales de préservation du patrimoine et de revitalisation
des quartiers historiques suggère trois chemins principaux pour promouvoir les changements
nécessaires :
- La revitalisation de secteurs historiques (édifices et espaces publics qui forment un ensemble
cohérent) avec une large participation de tous les acteurs, du fait de leur capacité à générer des
projets durables à long terme. Ces projets impliquent des défis institutionnels importants étant
donné la diversité des protagonistes concernés et les longs délais nécessaires pour réaliser les
investissements
- La protection du patrimoine en tant que catalyseur de processus majeurs de revitalisation urbaine,
en raison de sa capacité à générer des bénéfices généraux de développement urbain
- La promotion de la réhabilitation moyennant des motivations (exonérations fiscales) ou de
régulations, stratégie qui transfère une part importante de l’effort de protection au secteur privé et
aux organismes de la société civile.
La notion de développement durable est née d’une inquiétude bien partagée : celle d’un
développement économique mondial entraînant un amenuisement et une dégradation des milieux
ambiants. Pour cela, le développement durable peut être défini comme étant un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre le futur. En ce sens, toute définition du
développement durable doit inclure trois dimensions interdépendantes (économique, sociale et
environnementale) qui constituent sa base.
Tous les efforts visant la promotion de développement durable doivent soutenir les trois dimensions
en même temps.
- La première composante de DD, l’économique exige de la société qu’elle opte pour une croissance
capable de générer durablement un accroissement du revenu réel, au lieu des politiques qui
débouchent sur l’appauvrissement à long terme.
Paul Hawken décrit la durabilité comme un état économique dans lequel les demandes imposées à
l’environnement par la population et le commerce peuvent être satisfaites sans que l’on doive
réduire la capacité de subvenir aux besoins des générations futures.
- La deuxième composante, sociale, est basée sur l’égalité des chances. Ceci veut dire que dans
une société donnée une croissance viable à long terme, nécessite un partage des chances qui permet
à chacun d’accéder à une qualité de vie minimale en terme de sécurité, des droits de l’homme et
d’avantages sociaux. La dimension sociale de DD exige également la participation active sur le plan
politique de tous les secteurs sociaux ainsi que la responsabilité du gouvernement devant
l’ensemble du public en ce qui concerne la mise en place des mesures sociales.
- La dernière dimension du DD est fondée sur la nécessité de préserver l’environnement, et partant à
long terme des systèmes et des infrastructures urbaines et écologiques qui conditionnent la vie des
individus.
Ce constat exige que les biens et services environnementaux soient utilisés de façon à ne pas
diminuer la productivité du milieu naturel ni à affaiblir la contribution de ces biens et services au
bien-être de l’humanité. Dans un contexte mondial, marqué par une forte croissance des villes et des
mégapoles, où vivront bientôt la majorité des habitants de la planète, la maîtrise du développement
urbain devient un enjeu essentiel, tant pour les politiques d’urbanisme, d’habitat et de construction,
que pour l’organisation des services essentiels (eau, électricité, transports). Cela conduit à des
perspectives intéressantes pour la définition d'une politique de développement durable :
18
1. Le contenu d'une politique urbaine de développement durable
Il s'agit d'une politique qui prend sa source dans une connaissance approfondie des patrimoines. En
effet, la formation des patrimoines culturels matériels et immatériels n'existe que dans la durée et
exige un fort investissement permanent sur les milieux naturels. Il est essentiel de souligner que ce
sont les ruptures dans la transmission des savoirs qui nous conduisent trop souvent à construire sur
des bases erronées, décalées ou insuffisantes. Nous le constatons notamment dans les champs si
visibles de l'urbanisme, de l'aménagement, de la construction. Mais, c'est la même chose dans
d'autres domaines, par exemple ceux de l'éducation, de la culture. La politique du patrimoine ne
peut se passer de l'histoire du milieu dans lequel elle s'inscrit.
C'est aussi une politique qui doit s'enraciner dans les territoires. La diversité des territoires ne doit
pas aboutir à la fragmentation des espaces. La durabilité de nos actions reste liée à notre capacité à
intervenir aux bonnes échelles, à savoir articuler entre elles les échelles pour aller vers la cohérence,
la synergie et le mouvement. En matière de politique urbaine, nous allons de la rue au quartier, à
l'agglomération et inversement. Nous devons rechercher les liens, les complémentarités entre
territoires en diffusant les valeurs repérées, les éléments positifs d'un territoire à l'autre. Dans cette
perspective, le rapprochement entre le développement touristique des sites et la politique du
patrimoine est particulièrement intéressant. Il permet de structurer un développement urbain
harmonieux autour de sites attractifs. Aussi, la cohérence des espaces est-elle la première règle à
respecter pour que la politique du patrimoine soit réussie.
C'est enfin une politique qui doit prendre en compte les populations dans leur diversité,
particulièrement les plus défavorisées pour les relier aux autres et les entraîner dans les réseaux
d'éducation, de culture, de développement. L'exode rural et la transition démographique ont
provoqué une explosion démographique dans la ville de Nédroma, dans laquelle la structure urbaine
n'était pas assez solide pour recevoir ces nouvelles populations. A l'urgence des problèmes
d'habitation n'a pas répondu une politique patrimoniale adaptée, concertée, et surtout durable. Il
existe donc une menace de destruction du patrimoine urbain par les nouvelles populations, qui
risque de freiner - voire de bloquer - le développement de la ville. La pérennité des politiques
d'aménagement repose ainsi sur la lutte pour l'intégration des plus marginalisés. C'est en ce sens que
la durabilité est synonyme de progrès social et culturel, que la sauvegarde du patrimoine des villes
est indissociable d'une politique de développement durable.
2. Acteurs de la politique de développement durable
La mise en oeuvre d'une politique de développement durable passe par ce qu'on a appelé le « projet
d'aménagement et de développement durable » qui s’identifie à un document stratégique. Ce
document s'établie à partir de trois domaines de connaissance à savoir : le patrimoine, le territoire
et la population. Il est fondé sur des analyses clairvoyantes et exhaustives et trouve toute sa force et
sa légitimité dans la dimension égalitaire qu'il doit prendre tout au long de sa gestation. Un projet
professionnel solide n'a de chance d'être réalisé que s'il est pris en charge par les habitants, qui se
l'approprient afin qu'il devienne une référence permanente pour l'action des multiples acteurs. Le
programme de la ville de Fès en est un sérieux exemple. La réussite d'un projet tient tout autant à la
légitimité qu'il a pour les habitants qu'à sa mise en oeuvre concrète.
Les acteurs du développement se situent à plusieurs niveaux. Les organisations internationales en
charge du développement (N.U. et U.E.) avec leurs fonds d'interventions et leurs opérateurs jouent
un rôle majeur dans l'éducation et la culture (UNESCO). Il ressort toutefois des différentes
interventions que le soutien des États aux institutions internationales reste très en deçà du niveau
requis. Les grandes conférences internationales telles que celles de Rio, Johannesburg et Kyoto ont
toutes mis l'accent sur les constats dramatiques de l'état de la planète concernant l'environnement.
19
Pourtant, la réussite de la session « Villes et patrimoine », organisée par l'Unesco, montre bien qu'il
existe une prise de conscience, par de nombreux acteurs, de l'utilité d'une coopération
internationale autour de la sauvegarde et de la réhabilitation du patrimoine, vecteurs de cohésion
sociale, de protection et de promotion de cet environnement.
Le développement remarquable d’actions bilatérales et de coopérations décentralisées que
favorisent de plus en plus certains États constitue par ailleurs une nouvelle voie pleine de promesses
qu'il faut étendre et mieux organiser en y insufflant une participation active des collectivités et des
populations. Citons encore le rôle des agences d'Etats et des ONG qui s'inscrivent dans cette
démarche de terrain dans les multiples domaines de la protection du patrimoine
Avec quels outils tous ces acteurs peuvent-ils intervenir ?
- D'abord les outils juridiques qui donnent la légitimité nécessaire à toute intervention. On peut citer
les grandes conventions internationales, par exemple la convention de 1972 sur le patrimoine
universel de l'humanité et les conventions bilatérales de coopération entre Etats et entre
collectivités territoriales.
- Puis les outils techniques que sont les instruments de la planification et de la programmation à
savoir les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde
et de mise en valeur, les zones de protection du patrimoine, les chartes des parcs naturels.
- Enfin les outils d'intervention que sont les fonds d'aides aux populations alimentés par des taxes
locales et des dotations nationales et internationales, qui sont nécessaires à la coordination entre les
politiques sociales et urbanistiques.
V. CONCLUSION
En définitive, le concept du développement durable doit prendre une dimension concrète et
opérationnelle à tous les degrés. Il s'agit d'une politique globale qui doit être portée par la
coopération internationale mais trouver en même temps sa dimension locale avec le soutien actif
des collectivités locales et des habitants. Au-delà des aspects techniques, cette politique n'a de sens
que si elle s'inscrit dans une démarche d'explication, de compréhension et de participation
permanente.
20
BIBLIOGRAPHIE ALDOU, M. L'émigration vers la métropole des travailleurs musulmans de la commune-mixte
de Nédroma Inédit. Bibl. du CHEAM, Paris, 1946.
BASSET, René. Nédromah et les Traras. Paris, Leroux, 1901.
BEL, Alfred. Nédroma, métropole musulmane des Trara. Alger, 1934. (Bulletin de la Société
de Géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord, N° 140).
. CANAL, Joseph. Monographie de l'arrondissement de Tlemcen. Nédroma et les
Traras. Oran, 1988. (Bulletin de la Société d'Archéologie et de Géographie d'Oran, t.
VIII).
DIDELON, Gaston. Monographie économique de la commune mixte de Nédroma.
Inédit. Bibl. du CHEAM, Paris, 1941.
GENIAUX, Charles. Nédroma Revue des Deux-Mondes, l ` février 1922.
JANIER, Emile. Inscriptions arabes de Nédroma. Oran, L. Foulque, 1947. LEON
L'AFRICAIN. Description de l'Afrique. Ed. Schaeffer, Paris, 1898.
LLABADOR, Francis. Nemours (Djemâa-Ghazaouât). Alger, Carbonel, 1948.
MARÇAIS,Georges. La chaire de la grande mosquée de Nédroma. in Cinquantenaire de la
Faculté des Lettres d'Alger. Revue Africaine, 1932, p. 321-331.
MARCAIS,William. Le dialecte arabe parlé à Tlemcen. Paris, Leroux, 1902. MAUPRIX
(de), M. Six mois chez les Traras. Paris, Le Tour du Monde, 1889.
PRENANT-THUMELIN, Marie-Anne. Nédroma 1954. Alger, 1967. Annales Algériennes de
Géographie, N° 4, 1967, p. 21-64.
ROHRBACHER, Julien. Monographie de Nédroma. Inédit. Bibl. du CHEAM,
Paris, 1938.
SARI, Djilali. L'évolution récente de trois villes pré-coloniales : Mazouna, Nédroma, Al-
Kalaa. Thèse inédite. Institut de Géographie, Alger, 1969.
SARI, Djilali. L'évolution récente d'une ville pré-coloniale en Algérie occidentale
Nédroma. Tunis, 1968. Revue Tunisienne de Sciences Sociales N° 15, 1968, p.217 à 236.
SARI, Djilali. Nédroma 1966. Alger, 1967. Annales Algériennes de Géographie, N° 4, 1967, p.
64-71.
VIALATTE DE PEMILLE, Jean. L'émigration des Nédromis en France. Inédit.
Bibliothèque du CHEAM, Paris (étude portant sur les années 1945-1950). .
Augé M., 1997, L’impossible voyage, le tourisme et ses images, Paris, Rivages poche, 187 p.
Authier J-Y., 1993, La vie des lieux, un quartier du Vieux Lyon au fil du temps, Lyon, Presses
Universitaires de Lyon, 268 p.
Authier J-Y., 2003, La gentrification du quartier Saint-Georges à Lyon : un côtoiement de mobilités
différenciées, in Bidou-Zachariasen C. et al (coord.), Retours en ville, Paris, Descartes, p. 105-126.
Baby J-P., 2003, Réflexions et propositions pour une politique nationale du patrimoine (Etat,
Collectivités territoriales, secteur privé), Paris, Commission "Patrimoine et décentralisation",
Ministère de la culture. 53 p.
Baleynaud P., 1986, Le rôle des collectivités locales : l’exemple de la ville de Tours, in Jegouzo Y.,
Droit du patrimoine culturel immobilier, Paris, Economica, p. 155-177.
Bourdin A., 1984, Le patrimoine réinventé, Paris, PUF, 239 p.
Bourdin A., Lefeuvre M.-P., Melé P., 2003, Les qualifications juridiques de l’espace : structures de
confiance de l’habitat, Rapport final, pour Plan Urbanisme Construction Architecture, Ministère de