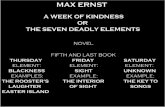POUR UNE RECONNAISSANCE, UNE MOBILISATION ET UNE SYNERGIE DES COMPETENCES ET APTITUDES À...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of POUR UNE RECONNAISSANCE, UNE MOBILISATION ET UNE SYNERGIE DES COMPETENCES ET APTITUDES À...
POUR UNE RECONNAISSANCE, UNE MOBILISATION ET UNE SYNERGIE DES
COMPETENCES ET APTITUDES À L’INNOVATION DURABLE
DE PETITES ORGANISATIONS TOURISTIQUES
Thématique : adaptation des métiers et des compétences
Auteurs :
Anthony FREMAUX
Docteur en Sciences de l’Education (Equipe post-doctorale de Remi HESS et Patrice VILLE,
Laboratoire EXPERICE)
Fondateur et Directeur de LIGAMEN http://ligamen.fr
Courriel : [email protected]
Axel FRICK
Chef de projet et formateur
Association Citoyens de la Terre
Développement soutenable - Economie responsable et solidaire
Courriel : [email protected]
Corinne VAN DER YEUGHT
Maître de conférences
IAE, Université du Sud Toulon-Var
Groupe de Recherche en Management (GRM, EA 4711)
Courriel : [email protected]
INTRODUCTIONCet article est fondé sur une recherche-intervention (RI) réalisée au sein d’un réseau de petites
organisations (PO) touristiques situées sur le Pays d’Aubagne et de l’Étoile (PAE, par la suite)
et coordonnées par l’association Citoyens de la Terre (CT) dans le cadre d’une démarche
collective de progrès en faveur du développement durable, la démarche Eveil-Tourisme.
L’étude met en évidence l'importance des capacités dynamiques développées par les acteurs
(capacité à coopérer, capacité d'apprentissage collectif) et elle s’appuie sur une typologie des
compétences dont la mobilisation nous paraît essentielle au développement d'une filière
« tourisme durable ». L’étude montre le rôle essentiel de l'animation territoriale réalisée par
CT pour mobiliser les acteurs, mettre en synergie leurs compétences, identifier leurs besoins,
mobiliser les ressources du territoire, organiser des ateliers collectifs et des échanges
d'expériences, et faire émerger des projets communs. À ce titre, les données recueillies auprès
des PO participant à la démarche Eveil sont retraitées à l’aide des arbres de connaissances
afin de proposer une cartographie dynamique des compétences, des projets et des ressources
d'apprentissage portés par le collectif étudié. Les arbres de connaissances constituent, en effet,
des objets médiateurs qui contribuent au travail d'animation territoriale assuré par
l’association CT. Ils offrent une cartographie dynamique qui facilite la reconnaissance des
atouts de chaque acteur pour le collectif et un repérage des complémentarités de compétences
entre acteurs, à partir des expressions d'offres, de demandes et de ressources d'apprentissage.
Ce support interactif facilite ainsi les implications, les mises en relations et il aide
objectivement aux coopérations. L’article présente de façon synthétique la démarche Eveil-
Tourisme, puis il expose les résultats de la recherche intervention réalisée, à l’intersection
entre Sciences de gestion et Sciences de l’éducation, avant de montrer l’intérêt des arbres de
connaissances dans la perspective d’une évolution de la démarche Eveil, voire de son transfert
vers d’autres acteurs ou territoires.
1. LA DÉMARCHE EVEIL-TOURISME
La démarche Eveil a été élaborée dans le Sud de la France entre 2004 et 2006 par
l'association Citoyens de la Terre, appuyée par les institutions locales, et par un petit groupe
de professionnels réputés pour leurs pratiques touristiques durables1. Grâce à l’expérience
1 Centre permanent d’initiation à la forêt provençale, Loubatas à Peyrolles-en-Provence (premier éco-gîte des Gîtes de France), Marais du Vigueirat en Camargue (site écotouristique certifié E-MAS), CPIE Côte provençale à la Ciotat (centre de loisirs écotouristiques), Parc Aoubré, parc privé de loisirs en forêt dans le Var, labellisé PEFC.
accumulée sur plusieurs années, ces professionnels ont conçu deux outils de gestion qui sont
aujourd’hui encore au centre du dispositif : 1) la Charte « Eveil-Tourisme et loisirs
responsables et solidaires » qui rappelle les enjeux du tourisme au regard de la durabilité,
justifie une approche responsable et solidaire, et stipule les principes de responsabilité
formalisant les valeurs portées par les membres du réseau ; 2) une grille d’évaluation des
pratiques professionnelles touristiques qui traduit en 65 critères très concrets les valeurs et les
principes énoncés dans la charte. À partir de 2007, l’association Citoyens de la Terre (CT)
propose d'expérimenter la démarche Eveil dans le cadre d'un projet de développement
territorial durable. Jugeant la démarche Eveil innovante et cohérente avec son projet d'Agenda
21, la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (PAE) apporte son
soutien à CT pour la développer sur son territoire. D'autres institutions locales2 intéressées par
la démarche Eveil deviennent partenaires du projet. Conçue comme une expérimentation
collective visant à favoriser les innovations en faveur de pratiques responsables et durables, la
démarche Eveil fait l’objet d’un projet pilote sur le PAE depuis 2007. Elle s’articule en quatre
étapes principales : 1) Le service tourisme du PAE et CT identifient des professionnels
susceptibles d’être associés à la démarche, puis les réunissent pour une réunion de
sensibilisation et de concertation. Pour intégrer le collectif, les professionnels doivent
s’engager dans un processus d’amélioration continue et signer la Charte marquant ainsi leur
engagement. 2) Les professionnels effectuent ensuite une première autoévaluation de leurs
pratiques au regard des 65 critères de la grille Eveil, puis le responsable de projet (CT) se rend
dans l’entreprise à périodes régulières pour vérifier les résultats obtenus et il affecte une note
sur 100 (indice de progression) à l’issue de chaque évaluation. 3) À chaque visite, un plan
d’action est co-construit avec le professionnel afin de déterminer ses objectifs de progrès. 4)
CT et la collectivité territoriale apportent ensuite différents services de soutien et de
valorisation (sous contrainte des moyens techniques et financiers disponibles) en fonction des
objectifs poursuivis et des difficultés rencontrées. En 2012, le réseau Eveil comptait 17
participants sur le PAE se répartissant de la façon suivante : trois artisans (deux céramistes, un
santonnier), deux restaurants, six hébergeurs (une résidence hôtelière, un hôtel, un camping,
un gîte, deux meublés), trois structures de loisirs, un centre de congrès, l’Office de Tourisme
du Pays d’Aubagne, et une agence de voyage.
Les résultats de cette recherche-intervention sont organisés en deux temps. Dans un premier
temps, l’étude retrace l’analyse effectuée en termes de capacités dynamiques et de
2 Conseil régional PACA, Conseil Général 13, DREAL PACA
compétences en management du développement durable dans le cadre du réseau Eveil étudié.
Dans un second temps, les données recueillies sont traduites sous formes d’arbres de
connaissances.
2. LES CAPACITÉS DYNAMIQUES ET LES COMPÉTENCES GÉNÉRÉES DANS LA DÉMARCHE ÉVEIL
2.1 Définition des capacités dynamiques et proposition d'une typologie de compétences
Les capacités dynamiques (CD) sont généralement conceptualisées, en Sciences de gestion,
comme une classe spécifique de capacités intéressées par le changement et l’innovation, une
sorte de meta-capacité gouvernant les processus organisationnels d’adaptation et faisant
intervenir l’apprentissage (Helfat et Peteraf, 2003 ; Zahra et al., 2006 ; Piening, 2011). Nous
retiendrons la classification d’Ambrosini et al. (2009) qui distingue trois niveaux de CD : 1)
les CD incrémentales, appropriées aux environnements stables, et correspondant à des
changements mineurs de la base de Ressources et de Compétences (R & C), les auteurs citent
comme exemples les réductions des déchets ou des consommations énergétiques ; 2) les CD
de renouvellement, caractéristiques des environnements changeants, impliquant la création,
l’extension ou la modification de la base de R & C (Helfat, 2007, p. 1) ; 3) les CD
régénératives nécessitant des capacités d’apprentissage afin d’agir sur les deux niveaux
précédents et se traduisant par une action indirecte sur la base de R & C.
Par ailleurs, quatre dimensions de la compétence ont pu être distinguées dans la littérature, la
quatrième étant reliée aux CD : 1) la dimension cognitive (qui englobe, dans le cadre de
l’étude effectuée, l’identification des enjeux stratégiques, les connaissances liées au DD, à la
RSE, à l’éthique, la prise en compte de la complexité, l’identification des valeurs stratégiques
mobilisatrices dans l’organisation, et de façon générale tous les apprentissages en simple
boucle) ; 2) la dimension fonctionnelle (qui porte sur la planification et la mise en œuvre de la
stratégie, toutes les fonctions du management (achats, production, commercialisation),
approche « métier », gouvernance, reporting) ; 3) la dimension relationnelle ou
comportementale (capacités relationnelles, managériales et coopératives) ; et 4) les méta-
compétences qui favorisent le développement de CD de niveau supérieur en stimulant les
apprentissages en double boucle (capacités réflexives, aptitude à l’expérimentation et à
l’innovation, organisation apprenante, capacité à déjouer les pièges de l’apprentissage
organisationnel) (Delamare Le Deist et Winterton, 2005 ; Van der Yeught et al., 2012).
2.2 Analyse des capacités dynamiques et des compétences développées par les acteurs Eveil
Afin de vérifier l’existence ou la création de CD, nous avons analysé les données collectées
par le biais de différentes méthodes : étude documentaire des différents supports produits par
l’association depuis 2007 (en particulier, les résultats obtenus par les participants Eveil lors
des évaluations effectuées à partir de la grille en 65 critères élaborée pour suivre leurs progrès
et le suivi des plans d’action mis en œuvre) et de tous les comptes-rendus de réunions depuis
2007 ; observation simple et participante depuis 2009 ; entretiens semi-directifs auprès des
responsables de l’association (une vingtaine au total d’une durée moyenne de deux heures) ;
entretiens semi-directifs auprès des 17 participants actifs dans la démarche en 2012. Nous
avons ainsi retracé tous les changements intervenus dans les compétences, les ressources et
les routines de chaque participant depuis son entrée dans la démarche. Les notes obtenues aux
évaluations Eveil et leur évolution sur la période d’engagement constituaient des preuves
tangibles de changement, mais ne pouvaient, seuls, signifier l’existence de CD. Pour identifier
les compétences générées dans le cadre de la démarche, les grilles d’évaluation ont été
analysées afin d’établir la liste de toutes les compétences en DD et RSE (principalement
fonctionnelles et relationnelles) qui ont ensuite été classées à partir du modèle des
compétences en management du DD proposé par Van der Yeught et al. (2012) autour des
quatre dimensions : cognitive, fonctionnelle, relationnelle et méta-compétence. L’étude
réalisée conduit ainsi à une première série de résultats.
Premièrement, grâce à l’innovation organisationnelle que constitue le réseau Eveil autour de
l’association CT, les PO membres peuvent en partie compenser les limites inhérentes à leur
petite taille : elles bénéficient des expérimentations réalisées par les premiers professionnels
militants et les autres participants ; elles explorent à moindre coût de nouvelles routines
permettant de répondre plus rapidement aux changements de l’environnement concurrentiel ;
elles sont mises en réseau ce qui accroît leur capital relationnel et favorise la coopération ; en
cas de difficulté, un soutien leur est proposé ; elles développent des apprentissages
organisationnels et inter-organisationnels qui stimulent la montée en compétence dans les
quatre dimensions retenues pour cette étude.
Deuxièmement, au niveau organisationnel, l’étude met en évidence une dynamique du
changement sollicitant les trois niveaux de CD identifiés et se traduisant par une plus grande
aptitude à l’innovation des participants. Centrés sur une approche « métier », ces derniers
innovent le plus souvent dans les procédés et plus rarement dans les produits. L’étude montre
toutefois que même les organisations ne dépassant pas le premier niveau de CD peuvent
innover. L’ensemble des expérimentations réalisées par les participants vient enfin alimenter
le réseau et contribue à réduire les coûts de recherche et d’exploitation des autres participants.
Ainsi, quasiment tous les participants démontrent une aptitude à l’innovation : certains ont
même réalisé des innovations produit relativement ambitieuses dans une perspective de
durabilité ou projettent de le faire, la plupart ont investi dans des innovations procédés.
Troisièmement, l'étude montre que la montée en compétence suscitée dans le réseau Eveil
porte sur les quatre dimensions identifiées par Van der Yeught et al. (2012) : cognitive,
fonctionnelle, relationnelle et méta-compétence. L’intégration au sein du réseau Eveil permet,
en effet, aux participants qui le souhaitent d’enclencher ou d’entretenir un cycle
d’apprentissage en favorisant la variation générative exploratoire tout en réduisant les coûts
qu’elle engendre (Zollo et Winter, 2002). La sélection interne est ensuite facilitée par les
échanges entre les responsables des structures et CT, en particulier lors de la co-construction
des plans d’action. La signature de la Charte Eveil marque l’engagement des participants et
les fédère autour d’un socle de valeurs partagées, signalant ainsi leur prise de conscience et
leur volonté d’entrer dans un processus de changement. Cependant, la capacité d’absorption
de chacun reste déterminante dans le processus d’appropriation. Certaines entreprises ont
ainsi rapidement progressé puis stagné à partir du moment où le responsable de la structure a
changé. L’appropriation des nouvelles compétences (rétention) peut être observée dans
chaque organisation ou plus globalement au sein du réseau. Certaines actions sont ainsi mises
en œuvre chez plusieurs participants : maîtrise des consommations d’eau, d’énergie, de
matières premières (avec des investissements plus ou moins lourds) ; accueil des personnes
handicapées (avec des équipements plus ou moins ambitieux) ; volonté de réduire les déchets
liés à l’exploitation (avec des contraintes liées à l'organisation du tri sélectif sur le territoire) ;
achats de produits bio, locaux, labellisés. La rétention dépend également tout à la fois de
chaque organisation et des efforts déployés par CT au niveau collectif pour articuler et
codifier les nouvelles compétences et routines générées : entretiens d’évaluation, plans
d’action co-construits, fiches de synthèse par acteur, guide des bonnes pratiques sur les
différentes thématiques du développement durable.
3. ARBRES DE CONNAISSANCES DES ACTEURS EVEIL, DES PROJETS ET DES RESSOURCES D'APPRENTISSAGE
Les données recueillies auprès des acteurs Eveil ont été traitées par la société Ligamen afin de
générer une cartographie dynamique des compétences des acteurs, des projets et des
ressources d'apprentissage. Les outils et méthodes de cartographie de compétences
développés par Ligamen (Frémaux et al., 2010) sont inspirés des démarches des arbres de
connaissances (Authier et al., 1992, 1998) et des réseaux d'échanges réciproques de savoirs
(Hébert-Suffrin et Hébert-Suffrin, 2009), enrichies des apports du Web 2.0. Les interventions
à l'aide de ces outils et méthodes sont inspirées des approches de la pédagogie institutionnelle
(Hess, 1975, 2008), pédagogie coopérative et de la socianalyse, sociologie participative
(Lourau, 1997 ; Ville, 2001). Dans un premier temps, nous avons traité les données recueillies
auprès des acteurs Eveil afin de générer une cartographie des compétences portées par le
groupement d'acteurs. Il s'agit du pôle des offres, dans le sens où cette cartographie rend
visibles les compétences sur lesquelles les acteurs acceptent d'être sollicités pour des échanges
d'expériences. Puis nous avons cartographié le pôle de demandes et le pôle des ressources. Le
dispositif permet, en effet, les expressions et la visualisation de besoins de compétences et de
ressources d'apprentissage.
3.1 Arbres de connaissances des acteurs Eveil
Un arbre de connaissances des acteurs se construit collectivement à partir de la production et
de la mise en commun par chaque acteur de sa page Web de présentation de ses intérêts et de
ses compétences, à l'aide d'une terminologie commune et de consignes d'écriture. Ces pages
Web « Collaborateur » peuvent aussi être générées semi-automatiquement à partir de données
déjà recueillies auprès des acteurs, mutualisées au sein d'un fichier Excel par exemple. C'est
cette option que nous avons retenue vu la richesse des informations recueillies précédemment,
via le questionnaire Eveil et les entretiens semi-directifs réalisés auprès des participants.
Chaque page Web est composée de la liste des compétences que l'acteur a développées lors de
diverses actions de DD, par exemple la maîtrise des consommations en énergie et en eau ou
encore l'accueil de personnes porteuses de handicap3. Un algorithme de cartographie met en
rapport l'ensemble de ces pages Web de présentation des richesses de chaque acteur pour
générer automatiquement un arbre de connaissances, cartographie dynamique de l'espace
3 Nous ne développons pas dans cet article le mode de validation des compétences dont notre approche se résume ainsi : « une façon de prouver une compétence est de partager ses connaissances du problème en question. »
commun de compétences généré collectivement par le groupement d'acteurs. Cette
cartographie permet une vision globale de l'ensemble des richesses humaines portées par cet
écosystème d'acteurs et une visibilité des liens que les acteurs tissent entre elles. (cf. figure 1).
Figure 1 : cartographie du groupement des 17 acteurs EVEIL
Chaque brique de l'arbre représente un élément de compétence, par exemple, « 1451
Concevoir une politique d'achat responsable », « 4252 Travailler un partenariat pour
mutualiser des déchets », « 4135 Installer des équipements économes en énergie », « 1224
Concevoir un jardin sec ou économe en eau ». Le tronc de l'arbre représente les compétences
les plus partagées par les acteurs, leur culture commune, en quelque sorte, et les branches
indiquent des agrégats ou « clusters » de compétences, individuels (vert clair) ou collectifs
(marron). Conformément aux résultats de la RI, parmi les compétences présentes dans le
tronc, on repère des compétences de type « relationnel » ainsi que des méta-compétences,
« 4452 Travailler en partenariat pour une offre commune de tourisme », « 4554 Participer à
une action locale de partage d'expériences », « 5154 Informer ses usagers sur les modes de
transport doux ou collectifs » ou encore « 4554 Participer à une action locale de promotion du
territoire ». La cartographie permet aussi une visibilité du positionnement de chaque acteur
par rapport à la communauté d'intérêt, en termes de points communs et de différences (cf.
figure 2).
Figure 2 : Visualisation du positionnement d'un acteur
L'arbre de connaissances, Figure 2, rend visible la position d'un acteur par rapport au
groupement des acteurs Eveil. Les briques en jaune correspondent aux compétences de son
profil. Les briques dans le tronc indiquent les compétences qu'il partage le plus avec les autres
acteurs, et les briques dans les branches, celles qui le différencient des autres, ses spécificités.
Un arbre de connaissances permet ainsi une reconnaissance par différenciation du profil
singulier de chaque acteur et, en identifiant les compétences communes et spécifiques de
chacun des acteurs, en repérant les complémentarités, la mise en réseau des acteurs est
favorisée afin que puissent émerger des projets communs sur diverses thématiques.
3.2 Les arbres de connaissances : un jeu à trois rôles (cf. figure 3)
Un arbre de connaissances des acteurs a été généré à partir des expressions d'offres de
compétences au sein de pages Web « Collaborateur ». Pour chaque acteur, on a en effet listé
les compétences sur lesquelles il accepte d'être sollicité pour des échanges d'expériences ou la
mise en place projets communs. Il s'agit du pôle des offres.
Nous avons ensuite produit des pages Web « Projet » qui listent et ordonnent les compétences
requises à la réalisation d'un projet, individuel ou collectif, par exemple, le plan d'action Eveil
de chaque structure ou un projet commun d’élaboration d'un coffret de produits du terroir. Un
arbre de connaissances des projets a été généré à partir des expressions de ces besoins en
compétences. Il s'agit du pôle des demandes. Cette cartographie rend visible l'ensemble
structuré des compétences requises à la réalisation de projets ou d'actions répondant à une
stratégie de développement. Ainsi, chaque acteur peut visualiser son positionnement par
rapport à ses projets de DD et repérer avec quels autres acteurs il devra s'associer pour
couvrir, ensemble, les besoins propres à tel projet ou appel à projet.
Un troisième rôle consiste à produire des pages Web « Ressource » , qui présentent les
ressources d'apprentissage proposées dans un atelier de sensibilisation, dans un guide écrit ou
un module de formation, et à lister les compétences que vise à développer cette ressource
d'apprentissage. Un arbre de connaissances des ressources a été généré à partir de ces
expressions de ressources. Cette cartographie rend visible l'ensemble structuré des
compétences que permettent d'acquérir les ressources disponibles au sein du groupement.
La mise en réseau des acteurs est ainsi facilitée par la visualisation des proximités entre
profils des acteurs (offres de compétences) et projets (demandes de compétences), ainsi que
par la visualisation des écarts entre offres et demandes, besoins qui peuvent être comblés par
la mobilisation de ressources d'apprentissage.
4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Grâce à l’innovation organisationnelle constituée par le réseau Eveil, les PO membres peuvent
compenser certains de leurs désavantages compétitifs, préciser ou réorienter et formaliser
leurs routines d’exploitation, enrichir leurs répertoires de compétences et leurs systèmes de
ressources, développer des CD de différents niveaux et innover (procédés, produit).
L’ensemble de la démarche stimule les apprentissages organisationnels et inter-
organisationnels et contribue à enrichir le réseau Eveil.
La montée en compétence suscitée dans le réseau Eveil porte sur les quatre niveaux identifiés
par Van der Yeught et al. (2012) : cognitif, fonctionnel, relationnel et méta-compétence. La
mise en réseau et les apprentissages générés par la démarche Eveil stimulent plus
particulièrement les compétences relationnelles et les méta-compétences des participants qui
compensent ainsi, du moins en partie, leurs insuffisances susceptibles d’entraver les processus
d’adaptation et d’innovation.
Au plan managérial, l’étude montre par conséquent qu’il n’y a pas de fatalité et que même des
PO disposant de capacités financières, stratégiques et managériales limitées peuvent
développer une aptitude à l’innovation et réaliser les mutations requises par l’évolution de
leur environnement stratégique. L’étude confirme néanmoins que certaines conditions sont
incontournables pour évoluer et innover : prise de conscience, volonté et capacité
d’absorption des participants restent des conditions sine qua non. L’adhésion aux valeurs et
principes stipulés dans la Charte Eveil ne dispense pas des efforts à déployer pour atteindre
les objectifs fixés.
Au-delà des apports indiqués, ce travail souffre néanmoins de limites que des études
ultérieures devront s’efforcer de repousser. Si le cas étudié apparaît relativement exemplaire,
son rayonnement potentiel reste, en l’état, circonscrit au périmètre de l’expérimentation. Nous
ne pouvons donc en déduire le caractère reproductible des résultats obtenus.
Les arbres de connaissances constituent-ils des supports adéquats pour développer et
transférer la démarche Eveil à d'autres territoires ou d'autres groupements d'acteurs ? Les
usages de cartographie dynamique des richesses humaines portées collectivement facilitent-
elles le développement de capacités dynamiques, la reconnaissance mutuelle de compétences
en DD et leurs synergies pour le développement d'une filière ? Les usages sociaux de ces
objets médiateurs facilitent-ils des convergences entre intérêts individuels et intérêts
communs ? Telles sont les questions que nous souhaitons explorer pour compléter les résultats
de la présente recherche.
Références bibliographiques
Ambrosini V., Bowman C., Collier N., (2009), “Dynamic Capabilities: An Exploration of
How Firms Renew their Resource Base”, British Journal of Management, vol. 20, S9-S24.
Authier M., Lévy P., (1992, 1998), “Les arbres de connaissances”, préface de Michel Serres,
La Découverte, Paris.
Delamare Le Deist, F., Winterton J., (2005), “What Is Competence?”, Human Resource
Development International, vol. 8, n° 1, 27-46.
Frémaux A., Arnaud M., D'Iribarne C., Ndordjii K, (2010), « Cartographier les connaissances
de communautés d'apprentissage : pour un autre rapport au savoir », actes du colloque
TICEMED.
Héber-Suffrin C et M., (2009), « Savoirs et Réseaux », Nice, Ovadia, préface de Philippe
Meirieu, Postface de André Giordan.
Helfat C. E., Peteraf M. A., (2003), “The Dynamic Resource-Based View: Capability
Lifecycles”, Strategic Management Journal, vol. 24, n° 10, 997-1010.
Helfat, C.E. (2007), “Dynamic Capabilities Foundations”, in C.E. Helfat, S. Finkelstein, W.
Mitchell, M.A. Peteraf, H. Singh, D.J. Teece, S.D. Winter, Dynamic capabilities:
Understanding Strategic Change In Organizations, Malden, MA: Blackwell Publishing, 1-18.
Hess R., (1975, 2008), La pédagogie institutionnelle aujourd’hui, Delarge, Paris.
Lourau R., (1997), « La clé des champs - Une introduction à l'analyse institutionnelle »,
Anthropos.
Piening E. P., (2011), “Insights into the process dynamics of innovation implementation. The
case of public hospitals in Germany”, Public Management Review, vol. 13, n° 1, 127-157.
Van der Yeught C., Bergery L., Frick A., (2012), « Quelles compétences pour un management
du développement durable dans les organisations ? », 21ème Conférence de l’AIMS
(Association Internationale de Management Stratégique), Lille, juin 2012.
Ville P. (2001), “Une socianalyse institutionnelle gens d’école&gens du tas”, Thèse d'Etat,
Paris 8.
Zahra S. A., Sapienza H. J., Davidson P., (2006), “Entrepreneurship and Dynamic
Capabilities: A Review, Model and Research Agenda”, Journal of Management Studies, vol.
43, 917-955.
Zollo M., Winter S. G., (2002), “Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic
Capabilities”, Organization Science, vol. 13, n° 3, 339-351.