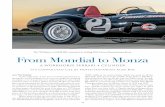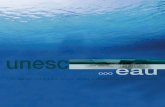Inscription au patrimoine mondial et dynamiques touristiques : le massif de l'uKhahlamba-Drakensberg...
-
Upload
univ-savoie -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Inscription au patrimoine mondial et dynamiques touristiques : le massif de l'uKhahlamba-Drakensberg...
INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL ET DYNAMIQUESTOURISTIQUES : LE MASSIF DE L'UKHAHLAMBA-DRAKENSBERG(AFRIQUE DU SUD) Mélanie Duval et Benjamin W. Smith Armand Colin | Annales de géographie 2014/3 - n° 697pages 912 à 934
ISSN 0003-4010
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2014-3-page-912.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Duval Mélanie et Smith Benjamin W., « Inscription au patrimoine mondial et dynamiques touristiques : le massif de
l'uKhahlamba-Drakensberg (Afrique du Sud) »,
Annales de géographie, 2014/3 n° 697, p. 912-934. DOI : 10.3917/ag.697.0912
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Armand Colin.
© Armand Colin. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
Inscription au patrimoine mondial etdynamiques touristiques : le massif del’uKhahlamba-Drakensberg (Afrique duSud)1
UNESCO World Heritage List inscription and touristdevelopment: the uKhahlamba-Drakensberg Park WorldHeritage site (South Africa)2
Mélanie Duval
Chargée de recherche CNRS – Laboratoire Edytem UMR 5204 CNRS/Université de Savoie ; RockArt Research Institute GAES, University of Witwatersrand.
Benjamin W. Smith
Winthrop Professor – Centre for Rock Art Research and Management, School of Social Sciences,University of Western Australia; Rock Art Research Institute GAES, University of Witwatersrand.
Résumé Cet article interroge les relations entre l’inscription au patrimoine mondial etles dynamiques touristiques, sous l’angle des freins dans la mise en place desynergies entre les registres patrimoniaux et touristiques. L’exemple du massif del’uKhahlamba-Drakensberg (Afrique du Sud), inscrit depuis 2000 au titre des biensmixtes, permet d’observer des décalages entre les effets initialement souhaitéspar les acteurs en matière de développement touristique avec l’inscription aupatrimoine mondial et la réalité des dynamiques touristiques engendrées. Cehiatus invite à rechercher les facteurs explicatifs de telles distorsions. À partir despièces constitutives du dossier UNESCO de 2000, des plans de gestion des acteursen charge du massif et de plusieurs campagnes de terrain (entre octobre 2009 etoctobre 2011), l’article vient souligner le rôle joué par des effets de sites, maisplus encore par les jeux d’acteurs et les modes d’association des populationslocales.
Abstract We consider the changing tourism and management dynamics that occur when asite is inscribed on the UNESCO World Heritage List. We use the example of theuKhahlamba-Drakensberg World Heritage Site (South Africa), a mixed natural andcultural property listed predominantly because of its beautiful southern alpinemountain scenery and its spectacular rock art. It was listed in 2000. This case
1 Cet article discute des dynamiques observées au sein du bien « uKhahlamba-Drakensberg Park », inscritau patrimoine mondial par l’UNESCO en 2000. Il ne prend pas en compte l’extension transfrontalièrede juillet 2013 qui inclut le parc national de Sehlabathebe au Lesotho et qui a conduit à une nouvelledénomination du bien : « Maloti-Drakensberg Park » (décision adoptée par le World Heritage Committee,WHC-13/37.COM/20 05/07/2013).
2 This paper focuses on what was termed the uKhahlamba-Drakensberg Park World Heritage Site (UDP),as inscribed in 2000 by UNESCO. It does not cover the recent transfrontier extension to include theSehlabathebe National Park on the Lesotho side from July 2013, which led to a change of name of theUNESCO site renamed Maloti-Drakensberg Park (Decisions adopted by the World Heritage Committee,WHC-13/37.COM/20 05/07/2013).
Ann. Géo., n° 697, 2014, pages 912-934, Armand Colin
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 912 — #48
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
Articles Inscription au patrimoine mondial et dynamiques touristiques • 913
study allows us to explore the gap between the tourism boom anticipated prior tonomination and actual post-inscription visitor numbers and management realities.Drawing upon the UNESCO nomination file, management plans and several fieldtrips (between October, 2009 and October, 2011), we start with an analysis of theUNESCO inscription process and the expectations at the time of nomination. Wethen consider the evolution of the post-inscription tourist dynamics and discussthe reasons behind the low visitor numbers realised at rock art sites and theimplications of this. Our comparative approach focuses upon the major rock arttourism sites and highlights the key importance of local tourism infrastructure andaccessibility in determining visitor numbers. Moreover we see the direct negativeeffects of stakeholder failing to cooperate and failing to realise sustainable localcommunity involvement. Besides the broad lessons that we can learn from thisexample we explore the ways in which stakeholders can be confronted and calledupon to deliver on their UNESCO World Heritage List nomination commitmentsregarding tourist development. Finally we discuss problems inherent to thecategory of mixed property as established by UNESCO.
Mots-clefs patrimoine mondial, tourisme, bien mixte, jeux d’acteurs territoriaux, art rupestre,massif de l’uKhahlamba-Drakensberg, Afrique du Sud.
Keywords World Heritage Site, tourism, mixed property, stakeholders, rock art, uKhahlamba-Drakensberg mountain, South Africa.
Introduction
En matière de développement touristique, les dynamiques patrimoniales consti-tuent une entrée privilégiée par les acteurs territoriaux, ces dernières participant àla valorisation des spécificités territoriales (Gauchon, 2010). Parmi les différentsclassements et autres formes de reconnaissance sociétale des valeurs patrimoniales,l’une d’entre elles tend, depuis une dizaine d’années, à fonctionner comme uneconsécration : l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.Le prestige conféré par cette reconnaissance internationale ainsi que les retom-bées touristiques attendues expliquent la « course à la labellisation » à laquelle lesacteurs territoriaux prennent part (Gravari-Barbas et al., 2012, p. 1-5). Selon lesterritoires, l’inscription est perçue comme un vecteur de développement touris-tique et/ou comme un moyen de requalifier une fréquentation jugée inadaptéeau lieu (Malgat, Duval, sous presse). Qu’il soit réel ou fantasmé, le rapport entretourisme et patrimoine mondial est tel que les retombées touristiques espéréesfonctionnent comme des moteurs dans le lancement des démarches d’inscriptionau patrimoine mondial et font partie de l’argumentaire. Sans pour autant qu’unecorrélation ait été formellement démontrée (Gravari-Barbas et al., 2012, p. 5-7),des covariations existent, au point que depuis 2005, les acteurs porteurs dela démarche sont tenus par l’UNESCO de joindre au projet d’inscription unplan de gestion indiquant les dispositions prises en vue de gérer les dynamiquestouristiques qui seront induites par l’inscription sur la liste du patrimoine mondial(UNESCO, 2005).
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 913 — #49
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
914 • Mélanie Duval, Benjamin W. Smith ANNALES DE GÉOGRAPHIE, N° 697 • 2014
Pour autant, ces effets d’entraînement sont loin d’être automatiques : il est desbiens pour lesquels l’inscription au patrimoine mondial, alors même qu’elle étaitpour partie envisagée par les acteurs comme un vecteur de développement touris-tique, ne s’accompagne pas d’une augmentation de la fréquentation touristique(Prud’Homme et al., 2008). Aussi, dans la continuité des réflexions développéespar plusieurs auteurs (Gravari-Barbas et al., 2012 ; Prud’Homme et al., 2008),cet article vise à mettre en exergue les pierres d’achoppement qu’il peut existerentre ces deux dynamiques. Il s’agira dès lors d’interroger les freins à l’activationd’effets rétroactifs positifs entre les entrées patrimoniales et touristiques.
Cette démonstration s’appuie sur le massif de l’uKhahlamba-Drakensberg Park(UDP), culminant à 3 400 mètres et situé à la frontière entre l’Afrique du Sud etle Lesotho, lequel est inscrit sur la liste du patrimoine mondial en tant bien mixtedepuis 2000 au titre de ses richesses paysagères et culturelles. Ce bien a fait l’objetd’une extension transfrontalière en juillet 2013 et inclut désormais le parc nationalde Sehlabathebe au Lesotho ; cette extension s’est traduite par un changementde nom, le bien se dénommant désormais « le parc Maloti-Drakensberg ». Apriori, les changements induits par la nouvelle configuration du bien inscrit surla liste du patrimoine mondial semblent minimes et secondaires par rapport à laproblématique abordée dans le présent article.
À partir des pièces constitutives du dossier UNESCO de 2000, des plans degestion des acteurs en charge du massif et de plusieurs campagnes de terrain (entreoctobre 2009 et octobre 2011), la réflexion part de la démarche d’inscriptionau patrimoine mondial, avec comme objectif de préciser le rôle joué par lessites d’art rupestre et leur mise en tourisme dans cette candidature. Ces pointsprécisés, l’évolution des dynamiques touristiques en lien avec l’inscription aupatrimoine mondial est discutée, ce qui conduit à souligner un hiatus entre lesambitions de développement touristique projetées par les acteurs et leur réalité.Une analyse comparée des sites d’art rupestre ouverts aux visites touristiquespermet alors d’identifier un certain nombre de freins à la mise en place dedynamiques touristiques, allant des effets de sites aux conséquences induitespar les jeux d’acteurs et par les modes d’association des populations locales. Infine, la réflexion porte sur les enjeux auxquels les gestionnaires de sites inscritsau patrimoine mondial peuvent être confrontés en matière de développementtouristique et invite à interroger les effets inhérents à la catégorie de bien mixteinstituée par l’UNESCO.
1 L’inscription au patrimoine mondial de l’humanité du massifde l’uKhahlamba-Drakensberg : entre enjeux patrimoniaux etprojets de développement touristique
1.1 Un bien mixte associant des critères naturels et culturels
En novembre 2000, l’uKhahlamba-Drakensberg Park (UDP) est inscrit sur laliste du patrimoine mondial par l’UNESCO en tant que bien mixte, au titre des
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 914 — #50
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
Articles Inscription au patrimoine mondial et dynamiques touristiques • 915
critères (i), (iii), (vii) et (x), les deux premiers renvoyant aux sites d’art rupestredu massif tandis que les deux suivants mettent l’accent sur la beauté naturelleexceptionnelle de l’escarpement et la richesse de la biodiversité (cf. encadré).
LES CRITÈRES D’INSCRIPTION DU MASSIF DE L’UKHAHLAMBA-DRAKENSBERG SUR LA LISTE
DU PATRIMOINE MONDIAL EN 2000
Critère (i) : l’art rupestre du Drakensberg constitue le groupe le plus important et le plusdense de peintures rupestres au sud du Sahara ; il est remarquable tant par sa qualitéque par la diversité de ses sujets.Critère (iii) : le peuple San a vécu dans la région montagneuse du Drakensberg pendantplus de quatre millénaires, laissant derrière lui un corpus exceptionnel d’art rupestrequi met en exergue son mode de vie et ses croyances.Critères naturels (vii) et (x) : la beauté naturelle exceptionnelle du site s’exprime dansses contreforts de basalte vertigineux, ses arrière-plans incisifs et spectaculaires et sesremparts de grès dorés. Elle est renforcée par les prairies de haute altitude, les valléesfluviales vierges encaissées et les gorges rocheuses. Les habitats très divers protègentde nombreuses espèces endémiques et des espèces menacées à l’échelle mondiale, enparticulier des oiseaux et des plantes.
Engagée depuis 1994 par l’agence provinciale en charge des questionsenvironnementales, Ezemvelo KwaZulu-Natal Wildlife (EKZNW), la démarched’inscription au patrimoine mondial s’inscrit dans la continuité d’un doubleprocessus de protection/patrimonialisation du massif et plus particulièrementdes ressources paysagères (Duval, 2013). Depuis le début du XXe siècle, unedizaine d’espaces protégés a, en effet, été créée tout le long de l’escarpement (cf.fig. 1). Les limites du bien inscrit au patrimoine mondial viennent en épouserles contours, intégrant les espaces protégés dans un seul et même document degestion.
Dans le même temps, l’inscription au patrimoine mondial marque un élargis-sement du spectre patrimonial, avec la prise en compte des sites d’art rupestre.Jusqu’alors protégés à l’échelle nationale par des lois génériques (Deacon, 1993),ils restaient secondaires dans les valeurs patrimoniales attribuées au massif. L’ins-cription en tant que bien mixte les place sur le même plan que les paysages et lesrichesses naturelles du massif (Duval, Smith, 2013).
Les missions d’EKZNW étant ciblées sur les volets environnementaux (main-tien de la biodiversité et développement de l’écotourisme), la gestion des sitesd’art rupestre est confiée à l’agence provinciale en charge des ressources cultu-relles, Amafa aKwaZulu-Natali (Amafa). Pour autant, la responsabilité du bieninscrit au patrimoine mondial revient à EKZNW, chargé du maintien des valeursuniverselles exceptionnelles ayant justifié l’inscription internationale du massif.
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 915 — #51
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
916 • Mélanie Duval, Benjamin W. Smith ANNALES DE GÉOGRAPHIE, N° 697 • 2014
Fig. 1 Les espaces protégés constitutifs du bien « uKhahlamba-Drakensberg Park », inscritau patrimoine mondial en 2000.
The natural protected areas within the UDP World Heritage Site inscribed in 2000.
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 916 — #52
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
Articles Inscription au patrimoine mondial et dynamiques touristiques • 917
1.2 Enjeux patrimoniaux et place des sites d’art rupestre dans le projetd’inscription au patrimoine mondial
L’élargissement des valeurs patrimoniales du massif et la prise en compte des sitesd’art rupestre résultent d’une convergence d’intérêts et de jeux d’acteurs situés àdifférentes échelles.
Les sites d’art rupestre sont mentionnés dès les premières ébauches du dossierde candidature porté par EKZNW, ces derniers étant perçus comme des aménitésà même de faire la différence en vue d’obtenir l’inscription (R. Porter3, entretien,2009). La mobilisation des sites d’art rupestre dans l’argumentaire était d’autantplus justifiée qu’elle faisait écho aux préoccupations de l’UNESCO qui, dans unevolonté de rééquilibrer la liste du patrimoine mondial et de garantir une liste« universellement représentative » (UNESCO, 1988, article 6. (iv)), vise, depuisla fin des années 1980, à corriger la sous-représentativité des biens africains ainsique celle des richesses archéologiques, souvent oubliées au profit des monumentsarchitecturaux.
À cela s’ajoute une sensibilité internationale de plus en plus marquée endirection de ce type de biens archéologiques. Depuis le début des années1980, des personnalités scientifiques ont commencé à attirer l’attention desinstances internationales sur la nécessité de préserver l’art rupestre (Anati etal., 1984). Rapidement, ces actions ont été relayées auprès de l’ICOMOSpar le président du Comité international pour l’Art Rupestre (Clottes, 1997),conduisant au lancement de projets régionaux tel que le Southern AfricanRock Art Project (SARAP). Lancé en 1995, celui-ci vise à identifier les sitesd’art rupestre subsahariens pouvant faire l’objet d’une inscription au patrimoinemondial (Deacon, 1997). Une démarche similaire étant engagée depuis 1994pour les sites de l’uKhahlamba-Drakensberg, le massif ne fera pas partie dece programme. Pour autant, cette prise de conscience générale de la valeurpatrimoniale des sites d’art rupestre sur un plan international a alimenté lesréflexions alors en cours Porter, entretien, 2009 ; Deacon4, correspondance,2010).
Dans le même temps, ces dynamiques internationales se mêlent aux chan-gements que connaît l’Afrique du Sud avec l’abrogation en 1994 du systèmepolitique de l’Apartheid. Sur le plan culturel et symbolique, la mise en place durégime démocratique s’est accompagnée d’une montée en puissance du conceptde « Renaissance africaine », largement mobilisé par la classe politique à la findes années 19905. Celui-ci englobe en même temps qu’il célèbre les différencesculturelles du pays, voire même du continent, appelant à un renouveau social,
3 Ancien responsable du service « Environnement » d’EKZNW, chargé du dossier d’inscription sur la listedu patrimoine mondial, entretien du 17/11/2009.
4 Archéologue retraitée du National Monuments Council of South Africa (Conseil des monumentsnationaux), responsable du projet SARAP, courriel du 11/03/2010.
5 Voir par exemple les discours politiques du président T. Mbeki des 8 mai 1996, 9 avril 1998 et 13 août1998.
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 917 — #53
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
918 • Mélanie Duval, Benjamin W. Smith ANNALES DE GÉOGRAPHIE, N° 697 • 2014
économique et politique intégrant la dimension « indigène » des peuples africains(Okumu, 2002).
En tant qu’objets témoins des populations San (également appelées Bushmen),l’art rupestre occupe une place de choix dans le courant de la « Renaissanceafricaine ». Dans une Afrique du Sud en quête de nouveaux symboles, il estprogressivement perçu par les édiles comme un moyen de réconcilier la diversitésud-africaine avec son passé, « as a bridge between the past and the future »(Jeursen, 1995 ; Lewis-Williams, 1995). Des éléments issus de peintures rupestresfleurissent sur différents supports commerciaux (Blundell, 1998) mais plus encore,sur des objets politiques et symboliques. Ainsi, dès novembre 1993, le nouveaudrapeau olympique sud-africain comporte des éléments issus de peintures rupestreset en 2000, le blason national est redéfini, avec en son centre deux personnagesissus d’une peinture rupestre et l’adoption d’une devise nationale en khoisan« ! KE E :/XARRA//KE » signifiant « Unity in Diversity » (Smith et al., 2000).Par un effet rétroactif, l’inscription du massif de l’uKhahlamba-Drakensberg aupatrimoine mondial de l’humanité découle de ce processus tout autant qu’ellealimente, inscrivant les sites d’art rupestre dans la construction plus générale d’unpatrimoine national commun (Duval, 2012).
1.3 Des synergies avec le volet touristique
Enfin, la démarche d’inscription du massif de l’uKhahlamba-Drakensberg aupatrimoine mondial a lieu dans un pays en pleine reconstruction où le secteur tou-ristique est perçu comme un moyen de réduire les inégalités socio-économiqueshéritées de l’Apartheid (Rogerson, Visser, 2004). Historiquement, le secteurtouristique s’est développé pour les blancs par les blancs (Visser, 2003) et l’undes objectifs du gouvernement post-Apartheid est de procéder aux transferts descapitaux et des compétences envers les populations précédemment désavantagées.
Parmi les ressources du pays pouvant faire l’objet de mise en valeur touristique,les ressources culturelles présentent plusieurs intérêts dont celui 1) de participer àla construction de la nation « arc-en-ciel » et d’alimenter le processus de « Renais-sance africaine » (Marschall, 2005) ; 2) de diversifier les ressorts touristiques d’unpays historiquement mis en valeur en raison des paysages et de la faune sauvage,captant ainsi d’autres formes de clientèle (Ivanovic, 2008), et 3) de générer desretombées économiques sur le plan local avec l’association des communautéslocales (DEAT, 1996).
Dans ce contexte, l’inscription de l’UDP au patrimoine mondial est perçuepar les différents acteurs comme un moyen de développer et de démocratiser lesecteur touristique (R. Porter, entretien, 2009). Aussi, l’inscription du massif entant que bien mixte vise à diversifier les ressorts de la fréquentation touristique,essentiellement organisée autour de pratiques de nature (randonnée, baignade,pêche en eaux vives, etc.) et d’activités ludo-récréatives (spa, golf, etc.) dans uncadre montagnard perçu comme ressourçant, tout en cherchant à associer lespopulations locales aux dynamiques touristiques (Duval, Smith, 2013).
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 918 — #54
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
Articles Inscription au patrimoine mondial et dynamiques touristiques • 919
Dans cette perspective, trois projets de valorisation touristique de sites d’artrupestre sont lancés en lien avec la démarche d’inscription au patrimoine mondial ;ils concernent les sites de Main Caves, de Game Pass Shelter et du Didima RockArt Centre (cf. fig. 2). Ces projets diffèrent tant au niveau des acteurs qui lesont portés qu’en ce qui concerne le type de réalisations effectuées. À MainCaves, une opération de réaménagement est conduite dès 1998 par les acteursrégionaux investis dans la gestion du futur bien candidat à l’inscription aupatrimoine mondial, EKZNW et Amafa ; elle vise à ré-aménager un site ouvert àla visite depuis 1969 en facilitant la déambulation des touristes tout en assurantla protection des peintures (Ndlovu, 2009). Le deuxième projet, porté par leMinistère des Affaires Environnementales et du Tourisme, concerne l’abri sous-roche de Game Pass Shelter, jusqu’alors peu fréquenté et retenu dans le cadred’un projet de valorisation nationale des sites d’art rupestre6. Ici, l’ambitionest tout autre puisqu’il ne s’agit pas de réaménager un site préexistant mais decréer une nouvelle offre touristique autour d’un site jugé emblématique par lesscientifiques (Duval, Smith, 2013). Aussi, en lien avec les chercheurs du RockArt Research Institute (Wits University, Johannesburg), un centre d’accueil estcréé, un sentier aménagé, des barrières de protection disposées autour de l’abriet des guides locaux sont formés (Smith, Blundell, 2000 ; Smith, 2006). Quantau centre de Didima, ce projet est porté par EKZNW lequel, par le biais duKZN Conservation Trust7, parvient à mobiliser 13 millions de rands pour laconstruction d’un espace muséographique chargé d’assurer la promotion des sitesd’art rupestre à l’échelle du massif (G. Hugues8, entretien, 2010). À défaut depermettre la découverte d’un abri sous-roche orné, la visite s’organise autour devitrines d’exposition et d’un film sur les chasseurs-cueilleurs (Mazel, 2008).
Ces trois projets d’aménagement touristique sont complétés par la réglemen-tation adoptée par Amafa en 2004. Celle-ci établit une liste de sites d’art rupestreouverts aux visites touristiques et statue sur leurs modalités de visites, lesquellesdoivent obligatoirement être encadrées par un guide local (cf. infra, paragraphe 3.3). Une vingtaine de sites ornés sont concernés, ce chiffre variant entre les sitesofficiellement désignés et ceux effectivement visités9 (cf. fig. 2).
6 Dès 2000, l’abri orné de Game Pass Shelter fait partie d’un projet porté par le Ministère des AffairesEnvironnementales et du Tourisme (Department of Environnemental Affaires and Tourism, DEAT), lequelvise à impulser des actions nationales en faveur de la mise en tourisme des sites d’art rupestre (Smith,2006). Six millions de rands sont dégagés pour cette opération qui concerne l’aménagement du site duGame Pass Shelter (1,6 million), celui des gravures de Wildebeest Kuil situées à proximité de Kimberleydans la province de Northern Cape (2,4 millions) et le lancement d’un musée d’envergure internationaleOrigins Center à Johannesburg (2 millions de rands, complétés par une importante levée de fondsauprès de donateurs privés).
7 Entité juridique et financière créée par EKZNW en vue de collecter des dons de personnes et/oud’organismes privés.
8 Ancien directeur d’EKZNW, en poste lors de la construction du centre d’interprétation de Didima,entretien du 22/07/2010.
9 Sur les critères retenus pour l’ouverture de sites à la visite et les différences entre les sites d’art rupestreofficiellement ouverts au tourisme et ceux in fine visités, se reporter à Duval, Smith, 2013.
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 919 — #55
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
920 • Mélanie Duval, Benjamin W. Smith ANNALES DE GÉOGRAPHIE, N° 697 • 2014
Fig. 2 Localisation des sites d’art rupestre ouverts aux visites touristiques dans le massifde l’uKhahlamba-Drakensberg.
Tourist rock art sites in the uKhahlamba -Drakensberg World Heritage Site.
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 920 — #56
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
Articles Inscription au patrimoine mondial et dynamiques touristiques • 921
Ainsi, la volonté puis l’inscription au patrimoine mondial ont impulsé de nou-velles dynamiques en faveur de la mise en tourisme des sites d’art rupestre, que cesoit avec l’aménagement en dur de certains sites, la création d’espaces muséogra-phiques ou encore avec la désignation et la réglementation des sites ouverts auxvisites touristiques. Ces orientations soulignent les liens établis/souhaités par lesacteurs entre les dynamiques patrimoniales et touristiques à l’échelle du massif,l’inscription sur la liste du patrimoine mondial étant notamment perçue commeun moyen de développer le tourisme en lien avec les sites d’art rupestre. Aussi,quatorze ans après l’inscription du massif au patrimoine mondial, il s’agit d’ob-server dans quelle mesure les effets d’entraînement souhaités se sont réalisés. Unpremier état des lieux peut être dressé, lequel donne à voir un décalage entre lesambitions initialement affichées et les dynamiques effectivement engendrées.
2 Un décalage entre les attendus de l’inscription au patrimoinemondial et les effets produits en matière de développementtouristique
2.1 La difficulté d’appréhender les effets liés à l’inscription au patrimoinemondial
Quels que soient les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial, il estdifficile d’identifier précisément le rôle joué par l’inscription en regard d’autresfacteurs influant sur les dynamiques touristiques (Gravari-Barbas et al., 2012 :6-7 ; Prud’Homme et al., 2008). Dans le cas de l’Afrique du Sud et du massif del’uKhahlamba-Drakensberg, le développement du tourisme international depuisla fin de l’Apartheid, ainsi que l’accès au tourisme d’une classe moyenne noirede plus en plus nombreuse jouent un rôle important, sans pour autant qu’ilsoit possible de préciser leur influence par rapport à l’inscription au patrimoinemondial.
À cela s’ajoute la difficulté rencontrée à l’échelle de l’UDP de conduireune approche diachronique, compte tenu de la qualité et du type de donnéesdisponibles (absence de série longue de fréquentation touristique notamment).Aussi, comparer le nombre d’entrées avant/après l’inscription au patrimoinemondial s’avère délicat. Par ailleurs, les données existantes sont à prendre avecprécaution. D’après les campagnes de terrain effectuées (2009-2010), le rapportentre les touristes s’acquittant d’un droit d’entrée dans les espaces protégésconstitutifs du bien UNESCO (cf. fig. 1) et ceux effectuant un séjour dansles établissements touristiques situés sur les contreforts du massif, à proximitéimmédiate du bien UNESCO, est de 1 pour 3,5 ; la majeure partie des touristesséjournant dans la région profite, en effet, du cadre paysager offert par lesmontagnes sans pour autant visiter l’un des espaces protégés constitutifs dubien UNESCO. Ainsi, pour 2009, la fréquentation du massif est comprise entre
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 921 — #57
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
922 • Mélanie Duval, Benjamin W. Smith ANNALES DE GÉOGRAPHIE, N° 697 • 2014
207 900 (nombre d’entrées dans les espaces protégés, cf. figure 1) et 740 000touristes (K. Kohler10, correspondance, 2010).
2.2 L’effet secondaire de l’inscription au patrimoine mondial sur lafréquentation touristique de l’uKhahlamba-Drakensberg en tant quedestination de nature
Étant donné les caractéristiques du massif (un bien mixte alliant des ressourcespaysagères et culturelles), les effets de l’inscription au patrimoine mondial enmatière de fréquentation touristique peuvent s’appréhender à l’échelle des espacesprotégés et/ou des sites d’art rupestre.
Si l’on considère le volet « destination de nature », la mise en tourisme du mas-sif s’étant historiquement construite autour des attraits paysagers (Duval, 2013 ;Duval, Smith, 2013), l’inscription ne semble pas jouer en matière de lisibilitétouristique, comme l’atteste l’enquête conduite auprès des populations touris-tiques (2009-2010)11. Bien que 66 % des touristes interrogés disent connaîtrel’inscription du massif sur la liste du patrimoine mondial, cette reconnaissanceinternationale ne joue pas dans leurs motivations à venir fréquenter cet espace.En effet, les touristes nationaux viennent essentiellement par habitude, dansun endroit fréquenté depuis plusieurs années (76 % des touristes sud-africainsinterrogés ont déjà effectué plus de trois séjours dans la région). Quant auxtouristes internationaux, si l’envie de découvrir une nouvelle région et d’êtredans un environnement montagnard constitue l’essentiel de leurs motivations,ces deux modalités se combinent avec une dimension pratique : sur la routeentre Johannesburg et Cape Town, entre le Kruger Park et la région des vins, leDrakensberg représente une halte intéressante dans un séjour itinérant de deux outrois semaines à travers le pays, format privilégié par les touristes internationaux.Aussi, quel que soit le type de touriste envisagé, l’inscription au patrimoinemondial ne semble pas jouer directement dans les motivations de ces derniers àvenir visiter la région (Duval, Smith, 2014).
La question des effets de l’inscription au patrimoine mondial sur la fréquen-tation des sites d’art rupestre se pose en d’autres termes. Compte tenu del’articulation entre la démarche d’inscription au patrimoine mondial et la volontéde développer le tourisme en lien avec les sites d’art rupestre, il appartient devoir dans quelle mesure les abris ornés sont effectivement devenus des ressortsdans la fréquentation touristique du massif de l’uKhahlamba-Drakensberg.
2.3 Des sites d’art rupestre en retrait dans l’image et la construction de ladestination touristique « massif de l’uKhahlamba-Drakensberg »
Quatorze ans après l’inscription sur la liste du patrimoine mondial, le tourismeen lien avec l’art rupestre représente une niche touristique et concerne environ
10 Chargée de mission au KwaZulu-Natal Tourism Office, courriel du 23 août 2010.
11 Échantillon global de 450 touristes répartis dans les différentes vallées du massif. Pour les résultatsdétaillés de cette enquête, se référer à Duval, Smith, 2014.
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 922 — #58
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
Articles Inscription au patrimoine mondial et dynamiques touristiques • 923
10 % des touristes s’acquittant d’un droit d’entrée dans l’un des espaces protégésconstitutifs du bien UNESCO. Pour la saison touristique 2009-2010, on estimeainsi à 27 300 les touristes ayant visité un site d’art rupestre (Duval, Smith, 2014).
Sur le plan de la promotion touristique, les sites d’art rupestre ouverts auxvisites touristiques sont absents des brochures touristiques à la fois locales etrégionales. Le même constat vaut pour les guides touristiques à destinationdes touristes internationaux où les informations relatives aux sites d’art rupestrerestent le plus souvent évasives et incomplètes, ne permettant pas au touristeeffectuant un court séjour dans le massif de s’organiser afin d’effectuer une tellevisite (Duval, Smith, 2013). Cette mise en retrait est renforcée par le manqued’informations dans les offices de tourisme et les hébergements de la région. Demanière générale, l’information liée à l’art rupestre n’est pas mise en avant, quece soit sur les sites Internet ou dans l’espace d’accueil des touristes. L’enquête deterrain a également révélé que le personnel d’accueil n’était bien souvent pas enmesure de délivrer des informations précises à ce sujet. L’analyse des documentset lieux touristiques souligne dès lors le peu de crédit accordé à l’art rupestreau regard des autres ressources touristiques du territoire, soulignant un décalagemanifeste entre les ambitions de l’inscription au patrimoine mondial et la réalitédes dynamiques touristiques engendrées.
Pour partie, ce hiatus s’explique en raison des temporalités liées à la construc-tion et à l’évolution de l’image touristique d’une région donnée. Aux quatorzeannées écoulées depuis l’inscription au patrimoine mondial et à la volonté demettre en avant les sites d’art rupestre répondent l’antériorité et la longévitéde dynamiques touristiques construites autour de ressources naturelles et pay-sagères depuis plus d’un siècle (Duval, 2013). À cela s’ajoutent les héritagessocio-historiques d’un ancien système politique ségrégationniste où les ressourcesculturelles des populations indigènes étaient peu considérées et/ou peu comprises(Duval, Smith, 2013).
Pour autant, les niveaux de fréquentation touristique enregistrés par des sitesd’art rupestre situés dans des contextes socio-politiques similaires démontrentla relativité des facteurs historiques. À titre d’exemple, les gravures rupestresde Twyfelfontein (Namibie), également inscrites au patrimoine mondial depuis2007, attirent environ 60 000 touristes par an, soit deux fois plus que l’ensembledes sites d’art rupestre touristiques du massif de l’uKhahlamba-Drakensberg (E.Ndalikokule12, correspondance, 2011). D’autres paramètres sont à rechercher envue d’expliciter les dissonances touristico-patrimoniales observées. Une approchecomparée des principaux sites d’art rupestre mis en tourisme permet alorsd’identifier un certain nombre de freins expliquant leur faible fréquentationtouristique.
12 Employée au National Heritage Council of Namibia (NHC), courriel du 18/01/2011.
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 923 — #59
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
924 • Mélanie Duval, Benjamin W. Smith ANNALES DE GÉOGRAPHIE, N° 697 • 2014
3 Les freins à la mise en place de synergies entre les registrespatrimoniaux et touristiques
3.1 Variables localisées et effets de sites
La mise en perspective des sites d’art rupestre ouverts au tourisme permetd’avancer des facteurs explicatifs quant à leurs niveaux de fréquentation, lesquelsse caractérisent par de fortes disparités (cf. tabl. 1), allant de 10 touristes annuelsà l’abri d’Ebusingata à 9 000 pour le site de Main Caves.
Pour partie, ces écarts s’expliquent en raison des aménagements réalisés. À uneéchelle microlocale, un gradient s’observe entre des sites non aménagés et ceuxéquipés de barrières et de passerelles déambulatoires. Ainsi, les sites de Game PassShelter, Main Caves, Battle Cave, Sigubudu présentent des aménagements en dur,tandis que ceux localisés dans le sud du massif n’offrent aucun aménagement. Pourautant, la présence d’équipements sur place n’est pas synonyme de fréquentationtouristique. Des contre-exemples peuvent être mentionnés comme le site de BattleCave qui, équipé d’une barrière de protection et d’un cheminement, connaît l’undes plus faibles niveaux de fréquentation touristique du massif.
La situation de l’abri orné par rapport aux hébergements touristiques est unautre facteur explicatif de leur fréquentation touristique (cf. tabl. 1). Ainsi, lesite de Sigubudu se situe à proximité immédiate d’une pléthore d’hébergementstouristiques qui lui assure un réservoir de fréquentation. À l’inverse, des abrissitués dans le sud du massif comme Mystery Cave ou encore Mpongweni sontrelativement éloignés des premiers hébergements touristiques. Pour autant, cecritère reste relatif : situé à moins d’un kilomètre de Sigubudu, l’abri d’Ebusingatan’enregistre que 10 visites par an, alors même qu’il se situe à proximité immédiatedes mêmes hébergements touristiques. Il en est de même pour l’abri de CowCave : situé non loin des 6 000 lits touristiques de la vallée de Champagne-Castle,celui-ci est loin d’égaler les niveaux de fréquentation enregistrés pour Sigubuduou encore Main Caves.
Dépassant une équation linéaire entre la présence d’hébergements touristiqueset la fréquentation des sites d’art rupestre, c’est davantage l’existence/absence derelais et de connexion entre les guides et les acteurs du tourisme qui influe surleur niveau de fréquentation. Ainsi, au sud du massif, la fréquentation touristiquede l’abri d’Ikanti s’explique avant tout par la création d’un circuit organisé etgéré par le principal établissement hôtelier de la vallée du Sani Pass, tandis queMpongweni, situé à proximité, ne figure pas au programme des hébergeurs de larégion.
Les conditions d’accessibilité expliquent également les écarts de fréquentationobservés, qu’il s’agisse des routes d’accès et/ou des marches d’approche (cf.tabl. 1). Le massif de l’uKhahlamba-Drakensberg étant composé de plusieursvallées parallèles, la circulation routière s’organise autour d’un réseau principalreliant les localités faisant office de « portes d’entrée » et d’un réseau secondairedesservant chacune des vallées, au bout desquelles se trouvent les espaces protégés
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 924 — #60
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
Articles Inscription au patrimoine mondial et dynamiques touristiques • 925
Tab. 1 Fréquentation touristique et caractéristiques des principaux sites d’art rupestrefaisant l’objet de visites touristiques dans la région de l’uKhahlamba-DrakensbergPark
The tourist frequency and characteristics of the main tourist rock art sites in theUDP region.
Nom du site(du nord au
sud dumassif)
Fréquentationtouristique2009-2010
En italique= nombre de
touristesestimés
Typed’aménagementautour du sited’art rupestre
Estimation dunombre de lits
touristiquessitués à moinsd’une heure deroute du pointde départ de la
randonnée
Conditionsd’accessibilitépar la route
0 = absence derevêtement,
nids de poule10 = routebitumée
régulièremententretenue
Durée de lamarche
d’approche
Sigubudu 3 640 Chemin d’ac-cès sécurisé,barrières deprotection
Entre 3 000et 4 000
10 < 30 min
Ebusingata 10 Aucun Entre 3 000et 4 000
10 < 30 min
Lions Rock 2100 Aucun Entre 1 000et 2 000
10 < 1 heure
ProcessionShelter
Aucun Entre 1 000et 2 000
10 < 1 heure
BrothertonRock
Aucun Entre 1 000et 2 000
10 < 30 min
LowerMushroom
Chemin d’accèssécurisé
Entre 1000et 2000
10 Demi-journée
DidimaCentre
5800 Centremuséographique
Entre 1 000et 2 000
10 0
Cow Cave 400 Aucun Entre 5 000et 6 000
10 Demi-journée
Battle Cave 228 Chemin d’ac-cès sécurisé,barrières deprotection
Entre 500 et1 000
2 Journée
Main Caves 9 000 Chemin d’ac-cès sécurisé,barrières deprotection,passerelles decheminement etplateformes enbois
Entre 2 000et 3 000
10 < 1 heure
Game PassShelter
950 Centre d’ac-cueil, chemind’accès sécurisé,barrières deprotection
Entre 1 000et 2 000
4 Demi-journée
Ikanti 350 Aucun Entre 1 000et 1 500
6 Journée
Mpongweni 150 Aucun Entre 1 000et 1 500
6 Journée
MysteryCave
75 Aucun Entre 400 et 600 6 Journée
et les sites ornés constitutifs du bien inscrit au patrimoine mondial. Si les grandsaxes routiers permettent de relier assez facilement les différentes régions du massif,les routes pénétrant dans les vallées sont de qualité inégale. Ainsi, les accès pourles vallées d’Injisuthi (Battle Cave), de Kamberg (Game Pass Shelter) ou encore
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 925 — #61
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
926 • Mélanie Duval, Benjamin W. Smith ANNALES DE GÉOGRAPHIE, N° 697 • 2014
de Bushman’s Neck (Mystery Cave) se font par des routes non goudronnées,minées de nids de poule, pouvant se révéler particulièrement boueuses lors de lasaison des pluies. De même, alors que certains sites nécessitent de courtes marchesd’approche, entre 20 et 40 minutes (Sigubudu, Main Caves, Ebusingata), d’autresappellent des randonnées à la demi-journée (Cow Cave, Game Pass Shelter),voire à la journée entière pour certains sites localisés dans le sud du massif(Mpongweni, Ikanti). De fait, ce type de visite touristique exclut une partie destouristes fréquentant la région (famille avec des enfants en bas âge, personne àmobilité réduite et/ou ayant une condition physique limitée, personnes âgées).Pour autant, la question de l’accessibilité est relative. D’autres exemples devalorisation touristique démontrent comment celle-ci peut être utilisée à des finsde promotion touristique, comme c’est le cas pour le site orné de Tsodilo Hills(Botswana) où des agences de voyages13 n’hésitent pas à jouer sur les mauvaisesconditions d’accessibilité afin de renforcer le mythe de « The Real Africa ».
Dès lors, si le niveau d’équipement, la présence d’hébergements touristiqueset l’accessibilité expliquent pour partie les freins observés en matière de déve-loppement touristique des sites d’art rupestre, les jeux d’acteurs et les modalitésd’association des populations locales s’avèrent être des facteurs déterminants.
3.2 Les effets induits par les jeux d’acteurs
La capacité de l’inscription au patrimoine mondial à insuffler des dynamiquestouristiques dépend pour beaucoup de la mobilisation des acteurs territoriaux(Gravari-Barbas et al., 2012). En soi, l’inscription ne garantit pas une augmen-tation de la fréquentation touristique (Prud’Homme et al., 2008). Celle-ci est,en effet, fonction des actions conduites par les acteurs, de manière à activer lepotentiel de cette reconnaissance internationale. Dans le cas d’un bien mixte gérépar deux entités distinctes, cela passe notamment par de la concertation et ladéfinition d’un projet partagé. Cette vision commune en matière de valorisationtouristique des sites d’art rupestre est cependant loin d’être effective à l’échelle dumassif de l’uKhahlamba-Drakensberg où les modalités de gestion entre EKZNWet Amafa conduisent à un certain nombre de dysfonctionnements freinant la miseen place de synergies touristico-patrimoniales.
Le premier d’entre eux est l’absence de passerelles effectives entre ces deux ins-titutions, ne serait-ce qu’avec le recrutement d’un archéologue au sein d’EKZNW,recommandation pourtant émise par l’ICOMOS dans l’évaluation du bien envue de son inscription en 2000 : « L’ICOMOS est préoccupé par l’absence d’har-monisation des différents plans de gestion au moyen d’un plan directeur. Il esttrès important que les objectifs et politiques du plan de gestion des ressourcesculturelles soient convenablement intégrés à ceux liés au patrimoine naturel, afind’éviter des conflits éventuels. Le personnel du service de Conservation de laNature se charge exclusivement du patrimoine naturel. L’ICOMOS recommande
13 Brummi Tours ou encore Africa Tours and Safaris, observations effectuées en mai 2010.
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 926 — #62
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
Articles Inscription au patrimoine mondial et dynamiques touristiques • 927
vivement qu’un département chargé du patrimoine culturel soit institué au seindu service. Des responsables en matière d’archéologie ou de conservation dupatrimoine ont été nommés, sur ces vingt dernières années, pour la plupart desparcs nationaux britanniques, une mesure qui a eu un impact plus que positif »(UNESCO, 2000, p. 8).
Compte tenu de l’absence d’un archéologue dans les services d’EKZNW,l’inscription au patrimoine mondial a donné lieu à la signature d’un agrémentdonnant à Amafa les compétences pour gérer les ressources culturelles des espacesprotégés de la province, le temps qu’EKZNW procède audit recrutement (Mazel,2012). Quatorze ans plus tard, cette situation temporaire est toujours de mise.Plusieurs arguments peuvent être ici avancés pour expliquer cette situation : 1)historiquement, les missions d’EKZNW sont orientées autour de la conservationde la nature et du développement de l’écotourisme ; on est ici en présence d’uneculture d’entreprise profondément ancrée autour de la biodiversité, 2) comptetenu de la réduction des subventions nationales et provinciales, EKZNW a uncertain intérêt financier à ce que le volet culturel continue à être géré par Amafa,d’autant plus que l’inscription au patrimoine mondial ne s’accompagne pas dedotations financières ; et 3) face à EKZNW dont l’histoire remonte au début duXXe siècle, gérer des sites d’art rupestre reconnus sur le plan international estégalement un moyen pour Amafa de tirer une certaine légitimité et d’asseoir salisibilité à l’échelle provinciale14.
En vue de favoriser la coopération entre ces deux acteurs, des instances deliaison ont cependant été mises en place (Amafa-Ezemvelo Liaison Committee,The Quarterly Rock Art Management Meeting). Dans les faits, les problèmes decommunication et de gestion se multiplient, empêchant l’activation du potentielUNESCO en matière de retombées touristiques. Ainsi, au service « tourisme »d’EKZNW, la responsable de la promotion touristique du massif de l’uKhahlamba-Drakensberg dit clairement ne pas comprendre les enjeux touristiques associésà l’art rupestre15. Pour elle, ce sont tout au plus des activités secondaires et ellene voit pas dans quelle mesure ces ressources seraient en mesure de participer àl’attractivité touristique du massif. De manière paradoxale, dans le même entretien,elle reconnaît pourtant que la réduction des aides gouvernementales nécessite dediversifier les ressorts touristiques en vue de capter de nouvelles clientèles... sanspour autant reconnaître aux sites d’art rupestre ce potentiel touristique, alorsmême que la démarche d’inscription au patrimoine mondial était pour partie liéeà des enjeux de développement touristique des sites d’art rupestre !
14 Cet organisme, nouveau sur la scène des acteurs, est issu des mouvements de ré-organisation du payspost-Apartheid. Suite à 1994, plusieurs décisions sont prises en matière de protection des biens culturels,que ce soit à l’échelle provinciale ou nationale. En 1997, à l’échelle du KwaZulu-Natal est adopté theKwaZulu-Natal Heritage Act (no. 10 of 1997), lequel instaure, entre autres, l’agence provinciale encharge de la protection des ressources culturelles de la province, Amafa.
15 A. van Eyssen, entretien du 16/02/2010.
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 927 — #63
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
928 • Mélanie Duval, Benjamin W. Smith ANNALES DE GÉOGRAPHIE, N° 697 • 2014
L’affichage secondaire des sites d’art rupestre sur le plan touristique est parailleurs renforcé par les fonctions d’Amafa, laquelle officie en tant qu’adminis-trateur et conservateur des sites d’art rupestre, sans qu’un volet de promotiontouristique lui soit officiellement associé. Aussi, si Amafa a initié l’ouverture desites d’art rupestre aux visites touristiques, c’est avant tout dans un souci depréservation, leur mise en tourisme étant perçue comme un moyen d’enrayerdes formes de fréquentation anarchique, synonyme de dégradations. Dès lors,un paradoxe majeur s’observe : alors même que la démarche d’inscription aupatrimoine mondial visait pour partie le développement du tourisme en lienavec les sites d’art rupestre, aucun acteur ne s’avère être en charge de ce volettouristique. Au final, un système bancal et bicéphale s’observe avec, d’une part,EKZNW qui est centré sur les questions de conservation/valorisation touristiquedes ressorts naturels/biodiversité, tandis qu’Amafa a pour fonction premièred’assurer la conservation des sites culturels.
Cette ambivalence au niveau des acteurs gestionnaires et de leurs compétencesréciproques explique pour partie le décalage constaté entre les ambitions viséesà travers la démarche d’inscription au patrimoine mondial et la réalité desdynamiques touristiques observées. Ces incohérences se retrouvent à une échellelocale, avec le système mis en place en vue d’associer les populations locales à lagestion des sites d’art rupestre ouverts au tourisme.
3.3 L’association des populations locales
La définition d’une vingtaine de sites d’art rupestre ouverts aux visites touristiquess’accompagne de l’entrée en vigueur d’une réglementation concernant leursmodes de visite avec la définition du statut de custodian, que l’on pourraitlittéralement traduit par « gardien » : « In order to address the conflict created by adesire to limit human access to rock art sites, and the desire of the public to visit thesesites, Amafa have introduced a custodian system. The purpose of the custodian isprimarily to accompany visitors to rock art sites and to ensure appropriate behaviourat the site » (Amafa, 2008, p. 60). Pour Amafa, associer les populations localesest un moyen d’alimenter des processus d’appropriation, lesquels sont garants,à terme, de la conservation des peintures (Chirikure, Pwiti, 2008). De plus, onse situe ici dans des zones rurales fortement marquées par le chômage et demanière explicite, le gouvernement exerce des pressions sur les acteurs publicsafin que ces derniers pensent l’ensemble de leurs actions dans un contexte deréparation/rénovation socio-économique du pays (Rogerson, 2006).
Formalisé en 200416, le statut de custodian est réservé aux personnes issues descommunautés locales (sous-entendues noires). Il équivaut à une accréditation (à
16 L’ensemble des données concernant le statut des custodian est issu de plusieurs entretiens avec C.Rossouw, Senior Heritage Officer, Amafa. Ces entretiens ont eu lieu en novembre 2009, juillet 2010,ainsi qu’en janvier et octobre 2011. Ces entretiens ont été complétés par l’analyse approfondie desdocuments réglementaires émanant d’Amafa (Amafa, 2008, 2009) et par des entretiens avec lescustodians rencontrés sur le terrain.
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 928 — #64
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
Articles Inscription au patrimoine mondial et dynamiques touristiques • 929
la différence d’un emploi) ; il donne le droit à la personne accréditée de conduiredes touristes aux sites d’art rupestre et d’être rémunérée pour ce service. Lesrétributions accordées par les touristes constituent l’essentiel du salaire puisqueles custodians ne sont pas employés par Amafa ou EKZNW17 et ne doivent pas,par ailleurs, occuper un emploi afin de pouvoir, en toute circonstance, répondre àd’éventuelles sollicitations touristiques. La fonction première du custodian est deguider et de surveiller le comportement des touristes sur les sites d’art rupestre,afin de garantir la préservation des peintures. De fait, ce statut diffère de celuide guide touristique puisqu’il n’est pas dans l’obligation de délivrer un savoirsur l’art rupestre. En contrepartie de cette accréditation, les custodians font unrapport annuel à Amafa sur l’état de conservation des sites visités, ce qui permetégalement de suivre les sites dans le temps à moindre coût.
Ainsi définie, la durabilité de ce système impose un minimum de fluxtouristique et ce, afin que le custodian puisse vivre de son activité. Ce quiest loin d’être le cas, notamment pour les abris ornés du sud du massif où uncustodian n’enregistre parfois que 3 touristes par mois, générant une centainede rands de revenus (env. 10 euros). Par ailleurs, cette accréditation provincialene s’accompagne pas d’un transfert des compétences en matière de promotiontouristique. L’obtention de l’accréditation se limite, en effet, à une demi-journéed’information sur le comportement à adopter dans l’abri sous-roche, suivie parle passage d’un examen écrit visant à vérifier l’assimilation des mesures énoncéesle matin même ainsi que le niveau d’anglais des candidats. Aussi, les custodiansrestent à la marge du système touristique et se retrouvent dans une situationparadoxale où leur revenu dépend de la fréquentation touristique sans pour autantavoir les moyens et les compétences nécessaires à la promotion de leur activité.Ils n’ont d’autres choix que de s’en remettre aux acteurs institutionnels ou privés,lesquels, on l’a vu, sont loin de faire de l’art rupestre leur priorité en matièrede promotion touristique. L’une des conséquences directes est une rotation deplus en plus importante des custodians, lesquels, après quelques mois à occuperce statut, se tournent vers une activité garantissant un revenu fixe. Aussi, lesprétendants à l’accréditation se font de plus en plus rares et il devient difficilepour Amafa de trouver des custodians pour l’ensemble des sites d’art rupestreouverts aux visites touristiques.
Une autre forme de dysfonctionnement tient au manque de lisibilité du statutde custodian. Officiellement, celui-ci est en charge de conduire et de surveillerles touristes une fois le site d’art rupestre atteint (Amafa, 2009). Livrer desconnaissances ne fait donc pas partie de ses missions, ce qui n’encourage guèreles touristes à aller visiter de l’art rupestre : « I had planned to visit the rock art.I had seen in the guidebook that you could do so and it seemed quite interesting,as it is something I don’t really know anything about. But, it said on the sign atthe entrance that the person who would accompany us was not there to provide
17 Exception faite pour le site de Main Caves où un custodian est employé par EKZNW.
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 929 — #65
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
930 • Mélanie Duval, Benjamin W. Smith ANNALES DE GÉOGRAPHIE, N° 697 • 2014
explanations. So, honestly, I wasn’t going to pay someone just to watch over me ! Iknow very well that I mustn’t touch the paintings or throw water on them. I’m notstupid ! So, honestly, no, I don’t really want to pay for that type of activity. Whatwould interest me would be someone who could explain the paintings, not just watchme18. »
Des distorsions majeures apparaissent ici entre le statut et le service délivré.En effet, sur le terrain, la majorité des custodians délivre un savoir sur les sitesvisités, mêlant les informations transmises par Amafa, les enseignements issusde discussions avec des groupes de touristes ainsi que leurs propres croyanceset pratiques religieuses19. Ce décalage entre le statut conféré par l’accréditationet la publicité qu’ils peuvent en faire s’explique par l’incompatibilité entre laréglementation provinciale d’une part et le statut national de guide touristiqued’autre part. Sur le plan national, le statut de guide est réglementé par l’obtentiond’une accréditation délivrée par l’autorité en charge de la formation dans lesecteur de la culture, du tourisme et des sports (The Cultural Arts, Tourism,Hospitality & Sport Sector Education Training Authority - CATHSSETA). Seulesles personnes ayant cette accréditation nationale peuvent s’afficher en tant que« guide touristique » (S. Richter20, entretien, 2010). Or les custodians peinent àobtenir cette dernière. Outre le fait qu’ils ne peuvent supporter individuellementle coût d’une telle formation, Amafa et EKZNW refusent de prendre celle-ci en charge : tandis qu’Amafa argumente du fait qu’elle est responsable de laconservation et non de la valorisation touristique des sites d’art rupestre, EKZNWse retranche derrière son statut d’agence en charge des ressources naturelles. Cetteincompatibilité entre les deux statuts engendre par ailleurs des tensions entreles custodians et des guides touristiques professionnels. Au final, nombre deces derniers ne proposent plus la visite de sites d’art rupestre à leurs clients,jugeant la situation trop compliquée (R. Gold21, entretien, 2010)...ce qui, parun effet-retour, ne favorise pas des effets d’entraînement entre l’inscription aupatrimoine mondial et le développement du tourisme en lien avec l’art rupestre.
Conclusions
L’étude de cas du massif de l’uKhahlamba-Drakensberg vient relativiser leseffets de l’inscription au patrimoine mondial en matière de développement
18 Entretien conduit dans la réserve naturelle d’Injisuthi, avril 2010.
19 Lors des missions de terrain de novembre 2009 à octobre 2010, une visite systématique des sitesd’art rupestre a été effectuée de manière anonyme. En effet, l’objectif de cette étude étant d’analyserl’expérience touristique, il s’agissait de se placer du point de vue du touriste. Aussi, les custodiansn’ont-ils été informés des raisons et motifs de ce travail de recherche que dans un second temps, nouspermettant de mieux apprécier l’expérience de l’art rupestre pour le touriste lambda.
20 Chargée d’organiser des sessions de formations pour obtenir l’accréditation nationale de guidetouristique, Services and Tourism Training Institute, Johannesburg, entretien du 17 août 2010.
21 Guide touristique, accréditation nationale, officiant dans la province du KwaZulu-Natal, entretien du15/02/2010.
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 930 — #66
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
Articles Inscription au patrimoine mondial et dynamiques touristiques • 931
touristique, démontrant que l’activation de synergies touristico-patrimonialesdépend davantage de jeux d’acteurs et des mesures mises en œuvre que d’unesimple reconnaissance internationale. Cet exemple est d’autant plus intéressantque la démarche d’inscription au patrimoine mondial était initialement envisagéepar les acteurs sud-africains comme un vecteur de développement touristique dessites d’art rupestre, différents projets ayant été initiés en ce sens.
Au final, plusieurs facteurs se combinent, mettant à mal le potentiel touristiquede l’inscription sur la liste du patrimoine mondial. Une approche comparée desprincipaux abris ornés ouverts au tourisme souligne le rôle joué par leur niveaud’équipement, mais plus encore par leur localisation, associant des effets de dis-tance par rapport aux hébergements touristiques et des conditions d’accessibilité.Pour autant qu’ils expliquent les effets limités de l’inscription au patrimoinemondial en matière de retombées touristiques, ces facteurs restent cependantrelatifs. Comprendre la timidité des dynamiques touristiques autour des sitesd’art rupestre impose dès lors de considérer les jeux d’acteurs, qu’il s’agisse desacteurs institutionnels et/ou des populations locales.
Sur ce point, les modalités de gestion du bien UNESCO, partagé (écartelé ?)entre les acteurs du secteur environnemental (EKZNW) et ceux de la culture(Amafa), sont une des variables explicatives de la faible fréquentation touristiquedes sites d’art rupestre. À cette absence de vision globale et partagée s’ajoutentles modes d’association des populations locales à la gestion des sites d’artrupestre touristiques. Compte tenu de la réglementation actuelle et du contexteinstitutionnel, les custodians n’ont, en effet, ni les compétences ni les possibilitésde développer le tourisme en lien avec l’art rupestre.
De manière transversale, cette étude de cas souligne quelques-uns des enjeuxauxquels les acteurs territoriaux peuvent être confrontés lorsqu’il s’agit d’optimiserles effets d’une inscription sur la liste du patrimoine mondial en matière dedéveloppement touristique. En termes de gestion, l’exemple de l’UDP souligne lesdécalages qu’il peut exister entre 1) des projets de territoire portés par des acteurssitués à différentes échelles et 2) les compétences effectives des gestionnaires. Àl’échelle du massif de l’uKhahlamba-Drakensberg, des distorsions s’observent,en effet, entre d’une part les ambitions touristiques initialement associées à ladémarche d’inscription au patrimoine mondial et encouragées par les acteurs de laclasse politique nationale, et, d’autre part, les compétences des deux gestionnairesde cet espace. Ainsi, le développement du tourisme en lien avec l’art rupestre,notamment souhaité sur un plan politique car entrant en résonance avec lecourant de « Renaissance africaine », ne trouve-t-il pas d’écho au niveau desmissions d’EKZNW qui restent ciblées sur la biodiversité, ni même d’Amafapour qui la mise en tourisme des sites d’art rupestre n’est clairement pas unepriorité. En termes de conduite de projet, cette étude de cas pose la question dela cohérence entre les objectifs visés et les moyens mis en œuvre par les acteurs,ainsi que des mesures à prendre en vue de parvenir à leur adéquation.
Dans un tel contexte, l’impulsion d’une synergie touristico-patrimoniale passepar l’adoption et la définition d’une approche globale, évolutive et systémique.
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 931 — #67
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
932 • Mélanie Duval, Benjamin W. Smith ANNALES DE GÉOGRAPHIE, N° 697 • 2014
Sur ce point, la nécessité d’une approche concertée est loin d’être spécifique aumassif de l’uKhahlamba-Drakensberg et la mise en tourisme des biens inscritssur la liste du patrimoine mondial nécessite un important travail en termesde collaboration (Gravari-Barbas et al., 2012). Une telle démarche appelle untravail de coopération entre les acteurs, dépassant le premier cercle constituépar les acteurs institutionnels et les gestionnaires pour impliquer l’ensemble desacteurs intervenants dans les dynamiques touristico-patrimoniales. On pourraitimaginer l’invention de nouveaux modes de co-gestion avec, par exemple, lacréation d’une structure idoine chargée de coordonner les actions engagées par lesdifférents acteurs, tout en pensant l’association des populations locales à de tellesdynamiques. Autrement dit, la mise en place de synergies touristico-patrimonialespasse par une réflexion approfondie sur les modèles de gouvernance.
In fine, cette étude de cas interroge l’aptitude des différentes catégoriesd’inscription au patrimoine mondial à engendrer des dynamiques touristiques,avec ici le cas spécifique d’un bien mixte. En juxtaposant les entrées naturelleset culturelles, ce type de bien marque en même temps qu’il encourage unedivision des compétences entre les acteurs du secteur environnemental et ceuxde la culture, favorisant des freins en matière d’activation de synergies touristico-patrimoniales. Sur ce point, des études comparatives seraient à conduire avec desbiens inscrits au titre des paysages culturels (catégorie de l’UNESCO en vigueurdepuis 1992), où une intégration des deux registres semble davantage s’observer(Roué, 2010, p. 14). Cette approche permettrait de vérifier dans quelle mesure lesdynamiques touristiques liées à une inscription sur la liste du patrimoine mondialsont pour partie fonction de la catégorie du bien inscrit, elle-même miroir desjeux d’acteurs.
Laboratoire Edytem UMR 5204 CNRS/Université de SavoieRock Art Research Institute, GAES, University of the [email protected]
Centre for Rock Art Research and ManagementSchool of Social Sciences, University of Western AustraliaRock Art Research Institute, GAES, University of the [email protected]
Bibliographie
Amafa (2008), Draft cure document. Préparé par C. Rossouw. Première version en décembre 2007,révisé en octobre 2008, document non publié. Pietermaritzburg, Amafa.
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 932 — #68
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
Articles Inscription au patrimoine mondial et dynamiques touristiques • 933
Amafa (2009), Draft policy on the accreditation of rock art custodians, document non publié.Pietermaritzburg, Amafa.
Anati, E., Wainwright, I., Lundy, D. (1984), « Rock art recording and conservation : A call forinternational effort », Current Anthropology, n° 25 (2), p. 216-217.
Blundell, G. (1998), « Some aspects concerning rock art and national identity in South Africa », inBank, A. (éd.), The proceedings of the Khoisan identities and cultural heritage conference, CapeTown, The Institute for Historical Research (UWC), p. 153-156.
Chirikure, S., Pwiti, G. (2008), « Community involvement in archaeology and cultural heritagemanagement : An assessment from case studies in Southern Africa and elsewhere », CurrentAnthropology, n° 49 (3), p. 467-485.
Clottes, J. (1997), L’art rupestre, un message culturel universel/Rock Art, a universal message, Paris,Icomos, 32 p.
Deacon, J. (1993), « Archaeological sites as national monuments in South Africa : A review of sitesdeclared since 1936 », South African Historical Journal, n° 29, p. 118-131.
Deacon, J. (1997), « A regional management strategy for rock art in Southern Africa », Conservationand Management of Archaeological Sites, n° 2, p. 29-32.
DEAT (1996), The white paper on tourism department of environmental affairs and tourism, Republicof South Africa, Pretoria, Government Printer. URL : http://scnc.ukzn.ac.za/doc/tourism/White_Paper.htm
Duval, M. (2012), « Enjeux patrimoniaux et identitaires autour des sites d’art rupestre sud-africains :approche multiscalaire à partir de la cérémonie de l’Eland (abri orné de Game Pass, massif duDrakensberg, Afrique du Sud) », Civilisations, n° 61 (1), p. 83-102.
Duval, M. (2013), « Place et fonctions de la patrimonialisation de la nature dans les espaces protégés.Enseignements à partir du massif de l’uKhahlamba-Drakensberg, Afrique du Sud », Revue VertigO,30.05.2013, URL : http://vertigo.revues.org/13572
Duval, M., Smith, B. (2013), « Rock Art Tourism in the uKhahlamba/Drakensberg World Heritage Site :obstacles to the development of sustainable tourism », Journal of Sustainable Tourism, n° 21 (1),p. 134-153.
Duval, M., Smith, B. (2014), « Seeking sustainable rock art tourism – the example of the Maloti-Drakensberg Park World Heritage Site », The South African Archaeological Bulletin, n° 69,p. 34-48.
Gauchon, C. (2010), Tourisme et patrimoines : un creuset pour les territoires ?, Texte de synthèse,Habilitation à diriger des recherches, laboratoire Edytem UMR 5204 CNRS/Université de Savoie,211 p.
Gravari-Barbas, M., Bourdeau, L., Robinson, M. (2012), Tourisme et patrimoine mondial, Laval, Pressesde l’Université de Laval, 326 p.
Ivanovic, M. (2008), Cultural tourism, Cape Town, Juta, 390 p.
Jeursen, B. (1995), « Rock art as a bridge between past and future : A common cultural heritage forthe New South Africa ? », Critical Arts, n° 9 (2), p. 119-129.
Lewis-Williams, D. (1995), « Some aspects of rock art research in the politics of present-day SouthAfrica », in Helskog, K., Olsen, B. (eds.), Perceiving rock art : Social and political perspectives,Oslo, Novus Forlag, p. 317-337.
Malgat, C., Duval, M. (sous presse), « La labellisation Unesco de la grotte Chauvet, une démarcheinternationale pour une reconfiguration locale », in Actes du colloque « Labellisation et mise enmarque des territoires », CERAMAC, 8, 9 et 10 novembre 2011.
Marschall, S. (2005), « Making money with memories : The fusion of heritage, tourism and identityformation in South Africa », Historia, n° 50 (1), p. 103-122.
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 933 — #69
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin
934 • Mélanie Duval, Benjamin W. Smith ANNALES DE GÉOGRAPHIE, N° 697 • 2014
Mazel, A.D. (2008), « Presenting the San Hunter-Gatherer past to the public : A view from theuKhahlamba-Drakensberg Park, South Africa », Conservation and Management of ArchaeologicalSites, n° 10 (1), p. 41-51.
Mazel, A.D. (2012), « Safeguarding a fragile legacy : managing uKhahlamba- Drakensberg », inMcDonald, J., Veth, P. (eds.), À Companion to Rock Art, Hoboken (NJ), Wiley Blackwell, p. 515-531.
Ndlovu, N. (2009), « The presentation of Bushman rock art in the uKhahlamba-Drakensberg »,in Mitchell, P., Smith, B. (eds.), The Eland’s people, new perspectives in the rock art of theMaloti-Drakensberg Bushmen, Johannesburg, Wits University Press, p. 62-63.
Okumu, W. A. J. (2002), The African renaissance : History, significance and strategy, Trenton, NJ,Africa World Press, 306 p.
Prud’Homme, R., Gravari-Barbas, M., Jacquot, S., Talandier, M., Nicot, B.-H., Odzirlik, B. (2008), Lesimpacts socio-économiques de l’inscription d’un site sur la liste du patrimoine mondial : troisétudes. Note préparée à la demande du patrimoine mondial de l’UNESCO, 150 p.
Rogerson, C. (2006), « Pro-Poor local economic development in South Africa : The role of prop-poortourism », Local environment, n° 11 (1), p. 37-60.
Rogerson, C., Visser, G. (2004), Tourism and development issues in contemporary South Africa,Pretoria, Africa Institute of South Africa, 96 p.
Roué, M. (2010), Paysages culturels et naturels : changements et conservation, Paris, Rapportprogramme Paysages et Développement durable, 187 p.
Smith, B. (2006), « Rock art tourism in Southern Africa : Problems, possibilities and poverty relief »,in Agnew, N., Bridgland, J. (eds.), Of the past, for the future : Integrating archaeology andconservation, Los Angeles, Getty Conservation Institute, p. 322-330.
Smith, B., Blundell, G. (2000), Rock Art Tourism in South Africa - A National Strategy for Growth.Proposed developments at Game Pass, document non publié.
Smith, B., Lewis-Williams, D., Blundell, G., Chippindale, C. (2000), « Archaeology and symbolism inthe new South African coat of arms », Antiquity, n° 74, p. 467-468.
UNESCO (1988), Comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine mondial culturel etnaturel, Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial,WHC/2 Révisé.
UNESCO (2000), Evaluation des Organisations consultatives, Drakensberg N° 985, http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/985.pdf
UNESCO (2005), Orientations devant guider la mise en oeuvre de la convention du patrimoineMondial, WHC.05/2.
Visser, G. (2003), « South African tourism and its role in the perpetuation of an uneven tourism spaceeconomy », Africa Insight « Tourism : Africa’s key to prosperity », n° 33 (1 – 2), p. 116-123.
Discours de T. Mbeki
8 mai 1996 : Statement of Deputy President TM Mbeki, on the occasion of the adoption by theConstitutional Assembly of « The Republic of South Africa Constitution Bill 1996 », Cape Town,online http://www.anc.org.za/ancdocs/history/mbeki/1996/sp960508.html.
9 avril 1998 : The African Renaissance, South Africa and the World, United Nations University, onlinehttp://www.unu.edu/unupress/mbeki.html.
13 août 1998 : The African Renaissance Statement, SABC, Gallagher Estate, online http://www.anc.org.za/ancdocs/history/mbeki/1998/tm0813.htm.
“Annales_697” (Col. : Revue de géographie) — 2014/6/17 — 18:50 — page 934 — #70
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Uni
vers
ité d
e S
avoi
e -
- 1
93.4
8.12
6.37
- 0
5/08
/201
4 09
h24.
© A
rman
d C
olin
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - U
niversité de Savoie - - 193.48.126.37 - 05/08/2014 09h24. ©
Arm
and Colin