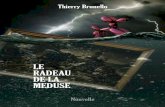Si l'on a raison de figurer l'infigurable, Degrés. Revue de synthèse à orientation sémiologique,...
-
Upload
univ-lille -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Si l'on a raison de figurer l'infigurable, Degrés. Revue de synthèse à orientation sémiologique,...
trfZ N i"t ON . U: S rvOMf3 f.Ed / ~ J eRt:.(fI.l(Z.J 0[. L4wC;IJé 1 Uf (01"'-';(.(.[J
1'"LA-G(2.~NP~J er- J.Mp~iC-,J',ONJ ~ 1\.< j ':;E Ërv rO(2/l(e ONr Éré r-4 iiéf
rA-t?- L.'eOiTév~ - ,4-f L1eCLHfllC J)V VOU)('t(Ç - LqZJ DE- U S"A-i f',[
Er Pt-llJ ~N(..'Oll.f s v tZ. IÉP!<E-tlvéS . :fie", .ro.« ..Pi S oLi. .(
j Si l'on a raison de figurer l'infigurable
Ne pas vouloir représente r un être, une chose ou un événement,ou vouloir représenter ce qui est considéré comme impossible àreprésenter, voila deux att itudes dont seule la première - le refus dela représentation (en relation avec son ardente promotion) - a été bienétudiée par les historiens des images. Ne pas souhaiter faire des imagesde quelque chose (par exemple de Dieu, parce que « nul ne peut [Le]voir et vivre» ou parce qu'il est « ce que l'œil n'a pas vu » 1) diffèreen effet de souhaiter représenter le caractère jugé irrep r ésentable dudivin ou d'autres réalités. C'est-à-dire d'essayer de rendre compte, aumoyen d'images visuelles ou verbales particulières, de ce qui est senticomme hors de portée de l'expression ou comme dépassant la raisoo.
En marge des attitudes de haine (ou d'aniconisme) et d'amour àl'égard des images, opposition certes fondamentale pour comprendrela culture visuelle occidentale, il existait au Moyen Âge un courant depensée issu de la mystique n éoplatonicienn e qui s'interrogeait sur lesmanières de réaliser des images de ce qui n'en avait pas, présentantmême des solutions pour dire l'indicible et imager l'inconnaissable.Des initiatives poétiques et graphiques indépendantes existaientégalement, parfois des œuvres majeures, auxquelles il y a lieu deprêter attention en ce sens. Cette att itude que l'on pourrait qua lifierde « troisième voie » est intermédiaire ou composée: d'un côté où elleadopte la cause du refus des images (la supériorité ahsolue du suje t,son invisibilité essentielle) sans condamner la figuration, de l'autreelle choisit de représenter mais en s'écartant du mode habituel.
Cette alt itude n'est pas limitée au seu l Moyen Âge. Il faut plutôty voir une attitude fondament ale à laquelle la culture chrétiennemédiévale a donné un contenu conceptuel propre et des réalisationssouvenr intrigantes- - de la même façon que la méfiance de Platonenvers les images, ainsi que l'a fait remarquer Jack Goody-, a étémoins J'invention historique d'un rapport à l'image que la formulation
Gil Bartholeyns
1 Exode 33, 20. 1 Cor inthi ens 2, 9.
2 Voir l'exposé d'Olivier Boulnois,Au-delà de l'image (2008) , p. 154 ·171. Bar tholeyns, Dittmar et Jolivet,Image et transgresston (2008) , p. 151et suiv.
3 Goo dy, La Peur des repr ésentatio ns(1997), p.41-43, prenant le contr epied de j'interprétation habituellement fournie par les histori ens, ici,par Alain Besançon da ns L'Imageinterdite (1994).
J Cil Bartholeyns
1,
4 Didi-Huberman, Images malgré tout(2003). Voir égalem ent Nancy, « Larepr ésentation in terd ite » (2001).Rancière, « S'il y a de I'ir rcpr ésentable» dans Le Destin des images(2003).
Shoah, 8'46"-9' 16" (t radu it) .
spéculative d'une attitude latente, « anthropologique », à l'égard dela représentation en général. Il suffit sans doute de rappel er le débatbrû lant autour des différentes représentations des camps de la mort etde l'extermination des Juifs pour saisir le caractère culturel, en quelquesorte « choisi », de ce qui est infigurable - ou seulement figurabled'une manière qui, précisément, va montrer cette impossibilité, nousfaire dire que cela ne l'est pas.i Car en soi rien n'est irreprésentab le,concrète ment ou mentalement, sinon les aberrations logiques tellesqu'un cercle carré ou une couleur salée. Ce qui relève du domainede ce qu'on appelle ici l'ir représentable est d'ordre historique, sujetà la polémique et à diverses tentat ives. Aux antipo des des fictionsdramatiques, spectacu laires, reconstit utionnistes ou imitatives , Nuitet Brouillard (1955) d'Alain Rainais commence par des « travellingssans sujet » (figure 1 haut), et Shoah (1985) de Claude Lanzm anns'ouvre sur le visage de celui qui a vu ce qu'il n'y a plus à voir (figure1 bas) et qui , sur les lieux même du massacre dont il ne reste rien,affirm e par des négations:
«Personne ne peut le décr ire. Personne ne peut recréer [se représenter]ce qui s'est passé ici. Imposs ible. Et personne ne peut le comprendre...Je ne crois pas que je suis ici. )}5
Pour les hommes du Moyen Âge, c'est Dieu qui, en tant que prototypesans image et sans mot, constitue le cas exemplaire des êtres ou lieuxauxquels certains donnaient un statut d'infigurab le ou d' ineffable, quece soit dans l'ordre du bien ou dans celui du mal. Pour ces clercs, cesmystiques ou ces peintres, la divinité, le paradis céleste, l'enfer et sessouffra nces, la merveille, la Bête ou les anges, parce qu'ils dépassentles catégories de l'expérience ordinaire, devaient , pour faire senti run peu de leur natu re, être placés aux limites de la représentationou bien confronte r l'esprit à ses propres limites. Par quels procé désiconographiques et littéraires la culture médiévale a-t-elle donc misen mots et en images ce qui était pour elle au-delà du langage et de
la figuration ? Comment ces procédés provoqua ient-ils l'incapacitéd'imaginer chez ceux qui regardaient , lisaient ou écoutaient?
-,
-,
.~
r
Si l'on a raison de figurer I'infigurabi e j 3
/"
r
,.
r:
À partir du VIII' siècle jusqu'aux Réformes, la pensée occidentalede l'image s'est principalement élaborée en fonction des moments derejet et d'adoration, autour du culte des images.' C'e st donc sur cetteligne qui va du « oui » à l'image, sous certaines conditions, au « non »destr ucteur, que le spécialiste évolue lui-même le plus souvent ,pour suivant en quelque sorte le travail critique des théologiens quis'attachaient à définir les bonnes et les mauvaises façons d'app récierles images.' Il existait pourtant, dès le haut Moyen Âge, une iconologiequi ne se situait pas sur cette ligne franche ment « morale », unevéritable réflexion sur la représentation des choses qui était « au-delàde l' intelligible » (la formule est médiévale).' Il s'agit de la théologie« négative » des images, don t Denys l'Aréopagite est le principal ar tisan
à la fin du VC siècle ou au début du VIe siècle.' Les écr its de celui quipasse pour le disciple direct de Paul penda nt tout le Moyen Âge, et quiont de ce fait une influence considérable sur la pensée médiévale, sonttraduits en latin dans les années 830, puis abondamment comm entéset diffu sés dans toute l'Europe.w
C'est dans le traité de la Hiérarchie c éleste» que se trouve énoncéecette théorie des figures qui sont au-delà de toute figure sensible.l'Il y a deux sortes d'images, écri t Denys l'Aréopagite: les imagesqui ressemblent à leur modèle, et les images qui di ssernblent . Lespremières sont « façon nées à la ressemblance de leur objet ».Dans lesautres, « la fiction [est poussée] jusqu'au comble de l'i nvraisemblableet de l'absu rde ».J3 Pour signifier les réalités tran scendantes, les«similitudes dissemblantes » (l'expression revient à plusieursrepri ses) sont donc préférables aux images qui semblent conven irà l'original. Ainsi, explique Denys, pour figurer la divin ité dans cequ'elle a de suressentie l, un ver de terre conviendra mieux qu'unefigure d'or ou qu'un homme lum inescent, magnifiquement drap é.t- Etceci pour deux raisons. En empruntant aux part ies les plus viles ouvulgaires du monde sensible, choqua ot l'idée qu'on se fait des êtressupérieurs, les figures spirituelles ne risquent pas d'être prises pourdes représentations véridiques. Ensuite, « les images empreintesd'alt érit é» incitent à s'élever « vers les archét ypes immatériels », «à
travers les apparences ».15
La dissimilitudo, par la distance criante qu'elle place entre l'imageet le prototype , fera mieux sentir l'abîme ontologique qui sépa re lacréature du Créateur et des mystères. Ce que ne font pas les images ou
ESTHÉTIQUE NÉGATIVE :LA DISSIMILITUDE
Belting, i mage et Culte (1998). Po urune synthèse des positions antagonistes autour de la q uestion du prototype, voir w irth, « Fau t-il adorerles images ? La théorie du culte desima ges jusqu'au concile de Trent e »(2001). Également dans la long uedurée: Schm itt , « De Nicée II àThomas d'Aqui n : l'éma ncipatio nde l'ima ge religieuse en Occident »(1987).
7 C'est pourquoila perspectived'OlivierBoulnois (op. cit.) est importante : « Jesouhaite éviter (P .) la probléma tiqu ebyzamine de la vénération de l'icône »,car elle n'est pas « première »pour lapensée occidentale de l'image (p. 13).Concernant ce qui suit, voir p. 154171.
Deny s L'Aréo pagite, Théologie mystique, Patrologia gra eca (PG), vol. 3,col. 1033 C.
9 Proclus inspire Denys à travers saréflexion sur les mythe s homéri ques:« le co ntre-na tu re » des fautes etatr ocités com mises par les dieuxnous rappellent « ce qui , dansles dieux, dépasse la nature »,« le co ntre-ra ison, ce qui est plu sdivin que la raison », le laid « cequi transcende (...) tout e beau tépar ticu lière 11. Proclus, Commentairesur la R épublique, 73, 26-25, tra d.Vrin , p. 91.
10 Théry, « L'entrée du pseudo-Denysen Occident » (1930). Maurice deGand illac et ai., « Influence dupseud o-Denys en Occident » (1954).
Il Denys L'Ar éopagi te, La Hiérarchiecéleste, éd . et trad. René Roques,Gu nther Heil, Mau rice de Gandillac,Pari s,Cerf, 1970(Sourceschrétiennes,58), désormais La Hiérarchie céleste.
j 4 Cil Bartholeyns .,
u La même thé or ie est dé veloppéepour les nom s donnés à Di eu dansLes noms divins (Œuvres complètes,tr ad. Maurice de Gandillac, Paris,Aubier-Mont aigne, 1980).
13 La Hiérarchie céleste, Il, 3, p. 77.
14 Ib id., II , 5 et Il , 3, p. 84 et 80.
15 lbid., Il, 3, p. 79 ; PG vol. 3, col.141 A. « Les images déraisonnablesélèvent mieux notre esprit que celiesque l'on forge à la ressemblance deleur objet ».
16 Jean Sco t Erigène, Expo sitionesin Ierarchiam coeleste, éd . Co rpuschri stianorum, continuatio
17 Litt éralement : « en appliquant surcelle-ci la for me d'un ver». Denys,La Hiérarchie céleste, II , 5, p. 83-84,ici p. 84; pa 3, co l. 140 B-C. Denyset Jean Scot parlent en bo nne par t.
18 Jea n Scot Erigè ne, Expositiones,II , 403-4 26 , éd . citée, p . 30-32;Patrologia latina (PL), vol. 122, col.152 C- 153 B. Evoquant not ammentEzéchiel, 1.
symboles qui sont créés à partir des ({ réalités qui apparaissent commede haut prix» telles que la lumière resplendissante. Aussi les imagesmonstrueu ses , illogiques, irra tionnelles, celles qui troublent la raison,
contrariant l'imagination et les idées préconçues, sont-elles ju géesplus propices à la reconnaissanc e des êtres et des choses par natureinfigurables. Le régime représentalion nel , mimétiq ue de l'imagedevient un régime émotionnel.
Jean Scot Erig ène compose une version glosée de la Hiéra rchiecéleste qu'i l pré sente à Char les le Chauve vers 862.16 Reprena ntla théologie négative de De nys, il la radicalise. Chez Denys, lemonstrueux est une dissemblance d'apparence, il y a dialect ique : unefigure est monstrueu se par rapport à ce qu'elle représente. Chez Jean
Scot, si on comprend bien le moine irlandais, le monstrueux n'évoquepas seulement le divin par des formes absolument contrai res ; l'image
est dissemblante par le mélange « monstrueux » des natures. Mettonsdeux pas sages en parallèle.
Denys:« Ils [les porte-parole des mystère s divins] [. . .] vont ju squ'à présenterla Théarchie sous l'aspect (eidos) de bête sauvage, lui att ribuant lestraits de lion ou de panthère, disant qu'Elle est un léopard ou uneourse qui s'élance avec fureur. J'ajouterais que l'image de toutes laplus indigne et qui semble la plus déraisonnable est celle dont usèrentles sublimes messagers de la tradition divine lorsqu' ils ne craig nirent
pas d'imaginer (periplattousan) la Théarchie sous les traits d'un verde terre. »1 7
Jean Scot:« Le second [mode de révélation du divin dans l' Écritu re] est forgé par
des figures de bêtes sauvages et orgue illeuses (bestiarum ferocium etsuperbarumqueï, comme celle du lion et du cheva l, ou laides (turpiumïcomme celle de l'ours et du ver (vermis) [... ]. La confusion des forme stformarium confusioy va jusqu 'à ce point que , dans une seule et
même ima ge (imagine), la forme (speeles) de l'homme, du veau , dulion, de l'a igle soit mons trueusement mêlée (monstruose miscetur) ;ce qui , on l'aperçoit, est absolument cont raire aux forme s absolues etnatu relles. )) 18
,
Si l' on a raison de figurer l 'infigurable j 5
,.Pour Denys, on ira ju squ'à présenter dieu sous l'aspect d'une bêtesauvage ou d'un lombric. Pour Jean Scot, on ira, pour la mêmechose, jusqu'à confondre et mêler plusieurs êtres dans une seuleimage. René Roques a souligné que, pour Denys, la monstruosit é estl'impression que certaines images bibliques produisent sur le profane :1'« impression d'effrayante absurdité » 19 ne dépend pas de l'anatomiede la figure.w Ces images sont contraires, alors que pour Jean Scotelles sont proprement contre-nature. On peut proposer le schémasuivant des iconologies de Denys et de Jean Scot.
19 Denys, Len re IX, l, PG vol. 3, col.1104B.
20 Roques, «Tératologie et théologiech ez Jea n Scot Erig ène » (1967),repris dans L ibres sentiers de l' érigénisme (1975), p, 18-20.
Comment représenter Dieu et lesêtres supérieurs selon Denys et Jean Scot?
Force anagogique"de lafigure
Iconologie lIégatil'e,utssembtabte(distance frappante,indicative de la distanceessentielle)
Non-~~itiét_~--,
fMonstrueux: -t. Hybride (mélange) -+ Image DU contre-nature }
{
Dissemblance ~ ~: Ver de terre (bas Simple) -+ Image contre natureJean Scot . . « contraire )}
Donc' .. .Ressernblance . oê- ROI en majeste [haut) -+ Image naturelle Iconologie positive. affirmative
(beauté apparente de la beautéinappa rente)
1 ' . '
i - "Initié" .....-,~ .. ';
• Propre à la connaissance (ou sensat ion) des choses en soi
La postérité de l'iconologie dionysienne est évidente dans les œuvrespoétiques d'un grand nombre de mystiques médiévaux. En revanche,il est beaucoup plus délicat d'établir un lien avec les œuvres visuelles,malgré la présence des textes de l'Aréopagite dans les monastères,longtemps les princi paux lieux de production des images. Malgré aussila liberté d'exécution dont jouissaient les peintres et les scutpteurs.» Etmalgré les faveurs que remporte la voie de la dissemblance figurativeauprés de personnalités aussi influentes que Thomas d'Aquin, celui-ciestimait non seulement qu'elle libère de l'erreu r et convient mieux queles figures de « corps nobles )} (car le plus manifeste pour l'homme àpropos du divin « c'est ce qu'il n'est pas »), mais aussi qu'elle cachemieux les choses divines aux impies.> Du registre textuel au registreiconographique, il n'y avait qu'un pas ~ surtout que le vocabulairede l'image ne faisait pas de distinction franche entre les domaines
FIGUR ES ANAGOGIQUES :LE CONTRE-NATURE
21 Berline r, ({ The Fr eedo m of Med ievalAr t » (1945). Baschet , « In ventivitéet sérialit è des images mé d iévales.Pour une appr oche iconogra phiqu eèlarg ie » (1996), Schmi tt , « Liber téet nonnes de s images o cc id en tales »(2000).
22 Thomas d'Aqui n, Somme théologique, l , l , quo1, 9, rép. \-3.
r
Gil Bartholeyns
23 Psaume 22 [21], 7 : « Ego aut em sumvermis, et non homo » (Vulgate).Pour Williams (l996), toutes lesdéform ations visuelles et verbalesda ns la cul tu re médiévale sont desempru nt s au principe di onysien,tous les monst res des images de Dieu(p. 286 et passim).
24 À deux reprises : La Hiérarchieceleste, xrn, 4, p. 157·158 et XV, 1,p. 163-164.
25 Didi-Hu berman, Fra Angelico. Dissemblance et f iguration (1995),p. 15, 144, passim. Georges DidiHuberman s'appuie sur l'iconologiedionys ienne pour écla irer les œuvresita lienne s du Quatt rocent o (p. 82et suiv).
26 Par exemple, dans le manuscrit desÉvangiles réalisé en Angleterre vers1220, Hereford Cathedral Libra ry,MS a.1.viii, f. 46.
27 Ezéchiel, 1, 5-11 et Ap ocalypse, 4,6-8.
du visuel, du discour s et de la vision qui dépendaient plein ement deYimaginatio.
Mais, de fait, on ne connaît pas de représentation du Christ sousla forme d'un ver. Cette image aurai t pourtant eu une gran de vertuanagogique. Comme le ver, auquel le juste se compare dans lesPsaume s» , personne ne s'est autan t humilité que Jésus ; et le ver,tout comme Jésus, naît « san s semence d'une vierge » dit Pachymèreau XIII' siècle. Bern ard de Clairvaux , lui-même commentateur deDenys, a même une position inverse quant à la valeur « spirituelle»des images: les figur es inféri eure s et hybride s ne peuvent pas faireaccéder le moine aux réalités supérieures, elles sont seulement bonnespour frapper Jes esprits simples. Au fond, le lien entre l'iconographieet la théologie négative de Denys et de ses continuateurs, Jean Scot,Richard de Saint-Victor ou Albert le Grand, ce sont les empruntsrespectifs à la Bible. Denys tire son iconologie négative et dissimila iredu mystère des images qu'il rencontre dans l'Écritu re - comme lesanges aux innombrables pieds, aux multiples visages et à six ailesd'I saïe 6, 224 - et la Bible est mise en images par les scul pteurs etpeintres.
Néanmoins cert aines images peuvent être interprétées en fonctionde la voie de la dissemblance transmise jusqu'à Ia fin du MoyenÂge. C'est l'hypothèse suivie par Georg es Didi-Hube rman pourles panneaux peint s « au jeté » de la Madone des ombres de FraAngelico au couvent de San Marco (1440-1450) : « la dissemblance[a pu] constituer Je moyen pr ivilégié d'une "mise en mystère" descorps, moyen dont les purs "bariolages" de Fra Angelico » seraientJe cas limite. Les constellati ons inqua lifiables des panneaux, qui sedonnent à voir dan s toute leur én igme, inciteraient le moine à y voir
« infiniment plus que ce qu'e lles donnent à discerner » .25
Pour une période antérieure, on pense plus simplement auxévangélistes animalisés. Marc, dont le symbole est le Iions«, possèdeparfois une apparence bestiale et féroce, comme dans un manuscritdes Évangiles réalisé au VIII' siècle (figure 2). Plus surprenant, iJ peutêt re représenté sous la forme d'un homme avec une tête de lion. Sil'on met de côté le symbolisme et Ja référence aux quatre vivants del'Ancien Testament (l'aigle, le taureau...)27, auxquels sont identifiésles évangélistes à partir du nesiècle, il y a le fait suivant. Best ialité,sauvager ie, laideu r, par ces traits généralement associés au mal, c'est
-,
,
."
Si t 'on a raison de figurer l'infi gurable j 7
;
avant tout la nature hors du commun des êtres qui est signifi ée.wLes hagiographes ne faisaient pas autre chose lorsqu'ils décrivaientl'apparence de certains saints par des signes d'im pureté ou liés aubas social. En renversant la poétique de la grandeur, ils créaient desimages déroutantes qui favorisaient une approche plus spirituelle desréalités saintes . Le monstrueux, au sens de Scot Erigène, donnera ità voir la nature des êtres qui sont au-delà des catégories de l'ordrenature l: soit homm e, soit an imal.. . On pense alors immédiatementaux « hybrides » qui envahissent les marges des manuscr its et desbâtiments aux XIIe et XIII e siècles , ces êtres sans nom, dont les cor psaccumulent les abertations .» Et pourtant on aura it tort de les associeraux images de dissemblance anagogique. Tout d'abord, en se livrant à
toutes sortes de compor tements condamnables, obscènes et rid icules,
ces figures qui prêtent souvent à rire, sont plutôt à comprendre selon
le sens moral. Ensuite, elles exemplifient le tabou du mélange desespèces , de la confusion de l'ordre de la Création: ce sont les ima geson ne peut plus affirmatives, littérales, de cette obsession médiévale.Enfin, elles ne renvoient à rien d'autre qu'à elles-mêmes. Les hybri desde cette sorte ne sauraient donc être une man ière de mettre sous lesyeux une représentat ion qui, faute de pouvoir être à la « hauteur» deson objet, oblige à « voir» au-delà, et donc à ressent ir ou, comme ledit Jacques Rancière, « à rendre présent le caractè re esse ntiel de lachose en question ».30
Bref, devan t ces hybrides, le spectateur n'est pas saisi d'une sorte deterreur sacrée, comme il le sera it devant une « sainte monstruo sité ».Kant ne définissait-il pas le sublime comme la transfiguration de laterreu r en une exaltation spir ituelle provoquée par le spectacle desdésordres « les plus sauvages », comme « le sentiment de l'impuissancede son imagination » 31 ? Sur le même mode que les formes, les quali tésconduisent, elles aussi, vers la perception spirituelle. À l'irascibilitéléonine (de saint Marc) correspond le courage intellectuel ; à lafolie d ivine, une immense sagesse ; à l'ivresse, la raison . Denys nemanque pas de le souligner. Ce qui est doué « figurativement »32 deconcup iscence est la similitu de dissemblante d'un amour immatérieldu divin. À chacun dês lors à se livrer à « l'exégêse sacrée des figuresde bêtes sauvages qui symbolisent saintement les esprits célestes »".
Une autre image dissemblable ou inconvenante peut êtr e la Trinitérepr ésentée sous la forme d'une personne à trois têtes> ou d'une tête à
t rois visages.» Le Dieu triface conservé à Lucerne (figure 3) const itue
28 À ce sujet, Image er transgression,op. cit., p. 65.
29 Di u mar , Naissance de la bestialité,thèse de doc torat , Paris, EH ESS,2010. Camille, Images dans les mar~
ges (l 997). Wirth , Engammare el al.,Les Ma rges à drôleries des manus~
crits gothiques (1250~1350) (2008).
30 R ancièr e, L eDestindes images (2003),p . 126.
31 « Ce qui veut di re qu'elle mérited'être ap pelée un plaisir nègatif o :Imm an uel K an t, Critique de lafaculté de jug er, livre II, § 23-26, trad .Pari s, GF Fl ammari on , 1995, p . 225~239.
32 Denys, La Hiérarchie céleste, p. 82 etp. 184-188, ici 188.
33 Ibid.
34 Par exemple , dans le Psauti er an glaisréa lisé vers 1270-1280, St John 'sCollege, Cambridge, MS K 26, ( 9.
35 Sur la Trini té tr icépha le ou trifons :Schade, « D rei G esichter , D reiKôpfe» (1969).
j 8 Gil Bartholeyns
\
,
36 K ruse et Stad 1er éd. , Am bigu ityin Mind and Nature Muu istableCognitive Phenomene (1995).
37 An toni n de Florence , Summa theologiae (1450), par tie 3, titre 8, chap.4, éd . Vérone, 1740 , col. 321 pour lacitati on (rcprod. G raz , 1959). JeanMolanus, Trait é des saintes images,1570, livre II , chap. 4 « Qu'il fautreje ter certaines images de la trè sSa in te Tri nite », éd . Par is, Cerf,1996, vol. 1, p. 133-136.
38 Thérèse d'Avil a, R elations spirituel les, Œuvres complètes, Pari s, Cerf,1964, p. 553.
39 Chronique de Sige bert continuée pa rRobert de Mons, éd. Migne, PL vol.160, col. 365. Boespûug, « Le Diab leet la Trinité tricéphale ... » (1998).
40 Rh étorique à Herennius, attribué àCicé ron, III, 22 er III, 23, 39. Yate s,L'Art de la mémoire (1975).
IMAGES VERBALES CONTREIMAGES MENTALES
41 Du by, Le Temps des cathédrales ,l'art et la société, 980-1420 (1976).
une étonnante image rnultistable, du type du cube de Necker ou duvase de Rubin» . Elle contient trois visages qui ne peuvent jamais être
perçus en même temps ni, souvent, de manière volontaire : percevantun visage. pu is un autre, mais jamais plusieurs à la fois, l'image semblealors s'animer, comm e procédant d'une obscure magie. Et sur le planformel, n'est-ce pa s en étant qualifiée de « monstrueux dan s l'ord re
de la nature », exact ement comme Denys inciterait à l' interpréter, queces images sont cond amnées sont par les tbéologiens à part ir du X V"sièclev? Thérèse d'Avila elle-même n'y sous crit pas, mais ses motssont significatifs ; « c'est là une chose qui nous épouvante »38. Quoi deplus symptomatique aussi que ce récit : le continuateur de la chroniquede Sigebert raconte que c'est sous la forme d'un homme à tro is tête sque le démon est apparu à un frère en 1211, moment de l'appa rition dece type iconographique."
En somme, une part de la force d'évocation « spirituelle » de ce typed'images rés ide dan s la charge émotion nelle des attributs traditionnels
du mal, du sauvage, de la bassesse, de l'insensé. Et, en présentant leplus grand écart possible, du moins le plus saisissant, entre le modèleet l'idée que l'on s'en fait, l'image vient « briser» la ressemblanceatten due, et agit comm e une révélat ion. Le rapprochement qu'il estpossible de faire avec les arts de la mémo ire n'est pas anod in. Pourse souvenir, la Rh étorique à Herrenius conseille de créer des scènesvivantes au moyen de « beauté(s) exceptionnell e(s) " ou de « laideu r(s)parti culièrets) » : un mort , des manteaux de pourpre, du sang.'. Plusles images dissembleront, plus elles seront mnémoniques.
Les ima ges matérielles manifestent , au moins empiriquement, cetteconcep tion de la représentation dissemblable élaborée au haut MoyenÂge et abondamment exploitée par certains mystiques dans leur sécrits. Denys ne fut pas l' init iateur d'une iconographie, comme Suger,à la fois théoricien, commanditaire et bât isseur» ; il cherchait à mettreau jour les principes de construction des images verbales qui étonnent
par leur incongruité, exacerbant l'idée d' un domaine « inexpr imable »(anenphras ton) du divin . Ces images procèdent d'une logique
esthétique et sémantique du bas pour le haut , de l'in forme pour la
perfection, du monstru eux pour le sacré, qui ne donne pas à voir ce àquoi on s'att endrait.
r
Si l' on a raison de fig urer L'infigurable j 9
/
/
, -
.-
Ce type d'images, souvent composée s dans des contextes culturelsradica lement différents, à plus de hu it siècles l'un de l'autre si l'onprend les visions d'Isaïe et l'Apocalypse de Jean, présente une autrecaractéri stique générale: elles ont pour effet d'entraver la faculté deconstruire la figure mentalement, rejetant de fait son objet au-delà del'« image ». Prenons l'exemple du début de la vision du char de Yahvédans Ezéchiel (1, 4-12), texte composé vers 585 av. J.-C. Le latin estcelui de la Vulgate :
« C'était un vent... un feu ja illissant, avec une lueur autour (in circuitu) ,et au centre comme l'éclat du vermeil (quasi species elec/ri)... Aucentre , je discernai quelque chose qui ressemblait (simi/itudo) àQUATRE animaux dont voici l'asp ect (asp ectum) : ils avaient formehumaine tsimilitudo hominis)... chacun avait QUATR E faces et chacunQUATRE ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs sabots étaientcomme (quasi) des sabots de bœufs, étince lants comme l'éclatde l'airain (quasi asp ectus...). Sous leurs ailes, il y avait des mainshumaines tournées <vers les quatre directions>, de même que leursfaces et leurs ailes... <jointes l'une à l'autre> ; ils ne se tournaientpas en marchant. .. Quant à la forme de leurs faces, ils avaient uneface d'homme, et tous les quatre avaient une face de lion à droite, ettous les quatre avaient une face de taureau, et tous les quatre avaientune face d'a igle. Leurs ailes étaient déployées <vers le haut> ; deux<se joignant>, deux <couvrant> le corps ; et ils allaient chacun devantsoi... »
Dislocation de l'image, mise à l'arrêt de la faculté d'imager...Au monstrueux par association (humain-animal, jambes-sabots,mains-ailes) et à la multipl icité tératologique (quatre faces, quatreailes...) s'ajoutent les approximations, les compara isons (les chosessemblent être comme d'autres choses ou bien en avoir l'apparence) ;la répétition, l'énumération ; et les antinomies (des an imaux de formehumaine, des membres déployés mais qui se joignent). Sous cet angle,les représentations de ce type d'image s verbales sont assez décevantes(figure 4).
On retrouve ces procédés dans les descript ions du « surnaturel », dumervei lleuxe et de l'effroyable. Plusieurs d'entre eux se distinguent parun usage plus systématique. Un premier procédé est la décomposition
42 Dubost, « La pensée de l'im pensabledan s la fiction mé d iévale) (1993),p. 53.
j 10 Cil Bartholeyns
-,
43 Denys, La Hiérarchie céleste, II , 3,p. 78. Voir aussi L es Noms divins.
44 Cer tains exemples sont rep ris à untravail colle ctif réalisé avec Pierr eOlivier Ditt mar et Vincent Jolivet :Image et transgression au Moyen Âge(2008).
4S Cité par Bichon, L'Animal dans lalitt érature française alt XIY et auXIII~ siècle (1976), vo l. J, p . 26. Voirles exemples donnés par Fer lampinAcher, ( Le monstre dans les rom ansdes Xl Ils et XI Ve siècles» (1993).
46 Denis, Image et cognition (1993),p. 135 et pass im.
sans fin des êtres et des choses au moyen de longues descr iptions et demétaphores qui empruntent à l'expérience ordinaire, ce qui correspondà la théor ie médiévale de la connaissance, selon laquelle l'hommene peut approcher l'intelligible qu'à travers le sensible. Un secondprocédé consiste à s'en tenir à des termes vagues, à décrire les êtres etles visions par le « dehors ». Un troisième procédé, sachant qu'ils seconjuguent l'un l'autre, est l'usage de l'anti logie et du paradoxisme.Un der nier, le plus connu, car il est typique de la théologie négative,est de se servir de « termes qui signifient, non ce que [la chose] est,mais ce qu'elle n'est point.o »
Un passage de la Vie de saint Georges (vers 1160) de Simon deFreine est caractéristique du premier procédé de non-représentationou d'anti-repr ésentat ions- :
« Ses poils [de la créatur e monstrueuse] pendaient comme la queued'un cheval, son front était velu comme celui d'un ours, il avait descornes de bœuf, les sourc ils comme une queue de renard, le nezrecourbé comme le bec d'un vautour, la bouche large comme celled'un chien de chasse, il montrait les dents comme un mâtin... »45
Très fréq uente dans les romans des XIIe-XIve siècles, l'énumérationparadoxales des part ies, rend l'image complexe et particulièrementdifficile à former mentalemen t. L'espr it est affaibli dans sonfonctionnement habituel par la prolifération des comparaiso ns.L'emploi de trai ts non figuratifs du genre « agi le comme une panthère »rend la description encore plus efficace, puisqu'on ne fait pas référenceà l'image du félin mais à sa quali té, donc à quelque chose d'abstrait - etqui savait à quoi ressemblait une panthè re ?
Dans le deuxième type de non-description, au lieu d'user d'unvocabulaire précis, voire naturaliste, on a recours à des termesgénéraux et extérieurs , déclarant souvent une incapacité à décrire,ce qui met plus encore à distance. Les sciences cognitives viennentconfirmer que les termes générique s (« siège» plutôt que « chaise »,
« demeure» plutôt que « château ») ralentissent voire neutrali sent lafaculté d' imagerie." C'est le cas de la vision d'Ezéchiel, présentéetout à l'heure, et de beaucoup d'autres descriptions d'apparitions qui,de plus, abondent en approximatifs, tels que les locutions comme ousorte de, ainsi qu en sauts d'échelle par l'emploi de termes comme
"
Si l'on a raison de fig urer l 'infigurable j 11
"
«immense », « infini » ou « illimi té ». L'effort et le temps quedemandent ces images leur donne une charge émotive et mnés iqueparticulière. Insistant sur l'extériorité, Angèle de Foligno écr it vers
1290 :
« Je vis une chose [...] si indicible tindicibitemï que je n'en puis riendire (nichil p ossum dicere), sinon que c'était le tout bien. Mon âmeétait dans une joie totalement inénarrable (inenarrabili) . Je ne vis paslà l'amour mais une chose inénarrable (rem inenarrabilem). [...] je sustrès certainement que plus on ressent la présence de Dieu, moins onpeut en parler (minus possunt loqui de eo). Car c'est précisément cequ'on éprouve de cet infini et indicible (indicibiliy qui rend incapabled'eo parler (de eo minus loqui possun t). ))47
Qu'on le tienne pour l'héritier d'une tradition litt éraire-sou bien qu'il« retrouve » cette logique descriptive, Howard P. Lovecraft procédaitsouvent de la même manière pour décrire l'horreur abyssa le :« Tandis que je poussais mon premier et dernier cri [...] j'aperçus, enpied, effrayant, vivant, l'inconcevable, l'indescriptible, l'in nommablemonstruosité .. . »49. Ala lettre, il n'y a rien à voir. Et dans l'exemplesuivant, il revient au lecteur d'imaginer en puisant dans ses propre sressources: «C'était partout [explique Manton à son ami Carter]- une sorte de gélatine - de gelée - et qui pourtant avait des formes- mille formes si horribles... dépassant toute description. Il y avait desyeux ~ et une souillure... C'était la fosse, c'était le maelstrom , c'éta itl'abomination ultime. Carter, c'était l' indicible (the unnamable) ! )) 50.
Dans ces images ({ floues », le langage est rendu inapte à dire , pourinduire.
Le troisième procédé est l'alliance de termes ou de qualités choisispour heurter la logique et enrayer l' imagination. Il est possible dedécrire la Jérusalem céleste, espace absolu de la fin des temps, parune image « de grand prix ) comme dit Denys, d'en faire une imageaffirmative. C'est le cas dans l'Apocalypse de Jean. Cette imagefinit par dépasser notre capacité représentative par sa surabondancemême. Comment se représenter en effet une « cité qui resplendit telleune pierre précieuse... munie d'un rempart pourvu de douze portes,reposant sur 12 assises, un rempart constru it en jaspe, et la ville estd'or pur, le tout est rehaussé de pierreries de toute sorte, de saphir,d'émeraude, de coraline... et les 12 portes sont 12 perles... et la place
47 Livre d 'Angèle de Foligno d'aprèsles tex tes originaux, G renoble,J. Million, 1995, p. 124 et 141.
48 Prigent, La Langue et ses monstres(1989).
49 H. P. Lovecra ft, The Outsider, 1921,tra d. Je suis d'ailleurs, Pari s, Dcnoël,t. 2, p. 86.
50 Id ., Th e Unnamable, 1925, trad .L'indicible, dernières lignes de cenenouvelle qui est aus si un essai surl'irrepr ésentable en litt ératu re. Leséd iteurs de Ma l/eus Mo ns trorum(San s-Detour éditions, 2009), unbestiaire dédié au jeu de rôle l 'Ap pel de Cthulhu, l'ont bien compris.Au lieu de pro poser une illust ration « naturali ste » des mons tres ilsles évoquent pa r des objet s et desimages de toutes les époques et lescultures. Je remercie Olivier Caïr apour cett e information .
j 12 Gît Bartholeyns
,
5l H ad ewijch d'An ver s, Nouveaux poè mes, I, trad. Écrits mystiques desbéguines, Paris, Seui l, 1954, p. 157.
52 Margueri te Porete, L e Miroir dessimples âme s anéanties, tr ad.G renoble, J. M illion, 2001, p. 134et 81.
S3 Jean de la Croix, L es Cant iques spirituels, Paris, Cerf, 1995, Cantique A ,§ 14.
54 Lewis Ca roll, The Hun ting of theSnark (1876), trad . Pléiade, 1983, p.371 -399.
55 Joh an nes Scheff ler oka AngelusSilesius, Cherubinischer Wandersmann , trad . Pari s, Ri vages, 2004.
est d'or pur, transparent comme du cristal », etc. ? Mais il est possibleaussi ne pas faire de la Jérusalem céleste un comble de matérialitéédifiante, mais d'en faire un état profond, que les mystiques disent videet rempli à la fois. On multiplie alors les antithèses et contradictionssensibles: « la claire ténèbre (...) la présence d'absence » d'Hadewijchd'Anvers», le « déser t fleuri ) de Bonaventure , le « loin-près » deMarguerite Porete, « ivre de ce qu'elle n'a jamais bu »j2, « la musiquesilencieuse, la solitude sonore» de Jean de la Croix»: Pendant uninstant, il est habité par un manque d'image.
Lewis Caroll a justement joué, dans La Chasse au Snark»,d'associations incongrues pour décri re la créature recherchée.Insaisissable mélange de snail (escargot) et de shark (requin), le Snarkse reconnaît à des carac téristiques comme sa saveur ou sa passion descabines de bain. Dans cette aventure fatale, tout découle du principede l'antinomie confondante: le bateau recule pour avancer et leboulanger est connu pour avoir oublié son nom. Sur la consigne deCaroll, l'éditeur avait précisé à l' illustrateur que les descriptions dumonstre étaient « parfaitement inimaginables » et que l'auteur désiraitqu'il restât fidèle à « la cohérence du nonsense ». Ainsi, quand à la fin,l'un des chasseurs tombe du rocher en croyant apercevoir la créature(figure 5), on pose immédiatement le regard sur l'illustration et l'onne peut s'empêcher d'y chercher une silhouette, des yeux, un corpsdissimulé dans le treilJage nocturne et infiniment pénétrable de lagravure.
Enfin, un comble de non-représentation, ce sont ces listesvertigineuses de tout ce que n'estpas la chose dont onparle. niantjusqu'àses attributs les plus abstraits ou immatériels (comme la lumière), ycompris tout ce qu'il n'est déjà pas - ce qui donne lieu à des négat ionsde négations, brouillant jusqu'à la représentation intellectuelle. Unpassage du Pèlerin chérubinique (IV, 21)de Johannes Scheffler, paruen 1657, en est un bon exemple:
« Ce qu'est Dieu on ne le sait pas : Il n'est pas lumière, ni esprit / Nivérité, ni unité, ni Un, Il n'est pas ce qu'on appelle divinité : / Il n'estpas sagesse, ni entendement, ni amour, volonté ou bonté : / Il n'estaucune chose, aucune non-chose non plus, ni essence, ni cœur: 1Il estce dont toi et moi et toute créature 1N'aurons jamais l'expérience avantde deven ir ce qu'Il est. »55
'\
,
r
r Si L'on a raison de figurer l'i nfigurable j 13
/
:
Les myst iques médiévaux ont placé la limite du discours au cœurde leur système. Leurs images reflètent cependant rarement cettetendanc e. L'expérience visionnai re étant plutôt dominée par l'allégorie,par le scrupule descr iptif et par l' image affirmative qui exprime lagrandeur spirituelle par la grandeur terrestrex- leurs figurationssuivent, quand il y en a. L'impression d'« abstract ion » qui se dégagedes images tir ées des visions d'Hildegarde de Bingen est le résulta td'une traduction « litt érale » de la descr iptionY C'est moins la visionque son événement qui est défini négativement par tout ce qu'il n'estpas.» Dans les appréciat ions qu'ils font des œuvres visuelles, on seserait attendu à ce que les mystiques n'y trou vent pas leur compte. etpou rtant Nicolas de Cues écr it : « parmi les productions humaines,je n'ai r ien trouvé de plus convenable à mon dessein que l'image d'unOmnivoyant dont le visage est peint avec un art si subtil qu'il sembletout regarder à l'entour. On trouve de nombreuses et exce llentespeintures représentant de tels visages [dont l'une] est cel1e que le plusgrand Roger [Van der Weyden] a exécutée... »".
Quelques œuvres échappent cependant à la déception que l'onressent en ne trouvant que peu d'images qui corre spondent, sur le planvisuel, à la poétique « négative » des œuvres spirituelles . C'est le casde plusieurs célèbres manuscrits du In honorem sanetae crucis deRaban Maur, composés dés le premier tiers du IX' sièclese. Ce traité oùlettrages et images se chevauchent propose au lecteur un chem inementqui va du figuré (depuis la dédicace au pape) au géométrique (figure6), selon un principe que Chr istian Heck a qualifié d'abstrac tionprogressive.o Au fur et à mesure qu'il tourne les pages, le lecteurassiste à un éloignement des repères « figuratifs », à un abandon dutraitem ent « naturaliste » des personnes et des objets , à la disparitiondu monde sensib le, activée par la lecture. Le tressage du texte et del'image ajoute à l'effet ornemental, intensément médi tatif des tap is deIenres.e
Un autre exemple est celui des Rothschild Canticles, un manusc ritfascinant réalisé autour de 1300 dans un mi lieu influencé par lathéologie négative. Dans cette œuvre de dévotion extatique attribuéeà des nonne s ou des béguines, l'ornement, placé d'ord inaire dans lesmarge s, se retrouve là auss i au centre de l'image, jusqu'à devenir lemotif principal des représentations de la Trinité" : silhouette blanche
ABSTRACTIONSORNEMENTALES
56 Par exemple, chez Elisabeth deSch ônau , Liber visionum , éd. F. w.Roth, Brünn, 1884, trad. Visions ,Paris, Cerf, 2009.
57 Hildegarde de Bingen, Liber SCÎI'ias[1l41-115l], trad. Sc ivias ou L e livredes visions, Paris, Cerf, 1996. Voirles imag es du fac-similé de 1925 dumanuscr it (détruit) réalisé sous lad irection de la visionnaire, abbayeSain te-Hildega rd e, Rüd esheimEibingen : h ttp://ww w.abtei-st-h ild ega rd .de/ h i1dega rd /mi ni a t u ren lmini atur en .php .
58 Schm itt,« Hildegarde ou le refus durêve » (2000).
59 Nicolas de Cues, De visione Dei,sive de Icona, cha p. 6, 1453, trad. L eTableau ou la Vision de Dieu, Paris ,Cerf, 1986, p . 31-32.
60 De ux manu scri ts, réa lisé s sousl'autorité de Raban Maur, sont bienconnus et repro du its: celui d'Am iens(dont la figure 6 est tirée), cf. Perrin,L' Iconographie de la Gloire à la saint ecroix (2009), et celui de la Biblio thecaApo stolica Vaticana, Reginenets 124(Fulda , 825).
61 Heck, « Raban Maur, Bern ard deClair vau x, Bonaventu re: expr essionde l'espace et topographie spir ituelledans les images méd iévales » (2006),p. 113-123.
62 L'ornementalit è textuelle est déjàprésente dan s la bordure de ladédicace avant qu e l'ornemental del'écriture et des figures géométr iquesne se retrouve au centre.
63 The Rothschild Cantlc les, N ewHaven , Beine cke R ar e Book andManuscript Librar y, MS 404. VOÎrla sér ie que for ment les fol ios 40, 68,84,98, 100, 104, \0 6.
j 14 Cil Bartholeyns
"
-.
64 Hamburger, The Rothschild Camicles (1990), p. 208.
65 Bonne, « De l'ornemental dans l'artm édi éval » (1996), p. 239.
66 Gol senne, « L'or nemen ta l: esthétique de la différence" (201O), p. 183.Sur l'animation pa r l'ornementa l:GeU, L'Arf et ses agent s (1998), p. 93et sui v.
CONCLUSION:LA NON-REPRÉSENTATIONCOMME VOLONTÉ
67 Anonyme du XIVe siècle , The Cloudeof Unknowyng, chap. 70, trad. Pari s,Seuil, 1977, p. 210.
68 C'est l'approche de Rus , {( Sur leparadi s au Moyen Âge. Les mot spour le dir e » (2002). Ponctuel lementchez de Courcelles, Langages mysti ques (2003), pa r ex. p. 21.
69 Sur ce dernier aspect , Bonne, ( Entrel'i mage et la matière : la chos éit é dusac ré en Occident )) (1999).
à la face cachée par le disque de sa propre gloire au folio 98, corp sdes trois personnes partiellement recouvertes au folio 104, unitécirculaire de Dieu rendant les trois personnes tota lement invisiblesau folio 106 (figure 7), en regard duquel on peut lire : « Je suis celuiqui est [Exode 3, 14], Dieu, nul ne l'a jamais vu [Jean l, 18]... » (folio105 verso).« Comme Jean -Claude Bonne et Thomas Golsenne l'ontsou ligné, l'ornementa l pe rmet ou vise deux chose s au moins . D' unepart, articuler des «régions discontinues et même opposées », del'hu main au cosmique, « par delà les similitudes et dissimilitudesfiguratives »65 . Dan s ce manuscr it qui servait à l'exercice de laméditation, la valeur synta xique de l'ornemental se géplace en quelquesorte pour jouer son rôle, non plus dans l'espace de la page, mais dansl'espace de la contemplation, entre le lecteur et Dieu. D 'autre part,l'ornemental it é, par sa complexité, fin it par déborder « les capaci tésde compréhens ion visuelle du spectateur », « lui donnant le sentimentqu 'il est dépassé - que quelque chose d'invi sible se manifeste à trave rscette ornementation »66. Soutenu par un texte composite à l'extrêm e,souvent mystérieux pour le lecteur, les figures de ce qui n'en a pascondu isaie nt le fidèle vers un état où le prototype et son image - c'est à-dire, cette fois, l'homme en tant qu'il a été fait ad imaginem Dei- éta ient réun is à la façon dont la mys tique expliquait qu 'on n'en avaitl'expéri ence qu'en le devenant.
Les proliférations compar atives ou les hype rboles ne sont pas , ain siqu'on a eu parfois tend ance à les prése nter, des tentatives désespéréespour parveni r à sais ir, à « voir» la chose qu i échappe, et dire enfin :c'est ça ! Ce sont plutôt des moyens po ur faire comprendre le statuttranscendant de cert aine s choses et, si possib le, pour faire éprouver
cogn itivement leur altérité radicale : « Que par le dépass ement etla cessation de nos sens corporels, nous com mençons à ven ir pluspromptement à la connaissance des choses spir ituelles ; comme par ledépassement et la cessation de nos sens spirituels, nous commençons
à venir plus promptement à la connaissance de Dieu », écr it l'auteurdu Nuage d 'inco nnaissance/a Les créations visuelle s et verbales de
cet ordre ne témoignent nullement d'un échec ou d'une incapacité",mais au contraire d'une faculté à produire une certaine formed'« agentivit é » entre le lecteur et le texte, ou entre le spectateur et lafigure matériellew, Au moins forcent-elles à dépasser la culture de la
-,
Si l 'on a raison de figurer l 'infigurable j 15
.'
:
mimèsis.Si l'h istoire occidentale des images nous montre que la
coha bitation est à peu près impossible entre iconophiles (iconodu les) eticonophobes (iconoclastes)?'; en revanche il y a cohabitation, et mêm eorganisation - Je moine et le simple fidèle, le mystique et le non-initié- entre les part isans de l' image apophalique (qui nie) et les adepteset consommateurs d' images kataphatique s (qui affirment). La voiedionysienne des images, dont la fortune fut immense, est d'emb léedouble : bien que les signes négatifs ou scandaleux fussent les plusfidèles à la connaissance - préci sément impossible - des réalitésspirituelles, il était tout à fait acceptable aussi de les dépeindre par desimages maté rielles les plus banales ou attendues (un trèfle, un oiseau,des joyaux), puisque la matière garde les vestiges du principe divinqui l'a créée et puisqu' il est nature l à l'homme de percevoir de manièrecorporelle les réalités spirituelles. De ces dernieres, il n'y a jamais quedes « signe s dissimiJaires » (dissimilia signaï n. Ains i, lorsque certainsconcevaient ou possédaient des représentations rutilantes du paradisou de Dieu, d'autre s essayaient d'en faire ou de s'en faire des imagesaussi étrangères ou contrai res que possible à tout ce qu'ils perceva ientsur terre, cette île de la conscience.
Baschet, Jé rôme, « Inventivité et sér ia lité des im agesméd iéva les. Po u r une approche iconograph iqu e élargie », AnnalesHSS, 51, 1996, 1, p. 93-133.
Belting, Hans, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes l'ordem Zeitalter der Kunst (1990). Image et Cu/te. Une histoire de l'artavant l' époque de l'art, Pa ris, Cerf, 1998.
Berliner, Rudolf, « The Freedo m of Medieval Art », Gazettedes Beaux-Ar ts, vol. 28, 1945, p . 134-164, repris dans RudolfBerliner (1886-1967). « The Freedom of Medieval A rt» und andereStudien zum christli chen Bild, éd . par Ro bert Suckale, Berlin,Lukas Verlag, 2003.
Bichon , Jean, L'Animal dans la littératurefran çaise au XIIeet auXIIIe siécle, thè se de doctorat, Paris IV, Service de reproduct ion
des thèses, Universitè de Lille3, 1976.Besançon, Alain, L'Image inte rdite. Une histoire intellectuelle
de l'iconoclasm e, Paris, Fayard , 1994.
70 Parmi lesq uel s o n peut inclu re le s hérétiques : Sch m itt ,« "Unor th odox" Images » (2007).
7 1 Su ivant l'expr ession lati ne d'Ambroise Tra versar i. Miernowski ,Signe s dissimilaires , la quête desnoms divins dans la poésie f rançaisede la R enaissance (1997).
RÉFÉRENCES
j 16 Gil Barthol eyns
-,
Boespflug, François, « Le Diable et la Trinité tricéphal e. Apropos d'une pseudo-t'vision de la Trinité" advenue à un novicede saint Norbert de Xanten », Revue des sciences religieuses, 72, 2,1998, p. 156-175.
Bonne, Jean-Claude, « Ent re l'image et la matiére : la choséitédu sacré en Occident », dans Les Images dans les sociétésmédiévales. Pour une histoire comparée, dir. Jean-Marie Sansterreet Jean- Claude Schmitt, Bruxelles-Rome, Bulletin de l'Instituthistorique belge de Rome, 1999, p. 77-112.
Bonne , Jean -Claude, « De l'ornemental dans l'ar t médié val(VIle-XIIe siécle). Le modéle insulaire », dans L'Image. Fonctionset usages des images dans l'O ccident médiéval, dir. Jérôm e Baschetet Jean -Claude Schmitt, Paris , Le Léopard d'Or, 1996, p. 207249.
Camille, Micha el, Im age on the Edge : Th e Ma rgins ofM edievalArt (1992). Images dans les marges. Aux limites de l'art médiéval,Paris , Gallimard, 1997.
Courcelles (de), Dominique, Langages mystiques et av ènementde la modernité, Pari s, Champion, 2003.
D eni s, Michel, Image et cognition, Paris , Presses Universitairesde France, 1993.
Didi-Huberman, Georges, Fra Angelico. Dissemblance etfiguration , Paris, Flammarion, 1995.
Didi-Huberman, Georges, Images malgré tout, Paris, Minuit, 2003,1ère par tie «Images malgré tout » initialement paru dans Mémoire des
camps. Photog rap hies des camps de concentration et d 'exterminat ion
nazis (1933-1999), dir. Clément Chéroux et al., Paris, Marval, 2001.Dubost, Francis, « La pen sée de l'impensable dans la fiction
médi éval e », dan s Écriture et modes de pensée au Moyen Âge :VIlle-XV" siècles, éd. Dominique Boute t et Lau rence HarfLancner, Paris, Presses de l'École normale supérieure, 1993,p.47-69.
Duby, Georges, L e Temps des cathédrales : l'art et la société,980-1420, Paris, Gallimard, 1976.
Ferlampin-Acher, Christine, « Le mon stre dans les roman sdes XIIIe et XIve siècles », dans Écriture et modes de pensée auMoyen Âge: V/Ile-XV"si ècles, éd. Dominique Boutet et LaurenceHarf-Lancner, Paris, Presses de l'École no rmale supérieure, 1993,
,
,
r- Si l 'on a raison de figurer l'infigurable j 17
p.69-87.Gandillac (de), Maurice, et al., « Influence du pseudo-Denys en
Occident », Dictionnaire de sp irituali té , Paris, Beauchesne, 1954,vol. 3, col. 318-386.
Gell, Alfred, Art and Agency : An Anthropological Theory (1998).L'Art et ses agents: une théorie anthropologique, Dijon, Les Presses
du réel, 2009.Golsenne, Thomas, « L'ornemental ; esthétique de la différence »,
Perspe ctive, 2010, l, p. 180-194.Goody, Jack, Representations and Contradictions, Ambivalance
Towards Images, Theatre, Fiction, Relies ad Sexuality (1997). La Peurdes rep résentation s. L'ambivalence à l 'égard des images, du théâtre,de la fi ction, des reliques et de la sexualité, Paris, La Découverte,2003.
Hamburger, Jeffrey, The Rothschild Cant icles : Art and Myst icismin Flanders and the Rhineland circa 1300, New Haven-Londres, YaleUniversity Press, 1990.
Heck, Ch ristia n, « Raba n Maur, Bernard de Clairvaux,Bonaventure; expression de l'espa ce et topographi e spirituelledans les images médi évales », dans The Mind's Eye: Art andTheologica l Argument in the Middle Ages, éd . par JeffreyHamburger et Anne-Marie Bouché, Princeton, PrincetonUniversity Pr ess, 2006, p. 11 2-132.
K ruse , Peter, et Stad ler, Michael éd., Ambiguity in M ind andNa ture : Multistable Cognitive Phenomena, Berlin-New York,Spr inger, 1995.
Miernowski, Jan, Sign es dissimilaires. La quête des noms divins
dans la poésie française de la Renaissance, Genève, Droz, 1997.Nancy, Jean-Luc, « La représentation interdite », dans L'Art et la
mémoire . Représenter exte rminer, dir. Jean-Luc Nancy, Paris, Seuil,2001, p. 13-39.
Perrin, Michel, L'Iconographie de la Gloire à la sa inte croix,Turnhout, Brepols, 2009.
Prigent, Christian, La L angue et ses monstres , Mon tpellier ,Cadex éditions, 1989.
Rancière, Jacques, « S'il y a de l'irreprésentable» (2001), reprisdans Le Destin des images, Paris, La fabrique éditions, 2003, p. 123153.
Roques, René, « Tératologie et théologie chez Jean Scot
j 18 Gif Bartholeyns
,
-,,
Er igène» (1967), rep ris dans Libres sentiers de l ' érigénisme, Rome,Edizioni dell'Ateneo, 1975, p. 13-43.
Rus , Martijn, « Sur le par adis au Moyen Âge. Les mots pour ledire», Poétique, 132, 2002, p. 415-428.
Schad e, Herbert, « Drei Gesichter, Orei K ëpfe », Lex ikon deschristlichen Iko nographie, t. 1, 1968, col. 537-539.
Schmitt, Jean -Claude, «"Unorthodox images" »? The 2006Neale Lecture », dans The Unorthodox Imagination in LateMed ieval Sri/ain, éd. Sophie Page, Ma nchester - New York,Ma nchester University Pre ss, 2010, p. 9-38.
Schmitt, Jean-Claude, «De Nicée II à Thoma~ d'Aquin :l'émancipation de l'image religieuse en Occident» (1987), reprisdans Le Corps des images, Paris, G allimard, 2002, p. 62-95.
Schm itt , Jean -Claude, «Hi ldegarde ou le refus du rêve»(2000), repris dans Le Corps des images, Paris, Gallimard , 2002,p.323-344.
Schmitt,Jean-Claude,«Libert éetnormesdes imagesoccidentales »(2000), repris dans Le Corps des images, Paris, Gallimard, 2002,p. 135-164.
Théry, Gabriel, « L'entrée du pseudo-Denys en Occident », dansMélanges Ma ndon net . Études d 'histoire littéra ire et doctrinale du
Moyen Âge, Paris, Vrin, 1930, vol. 2, p. 23-30.Wirth, Jean, « Faut-il adorer les images ? La théorie du culte des
imagesjusqu'auconcile de Trente », dans iconoclasme, Vie et mort del'image médiévale, dir. Cécile Dupeux, Peter Jezler et Jean Wirth,
Williams, David, Deformed Discourse : The Function of theMonster in Medieval Thought and Literature, Montreal, McGillQueen's University Press, 1996.
Wirth, JeanetPeter JezJer,Berne- Strasbourg -Zürich, ,somogy,2007, p.28-37.Wirth, Jean et Engam mare, Isabelle et at.. Les Marges à dr ôleries
des manuscrits gothiques (1250-1350j, Genève, Droz, 2008.Yates , Frances A., The Art of Memory , 1972. L'Ar! de la
mémoire, Paris, Ga llima rd, 1975.
,
Si l'on a raison de fig urer l 'infi gurable j 19
r
r
Fig. 1.En haut: la campagne vide du début de Nui t et Brouillard d'AlainRenais, France, 1955. En bas: un témoin, rescapé du génocide, dansShoah de Claude Lanzmann, New Yorker Film, 1985, T OI ". Capturesd'écran extraites des DVDs Arte Vidéo (2003) et Videofilmexpress(2005).