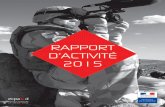Sidi Ali Ben Ahmed – Thamusida 3. "Suppellettile da Illuminazione. Lucerne"
Rapport SIDI IBRAHIMA Amat-Oulah_compressed.pdf
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Rapport SIDI IBRAHIMA Amat-Oulah_compressed.pdf
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN **********
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
********** UNIVERSITÉ D’ABOMEY-CALAVI
********** ÉCOLE POLYTECHNIQUE D’ABOMEY-CALAVI
********** DÉPARTEMENT DE GÉNIE D’IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOBIOLOGIE
RRAAPPPPOORRTT DDEE SSTTAAGGEE DDEE FFIINN DDEE FFOORRMMAATTIIOONN
PPOOUURR LL’’OOBBTTEENNTTIIOONN DDUU DDIIPPLLÔÔMMEE DDEE LLIICCEENNCCEE PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE EENN
IIMMAAGGEERRIIEE MMÉÉDDIICCAALLEE
TUTEUR M. BONOU Aimé Ingénieur des Travaux d’Imagerie Médicale
JURY
PRESIDENT Dr HOUNSOSSOU Hubert Maître Assistant des Université (CAMES) Enseignant chercheur à l’EPAC/UAC
JUGE M. TOPANOU Roland Enseignant chercheur à l’EPAC/UAC
SUPERVISEUR Dr MEDEHOUENOU Thierry C. Marc Enseignant chercheur à l’EPAC/UAC
Étude dosimétrique de poste dans le service
de mammographie du Centre Autonome de
Radiologie
. Présenté et soutenu par :
Amat-Oulah SIDI IBRAHIMA
Année académique : 2015-2016 9e promotion
I
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
********************
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
********************
UNIVERSITÉ D’ABOMEY CALAVI
********************
ÉCOLE POLYTECHNIQUE D’ABOMEY CALAVI
********************
DÉPARTEMENT DE GENIE D’IMAGERIE MÉDICALE ET DE RADIOBIOLOGIE
DIRECTEUR
Professeur Titulaire Mohamed M. SOUMANOU
DIRECTEUR ADJOINT CHARGÉ DES ÉTUDES ET DES AFFAIRES
ACCADÉMIQUES
Professeur Clément AHOUANNOU
CHEF DE DÉPARTEMENT
Docteur Hubert HOUNSOSSOU
Année académique : 2015-2016
II
LISTE DES ENSEIGNANTS AYANT INTERVENU EN
IMAGERIE MEDICALE AU COURS DE NOTRE FORMATION Années académiques : 2013 – 2016
1. Enseignants permanents
PRÉNOM(S) et NOM MATIÈRE(S) ENSEIGNÉE(S)
Théodora AHOYO Microbiologie
Casimir D. AKPOVI Biologie cellulaire ; Physiologie humaine
Christian AKOWANOU Sciences physiques
Guy ALITONOU Chimie générale ; chimie organique
Sylvère ANAGONOU Education physique et sportive I & II.
Nicolas ATREVI Embryologie ; Anatomie radiologique II ;Techniques radiologiques III ; Neuro-anatomie
Noël DESSOUASSI Biophysique de l’imagerie
Cyriaque DOSSOU Techniques d’expression et méthodes de communication III & IV
Julien DOSSOU Notions de radiobiologie et de radioprotection
Servais GANDJI Anatomie humaine I & II ; Anatomie radiologique I ; Techniques radiologiques II ; Notions générales d’échographie
Bertin A. GBAGUIDI Enregistrement d’image, Techniques radiologiques I
Hubert HOUNSOSSOU Eléments de biométrie
Évelyne LOZES Immunologie générale
Thierry C. Marc MEDEHOUENOU
Initiation à la méthodologie de la recherche
Daton MEDENOU Appareillage II ; Physique électronique
Mohamed M. SOUMANOU Biochimie générale
Roland TOPANOU Techniques radiologiques I & II
Sonagnon Paulin YOVO Pharmacologie
III
2. Enseignants vacataires
PRÉNOM(S) et NOM MATIÈRE(S) ENSEIGNÉE(S)
Sylvestre ABLEY Déontologie médicale
Gilles AGOSSOU Législation et droit du travail
Gervais AHOGA Soins infirmiers
François AMETONOU Techniques d’expression et méthodes de communication I & II
Olivier BIAOU Notions de sémiologie radiologique
Bertin DANSOU Anglais III & IV
Lordson DOSSEVI Techniques instrumentales
Léonard FOURN Santé publique
Thirbuce HOUNDEFFO Notions de sémiologie gynécologique et obstétricale
Hyppolite HOUNNON Mathématiques
Gervais HOUNNOU Notions de sémiologie chirurgicale
Aristide KOFFI Anglais I & II
Gabriel KOUNASSO Informatique ; Informatique médicale
Edgard LAFIA Notions de sémiologie médicale
V
Nous dédions ce travail :
- À papa SIDI IBRAHIMA Bachirou, que ce travail soit pour vous, le témoignage
de tous les efforts consentis à notre égard. Que DIEU vous bénisse !
- À maman MOUSSA AROUNA Aminatou, pour tout l’amour et les multiples
sacrifices consentis à notre égard. Que le seigneur vous comble de ses
bénédictions !
VII
Nous remercions très sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin, en actes
et en esprits, ont contribué à notre éducation, à notre formation et à la réalisation de
ce document.
- À notre superviseur, le Docteur Thierry C. Marc MEDEHOUENOU, nous lui
adressons toutes nos gratitudes et nos sincères remerciements pour sa
disponibilité permanente et son dévouement à la réussite de ce travail.
- Au Docteur Bertin GBAGUIDI, responsable du Centre Autonome de
Radiologie où nous avons effectué notre stage de fin de formation, pour ses
conseils.
- Au Docteur Hubert HOUNSOSSOU, Chef du département de Génie
d’Imagerie Médicale et de Radiobiologie.
- À notre tuteur de stage Monsieur Aimé BONOU, vous qui avez accepté avec
enthousiasme nous encadrer au cours de notre stage, malgré vos multiples
occupations. Recevez ici notre profonde sympathie.
- À nos frères et sœurs, que ce travail soit pour vous une source de motivation
dans tout ce que vous allez entreprendre.
- À tous nos amis et camarades de promotion pour la joie qui nous a été
procurée tout au long de ces années passées ensemble.
- À tout le personnel du Centre Autonome de Radiologie pour l’ambiance
fraternelle dont nous avons bénéficiée tout le long de notre stage.
- À tout le corps professoral de l’EPAC en particulier celui du Département de
Génie d’Imagerie Médicale et de Radiobiologie (D/GIMR).
IX
Tous nos hommages
- Au président du jury,
Vous nous avez honorée pour avoir accepté avec grande amabilité présider
notre jury de soutenance de rapport de stage pour l’obtention du diplôme de la
Licence Professionnelle. Vos remarques ne feront qu’améliorer la qualité scientifique
de ce travail. Veuillez trouver ici l’expression de notre grand respect et nos vifs
remerciements.
- Au membres du jury,
Vous avez accepté de bon cœur sacrifier une partie de votre temps pour
apprécier et juger ce travail. Vos remarques seront les bienvenues pour son
amélioration. Nous vous prions d’accepter toute notre reconnaissance et nos
remerciements distingués.
X
CAR : Centre Autonome de Radiologie
CIPR : Commission Internationale de Protection Radiologique
CIUR : Commission Internationale des Unités de mesure et de
Rayonnement
CNRP : Centre National de Radioprotection
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire
HSG : Hystérosalpingographie
LB : Lavement Baryté
TOGD : Transit Oeso-Gastro-Duodenal
UIV : Urétro-Cystographie-Rétrograde
2D : Deux Dimensions
3D : Trois Dimensions
% : Pourcentage
OSL : Luminescence Stimulée Optiquement
KV : kilovoltage
mAs : milli ampérage (charge)
mSv.h-1 : milli Sievert par heure
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
LISTE DES TABLEAUXLISTE
DES SIGLES ET ABREVIATIONS
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
XI
Tableau I: : Récapitulatif des examens effectués au cours de notre stage qui s'est
tenu du 20 juin au 20 septembre 2016 ..................................................................... 13
Tableau II: Limites réglementaires pour les travailleurs exposés ............................. 20
Tableau III: Caractéristiques de l'appareil de mammographie ................................. 25
Tableau IV: Caractéristiques de la salle de mammographie .................................... 25
Tableau V: Doses totales brutes (bruits de fond) en mSv enregistrées par les
dosimètres témoins au cours du mois ..................................................................... 27
Tableau VI: Doses totales en mSv enregistrées par les deux dosimètres au cours du
mois .......................................................................................................................... 27
Tableau VII: Doses totales en mSv (doses réelles) obtenues après avoir enlevé la
moyenne des bruits de fond ..................................................................................... 27
LISTE DES TABLEAUX
XII
Figure 1 : Plan sommaire du CAR ............................................................................. 5
Figure 2 : Répartition du nombre de mammographie en fonction, du nombre
d'exposition ............................................................................................................... 25
Figure 3 : Répartition du nombre d'examen en fonction des mAs ........................... 26
Figure 4 : Répartition de la densité des seins en fonction du mAs .......................... 26
LISTE DES FIGURES
XIII
Notre stage, effectué au Centre Autonome de Radiologie (CAR), couvrant la
période du 20 juin au 20 septembre 2016, a pour but d’appliquer les connaissances
théoriques reçues et de maîtriser la réalisation des examens radiographiques
standards et spéciaux. L’un de ces examens standards est la mammographie qui
constitue un examen fondamental dans l’exploration des seins.
Au cours de ce stage, nous avons constaté que le CAR ne contrôle pas les
doses de rayons X reçues au cours des examens. Nous avons alors jugé nécessaire
de réfléchir sur le thème : Étude dosimétrique de poste dans le service de
mammographie du CAR. L’objectif général était de contribuer à la radioprotection
du personnel technique du CAR.
Les données ont été recueillies grâce aux dosimètres OSL placés à des
endroits stratégiques dans le service de mammographie.
Ces données ont permis de savoir que les doses individuelles réelles
délivrées au niveau du tube (0,205 mSv) et au niveau du pupitre (0,045 mSv), sont
très inférieures à celles des bruits de fond.
Il ressort en que les limites d’exposition réglementaires ne sont pas
dépassées.
Mots clés : Mammographie, étude dosimétrique
RÉSUMÉ
XIV
The purpose of our internship, carried out at the Centre Autonome de
Radiologie (CAR), from June 20 to September, 2016, is to apply received theoretical
knowledge, and to master the standard and special X-ray examination procedures.
One of the standard examinations performed at the CAR is the X-ray examination of
breast named mammography.
During our internship, we have noticed that the CAR did not control any
quantities of X-rays received during examinations by technicians. We then chose to
reflect on the topic: Dosimetry study in the mammography unit of the CAR. The
objective was to contribute to the radiation protection of the known technical
personnel of CAR.
The data were analysed after they were collected prospectively by means of
dosemeters OSL put at strategic locations in the mammography unit. The study
showed that the individual doses per month delivered at the X-ray tube (0.205 mSv)
and at the console (0.045 mSv) were lower than the background measures.
In conclusion, it appears that the regulatory exposure limits are not exceeded.
Keywords: Mammography, dosimetry study
ABSTRACT
XVI
INTRODUCTION
PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DU LIEU DE STADE
1.1. Situation et historique du CAR
1.2. Description des locaux du CAR
1.3. Personnel du CAR
DEUXIÈME PARTIE : DÉROULEMENT DU STAGE
2.1. Objectifs et activités du stage
2.2. Apports du stage
2.3. Choix du thème
TROISIÈME PARTIE : ÉTUDE DU THÈME
3.1. Généralités
3.2. Cadre, matériel, méthode d’étude
3.3. Résultats
3.4. Commentaires
CONCLUSION
SUGGESTION
2
L’imagerie médicale regroupe l’ensemble des techniques permettant le
diagnostic des pathologies à travers l’image. Cependant, cette discipline médicale à
travers l’utilisation des rayons X expose le technicien de radiologie à des radiations.
Le problème qui se pose dans les centres de radiologie du BENIN est celui du
contrôle des doses reçues par le technicien.
Au CAR, les doses de radiations reçues par le technicien ne sont pas
contrôlées. C’est pour tenter d’apporter notre contribution à la résolution de ce
problème que nous avons jugé utile d’initier l’étude sur : Étude dosimétrique de
poste dans le service de mammographie au CAR.
En vue de rendre compte de manière fidèle et analytique des mois passés au
CAR et pour atteindre les objectifs de notre étude, il apparaît logique de présenter en
première partie le cadre de stage puis d’envisager en deuxième partie son
déroulement pour finir en troisième partie par l’étude du thème.
4
1.1. SITUATION ET HISTORIQUE DU CAR
Le CAR se trouve dans l’enceinte de l’Université d’Abomey-Calavi plus
précisément à l’Ecole Polytechnique d’Abomey Calavi. Il est situé au rez-de-
chaussée du bâtiment C, en face du restaurant universitaire. Il a été créé en mai
1984 par l’arrêté N° 218/MESRS/TR du 19 octobre 1983 grâce à la coopération
bénino-canadienne.
Il a été premièrement dirigé par une coopérante canadienne, Madame Denise
LEBRUN jusqu’en 1985, puis par :
- Monsieur Servais GANDJI, 1985 à 1987, 1989 à 1998, 2004 à 2011 ;
- Monsieur Augustin SODEGNON, 1987 à 1989 ;
- Monsieur Henri ADJALLIAN, 1998 à 2004 ;
- Feu Monsieur Nestor SANTOS, décembre 2011 à mars 2013 ;
- Monsieur Bertin GBAGUIDI, mars 2013 à nos jours.
Le CAR a pour mission de servir de cadre d’application pour les étudiants du
département de Génie d’Imagerie Médicale et de Radiobiologie (GIMR), de réaliser
des examens radiographiques et échographiques pour les patients, et de former les
stagiaires en échographie. Les patients sont reçus de 08h à 14h du lundi au vendredi
sauf les jours fériés et les week-ends.
1.2. DESCRIPTION DES LOCAUX DU CAR
Le CAR est composé de :
- un secrétariat ;
- une salle d’attente pour les patients ;
- une salle d’échographie dotée d’une toilette ;
- un vestiaire pour les patients ;
- une salle de mammographie ;
- un bureau pour le responsable du CAR ;
- un magasin ;
- une chambre noire ;
- une chambre claire ;
- deux salles d’examens (C 1116 et C 1120) pour la radiographie.
6
Le CAR est composé des services de radiographie et d’échographie.
1.2.1. Secrétariat
C’est le premier lieu où les patients sont reçus sur présentation de leur bon
d’examen. Après avoir payé à la comptabilité et enregistré au secrétariat, ils sont
orientés vers la salle d’attente et le bon est acheminé dans la salle d’examens.
1.2.2. Salle d’attente
C’est là où les patients viennent s’asseoir après avoir payé en attendant le
tour de leur examen. Elle est située derrière la salle d’échographie et à côté de la
salle d’informatique et s’ouvre à l’extérieur par la troisième porte dans le couloir à
gauche de la réception. Elle comprend :
- des bancs pour les patients ;
- une petite table sur lequel est déposé un pot de fleur.
1.2.3. Service de radiographie
1.2.3.1. Salle d’examens C1116
C’est l’une des salles de radiographie, située à droite de la chambre noire.
Son ouverture dans la chambre claire fait face au séchoir électrique. On y retrouve :
- un panneau lumineux de signalisation des rayons X se trouvant à son entrée ;
- un appareil de radiographie de marque CGR muni d’une table horizontale
flottante de marque TRENDIX ;
- un pupitre de commande de marque UNIMAX 300 ;
- un Potter mural ;
- un porte-instruments muni d’un projecteur (source de lumière orientable pour
l’HSG) ;
- une armoire contenant du matériel nécessaire à la réalisation des examens
spéciaux ;
- des accessoires de travail comme (un cône localisateur, des gants et des
tabliers plombés) ;
- une passe-cassette ;
- un mannequin ‘’ Kokou ’’ pour les travaux pratiques ;
7
- un évier ;
- des tabliers plombés.
1.2.3.2. Salle d’examen C1120
C’est la deuxième salle de radiographie située en face de la précédente et
dont la porte fait directement face à l’entrée principale de la chambre claire. C’est la
salle la plus spacieuse. Elle dispose de :
- un panneau lumineux de signalisation des rayons X à son entrée ;
- un appareil de marque CGR muni d’une table motorisée de marque TRENDIX
pouvant passer de la position horizontale à la position verticale ;
- un pupitre de commande de marque UNIMAX 300 ;
- un Potter mural ;
- une passe-cassette ;
- un évier pour le nettoyage des instruments de travail ;
- une armoire ;
- plusieurs accessoires de travail (des sacs de sable ; des gants plombés ; un
cône localisateur) ;
- de deux crânes ‘’OSCAR’’ pour les travaux pratiques.
L’accès facile aux toilettes dans cette salle fait qu’elle se prête de préférence à
l’exploration du tube digestif et de l’arbre urinaire.
1.2.4. Salle de mammographie
Elle comporte essentiellement :
- un appareil de mammographie de marque PHILIPS muni d’un paravent
plombé, d’un cône localisateur et d’un compresseur ;
- un Sénographe 700TGENERAL ELECTRIQUE muni également d’un paravent
plombé, d’un cône localisateur et d’un compresseur.
8
1.2.5. Laboratoire de traitement des images
1.2.5.1. Chambre noire
C’est la salle où se fait le développement manuel et automatique des films.
Elle est éclairée par la lumière blanche et par deux lampes inactiniques au besoin.
Ici, nous pouvons identifier :
- une développeuse automatique de marque 3M XP505TM en usage ;
- un ensemble de cuves pour le développement manuel ;
- un appareil d’impression des noms ;
- deux armoires contenant des films vierges ;
- des cadres de différents formats servant au développement manuel;
- des cassettes de tout format ;
- un évier.
1.2.5.2. Chambre claire
Elle contient essentiellement :
- un séchoir électrique ;
- un négatoscope mural de marque HEALTHLINE ;
- une développeuse automatique de marque Kodak RP X-omaT Processor ;
- une table et des chaises.
C’est ici que se font l’évaluation des clichés et l’enregistrement des résultats
après interprétation.
1.2.6. Service d’échographie
Il comprend essentiellement :
- deux échographes (l’une de marque MINDRAY Digiprince DP-8800 Plus et
l’autre de marque SonoScape) ;
- deux imprimantes de marque Sony ;
- deux lits servant de table d’examen ;
- un négatoscope ;
- un évier ;
- une toilette ;
9
- une table et des chaises ;
- deux moniteurs fixés stratégiquement sur une armoire pour permettre au
patient de suivre l’examen.
Ce centre dispose également de plusieurs matériaux médico-techniques. En
plus de ceux que nous avions précédemment cités dans les salles d’examens, nous
avons :
- le matériel COLCHER SUSSMAN en C1116 ;
- le matériel MAXCO en C1116 ;
- une lampe baladeuse associée à un chariot en C1116 ;
- une serre tête en C1116.
1.3. PERSONNEL DU CAR
Le personnel du CAR se présente comme suit :
- Dr Bertin GBAGUIDI, responsable du CAR ;
- deux échographistes ;
- trois ingénieurs des Travaux en Imagerie Médicale ;
- un comptable ;
- une secrétaire ;
- une agente d’entretien ;
- un conducteur du véhicule du CAR.
Mentionnons que les enseignants du département apportent leur expertise et
les médecins radiologues externes sont chargés de l’interprétation.
Il faut souligner que le centre dispose, en plus de tous les équipements
précités, d’un poupinel pour la stérilisation des instruments situé à côté du
secrétariat.
11
2.1. OBJECTIFS ET ACTIVITÉS DU STAGE
A la fin de la 3ème année de formation en Imagerie Médicale, tout étudiant est
tenu de faire un stage pratique afin de rédiger un rapport qu’il soutient pour
l’obtention du diplôme de Licence Professionnelle.
2.1.1. Objectifs du stage
2.1.1.1. Objectif général
L’objectif général du stage pratique est de rendre l’étudiant apte à remplir la
fonction et le travail exigé du technicien supérieur en Imagerie Médicale par la
révision pratique des cours reçus.
2.1.1.2. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de ce stage sont les suivants :
- Organisation et gestion de la réception/ secrétariat du service ;
- Apprendre aux stagiaire à bien accueillir et à bien s’occuper des patients ;
- Inculquer aux stagiaires la bonne gestion du matériel technique lourd et léger ;
- Apprendre aux stagiaires la bonne tenue et gestion du laboratoire ;
- Amener à mieux pratiquer les techniques d’enregistrement de l’image
radiologique ;
- Familiariser le stagiaire à la classification et à la sélection des clichés ;
- Rendre l’étudiant capable de produire des radiogrammes de routine et
d’acquérir une bonne dextérité dans la conduite des différents techniques
d’examens spéciaux ou non ;
- Appliquer les lois de la radioprotection pour soi-même, le personnel et le
public en connaissance de cause de la radiobiologie ;
- Amener à assimiler et à effectuer autant que faire se peut la pratique de
clinique de film après chaque examen ;
- Apprendre les notions élémentaires de l’interprétation radiologique sur la base
de ses connaissances en anatomopathologie, en sémiologie et en pathologie
radiologique décelable.
Dans le but d'atteindre ces objectifs, nous avons effectué notre stage de au
service de radiologie du CAR. Au cours de ce stage, nous avons eu l’opportunité de
12
découvrir un métier sous toutes ses formes et de comprendre de manière globale les
difficultés que les techniciens pourraient rencontrer dans l'exercice de leur fonction.
Pour mieux présenter le déroulement de cette expérience, voici décrits ci-
dessous les activités effectuées et les apports de ce stage.
2.1.2. Activités effectuées
Notre stage au CAR a été marqué par une participation active au
fonctionnement des différentes entités qui composent ce service. Observation et
participation ont meublé les quatre (04) premières semaines. L’exécution des
examens proprement dite a commencé à partir de la cinquième semaine.
Pendant notre stage, nous n’avons pas eu de tâches spécifiques. Nous avons
parcouru les entités fonctionnelles du service à savoir : les salles d’examens et la
chambre noire. Étant au nombre de neuf (09), nous avons été répartis en trois (03)
groupes de trois personnes dans les salles d’examens qui suivent : la salle C-1120,
la salle C-1116 et la salle de mammographie. L’alternance se faisait par semaine
pour permettre à chaque stagiaire d’avoir la chance d’assister aux différents types
d’examens.
Dans la chambre noire, les opérations réalisées en permanence consistent à :
- décharger et charger les cassettes ;
- imprimer les références des patients sur les clichés ;
- développer avec une développeuse automatique les films ;
- envoyer les clichés au séchoir électrique s’ils n’étaient pas auparavant bien
séchés.
Dans la salle d’examen, malgré les difficultés liées à la maîtrise de
l’appareillage et à l’adaptation des techniques radiographiques décrites en théorie
aux réalités du terrain, nous avons réussi à atteindre nos objectifs. Dans cette entité,
nous avons réalisé la plupart des examens standards et participé à la réalisation des
examens spéciaux à savoir l’Urographie Intra- Veineuse (UIV), l’Hystéro
Salpingographie (HSG) et le Lavement Baryté (LB).
Nous avons essayé de regrouper certains examens de la façon suivante :
13
- examens des membres thoraciques (de l’humérus aux phalanges des doitgs) ;
- examens des membres pelviens (du fémur aux phalanges des orteils) ;
- examens du rachis (du rachis cervical au rachis coccygien) ;
- examens du thorax (pulmonaire, télécoeur, grill costal) ;
- examens du crane (crane, sinus,cavum).
Le tableau suivant récapitule le nombre d’examen enregistré au cours de
notre stage.
Tableau I: : Récapitulatif des examens effectués au cours de notre stage qui s'est
tenu du 20 juin au 20 septembre 2016
EXAMENS SUIVIS RÉALISÉS TOTAL DU TRINOME
TOTAL AUTRES
TRINOMES
TOTAL DU CENTRE
ASP 1 0 1 3 4
Bassin 7 2 9 20 29
Crane 4 2 6 25 31
Membres pelviens
39 12 51 48 99
Membres thoraciques
12 10 22 24 46
Rachis 20 9 29 62 91
Thorax 21 9 30 46 76
HSG 11 2 13 32 45
LB 3 0 3 11 14
TOGD 0 0 0 6 6
UIV 0 0 0 1 1
Mammographie 23 8 33 54 87
TOTAL 143 54 197 332 529
14
En somme, les trois trinômes ont enregistré 529 examens dont 197 réalisés
par notre trinôme et 54 réalisés seule.
De la lecture de ce tableau, il ressort que les examens les plus courants sont
ceux des membres pelviens (99) pour les examens standards et l’HSG (45) pour les
examens spéciaux.
2.2. APPORTS DU STAGE
Notre stage de fin de formation nous a beaucoup appris. Les apports que
nous avons pu tirer de cette expérience professionnelle peuvent être regroupés
comme suit : compétences acquises et difficultés rencontrées.
2.2.1. Compétences acquises
Le tableau ci-dessus montre que le service de radiologie du CAR est assez
fréquenté et que bon nombre d’examens (standards comme spéciaux) étudiés en
cours théoriques y sont réalisés. Ce qui nous a permis d’approfondir nos
connaissances et d’acquérir une dextérité dans la réalisation des examens standards
et des examens spéciaux tels que l’UIV, l’HSG, l’UCR, le TOGD et le LB.
2.2.2. Difficultés rencontrées
Durant notre séjour au CAR, nous avons été confrontée à un certain nombre
de difficultés qui sont liées :
- À la mauvaise prescription des examens radiographiques ;
- aux problèmes socioculturels (difficultés à comprendre la langue de l’autre)
rendant parfois la communication difficile ;
- à l'absence de mesures pour réduire l'inconfort induit au cours des examens
de l'HSG ;
- au délestage obligeant les patients à attendre jusqu’à ce que l’électricité
revienne ;
- à la défaillance de l’appareil de la salle C-1120, ce qui a ralenti
considérablement la fluidité et la rapidité du travail ;
15
- à la développeuse qui gratte les films ce qui oblige le technicien à reprendre
certains examens.
2.3. CHOIX DU THÈME
Pratiquer l’imagerie médicale expose le technicien de radiologie à des risques.
Au CAR, les doses de rayonnement reçues par le technicien ne sont pas contrôlées.
Afin d’estimer les risques d’exposition aux rayonnements du technicien, nous avons
jugé bon que notre thème porte sur : l’Étude dosimétrique de poste dans le
service de mammographie du CAR.
L’objectif général de notre thème est de contribuer à la radioprotection du
personnel technique du CAR.
Les objectifs spécifiques sont :
- Rapporter les caractéristiques de l’appareil et de la salle de mammographie;
- évaluer la charge de travail pendant la période d’étude ;
- estimer la dose d’ambiance dans la salle d’examen (au niveau de la table
d’examen et au niveau du pupitre de commande) avec des dosimètres OSL.
17
3.1. GÉNÉRALITES
3.1.1. Radiologie
3.1.1.1. Définition
La radiologie est l’ensemble des modalités diagnostiques et thérapeutiques
utilisant les rayons X, ou plus généralement utilisant des rayonnements. En tant que
spécialité médicale, elle concerne les domaines suivants : la radiologie
conventionnelle (radiographie), la mammographie, la tomodensitométrie.[1]
3.1.1.2. Modalités
3.1.1.2.1. Radiologie conventionnelle (radiographie)
Il s’agit des examens radiographiques utilisant la technologie radio la plus
basique. Un tube à rayon x et une plaque radiologique. Le résultat de cet examen est
une radiographie.[1]
3.1.1.2.2. Mammographie
C’est une technique radiographique adaptée à l’imagerie des seins. Du fait de
sa particularité, un équipement spécifique est utilisé. En effet, le sein possède un
faible contraste aux rayons X et les structures recherchées sont parfois de très
petites tailles. Un système de protection est utilisé afin d’améliorer le contraste de
l’image. De plus, le générateur de rayons X utilisé est spécifique, il fonctionne à faible
kilovoltage, avec une charge (mAs) relativement importante et un petit foyer optique.
Cet examen diagnostique est particulièrement utilisé dans le cadre du dépistage du
cancer du sein.[1]
3.1.1.2.3. Tomodensitométrie
C’est une technique d’imagerie médicale qui consiste à mesurer l’absorption
des rayons X par les tissus puis, par traitement informatique, à numériser et enfin
reconstruire des images 2 dimensions ou 3 dimensions des structures anatomiques.
Pour acquérir les données, on emploie la technique d’analyse tomographique ou par
coupes, en soumettant le patient au balayage d’un faisceau de rayon X.[1]
Toutes ces modalités de diagnostic exposent les techniciens ainsi que les
patients à des risques d’irradiation. C’est pourquoi, la radioprotection apporte son
aide pour essayer de limiter autant que possible ces risques.
18
3.1.2. Radioprotection :
3.1.2.1. Définition
La radioprotection est l’ensemble des mesures prises pour assurer la
protection de l’homme et de son environnement contre les effets néfastes des
rayonnements ionisants.[2]
3.1.2.2. Principes
Les principes fondamentaux de la radioprotection sont :
La justification
L’exposition aux rayonnements ionisants doit être justifiée par les avantages
qu’ils procurent [3].
L’optimisation
Toutes les expositions doivent être maintenues à un niveau aussi bas qu’il est
raisonnablement possible.[3]
La limitation
La somme des doses reçues et engagées du fait des différentes pratiques ne
doit pas dépasser les limites de doses fixées.[3]
3.1.2.3. Organisations de radioprotection
Les organismes de radioprotection sont nombreux et multiformes et ont des
domaines d’activité spécifiques respectifs. Parmi ceux-ci on peut citer :
La Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR)
C’est une organisation non gouvernementale internationale qui émet des
recommandations concernant la mesure de l’exposition aux rayonnements ionisants
et les mesures de sécurité à prendre sur les installations sensibles. La quasi-totalité
des réglementations et normes internationales et des réglementations nationales en
radioprotection reposent sur ces recommandations.[4]
Le Centre National de Radioprotection du Maroc
C’est une organisation qui suggère qu’une salle de mammographie ait :
19
Une superficie d’au moins 9 m2 ;
Un paravent en plomb ou en verre ;
Un voyant rouge au-dessus de la porte d’accès qui s’allume à la
mise sous tension.[4]
3.1.3. Dosimétrie
3.1.3.1. Définition
La dosimétrie est la détermination quantitative de la dose absorbée par un
organisme ou un objet, c’est-à-dire l’énergie reçue par unité de masse, à la suite de
l’exposition à des rayonnements ionisants. Ces mesures peuvent être réalisées soit
par dosimétrie passive, soit par dosimétrie opérationnelle.[5]
3.1.3.2. Grandeurs dosimétriques
Les organismes de radioprotection ont défini deux familles de grandeurs
dosimétriques : les grandeurs de protection et les grandeurs opérationnelles.
Grandeurs de protection
Les grandeurs de protection, à savoir la dose équivalente à l’organe et la
dose efficace, sont associées aux doses absorbées dans l’organisme résultant
d’une exposition externe ou interne. Ces grandeurs ne sont pas directement
mesurables, mais c’est à elles que s’appliquent les limites réglementaires, tant pour
les doses reçues annuellement par les travailleurs que pour la délimitation des zones
de travail.[4]
Grandeurs opérationnelles pour l’exposition externe
Les grandeurs opérationnelles sont utilisées pour la surveillance de zone et la
surveillance individuelle vis-à-vis de l’exposition externe aux rayonnements. Elles
sont conçues pour être mesurables au poste de travail et sont des estimateurs des
grandeurs de protection. Elles sont mesurées par des instruments étalonnés
(dosimètres individuels, radiamètres, etc.) et peuvent être comparées aux limites
réglementaires.[4]
Pour la surveillance de zone, la grandeur opérationnelle appropriée est
l’équivalent de dose ambiant H*(d), alors que pour la surveillance individuelle on
20
définit l’équivalent de dose individuel Hp(d), d étant la profondeur dans le corps
(mm) à laquelle la dose absorbée est évaluée.
On utilise en pratique H*(10) et Hp(10) pour respectivement la surveillance de
zone et la surveillance individuelle en tant qu’estimateurs de la dose efficace E, ainsi
que Hp(0,07) et Hp(3) en tant qu’estimateurs des doses équivalentes respectivement
à la peau Hpeau et au cristallin Hcristallin. La dose équivalente à la peau est la
grandeur qu’il convient d’estimer dans le cas des extrémités (mains, avant-bras,
pieds et chevilles).[4]
3.1.3.3. Limites réglementaires
Les limites réglementaires de doses reçues par les travailleurs exposés sont
spécifiées pour les femmes enceintes, les nourrices et les jeunes travailleurs âgés de
16 à 18 ans. Il n’est pas conseillé de délivrer ou de recevoir des doses jusqu’à ces
valeurs. En tout état de cause, maintenir les doses en-deçà de ces limites ne
dispense pas d’appliquer le principe d’optimisation de la radioprotection. Le tableau
suivant nous renseigne sur les limites à ne pas dépasser.[4]
Tableau II: Limites réglementaires pour les travailleurs exposés
Grandeur de protection
Travailleurs de catégorie A (mSv sur 12
mois)
Travailleurs de catégorie B
et jeune travailleur de 16 à 18 ans (mSv sur 12
mois)
Femme enceinte
(grossesse déclarée)
Femme allaitant
Dose efficace 20 6 L’exposition de l’enfant à naitre doit
rester inférieure à
1mSv
Ne doit pas être soumise à un risque d’exposition
interne
Dose équivalente
Mains, avant-bras, pieds,
cheville
500 150
Peau 500 150
Cristallin 150 45
3.1.4. Étude dosimétrique de poste
3.1.4.1. Définition et utilité
L’étude dosimétrique de poste est un élément essentiel pour assurer du
respect des limites réglementaires et du principe d’optimisation de la radioprotection.
21
Elle intervient pour définir la délimitation des zones et la classification des
travailleurs. Les choix faits permettent de statuer sur le suivi individuel par dosimétrie
passive.
Cette étude permet de:
- identifier un danger ;
- estimer un risque afin de mettre en œuvre les actions de prévention
adaptées ;
- apporter des éléments pour la gestion d’incidents éventuels ;
- de définir le programme des contrôles techniques d’ambiance.[4].
Plusieurs organisations ont réalisé des études dosimétriques de poste comme
par exemple : l’Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire (IRSN), le Centre
National de Radioprotection (CNRP).
3.1.4.2. Période d’une étude de poste
Une étude de poste doit être réalisée avant la mise en service de tout
nouveau poste de travail, puis périodiquement, ainsi qu’à l’occasion de toute
évolution notable d’un poste.[4]
3.1.4.3. Déroulement d’une étude de poste
La méthode générale d’une étude de poste se décline en trois phases qui
sont :
- la préparation de l’étude ;
- l’évaluation des doses ;
- l’exploitation des résultats obtenus.
La phase de préparation de l’étude de poste consiste à recueillir des
informations relatives d’une part à l’installation des sources produisant les
rayonnements ionisants et les dispositifs de protection associés et d’autre part aux
tâches effectuées à ce poste par le personnel.
L’évaluation des doses doit être effectuée dans des conditions réalistes du
poste de travail, c’est-à-dire telles qu’elles se présentent lors du fonctionnement
normal de l’installation.
22
Pour l’exploitation des résultats, cette évaluation permet d’identifier les risques
d’exposition aux rayonnements ionisants et sert de base à la classification du
personnel, à la délimitation des zones de travail et au processus d’optimisation de la
radioprotection.[4]
23
3.2. CADRE MATÉRIEL ET MÉTHODES D’ÉTUDE
3.2.1. Cadre de l’étude
Le cadre de notre étude est le CAR plus précisément la salle de
mammographie.
3.2.2. Type de l’étude
Nous avons effectué une étude descriptive transversale.
3.2.3. Période de l’étude
Notre étude a couvert une période de 1 mois s’étendant du 22 août au 22
septembre 2016.
3.2.4. Matériel
Les 30 patientes venues pour la mammographie au cours de notre période
d’étude constituent notre matériel d’étude.
3.2.5. Méthode d’étude
3.2.5.1. Instruments de collecte
Au cours de notre étude, nous avons utilisé :
- quatre détecteurs OSL qui sont des détecteurs passifs ;
- un lecteur de dose (le lecteur microstar) ;
- une règle ;
- un mètre ruban.
3.2.5.2. Collecte des données
La collecte des données a consisté à :
- recueillir les caractéristiques de l’appareil et de la salle de mammographie ;
- placer les deux dosimètres chaque jour : l’un au niveau du pupitre afin
d’apprécier la qualité de la protection du paravent et l’autre au niveau de la
table d’examen pour quantifier la dose reçue par le patient ;
24
- placer les deux dosimètres témoins dans un bureau ;
- noter à chaque examen les facteurs techniques utilisés ;
- quantifier à la fin du mois les doses enregistrées par les dosimètres à l’aide du
lecteur microstar.
3.2.5.3. Traitement et analyse des données
Les données recueillies ont été saisies dans un feuillet MS Excel 2016. Les
tableaux et les graphes ont été réalisés par la même application du logiciel Microsoft
office.
Le calcul de la charge de travail W du mois est fait à l’aide de la formule
suivante[6] : 𝑊 =∑mAs
60
25
3.3. RÉSULTATS
Tableau III: Caractéristiques de l'appareil de mammographie
mAs maximal
mAs minimal
KV maximal KV minimal Distance pupitre-tube
Distance paravent-
tube
600
04 35 22 107,5 cm 67,5 cm
Tableau IV: Caractéristiques de la salle de mammographie
Longueur de la salle
Largeur de la salle
Surface de la salle
Paravent Voyant rouge
7,18 m 2,34 m 16,80 m2
En plomb N’existe pas
0
2
4
6
8
10
12
14
6 7 8 9 10 11
No
mb
re d
'ex
am
en
Nombre d'exposition
Figure 2: Répartition du nombre de mammographie en fonction du nombre
d'exposition
26
Figure 4: Répartition de la densité en fonction du mAs
Charge de travail
W= 409,07 mA.min / mois donc W= 102,27 mA.min / semaine
0
2
4
6
8
10
12
14
[300,800[ [800,1300[ [1300,1800[ [1800,2300[
No
mb
re d
'ex
am
en
Intervalles des mAs
Graisseux Peu dense Très dense
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
[300,800[ [800,1300[ [1300,1800[ [1800,2300[
No
mb
re d
'ex
am
en
s
Intervalles des mAs
Figure 3: Répartition du nombre d'examen en fonction des mAs
27
Tableau V: Doses totales brutes (bruits de fond) en mSv enregistrées par les
dosimètres témoins au cours du mois
Doses
Dosimètres
Individuel HP(10) en mSv
A la peau HP(0,07) en mSv
Au cristallin HP(3) en mSv
Dosimètre № 1 1,50 1,43 1,50
Dosimètre № 2 1,51 1,46 1,51
Moyenne des doses
1,505 1,445 1,505
Tableau VI: Doses totales en mSv enregistrées par les deux dosimètres au cours du
mois
Dose
Compartiment
Individuel HP(10) en mSv
A la peau HP(0,07) en mSv
Au cristallin HP(3) en mSv
Tube
1,71 1,99 1,91
Pupitre 1,55 1,53 1,55
Tableau VII: Doses totales en mSv (doses réelles) obtenues après avoir enlevé la
moyenne des bruits de fond
Dose
Compartiment
Individuel HP(10) en mSv
A la peau HP(0,07) en msv
Au cristallin HP(3) en mSv
Tube
0,205 0,545 0,405
Pupitre 0,045 0,085 0,045
28
3.4. COMMENTAIRE
Notre étude avait pour objectif général de contribuer à la radioprotection du
personnel technique du Centre Autonome de Radiologie. Le tableau III nous montre
que l’appareil de mammographie possède comme mAs maximal 600, mAs mininal
04, KV maximal 35 et KV minimal 22, une distance pupitre-tube de 107,5 cm et une
distance paravent-tube de 67,5 cm.
L’analyse du tableau IV nous permet de dire que la salle de mammographie
du CAR ne possède pas de voyant rouge au-dessus de la porte ce qui ne respecte
pas les normes d’installation.
Il est à remarquer que les examens ayant utilisé un faible nombre d’exposition
ont été plus nombreux que ceux ayant utilisé un nombre d’exposition élevé (figure 2).
Ce qui veut dire qu’au cours du mois qu’a duré notre étude, la plupart des examens
réalisés n’a pas nécessité de reprise de cliché. Le principe d’optimisation de la
radioprotection est donc respecté du moment où toutes les expositions ont été
maintenues à un niveau bas.
Les examens ayant utilisé un faible mAs ont été plus nombreux que ceux
ayant utilisé un mAs élevé (Figure 3). Ce qui veut dire que pendant le mois, la plupart
des examens réalisés n’a pas utilisé de mAs élevé.
Nous avons tenté d’établir un rapport entre la densité du sein et le mAs. Les
seins très denses ont utilisé un fort mAs comparativement aux seins graisseux et peu
denses qui ont utilisé des mAs faibles (Figure 4). On peut donc dire que la valeur du
mAs augmente au fur et à mesure que la densité du sein augmente.
A l’issue de notre étude, il ressort que la charge de travail (W) a été 102,27
mA.min / semaine. La charge de travail étant normalement de 300 mA.min /
semaine, on peut donc dire que la charge de travail dans le service de
mammographie n’a pas dépassé les limites réglementaires.
Les doses enregistrées au niveau du tube ont été nettement supérieures à
celles du pupitre de commande (tableau V, VI et VII). Le paravent plombé protège
donc le technicien contre les rayons X.
30
Notre séjour au Centre Autonome de Radiologie nous a permis, non
seulement d’être plus imprégnée des réalités professionnelles, mais aussi, d’acquérir
une bonne dextérité en matière de réalisation des examens radiographiques. Dans
ce centre, nous avons eu la chance de réaliser beaucoup d’examens parmi lesquels
figurent ceux de la mammographie.
Cependant, il s’est fait remarquer que ce centre n’a pas l’habitude de contrôler
de façon périodique les doses de rayons X reçues par le personnel technique. Nous
avons alors décidé de mener une réflexion sur le thème Étude dosimétrique de
poste dans le service de mammographie du Centre Autonome de Radiologie.
En effet, grâce à cette étude descriptive transversale, nous avons pu rapporter
les caractéristiques de l’appareil et de la salle de mammographie, évaluer la charge
de travail pendant la période d’étude et estimer la dose d’ambiance dans la salle
d’examen avec des dosimètres OSL. Cette étude nous a permis de constater que les
limites réglementaires ne sont pas dépassées dans le service de mammographie du
CAR malgré qu’il ne possède pas de voyant lumineux au-dessus de la porte. Ces
résultats obtenus nécessitent que les autorités du CAR fassent périodiquement une
étude dosimétrique de poste afin de prévenir une surexposition par les rayons X. Ce
n’est qu’après cela que notre objectif général qui était de contribuer à la
radioprotection du personnel technique sera atteint.
Enfin, nous espérons que ce travail aura permis d’une part à connaitre si le
CAR respecte les limites de la réglementation internationale et d’autre part, à
contribuer à de nouvelles dispositions des autorités du CAR pour une radioprotection
du personnel technique.
32
- À l’endroit des autorités du CAR ; de placer un voyant lumineux à l’entrée de
la salle de mammographie ;
- À l’endroit du technicien, de respecter les normes de radioprotection pour ne
pas être surexposé aux rayons x.
33
[1] Montagne E, Heitz F, Buthiau D, Meyer F. Imagerie médicale Tome 1 : Radiologie
conventionnelle standard. 3e ed. Paris: Heures de France; 2009.
[2] IRCP. IRCP Publication 103 : Recommendation of the IRCP Londres: IRCP, 2007.
[3] Dossou J. Notions de Radiobiologie et de Radioproctection (Power point). Abomey-
Calavi: UAC 2016.
[4] Donadille L, Rehel JL, Deligne JM, Queinnec F, Aubert B, Bottollier-Depois JF, et al.
Réalisation des études dosimétriques de poste de travail présentant un risque d’exposition aux
rayonnements ionisants 2010 [Consulté le 30 septembre 2016]. Disponible à :
www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/radioprotection-homme/Pages/Guide-pratique-
realisation-etudes-dosimetriques-poste-de-travail-version2.aspx#.WEqaFzPjJkc.
[5] Attix FH. Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry. New York:
John Wiley & Sons; 1986.
[6] Charlet J-P. Installations en milieu médical, exigences de radioprotection : cas de la
radiologie conventionnelle 2011 [Consulté le 30 septembre 2016].Disponible à :
www.docslide.fr/documents/installations-en–milieu-medical-exigences-deradioprotection-
nfc-15-160-scanner-mars-2011-jean-paul-charlet-ge-healthcare.html.
RÉFÉRENCES
34
Numéro des examens
Nombre d’expositions
mAs KV
No1 07 668 238
No2 08 684 274
No3 08 620 280
No4 08 721 280
No5 07 1140 245
No6 11 1410 385
No7 06 890 210
No8 07 610 245
No9 07 910 245
No10 08 650 263
No11 08 537 255
No12 09 860 288
No13 06 530 192
No14 07 955 232
No15 07 488 236
No16 06 360 200
No17 09 1515 288
No18 06 972 194
No19 10 948 320
No20 06 668 196
No21 07 860 245
No22 09 1926 315
No23 10 2066 350
No24 06 486 194
No25 06 674 198
No26 06 572 198
No27 06 320 192
No28 06 480 182
No29 06 520 192
No30 06 504 188
Total 219 24544 7320
ANNEXE
35
Calcul de la charge de travail W : 𝑊 =∑mAs
60
La somme des mAs pendant le mois étant de 24544, alors : 𝑊 =24544
60
W= 409,07 mA.min / mois
409,07
4= 102,27 mA.min / semaine
Doses :
Pour convertir m rem en mSv, on a la relation : 1 mSv = 100m rem
36
LISTE DES ENSEIGNANTS AYANT INTERVENU EN IMAGERIE MEDICALE AU COURS
DE NOTRE FORMATION ................................................................................................................... II
1. Enseignants permanents ..................................................................................................... II
2. Enseignants vacataires ........................................................................................................ III
DÉDICACE ........................................................................................................................................... IV
REMERCIEMENTS ............................................................................................................................. VI
HOMMAGES ...................................................................................................................................... VIII
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS ....................................................................................... X
LISTE DES TABLEAUX .................................................................................................................... XI
LISTE DES FIGURES ....................................................................................................................... XII
RÉSUMÉ ............................................................................................................................................. XIII
ABSTRACT ........................................................................................................................................ XIV
SOMMAIRE ......................................................................................................................................... XV
INTRODUCTION .................................................................................................................................. 1
Première partie : ................................................................................................................................. 3
PRÉSENTATION DU LIEU DE STAGE ........................................................................................... 3
1.1. SITUATION ET HISTORIQUE DU CAR ........................................................................... 4
1.2. DESCRIPTION DES LOCAUX DU CAR .......................................................................... 4
1.2.2. Salle d’attente .............................................................................................................. 6
1.2.3. Service de radiographie ............................................................................................ 6
1.2.4. Salle de mammographie ................................................................................................ 7
1.2.5. Laboratoire de traitement des images ....................................................................... 8
1.2.6. Service d’échographie .............................................................................................. 8
1.3. PERSONNEL DU CAR ........................................................................................................ 9
Deuxième partie : .............................................................................................................................. 10
DÉROULEMENT DU STAGE .......................................................................................................... 10
2.1. OBJECTIFS ET ACTIVITÉS ............................................................................................. 11
2.1.1. Objectifs du stage .................................................................................................... 11
2.1.2. Activités effectuées.................................................................................................. 12
2.2. APPORTS DU STAGE ...................................................................................................... 14
2.2.1. Compétences acquises ........................................................................................... 14
2.2.2. Difficultés rencontrées ............................................................................................ 14
TABLE DES MATIÈRES
37
2.3. CHOIX DU THÈME ............................................................................................................ 15
Troisième partie : .............................................................................................................................. 16
ÉTUDE DU THÈME ........................................................................................................................... 16
3.1. GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................... 17
3.1.1. Radiologie ................................................................................................................... 17
3.1.2. Radioprotection ........................................................................................................ 18
3.1.3. Dosimétrie .................................................................................................................. 19
3.1.4. Étude dosimétrique de poste ................................................................................ 20
3.2. CADRE MATÉRIEL ET MÉTHODES D’ÉTUDE ............................................................ 23
3.2.1. Cadre de l’étude ............................................................................................................. 23
3.2.2. Type de l’étude .......................................................................................................... 23
3.2.3. Période de l’étude ..................................................................................................... 23
3.2.4. Matériel ........................................................................................................................ 23
3.2.5. Méthode d’étude ....................................................................................................... 23
3.3. RÉSULTATS ....................................................................................................................... 25
....................................................................................................................................................... 25
3.4. COMMENTAIRE ................................................................................................................. 28
CONCLUSION .................................................................................................................................... 29
SUGGESTIONS .................................................................................................................................. 29
RÉFÉRENCES .................................................................................................................................... 29
ANNEXE .............................................................................................................................................. 29
TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................................... 29