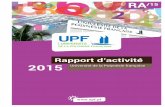RAPPORT D'ACTIVITE - l'ENSAPLV - Architecture
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of RAPPORT D'ACTIVITE - l'ENSAPLV - Architecture
3
L’ENSAPLV en bref
L’ENSAPLV en quelques chiffres (2008 – 2009) - 2263 étudiant(e)s inscrit(e)s dont : - 48 étudiant(e)s en double cursus architecte-ingénieur (BAI) - 47 étudiant(e)s en double cursus ingénieur- architecte (BIA) - 106 étudiant(e)s inscrits en architecture en mobilité sortante - 177 étudiant(e)s étrangers en mobilité entrante - 31 professionnels inscrits en formation continue - 5 laboratoires et équipes de recherche - 231 enseignant(e)s dont 105 titulaires et\ou associé(e)s - 70 agents administratifs, techniques, ouvriers et de service
Les formations de L’ENSAPLV - Formation conduisant au Diplôme d’études en architecture conférant le grade de Licence ; - Formation conduisant au Diplôme d’Etat d’architecte conférant le grade de Master ; - Double-cursus architecte – ingénieur en coopération avec l’ESTP ; - Doctorat en architecture au sein des écoles doctorales «Ville et Environnement» et «Pratiques et Théories du sens» ;
- Habilitation à l’exercice de la maîtrise d’oeuvre en son nom propre (HMONP) ; - Diplômes propres aux écoles d’architecture (DPEA) : DPEA Architecture navale, DPEA Métropoles de l’Arc Pacifique et DPEA Architecture et Philosophie ; - Diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture (DSA) : option projet urbain et option paysages ; - Master professionnel - Formation professionnelle continue.
Les diplômés de L’ENSAPLV En 2007-2008, dans le cadre de la réforme des études d’architecture, l’ENSAPLV a délivré : - 204 diplômes d’études en architecture (conférant le grade de Licence) - 308 diplômés d’Etat d’architecte - 125 habilitations à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre - 25 diplômes de spécialisation et d’approfondissement en architecture - 11 diplômes de master professionnel - 30 diplômes pour les formations DPEA
Par ailleurs, l’ENSAPLV est en train de constituer progressivement un annuaire qui compte près de 8500 architectes diplômés de l’établissement.
Les coordonnées de l’ENSAPLV Ouverte de 8 heures à 22 heures, secrétariat : de 9h30 - 12h30 / 14h30 - 17 h 00 sauf lundi après-midi, mercredi toute la journée et vendredi matin, 144 avenue de Flandre – 75019 PARIS - annexes : 11, rue de Cambrai, 75019 PARIS et 118 rue Jean Jaurès, 75019 PARIS – Téléphone : (accueil) : +33 (0)1 44 65 23 00 – télécopie : +33 (0)1 44 65 23 01 - métro : Corentin Cariou ou Crimée (ligne 7 direction La Courneuve), bus : 54 et 60 - arrêt Crimée, voiture : périphérique sortie Porte de la Villette.
4
Sommaire 2 L’ENSAPLV en bref 5 Introduction 8 1- Le projet d’établissement de l’ENSAPLV
10 2- Les effectifs étudiants a. Les effectifs étudiants globaux
b. La structure des effectifs étudiants c. Les effectifs étudiants par formation
18 3- Les formations de l’ENSAPLV a. Le premier cycle (Licence)- initiation à l’architecture
b. Le second cycle (Master) – approfondissement et autonomie c. Le double cursus architecte - ingénieur d. Le doctorat en architecture e. la HMONP f. Le DSA Architecture et Projet urbain g. Les diplômes propres aux écoles d’architecture - DPEA h. La formation continue i. Le master professionnel : organisation du travail et ergonomie j. Les voyages pédagogiques k. Les concours
25 L’Observatoire des métiers a. Les missions - b. Les objectifs - c. Les enquêtes réalisées
26 4- La recherche 46 5- Les relations internationales a. La Commission des Relations Internationales (CRI) b. La mobilité à l’étranger c. Les activités pédagogiques soutenue par la Commission européenne d. Les programmes internationaux e. Les workshops internationaux
68 6- Le corps enseignant a. Les enseignants titulaires et associés b. Les enseignants contractuels et vacataires c. La répartition statutaire des enseignants d. La répartition du corps enseignant par sexe e. La répartition du corps enseignant par champs disciplinaires f. La répartition du corps enseignant par âge g. Les flux
72 7- L’organisation de l’école a. L’administration de l’école b. Le Conseil d’Administration c. L’organigramme de l’ENSAPLV d. Les comités de l’ENSAPLV e. Les commissions de l’ENSAPLV
80 8- Les locaux 81 9- La gestion financière 89 10- Les services pédagogiques a. La bibliothèque
b. Le centre de documentation c. La vidéothèque - diathèque d. L’atelier photo e. L’atelier vidéo f. L’atelier maquette g. La reprographie h. L’informatique i. Le libre service informatique
97 11- La communication a. Les supports de communication
b. La journée Portes Ouvertes c. Les actions de communication externe d. Les expositions e. Les conférences
102 12- Les Editions de la Villette 103 13- Les associations
5
Introduction Ce rapport d’activité présente l’évolution des missions et des activités de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris la Villette (ENSAPLV) sur l’année civile 2008. Etablissement public à caractère administratif sous la tutelle du Ministère de la culture et de la communication, Direction de l’architecture et du patrimoine, l’ENSAPLV a traversé de nombreux changements en 2008, dans le respect toutefois de ses valeurs d’ouverture au monde et à l’international, de pluralité disciplinaire et de diversité des cursus. Ses effectifs étudiants ont connu en 2008 une baisse sensible due à l’achèvement du cursus DPLG, clos le 31 décembre 2007. Plus de 800 diplômes d’architecte DPLG ont ainsi été délivrés avant cette date. L’effectif s’est ainsi stabilisé en 2008 à environ 2200 étudiant(e)s inscrit(e)s toutes formations confondues, un effectif comparable à ce qu’il était il y a six ans. L’ENSAPLV reste toutefois la plus importante, par le nombre de ses étudiants, des écoles d’architecture habilitées en France. Le projet pédagogique et scientifique de l’école, habilité en 2006 pour deux ans et déjà réactualisé en 2007, a été profondément remanié, à la lumière des deux premières années de mise en place du cursus LMD. A la suite d’une centaine de réunions de la CPR et de diverses commissions et de groupes de travail, un nouveau programme a été présenté en juin 2008 à l’habilitation. Suite à l’avis favorable de la CCST, il a été habilité pour quatre ans pour le premier cycle «Licence», le second cycle «Master», le double-cursus architecte-ingénieur, l’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) et le diplôme propre aux écoles d’architecture (DPEA) «architecture et philosophie». Le diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture (DSA) sur le thème du «projet urbain, paysage et développement» et le diplôme propre aux écoles d’architecture (DPEA) concernant l’architecture navale et les métropoles d’Asie Pacifique ont été également habilités pour quatre ans en juin 2009. Enfin, le cycle de formation continue diplômante sur le thème de l’ingénierie du développement durable a été poursuivie. La totalité de l’offre pédagogique de l’école, soit environ 550 enseignements ou groupes, est désormais présentée en livrets par formation. L’ENSAPLV peut ainsi continuer à assurer avec une excellente visibilité l’ensemble des missions dévolues aux écoles nationales supérieures d’architecture, de la formation initiale à l’échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, afin de mieux répondre à sa mission qui est de former des architectes dotés d’une compétence affirmée dans le domaine de la conception, capables d’exercer des missions diversifiées dans le champ de l’architecture et du bâti, conscients des responsabilités éthiques et sociales qu’ils doivent assumer. La mise en œuvre des nouveaux cursus «Licence» et «Master» a été effective dès la rentrée 2008-2009. Deux sessions de PFE ont été organisées en juillet et en septembre 2008, pour un total de 308 architectes diplômés d’Etat. Par ailleurs, la mise en place d’un cursus d’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) à l’automne 2007 s’est traduite par une première session de jury en juin 2008, sanctionné par la délivrance de 125 habilitations. La possibilité de passer à l’ENSAPLV un Doctorat en architecture a été étendue avec la signature d’une seconde convention d’association à une école doctorale, «Pratiques et théories du sens». Le nombre de doctorants en architecture inscrits à l’ENSAPLV est ainsi passé de 7 à 17. Le Doctorat en architecture peut désormais s’appuyer sur cinq équipes ou laboratoires de recherche, avec l’intégration effective du laboratoire Gerphau au sein de l’école. Les effectifs de l’ENSAPLV ont connu de nombreux changements avec le départ en retraite de neuf enseignant(e)s et la mutation de deux enseignant(e)s. Le personnel administratif a également vu le départ de cinq agents.
6
Enfin, l’école a dû faire face à des difficultés financières sans précédents. Plusieurs facteurs se sont conjugués pour tendre à l’extrême les comptes de l’école : une diminution sensible de ses ressources essentiellement due à la baisse des effectifs, dans le contexte d’une subvention de fonctionnement exactement maintenue à niveau, intégrant toutefois le complément destiné à la location de Cambrai, et malqré une augmentation de 168% du produit de la taxe d’apprentissage et de l’apport de nouveaux contrats de recherche ; une augmentation des dépenses et ce malgré une attention particulière à toutes les charges inhérentes à l’ENSAPLV. Ces difficultés n’ont pu être résolues qu’en diminuant le fonds de roulement à 32 jours, un minimum historique, et l’affectation d’une grande partie de la subvention d’investissement au fonctionnement. Par ailleurs, un certain nombre de changements ont porté sur l’organisation de l’équipe administrative, l’affectation des locaux et la relance des travaux d’aménagement intérieur, la communication, les relations internationales, la gestion financière, la recherche et l’analyse détaillée des ressources pédagogiques de l’école. L’ENSAPLV ainsi mis en œuvre en 2008 un nombre significatif d’évolutions, tout en restant fidèle à ses valeurs, en développant son projet d’école et en mettant en place un cadre pédagogique et administratif rénové. Enfin, un plan de gestion des archives de l’école a été défini en étroite collaboration avec la mission des Archives du Ministère de la culture et de la communication, à l’heure ou l’école s’apprête à fêter son 40ème anniversaire. Bertrand LEMOINE Directeur de l’ENSAPLV
7
1. Le projet d’établissement de l’ENSAPLV L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette (ENSAPLV) articule son projet d’école autour de cinq grands principes fondateurs, dont l’application et la déclinaison ont certes varié au cours de son histoire, au fil des réformes et des contextes pédagogiques, mais qui sont toujours restés d’actualité depuis sa création, il y a quarante ans. Ces principes sont aujourd’hui mis en œuvre dans le contexte du système pédagogique européen (LMD) adopté par l’ensemble des écoles d’architecture en France. Une tradition critique et pluridisciplinaire
L'ENSAPLV est l'héritière de l'Unité Pédagogique d'Architecture n° 6 fondée en 1969. A ce titre, elle est porteuse d'une tradition critique qui récuse une conception de l'architecture close sur elle-même, productrice narcissique de “ beaux ” objets solipsistes. L'architecture est, en paraphrasant Marcel Mauss, un phénomène socio-culturel total et sa raison d'être, comme établissement d'enseignement supérieur, est de préparer les étudiants à en comprendre et à en maîtriser tous les aspects. Aussi l’ENSAPLV est-elle à la fois un lieu universitaire de production et de diffusion des connaissances, un lieu de formation professionnelle et un lieu de préparation des futurs acteurs à leurs responsabilités sociales. En particulier, dès son origine, elle a fait le choix de ne pas ancrer son enseignement dans les pratiques professionnelles alors dominantes en France, mais a développé des approches nouvelles, notamment en articulant la reconstruction critique de l’enseignement de l'architecture à la création plastique, à la philosophie, aux sciences humaines et sociales ainsi qu’aux sciences et aux technologies. L'ENSAPLV assume sa position d’établissement d'enseignement supérieur de l'architecture au sens entier du terme, en embrassant les trois échelles de l'édifice, de la ville et du territoire, y compris le paysage. Sur cette base, l'ENSAPLV a élaboré un certain nombre de champs de savoirs qui fondent ses compétences et son identité. Elle assure des formations diversifiées correspondant à l'élargissement des formes d'intervention professionnelle des architectes (dont le nombre, selon nous, doit augmenter en France) et de développer la formation à et par la recherche. Ainsi le projet pédagogique de l’ENSAPLV se distingue-t-il par la pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité des
enseignements dispensés, tout en gardant l’enseignement du projet architectural et urbain au centre de la formation. Une grande Ecole d’enseignement supérieur L'ENSAPLV est aujourd’hui la plus importante école nationale supérieure d'architecture en France, par le nombre de ses enseignants comme par celui de ses étudiants. Ceci lui permet de proposer une grande diversité d'enseignements et de pratiques, ouvrant ainsi largement les points de vue sur une discipline qui se situe au carrefour de multiples savoirs, ainsi que sur les enjeux éthiques et esthétiques dont elle est porteuse. Cette ouverture lui a permis de développer des activités d'enseignement et de recherche en collaboration avec d'autres institutions françaises et étrangères dans le cadre de formations propres à l’Ecole ou en partenariat avec des universités françaises ou étrangères. Elle lui vaut aussi d'être un lieu d'accueil et de formation pour des étudiants venus de nombreux pays étrangers, ceci tant au sein de son cursus propre (premiers entrants, transferts après validation d’acquis, souvent pour des architectes ou des ingénieurs ayant déjà obtenu un diplôme dans leur pays d’origine) que dans le cadre des échanges Socrates-Erasmus ou de conventions particulières passées avec de multiples autres écoles d'architecture. La dimension de l’ENSAPLV, la diversité et la qualification professionnelle et universitaire de son corps enseignant lui ont ainsi permis de développer une importante production intellectuelle, tant au sein des équipes de recherche que par les travaux personnels des enseignants, relayée par la politique éditoriale des Éditions de la Villette, fondées au sein de l'ENSAPLV dans un esprit d’ouverture aux enseignants des autres écoles d’architecture. Ces caractères confèrent à l’ENSAPLV un rayonnement qui incite de nombreux étudiants en architecture, issus de France ou de l’étranger, à venir y terminer ou y compléter leur cursus. En effet, cette masse critique offre aux étudiants la possibilité de construire un parcours personnalisé, en particulier en second cycle.
8
Une ouverture sur les réalités du monde C'est donc en s'appuyant sur cette tradition d'ouverture culturelle, de liberté intellectuelle, de critique sociale, de diversité et de tolérance, alliée à de hautes exigences de qualification des formations que l'ENSAPLV développe son programme de formation, lui-même destiné à répondre efficacement aux enjeux qui naissent de l'évolution de la société contemporaine et des perspectives ambitieuses posées par la construction européenne et la mondialisation. Une formation à l’architecture
L'ENSAPLV entend former ses étudiant(e)s à la maîtrise de toutes les composantes de la pensée de l'architecture, en intelligence avec toutes les dimensions d'un lieu, en vue de la transformation de celui-ci. Recréer du sens et des liens, donc du commun, dans l'espace de la cité, par la mise en œuvre de toutes les ressources du projet architectural, urbain et paysagiste, appelle de la part de tous ceux qui en auront la charge la pleine possession de la culture du projet, entendu dans toutes ses diversités et toutes ses composantes. C'est dans cette perspective que la formation à la démarche de projet situé et fondé dans l’espace et dans le temps est au cœur des objectifs de l'ENSAPLV. Cette démarche, qui concerne et associe tous les types d’enseignements dispensés dans l’Ecole, ainsi que la recherche – et non le seul enseignement du projet au sens étroit du terme – implique que le projet d’Ecole de l’ENSAPLV soit structuré autour d’une idée forte parcourant son cursus (ou plutôt ses cursus) dans la mesure où chaque étudiant, tout en suivant une progression raisonnée au sein d’un cadre collectif, construit lui-même le sien grâce à la variété de l’offre pédagogique : celle de conduire à des diplômes – Diplôme d’études en architecture conférant le grade de Licence et Diplôme d’Etat d’architecte conférant le grade de Master – “généralistes” ou mieux : polyvalents. L’ENSAPLV offre ainsi un parcours équilibré entre parcours encadré et autonomie, entre enseignements obligatoires, enseignements dispensés dans le cadre d’un choix possible entre différentes offres et enseignements optionnels. Par ailleurs, le «diplôme d’Etat d’architecte» peut conduire, toujours dans le cadre universitaire de l’ENSAPLV, d’une part à l’ «habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre» (HMONP), d’autre part à des diplômes de spécialisation et
d’approfondissement (DSA), à des diplômes propres aux écoles d’architecture (DPEA) et au Doctorat en architecture délivré par l’ENSAPLV dans le cadre des Ecoles doctorales «Ville et environnement» et «Pratiques et théories du sens». Une dimension internationale L’ENSAPLV a l’ambition de s’imposer pleinement sur la scène non pas simplement régionale, nationale ou même européenne, mais internationale, de l’enseignement de l’architecture. Elle se situe dans l’ensemble des quelque mille écoles d’architecture existant de par le monde comme une école résolument internationale, ouverte sur l’ensemble des continents. D'ores et déjà, l’ENSAPLV dispose de nombreux atouts résultant de la politique d'ouverture qu'elle a suivie depuis toujours : un réseau de partenariats, de conventions, d'échanges (d'étudiants et d'enseignants), de workshops partagés, de Masters et/ou de post-Masters internationaux, d'une annexe de Georgia-Tech (Atlanta – USA) dans ses murs, ainsi que de programmes de type Alfa Europe/Amérique latine, Asia-Link en Inde et Chine, Europe/Japon, Europe/Etats-Unis, dépassant de beaucoup les échanges européens classiques de type Erasmus-Socrates ; un corps enseignant et une population étudiante cosmopolites. Tous ces éléments contribuent au rayonnement de la culture française dans notre domaine de compétence (notons au passage qu’un nombre non négligeable de nos anciens étudiants européens, coréens, chinois, latino-américains, africains, sont devenus enseignants dans leurs pays), à l'ouverture de nos enseignements, à l’ouverture de nos étudiants vers des cultures et des sociétés différentes, et enfin à l'élargissement des débouchés professionnels pour nos diplômés et des marchés pour les entreprises françaises et européennes.
9
2. Les effectifs étudiants a. Les effectifs étudiants globaux L’ENSAPLV reste l’école nationale supérieure d’architecture française qui compte les effectifs les plus importants. Elle a connu ces dernières années jusqu’en 2007 une hausse sensible de ses effectifs. Cette augmentation n’a pas eu lieu uniformément pour toutes les années. En 2006-2007, l’école a rencontré une baisse de 16,8% de ses nouveaux entrants de première année de premier cycle (183) par rapport à l’année 2005-2006 (220). Ses effectifs globaux ont très sensiblement décru en 2008 par rapport à 2007, de 2900 à 2263 étudiant(e)s inscrit(e)s toutes formations confondues, un chiffre comparable à l’année 2002. Cette diminution est liée à la fin du cursus du DPLG au 31 décembre 2007. L’évolution des effectifs étudiants de 2002-2003 à 2008-2009
Année universitaire Effectif étudiant 2002-2003 2212 2003-2004 2686 2004-2005 2793 2005-2006 2937 2006-2007 3068 2007-2008 2900 2008-2009 2263
0500
100015002000250030003500
2002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009
Nb : Ces chiffres représentent l’ensemble des étudiant(e)s inscrit(e)s à l’école. En fonction des années, ils comprennent le premier, le second et le troisième cycle, les formations post-diplômes (HMONP, DSA, DPEA et Doctorat en architecture, la mobilité entrante et sortante, les étudiant(e)s de Georgia Tech et la formation continue).
Les différentes situations des étudiants lors des inscriptions administratives - Primo-inscriptions Les primo-inscriptions sont les étudiant(e)s inscrit(e)s pour la première fois à l’école. En première année de premier cycle, il s’agit souvent de bachelier(e)s de l’année en cours ou de bacheliers ayant déjà obtenu leur baccalauréat qui souhaitent effectuer des études d’architecture. - Primo-inscriptions avec équivalence Les primo-inscriptions avec équivalence concernent des étudiant(e)s français ou étrangers qui au vu de leurs parcours et expériences professionnelles passent par la Commission de validation des acquis et des expériences professionnelles afin d’être repositionner dans les cursus. - Double-cursus architecte ingénieur L’école en partenariat avec l’Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie (ESTP) propose aux étudiant(e)s de première année de premier cycle une double formation d’architecte et d’ingénieur. - BAI Il s’agit d’étudiant(e)s inscrit(e)s à l’ENSAPLV qui suivent en parallèle de leur formation initiale une formation scientifique complémentaire, réparties sur les cinq ans, à l’ESTP. - BIA Il s’agit d’étudiant(e)s inscrit(e)s à l’ESTP qui suivent en parallèle de leur formation des enseignements de l’ENSAPLV. - Réinscrit(e)s Il s’agit d’étudiant(e)s déjà inscrit(e)s l’an passé à l’école. - Les revenants Il s’agit d’étudiant(e)s ayant effectué une ou plusieurs années d’études à l’école et qui après une interruption reviennent par la Commission de validation des acquis et expériences professionnelles. - Les transferts Les transferts sont des étudiant(e)s ayant commencé leurs études d’architecture dans une autre ENSA et qui intègrent l’école. Les origines scolaires des étudiant(e)s et des diplômes en formation initiale - 2008-2009
10
Niveau bac Série 1er inscrits
2008-2009 Diplômes d’Etat
d’architecte 2007-2008*
L 13 33 ES 23 29 S 126 104 STI 14 21 STL 0 1 STT 1 1 Bac prof. 1 4 BT 5 8 Equivalent 0 2 Diplôme étranger niveau bac
18 21
Validation des acquis
5 1
Diplômes d’études supérieures BTS 10 DUT 1 Licence 1 Maîtrise 4 Diplôme d’ingénieur habilité
6
3ème cycle universitaire
1
Autres (diplômes étrangers)
79 68
TOTAL 308 293 *du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 La répartition des étudiant(e)s selon le sexe et la nationalité - formation initiale et HMONP 1er cycle Français et Etranger Hommes Femmes Année 1 100 133 Année 2 95 165 Année 3 121 136 TOTAL 316 434 2ème cycle Français et Etranger Hommes Femmes Année 1 181 186 Année 2 308 316 TOTAL 489 502 HMONP Français et Etranger Hommes Femmes TOTAL 100 78 TOTAL GENERAL
905 1014
0100200300400500600
1er cycle 2èmecycle
HMONP
HommesFemmes
11
La répartition des étudiant(e)s par profession et catégorie sociale – 1er inscrits – 2008-2009 Profession et CSP 1er inscrits Agriculteurs 0 Artisans, commerçants et chef d’entreprises
20
Cadres et professions intellectuelles supérieures
168
Professions intermédiaires 24 Employés 20 Ouvriers 9 Retraites 13 Inactifs 2 Non renseignées 51 TOTAL 307 Les origines géographiques des étudiant(e)s étranger(e)s de la formation initiale – 2008-2009 Europe 87 20,42% Afrique 187 43,89% Asie 108 25,35% Amérique du Nord
6 1,40%
Amérique centrale
38 8,92%
TOTAL 426 100
050
100150200
Agric
ulteu
rs
Cadr
es et
profe
ssion
s
Emplo
yés
Retra
ites
Non
rens
eigné
es
0
50
100
150
200Europe
Afrique
Asie
Amérique duNordAmériquecentrale
12
Le premier cycle (Licence) Pour l’année 2008-2009, 1860 dossiers de pré-inscriptions en première année ont été remis et examinés. Les nouveaux entrant(e)s en première année de premier cycle sont au nombre de 173 étudiant(e)s, auxquels s’ajoutent 22 étudiant(e)s inscrit(e)s dans le double-cursus ingénieur-architecte (BIA) dans le cadre de la convention avec l’ESTP, 33 redoublant(e)s et 2 revenant(e)s, soit 230 étudiants au total. L’arrivée des nouveaux étudiant(e)s de première année de premier cycle a été marquée par une semaine d’accueil (du 22 au 28 septembre) afin de présenter les différentes facettes de l’offre pédagogique de l’école. A l’ENSAPLV, la sélection des candidat(e)s se fait à partir de l’examen par une Commission du dossier scolaire de l’étudiant(e), sans préférence particulière pour une section littéraire ou une section scientifique et sur l’analyse d’une lettre de motivation de l’étudiant(e) expliquant la volonté de suivre des études d’architecture, en particulier à l’ENSAPLV. La seconde année de premier cycle est composée de la manière suivante : 225 réinscrit(e)s, 17 étudiant(e)s sont arrivé(e)s par équivalence, 16 étudiant(s) en BIA, et 2 revenant(e)s. La troisième année de premier cycle est constituée de 194 réinscrit(e)s, de 38 étudiant(e)s émanant de la validation des acquis, 9 étudiant(e)s en BIA, et 8 étudiant(e)s par transfert. Au total, le premier cycle pour l’année 2008-2009 est composé de 452 réinscrit(e)s, 173 primo-inscriptions, 55 primo-inscriptions avec équivalence, 47 étudiants inscrits en BIA, , 2 revenant(e)s et 10 étudiants transferts, soit un total de 739 étudiants. Le second cycle (Master) Pour l’année 2008-2009, le second cycle est composé au total de 891 réinscrit(e)s, 52 primo-inscriptions avec équivalence, 19 revenant(e)s et 38 transferts, soit au total, 1000 étudiants. En première année de second cycle, 291 réinscrit(e)s, 43 étudiant(e)s sont arrivé(e)s par équivalence, 26 étudiant(e)s par transfert, 1 étudiant(e) est revenu(e) après une interruption de son cursus.
La seconde année de second cycle compte 600 réinscrit(e)s, 9 primo-inscriptions avec équivalence, 12 étudiants par transfert, 18 revenant(e)s. Pour les deux cycles, 18% des étudiant(e)s sont de nouveaux étudiant(e)s. Le positionnement des primo-inscriptions avec équivalence dépend de leur niveau de diplôme, français ou étranger et de l’examen du dossier par la Commission de la validation des acquis et des expériences professionnelles. A la rentrée 2008, l’ENSAPLV a du encadrer 2263 étudiant(e)s dans toutes les formations dispensées dont 1945 étudiant(e)s en formation initiale (106 étudiant(e)s inscrit(e)s en architecture ont effectué une mobilité à l’étranger). Les Erasmus entrants, au nombre de 177 (soit 44 étudiant(e)s de plus que l’an passé) se sont inscrits plus particulièrement en troisième année de premier cycle et en première année de second cycle. En formation initiale, les Erasmus entrants représentent 9% des effectifs étudiants, la mobilité sortante 5% des étudiant(e)s. b. La structure des effectifs étudiants Les effectifs se caractérisent par un fort pourcentage d’étudiant(e)s étranger(e)s, qui peuvent avoir différents statuts au sein de l’école. La plupart suivent la formation initiale et\ou les formations post-diplôme, 177 sont en échange entrant Erasmus, 29 viennent pour un semestre de l’Université de Georgia Tech. Au total, l’école compte 25,42% d’étudiant(e)s étranger(e)s, représentant un grand nombre de nationalités différentes. Les étudiantes En première année de premier cycle, les étudiantes représentent 57,39% des effectifs. Les étudiant(e)s boursier(e)s En 2008, 305 étudiant(e)s ont bénéficié d’une bourse sur critères sociaux. 37 étudiant(e)s ont été exonérés des droits d’inscription et de sécurité sociale. Par ailleurs, en 2008 un nouvel échelon de bourse est apparu. Nombre d’étudiant(e)s par échelon de bourse :
Echelon 2006-2007 2007-2008 2008-2009 0 32 31 37 1 61 71 54 2 39 39 36 3 31 31 31 4 38 24 25 5 146 129 52 6 0 0 70
TOTAL 347 325 305
13
c. Les effectifs étudiants par formation En formation initiale, 1839 étudiant(e)s ont suivi des enseignements au sein de l’école. En fonction de leur cursus, ils ont reçu un nombre variable d’heures encadrées habilitées. 106 étudiants inscrits en formation initiale ont effectué une mobilité sortante. 318 étudiant(e)s se sont inscrit(e)s dans des formations post-diplômantes et l’ENSAPLV a accueilli 31 professionnels en formation continue. Formation Intitulé de l’année Nombre d’inscrits Nombre d’inscrits Nombre d’inscrits FORMATION INITIALE 2006-2007 2007-2008 2008-2009
1 200 293 230 2 322 226 260
Premier cycle (Licence)
3 357 281 249 Total d’inscrits (Licence) 879 800 739
1 341 431 361 Second cycle (Master) 2 568 676 639
Total d’inscrits (Master) 909 1107 1000 Total (Licence + Master) 1788 1907 1739 Mobilité entrante 159 133 177 Georgia Tech 36 23 29 SOUS –TOTAL FORMATION INITIALE
1983 2063 1945
FORMATION POST-DIPLOME 2006-2007 2007-2008 2008-2009 HMONP 136 185 Doctorat en architecture 7 17 DPEA architecture et Philosophie
22 28 20
DPEA Architecture Navale 11 10 18 DPEA Métropoles d’Asie Pacifique
17 18 7
DSA Architecture Projet Urbain
Semestres 1 et 2 44 40
DSA Architecture Projet Urbain
Semestre 3 34 26 31
TOTAL POST-DIPLOME 120 292 318 Etudiants inscrits dans les enseignements
1995 2332 2234
TOTAL DES INSCRITS A L’ENSAPLV 3068 2900 2263
14
Les effectifs étudiants de premier cycle (Licence)
Effectif total du premier cycle Licence
Origine des étudiant(e)s
Nombre d’inscrits
Primo-inscriptions 173 Primo-inscriptions avec équivalence
55
BIA ESTP 47 Réinscrits 452 Revenants 2 Transferts 10 TOTAL 739
1er cycle année 1 Origine des étudiant(e)s
Nbre d’inscrits
Primo-inscriptions 173 BIA ESTP 22 Réinscrits 33 Revenants 2 TOTAL 230
1er cycle année 2
Origine des étudiant(e)s
Nbre d’inscrits
Primo-inscriptions avec équivalence
17
BIA ESTP 16 Réinscrits 225 Revenants 2 TOTAL 260
1er cycle année 3
Origine des étudiant(e)s
Nombre d’inscrits
Primo-inscriptions avec équivalence
38
BIA ESTP 9 Réinscrits 194 Transferts 8 TOTAL 249
Les effectifs du premier cycle
050
100150200250300350400450500 Primo-inscription
Primo-inscriptionavec équivalenceBIA ESTP
Réinscrits
Revenants
Transferts
15
Les effectifs étudiants de second cycle (Master)
Effectif total du second cycle Master
Origine des étudiant(e)s
Nombre d’inscrits
Primo-inscriptions avec équivalence
52
Réinscrits 891 Revenants 19 Transferts 38 TOTAL 1000
2ème cycle année 1 Origine des étudiant(e)s
Nombre d’inscrits
Primo-inscriptions avec équivalence
43
Réinscrits 291 Revenants 1 Transferts 26 TOTAL 361
2ème cycle année 2
Origine des étudiant(e)s
Nombre d’inscrits
Primo-inscriptions avec équivalence
9
Réinscrits 600 Revenants 18 Transferts 12 TOTAL 639
Les effectifs étudiants du Doctorat en architecture En 2008, 24 étudiants encadrés par des enseignant(e)s de l’école sont inscrits en Doctorat en architecture dans le cadre de l’école doctorale « Ville et Environnement ». 17 se sont inscrits à l’ENSAPLV et 7 à l’université de Paris VIII. La répartition est la suivante : 1ère année 6 2ème année 5 3ème année 9 4ème année et plus 4 TOTAL DES DOCTORANT(E)S
24
Les effectifs du second cycle
0100200300400500600700800900
Primo-inscription avecéquivalenceRéinscrits
Revenants
Transferts
Les effectifs étudiants des DPEA
DPEA Architecture
Navale Métropoles
d’Asie Pacifique
Architecture et Philosophie
18 7 20 Total : 45 étudiant(e)s
Les effectifs étudiants du DSA
DSA Semestre 1 et
2 Semestre 3 TOTAL
40 31 71
16
Les transferts entrants en 2008 (d’une ENSA extérieure vers l’ENSAPLV)
L1 VERS L2 L2 VERS L3 L3 VERS M1 M1 VERS M2 TOTAL ENSA
Cand
idatur
e
Entré
e
Cand
idatur
e
Entré
e
Cand
idatur
e
Entré
e
Cand
idatur
e
Entré
e
Cand
idatur
e
Entré
e
BELLEVILLE 1 0 1 0 2 0 4 0 MALAQUAIS 2 2 2 2 MARNE LA VALLEE 1 0 4 3 2 1 7 4 VAL DE SEINE 3 3 3 3 VERSAILLES 1 0 1 0 BORDEAUX 1 0 3 2 2 0 1 1 7 3 BRETAGNE 2 1 2 1 CLERMONT-F. 1 1 8 3 4 0 2 1 15 5 GRENOBLE 1 0 1 1 2 1 LILLE 1 0 2 1 3 1 LYON 2 0 2 0 4 0 MARSEILLE 8 7 8 7 MONTPELLIER 2 1 4 0 6 4 5 3 17 8 NANCY 2 1 2 1 NANTES 1 0 2 2 3 2 NORMANDIE 2 0 1 0 3 1 1 1 7 2 ST-ETIENNE 1 0 1 0 1 0 3 0 STRASBOURG 2 0 8 3 10 3 TOULOUSE 1 0 4 1 2 1 7 2 TOTAL 10 2 27 6 49 24 20 107 45
En 2008, les demandes de transferts entrants représentent 107 étudiant(e)s. 44,85% des demandes ont été satisfaites. 73% des demandes se concentrent sur les 8 écoles suivantes : Marne la Vallée, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Marseille, Montpellier, Normandie, Strasbourg et Toulouse. Les transferts sortants en 2008 (de l’ENSAPLV vers une autre ENSA)
L1 VERS L2 L2 VERS L3 L3 VERS M1 M1 VERS M2 TOTAL ENSA
Cand
idatur
e
Entré
e
Cand
idatur
e
Entré
e
Cand
idatur
e
Entré
e
Cand
idatur
e
Entré
e
Cand
idatur
e
Entré
e
BELLEVILLE 2 0 2 0 MARNE LA VALLEE 1 0 1 0 VAL DE SEINE 1 0 1 1 2 1 BORDEAUX 1 0 1 1 2 1 BRETAGNE 1 0 1 0 LILLE 1 1 1 1 MARSEILLE 1 0 1 0 NANTES 1 0 1 1 2 1 NORMANDIE 1 0 1 0 TOULOUSE 1 1 1 1 TOTAL 2 2 1 6 1 4 3 14 5
En 2008, les demandes de transferts sortants représentent 14 étudiant(e)s soit sept à huit fois moins que les demandes de transferts entrants. 36% des demandes ont été satisfaites.
17
3. Les formations de l’ENSAPLV En 2008, l’ENSAPLV a soumis à l’habilitation et à l’agrément de la CCST l’ensemble de son offre pédagogique. - Premier cycle (Licence) - Second cycle (Master) - Double-cursus Architecte - Ingénieur - HMONP - DSA option projet urbain - DPEA Architecture navale - DPEA Métropoles d’Asie Pacifique - DPEA Architecture et Philosophie Elle a réaffirmé son projet dans la continuité des acquis pédagogiques depuis la création de l’école (1969). Un certain nombre de modifications substantielles a été introduit. Cette campagne d’habilitation a mobilisé les différents corps de l’ENSAPLV (enseignants, étudiants et administratifs). Elle s’est déroulée par la mise en place de nombreux groupes de travail (un groupe et six sous-groupes pour le premier cycle et quatre groupes pour le second cycle) structurés par formation et cursus et a donné lieu à de multiples réunions. Chaque groupe ou sous-groupe a été animé par un(e) enseignant(e) coordinateur ou responsable et un(e) représentant(e) de l’administration. Chaque réunion a fait l’objet d’un compte-rendu diffusé à l’ensemble des personnels de l’ENSAPLV. Deux séminaires ont été organisés (le 16 février 2008 pour le second cycle et le 5 avril 2008 pour le premier cycle) ainsi que des réunions bi-mensuelles de la CPR avec pour certaines des membres élus du CA. Pas moins d’une centaine de réunions ont été organisées au total. Enfin, la CPR ayant été très largement mobilisé a validé le 15 avril 2008 les principes généraux des différentes formations concernées. Puis le CA le 21 mai 2008 a approuvé dans sa globalité les différents programmes (calendrier universitaire, nouveaux enseignements, règlements des études, guide des stages…). A l’automne 2008, l’ENSAPLV a obtenu une habilitation pour quatre années ou un agrément pour les formations suivantes : - Premier cycle Licence - Second cycle Master - Double-cursus Architecte - Ingénieur - HMONP - DPEA Architecture et Philosophie Pour les autres formations, les demandes sont en cours.
L’enseignement dispensé à l’ENSAPLV continue de se distinguer par son ouverture particulière aux sciences humaines et aux arts plastiques, y compris la photographie et le cinéma, lesquels contribuent à donner aux étudiant(e)s la possibilité d’opérer une synthèse créative des connaissances et des savoirs-faire mis en jeu dans le projet, une meilleure compréhension des enjeux auxquels ils auront à faire face dans leur vie professionnelle et à les sensibiliser à la dimension artistique de leur activité future. La formation à l’architecture est assurée par des équipes pluridisciplinaires comprenant des architectes praticiens pour l’enseignement du projet et des ingénieurs, des sociologues, des historiens, des géographes, des philosophes, des juristes, des plasticiens, des photographes, des cinéastes… pour les disciplines connexes. Outre sa nature professionnelle, l’enseignement se distingue par sa dimension universitaire affirmée. Un très large choix de matières est laissé aux étudiant(e)s, en particulier en second cycle, qui permet à chacun de définir de façon autonome le parcours qui lui semble le plus approprié à ses aspirations. a. Le premier cycle (Licence) – Initiation à l’architecture Le premier cycle (Licence) d’une durée de trois ans conduit à l’obtention du diplôme d’Etudes en architecture conférant le grade de Licence. Il permet à l’étudiant(e) d’acquérir les bases d’une culture architecturale, de la compréhension et de la pratique du projet architectural et des processus de conception en référence à des usages, des techniques et des temporalités. Ce cycle comprend deux stages obligatoires d’une durée totale d’au moins six semaines, dont un stage "ouvrier et/ou de chantier". Il s’achève par un rapport d’études et sa soutenance devant un jury. En 2008, 204 diplômes d’études en architecture conférant le grade de Licence ont été délivrés. L’offre pédagogique du premier cycle a fait l’objet en 2008 d’une plaquette commune regroupant la présentation détaillée de l’ensemble des enseignements dispensés pendant les trois années.
18
b. Le second cycle (Master) – Approfondissement et autonomie Le second cycle d’une durée de deux ans conduit à l’obtention du diplôme d’Etat d’architecte conférant le grade de Master. Il permet de maîtriser : - une pensée critique relative aux problématiques propres à l’architecture ; - la conception d’un projet architectural de manière autonome par l’approfondissement de ses concepts, de ses méthodes et des savoirs fondamentaux ; - la compréhension critique des processus d’édification dans leurs rapports à divers contextes, échelles et en référence aux différents usages, techniques et temporalités ; Et de se préparer : -aux différents modes d’exercice et domaines professionnels de l’architecture ; - à la recherche en architecture. Il peut conduire également vers d’autres formations d’enseignement supérieur, comme des Masters, dans le respect des conditions particulières d’accès à ces formations. Il donne à l’étudiant(e) la capacité de définir un projet architectural situé dans un contexte géographique et social. Il est largement fondé sur une grande autonomie, avec un très large choix de matières optionnelles permettant à chaque étudiant(e) de façonner son parcours à la carte et de préparer un parcours recherche. La première année du second cycle est également le moment privilégié pour bénéficier d’un programme d’échange international et d’un séjour long à l’étranger. En 2008, 308 diplômes d’Etat d’architecte conférant le grade de Master ont été délivrés. L’organisation pédagogique du second cycle s’appuie en partie sur neuf pôles thématiques correspondant à des thématiques distinctes. Après un semestre de tronc commun, les étudiant(e)s choisissent un pôle thématique dans lequel ils suivent pendant deux semestres (semestres 8 et 9) un groupe de projet, un séminaire et des enseignements optionnels liés par semestre, à choisir parmi une offre large offerte au sein des pôles thématiques.
Les neuf pôles thématiques proposés sont les suivants : - Art, scénographie et architecture (ASA) - Architecture, société et métropolisation (ASM) - Ville, architecture, habitat (VAH) - Paysage - Projet, histoire, critique (PHC) - Architecture, environnement et développement durable (AEDD) - Architecture, modélisation et construction (AMC) - Architecture, art et philosophie (AAP) - Métropoles de l’Arc Pacifique (MAP) L’offre pédagogique du second cycle a fait l’objet en 2008 d’une plaquette commune regroupant la présentation détaillée de l’ensemble des enseignements dispensés lors des deux années à l’exception du semestre dix consacré aux PFE. Un appel d’offres spécifique au PFE permet de proposer chaque année de nouvelles thématiques. En 2007-2008, 26 groupes de PFE ont ainsi été constitués. A l’ENSAPLV, le dernier semestre est consacré à la préparation des PFE. L’encadrement spécifique mis en place pour le PFE, soit 6 heures par semaine, comprend un enseignant(e) directeur d’études et une équipe pédagogique. Un parcours recherche permet de préparer une orientation future vers un doctorat à travers une initiation à la recherche débouchant sur un Master recherche. Compte tenu des effectifs importants, les jurys de PFE ont été organisés selon les modalités suivantes. Chaque étudiant(e) présente son travail de PFE pendant une heure devant un jury de soutenance, qui comprend obligatoirement son directeur d’études et un rapporteur. Chaque jury de soutenance siège pendant deux jours et auditionne l’effectif d’un groupe de PFE. A l’issu des auditions, les directeurs d’études et un rapporteur de quatre jurys de soutenance se rassemblent pour former un jury de délibération, présidé par une personnalité extérieure à l’école, qui peut également siéger dans les jurys de soutenance si elle le souhaite. Vingt jurys de soutenance et cinq jurys de délibération ont ainsi été organisés en juillet puis seize jurys de soutenance et quatre jurys de délibération ont été organisés en septembre.
19
Les stages obligatoires de la formation initiale En 2008, la réorganisation du calendrier pédagogique a permis d’intégrer une période libre de cours (inter-semestre de février) pour permettre aux étudiant(e)s qui le souhaitent d’effectuer leurs stages de premier et de deuxième cycle. L‘obligation d’effectuer deux stages en premier cycle et un en second cycle a multiplié le nombre de conventions passées avec les organismes d’accueil. 1241 stages ont ainsi été effectués.
Année\ Cursus
Stage d’été Stage inter-semestre
1er cycle année 2 (L2)
102 163
1er cycle année 3 (L3)
42 55
2ème cycle année 1 et 2 (M1\M2)
268 611
TOTAL CONVENTIONS
412 829
TOTAL : 1241 stages
0
200
400
600
800
L2 L3 M1/2
stage été
stage inter-semestre
En premier cycle, 28,23% des étudiants effectuent leurs stages pendant la période d’été et 42,74% pendant l’inter-semestre. En second cycle, 26,80% des étudiants accomplissent une partie de leur stage de Formation Pratique pendant la période estivale contre 61,10% pendant l’inter-semestre. c. Le double cursus architecte-ingénieur Depuis 2006, un double cursus architecte-ingénieur est organisé conjointement avec l’Ecole spéciale des travaux publics (ESTP). Il est ouvert après sélection dès la première année de premier cycle aux étudiant(e)s titulaires d’un baccalauréat scientifique avec mention bien ou très bien.
A l’issue d’une formation de 7 ans (au lieu de 5 ans), les étudiant(e)s sortent avec deux diplômes : celui d’architecte diplômé d’Etat et celui d’ingénieur de l’ESTP. En 2008, le double cursus a été habilité pour quatre années. Ce double cursus est très apprécié des étudiant(e)s, et constitue une valeur ajoutée certaine à l’ENSAPLV comme à l’ESTP. Pour renforcer ces liens, le directeur de l’ENSAPLV a été invité à siéger au Conseil de Perfectionnement de l’ESTP. En 2008, 48 étudiant(e)s inscrits en architecture ont suivi le double-cursus soit 6% des effectifs globaux de premier cycle. En parallèle, 47 étudiants inscrits à l’ESTP ont suivi des enseignements de projet, d’histoire de la construction, de l’architecture et de la ville, de perception et langage plastique, de sciences humaines, une option thématique « Culture architecturale – usage et édification ». Répartition des étudiant(e)s du double-cursus en premier cycle : Premier cycle Licence
Année 1 Année 2 Année 3
BAI 25 13 10 TOTAL BAI 48 étudiant(e)s BIA inscrits 22 16 9 TOTAL BIA 47 étudiant(e)s d. Le doctorat en architecture L’ENSAPLV délivre le doctorat en architecture par le biais de conventions d’association avec deux écoles doctorales : - L’école doctorale «Ville et Environnement» (ED 448) est constituée de l’Université de Paris VIII, de l’Université de Marne-la-Vallée, de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées et des écoles nationales supérieures d’architecture de Paris-Belleville, de Paris-Malaquais et Paris-la-Villette à travers leurs structures de recherche : le Laboratoire Espaces - Travail (LET), le Laboratoire ARIAM-LAREA, Equipe de recherche Architectures Milieux et Paysages (AMP). - L’école doctorale «Pratiques et Théories du Sens» (ED 31) associe l’Université Paris VIII et l’ENSA Paris-la-Villette, à travers le laboratoire de recherche GERPHAU .
20
Au titre de l’ENSAPLV, les enseignant(e)s possédant une Habilitation à Diriger la recherche (HDR) sont : - Agnès Deboulet - Thérèse Evette - François Guéna, - Jean-Pierre Le Dantec, - Christian Moley, - Yann Nussaume, - Yannis Tsiomis, - Yves Trochel - Serge Wachter - Chris Younès En 2008, 24 étudiant(e)s encadré(e)s par des enseignants de l’école sont en doctorat en architecture dans le cadre de l’école doctorale « Ville et Environnement », dont 17 sont inscrits à l’ENSAPLV et 7 inscrits à Paris VIII. La répartition en est la suivante : - 6 inscrits en 1ère année - 5 inscrits en 2ème année - 9 inscrits en 3ème année - 4 inscrits en 4ème année et plus. La répartition au titre des directeurs de thèse est la suivante : Jean-Pierre Le Dantec 11 Yannis Tsiomis 7 François Guéna 3 Thérèse Evette 2 Agnès Deboulet 1 e. La HMONP L’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP) permet à son titulaire d’endosser les responsabilités personnelles. La formation a, selon l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2007, pour objectif : - L’acquisition, - L’approfondissement, - L’actualisation des connaissances de l’architecte diplômé d’Etat dans trois domaines spécifiques :
* les responsabilités personnelles du maître d’œuvre : la création et la gestion des entreprises d'architecture, les principes déontologiques, les questions de la négociation de la mission (contrat, assurances...), les relations avec les partenaires (co-traitance...), la gestion et les techniques de suivi du chantier ; * l'économie du projet : la détermination du coût d'objectif, les liens avec les acteurs (économiste, bureaux d'études techniques, entreprises...) ; * les réglementations, les normes constructives, les usages…
En 2008, sur 136 ADE inscrits, 6 ADE ont abandonné cette formation. Résultat des soutenances 2008 Soutenance de juin 2008 Nombre d’ADE présentés 119 Admis 104 ADE présents au rattrapage
15
Soutenance de septembre 2008 Nombre d’ADE présentés 26 Admis 21 Refusés 5 Nombre d’Habilitations délivrées
125
En juin 2008, la formation HMONP a reçu une avis favorable pour quatre années. Pour la rentrée 2008-2009, la mise en place de la HMONP a vu quelques modifications en matière d’organisation. En effet, pour permettre une mise en situation professionnelle à l’étranger (MSP) répondant ainsi à l’ouverture sur l’international qui est un des objectifs majeurs de l’ENSAPLV, l’organisation de la HMONP a été la suivante : - une 1ère session de formation fin septembre – début octobre - 6 mois de MSP - une 2ème session de formation en avril En septembre 2008, 185 ADE se sont inscrits en HMONP dont l’origine est la suivante : Les origines des inscriptions 2008-2009 Origines des inscriptions Nbr d’inscrits % ENSAPLV 167 90 ENSA Grenoble 2 1 ENSA Nantes 2 1 ENSA Marne la Vallée 2 1 ENSA Malaquais 1 1 ENSA Montpellier 2 1 ENSA Val de Seine 7 4 ENSA Versailles 1 1 Ecole polytechnique de Milan
1 1
TOTAL DES INSCRITS 185 100 L’ouverture internationale se traduit par le nombre d’ADE d’origine étrangère inscrit en HMONP : Origine Nbr d’inscrits % ADE Français 125 68 ADE Etrangers 60 32 TOTAL DES INSCRITS 185 100
21
Les lieux de la MSP Lieux Nbr d’inscrits % PARIS/IDF 178 84 PROVINCE 6 4 ETRANGER 1 12 TOTAL DES INSCRITS 185 100 Les différents types de contrats des ADE Durant leur MSP, différents types de contrat se déclinent de la manière suivante : Type de contrat Nbr d’inscrits % Contrat à durée déterminée 89 49 Contrats via Passerelle V 46 25 Contrat à durée déterminée 32 18 Travailleur indépendant 9 5 Stage 6 3 TOTAL DES CONTRATS 182* 100 * 3 abandons Les salaires des ADE dans le cadre de l’HMONP s’échelonnent de 1 321 € à 3 000 € brut, la moyenne des salaires étant de 1 500 € brut. Pour les MSP à l’étranger, ne pouvant imposer la réglementation française en matière droit du travail, c’est la seule exception pour laquelle des conventions de stage ont été signées. Les gratifications s’échelonnent entre 398 € et 700 €. 43 enseignants de l’ENSAPLV assurent le rôle de directeur d’études encadrant les ADE durant les 6 mois de leur mise en situation professionnelle. Ceux-ci encadrent de 1 à 16 ADE, la moyenne étant de 3 ADE encadrés par directeur d’études. f. Le DSA «Architecture et Projet urbain» L’ENSAPLV dispense sur trois semestres une formation spécialisée post-master, le DSA "Architecture et projet urbain" qui comprend trois options : - une option Projet urbain (PUM) - une option Paysage (PAY) - une option Développement (DEV) Ce DSA propose une formation approfondie sur le projet urbain dans sa double dimension de conception et de projet architectural, urbain et de paysage. Il se caractérise par une ouverture aux architectes ainsi qu’à d’autres formations désireuses d’acquérir une spécialisation dans ces domaines de compétence. Il inclut une spécialisation recherche optionnelle.
La répartition des inscriptions de la promotion 2006-2008 Inscriptions 2006-2007 au 1er et 2ème semestre :
Français Etranger Total 39 32 71
Inscriptions 2007-2008 au 3ème semestre :
Français Etranger Total 1 26 27
Les diplômés par option Session de février Session de
juin Développement 5 4 Paysage 7 3 Pum 2 4 TOTAL 14 11 TOTAL DES DIPLOMES 25 Le nombre d’inscrits en 2008 DSA 1er et 2ème
semestre 3ème semestre
Paysage 13 13 Métropolisation 26 8 Développement - 10 TOTAL DES INSCRITS 39 31 Au semestre 1 et 2, sur les 39 étudiant(e)s inscrit(e)s en DSA, 5 sont des étudiant(e)s français, 34 des étudiant(e)s étranger(e)s. Au semestre 3, 4 étudiant(e)s sont français et 27 sont des étudiant(e)s étranger(e)s. Le DSA compte 87,14% d’étudiant(e)s étranger(e)s. g. Les diplômes propres aux écoles d’architecture - DPEA L’ENSAPLV propose trois DPEA aux titulaires d’un diplôme d’Etat d’architecte : - DPEA - Architecture Navale ; - DPEA - Métropoles d’Asie-Pacifique ; - DPEA - Architecture et Philosophie.
22
Le DPEA – Architecture Navale L’architecture navale constitue à l’ENSAPLV une composante forte de la diversité des enseignements qui y sont proposés. Le projet d’architecture navale est enseigné à l’ENSAPLV pratiquement depuis la création de l’école. Les enseignements permettent d’acquérir une bonne connaissance de la représentation des formes courbes dans l’espace, de l’organisation d’espaces restreints, de la plastique liée à l’environnement marin… Ils dépassent de loin le cadre de la construction navale, et à fortiori celui plus restreint des navires de plaisance. Avant d’être « navals », ils sont des enseignements du projet d’architecture au sens le plus large. La durée de la formation est de deux semestres répartis sur 34 semaines. Cette formation constitue un approfondissement de l’architecture navale. Les principales disciplines concernés par ce domaine sont : l’architecture, la culture, la théorie du navire, l’évaluation des espaces, l’informatique, la construction, le calcul des structures, la plastique et la représentation… Les projets rendus devront obtenir la mention B (très bien en notation ECTS, équivalent à une note minimum de 14/20) pour l’obtention du DPEA de l’ENSAPLV permettant la validation de 60 ECTS. Le DPEA – Métropoles d’Asie Pacifique - MAP Le thème central de la formation s’attache à l’étude des phénomènes de développement des métropoles en processus accéléré dans leurs dimensions architecturales et urbanistiques. Elle repose sur : - l’intérêt d’une formation à l’intervention architecturale et urbaine dans des contextes de développement économique et urbain accéléré (y compris sous l’angle des effets de crise auxquels ceux-ci s’exposent) ; - la nécessité, à cet effet, d’appréhender la spécificité de la production et des pratiques architecturales et urbaines dans l’aire concernée, tant sur le plan des éléments de structuration de l’espace et des modes d’habiter que sur le plan de leur dynamique de transformation. Le programme du DPEA MAP situe donc l’approche de l’intervention spécialisée et singulièrement du projet - au croisement, d’une part, de l’architecture et de l’urbanisme, de l’histoire, de l’anthropologie et de l’économie, d’autre part.
La formation retient l’importance de l’approche in situ, comme une condition déterminante de la compréhension des phénomènes et de la conception des formes d’intervention. Le DPEA – Architecture et Philosophie Le DPEA est consacré à l'étude critique des "théories" de l'architecture d'un point de vue philosophique, et en particulier pour la période contemporaine. L'objectif est celui d'une formation à la recherche. La recherche est entendue en son sens institutionnel (thèse de doctorat, recherche contractuelle des équipes et laboratoires de recherche), mais sans exclure, les pratiques réflexives de l'architecture, dites pratiques "théorisées" ou critiques. Le nombre d’inscrits en 2008 par DPEA
DPEA Nbr d’inscrits Architecture Navale 18 Métropoles d’Asie Pacifique 7 Architecture et Philosophie 20 TOTAL DES INSCRITS 45
L’organisation des DPEA
DPEA Durée Nbr d’heures de formation
CM TD
Architecture Navale 1 459 153 306 Métropoles d’Asie Pacifique
1 504 192 312
Architecture et Philosophie
1 295 295 -
La répartition des heures d’encadrement des DPEA - DPEA Architecture navale : *Obligation de service : 219 *Vacations : 240 *Total : 459 - DPEA Architecture et Philosophie : *Obligation de service : 142 *Vacations : 153 *Total : 295
23
Le nombre de diplômés en 2008 / nombre d’inscrits Formations Inscrits
07-08 Diplômés
07-08 % des
diplômés Métropoles d’Asie Pacifique
17 11 65
Architecture Navale
10 5 50
Architecture et Philosophie
28 14 50
TOTAL DPEA 55 30 h. La formation continue L’ENSAPLV organise un cursus de formation continue proposé aux professionnels en exercice sur « l’ingénierie et architecture environnementale» qui se déroule de janvier à novembre et donne lieu à un diplôme spécifique de l’ENSAPLV. Une trentaine de professionnels ont suivi en 2006-2007 ce cycle de formation continue et la totalité ont été diplômés. Ce cycle a été reconduit à partir de janvier/décembre 2008, avec un effectif inchangé de 30 personnes, malgré une demande supérieure de 40 personnes. Le montant des droits d’inscriptions s’élève à 6900 euros par stagiaire. Pour clarifier le positionnement de ce cycle de formation au sein de l’école, il a été décidé que l’ENSAPLV en reprenait pleinement la responsabilité en 2007. La mise en œuvre du contenu pédagogique a été confiée à la société coopérative Score 2D après procédure d’appel d’offres. i. Le master professionnel : organisation du travail et ergonomie L’ENSAPLV assure en co-habilitation avec l’Université Paris I, un Master 2 professionnel organisation travail. Ce Master articule les enseignements sur des questions majeures (qualité, fiabilité, sûreté, sécurité, productivité, santé) abordées sous l'angle des compétences, des dynamiques collectives, et des dispositifs techniques, spatiaux et organisationnels qu’elles engagent. La question de l’intervention dans les organisations, dans la conception, dans le management constitue le fil directeur de la formation.
Elle est déclinée sous l’angle épistémologique, méthodologique et politique. 11 étudiant(e)s inscrit(e)s sur 23 au total en 2007 ont été diplômé(e)s en 2008. Pour l’année 2008-2009, 32 étudiant(e)s se sont inscrit(e)s à cette formation. j. Les voyages pédagogiques De nombreux voyages et visites pédagogiques ont été organisés en 2008 dans le cadre des activités liées au cursus pédagogique. Un voyage d’étude au Pays-Bas a été organisé pour la première fois pour l’ensemble de la promotion de première année de premier cycle du 23 au 26 février 2008. Compte tenu du vif succès de ce voyage, il a été décidé de reconduire le principe malgré la charge que cela représente pour l’école. Un voyage est en principe prévu du 23 au 26 février 2010 à Berlin. Chaque car dispose d’une équipe d’encadrement pluridisciplinaire en charge de l’élaboration du programme spécifique aux étudiant(e)s de ce car, mais des exercices croisés, communs à toute la promotion d’étudiant(e)s sont également projetés. k. Les concours De nombreux étudiant(e)s de l’ENSAPLV ont été primés à divers concours ou distingués par divers prix français ou internationaux.
24
L’observatoire des métiers a. Les missions - L’annuaire des architectes DPLG Une mise à jour de l’annuaire des architectes DPLG, diplômés de l’ENSAPLV a été effectuée. Cet annuaire a été réalisé sur une base de données Access. Elle contient les diplômés de 1969 au 31 décembre 2007. Au total elle compte plus de 8500 diplômés architectes DPLG (avec 3000 adresses dont les plus anciennes datent de 2007). Le croisement des fichiers avec le fichier du CNOA a déjà permis de renseigner 2031 fiches professionnelles de diplômés inscrits à l’Ordre des architectes. Actuellement, le travail de recherche d’adresses se poursuit. Par ailleurs, un projet de mise en ligne de cet annuaire informatisé et sécurisé est à l’étude. - L’annuaire des Architectes Diplômés d’Etat (ADE) Parallèlement; une étude est menée afin de constituer un annuaire des architectes diplômés d’Etat. - L’annuaire des architectes ayant effectué un HMONP à l’ENSAPLV Une étude est également en cours afin de constituer un annuaire des architectes ayant suivi une HMONP au sein de l’ENSAPLV. b. Les objectifs Ces différentes missions ont pour but d’observer l’insertion professionnelle des diplômés au moyen d’enquêtes. Cela permet de suivre l’évolution du métier dans ses différents modes d’exercices, de mesurer la diversification des débouchés et de préciser les modalités de transition entre l’enseignement et l’exercice professionnel. Elles permettent également une interactivité entre l’ENSAPLV et ses diplômés, de solliciter l’annuaire pour la recherche de lieux de stages et d’emplois dans le cadre de la HMONP, d’élargir la collecte de la taxe d’apprentissage. Elles permettront également à terme de créer une association des anciens diplômés de l’école.
c. Les enquêtes réalisées Plusieurs enquêtes ont été menées : - en 2007 relatives aux diplômés DPLG 2002-2003 - en 2008 relatives aux diplômés DPLG 2003-2004 - en 2009 sur les diplômés DPLG 2004-2005 dans le cadre d’une enquête nationale relative à l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur du Ministère de la culture et de la communication. - fin 2009, une même enquête nationale sera conduite sur les diplômés DPLG 2005-2006 Par ailleurs, en 2010 une enquête du Centre d’Etudes et de la Recherche sur les Qualifications (CEREQ) sera réalisée sur les étudiant(e)s ayant quitté l’établissement en 2007 (diplômé(e)s ou non).
25
4. La recherche L’ENSAPLV abrite cinq formations de recherche habilitées. Ces équipes rassemblent une trentaine de chercheurs, dont neuf habilités à diriger des recherches (HDR). Ils contribuent par leurs publications au développement des connaissances et assurent l’initiation et la formation à la recherche des étudiants et encadrent les doctorants. Un parcours recherche et un Master recherche permettent aux étudiant(e)s qui le souhaitent de s’orienter vers la préparation d’un doctorat en architecture. Les laboratoires et équipes de recherches - Le laboratoire Architectures, Milieurs, Paysages – AMP dirigé par Jean-Pierre Le Dantec - L’atelier de Recherche en Informatique Architecture et Modélisation – Laboratoire d’Architecturologie et de Recherches Epistémologiques sur l’Architecture – ARIAM – LAREA dirigé par François Guéna - Le GERPHAU dirigé par Chris Younés - Le laboratoire Architecture Anthropologie – LA/A dirigé par Alessia De Biase - Le Laboratoire Espaces Travail – LET dirigé par Thérèse Evette Une personne de l’administration assure et coordonne l’activité des équipes de recherche ainsi que la gestion des contrats de recherche.
Au titre de l’année 2008, la DAPA a notifié les montants suivants pour les dotations de fonctionnement accordées aux unités de recherche de l’établissement dans le cadre du programme pluriannuel 2006-2009 : Laboratoire LAREA-ARIAM : 15 598 € Laboratoire LET : 18 835 € Equipe LA\A : 11 036 € Equipe AMP : 14 126 € Laboratoire GERPHAU : 16 187 €
26
Laboratoire Architectures, Milieux, Paysages - AMP Dirigé par Jean-Pierre LE DANTEC Laboratoire de recherche de l’ENSAPLV Site internet : un nouveau site Internet de l’équipe de recherche AMP est en cours de création. Il donnera plus amplement accès à l’ensemble des activités de recherche de l’équipe, ses liens avec l’enseignement et la formation à la recherche, ses coopérations internationales. Le travail de cette équipe vise à développer des connaissances nouvelles et une réflexion sur le devenir des lieux et des territoires, en considérant le paysage et le milieu en lien avec l’architecture. Les membres Le laboratoire comprend les chercheurs suivants : - Jean-Pierre Le Dantec (directeur, HDR), - Yann Nussaume (directeur-adjoint, HDR), - Arnauld Laffage (secrétaire général), - Pascal Aubry, Augustin Berque (HDR), Rosa Di Marco, - Eric Daniel-Lacombe, Philippe Duboy, Patrick Duguet, Andreas Christo-Foroux, Mongi Hammami, Nikola Jankovic, Olivier Jeudy, Hervé Jézéquel, Philippe Nys, Anne Philippe, Che Bing Chiu, Michel Vernes, Catherine Zaharia-Franceschi. Il s’agit d’une équipe pluridisciplinaire d’historiens, de géographes, de philosophes, d’architectes, de paysagistes, de plasticiens, d’artistes, de cinéastes et de photographes dont la majorité sont enseignant(e)s à l’ENSAPLV, mais comprenant aussi des enseignants de l’EHESS, de Paris VIII, de l’ENSA de Grenoble et de l’ENSA du Paysage de Versailles. Elle accueille actuellement 25 doctorants inscrits soit à l’école doctorale " Ville et Environnement ", soit dans l’école doctorale de l’EHESS, dont certains en co-tutelle avec des Universités d’Italie, du Portugal ou de Chine, ainsi que deux stagiaires boursiers étrangers dans le cadre de doctorat ou de post-doctorat. L’orientation structurante de l’équipe AMP Trois axes de recherche structurent les travaux de l’ensemble des chercheurs : - Axe 1 : Notions et théories : approches épistémologique, historique, philosophique et comparative. - Axe 2 : Idées agissantes dans la transformation des lieux et territoires : approches historique, herméneutique, mésologique et comparative.
- Axe 3 : Enseignement du paysage dans les écoles d’architecture : approches comparatives. Les recherches menées spécifiquement en 2008. - Le programme ASIA-LINK - Achèvement du programme international "Asia-Link", financé par la Communauté Européenne (décembre 2005- décembre 2008) : Development of an International Curriculum of Landscape Knowledge in Architecture and Urban Planning Education. Ce programme a impliqué quatre universités partenaires en France : ENSAPLV, Equipe de recherche AMP ; en Angleterre : UCL, University College London (Bartlett), laboratoire " Space Syntax " ; en Chine : Tianjin University et Chongqing University. Ce programme s’est achevé par la publication du livre De l’enseignement du paysage dans les Ecoles d’architecture, éditions de la Villette, 2009. - Le programme "L’architecture de la grande échelle" - Programme "L’architecture de la grande échelle" du BRAUP-MCC 2007-2009 : Vers une architecture des milieux : expérimentations projectuelles et pédagogiques de la " ville-nature ", projet proposé et retenu par le BRAUP sous la direction de Chris Younès, Laboratoire GERPHAU, en association avec l’équipe AMP-ENSAPLV (Rosa De Marco). - Le programme «Le Pari du Grand Paris» - Programme «Le Pari du Grand Paris» : l’équipe AMP a été l’unité de recherche associée à l’’atelier Castro-Denissof-Casi dans le cadre de cette consultation internationale : de nombreux séminaires ont été organisés et deux rapports de recherche/développement produits à cette occasion par l’équipe, ainsi qu’un ouvrage publié aux éditions de la Villette sous la direction d’Hélène Bleskine Le Grand Paris est un roman. L’ensemble du travail de l’équipe a été présenté en 2009 à la Cité de l’architecture et du patrimoine. L’équipe AMP et l’international L’équipe AMP a développé de longue date des coopérations avec des universités et des organismes de recherches et d’enseignements nationaux et internationaux (Europe et hors Europe).
27
Au cours de l’année 2008, AMP s’est associé à 2 réseaux internationaux : 1/ le réseau Uniscape ayant vocation à promouvoir dans les Universités d’Europe la Convention européenne du paysage (Jean-Pierre Le Dantec est membre de son comité directeur) ; 2/ le réseau « Paysage et tourisme » dans l’espace méditerranéen (Ecoles d’architecture de Malaga, Rabat, Syracuse, Rome Sapienza et ENSAPLV via AMP). En plus des coopérations scientifiques internationales existantes depuis plusieurs années, voici quelques participations récentes d’AMP à de nouvelles réalisations : - Création d’un laboratoire de recherche commun entre AMP et l’Institut d’architecture et d’urbanisme de l’Université de Tianjin, où Jean-Pierre Le Dantec, Arnauld Laffage et Pascal Aubry ont été nommés professeurs associés. La création de ce nouveau laboratoire est directement lié aux travaux réalisés dans le cadre du programme ASIA-LINK en cours de réalisation. Une recherche commune est en cours. - Participation à la mise en place de plusieurs réseaux universitaires européen et sud-américain, ainsi : 1- Maestria " Ciudad, Paisage et Medioambiente " de la Red, Réseau d’Universités sud-américaines pilotée par l’Université argentine de La Plata, faisant suite au programme Alfa-Puhuen initié en 2000 ; 2- Réseau universitaire européen Uniscape (dont Jean-Pierre Le Dantec est membre du conseil de direction) concernant l’enseignement et la recherche à propos de la Convention européenne du paysage (Florence, 2000), réseau piloté par l’I.U.A. de Venise. - Nouvelles coopérations scientifiques internationales avec :
- Le master Européen "Paysages méditerranéens" de l’Université de Catane, depuis 2006. - Le master de second niveau "Paysages du XXIe siècle" de la Faculté d’Architecture de l’Université de Florence en Italie. - Maintien de la coopération avec la Bartlett School UCL de Londres, laboratoire " Space Syntax " dirigé par Alan PENN, partenaire au même titre qu’AMP dans le cadre du programme Asia-Link.
Chaque membre de l’équipe AMP enseigne à l’ENSAPLV, dans les trois années du premier cycle et dans les deux années du second cycle au sein du pôle " Paysage " ou dans d’autres pôles constitués, et en post-diplôme.
Depuis la restructuration des 3ème cycles, les membres de l’équipe AMP partie prenant de l’ex DEA "Jardins, Paysages, Territoires" sont responsables de l’option " Paysage " du DSA "Architecture et Projet urbain" de l’ENSAPLV. Ce DSA ouvre la voie à la préparation d’un doctorat au sein de l’unité de recherche AMP. Quelques membres enseignent à l’Université ou dans d’autres Ecoles d’Architecture, ce qui favorisent les participations de l’équipe dans des programmes de recherche ou d’autres actions scientifiques et pédagogiques impliquant ces autres établissements. C’est le cas notamment de Rosa Di Marco, enseignante titulaire à l’ENSA de Grenoble et coordinatrice scientifique du séminaire et atelier international Habiter la montagne, habiter le paysage, mené par l’équipe "Architecture Paysage Montagne" de l’ENSA de Grenoble en association avec l’équipe AMP de l’ENSA de Paris-La Villette et avec d’autres écoles et universités européennes. Les résultats des recherches conduites collectivement ou individuellement au sein de l’équipe enrichissent bien sûr les enseignements de chacun des membres. Ils garantissent aussi leur renouvellement. Ces liens sont tout particulièrement développés dans le cadre programme Asia-Link. En effet, 5 workshops ont été organisés en France, en Angleterre et en Chine depuis le début du programme, impliquant près de 170 étudiants au total. De même, outre les communications et conférences données dans le cadre des colloques internationaux, de nombreux cours ont été dispensés. Tout considéré, 70 enseignants et plus de 400 étudiants ont participé à ce programme au cours de ces deux premières années de réalisation.
28
Atelier de Recherche en Informatique Architecture et Modélisation – Laboratoire d’Architecturologie et de Recherches Epistémologiques sur l’Architecture – ARIAM - LAREA Dirigé par François GUENA Laboratoire de recherche de l’ENSAPLV Site Internet : www.ariam-larea.archi.fr L’ARIAM-LAREA est une équipe de recherche habilitée par le BRAU en 2006. Elle est issue du regroupement de l’ARIAM (Atelier de Recherche en Informatique Architecture et Modélisation) habilitée en 1998 et du LAREA (Laboratoire d’Architecturologie et de Recherches Epistémologiques sur l’Architecture) habilitée depuis 1975. Le programme de recherche Le programme de recherche de cette équipe pluridisciplinaire vise la production de connaissances sur l’activité cognitive de la conception architecturale et urbaine et sur les applications de l’informatique dans ce secteur. Les membres Le directeur scientifique : - François Guéna, architecte - docteur en informatique - habilité à diriger des recherches, directeur scientifique de l’ARIAM-LAREA, professeur des écoles d'architecture Les chercheurs : - Thierry Ciblac, ingénieur, docteur en génie civil, maître assistant des écoles d'architecture - Caroline Lecourtois, architecte, docteur en aménagement de l’espace, maître assistant des écoles d'architecture - Françoise Schatz, architecte, professeur des écoles d’architecture (ENSA de Nancy) - Louis-Paul Untersteller, ingénieur, chercheur, maître assistant des écoles d'architecture Les chercheurs associés : - Philippe Boudon, architecte, docteur es sciences, ancien professeur des écoles d'architecture - Alain Chassagnoux, ingénieur, docteur, professeur des écoles d’architecture (ENSA de Nantes) - Gérard Engrand, philosophe, maître assistant des écoles d'architecture (ENSA de Lille)
- Hélène Géroyannis, mathématicienne, ingénieur de recherche de l’EHESS - Pierre Mace, mathématicien, ancien chargé de recherche au CNRS Les doctorants - Nazila Hannachi-Belkadi (encadrement conjoint avec le CSTB) - Apotolia Oikonomopoulou - Anne-Sophie Delaveau - Samia Ben Rajeb Les stagiaires de master - Romain Boyet - Aurélie De Boissieu - Louisa Zemirli Les partenaires de l’équipe - AMCX, J.L. Le Moigne - CSTB, Département Développement Durable, M. Jandon - ENSA de Paris Val de Seine, EVCAU, C. Deshayes - Massachusetts Institute of Technologies, Architecture Department, J. Ochsendorf - Université de Bourgogne, LE2I, D. Michelucci - Université de Liège, Lucid-LEMA, P. Leclercq - Université de Montréal, GRCAO, J.F. Rotgé - CNAM, LGU, G. Burgel - CNAM, Laboratoire d'Ergonomie CRTD, F. Darses - E.H.E.S.S.- L.A.T.E.S., H. Géroyannis - LIMSI-CNRS, Université Paris 11, Ch. Jacquemin
29
Les activités de recherche - La modélisation de l’activité de CAAO Il s'agit d’interroger la conception assistée par ordinateur en vue de construire une intelligibilité des opérations cognitives qu’elle induit. Il s’agit également de s’interroger sur les opérations de la conception susceptibles d’être assistées par de nouveaux systèmes. Cet axe de recherche porte donc sur les opérations de la conception architecturale et sur les opérations informatiques qui peuvent leur « correspondre » pour une activité de conception architecturale assistée par ordinateur (CAAO). Deux visées constituent cet axe : 1) constituer une connaissance par des analyses de cas d'activité de conception développée dans des agences d'architecture ; 2) interroger et poursuivre la connaissance architecturologique sur la conception en se nourrissant de ces cas. L’architecturologique constitue donc le principal outil de travail de cet axe. Ce travail est mené par Caroline Lecourtois, François Guéna et fait l’objet de la thèse d’Anne Sophie Delaveau. - Le projet Cocréa En partenariat avec le LIMSI/CNRS de l’université d’Orsay et le Lucid, Groupe de l’université de Liège, nous avons proposé un projet de recherche en réponse à l’appel d’offres de l’ANR pour le programme : La création : acteurs, objets, contextes. Ce projet a été retenu et a débuté le 15 décembre 2008 et doit se terminer fin 2010. Il s’agit du projet Cocréa (coordinatrice : Françoise Darses, LIMSI.CNRS). La part du financement reçue par l’ARIAM-LAREA s’élèvera à 95.000 euros. Il s'agit d'étudier l'activité de conception collaborative à distance en architecture et de spécifier les fonctionnalités de dispositifs matériels et logiciels qui seraient susceptibles d'assister les activités de conception collaboratives. Pour cette étude, nous réalisons des expériences de conception sur la base d'un dispositif développé par l'université de Liège et qui permet d'effectuer des réunions de conception entre plusieurs acteurs situés sur des sites distants. Le dispositif comprend une table à digitaliser sur laquelle sont projetées et saisies les données échangées et d'un système de visioconférence. Depuis octobre 2008, Samia BEN RAJEB a commencé un doctorat encadré par Caroline Lecourtois et François Guéna et dont le sujet s’inscrit dans ce projet Cocréa.
- Le projet Croqueur Ce projet s’inscrit dans la poursuite des travaux du laboratoire sur l’interprétation du dessin à main levée. Louis-Paul Untersteller, Pierre Mace et François Guéna cherchent à développer des d'outils de CAO utilisables dès les premières phases de l’étude d’un projet d’architecture et capables d’interpréter des projections 2D dessinées à main levée. Il s'agit d'exploiter les théories de la géométrie projective pour interpréter une esquisse et par exemple en produire une modélisation en 3D ou bien encore utiliser la dualité pour interpréter la projection esquissée d'un polyèdre et produire d'autres vues de ce même polyèdre. Ce projet est financé sur les fonds propres du laboratoire. Chaque année, il fait l’objet de publications qui présentent les avancées de cette recherche. - Les simulations et les évaluations techniques Le laboratoire poursuit ses travaux sur la simulation des édifices maçonnés médiévaux ; travaux à l'origine de la création de l'ARIAM en 1998. Ces travaux ont été prolongés dans le cadre d'une collaboration avec le MIT en 2004-2005 et dans le cadre d'une thèse qui sera soutenue en 2009 par Apotolia Oikonomopoulou (thèse encadrée par Thierry Ciblac et François Guéna). Le sujet porte sur l’exploitation de l’analyse limite pour l’étude du comportement des structures médiévales maçonnées. Le travail de Nazila Hannachi-Belkadi mené en collaboration avec le CSTB s’inscrit dans cet axe de simulations et d’évaluations techniques. Ce travail de thèse a pour objet l'évaluation et l'aide à la décision pour la conception des bâtiments à faible consommation d'énergie. L'originalité du travail réside dans l'utilisation de réseaux probabilistes bayésiens qui autorisent à la fois l'évaluation et l'aide à la décision. La thèse a été soutenue en juillet 2008.
30
Les activités pédagogiques liées à la recherche Notre équipe se constitue pour majeure partie d’enseignants exerçant leurs activités pédagogiques à l’ENSAPLV et à l’ENSA de Nancy (Françoise Schatz). Soucieux de constituer un lien fructueux entre nos travaux de recherche et nos enseignements, une part de notre travail de recherche se consacre à penser des didactiques concernant l’assistance de la conception. Divers types d’enseignement visant des objectifs pédagogiques spécifiques et disjoints constituent des ancrages pragmatiques de nos travaux de recherche. Le premier cycle Licence En premier cycle licence et à l’occasion du nouveau programme habilité de l’ENSAPLV, François Guéna a œuvré pour la refonte du programme de l’enseignement des techniques de représentation utilisant l’informatique. Toujours en premier cycle, Thierry Ciblac et Louis-Paul Untersteller ont proposé un nouvel enseignement de géométrie des projection utilisant l’informatique comme outil pédagogique. (http://www.paris-lavillette.archi.fr/cours-uel6tr). Le second cycle Master En second cycle, François Guéna propose un cours de programmation informatique dans lequel est posée la question des fonctionnalités à penser pour opérer dans la conception architecturale (http://194.199.196.99/So921-2008-2009). Collégialement, avec Thierry Ciblac, Caroline Lecourtois et Jean Letourneur, sculpteur, il anime un atelier de maquettes numériques à partir de la production de sculpture en terre. Ce cours a pour objectif premier de prendre connaissance et de manipuler les outils de modélisation surfacique. Il vise en outre à en construire une approche critique. Par ailleurs, Thierry Ciblac, accompagnés de Dalil Hamani, enseigne l’utilisation des outils informatiques de reconstruction en 3D (http://www.paris-lavillette.archi.fr/reconstruction3d) ainsi que l’utilisation d’outils de simulation et d’évaluation structurelle et thermique (http://www.paris-lavillette.archi.fr/cours-simulations-evaluations). Hélène Geroyannis, chercheur associée, enseigne l’utilisation des SIG et de la télédétection pour l’analyse du développement urbain. Conjointement avec les membres du CRAI, Françoise Schatz participe à un enseignement de Master orienté recherche à Nancy et elle anime des ateliers de projet sur les bases théoriques de l’architecturologie.
Enfin, l’activité pédagogique dans laquelle s’articule l’ensemble de nos problématiques que nous abordons d’un point de vue pluridisciplinaire est celle d’un séminaire de recherche que nous avons monté ensemble en 2006, à l’occasion de la fusion de nos équipes. Ce séminaire de recherche : “Conception et modélisations” se déroule en second cycle à l’ENSAPLV et regroupe l’ensemble des membres de notre laboratoire. Il vise la production de travaux de recherche sur la conception assistée par ordinateur. L’organisation de ce séminaire est largement présentée dans le rapport d’activité scientifique de l’ARIAM-LAREA 2006-2007 http://194.199.196.99/s809 - http://194.199.196.99/s911 Un parcours recherche est proposé conjointement à cet enseignement. Constitué d’exigences théoriques et pratiques, liées à la recherche du point de vue des préoccupations de notre laboratoire, ce parcours prend la forme d’un enseignement complémentaire et d’un stage de mise en situation de recherche au sein de notre équipe. Il s’accompagne d’une production effective sous forme d’un rapport de recherche et donne accès à la mention recherche au Diplôme d’Etat d’Architecte. Ce parcours permet aux étudiants qui le désirent d’obtenir les compétences et titres nécessaires pour accéder à l’école doctorale «Ville et Environnement» à laquelle nous sommes rattachés pour s’inscrire en thèse. L’encadrement doctoral Notre équipe compte actuellement une personne HDR (François Guéna) qui lui permet d’accueillir des doctorants. En 2008, quatre doctorantes ont participé à l’activité de notre laboratoire: - Nazila Hannachi-Bekaldi a débuté sa recherche en 2004. Elle a été encadrée conjointement par l’ARIAM-LAREA (François Guéna) et le département «développement durable» du CSTB (M. Jandon). Son sujet portait sur l’assistance au commissionnement des bâtiments à faible consommation d’énergie. La soutenance a eu lieu en juillet 2008.
31
- Apostolia Oikonomopoulou a débuté sa 3ème année de thèse en octobre 2008. Son sujet porte sur la simulation du comportement des maçonneries médiévales. Il s’agit de poursuivre les travaux sur le comportement des voûtes d’ogives gothiques développés à l’ARIAM depuis 1998 et ceux élaborés dans le cadre d’un projet d’échange dans la cadre du «MIT-France Program» entre l’ARIAM et le département d’architecture du MIT en 2004-2005. - Anne-Sophie Delaveau a débuté sa 2ème année de thèse en octobre 2008. Son sujet porte sur la question du style architectural dans un contexte d’utilisation de l’informatique comme outil de conception. Cette seconde année de thèse est consacrée à l’analyse, d’un point de vue architecturologique et morphologique, d’un corpus de réalisations architecturales où l’informatique a manifestement joué un rôle important. - Samia Ben Rajeb a débuté sa 1ère année de thèse en octobre 2008. Son sujet porte sur la conception architecturale collaborative à distance. Son travail s’inscrit dans le projet Cocréa financé par le programme Création-Objets-Acteurs de l’ANR. La communication des recherches en 2008 La participation à des conférences Caroline Lecourtois : - « Enseigner la conception architecturale assistée par ordinateur », In Actes du colloque BASC 2008, Biskra Algérie 8-10 Avril 2008. - « “Espace de conception” d’architectures judiciaires : les nouveaux palais de justice (Caen, Melun, Nantes, Grenoble et Pontoise) », conférence à la Journée « L’écriture de l’espace », Faculté de Philosophie Lyon 3, 17 Octobre 2008 (à publier en 2009). - Qualité architecturale, urbaine et paysagère : un alibi ?, conférence au Séminaire Analyse et politique de la ville : Le Grand Paris – Vivre en métropole, dirigé par G. Burgel et M. Cantal-Dupart, CNAM , 14 mars 2008. - Architecturologie fondamentale/Architecturologie Appliquée, Annaba, Conférence au département d’architecture de l’Université de Badji Mokhtar, 15 avril 2008. - ARIAM-LAREA, Conception, Architecturologie, Annaba, Conférence au département d’architecture de l’Université de Badji Mokhtar, 14 avril 2008.
Les publications - Thierry Ciblac, Structure computation tools in architectural design, eCAADe 26 conference, Anvers, 2008 - François Guéna, Louis-Paul Untersteller, Computing different projections of a polyhedral scene from a single 2D sketch, eCAADe 26 conference, Anvers, 2008 - Oikonomopoulou A., Ciblac Th., Guéna F., Approches numériques pour l'étude du comportement des structures maçonnées anciennes, Congrès d'histoire de la construction, Paris, 19, 20, 21 Juin 2008. - Thierry Ciblac, Louis-Paul Untersteller, Géométrie dynamique et modélisation géométrique : de la pédagogie à la pratique architecturale. La Geometria fra didattica e ricerca (La géométrie entre didactique et recherche) Florence, Italie, Avril 2008.
32
GERPHAU – FRE CNRS 7145 - LOUEST Dirigée par Chris YOUNES Laboratoire de recherche de l’ENSAPLV Site Internet : www.gerphau.archi.fr Les membres La responsable scientifique : - Chris Younès Le secrétariat du réseau PhilAU : - Nathalie Sabaté Le technicien de recherche : - En cours de recrutement Les enseignants chercheurs des ENSA et des universités : - Xavier Bonnaud, architecte DPLG, urbaniste, professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Clermont-Ferrand. - Frédéric Bonnet, architecte DPLG, urbaniste, maître assistant TPCAU Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Clermont-Ferrand. - Stéphane Bonzani, architecte DPLG, DEA de philosophie «étude des systèmes», doctorant à l'Ecole doctorale lettres - CERCI de l'université de Lyon III. Professeur associé à l'ESA. - Jacques Boulet, architecte DPLG, maître assistant TPCAU à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-la-Villette. - Eric Daniel-Lacombe, architecte DPLG, docteur en urbanisme, maître assistant TPCAU à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-la-Villette. - Marc-Antoine Durand, architecte DPLG, DEA de philosophie «étude des systèmes» université de Lyon III - Cécile Duteille, docteur en sociologie, contractuelle CNRS à l’Université de Paris Nanterre - Jean-Marc Ghitti, docteur de 3e cycle en philosophie, professeur agrégé de philosophie au lycée Léonard de Vinci à Monistrol/Loire (43) - Christian Leclerc,architecte DPLG, doctorant à l'Ecole doctorale lettres - CERCI de l'université de Lyon III, maître assistant à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Normandie - Panos Mantziaras, architecte de l'Ecole Polytechnique d'Athènes, docteur en urbanisme, maître assistant à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris Malaquais. - David Marcillon, architecte DPLG, DEA Projet architectural et Urbain, maître assistant TPCAU Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon, doctorant Ecole doctorale CERCI de l'Université de Lyon III
- Alexis Meier, architecte DPLG, docteur en philosophie, maître assistant associé THP école nationale supérieure d'architecture de Paris Malaquais. - James Njoo,architecte diplômé de l’Université de Waterloo, maître assistant Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-la-Villette - Elodie Nourrigat, architecte DPLG, DEA de philosophie «étude des systèmes», doctorante Ecole doctorale CERCI de l'Université de Lyon III, maître assistant Ecole Nationale Supérieure d'Architecture du Languedoc-Roussillon. - Thierry Paquot, professeur d’université à l’institut d'urbanisme de Paris (IUP) - Université de Paris XII Val de Marne, habilité à diriger des recherches, directeur de la Revue Urbanisme. - Didier Rebois, architecte DPLG, Secrétaire Général d'Europan, maître assistant TPCAU à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-la-Villette. - Anne Tufano, architecte, DPLG, docteur en arts et littérature, professeur à l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Valenciennes - Anne Tüscher,architecte DPLG, docteur en sciences cognitives de l’EHESS, maître assistant SHS à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette. - Jean-Pierre Vallier, architecte DPLG, DEA de philosophie, maître assistant TPCAU à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Malaquais. - Christophe Widerski, architecte DPLG, maître assistant associé TPCAU à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon. - Chris Younès, docteur de 3ème cycle en philosophie, habilitée à diriger des recherches, professeur SHS à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette et professeur associé à l'ESA. Les enseignants chercheurs associés - Jean Delsaux, docteur en esthétiques et sciences de l’art, maître de conférence et responsable 1ère année d’étude à l’IUT – Clermont 1 du Puy-en-Velay - Benoît Goetz, docteur de 3ème cycle en philosophie, habilité à diriger des recherches, professeur à l'Université Paul Verlaine de Metz. - François Guéry, professeur émérite des Universités à l'Université Lyon III.
33
La problématique spécifique au Gerphau Le laboratoire Gerphau se positionne dans une dynamique d’interdisciplinarité, où les croisements de disciplines (philosophie, architecture, urbanisme) permettent d’élargir et repenser leurs champs propres de problématisation théorique et pratique. La philosophie et ses concepts d’une part, l’architecture et l’urbanisme avec leurs systèmes de pensée et leurs dispositifs spatiaux d’autre part, confrontés à des situations construites multiples, tentent de définir de nouvelles orientations entre urbanité et nature, prenant forme dans la configuration de milieux habités de plus en plus hybrides et complexes. Le nouage entre philosophie, architecture et urbain est une tentative de questionnement sur le sens d’habiter aujourd’hui, en ses projets et dispositifs spatiaux. L’ancrage problématique déterminé implique une pensée de l’espace, du temps et du vivre ensemble qui se joue aussi dans une ré-articulation des échelles dans le projet et le processus urbain, dans de nouvelles approches éthico-politiques de l’action et dans une réévaluation du rapport à la nature au cœur des questions écologiques, paysagères et sociétales. Le développement du travail scientifique dans la dynamique d’une UMR du CNRS Le Gerphau est un des quatre sites du FRE 7145 du CNRS - LOUEST. A ce titre, les différents sites coopèrent au travail de recherche décliné selon les trois programmes suivants : - Des mutations sociales aux territoires urbains - Villes, compétences, démocratie - Articulations des échelles spatiales et temporelles dans le contexte du développement durable La mise en synergie recherche et enseignement entre écoles nationales supérieures d’architecture et universités : La recherche est en effet une composante de l’enseignement supérieur. Ainsi les membres sont impliqués dans des problématiques d’enseignement au sein de différents cycles. Les programmes de recherche L’ensemble des programmes développés en 2008 constitue la poursuite d’une activité conséquente du laboratoire.
Les budgets du laboratoire sont sur des dotations de soutien de programme de recherche et sur des contrats obtenus suite à des réponses retenues à des appels d’offres. En 2008, des efforts tout particuliers ont été portés sur la conduite du projet scientifique « Vers une architecture des milieux. Expérimentations projectuelles et pédagogiques de la ‘ville-nature’ », dans le cadre du programme interdisciplinaire « L’architecture de la grande échelle », et en collaboration avec l’équipe du professeur Concetta Fallanca de l’Università del Mediterraneo di Reggio Calabria. Dans le cadre du soutien du BRAUP, poursuite du travail d’élaboration et de réflexion sur la problématique de la nature et de la technè architecturale et urbaine, plus particulièrement dans la perspective du ‘développement durable’ et du projet urbain et architectural. D’autre part, depuis plusieurs années le GERPHAU mène des recherches sur le concours européen d’architecture EUROPAN. C’est dans le cadre de ce partenariat qu’une recherche-bilan sur le thème « Europan et le développement durable », a été initiée en 2008. Il s’agit de rendre compte de l’évolution de l’innovation durable sur les sites français de la session 5 à la session 9. Les doctorants Le laboratoire, site d’accueil des doctorants, est lié à deux écoles doctorales en partenariat avec les universités Paris XII et Lyon III : - l’Ecole doctorale CERCI, Université Jean Moulin, Faculté de philosophie, Lyon III, - l’Ecole doctorale «Egée», IUP institut d'urbanisme de Paris – Université de Paris XII Val de Marne. Le «pôle doctorant» a pris en charge 25 doctorants qui préparent leur thèse sous la direction de Thierry Paquot, Chris Younès ou François Guéry. Le laboratoire Gerphau vise à mettre en synergie scientifique ces différents travaux et thèses, et à développer des croisements et séminaires en son sein dans la perspective de constituer un collectif de recherche et d’en diffuser les résultats. En 2008, deux doctorats et deux HDR ont été soutenus.
34
Le site Internet La possibilité du partage d’un espace virtuel commun à tous les membres du Gerphau participe de la matérialité même du laboratoire. La réalisation de cet espace était une nécessité et est désormais chose faite avec la création du site Internet www.gerphau.archi.fr. L’idée d’une plate-forme commune ouverte aux différents membres du laboratoire, regroupant et valorisant les spécificités de chacun en même temps que promouvant une production scientifique commune, est celle qui a commandé la création du site et celle qui guidera son évolution future. Le site reprend les thèmes de recherche du laboratoire : Architecture, Philosophie, Urbain, Mobilité, Paysage, Art, Habiter, Echelle, Nature, Projet, Milieu, Ethique, Durable, Régénération. Chaque mot donne accès à une sélection d’articles. (La base de données doit encore être augmentée). Le site Internet du Gerphau a été mis en ligne le 1er mars 2008. Le Réseau Scientifique Thématique PhilAU (Philosophie Architecture Urbain) entre ENSA et universités Il s’agit d’un programme scientifique habilité par le Ministère de la culture et de la communication (DAPA, BRAUP), d’échanges, d’organisation de séminaires et de colloques, et de publications sur les rapports entre philosophie, architecture et urbain. Les Territoires de philosophes : L’espace et le lieu dans la pensée du 20e siècle Les séminaires ont porté en 2007 et 2008 sur « Les Territoires des philosophes » : L’espace, le lieu, le territoire, la ville, le paysage ne sont pas des sujets étudiés prioritairement par les philosophes contemporains, alors même que l’urbanisation représente dorénavant un phénomène planétaire. La question du lieu qui est posée et examinée, par vingt philosophes importants du XXe siècle (Simmel, James, Bergson, Heidegger, Weil, Bachelard, Merleau-Ponty, Arendt, Jonas, Wittgenstein mais aussi Lefebvre, Derrida, de Certeau, Levinas, Foucault, Deleuze et Guattari, Maldiney, Nancy, Sloterdijk), se trouve présentée par de jeunes philosophes et de plus anciens, tous confirmés. En mai 2009, une publication a été effectuée aux éditions de La Découverte, collection Armillaire.
L’environnement et les milieux urbains Un séminaire de recherche interdisciplinaire (2007) et un colloque (9 et 10 juin 2008) ont été menés en partenariat avec l’IUP- Créteil Université Paris 12. L’ouvrage Environnement et milieu urbain est en cours de préparation (publication prévue fin 2009) et fait suite à ces deux rencontres interdisciplinaires. Le mot « environnement » est particulièrement riche de sens, aussi paraît-il nécessaire de l’examiner avec la plus grande attention et bien le situer eu égard à d’autres termes, qui parfois curieusement sont imposés comme ses synonymes, nous pensons à « nature »,« paysage »,« écologie », « écosystème », « contexte », « écoumène », etc. Cet ouvrage vise à une telle clarification mais aussi à un questionnement quant aux relations entre « environnement », « technique », « urbanisation » et « architecture ». La préparation du Philotope n°7, revue du Gerphau, sur le thème : « Actualités de la complexité Urbaine – Contemporary Urban complexities » dirigé par Alexis Meïer L’objet de ce numéro est d’examiner les protocoles complexes qui participent de la constitution de la forme urbaine d’aujourd’hui : Comment par exemple, parler de mutations des mégalopoles et de la transformation des territoires en recourant à la notion d’appareil, de texte ou de diagramme ? Comment mesurer à l’encontre de tout dispositif déterministe de planification et de mixité, la possibilité d’une Éthique du vivre ensemble en s’appuyant, par exemple, sur certains concepts hérités de philosophie pragmatique et politique ? Comment encore, se réapproprier la « perception » de l’espace urbain en l’inscrivant dans la « zone de transfert distraite » de Walter Benjamin. A partir d’outils d’analyses développés dans le champ de la philosophie, des sciences humaines et des sciences de l’architecture (y compris l’apport des technologies digitales), cet examen permettra alors de proposer de nouveaux paradigmes autour desquels le questionnement, le débat et l’action publique peut et doit s’engager.
35
La préparation de « l’Indéfinition de l’architecture » : La multiplicité des définitions de l'architecture désigne la difficulté de formuler ce qui en constitue la spécificité. Nulle définition ne peut en être valable d'emblée. L’architecture n’est pas « indéfinissable », au sens où l’on dit, en philosophie, de l’individu qu’il ne peut jamais être défini (on ne peut définir que des espèces). Son « in-définition » doit être comprise comme l’impossibilité d’arrêter une fois pour toute une définition adéquate qui fixerait l’essence de l’architecturalité. On sait, aujourd’hui, que c’est ce projet qui est vain. L’architecture diffère et reporte sans cesse sa propre définition. L’architecture est la mise en variation de la somme indéfinie de ses définitions. Le moment est venu à la fois d’explorer les représentations et définitions en cours et de récapituler les définitions anciennes pour ne pas laisser totalement se perdre avec elles leur « teneur en vérité » (Walter Benjamin). Et ce, au moment même, où la nouvelle donne architecturale a été fortement reconfigurée par les interfaces incontournables avec l'urbain, le paysage, le territoire, et plus récemment les logiques environnementales qui en sont devenues des dimensions constitutives. La constellation sémantique ainsi générée et dont nous héritons, comme la diversité de ses expressions mais aussi le monde technique créé conduisent à en réinterroger à la fois les principes et les productions à l'œuvre. Cette conjoncture nous conduit à proposer une problématique de recherche concertée et comparée sur les représentations et définitions de l’architecture. Une publication sera effectuée en mai 2009. Le devenir Le réseau scientifique Thématique PhilAU conserve son siège et son budget à l’ENSA Clermont-Ferrand. En préparation, une publication à La Découverte, collection Armillaire, de l’ouvrage Environnement et milieux urbains, faisant suite au séminaire (2007) et au colloque qui s’est tenu les 9 et 10 juin 2008 à l’IUP Créteil – Université Paris 12 En préparation pour 2009-2010, une Anthologie sur le lieu et l’espace dans la pensée occidentale. Le budget du Gerphau ayant versé à partir de juillet 2008 à l’ENSAPLV, ses activités se poursuivent à Clermont-Ferrand en tant qu’antenne du laboratoire Gerphau – UMR CNRS 7145 LOUEST sous la responsabilité de Xavier Bonnaud et Chris Younès.
En cours de préparation : un colloque à l’ENSACF en décembre 2009 : La Nature en projet. Architecture et philosophie. Quelles régénérations ? Quels imaginaires ? Quelles visions ? Cette action sera menée en liaison avec la MSH-Auvergne et le Réseau établi avec l’Amérique du Sud. La question écologique fonde de nouvelles logiques de transformations des territoires et devient un support actif dans la conception comme dans la concertation des projets au niveau politique et citoyen. A la polarité ville-campagne se superpose désormais un autre paradigme articulant civilisation urbaine et nature. Quelle est cette nature dont l’homme fait partie ? Comment se développent les rapports de la culture à la nature ? Quels imaginaires ? Quelles visions ? Quelles responsabilités ? Ces questions s’avèrent cruciales dans la mise en œuvre architecturale. Plusieurs attitudes se superposent : maîtriser le milieu naturel en se défiant d’une exploitation aveugle, se tenir à distance par respect ou méfiance, rechercher la symbiose avec une nature en mouvement, qui est flux, énergie, diversité. Seront interrogées dans une mise en perspective philosophique et critique les mutations et stratégies architecturales et urbaines amplifiées par le contexte politique du Développement Durable. En cours de préparation : un colloque à l’ENSAPLV au printemps 2010 sur la thématique : « Milieux » - Teknè architecturale et urbaine.
36
Laboratoire Architecture Anthropologie - LA/A Dirigée par Alexia DE BIASE Laboratoire de recherche de l’ENSAPLV 118-130 Avenue Jean Jaurès - 75019 Paris Tél. +33 (0)1 53 72 84 72/73/74 Fax +33 (0)1 53 72 84 78 Site Internet : www.laa.archi.fr/ Les mots clés Anthropologie de la ville, anthropologie de l’espace, architecture comparée, architecture et sociétés, architecture vernaculaire, cartographie, émigration / immigration, Grands Ensembles, habitat individuel, Inter-disciplinarité, histoire urbaine, identités / territoires, Mondialisation, Nouvelles Méthodologies de recherches, Temporalités, Ville, Ville et corps. Le projet scientifique Anthropologie de la ville dans les mondes contemporains La problématique Depuis environ deux décennies, la question des relations entre territoires et identités est au centre d’un débat qui intéresse les sciences sociales, et notamment l’anthropologie, tant d’un point de vue épistémologique que méthodologique : à l’époque de la mondialisation, des territoires différents préfigurent-ils des identités culturelles spécifiques ; réciproquement des identités distinctes appellent-elles des territoires spécifiques ? La méthode utilisée par les anthropologues dans la production de leurs savoirs a longtemps été celle de l’« étude détaillée d’une aire délimitée » (Stocking, 2003). Pendant plusieurs décennies, cette méthode s’est transmise à travers les générations de chercheurs de façon quasi dogmatique et s’est ainsi transformée en une conception « scientifique » du monde selon laquelle un espace géographique, une société et une culture donnés constituent des entités qui se correspondent de manière parfaite. Aujourd’hui, une telle correspondance entre territoire et identité collective ne peut plus être acceptée comme allant de soi, encore moins pour en faire la base consistante sur laquelle ancrer la définition d’une culture ou d’un processus de civilisation. L’idée selon laquelle chaque groupe humain et ses productions culturelles serait localisés dans un espace circonscrit et cloisonné se heurte fréquemment à la réalité d’existences vécues dans plusieurs pays, et à l’existence de réseaux de contact culturel et d’échange économique développés, parfois depuis plusieurs siècles, sur des territoires très vastes et « pluriculturels ». Sans oublier qu’actuellement, les médias électroniques permettent à de nombreux groupes et individus de cultiver des sentiments d’appartenance à des « communautés imaginées » (Anderson, 2002) qui transcendent les frontières
matérielles. Cependant, si beaucoup de travaux ethnographiques montrent que, dans les mondes contemporains, la dislocation – qu’elle soit matérielle ou « virtuelle » - constitue l’un des facteurs principaux de la production du sens, force est de constater que ces mouvements impliquent des espaces de départ, de transit et d’arrivée qui sont souvent chargés de valeur symbolique et imaginaire. Dans ces lieux – et même dans ceux que l’on serait tenté de définir, de l’extérieur, comme des « non-lieux » (Augé, 1999)– les identités et les relations se créent et se transforment de manière originale. Il nous semble aussi important de rappeler que, parmi nos contemporains, nombreux sont ceux qui vivent toute leur vie au même endroit, au sein d’une communauté relativement stable, et qu’une bonne partie de la population de la planète n’a pas accès aux médias électroniques. La mondialisation, alors, concernerait seulement certains secteurs du social, même dans les pays qui en sont le pivot (Augé, 1999). D’après Jonathan Friedman, tout le monde n’a pas « un passé local » ni « un présent global » (Friedman, 2000). Nos contemporains n’ont pas tous cette vision « aérienne » du monde qui fait apparaître la planète « comme un bazar multiethnique » en dislocation perpétuelle et que Friedman attribue à la « vulgate transnationaliste ». Pour beaucoup de groupes humains, les identités se construisent, même aujurd’hui, essentiellement dans une dimension territorialisée. Le local produit encore de la culture, du sentiment d’appartenance et des interprétations du monde même quand il est traversé et en partie façonné par des « flux de culture globale » (Appadurai, 1991). Ces derniers, réélaborés et « traduits » là où ils « atterrissent » fournissent des matériaux symboliques qui souvent contribuent au renouveau des cultures locales et à la permanence de leur spécificité (Hannerz, 1992). « Le fait que les populations qui occupent un lieu singulier, où elles vivent et construisent un monde singulier, sont totalement intégrées dans un système plus vaste (…) » , écrit encore Friedman , « n ‘est pas contradictoire avec le fait qu’elles construisent leur monde là où elles se trouvent et avec les individus qui font partie de leur vie locale ». Comme le soulignent Marie-José Jolivet et Philippe Léna, « La dimension spatiale constitue un support identitaire privilégié » (Jolivet, 2000) même dans le contexte des mondes contemporains, et si dans beaucoup de cas il y a eu un bouleversement « des anciens cadres de référence spatiaux » c’est précisément celui-ci qui nous pousse à regarder de près et à analyser les « nouvelles articulations entre le spatial et le social [qui] sont élaborées [et] qui mettent en question les formes classiques, les dépassent et les transforment », (Jolivet, 2000).
37
Le parti pris scientifique : pour une anthropologie de la ville Pour réaliser ce projet scientifique nous sommes obligés de nous situer aussi du point de vue épistémologique dans le débat soulevé par l’anthropologie des mondes contemporains autour de l’importante distinction entre « anthropologie de la ville » et « anthropologie dans la ville » (Augè, 1994, Agier, 1999). Cette dernière s’occupe principalement des groupes sociaux ou ethniques dans la ville en les analysant d’une manière « classique » – c’est-à-dire, selon la poétique de « l’étude intensive d’une aire délimitée » (Stocking, 2003)– et en produisant, ainsi, des « études de communauté ». Dans ce cadre, la ville (ou l’architecture) n’est que la scénographie des phénomènes à explorer. L’anthropologie de la ville, en revanche, prend en considération la ville dans sa totalité, i.e dans sa forme réelle (ou imaginaire), spatiale et temporelle. Cette vision, que nous adoptons, fait de la ville non pas un simple cadre des interactions d’un groupe étudié, mais surtout, un objet complexe fait d’espaces et de temps continuellement imaginés, projetés, détestés, rêvés et aimés par les gens qui les habitent (en sens large). La forme urbaine et architecturale devient alors l’objet central des récits et des analyses. Pour cela, l’interdisciplinarité nous apparaît comme le moyen nécessaire pour atteindre la complexité des villes contemporaines face à la mondialisation. Une posture interdisciplinaire L’interdisciplinarité permet aussi de ne pas perdre de vue notre objet urbain ou architectural, face à de faciles « glissements disciplinaires » qui mènent parfois à une « amputation » du dialogue avec les autres disciplines en empêchant ainsi la construction d’un langage commun. Cette situation n’étant jamais figée, mais en continuelle évolution, on cherchera ainsi à explorer différentes possibilités de décrire, représenter et analyser la ville contemporaine aujourd’hui à travers l’aide des outils classiques ou nouveaux, issus des différentes disciplines, en les réemployant chaque fois au mieux des circonstances exigées par le terrain (de la cartographie au documentaire, en passant par l’entretien le langage hypertextuel du WEB, ou d’autres formes à explorer). Grâce aux expériences des dernières années nous avons pu évaluer le défi scientifique et nous y avons retrouvé la meilleure manière pour atteindre nos enjeux. Les trois axes thématiques L’étude du rapport entre territoires, identités, et leur traduction urbaine et architecturale, d’une part, et la réflexion sur la construction d’une culture spatiale, d’autre part, qui a caractérisé le travail de notre équipe dans les dernières années, nous a amené à formuler pour la période 2005-2009, une même problématique générale, articulée et déclinée en trois axes thématiques, complémentaires, afin de mieux mettre en correspondance les différents points de vue qui la structure :
Axe 1 - Architectures et villes face à la mondialisation Coordination : Alessia de Biase La problématique Cet axe prend ses sources dans les réflexions de notre équipe tant autour du rapport entre identités et territoires dans les mondes contemporains qu’autour de la volonté de construire les cultures spatiales, afin de repérer, aujourd’hui, les conditions d’émergence et de transmission gouvernant, actuellement, la dynamique de leurs transformations (ou de leur persistance). Les recherches - 2005 – 2009 - La régularité de l’espace chinois Recherche menée par Jean-Paul Loubes - 2005 – 2009 - Topographie sacrée. Le recyclage des sites sacrés au Turkestan chinois Recherche menée par Jean-Paul Loubes - Architectures et Villes globales : identités et territoires dans les mondes contemporains HDR d’Alessia de Biase à l’EHESS - 2005-2009 - Autour de Ikea : mondialisation de l’imaginaire de l’habiter Recherche menée par Alessia de Biase, Christina ROSSI, Maria Anita Palumbo, Virginie Thomas et Adriana Soldati - 2005-2009 - Les architectures « sans auteurs » dans le Nord-Est de l’Italie : l’apparition du style néo-régionaliste dans le périurbain Recherche menée par Christina Rossi - Mutation territoriale : la métropolisation de la région du bas Yangzi (Chine) Recherche menée par Zhang Liang - 2005-2009 – Le modernisme dans l’émergence des projets architecturaux et d’urbanisme en Chine contemporaine Recherche menée par Zhang Liang - 2005-2009 – Les processus de construction du «chez soi» dans la ville contemporaine Recherche menée par Benoîte Decup-Pannier Axe 2 – Le travail du temps dans la ville contemporaine Coordination : Alain Guez La problématique Vers une approche spatiale et temporelle de la ville contemporaine La ville contemporaine par les signes, les permanences, les projets qui anticipent et dessinent l’avenir constitue un espace d’expérience du temps des points de vue symboliques, fonctionnels, et sensibles.
38
La ville peut être interprétée comme un territoire en commun, qui, dans sa forme contemporaine, s’inscrit dans une complexe articulation entre le proche et lointain, autant spatialement que temporellement. La ville contemporaine pour habiter le temps Si la ville contemporaine présente des enjeux en termes organisationnels, elle est aussi constituée d’un ensemble de lieux construits historiquement constituant des repères dans l’histoire de l’humanité et des civilisations. Ceci étant, bien que les bâtiments soient considérés dans notre culture occidentale comme des structures stables, la permanence des espaces urbains et des objets architecturaux est en fait soumise à des stratégies de mémorisation-transmission qui nous informent, selon les époques, sur les valeurs et conceptions respectives du passé et du futur : les transformations en cours, aujourd’hui observables, nous informent sur notre modernité contemporaine. La transformation de la ville et la fabrication de l’architecture sont sous-tendues par des conceptions du temps qui questionnent notre être et notre habiter le temps. Le présent se dessine dans la transformation de la ville La ville contemporaine est ici pensée comme un territoire en projet où les transformations conçues et impliquant différents acteurs, agissent comme révélateur de propositions ou prises de position visant à instaurer une relation entre l’homme et son histoire, l’homme et son avenir, l’homme et son quotidien. Cette « périodisation » artificielle est en fait vécue synchroniquement (de manière con-temporaine) par chacun de nous dans un présent plus ou moins épais où cohabitent passé, présent et futur. L’architecture et l’urbanisme font partie, dans notre société, des outils à travers lesquels cette épaisseur se construit, traduisant, selon les idéologies, les savoirs, les philosophies, des orientations du présent plutôt tendu vers le passé, vers l’avenir ou encore des réductions de l’horizon temporel au seul présent instantané comme valeur absolue du présent. Dans cette perspective, les transformations de la ville contemporaine nous informent sur l’état du présent tendu entre espace d’expérience et horizon d’attente (Koselleck , 1979). L’histoire de l’architecture et de l’urbanisme contemporain peut être relue comme un ensemble de propositions alternatives d’inscription de l’homme moderne dans le présent à travers différentes formes de processus et d’objets relationnels définis non seulement spatialement, mais aussi temporellement. Explorer le travail du temps dans la ville contemporaine revient à travailler dans une complexité qui appelle des regards différents. Nous entendons ici par travail du temps le modelage par l’homme, à travers la transformation de la ville, d’un monde réel et imaginé.
Cette hypothèse suppose d’identifier des situations différentes, mais comparables entre elles, et de mobiliser des regards qui permettront de mieux comprendre qui modèle le présent et comment celui-ci est envisageable à travers les alternatives proposées dans les cas étudiés par les projets de recherches du Laa. Cet axe de recherche est pluridisciplinaire : il s’agit de comprendre les dispositifs culturels, politiques, économiques, esthétiques,… qui sous-tendent des transformations en cours et d’en analyser les conceptions et les rapports au temps qu’elles présupposent. Cette exploration sera élaborée transversalement, tant à travers les différentes intentions de recherche exprimées par les chercheurs, que par les recherches commandités, les réponses aux appels d’offres et les actions menées dans les prochains quatre ans au sein du LAA : Les recherches - 2005-2009 – Les nouveaux « écosystèmes urbains » asiatiques Recherche menée par Olivier Boucheron - 2005-2009 – L’heure de la Renaissance ? Le logement social entre processus de destruction et patrimonialisation Recherche menée par Valérie Fourcher-Dufoix Axe 3 – Nouvelles méthodes pour les territoires contemporains La méthodologie comme objet scientifique et la perspective interdisciplinaire Coordination : Christina Rossi Un axe de recherche transversal Cet axe est né de la volonté de capitaliser nos expérimentations méthodologiques passées et futures Comment approcher, analyser et décrire la ville aujourd’hui ? Notre hypothèse de travail est que la ville est, dans son essence, un objet interdisciplinaire, impossible à approcher avec un seul regard. A partir de là, la méthode pour construire un dialogue et un travail interdisciplinaire devient elle même un objet scientifique. Le but de cet axe est d’entamer un travail de réflexion systématique sur les méthodes et sur les dispositifs d’enquête utilisés par les membres de l’équipe lors de leurs recherches. Cela permettra de « capitaliser » les expériences et les connaissances en tant qu’équipe de recherche, non seulement sur le plan des contenus, mais aussi dans le domaine méthodologique.
39
La problématique La création de cet axe de recherche est liée au double constat de la complexité des territoires contemporains et de l’insuffisance des paradigmes théoriques et méthodologiques disciplinaires, dans leur acception classique « pure », face à la mondialisation et à ses facettes multiples, contradictoires et mouvantes. Nous pensons que de tels objets, pour être cernés, analysés et interprétés, nécessitent un renouveau méthodologique qui se joue à la fois à l’intérieur de chacune de nos disciplines d’appartenance (l’anthropologie, l’architecture, l’urbanisme, la sociologie…) et à la fois dans le dialogue étroit entre ces disciplines. Plus précisément, il s’agit, d’une part, de garder la spécificité des différentes approches méthodologiques disciplinaires tout en ayant « le courage » de les réinterpréter pour les rendre opérationnelles face aux défi de la complexité des mondes contemporains, et, de l’autre, d’embrasser une perspective méthodologique interdisciplinaire. Perspective enrichissante car elle pose l’objet de recherche en tout premier plan et l’aborde, ensuite, par une pluralité de points de vue et de dispositifs d’enquête. Ainsi, dans le cadre de notre parti pris scientifique concernant l’anthropologie de la ville, par exemple, nous souhaitons contribuer à la recherche de solutions aux problèmes méthodologiques posés, déjà à l’époque de l’Ecole de Chicago, par le décalage existant entre l’ambition de cerner la ville en tant que totalité et les dispositifs d’enquête propres à l’anthropologie, conçus au départ pour l’étude de petites communautés (Rossi, 2003). Pour ce faire, nous entendons approfondir, affiner, systématiser et valoriser les acquis méthodologiques issus de certaines de nos expériences de recherche récentes, à savoir, entre autres, la pratique de terrain en équipe (et non pas en solo, comme le prescrit la tradition malinowskienne) (Ulf, 1983), l’utilisation du dessin sur fond plan lors des entretiens et la collaboration étroite avec des chercheurs et des praticiens architectes et urbanistes. Dans le cadre de la recherche Tranche de ville : habiter Paris ou comment apprécier la qualité de la vie urbaine à Paris ?, ces choix méthodologiques nous ont permis, d’une part, de mener le travail ethnographique sur un territoire urbain physiquement et socialement vaste et, de l’autre, d’aboutir à des résultats originaux grâce, notamment, à la mise au point d’une méthode de travail interdisciplinaire dans laquelle les outils de recherche des anthropologues et des architectes urbanistes ont dialogué de manière féconde. Les membres - Christelle Robin, psychologue, docteur en sociologie, membre fondateur, responsable scientifique du LA/A depuis 1986, maître-assistante classe exceptionnelle
- Alessia De Biase, architecte, docteur en anthropologie, responsable scientifique du LA/A depuis 2003, maître-assistante en SHS à l’ENSA de Belleville ; - Jean-Paul Loubes, architecte, docteur en anthropologie, chercheur membre depuis 1990, maître-assistant à l’ENSA de Bordeaux et enseignant à l’EHESS ; - Christina Rossi, docteur en anthropologie, chercheur membre depuis 2004, vacataire en SHS à l’ENSA de Belleville ; - Alain Guez, architecte, docteur en planification territoriale et environnementale, chercheur membre depuis 2005, maître-assistant en VT à l’ENSA de Nancy ; - Liang Zhang, architecte, docteur en architecture, chercheur membre depuis 2005, maître-assistant associé en TPCAU à l’ENSA de Belleville ; - Olivier Boucheron, architecte, DEA en géographie culturelle, chercheur membre depuis 2005 ; - Benoîte Decup-Pannier, sociologue, DEA en sociologie, chercheur membre depuis 2006, vacataire en SHS à l’ENSA de Belleville ; - Valérie Foucher-Dufoix, politiste, docteur en sociologie, chercheur membre depuis 2006, maître-assistante en SHS à l’ENSA de Clermont-Ferrand ; - Nava Meron, architecte, DEA en urbanisme, chercheur membre depuis 2006, vacataire en SHS à l’ENSA de Belleville ; - Paola Berenstein-Jacques, architecte-urbaniste, docteur en histoire de l’art, chercheur associé depuis 2005, professeur à la Faculté de l’Université Fédérale de Bahia ; - Rozenn Kervella, ingénieur en génie civil, architecte, chercheur associé depuis 2006 ; - Luis Lopez, docteur en sociologie, chercheur associé depuis 2006, maître-assistant en SHS à l’ENSAPLV ; - Virginie Thomas, architecte, architecte d’intérieur, chercheur associé depuis 2006 ; - Nadja Monnet, ethnologue, chercheur associé depuis 2007 ; - Sandra Parvu, architecte et docteur en études urbaines, chercheur depuis 2007, enseignante de projet en « Architecture et Paysage » à l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève, Suisse . - Piero Zanini, architecte et chercheur en sciences humaines et sociales, chercheur depuis 2007, enseignant associé à la Faculté d’architecture « Aldo Rossi » - Cesena, Université de Bologne, Italie ; - Alice Sotgia, historienne, docteur en urbanisme, chercheur associé depuis 2008 ; - Barbara Morovich, docteur en anthropologie, diplômée en archéologie, chercheur associé depuis 2009, maître-assistante titulaire à l’ENSA de Versailles.
40
Les doctorants - Adriana Caula, doctorante en urbanisme à l’Université Fédéral de Bahia – PPG-AU - Maria Anita Palumba, doctorante à l’EHESS/LA/A - Monique Sanches Marques, doctorant en urbanisme à l’Université Fédéral de Bahia – PPG-AU - Eduardo Teixera De Carvalho, doctorant en urbanisme à l’Université Fédéral de Bahia – PPG-AU - Etienne Delprat, doctorant à l’EHESS/LA/A - Guilia Mensitieri, doctorante à l’EHESS/LA/A Les invités 2007-2009 : - Eric La Casa, artiste sonore - Thierry Lafont, danseur et chorégraphe Les publications - Sous la direction de A. Berque, A. de Biase et Ph. Bonnin L’habiter dans sa poétique première Actes du colloque de Cerisy-la-Salle Editions donner lieu, 2008 - Sous la direction de A. De Biase et Ph. Bonnin L’espace Anthropologie L’abécédaire anthropologique de l’architecture et de la ville Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, n°20-21, mars 2007.
41
Laboratoire Espaces Travail - LET Dirigé par Thérèse EVETTE Laboratoire de recherche de l’ENSAPLV Site Internet : www.let.archi.fr/ Direction scientifique Thérèse Evette Membre de l’école doctorale Ville Environnement Tête du réseau scientifique thématique RAMAU Activités et métiers de l’architecture et de l’Urbanisme Le domaine de recherche Architecture, urbanisme, sociologie, espaces de travail, facilities management, usages, métiers de l’architecture, acteurs et processus de conception architecturale et urbaine, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, images et savoirs. Les programmes et actions de recherche Le programme scientifique du LET porte sur l’étude des modes de pensée et d’action des différents groupes sociaux impliqués par la conception, la production et la gestion de l’espace construit et aménagé. Sa problématique insiste sur les jeux de représentations, de langages, de modèles ou de médiations qui s’y déploient. La notion de "travail d’architecture et d’urbanisme" cristallise les travaux actuels du laboratoire. Il s’intéresse aux activités de conception architecturale, urbaine ou paysagère, considérées comme ensemble des pratiques qui concourent à la définition des projets. Focalisés sur les acteurs de la conception, nous prenons en compte les relations de ceux-ci avec l’ensemble des milieux concernés par les projets, et notamment leurs destinataires, ainsi qu’avec les objets ou aménagement produits. Le LET étudie l’organisation des activités, à l’échelle individuelle et collective, les coopérations, concurrences et négociations qui marquent l’élaboration des projets, leur mise en œuvre et leur réception. Insister sur le travail d’architecture et d’urbanisme, c’est étudier ses cadres matériels et de pensée, les savoirs et les outils, les compétences et répertoires d’action mobilisés, ainsi que les réseaux et collectifs au sein desquels il se déploie. C’est aussi s’interroger sur la construction de ces savoirs et compétences, leur capitalisation et leur circulation. Les axes de recherche - Conception, usages, expériences - Images et médiations architecturales et urbaines - Identités et polarités professionnelles
Les actions en 2008 - Le projet architectural durable négocié : pratiques, compétences, valeurs, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du territoire - Plan Urbanisme Construction et Architecture Appel d’offres : « Le projet négocié ». Responsable scientifique : Christophe Camus, LET, ENSA de Paris La Villette Equipe de recherche : Christophe Camus, Olivier Chadoin, Béatrice Durand, Michael Fenker, Isabelle Grudet, Bendicht Weber. - Collectifs d’actions artistiques, constitution mémorielle et identitaire de la ville et du territoire Plan Urbanisme Construction et Architecture Responsable scientifique : Isabelle Genyk, avec Elise Macaire. L’expertise Le LET produit les statistiques de la profession d’architecte, ainsi que diverses études sur les activités professionnelles des architectes, pour le Ministère de la Culture et de la Communication, Sous direction Architecture et Cadre de vie. Les membres - Thérèse Evette, docteur en sociologie, habilitée à diriger des recherches, directrice scientifique du LET, professeur à l’ENSAPLV - Christophe Camus, docteur en sociologie, maître assistant à l’ENSA de Bretagne. - Olivier Chadoin, docteur en sociologie, maître assistant à l’ENSAPLV. - Enrico Chapel, architecte, docteur en projet architectural et urbain, maître-assistant à l’ENSA de Toulouse. - Michael Fenker, architecte, docteur en sciences de gestion, ingénieur de recherche du Ministère de la Culture et de la Communication. - Isabelle Genyk, architecte DPLG, docteur en architecture, maître-assistant associé à l’ENSA de Normandie. - Isabelle Grudet, architecte DPLG, docteur en architecture, ingénieur de recherche du Ministère de la Culture et de la Communication. - Denis Plais, architecte DPLG, DES de gestion des entreprises, diplômé de l’Institut d’administration des entreprises (IAE Lyon - Université Jean-Moulin), maître-assistant à l’ENSA de Lyon.
42
- Claudio Secci, architecte, docteur en projet architectural et urbain, maître-assistant à l’ENSAPLV - Mathilde Silvan, architecte diplômée d’État, chercheur contractuelle - Serge Wachter, économiste, habilité à diriger des recherche, professeur à l’ENSAPLV Les chercheurs associés - Keith Alexander, Salford University, Royaume Uni - Jan Åke Granath, Chalmers University, Suède - François Lautier, docteur en sociologie, habilité à diriger des recherches, enseignant de 1967 à 2007 à l’ENSA de Paris La Villette - Göran Lindahl, Chalmers University, Suède - Thierry Mandoul, architecte DPLG, docteur en architecture de Paris 8, maître assistant à l’ENSA de Paris Malaquais. Les doctorant(e)s - Marwan Alkhouli, architecte, DEA (Ambiances Architecturales et Urbaines) - Marie Bels, architecte DPLG - Elise Macaire, architecte DPLG, master de sociologie (EHESS) - Noura Arab, architecte Les formations Master et la formation doctorale - Master architecture et parcours recherche dans les écoles d’architectures. - Encadrement doctoral dans l’école doctorale Ville Environnement. - Master "Etudes Sociales : Travail et Développement", Mention : "Travail, Administration et Gestion Sociale", Spécialité : "Organisation du Travail et Ergonomie", Paris 1 Panthéon-Sorbonne – ENSAPLV. Les collaborations scientifiques Le LET est tête du réseau de recherche et d’information Activités et métiers de l’architecture et de l’urbanisme : Ramau, réseau de la recherche architecturale et urbaine (Responsables : Thérèse Evette, François Lautier). A vocation européenne, il a pour but d’organiser les échanges entre chercheurs et avec les milieux professionnels. Il aborde les questions de l’évolution des activités et métiers dans une perspective interprofessionnelle et interdisciplinaire. Il développe un centre de ressources sur Internet (www.ramau.archi.fr).
En outre, au long des recherches sur les espaces de travail, le LET a établi des relations avec un certains nombre d’unités de recherches françaises et étrangères. Il participe ainsi à plusieurs réseaux de recherche européens et notamment EuroFM et le réseau Usability (CIB Working commission W111), ainsi qu’à des séminaires internationaux (par exemple, actuellement : Facilities innovation in the workplace seminars). Les publications - Christophe Camus, "De l’intérêt des pseudo critiques de réalisations architecturales pour l’architecture", dans A. Deboulet, R. Hoddé, A. Sauvage, La critique architecturale. Le jugement et après, Editions de la Villette, 2008. - Enrico Chapel, "Le dessin urbain entre conception et concertation", in Tsiomis (Y.), (éd.), Matières de ville. Projet urbain et enseignement, Paris, éditions de La Villette, 2008. - Enrico Chapel, Thierry Mandoul, "Lacaton et Vassal, che radicali!", Il giornale dell’architettura, n° 69, janvier 2009. - Thérèse Evette, Véronique Biau, « Activités et métiers de l’architecture et de l’urbanisme : recherche et dispositifs réflexifs », Annales de la Recherche Urbaine, n°104, avril 2008. - Michael Fenker, Hubault (F.), «La conception architecturale tournée vers la relation de service : nouvelles questions ergonomiques» actes du 43ème congrès de la SELF Ergonomie et conception – concevoir pour l’activité humaine, 2008, pp. 308-315. - Elise Macaire, sous la direction de Violaine Appel, Cécile Bando, Hélène Boulanger, Gaëlle Crenn, Valérie Croissant, Bénédicte Toullec, Ville, art et politique : un nouveau champ d’action pour les architectes, in La mise en culture des territoires. Nouvelles formes de culture évènementielle et initiatives des collectivités locales, Presses Universitaires de Nancy, 2008. - Bendicht Weber, «Urbanité et processus local. L’exemple des Brichères à Auxerre, France », in E. Raith, E. Leitner, V. Ziegler (dir.), Urbanité mon Amour. International Workshop Vienna Austria, Vienne, Technische Universität, 2008, pp. 148-159. - Bendicht Weber, Pierre Bouché, «Habitat et projet urbain», in Yannis Tsiomis (dir.), Matières de la ville. Enseigner le projet urbain, Paris, Editions de la Villette, 2008, pp. 110-116.
43
Les rapports de recherche - Olivier Chadoin, Thérèse Evette, La mesure des activités d’architecture : Problèmes, enjeux et perspectives., DAPA, décembre 2008. - Enrico Chapel, avec Sophie Cordier, Les images d’architecture entre politiques et formes urbaines. Analyse de l’îlot 13 de la ZAC Andromède, ENSA de Toulouse, EPAU-GIP, POPSU, mars 2008. - Isabelle Genyk, dir., Elise Macaire, Rapports Collectifs d’action artistique et projets de renouvellement urbain, Programme interministériel de recherche « Cultures, villes et dynamiques sociales », programme territorialisé Rhône-Alpes, PUCA, rapport intermédiaire, octobre 2008. Les communications - Olivier Chadoin, « Architecture et sociologie : matériau pour un croisement disciplinaire », communication au colloque de la Société Française d’Histoire des Sciences de l’Homme, Mai 68, creuset pour les sciences de l’Homme, avec Jean-Louis Violeau, 11 septembre 2008. - Olivier Chadoin, « Matériaux et conditions d’une sociologie de l’architecture : pour une socio-histoire de la rencontre des entre sociologie et architecture », communication pour le forum de ISA-Forum of sociology, committee 37, La sociologie de l’art et de la culture : vers une sociologie publique, Barcelone, 5-8 septembre 2008. - Olivier Chadoin, « Les vertus de l’indétermination : une sociologie du travail professionnel des architectes », communication au séminaire « Anthropologie, ville et architecture » (coord. Alban Bensa, Miguel Mazeri), IRIS-EHESS, 12 mars 2008. - Olivier Chadoin, « Une sociologie du travail professionnel des architectes », communication au séminaire de recherche en sciences sociales (coord. Pascale Moulevrier et Hélène Desfontaines), Université Catholique d’Angers, 4 mars 2008. Olivier Chadoin, « Les chassés-croisés du sujet et de l’objet dans la pensée urbaine », texte pour le colloque international « Villes et liens sociaux », Université de Sfax, Département de sociologie, 6,7 et 8 mars 2008. - Michael Fenker, « Working with architecture – a continuous learning process between the use and the design of buildings », communication au séminaire Architecture and social architecture, European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Bruxelles, 15-16 mai 2008.
- Michael Fenker, « Expérience et légitimité des acteurs dans des situations de coopération ; le cas des opérations immobilières complexes », communication au séminaire Pouvoir d’agir et autorité dans le travail, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2 – 4 juin 2008. - Michael Fenker, « Organisational learning, design processes and the usability of buildings », communication au 7ème EuroFM research symposium, Manchester, 10 – 11 juin 2008. - Michael Fenker, « L’open space - quelle place pour le vécu des utilisateurs », communication au séminaire Faut-il fermer les open space, Actinéo, 19 novembre 2008. - Isabelle Grudet, « Pierre Lavedan. L’histoire de l’urbanisme et sa réception », , séminaire « Idéologies et pratiques de l’urbanisme aux 19ème et 20ème siècles », EHESS, 5 mars 2008. - Isabelle Grudet, « Références à la sociologie chez quelques architectes enseignants des années 1920 aux années 1960 », 2 avril 2008. - Elise Macaire, "Des architectes à l’épreuve de la participation", colloque « Ville éphémère / ville durable. Quels acteurs pour la ville de demain ? », 2ème colloque de l’Ecole doctorale « Ville et Environnement », le 17 janvier 2008. L’organisation de colloques et de séminaires - « Architecture et Facilities Management. La conception face à la montée des services », 17 et 18 avril, INHA Paris, atelier international organisé en partenariat avec le réseau RAMAU, et avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication et du Plan Urbanisme Construction Architecture, PUCA (MEDAD). Responsables scientifiques : Michael Fenker et François Lautier. - «Des sociologues chez les architectes, 1968-2008 : histoire(s) d’une rencontre», coordination Olivier Chadoin. - Participation à l’organisation scientifique du colloque de l’école doctorale de janvier 2008 « Ville éphémère, ville durable » et au journées de juillet 2008 «Ville et aménagement», Thérèse Evette, responsable du thème Démarches de conception.
44
Le RAMAU - Réseau Activités et métiers de l’architecture et de l’urbanisme Le Ramau est un réseau scientifique thématique de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, habilité par la direction de l’architecture et du patrimoine, ministère de la culture et de la communication. Il s’intéresse aux activités de conception des projets architecturaux, urbains et paysagers, dans leurs relation à la commande et à la réalisation et dans une perspective interdisciplinaire et interprofessionnelle Il a pour objectif : - de capitaliser et de diffuser les travaux disponibles dans son champ, en particulier à travers un centre de ressources électronique www.ramau.archi.fr - d’engager des réflexions collectives entre chercheurs, en liaison avec des professionnels pour proposer des actions coordonnées de recherche qui fassent progresser la connaissance et éclairent les pratiques professionnelles. Il organise des ateliers de travail et des séminaires «Les rencontres Ramau» qui donnent lieu à des publications aux Editions de La Villette, dans la collection des Cahiers Ramau. Le site www.ramau.archi.fr Le centre de ressources sur Internet du réseau Ramau réunit une importante documentation sur les activités et les métiers de l’architecture et de l’urbanisme. Cette documentation est organisée en trois grands domaines : - les métiers, - la recherche - et la formation. Il propose des rubriques d’actualité de la recherche, une revue de presse et un agenda des évènements liés à la recherche et aux activités professionnelles. Il édite une lettre d’information trimestrielle.
45
5. Les relations internationales L’ENSAPLV est une école profondément ouverte sur les relations internationales. Outre le nombre très important d’étudiant(e)s étranger(e)s qu’elle accueille, elle entretient de longue date des relations suivies avec une centaine d’écoles ou universités d’architecture dans le monde. Ces partenariats se traduisent par des mobilités d'étudiant(e)s, des missions d'enseignant(e)s de courte durée qui permettent de créer ou de renforcer les relations institutionnelles et des ateliers internationaux de confrontation pédagogique pouvant donner lieu à des formations conjointes. Durant l’année 2007-2008, le programme Erasmus ayant offert aux établissements d’enseignement supérieur la possibilité à leur personnel d’effectuer une mobilité de formation, l’ENSAPLV a réservé cette ouverture à son personnel administratif. Cette volonté a permis à trois agents administratifs de confronter leur expérience professionnelle avec celle des universités partenaires européennes. a. La Commission des Relations Internationales – CRI Durant l’année 2008, la Commission des Relations Internationales (CRI) a organisé son travail avec la volonté d’ancrer l’offre d’enseignement de l’établissement dans une politique de relations internationales. Cette volonté a été réaffirmée par le Conseil d’Administration le 4 avril 2008. La CRI a mené ses réflexions en liaison avec la CPR lors de la compagne d’habilitation des programmes d’enseignement. A l’ENSAPLV, chaque étudiant(e) inscrit(e) bénéficiera obligatoirement dans sa scolarité d’au moins de deux temps forts de mise en situation de confrontation avec le contexte international : - en première année de premier cycle, un voyage d’études est organisé pour toute la promotion dans une aire urbaine européenne ; en 2008 il s’est déroulé du 23 au 26 février au Pays-Bas ; - en second cycle, les étudiant(e)s doivent valider un enseignement au minimum dans le cadre d’échanges internationaux, soit en effectuant un séjour d’études de longue durée à l’étranger dans le cadre de conventions d’échanges d’étudiants, soit en participant à des ateliers internationaux ou activités pédagogiques s’inscrivant dans des partenariats établis.
Le voyage d’études de première année de premier cycle En 2008, l’ENSAPLV a organisé pour la promotion entière de première année un voyage d’études aux Pays-Bas autour de la thématique commune du logement. Les 254 étudiant(e)s de la promotion ont bénéficié d’un encadrement pluridisciplinaire composé de 22 enseignant(e)s articulé autour des groupes de projets, des enseignant(e)s de démarches plastiques, de sciences humaines et de construction. Ensemble, ils ont défini un programme spécifique par groupe. Les déplacements ont été faits en autocars. Le travail de l’étudiant(e) durant le voyage et à posteriori par la réalisation notamment d’un carnet de voyages a donné lieu à une évaluation intégrée au contrôle continu des unités d’enseignement du deuxième semestre. A l’occasion de ce voyage, une visite de l’académie d’Architecture d’Amsterdam (établissement d’enseignement partenaire de l’ENSAPLV dans le cadre du programme Erasmus) a été organisée. La sensibilisation à l’international des étudiant(e)s par le renforcement de l’enseignement des langues vivantes Un enseignement obligatoire de langue vivante a été introduit dès la première année du premier cycle. Le choix offert aux étudiant(e)s correspond à une poursuite de l’enseignement des langues reçu par l’étudiant(e) au lycée, en orientant ses apprentissages vers l’expression écrite et orale dans le domaine de l’architecture. L’objectif pédagogique de cet enseignement est d’amener l’étudiant(e) à présenter dans une langue étrangère ses compétences en architecture. A l’issue de ces trois années d’apprentissage, l’étudiant(e) recevra un certificat attestant certifiant de son niveau de maîtrise d’une langue étrangère dans l’analyse, le commentaire et la présentation du projet d’architecture.
46
Les enseignements internationaux de second cycle La CRI est intervenue, à la demande des instances de l’ENSAPLV dans le choix des enseignements internationaux aidés par l’établissement et proposés aux étudiant(e)s inscrits principalement en second cycle. En effet, les étudiant(e)s n’effectuant pas de séjours d’études de longue durée ont accès à des enseignements internationaux de projets prévoyant l’organisation d’ateliers européens (programmes intensifs Erasmus) ou internationaux mettant en présence sur un sujet choisi en commun plusieurs équipes d’étudiant(e)s encadré(e)s de leurs enseignant(e)s pendant deux semaines. Ces ateliers s’inscrivent dans des partenariats développés durablement par l’ENSAPLV et permettent aux équipes d’encadrement de confronter leurs démarches pédagogiques dans la perspective à terme de création en commun de formations diplômantes. Ces ateliers se déroulent soit à l’étranger, soit au sein de l’ENSAPLV et sont détaillées ci-après. Le Projet de Fin d’Etudes (PFE) L’ouverture de groupes de PFE aux étudiants inscrits en seconde année du deuxième cycle à l’ENSAPLV en échange à l’étranger dont la thématique d’études s’apparente à celle des groupes de PFE et dont le suivi dans l’université partenaire répond aux exigences du PFE de l’ENSAPLV, le jury de soutenance pouvant intégrer dans ses membres l’enseignant de l’université partenaire ayant suivi l’étudiant durant son séjour d’études à l’étranger. Certains de ces groupes pourraient également accueillir des étudiants étrangers en échange en seconde année du deuxième cycle, la délivrance du diplôme dans ce cas incombant à l’université d’origine. Cette activité pédagogique permettrait avec l’aide Erasmus prévue pour la mobilité des enseignants d’élargir ainsi les échanges enseignants avec nos universités partenaires, donnant ainsi des lieux de réflexion pouvant conduire à des développements de cursus en commun. Les relations post-diplômes L’ENSAPLV souhaite s’engager vers le développement de formations en commun post-diplômes. Cette démarche a d’ores et déjà été engagée par l’établissement qui participe à la délivrance du Master de spécialisation «management du projet d’architecture complexe» avec l’université de Roma la Sapienza. Par ailleurs, des partenariats déjà anciens permettent aux étudiants diplômés de l’établissement d’effectuer des master de spécialisation à Georgia Institute of Technology – Altanta et des recherches à Osaka Sangyo.
b. La mobilité à l’étranger L’ENSAPLV a accueilli en 2007-2008 135 étudiant(e)s étranger(e)s dans le cadre de programmes de mobilité. 91 étudiant(e)s de l’école ont de leur côté bénéficié de ces conventions d’échanges pour effectuer une mobilité de long séjour à l’étranger (un ou deux semestres). Les séjours à l’étranger sont possibles à l’ENSAPLV dans de nombreux pays d’Europe et\ou dans le monde, soit dans le cadre du programme européen d’éducation et de formation tout au long de la vie (Erasmus) mis en place par la Commission européenne, soit à l'occasion de conventions bilatérales. Ces séjours d'études s'effectuent dans un cadre réglementé et font l'objet d'un contrat approuvé par l'ENSAPLV qui permet à l'étudiant(e) de valider les enseignements suivis à l'étranger dès lors que ceux ci ont reçu la validation des instances de l'université partenaire. Ainsi, que l’étudiant(e) effectue une mobilité en Europe ou hors de l’Europe, l’école et l’étudiant(e) concernés sont liés par les dispositions réglementaires de la Charte Erasmus délivrée par la Commission européenne à l’établissement pour la période 2007-2013. Il faut noter que cette nouvelle Charte élargit ces dispositions aux étudiant(e)s effectuant des stages en Europe. L’objectif pour l’ENSAPLV est, tout en mettant en œuvre les dispositions proposées par la CRI en 2007 quant à la validation du séjour d’études à l’étranger, d’équilibrer à terme les échanges avec chaque institution ou écoles partenaires et de respecter un équilibre dans les nationalités accueillies. Les nouveaux accords Le développement des relations internationales s’est concrétisé par la négociation et la signature de nouvelles conventions avec des établissements étrangers. - l’Ecole d’architecture de Nanjing, de Chongqing et de Tian Jin en Chine. - La Faculté d’Architecture de l’Université Technique de Malaisie (UTM) Johore Barhu - L’Institut Supérieur d’Architecture de la Communauté française La Cambre à Bruxelles - L’école supérieure d’Architecture de Casablanca au Maroc - La faculté d’architecture de Sarajevo en Bosnie-Herzegovine - L’Académie Libanaise des Beaux-Arts – Université de Balamand, Beyrouth, - L’université d’Art et de design d’Helsinki
47
- ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology en Suisse. Et en 2008, - L’école d’architecture de l’université de Tianjin, - L’école d’architecture de l’université du Sud-Est, Nankin, - Le Centre universitaire Ritter dos Reis de la faculté d’architecture et d’urbanisme de Porto Alegre - Gyongsang National University. L’accord liant les universités partenaires doit être renouvelé en 2009 et inclura la Technische Universität München. Des pourparlers sont en cours avec d’autres écoles, notamment l’université de Floride, l’Ecole nationale d’architecture de Rabat (ENA), l’université technique de Fez. Concernant le Japon, la qualité des relations entre les deux coordonnateurs du programme d’échange entre l’Université de Tokyo et l’ENSAPLV a permis d’organiser une activité pédagogique de trois semaines au Japon en juillet 2008 comprenant à la fois un voyage d’études pour l’équipe française, suivi d’un atelier intensif réunissant les 9 étudiant(e)s de l’ENSAPLV et les 11 étudiant(e)s de l’université de Tokyo regroupés en 7 groupes mixtes de travail. L’objectif pédagogique de l’atelier a été d’inciter les étudiant(e)s à réfléchir sur la thématique «développement des villes et préservation du patrimoine architectural». Cette activité pédagogique a été rendue possible grâce à l’investissement des équipes d’encadrement, notamment celles de l’université de Tokyo, et du soutien financier accordé par la fondation du Japon. c. Les activités pédagogiques soutenues par la Commission européenne Charte universitaire Erasmus 2007-2013 - aides à la mobilité étudiante (études et stages) - aides à la mobilité enseignante et administrative - organisation de la mobilité - participation au programme intensif (IP) « Habitat innovant des aires urbaines européennes – relevé d’urbanité » coordonné par l’ENSA de Strasbourg avec les universités de Karlsruhe, Vienne et Bratislava - coordination du programme intensif (IP) « Scénographie et architecture » avec les universités de Lund, Lisbonne, Strathclyde (Glasgow) et Prague
Europe / Japon Poursuite sur financement japonais du projet pilote Europe/Japon AUSMIP (Architecture and Urbanism student mobility programme) préfigurant des échanges de type Erasmus pour des étudiants inscrits en 2ème année de second cycle – Partenariat avec Hogeschool voor Wetenschap & Kunst St Lucas, Bruxelles, Universita Tecnica de Lisbonne, deux départements de l’université de Tokyo, l’université de Chiba et l’université de Kyushu. Asia Link Programme coordonné par l’ENSAPLV dont l’objectif est d’intégrer la demande du paysage dans l’enseignement de l’architecture – Partenariat : Bartlett et les universités de Tianjin et de Chongqing – programme sur trois ans (2005-2008) d’échanges d’enseignants.
Les destinations d’accueil Allemagne (Berlin, Braunschweig, Cottbus, Hambourg, Karlsruhe, Münich), Argentine (Buenos-Aires), Autriche (Graz, Vienne), Belgique (Anvers, Bruxelles, Gand, Liège, Louvain), Bolivie (La Paz), Brésil (Rio de Janeiro, Sao Paulo), Bulgarie (Sofia), Canada (Calgary, Montréal), Chili (Santiago), Chine (Beijing), Corée du Sud (Séoul), Cuba (La Havane), Espagne (Barcelone, La Corogne, Madrid, Séville, Valence), Etats-Unis (San Francisco, Houston), Grèce (Athènes, Thessalonique), Irlande (Dublin), Israël (Haïfa, Jérusalem), Italie (Ancone, Bari, Brescia, Camerino, Florence, Gènes, Milan, Naples, Reggio di Calabre, Rome, Trente, Turin, Venise), Japon (Chiba, Kyoto, Kyushu, Osaka, Sangyo, Tokyo), Macédoine (Skopje), Mexique (Mexico), Norvège (Oslo), Pays-Bas (Amsterdam, Delft, Eindhoven), Pologne (Gdansk, Varsovie), Portugal (Coimbra, Lisbonne), République Tchèque (Prague), Roumanie (Bucarest), Royaume-Uni (Birmingham, Bristol, Glasgow, Oxford), Suède (Göteborg, Lund, Stockholm), Suisse (Zürich), Tunisie (Tunis), Uruguay (Montevideo), Venezuela (Caracas). Des séjours sont également possibles en post-diplôme à Atlanta (Georgia Tech), Osaka, Sangyo et Rome.
48
d. Les programmes internationaux L’école est partie prenante de plusieurs programmes européens : Le programme Asia Link, Europe-Chine “DEVELOPMENT OF AN INTERNATIONAL CURRICULUM OF LANDSCAPE KNOWLEDGE IN ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING EDUCATION” 2006/ 2008 "Développement d’un programme international sur la prise en compte paysagère dans l’enseignement de l’architecture et du projet urbain" pour la promotion d’une coopération en réseau entre institutions d’enseignement supérieur d’Europe et d’Asie sur l’enseignement du Paysage dans les écoles d’architecture. Ce programme d’une durée de 36 mois et d’un coût total de 495 324 euros a bénéficié d’une contribution de la Commission Européenne de 294 817 euros (soit presque 60 % de son budget). L’objectif a été de mettre en place une plate-forme éducative commune prenant en compte les différences culturelles et géographiques à partir d’une analyse et comparaison des programmes, par des échanges d’enseignant(e)s entre la France (ENSAPLV – établissement coordinateur), l’Angleterre (Bartlett School UCL of London) et la Chine (Ecoles d’architectures des Universités de Tianjin et de Chongqing). Ce programme s’est articulé sur l’enseignement du paysage en théorie et pratique dans la conception architecturale, tant en premier et en second cycle qu’en doctorat, l’objectif n’étant pas de lisser les particularités, mais au contraire de les comprendre pour les faire émerger et les promouvoir. Les activités dominantes de ce programme ont été : - L’élaboration d’une stratégie pédagogique pour développer l’enseignement du paysage dans le cadre des programmes d’enseignement des 4 écoles partenaires. Une équipe d’enseignant(e)s a été constituée pour échanger et assurer le développement de principes pédagogiques communs (120 enseignant(e)s ont été directement impliqués et plus de 400 étudiant(e)s ont participé dans les cours d’accueil). - 7 workshops ont été organisés (avec 231 étudiant(e)s niveau master) - 107 cours et conférences ont été donnés à Paris/ Londres/Tianjin et Chongqing - Le renforcement des laboratoires de recherche dans chaque Université partenaire : une mise en commun des travaux et des publications a été effectuée pour favoriser une meilleure compréhension et une capacité d’adaptation de chaque acteur du projet :
- 1 laboratoire de recherche commun a été créé entre l’Université de Tianjin et le laboratoire de recherche AMP de l’ENSAPLV - 2 associations ont été créées «AMP France/chine» (pour permettre et soutenir des recherches entre les universités françaises et chinoises et l’association «AATC» (pour la mise en place de travaux communs entre l’équipe de recherche AMP et l’atelier AA de Tianjin/projet urbain concernant la place centrale du quartier de la Concession Française à Tianjin/ projet d’extension urbaine« The urban Design of Peninsular Diaoyuzui in Daduku district, Chonqqing »). - La recherche de nouveaux partenaires : lors des échanges, les enseignant(e)s ont donné des conférences dans différentes universités et Instituts d’urbanisme pour développer de nouveaux partenariats. Pendant leur séjour dans les écoles étrangères, les professeurs européens, en collaboration avec leurs collègues chinois, ont favorisé la prise en compte des concepts paysagers au niveau de l’industrie de la construction en Chine et inversement (contacts avec les services d'urbanisme de différentes villes chinoises et européennes (7 villes chinoises : Pekin, Tianjin, Chongqing, Tsingtao, Weifang, Qinhuangdao, Penglai / 3 villes françaises : Marseille, Nantes Saint-Nazaire, Paris). - L’organisation de 2 colloques internationaux : «Entre éducation architecturale et paysagère ?» ENSAPLV , Paris (22 et 23 nov 2007) « Between Landscape, Architecture and Urban Planning Education”. Colloque de clôture du programme Asia-Link FAUP, Chongqing (8, 9 et 10 oct 2008). - 19 Universités ont été invitées à participer :
* 4 Universités chinoises (Peking University, Beijing Forestry, Nanjing University, Tsinghua University Département Paysage de l'Institut d'Urbanisme). * 4 académies des Beaux-Arts en Chine (Tiannjin, Chongqing, Qingtao et Hangzhou). * 1 Université japonaise (Université de Kyoto, Département d’Architecture).
49
* 10 Universités ou écoles Européennes : France (Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles ENSP, EHESS, Paris, Ecole d’architecture de Chaillot, Paris, ENSA de Nancy - Italie (Institut Universitaire d’Architecture de l’Université de Venise IUAV, Université Polytechnique Delle Marche Faculté d'Ingénierie d'Ancone) - Allemagne (Université d’Hanovre faculté de Sciences de l’Architecture et du Paysage, Université de Karlsruhe) - Portugal (Université da Beira Interior) – Angleterre (Université de Greenwich). Ces colloques internationaux sur l’enseignement ont élargi le débat, à l'écoute d'expériences d'autres universités européennes et chinoises et ces échanges ont permis d’imaginer concrètement la mise en place de programmes spécifiques à la démarche paysagère dans les universités chinoises et européennes. - La participation à différents programmes internationaux : « City History and Multi-scale Spatial Master-planning International Research Network » Londres (Angleterre) - 11/16 Octobre 2007 - “Dessiner sur l’herbe” IUAV Ecole d’architecture de Venise (Italie) – UNISCAPE 2008 / « Les journées du patrimoine France-Chine » Cité du Patrimoine et de l’Architecture, Palais de Chaillot, Paris (France) 2008 / « Historical Architecture Heritage Preservation and Sutainable Development International Symposium » Symposium international (10/11/12 novembre 2007) Tianjin (Chine) Grâce aux contacts établis durant ce programme, un réseau d'Universités en Chine et en Europe a été constitué, particulièrement intéressées par les problématiques du paysage. L’ENSAPLV s’est appuyée sur ce réseau pour répondre à l’appel d’offres «Erasmus Mundus 2009» (12 universités chinoises et 8 universités européennes partenaires). - 2 Publications « De l'enseignement du paysage en architecture » sous la direction de Arnauld Laffage et Yann Nussaume (480 pages) Editions Paris La Villette (à paraître en mars 2009) « Works of International Studios » sous la direction de Zhang Xingguo et Liu Jun (66 pages) Editions de l’Université de Chongqing (octobre 2008) http://www.paris-lavillette.archi.fr/asialink
Le programme pilote Europe-Japon Architecture and Urbanism Student Mobility - Program en 2006-2007 et 2007-2008 L'ENSAPLV a été retenue par la Commission Européenne pour diriger de 2002/2003 à 2004/2005, un projet pilote de préfiguration des échanges de type Erasmus entre l'Europe et le Japon : AUSMIP (Architecture and Urbanism Student Mobility International Program). Malgré la fin de ce programme et le tarissement du financement du côté européen, certains des partenaires ont décidé de poursuivre leur collaboration pour les années universitaires 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 grâce à des financements exclusivement japonais. Dans un contexte de globalisation économique, le Japon et les pays européens réfléchissent au futur de leurs villes alors que le développement urbain semble prendre des formes différentes dans l'un ou l'autre cas. Le projet offre la possibilité à 2 étudiant(e)s de l'ENSAPLV de partir en mobilité pour sept mois au Japon, à Todai. Les institutions partenaires participant à la poursuite de ce projet pilote sont : 1) du côté européen : L'ENSAPLV, France ; Departement Architectuur Sint-Lucas Brussels, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (W&K), Belgique ; Faculdade de Arquitectura – Universidade Técnica de Lisboa (FA-UTL), Portugal. 2) du côté japonais : Department of Architecture, Graduate School of Engineering, University of Tokyo (TODAI-1) ; Institute of Environmental Studies, Graduate School of Frontier Sciences, University of Tokyo (TODAI-2) : Department of Urban Design, Planning and Disaster Management, Graduate School of Human-Environmental Studies, Kyushu University (KYUDAI).
50
Le Programme Intensif Erasmus Scénographie et architecture symbiose des cultures : de la scène à la ville Quatre écoles et/ou universités d’architecture européennes, Prague, Lund et Lisbonne et l’ENSAPLV se sont réunies afin de créer ce réseau autour de l’enseignement de la scénographie et de l’architecture. Avec le soutien du programme d’échange international de Erasmus, ces quatre établissements européens ont organisé du 13 février au 1er mars 2007 à Prague un atelier intensif auquel huit étudiants de chaque pays ont participé, encadrés par les professeurs des quatre universités. Une expérience qui sera renouvelée chaque année dans une ville européenne différente, et rejoint par de nouveaux partenaires. L’objectif était d’aborder la problématique de la démarche et de la conception du projet architectural et urbain, à travers la création scénographique, ce qui implique un travail sur la culture littéraire, historique, sociale et esthétique de chaque pays pendant trois années consécutives. Ce workshop a démontré les différentes approches des étudiants selon leurs universités et leurs écoles d’origine. Les étudiants tchèques et portugais avaient une approche technique et constructive du bâtiment, les étudiants français et suédois étaient davantage dans la recherche d’un concept. Ces différences d’interprétation ont montré une complémentarité des enseignements des différentes universités. Deux sujets et deux sites ont été proposés comme points de départ du projet scénographique : 1- La musique Vltava (La Moldava) de Bedrich Smetana ; 2- Le théâtre baroque de Cesky Krumlov. Et comme site : 1- Le site du château d’Orlik au bord du lac de barrage de la rivière Vltava ; 2- Le site de Cisarsky Ostrov sur un axe de connexion entre deux châteaux et leurs jardins. Huit groupes ont été composés d’un étudiant de chaque pays. Ces quatre étudiants de nationalités différentes ont travaillé ensemble pendant 15 jours sur 2 projets – scénographie et architecture. La reconnaissance académique des ateliers intensifs s’est fait sous forme de ECTS comptant pour les modules ou unités d’enseignement de chaque établissement. L’ensemble des projets a été présenté à la Quadriennale de Prague, la plus grande exposition mondiale sur la scénographie, du 14 au 24 juin 2007.
Une conférence a été organisée le 16 juin pour la présentation de la démarche, du déroulement et du résultat du workshop. L’ENSAPLV a pris en charge les voyages à Prague des 8 étudiants et 2 enseignants (2411 euros, la prise en charge du séjour et des frais de l’organisation de l’atelier étant assurée par la subvention européenne versée à l’université de Prague coordonnateur de ce premier atelier. L’atelier 2007-2008, dont l’ENSAPLV est coordonnateur s’est déroulé à Lisbonne du 9 au 24 février 2008. Il a réuni 5 écoles et universités européennes, Paris la Villette, Lisbonne, Prague, Lund et Strathclyde University de Glasgow. Le titre de cet atelier intensif était l’île de théâtre- the island theatre of the theatre island. Les étudiants étaient invités à réfléchir sur la place du théâtre aujourd’hui, à l’image d’une île flottante où la fantaisie et l’imagination nous mènent vers des réalités plus utopiques. Les sites proposés étaient à Lisbonne sur le bord du Tage. Les rapports de la ville avec la mer ainsi que les thèmes développés dans le sujet exigeaient une réflexion en relation avec l’eau. Les interprétations analytiques, sensitives ou métaphoriques de ce sujet ont été à la base de projets scénographiques très différents. Le concept spatial de la scénographie a été le fil conducteur d’une proposition architecturale et urbaine. 9 groupes ont été composés d’un étudiant de chaque pays. Ces 5 étudiants de nationalités différentes ont travaillé ensemble pendant 15 jours sur 2 projets – scénographie et architecture. La reconnaissance académique des ateliers intensifs s’est fait sous forme d’ECTS comptant pour les modules ou unités d’enseignement de chaque établissement. L’ensemble des travaux ont fait l’objet d’une exposition dans chaque établissement. A Lisbonne, l’exposition des travaux a été inauguré par une conférence de José Saramago. Les produits de l’IP ont été publiés dans un catalogue et ont fait l’objet d’un CD Rom.
51
Le programme Intensif Erasmus «Habitat innovant des aires urbaines européennes – relevés d’urbanités» Le programme intensif Erasmus «Habitat innovant des aires urbaines européennes – relevés d'urbanité» réunit en partenariat les cinq écoles d’architecture suivantes, le long d’un axe continental européen est-ouest : - Université de Bratislava (Slovaquie) - Université Technique (TU) Wien ( Autriche) - Université de Karlsruhe (Allemagne) - ENSA de Strasbourg - ENSA de Paris la Villette. Dans le cadre de ce programme, sont prévus trois workshops internationaux intensifs de deux semaines, réunissant 40 étudiants et 10 enseignants: après un premier workshop organisé en 2006 à Strasbourg, le deuxième workshop international s’est déroulé en juillet 2008, dans le quartier de Ottakring à Vienne (responsables : E. Raith, E. Leitner). Pour l’ENSAPLV ont participé huit étudiants et deux enseignants (N. Soulier, B. Weber) du DSA architecture et projet urbain. Ce deuxième workshop intitulé « Urbanité mon amour » poursuivait l’approfondissement des questions théoriques et méthodologiques relatives à l’urbanité. Cet atelier intensif à Vienne a été un grand succès en terme d’intensité et d’échanges, et a permis d’approfondir et de comparer des questionnements portant sur la nature des observations, les caractéristiques à retenir, les enjeux en terme d’urbanité. Publication 2008 : rapport comprenant contributions des enseignats (conférences), productions de l’atelier, et film sur DVD réalisé par la TU de Vienne. Le 3ème workshop en 2009 sera organisé sur la base de ces acquis et expériences communes par les enseignants de l’ENSAPLV à Paris/Gennevilliers, et aboutira à un bilan en terme de valorisation et de perspectives d’enseignements communs. e. Les workshops internationaux Par ailleurs, des conventions de collaborations ponctuelles ont également été signées avec d’autres écoles d’architecture, pour des échanges, des workshops, des ateliers intensifs... Plusieurs workshops internationaux ont été organisés en 2008. Le concours de l’Atelier International de l’Architecture Construite Il s’agit d’un atelier international visant à faire travailler ensemble chaque année des étudiant(e)s de diverses universités étrangères (en général 5 ou 6 universités soit
environ 100 étudiants) sur un programme commun pendant un semestre à partir d’une philosophie constructive identique. Celle-ci s’est développée autour des techniques nouvelles SCICL : systèmes constructifs secs et légers constitués de produits manufacturés complémentaires, assemblés de façon mécanique sur le site. Cette coopération s’inscrit dans le pôle de l’enseignement de l’architecture de deuxième année de second cycle cycle «architecture et développement» de l’ENSAPLV. L’encadrement est assuré par Eric Dubosc et Alain Enard, architectes – enseignants de l’ENSAPLV. L’intérêt pédagogique de cette coopération consiste principalement à permettre d’étalonner les différents enseignements, à comparer les niveaux d’acquisition manifestés dans les projets et à ouvrir les étudiant(e)s aux possibilités de coopérations internationales. En mars 2007, l’ENSAPLV a été invitée par le promoteur chinois de Shenzen China Merchants à participer à un concours international. Il s’agit de proposer un bâtiment vert au bord de l’estuaire de la rivière des perles, face à Hong Kong dans le nouveau quartier de Shoku (Shenzen). Le programme comporte des commerces, des bureaux et des équipements culturels. Le jury présidé par M. LI Dexiang, doyen de la Faculté d’architecture de l’Université de Tsinghua à Beijing (RP de Chine), de personnalités extérieures et du Directeur de l’ENSAPLV s’est déroulé dans l’école en octobre. Les échanges entre la Faculté d’architecture n’°1, Ludovico Quaroni, La Sapienza Rome et l’ENSAPLV Cet atelier intensif de projet a réuni à Rome en mai 2008, en équipes mixtes, 15 étudiant(e)s de première année de second cycle du pôle Architecture, Arts et Philosophie ("Les conceptions urbaines du projet d'architecture Processus critiques") et 10 étudiants de 5ème année du Dipartimento CAVEA (Dipartimento di Caratteri dell'Architettura, Valutazione et Ambiente), Faculté d'architecture n°1, Ludovico Quaroni, La Sapienza Rome. Le thème de projet était "Architecture contemporaine et archéologie". L'objectif était de mettre en question la normativité des politiques patrimoniales par une pratique de projet en site archéologique. Le programme du projet était l'accès sud du Forum d'Auguste. Deux enseignants de l’ENSAPLV et trois enseignants de la Faculté ont encadré les équipes de projets, et les visites d’architecture. Cet atelier a été présenté et préparé au sein du pôle AAP par l'intervention d’un enseignant de Rome en groupe de projet.
52
L’atelier Mercosur 2008 à Porto Alegre (Brésil) du 19 avril au 3 mai 2008 «Ville – eau : conflits et projets», La ville rencontre le fleuve à Porto Alegre, Brésil. Cet atelier a réuni des équipes pédagogiques de Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette, de la Faculté d’Architecture de l’Université de la République, Montevideo, Uruguay, de la Faculté d'Architecture, de Design et d'Urbanisme de l'Université Nationale du Littoral, Santa Fe, Argentine et du Département d'Architecture et d'Urbanisme de l'Université Ritter dos Reis, Porto Alegre, Brésil sur la thématique suivante : Les longues et traditionnelles relations de l'ENSAPLV avec l’Amérique latine ont été renforcées, il y a quelques années par deux impulsions : la signature d’une convention le 1er décembre 2004 entre cette école et la Faculté d’Architecture de l'Université de la République d'Uruguay, basée à Montevideo. Par ailleurs, elles ont été consolidées par l’adhésion en 2005 de l’école au POLO MERCOSUR à Montevideo, plate-forme académique, créée par IHEAL, Paris 3, IPEALT, Toulouse, et Paris 8 pour fédérer des programmes universitaires communs entre la France et l’Amérique latine. Après sa participation aux « Workshop Montevideo 2006 » et « Workshop Santa Fe 2007 », l’ENSA Paris La Villette a poursuivi cette coopération dans les domaines architecturaux, urbains et paysagers par sa présence active au « Workshop Porto Alegre 2008 ». A long terme : constituer et échanger un savoir théorique et pratique sur les grandes métropoles en Amérique Latine et en Europe concernant les questions stratégiques urbaines et environnementales en coopération avec les partenaires du Polo Mercosur Argentine, Brésil, Uruguay, Venezuela. A court terme : poursuivre la coopération avec trois écoles d’architecture d’Amérique latine centrée sur des problématiques métropolitaines et l'élargir vers d'autres partenaires. Un nouveau partenaire pressenti a manifesté son intérêt à rejoindre la coopération. Il s'agit de la Faculté d'Architecture et d'Urbanisme de l'Université Centrale du Venezuela, Caracas qui accueillera la version 2009 de la rencontre annuelle d'atelier de travail intensif.
36 étudiants ont participé en 2008 : - 8 étudiants de l'ENSA Paris La Villette (soit deux de plus que l'année précédente grâce à une participation financière plus importante demandée à chaque étudiant) ; - 3 étudiants de la Faculté d’Architecture de l’Université de la République, Montevideo, Uruguay (nombre diminué de moitié par rapport à l'année précédente pour des raisons financières) ; - 13 de la Faculté d'Architecture, de Design et d'Urbanisme (FADU) de l'Université Nationale du Littoral (UNL), Santa Fe, Argentine (soit 3 de plus que l'année précédente, augmentation que l'on peut expliquer par le succès remporté par la version 2007 du workshop à Santa Fe) ; - 12 étudiants du Département d'Architecture et d'Urbanisme de l'Université Ritter dos Reis, Porto Alegre, Brésil (puissance invitante et participant pour la première fois à l'échange) ; et : deux enseignants par école invitée (dont un coordinateur-enseignant du Polo Mercosur), et un important groupe de 4 enseignants (sans compter ceux qui sont intervenus de manière ponctuelle) de l'école invitante : soit au total 10 enseignants. Le workshop s’est effectué du 19 avril au 3 mai 2007, avec 12 jours de travail intensif effectif sur trois sites touchant à la question du rapport entre la ville et les réseaux fluviaux (la zone du centre et des remblais, le zone du FASE et la zone de l'hippodrome) La structure d’accueil a été fournie à Porto Alegre par le Département d'Architecture et d'Urbanisme de l'Université Ritter dos Reis Une exposition publique des travaux a été réalisée à l'ENSAPLV du 11 au 25 octobre 2008. La coopération Sarajevo / Beyrouth / Paris Cette coopération tripartite entre l’ENSAPLV, l’AFS (Ecole d’architecture de Sarajevo) et l’Académie Libanaise des Beaux-Arts de Beyrouth s’inscrit dans un projet soutenu par la DAPA et la Région Ile de France sur deux années. Les trois équipes se sont engagées, dans la continuité des travaux de l’ENSA-Paris La Villette et de son centre de ressources Centre SUD (Situations urbaines de Développement) à développer un enseignement de projet sur 4 semestres qui articule formation théorique, formation au projet urbain et workshops trilatéraux. La thématique qui rassemble ces trois établissements est celle des « transitions
53
métropolitaines », qu’elles soient liées à la transition post-socialiste, à une situation post-conflit ou à une gestion métropolitaine basée sur l’horizon incertain du développement. Chaque année, un workshop est organisé dans chaque ville, soit trois workshops au total. Y participent des groupes (une partie stable, une partie nouvelle) d’étudiants autour d’une thématique fédératrice. Ainsi, l’atelier de Beyrouth en novembre 2008 a porté sur les mutations des quartiers péri-centraux dans une optique tant architecturale qu’urbaine. Il s’agit d’arriver à construire avec les étudiants des trois pays une capacité d’élaboration collective d’une connaissance des questions socio-spatiales, foncières et économiques qui pourraient générer des projets d’amélioration durable des quartiers précaires ou en forte transition dans une pédagogie du projet urbain. Des projets de fin d’étude, des mémoires alimentent, en plus des rendus collectifs d’ateliers, la production de ce programme. Une première exposition a été réalisée en septembre 2008, une seconde aura lieu en septembre 2009 et donner lieu à une publication. L’idée maîtresse de ce programme de travail est également de préfigurer un Master européen. La coopération avec la Faculté d’architecture et d’urbanisme de la Havane (Cuba) Atelier intensif Malecon 2008 La proposition de nouvelle localisation, pour l’Atelier Intensif d’avril 2008 organisé dans le cadre de l’enseignement de projet « Villes Amerique latine », se situe en concordance avec la nécessaire évolution de la coopération développée avec la CUJAE depuis 10 ans, décidée en 2007 par les directeurs des deux établissements. Cet atelier, soutenu par le bureau de la Planification Physique, a permis également un rapprochement opérationnel avec la OHC (Bureau de l’Historien de la ville de la Havane) et de son Atelier du Malecon qui a constitué ainsi le lieu d’ancrage de l’Atelier Intensif réunissant les étudiants de La Villette et de la CUJAE conduits par le professeur Felicia Chateloin. L’atelier s’est déroulé du 22 avril au 2 mai 2008 avec pour objet d’études différents secteurs du Malecon. L’équipe étudiante de l’ENSAPLV était composée de 8 étudiants encadrés d’une enseignante. Les échanges ont été permanents avec les étudiants cubains participant à cet atelier, développant des interrogations croisées concernant l’architecture de la ville et les projets en cours.
L’atelier d’analyse des secteurs urbains à étudier a été assuré avec des visites architecturales et des conférences. Les relevés d’habitat ont été effectués sur différents types d’appartements (maison avec jardin, appartement sur terrasse, appartement sur cour, appartement traversant, duplex,…). Ces études in situ ont été complétées sur place par des exemples classiques et contemporains situés dans chaque quartier d’étude. Ont été ainsi alimentées, par des exemples concrets, les pratiques architecturales, historiques et contemporaines. L’hébergement de l’atelier a été effectué en centre ville, dans un bâtiment historique, le Couvent de Santa Clara (CENCREN). L’atelier El Alto 2008 (La Paz-Bolivie) Cet atelier s’est déroulé du 15 au 29 avril 2008 et a réuni 28 étudiants dont 8 étudiants de l’ENSAPLV, inscrits dans le groupe de projet Villes d’Amérique Latine, encadrés de 2 enseignants. Cet atelier a été conduit en partenariat avec la faculté d’architecture de San Andrès (FAADU) et la faculté d’architecture de l’université publique de El Alto (UPEA), accueillant l’atelier. L’atelier Intensif de El Alto nous a permis de constituer des équipes mixtes (trinômes) comportant un représentant des trois institutions partenaires : FAADU, UPEA, ENSAPLV. Cette expérience, novatrice, a suscité l’intérêt et l’appui des étudiants, des enseignants, ainsi que des autorités locales. La UPEA nous a fait part de son intention de continuer cette expérience, sous forme d’un atelier permanent. C’est à ce titre que cette institution nous a demandé de préparer une convention de coopération avec l’ENSAPLV. La Municipalité de El Alto dite « Honorable Alcaldia de El Alto » a assumé un rôle important dans cet atelier. Est également à remarquer la participation d’une dizaine de fonctionnaires municipaux à nos activités pédagogiques et l’implication du Bureau des Projets Urbains de la municipalité dans ceux-ci. A l’occasion de cet atelier a été organisée l’exposition « la ville sur la ville ».
54
Cette exposition constituait dans la présentation, en une centaine de panneaux, d’une sélection de deux années (2006 et 2007) de production de projets urbains et architecturaux du Master Villes d'Amérique Latine. L’inauguration de cette exposition a été l’occasion de réunir le monde municipal et le monde pédagogique. Cette exposition a également été présentée au Museo Nacional de Arte (Musée national d’art) à la demande de l’UMSA et appuyée par le président de l’Assemblée nationale.La réception de clôture, organisée avec et financée par l’Ambassade de France à La Paz, a compté avec la présence de son Excellence Alain Fouquet et a permis de réunir plus de 200 participants avec une ample couverture par les médias. La mobilité enseignante Erasmus – Flux sortants
Année 2007-2008 % TOTAL SEMAINES 34 100% Italie 14 40% Espagne 4 12% Allemagne 4 12% Scandinavie 3 9% Anciens PECO 4 12% Portugal 3 9% Belgique 1 3% Grèce 1 3% NB ENSEIGNANTS 34 AIDES ERASMUS 17 332,03 €
14
4 43
43
1 10
2
4
6
8
10
12
14ItalieEspagneAllemagneScandinavieAnciens PECOPortugalBelgiqueGrèce
La mobilité de formation Erasmus – Flux sortants
Année 2007-2008
TOTAL SEMAINES 4 Allemagne 1 Grèce 1 Espagne 2 Agents administratifs 3 AIDES ERASMUS 1 947,92 €
1 1
2
3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3Allemagne
Grèce
Espagne
Agentsadministratifs
55
La mobilité étudiante de longue durée – flux sortants – flux entrants Année* 2007-2008 sortants 2007-2008 entrants 2008-2009 sortants 2008-2009 entrants Total 91 100% 135 100% 106 100% 143 100% Dont Erasmus 53 58% 92 68% 60 57% 99 69% La répartition géographique Année 2007-2008 sortants 2007-2008 entrants 2008-2009 sortants 2008-2009 entrants Pays 53 = 100% 92 = 100% 60 = 100% 99=100%
Italie 9 17% 28 30% 7 12% 30 30% Espagne 13 25% 21 23% 13 22% 20 20% Allemagne 6 11% 9 10% 4 7% 10 10% Scandinavie 13 25% 6 7% 13 22% 5 5% Anciens PECO 2 4% 7 8% 3 5% 8 8% Irlande 1 2% 2 3% 2 2% Pays-Bas 3 6% 2 3% 1 1% UK 6 11% 2 2% 8 13% 4 4% Belgique 6 7% 2 3% 6 6% Portugal 3 3% 2 3% 4 4% Grèce 1 2% 6 7% 4 7% 8 8% Autriche 4 4% 1 1% dont échanges européens sans statut Erasmus 2 2% 2 2% dont pays hors de l'Europe 36 40% 43 32% 44 42% 44 31% Pays 36 = 100% 43 = 100 % 44=100% 44=100%
Canada 3 8% 2 5% 3 7% 3 7% Israel 2 6% 7 16% 2 5% 2 5% USA 5 14% 6 14% 1 14% Suisse 2 6% 3 7% 1 2% 1 2% Japon 8 22% 13 30% 9 20% 14 20% Amérique Latine 12 33% 11 26% 21 48% 11 48% Chine 2 6% 2 5% 1 2% 4 2% Afrique du Nord 5 12% 1 2% 6 2% Malaisie 2 6% 2 0 * Rappel 2006-2007 : Sortants : 91 – Entrants : 159
56
Le positionnement dans les cursus Année 2007-2008 sortants 2008-2009 sortants Premier cycle Licence 6 1 Second cycle Master année 1 72 76 Second cycle Master année 2 13 29 Les différentes bourses Année 2007-2008 sortants 2008-2009 sortants Type de bourses Montant des bourses Nbr d’étudiants Montant des bourses Nbr d’étudiants Bourses études Erasmus 87 687,56 € 53 total non connu 60 Bourses Stages Erasmus 6 000 € 4 8 000 € 6 Bourses Mairie de Paris 37 600 € 25 42 560 € 29 Bourses Région Ile de France 34 932 € 10 42 174 € 12 Bourses Min. Culture mob 131 480 € 113 128 592 € 109 *** hors bourses postdiplômes
57
Les universités partenaires 2008-2009 EUROPE
ALLEMAGNE Universität der Künste BERLIN http://www.udk.-berlin.de/
D BERLIN 03
Technische Universität BERLIN http://www.tu-berlin.de
D BERLIN 02
Technische Universität BRAUNSCHWEIG http://www.tu.bs.de
D BRAUNSC 01
Brandeburgische Technische Universität Cottbus http://www.tu-cottbus.de
D COTTBUS01
Hafencity Universität Hamburg http://www.hcu-hamburg.ce
D HAMBURG06
Universität Fridericiana KARLSRUHE http://www.uni-karlsruhe.de/Uni/
D KARLSRU 01
Technische Universität MUNCHEN http://www.arch.tu-muenchen.de/
D MUNCHEN 02
AUTRICHE Technische Universität GRAZ http://www.tugraz.at/
A GRAZ 02
Technische Universität WIEN http://www.tuwien.ac.at
A WIEN 02
BELGIQUE Hogeschool Henry Van der Welde – ANVERS http://www.ha.be/
B ANTWERP 01
Hogeschool Voor Wetenschap & Kunst Saint Lucas BRUXELLES http://www.sintlucas.wenk.be
B Bruxel 76
Vrije Universiteit Brussel http://vub.ac.be
B BRUSSEL01
University of GENT http://www.rug.ac.be/dib
B GENT 01
Institut Supérieur d’Architecture de la communauté française – LA CAMBRE http///www.lacambre-archi.org
B BRUXEL 56
ISA Saint-Luc de Wallonie – LIEGE http://www.saint-luc.org
B LIEGE 30
Université de LIEGE http://www.ulg.ac.be
B LIEGE 01
Université Catholique de Louvain http://www.fsa.ucl.ac.be
Bosnie-Herzegovine Faculté d’architecture de Sarajevo BULGARIE University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy of SOFIA http://www.uacg.bg
BG SOFIA 04
DANEMARK
EURO
PE
Arkitektskolen Aarhus http://www.aarch.dk
DK ARHUS04
58
EUROPE
ESPAGNE Unversitat politecnica de Catalunya – Escola tecnica Superior d’Arquitectura BARCELONE http://www.upc.es
EBARCELO 03
Universitat politecnica de Catalunya – Escola tecnica superior Arquitectura del Valles BARCELONE http://www.etsav.upc.es
E BARCELO 03
Universidad de la CORUNA http://www.udc.es
E LA-CORU 01
Universidad politecnica de MADRID http://www.upm.es
E MADRID 05
Universidad de SEVILLA http://www.us.es
E SEVILLA 01
Universidad Politecnica de VALENCIA http://www.arq.upv.es
E VALENCI 02
FINLANDE University of Art and Design Helsinki Taik http://www.taik.fi
SF HELSINK06
GRECE National Technical University of ATHENES http://www.ntua.gr/
G ATHINE 02
Aristotle University of THESSALONIKI http://www.auth.gr
G THESSAL 01
HONGRIE Université des Sciences et Techniques de BUDAPEST http://www.bme.hu HU BUDAPEST 02 IRLANDE Institute of Technology DUBLIN http://www.dit.ie
IRL DUBLIN 27
ITALIE Universita degli studi di ANCONA http://www.unian.it
I ANCONA 01
Universita degli studi di BRESCIA http://www.unibs.it
I BRESCHIA 01
Universita degli studi di CAMERINO – Faculta di Architettura di Ascoli Piceno http://www.unicam.it
I CAMERIN 01
Universita degli studi di FIRENZE http://www.unifi.it
I FIRENZE 01
Universita degli studi di Genova http://www.unige.it
I GENOVA01
Politecnico di MILANO Leonardo http://www.polimit.it
I MILANO 02
Politecnico di MILANO Bovisa http://www.polimit.it
I MILANO 02
Universita degli Studi di NAPOLI FEDERICO II http://www.unina.it/universit/
I NAPOLI 01
Seconda Universita Degli studi di NAPOLI AVERSA http://www.unina2.it/
I NAPOLI 09
Universitat degli studi di ROMA LA SAPIENZA – Facolta di Ingegneria http://www.uniroma1.it
I ROMA 01
Universita degli studi di ROMA LA SAPIENZA – Prima Facolta http://www.uniroma1.it
I ROMA 01
Universita degli studi di ROMA LA SAPIENZA – Valle Giulia http://www.uniroma1.it
I ROMA 01
EURO
PE
Universita degli studi di ROMA TOR VERGATA http://www.uniroma2.it
I ROMA 02
59
EUROPE Universita degli studi ROMA TRE
http://www.uniroma3.it I ROMA 16
Istituto Universitario di Architettura di VENEZIA http://www.iuav.it
I VENEZIA 02
Politecnico di TORINO http://www.polito.it
I TORINO 02
NORVEGE school of architecture OSLO http://www.aho.no
N OSLO 02
Norwegian University of science and technology TRONDHEIM http://www.ntu.no/
N TRONDHE 01
PAYS-BAS Technische Universiteit DELFT http://www.tudelft.nl
NL DELFT 01
Akademie van Bouwkunst AMSTERDAM http://www.academievanbouwkunst.nl
NL AMSTERD 07
POLOGNE Politeknika VARSOVIE http://www.arch.pw.edu.pl
PL WARSAW 02
PORTUGAL Universidade de COIMBRA http://www.uc.pt/
P COIMBRA 01
Universidade Technica de LISBONNE http://www.fa.utl.pt
P LISBOA 04
REPUBLIQUE DE MACEDOINE Université Saint Cyrille SKOPJE REPUBLIQUE DE TCHEQUE Czech Technical University – PRAGUE http://www.cvut.cz/fa/
CZ PRAHA 10
ROUMANIE Universitatea de Arhitectura si Urbanism « ION MINCU » BUCAREST http://www.elt.ro
RO BUCARES 07
ROYAUME-UNI University of Central England BIRMINGHAM http://www.uce.uk
UK BIRMING03
University of the West England BRISTOL www.uwe.ac.uk/
UK BRISTOL02
University of Strathclyde GLASGOW http://www.strath.ac.uk
UK GLASGOW 02
Brookes University OXFORD http://www.brookes.ac.uk
UK OXFORD 04
SLOVÉNIE University of LJUBLJANA http://www.uni-lj.si SI LJUBLAJ 01 SUEDE CHALMERS University of Technology www://arch.chalmers.se
S GOTEBORG 02
University of LUND http://www.lu.se/intsek/
S LUND 01
Royal Institute of Technology – STOCKHOLM http://www.arch.kth.se
S STOCKH 04
SUISSE
EURO
PE
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich http://www.mobilitaet.ethz.ch
60
AFRIQUE DU NORD
TUNISIE Université Tunis Carthage http://www.utc.ens.tn Ecole Nationale d’architecture et d’urbanisme de TUNIS http://www.mes.tn/francais/universite/7_novembre/enautp_enaut.htm MAROC Ecole Supérieure d’architecture de Casablanca http://www.ecole-archi-casa.com Ecole Nationale d’Architecture de Rabat http://www.archi.ac.ma
AFRI
QUE
DU N
ORD
Faculté des sciences Har El Mhraz de Fes, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah – en cours de signature CONTINENT AMERICAIN
CANADA Ecole d’Architecture du Paysage de la Faculté d’Aménagement de l’Université de MONTREA http://www.ame.umontreal.ca/ University of Calgary http://www.ucalgary.ca USA Georgia Institute of technology –ATLANTA http://www.gatech.edu/ Université de HOUSTON http://www.uh.edu/ California college of arts and crafts – Oakland, SAN FRANCISCO http://www.ccac-art.edu/ CUBA Institut supérieur Polytechnique Jose Antonio Echeverria (ISPJAE) CUBA http://www.ispjae.edu.cu/cgi.bin/visualiza.pl Universidad de Oriente – Ciencia y Conciencia convention en cours de signature Santiago de Cuba http://www.uo.edu.cu ARGENTINE Faculté Architecture, design et urbanisme de BUENOS AIRES http://www.fadu.urba.ar/ BOLIVIE Universidad Mayor de San Andrès. Facultad de Arquitectura, Artes, Diseno y Urbanismo- La Paz http://www.umsa.bo BRESIL Universidade estadual Paulista de SAO PAULO www.unesp.br/ CAMPINAS Pontifica Universidade Catolica http://www.puccamp.br Université de Sao Paulo http://www.usp.br/fau Universidade Federal do Rio de Janeiro http://www. Porto Alegre CHILI
CONT
INEN
T AM
ERIC
AIN
Universidad Diego Portales Facultad de Arquitectura, Arte y Disena Santiago http://www.faad.cl
61
CONTINENT AMERICAIN
URUGUAY Université de la République – Montevideo http://www.farq.edu.uy VENEZUELA Université Centrale du Venezuela, CARACAS http://www.ucv.ve/ MEXIQUE
CONT
INEN
T AM
ERIC
AIN
Universidad Nacional Autonoma de Mexico http://www.unam.mx
PROCHE ORIENT
ISRAËL Bezalel Academy of Arts and Design JERUSALEM http://www.ac.il/ Technion HAIFA http://www.technion.ac.il/ LIBAN Université de Balamand – Académie libanaise des Beaux Arts http://www.alba.edu.lb PR
OCHE
ORI
ENT
Université Saint-Esprit de Kaslik – Jounieh, Liban http://www.usek.edu.lb
ASIE
COREE Université d’Hanyang – SEOUL http://www.hanyang.ac.kr/ Gyongay CHINE Université de Tsinghua – Pekin http://tsinghua.edu.cn/eng/ Southeast University, Nanjing Université de Tianjin Université de Chongqing JAPON CHIBA University – The Graduate school of Science and Technology (Ausmpi) http://www.ta.chiba-u.ac.jp Université de KYOTO http://www.kyoto-u.ac.jp/ KYOTO Institute of Technology http://www.kit.ac.jp/ja/en Institut Technologique de TOKYO http://titech.ac.jp/home.htm/ WASEDA University http://www.waseda.ac.jp/ OSAKA SANGYO http://www.osaka-sandai.ac.jp/english/riji.html/
ASIE
OSAKA University Graduate school of Engineering et Graduate school of letters http://www.osaka-u.ac.jp
62
ASIE
JAPON KYUSHU University – The Graduate school of Human Environment studies (Ausmip) http://kyuday-archurb.jp TOKYO University – The school of Engineering et Graduate school of Frontier Sciences (Ausmip) http://u-tokyo.ac.jp MALAISIE Universiti Teknologi Malaysia, Johor http://www.utm.my VIETNAM Ho Chi Minh ville Université d’Architecture
ASIE
63
Les missions par service en 2008
SERVICES NOMBRE
DE JOURS
NBR D'ADMINISTRATIFS OU D’ENSEIGNANTS
MONTANT DU TRANSPORT
MONTANT DES INDEMNITES
COUT TOTAL MISSION
SOUS TOTAL FRANCE 18 22 2 406,52 1 804,45 4 210,97
SOUS TOTAL ETRANGER 140 4 4 219,15 325,00 4 544,15
ADMI
NIST
RATI
ON
TOTAL ADMINISTRATION 158 26 6 625,67 2 129,45 8 755,12
SOUS TOTAL ETRANGER 6 2 384,00 340,00 724,00
EDIT
ION
DE LA
VI
LLET
TE
TOTAL EDITIONS DE LA VILLETTE 6 2 384,00 340,00 724,00
SOUS TOTAL FRANCE 2 1 - 147,50 147,50
COMM
UNIC
ATIO
N
TOTAL COMMUNICATION 2 1 - 147,50 147,50
SOUS TOTAL FRANCE 195 78 12 801,43 2 356,33 15 157,76
SOUS TOTAL ETRANGER 201 40 12 594,59 11 304,30 23 898,89
RECH
ERCH
E
TOTAL RECHERCHE 396 118 25 396,02 13 660,63 39 056,65
64
SERVICES NOMBRE DE JOURS
NBR D'ADMINI OU ENSEIGNANTS
NOMBRE ETUDIANTS
MONTANT DU TRANSPORT
MONTANT DES INDEMNITES
COUT TOTAL DE LA MISSION
SOUS TOTAL FRANCE 66 110 461 13 055,20 15 657,53 28 712,73
FORMATION INITIALE 76 56 557 43 090,85 13 312,86 56 403,71
DSA Projet Urbain (10558) 5 3 9 2 185,64 1 280,00 3 465,64 DPEA Architecture
Philosophie 13 3 9 4 586,72 334,00 4 920,72
DPEA Map 105 7 36 14 885,06 3 545,54 18 430,60 Georgia Tech 13 3 62 1 842,29 2 571,50 4 413,79
Pédagogie (Centre Partir) 15 5 743,00 743,00 Sous Total Etranger 227 72 678 67 333,56 21 043,90 88 377,46
MISS
IONS
PED
AGOG
IQUE
S
TOTAL PEDAGOGIE 293 182 1139 80 388,76 36 701,43 117 090,19
SERVICES NOMBRE DE JOURS
NBR D'ADMINI OU ENSEIGNANTS
NOMBRE ETUDIANTS
MONTANT DU TRANSPORT
MONTANT DES INDEMNITES
COUT TOTAL DE LA MISSION
Asia Link 22 45 22 652,89 7 428,00 30 080,89
Cuba 1 704,10 244,39 948,49
SOUS TOTAL FRANCE 23 45 23 356,99 7 672,39 31 029,38 Asia Link 28 0 32 814,74 16 026,74 48 841,48
Aide à la mobilité Enseignante 41 40 13 135,04 10 560,53 23 695,57
IP Lisbonne 6 0 33 515,26 832,07 34 347,33 Cuba 3 8 8 719,36 1 957,89 10 677,25
Coopération Beyrouth 12 79 18 296,06 3 218,00 21 514,06 Atelier Rome 1 26 3 576,00 1 423,00 4 999,00
Coopération Bucharest 1 0 216,14 -
216,14 Atelier International 3 21 10 708,29 939,60 11 647,89
La paz 2 8 7 900,00 1 951,20 9 851,20 Voyages pédagogiques 41 362 44 367,44 4 451,95 48 819,39
SOUS TOTAL ETRANGER 138 544 173 248,33 41 360,98 214 609,31
RELA
TION
S IN
TERN
ATIO
NALE
S
TOTAL INTERNATIONAL 161 589 196 605,32 49 033,37 245 638,69
65
SERVICES NOMBRE DE JOURS
NBR D'ADMINI OU ENSEIGNANTS
NOMBRE ETUDIANTS
MONTANT DU TRANSPORT
MONTANT DES INDEMNITES
COUT TOTAL DE LA MISSION
TOTAL GENERAL DES MISSIONS (2008) 1 763 490 1 728 309 399,77 102 012,38 411 412,15
Les missions par service en 2008
0%
28%
9%
2%
61%
Administration
Edition de la Villette
Recherche
Pédagogie
Relations Internationales
66
Les voyages pédagogiques en autocars en 2008
NBR DE JOURS NBR D'ETUDIANTS NBR D'ENSEIGNANTS MONTANT 1 50 1 525,00 1 38 2 525,00 1 24 4 525,00 1 24 4 365,00 1 25 1 410,00 3 45 4 2 350,00 7 28 2 246,00
6 22 2 390,00
3 50 5 1 550,00 3 50 5 1 688,00 1 50 5 495,85 1 50 1 500,00
FRAN
CE
1 50 2 1 002,25
TOTAL DES VOYAGES EN FRANCE 10 572,10
5 32 5 3 425,00
4 293 25 17 523,00
4 46 6 3 119,00
5 35 3 3 175,00 9 50 3 5 905,00 8 40 5 5 750,00 9 301,00
ÉTRA
NGER
3 60 4 3 400,00
TOTAL DES VOYAGES A L’ETRANGER 42 598,00
TOTAL GENERAL DES VOYAGES PEDAGOGIQUES EN AUTOCAR EN 2008 53 170,10
67
6. Le corps enseignant Le corps enseignant de l’ENSAPLV est composé de 365 enseignant(e)s environ dont 105 titulaires et\ou enseignant(e)s associé(e)s et 260 enseignant(e)s contractuel(le)s (53) et\ou vacataires totalisant plus de 96 heures de cours pour une année universitaire. a. Les enseignant(e)s titulaires et associé(e)s En 2008, différents mouvements ont eu lieu. Les départs en retraite : - Hervé Fillipetti - Odile Hamburger - Pétia Kandeva - Christelle Robin - Louis-Paul Untersteller - Christian Muschalek - Philippe Revault - Michel Vernes Le départ suite à un concours : - Françoise Fromonot Les enseignant(e)s en disponibilité : - Dietmar Feichtinger Les enseignant(e)s à mi-temps : - Brigitte Donnadieu - Christophe Barreau Les recrutements par mutation : - Pietro Cremonini - James Njoo - Claudio Secci - Pierre Bouché - Serge Watcher Les recrutements par concours : - Hélène Jannière - Caroline Lecourtois - Suzel Vassalo-Balez Les recrutements d’enseignants associés : - Antonio Brucculeri - Véronique Fabbri - Philippe Simay - Carole Gayet-Viaud - Frédéric Neuman - Jean Magerand - Sophie Denissof - Anne Nguyen Khac Schéou
b. Les enseignant(e)s contractuel(le)s et vacataires En 2008, L’ENSAPLV compte 53 enseignants contractualisés dans le cadre de l’application du décret, avec effet rétroactif au 1er octobre 2006 : 37 enseignants sur contrat de 3 ans et 16 enseignants sur contrat d’un an. Par ailleurs, l’école emploie des vacataires dont le volume d’heures est supérieure ou égal à 96 heures. c. La répartition statutaire des enseignant(e)s
LE CORPS ENSEIGNANT 2008-2009 STATUT NBR
DE PP NBR EN
ETP
% %
Professeur (PROF) 14 14 8,4 Maître assistant titulaire (MAT)
77 75 45,1
Maître assistant associé (MAA)
17 13 7,8
Enseignant contractuel MCC (CMCC)
2 2 1,2
62,5
Enseignant contractualisé (CT)
53 22,9 13,8
Enseignant vacataire (VAC)*
204 39,5 23,7
37,5
TOTAL 365 166,5 100 * La liste des enseignant(e)s vacataires a été arrêtée en mai 2009 et comprend l’ensemble des vacataires quelque soit le nombre d‘heures effectuées. Par ailleurs, il est à noter l’importance des enseignant(e)s non titulaires dans les effectifs du corps enseignant : - 37,5% en ETP d’enseignant(e)s non titulaires relevant du budget de l’ENSAPLV, - 9% en ETP d’enseignant(e)s non titulaires relevant du Ministère de la culture et de la communication (MCC).
68
LES ENSEIGNANT(E)S TITULAIRES ET ASSOCIE(E)S DE L’ENSAPLV Titulaires Jean-Pierre ALBERTANI Philippe DUBOY Philippe ALLUIN Patrick DUGUET Andrés ATELA Frédéric DURAND Pascal AUBRY Alain ENARD Thibaud BABLED Thérèse EVETTE Suzel BALEZ Dietmar FEICHTINGER Christophe BARREAU Jean-Pierre FRANCA Dominique BEAUTEMS Christian GARRIER Marc BEDARIDA Bruno GAUDIN Véronique BIGO Jakob GAUTEL Pierre BOUCHE Patrick GERME Jacques BOULET Lionel GODART Marc BOURDIER Claude GOLDSTEIN Vincent BROSSY José GONZALEZ Mario CARPO Gérald GRIBÉ Olivier CHADOIN François GUENA Olivier CHASLIN Dalil HAMANI Bikash CHAUDHURI Jean HARARI Thierry CIBLAC Hélène JANNIERE Jean-Michel COGET Eric JANTZEN Albert-Gilles COHEN Philippe JEAN Vincen CORNU Valérie JOUVE Pietro CREMONINI Xavier JUILLOT Edith CRESCENZI Ron KENLEY Eric DANIEL-LACOMBE Maxime KETOFF Daniel DAVALAN Arnauld LAFFAGE Pascal DE BECK Jean-Pierre LE DANTEC Agnès DEBOULET Emanuel LICHA Anne Mie DEPUYDT Alain LIEBARD Annick DESMIER Luis LOPEZ Jean DESMIER Louis MARIANI Marco DESSARDO Caroline LECOURTOIS Brigitte DONNADIEU Mahtab MAZLOUMAN LAM
QUANG Philippe DUBOIS Mireille MENARD Eric DUBOSC Christian MOLEY
Associé(e)s Christian MORANDI Antonio BRUCCELERI Stéphanie NAVA Andréas CHRISTO-
FOROUX Valérie NEGRE Sophie DENISSOF Jimmy NJOO Anne D'ORAZIO Yann NUSSAUME Véronique FABBRI Gilles OLIVE Ignace GRIFO Christine PAPIN Laure HELAND Jean-Marie PERIN Jean-Jacques LYON-CAEN François PHILIPPE Jean MAGERAND Pascal QUINTARD HOFSTEIN Frédéric NEUMAN Didier REBOIS Christian PEDELAHORE Hugues REIP Vincent POIRIER Eva SAMUEL Gwenaelle ROUVILLOIS Claudio SECCI Philippe SIMAY Yong-Hak SHIN Joanne VAJDA Nicolas SOULIER Yves TROCHEL Yannis TSIOMIS Anne TÜSCHER-DOKIC Serge WATCHER Bendicht WEBER Chris YOUNES Mario ZORATTO
69
d. La répartition des enseignant(e)s par champs disciplinaires
CHAMPS DISCIPLINAIRES NBR D’ENSEIGNANT(E)S
%
HCA Histoire et culture architecturale
19 6,3
ATR Arts et technique de la représentation
44 14,7
TPCAU Théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine
133 44,3
STA Sciences et techniques pour l’architecture
57 19
VT Ville et territoire 20 6,7 SHS Sciences de l’homme et
de la société pour l’architecture
27 9
TOTAL 300* 100 * Le champ de l’étude est limité aux enseignant(e)s titulaires et non titulaires du MCC, aux enseignant(e)s contractuel(le)s de l’ENSAPLV et aux vacataires dont le nombre d’heures effectuées est supérieur à 14 heures.
6% 15%
44%
19%
7% 9%HCAATRTPCAUSTAVTSHS
e. La répartition du corps enseignant par sexe
26%
74%
FemmeHomme
Parmi les effectifs enseignants pris en compte, on remarque une prépondérance des hommes, ces derniers représentants près des 3/4 des enseignants.
Il est à noter également que si l’on prend en compte uniquement les enseignants titulaires et non titulaires relevant du MCC, la proportion des hommes est légèrement au dessus (76,6%). Elle diminue ensuite si l’on associe les 53 contrats d’établissements (74,4%). Enfin, elle baisse légèrement encore avec l’ajout des 60 vacataires sélectionnés (dont le nombre d’heures est supérieur à 96 heures). f. La répartition des enseignant(e)s par âge 49,78% des enseignants de l’ENSAPLV ont moins de 50 ans contre 50,23% âgés de plus de 50 ans. AGE PP % % 31 – 35 ans 8 3,59 36 – 39 ans 20 8,97 40 – 45 ans 43 19,28 46 – 50 ans 40 17,94
49,78
51 – 55 ans 36 16,14 56 – 59 ans 29 13
29,15
60 – 67 ans 47 21,08 21,08 TOTAL 223 100 100
PP
4%
9%
19%
18%16%
13%
21%
31 – 35 ans 36 – 39 ans 40 – 45 ans46 – 50 ans 51 – 55 ans 56 – 59 ans60 – 67 ans
70
g. Les flux Les départs prévisionnels pour 2008-2009 par motifs et ETP
DEPARTS 2008-2009 Retraite Dispo Détachement Fin de
contrat Maass
TOTAL
NBR DE DEPARTS
9,5 1 1,5 1,5 13,5
EN % 70,4 7,4 11,1 Les arrivées prévisionnelles pour 2008-2009 par motifs et ETP
ARRIVEE 2008-2009 Mutation Concours Recrutement
contrat Maass TOTAL
NBR EN ETP
5 4 6 15
EN % 33,3 26,7 40 100
71
7. L’organisation de l’école a. L’administration de l’école L’équipe administrative comprend 68 personnes incluant des agents titulaires de la Culture, des agents titulaires de l’Équipement, des contractuels et des vacataires. Plusieurs mouvements de personnel ont eu lieu en 2008. La répartition statutaire des ATOS ATOS Titulaires de
la Culture Titulaires et contractuels
de l’Equipement
Contractuels d’établis.
Nbr d’agents
37 14 17
TOTAL 68 Les effectifs ATOS par catégorie
Effectifs des ATOS par catégorie Catégorie %
A 33,3 B 30,8 C 35,9
TOTAL 100
Répartition des ATOS par catégorie
33%
31%
36% ABC
La répartition des ATOS par type de service Les agents de l’ENSAPLV sont répartis au sein des services administratifs et des services techniques. ATOS Administratif Technique Total PP 44 24 68 % 64,7 35,3 100
Le personnel administratif représente près des 2/3 de l’effectif total des ATOS. La répartition des ATOS par sexe ATOS H F Total PP 31 37 68 % 45,6 54,4 100
46%54%
h f
La propension H\F est globalement équilibrée. La répartition des ATOS par âge
Pyramide des âges des ATOS % PP < 30 ans 4,41 3 32 – 35 ans 4,41 3 36 – 39 ans 4,41 3 40 – 45 ans 23,53 16 46 – 50 ans 8,82 6 51 – 55 ans 22,06 15 56 – 59 ans 19,12 13 60 – 64 ans 11,76 8 65 – 67 ans 1,47 1 TOTAL 100 68
4% 4%4%
25%9%22%
19%12% 1%
< 30 ans32 – 35 ans36 – 39 ans40 – 45 ans46 – 50 ans51 – 55 ans56 – 59 ans60 – 64 ans65 – 67 ans
1/3 des ATOS ont entre 56 et 67 ans, et que plus de la moitié de l’effectif total a plus de 50 ans (54%). Enfin, près de 13% des ATOS peuvent faire valoir leur droit à la retraite, d’où l’importance de sensibiliser les agents afin qu’ils informent le plus tôt possible de leur départ. Les flux LES FLUX DEPARTS ARRIVEE Nbre de PP 6 5
Les motifs des départs RETRAITE MUTATION CONCOURS TOTAL NBR DE PP
4 1 1 6
72
b. Le Conseil d’Administration L’ENSAPLV est un Etablissement Public à caractère administratif (décret nº 86.390 du 10/03/86). Conformément aux termes de l’article 8 du décret n°78-266 du 8 mars 1978, le Conseil d’administration délibère sur : 1) le règlement intérieur de l’établissement qui est soumis par le directeur à l’approbation du ministre chargé de la culture ; 2) le programme d’enseignement préparé par la commission de la pédagogie et de la recherche ; 3) le budget et le compte financier ; 4) les catégories de contrats ou de conventions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, lui sont soumises par le directeur de l’établissement ; 5) les questions qui sont de sa compétence en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (…) ; Le conseil d’administration examine le rapport d’activité établi chaque année par le directeur. Il est présidé par Vincen Cornu, enseignant à l’école, et comprend 24 membres, dont 7 représentants du collège des enseignants, 7 représentants du collège des étudiants et 7 personnalités extérieures. En moyenne, il s’est réuni une fois par mois. La composition du Conseil d’Administration en 2008 Président Vincen Cornu, enseignant Directeur Bertrand Lemoine
Collège enseignants - Jacques Boulet - Jean-Marc Chanteux - Albert-Gilles Cohen
- Jean Desmier - Didier Henry - Arnauld Laffage
Collège administratifs - Marléna Gorge - Claude Lebrun Collège étudiants - Maxime Géraut - Annabelle Blin - Sarah Husson
- Isabelle Cotta - Pierre-Emmanuel Limondin - Thomas Egoumenides
Collège des personnalités extérieures - Agnès Vince, ex chef du bureau des enseignements à la DAPA, sous-directrice des métiers de l'aménagement au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. - Michèle Saban, vice présidente du conseil régional d’Ile de France. - Gus Massiah, ingénieur civil des mines, ancien professeur de l'école - Francine Demichel, ex directrice de l’enseignement supérieur et de la recherche, et professeure à l'université Paris-VIII - Jean Claude Deutsch, directeur de l’Ecole doctorale " Ville et environnement - Zahia Rahmani, chercheur à l'Institut national d'histoire de l'art - Maurice Laurent, architecte DPLG, architecte voyer en chef honoraire à la ville de Paris, membre de l'Académie d'architecture
En mars 2009, des élections pour le renouvellement du Conseil d’administration de l’ENSAPLV seront organisées.
73
L’organigramme de l’ENSAPLV Si possible intervertir l’ordre du nom et du prénom Nom + prénom DIRECTION Directeur Bertrand Lemoine Directrice-adjointe Sandrine Sartori Assistante de Direction et gestion des bourses Danielle Boulard Secrétariat du conseil d'administration Pascal Barhimi MISSION DEVELOPPEMENT ET PROSPECTIVE Chargée de mission Nathalie Guerrois MISSION RELATIONS ENSEIGNANTS Chargée de mission Chantal Roger Coordination des vacations Frédérique Gobet MISSION COMMUNICATION Site internet, chargé de communication Gilles Enriquez Manifestations, expo, conférences, colloques Marie-Liesse Sztuka EDITIONS DE LA VILLETTE Responsable Marc Bedarida Coordination éditoriale, contrats d'auteurs Esther Gauthier Coordination éditoriale, gestion du stock et des ventes, comptabilité Brankika Radictachou SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE ETUDIANTE Responsable Catherine Comet Suivi du cycle I et inscriptions Bernard Coiffet Suivi du cycle I et stages Céline Protat Suivi du cycle II Annie Belleselve Suivi du cycle II Agnès Mirandel Suivi du cycle II et stages Marie-Odile Bourdin HMONP Nicole Ajarraî Observatoire des métiers de l'architecture Monique Daniaud Inscriptions des étrangers, validation des acquis Soraya Ghaleh-Marzban SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES Responsable Danielle Hugues Mobilité étudiante et contrats internationaux Martine Provoost Mobilité étudiante et contrats internationaux Nicole Videment SERVICE DE LA RECHERCHE Coordination administrative des équipes de recherche et gestion des contrats de recherche Christiane Monsonego MEDIATHEQUE Bibliothèque : Co-responsable Rosine Cohu Bibliothèque : Co-responsable Laurence Bizien Accueil et information du public Vazoumana Meite Documentation : Responsable Didier Tourade Accueil, prêt Sylviane Cédia Vidéothèque : Responsable Catherine Bourguet POLE IMAGE Laboratoire photographique : Responsable Hervé Jézéquel Laboratoire audio-visuel : Responsable Jean-Luc Poupas Prêt, entretien, aide aux utilisateurs Alain Chalu Prêt, entretien, aide aux utilisateurs Marcello Mendoza ATELIER MAQUETTE Responsable François-Xavier Allard
74
SECRETARIAT GENERAL ET SERVICE FINANCIER Secrétaire générale Marléna Gorge Gestion de recettes et des dépenses, régisseurs EV Morgane Steimetz Gestion des missions et des voyages Brigitte Seknagi SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Responsable Maryline Kurtz Personnels titulaires et contractuels Etat Nicole Fouquet Personnels titulaires et contractuels Etat Marie-Elisabeth Girard Vacataires et contractuels de l'établissement Laurence Ricou Vacataires et contractuels de l'établissement Zohra Naceur Secrétariat Madely Labansine SERVICE INFORMATIQUE Responsable Claude Lebrun Gestion des serveurs et sécurisation des réseaux Bernard Peltier Gestion du parc et des marchés Patrick Bottier Assistance technique et maintenance Sunny Jean-Louis Assistance technique et maintenance Sylvain Vognin Libre-service informatique Barmak Lahidji SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DES MOYENS COMMUNS Responsable Philippe Bourdier Adjoint, maintenance et entretien des bâtiments Jean-Pierre Bras Maintenance et entretien des bâtiments Marc Fayolle de Mans Adjoint, accueil, surveillance, livraisons, prêt de matériel David Tenreiro Accueil, surveillance, livraisons, prêt de matériel Kassimi Baba Meité Accueil et surveillance (soir, nuit, week-end) André Bapin Accueil et surveillance (soir, nuit, week-end) Ammar Djenhia Accueil du public, gestion du standard Patricia Bonhoure Accueil et surveillance (soir, nuit, week-end) Laurent Sonneville Accueil et surveillance (soir, nuit, week-end) Francis Gorain Accueil et surveillance (soir, nuit, week-end) Guglielmo Mazocchi Magasin Nicolas Lesueur Reprographie René Steimetz AGENCE COMPTABLE Agent comptable Alice Djakovitch Assistante Cécile Francin
75
c. Les comités de l’ENSAPLV 1. Le comité technique paritaire (CTPL) Le comité s’est réuni deux fois au cours de l’année. Les réunions ont notamment porté sur la réorganisation de l’équipe administrative, la situation financière de l’école, l’application de l ‘aménagement et de la réduction du temps de travail, etc Composition du CTPL : - Les représentations de l’administration Titulaires Suppléants Le directeur président Philippe Bourdier Sandrine Sartori Chantal Roger Catherine Comet Monique Daniaud Maryline Kurtz Marie-Elisabeth Girard Patrick Bottier Claude Lebrun Marléna Gorge Hervé Jézéquel
- Les représentations du personnel Titulaires Suppléants Catherine Bourguet David Tenreiro Rosine Cohu Gilles Enriquez Mario Zoratto Martine Provoost Danielle Boulard Marie-Odile Bourdin Christian Morandi Dominique Dehoux Non nommé Non nommé
2. Le comité d’hygiène et de sécurité (CHS) Il s’est réuni plusieurs fois. Ses travaux portent sur le bilan de la médecine de prévention, les problèmes d’aération et d’éclairage dans les locaux administratifs, l’élaboration du document unique sur les risques professionnels, le règlement intérieur de l’établissement, le rapport d’inspection hygiène et sécurité de l’IGAAC. - La composition du CHS - Les représentations de l’administration Titulaires Suppléants Le directeur président Catherine Comet Marléna Gorge Chantal Roger Jean-Pierre Bras Jean-marc Chanteux Marc Fayolle de Mans Patricia Fred
- Membre de droit Philippe Bourdier ACMO
- Les représentations du personnel au CHS Titulaires Suppléants David Tenreiro Non nommé Hammar Djenhia Non nommé Marie-Odile Bourdin Mario Zoratto Nicolas Lesueur Non nommé Non nommé Non nommé
d. Les commissions de l’ENSAPLV 1. La commission de la pédagogie et de la recherche (CPR) La CPR est composée du directeur de l’école et de 10 à 20 enseignants de l’établissement désignés chaque année par le CA en dehors de ses membres. Ses missions Elle prépare les décisions du CA en matière de pédagogie et donne son avis sur toute question pouvant avoir une incidence en matière de recherche. Elle se réunit en moyenne tous les quinze jours. En 2008, elle a travaillé en particulier sur : - la poursuite de la mise en place des cursus de formation initiale, - le mode des fonctionnements des groupes et des jurys de PFE, - la continuité de la HMONP. - Les membres de la CPR Coordinateurs du premier cycle : Brigitte Donnadieu, Christian Albert Muschalek, Valérie Nègre Coordinateurs du second cycle : Jean-Pierre Franca, Bruno Gaudin, Patrick Germe, François Guéna Doctorat : Thérèse Evette, Jean-Pierre Le Dantec Représentants des champs disciplinaires : ATR : Stéphanie Nava HCA : Marc Bédarida SHS : Agnès Deboulet STA : Vincent Poirier Enseignants membres de la CPR plénière : Dominique Dehoux (VT), Anne D’Orazio (TPCAU), Jean Magerand (TPCAU), Caroline Varlet (HCA) Membres du collège étudiants : Océane Ragoucy, Sarah Robalo Da Fonseca, Vincent Lavergne, Géraut Sarret Membres de l’administration : Bertrand Lemoine, Sandrine Sartori, Catherine Comet, Nicole Ajarrai, Monique Daniaud, Nathalie Guerrois, Chantal Roger, Philippe Bourdier + invités en fonction de l’ordre du jour
Plusieurs groupes de travail ont été organisés sous l’égide de la CPR afin de présenter les dossiers d’habilitation de l’ensemble des formations de l’ENSAPLV. Ces groupes se sont particulièrement réunis pour la formation initiale et la HMONP.
76
2. Les autres commissions - La Commission d’orientation (Article 11 de l’arrêté du 20/7/2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d’architecture) Son mode de fonctionnement et sa composition sont fixés par le CA ; elle comprend entre autres 2 enseignants désignés par le recteur et 2 étudiants élus du CA. Elle organise une session d’orientation à l’attention des candidats à une inscription en 1ère année des études d’architecture. Les membres : - Patrice Boissy, Jean-Marc Chanteux, Jean Desmier, Patrick Duguet, Frédéric Durand, Alain Enard, Lionel Godart, Gérald Gribé, Alain Liebard, Jean-Marie Périn. Enseignants chercheurs : C.Corre, M. Guiomar Université Paris VIII. Administration : Catherine Comet, Chantal Roger. - La Commission de validation des acquis (Article 9 de l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d’inscriptions dans les écoles d’architecture et décret n°98-2 du 2/1/1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux études d’architecture). Elle examine les demandes de validation d’études suivies dans d’autres établissements français ou étrangers, l’expérience professionnelle acquise au cours d’une activité salariée ou non salariée et les connaissances et aptitudes acquises hors de tout système de formation. Elle étudie également les demandes de transferts entrants en cours de cycle en vue de les positionner dans le cursus. Les membres : - Dominique Beautems, Jean-Pierre Franca, Christine Papin, Mario Zoratto et Soraya Ghaleh-Marzban ainsi que 5 enseignants au moins désignés pour 2 ans par le collège enseignant du CA. - La Commission des stages Elle participe à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique des stages en liaison avec la CPR et selon les directives du CA. Elle examine les rapports de stage et étudie les demandes de dispense de stage. Les membres : - Marc Bourdier, Brigitte Naviner, Jean-Marie Périn et Céline Protat.
- La Commission d’année supplémentaire d’inscription (Idem commission d’orientation : Article 11 de l’arrêté 20/7/2005 relatif aux modalités d’inscriptions dans les écoles d’architecture) Elle reçoit les étudiants ayant épuisé leurs droits à inscription (2 en 1ère année de 1er cycle, 4 en premier cycle et 3 en second cycle) en vue de formuler un avis soit pour accorder une année supplémentaire et\ou préconiser une décision d’exclusion. C’est le directeur de l’école qui autorise l’étudiant à bénéficier d’une année supplémentaire ou qui prononce une décision d’exclusion pour une durée de 3 ans. - La Commission des Relations Internationales (CRI) Elle statue sur les dossiers de demande de mobilité des étudiants à l'étranger, dans le cadre des conventions de type Socrates ou autres. Elle participe à l'information auprès des étudiants candidats au départ, et à la gestion pédagogique du contrat d'études avec les établissements partenaires. Elle participe aussi à l'accueil des étudiants et des enseignants étrangers. Elle conseille le CA sur la politique générale de l'école pour ce qui concerne les relations internationales et plus particulièrement les demandes de budget pour des actions de coopération. Elle étudie les projets de voyages pédagogiques. Les membres : - Dominique Beautems, Marc Bourdier, Hariklia Brassel, Marco Dessardo, Philippe Duboy, Jean-Pierre Franca, Didier Henry, Eric Locicero, Christian Albert Muschalek, Philippe Revault, et Sandrine Sartori, Danièle Hugues, Martine Provoost, Nicole Videment.
77
- La Commission des vacations Elle définit les critères d’attribution des vacations. Elle examine les demandes de vacations permanentes et ponctuelles pédagogiques (enseignants, moniteurs) et administratives (services techniques ou autres)et étudie les différents taux à appliquer. Les membres : - le président du CA : Vincen Cornu - les coordinateurs de premier cycle : Brigitte Donnadieu, Christian Albert Muschalek, Valérie Nègre - les coordinateurs de second cycle : Jean-Pierre Franca, Bruno Gaudin, Patrick Germe, François Guéna - les coordinateurs du Doctorat : Thérèse Evette, Jean-Pierre Le Dantec - l’administration : Bertrand Lemoine, Sandrine Sartori, Marléna Gorge, Maryline Kurtz, Laurence Ricou, Chantal Roger. - La Commission des bourses Elle veille à l'application de la réglementation sur l'attribution des bourses d'études. Elle examine les premières demandes de bourses déposées par les étudiants ainsi que les demandes de renouvellement. Elle vérifie les résultats obtenus dans le cycle concerné. - Le Fonds d’aide à la vie étudiante (FAVE) Il attribue des aides exceptionnelles individualisées à des étudiants rencontrant des difficultés financières. - La Commission des locaux et des travaux Elle travaille à l’amélioration des conditions de "logement" des enseignements, analyse les manques, optimise les moyens, travaille sur la programmation et le choix des actions prioritaires, étudie et suit les projets et réalisations, suit le dossier "déménagement". Les membres : Vincen Cornu, Bertrand Lemoine, Sandrine Sartori, Marléna Gorge, Jean-Pierre Franca, Bruno Gaudin, Philippe Bourdier ; - La Commission de recrutement Elle examine les dossiers de demande de mutation des enseignants d’autres ENSA, les dossiers des candidats à un poste d’enseignant associé. Par ailleurs, elle reçoit les candidats retenus après examen de leur dossier.
Les membres : - le président du CA : Vincen Cornu - les coordinateurs de premier cycle : Brigitte Donnadieu, Christian Albert Muschalek, Valérie Nègre - les coordinateurs de second cycle : Jean-Pierre Franca, Bruno Gaudin, Patrick Germe, François Guéna. - 2 enseignants élus au CA et 2 enseignants experts représentant le champ disciplinaire concerné - Bertrand Lemoine, Sandrine Sartori + en fonction les enseignants représentants des champs concernés. d. La formation continue des personnels (enseignants et ATOS) Au cours de l'année 2008 l'école a poursuivi ses objectifs de formation à savoir : - permettre aux agents (administratifs et enseignants) d’acquérir et de développer des compétences nécessaires ou complémentaires pour répondre à une meilleure efficacité dans les fonctions, à la satisfaction des usagers de l'établissement et le plein accomplissement des missions du service. - favoriser la formation de préparation aux examens, aux concours administratifs et autres procédures de promotion interne. - favoriser l'épanouissement personnel des agents par une ouverture ou un approfondissement de la connaissance des langues. - former les agents à l'hygiène et à la sécurité. Pour mener à bien ses objectifs, l'école a fait appel en priorité aux formations dispensées par le Ministère de la culture et de la communication, principalement dans le domaine des nouvelles technologies, des langues et des métiers "culture". - Le bilan des formations par catégorie
NBR D’AGENTS PAR CATEGORIE A B C Total ATOS 12 7 12 31 Enseignants 4 4 TOTAL 16 7 12 35 % 45,71 20 34,29 100
Le bilan des formations 2008 fait état que 45% des agents ayant bénéficié d’une formation relèvent de la catégorie A.
78
Les formations sollicitées concernent pour la plupart les domaines suivants : - approfondissement des langues - métiers de la culture - préparation aux concours
NBR D’AGENTS PAR SERVICE SERVICES NBR D’AGENTS NBR DE JOURS
Documentation 5 44,5 Pédagogie 5 53 Informatique 2 17 Personnel 6 26,5 Communication 1 20 Comptabilité 3 12 Relations internationales
2 24
Services techniques
3 36
Intendance 1 2 Editions de la Villette
1 16
Accueil 2 31 Enseignants 4 43,5 TOTAL 35 325,5
79
8. Les locaux L’école est actuellement installée sur trois sites distincts : . l’établissement principal au 144, avenue de Flandre, 75019 PARIS ; . une annexe au 11, rue de Cambrai, 75019 PARIS, où se trouvent les salles de cours informatique, le libre-service informatique, les bureaux du service informatique, les bureaux mis à disposition des associations ; . enfin un plateau de bureaux au 118 -130, boulevard Jean Jaurès, 75019 PARIS abrite les équipes de recherche, l’association Partir et une grande salle pour accueillir les séminaires de l’établissement. Outre les difficultés de gestion occasionnées par cette dispersion sur trois sites, l’inadaptation notoire des locaux pédagogique (manque de lumière naturelle, poteaux au milieu de presque toutes les salles) se conjugue à un manque de surface disponible. La surface par étudiant inscrit est en effet en 2008 de 4,3 m2 par étudiant, soit très en dessous de la norme prescrite qui est de 10 m2 par étudiant. Il est urgent que l’ENSAPLV puisse être dotée de locaux mieux adaptés à sa vocation pédagogique, comme l’ont été la plupart des autres écoles françaises. Différentes pistes ont été explorées à cet effet en 2008, en concertation avec la Ville de Paris. En attendant une relocalisation qui ne devrait pas pouvoir s’effectuer avant plusieurs années, différents travaux ont été étudiés ou menés. Le site de l’avenue de Flandre a fait l’objet de plusieurs actions et études : - les travaux de réaménagement concernant le pavillon d’entrée et deux salles de cours (salles 210 et 212) en souffrance depuis deux ans ont été relancés auprès de la DRAC Ile de France, mandataire de ces travaux et d’ICADE, maître d’ouvrage délégué. Ces travaux ont eu lieu courant 2008 pour une livraison au printemps 2009. - le programme de mise aux normes de la cafétéria a été étudié mais n’a pu être engagé faute de crédits alloués. - l’accès à l’école a fait l’objet de travaux de réfection et de peinture du porche d’entrée sur l’avenue de Flandre.
Le site de Cambrai a fait l’objet de travaux visant à y déployer l’ensemble du service informatique et des salles de cours informatique. Trois salles de cours ont été câblées pour recevoir 60 postes informatique. Les bureaux des personnels des services informatiques ont également été aménagés. Une salle de cours équipée de 20 postes a toutefois été conservée sur le site de l’avenue de Flandre. Le site de l’avenue Jean-Jaurès accueille les quatre laboratoires et équipes de recherche et l’association Partir, ainsi que deux salles de cours ou de séminaire. Le bail 3-6-9 venant à expiration en mai 2008 a été renouvelé pour une période de 9 ans, avec la possibilité de sortie anticipée après un an.
80
9. La gestion financière Sur le plan financier l’année 2008 a été rythmée à la fois par des difficultés budgétaires et des difficultés de trésorerie. Les recettes de fonctionnement de l’exercice 2008 se montent à 5 695 867,39 € et les recettes d’investissement à 180 390,00 €. Certaines ressources propres ont pu être augmentées grâce à : - l’intégration de la totalité des charges locatives de Cambrai dans la subvention de fonctionnement ; - l’augmentation de 168% de la taxe d’apprentissage (de 28 000 à 47 000 €) ; - l’intégration de l’offre de la formation continue «ingénierie et architecture à haute qualité environnementale» dans l’école ; - l’apport de nouveaux contrats de recherche et de contrats internationaux. Toutefois, les recettes de l’ENSAPLV ont également baissé dans certains domaines : - les recettes issues des droits d’inscription ont baissé de 145 000 €, du fait de la diminution du nombre d’étudiant(e)s d’inscrit(e)s (étudiants en TPFE diplômés en fin d’année 2007) ; - la diminution des ventes (- 47 000 €) et la baisse du stock des Editions de la Villette ; - la baisse du montant global des frais de gestion sur les contrats de recherche, malgré l’augmentation de 4 points du pourcentage des frais de gestion prélevés sur les nouveaux contrats ; - la baisse de 20 000 € de la subvention d’investissement. Les dépenses de fonctionnement de l’exercice 2008 se montent à 6031300,61 € et les dépenses d’investissement à 299 199,26 €. Certaines dépenses ont été maîtrisées tout au long de l’année : - les vacations enseignantes ont toutes été analysées en fonction des besoins, afin d’honorer dans les meilleures conditions le programme pédagogique de l’école, habilité en 2008 pour 4 ans ; - les achats de fournitures et de petits équipement ont été revus à la baisse ; - les subventions accordées aux associations ont été réduites ;
- certains travaux ont dû été reportés sur 2009, par manque de moyens, notamment la mise en conformité de la cafétéria ; - les acquisitions de matériels pédagogiques, de mobiliers ont également été repoussées sur le budget suivant. D’autres charges telles que les charges de bâtiment, de location et de maintenance de matériels demeurent incompressibles. Finalement, un certain nombre de dépenses ont augmentées : - le gardiennage, charge incompressible depuis 2007 pour la sécurité de l’établissement qui a subi à plusieurs reprises des intrusions et des violences ; - les missions et les voyages pédagogiques : les workshops, les ateliers intensifs et les voyages pédagogiques font désormais l’objet d’une programmation annuelle et de prévisions de dépenses encadrées (appel d’offres lancé aux enseignants au cours de l’année n-1, instruction des dossiers par la Commission des relations internationales notamment au regard du bien-fondé pédagogique et de l’intérêt des échanges internationaux, examen de la faisabilité budgétaire et incitation à la recherche de financements extérieurs, etc.) des voyages programmés en 2007, ont dû être honorés. La mise en place dès 2008, d’un «voyage de 1ère année de premier cycle» aux Pays-Bas a également engendré un coût supplémentaire. - les honoraires se sont accrus, notamment dans le cadre des jurys de PFE et d’HMONP ; - la sous-traitance de l’organisation et la dispense de la formation continue HQE a été une charge nouvelle. Ainsi, le budget 2008 a été insuffisant pour couvrir l’ensemble des besoins. L’école a donc dû procéder à un prélèvement sur le fonds de roulement (compensé en partie par la subvention d’investissement) le réduisant ainsi à 32 jours de fonctionnement.
81
Cette solution temporaire a été trouvée en accord avec la DAPA, la DAG ainsi que le contrôle financier. L’école est désormais dans l’obligation, de reconstituer son fonds de roulement, en trouvant des solutions à long terme. Une réflexion sur la politique des locaux a été entamée dès 2008, afin de retrouver un «souffle financier», qui permettra d’honorer nos besoins et de reconstituer progressivement un fonds de roulement suffisant, élément nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement.
Le budget par enveloppes de l’ENSAPLV en 2008
DEPENSES Budget
Prévisionnel 2008
Décision modificative 2
2008
Compte Financier
2008 RECETTES
Budget Prévisionnel
2008
Décision modificative 2
2008
Compte Financier
2008
Personnel 2 261 750 2 371 890 2 370 824,37 Subventions d'exploitation 4 203 632 4 600 430 4 460 823,26Fonctionnement autre que les charges de personnel 2 946 282 3 785 646 3 660 476,24 Autres ressources 1 025 200 1 251 106 1 235 044,13
TOTAL DES DEPENSES (1) 5 208 032 6 157 536 6 031 300,61 TOTAL DES RECETTES (2) 5 228 832 5 851 536 5 695 867,39
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) 20800 Résultat prévisionnel : perte (4) =
(1) - (2) 306000 335 433,22
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)
5 228 832 6 157 536 6 031 300,61
TOTAL EQUILIBRE du comptede résultat prévisionnel (1) + (3)= (2) + (4)
5 228 832 6 157 536 6 031 300,61
TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE
EMPLOIS Budget
Prévisionnel 2008
Décision modificative 2
2008
Compte Financier
2008 RESSOURCES
Budget Prévisionnel
2008
Décision modificative 2
2008
Compte Financier
2008 Insuffisance d'autofinancement 30 950 91 341,52 Capacité d'autofinancement 295 850
Subventions d'investissement 180 000 180 390Investissement 295 850 304 880 299 199,26Autres ressources
TOTAL DES EMPLOIS 295 850 335 830 390 540,78 TOTAL DES RESSOURCES 295 850 180 000 180 390APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)
PRELEVEMENT sur FONDS DEROULEMENT (8) = (6)-(5) 155 830 210 150,78
82
L’évolution des subventions de la DAPA – 2003-2008 Subventions par année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Subvention de base de fonctionnement 2 763 731 2 827 932 2 849 062 2 849 062 3 229 062 3 721 062 Subvention totale de fonctionnement 2 826 832 2 743 094 3 590 829 3 961 562 4 145 662 3 788 987 Subvention d'investissement 224 000 400 000 190 000 230 000 200 000 180 000
Evolution des subventions DAPA - 2003-2008
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
2003 2004 2005 2006 2007 2008années
monta
nts
subvention de base
subvention totale
subventiond'investissement
La répartition des recettes de l‘ENSAPLV en 2008
Répartition des recettes en 2008
180 390,00 subvention
invest
1 235 044,13 recettes propres
4 460 823,26 subvention
fonctionnement
83
L’évolution de la taxe d’apprentissage perçue par l’ENSAPLV – 2004-2008
Année 2004 2005 2006 2007 2008 Montant perçu 20 749,00 24 649,98 16 339,87 28 067,15 46 295,58
Evolution de la taxe d'apprentissage - 2004 - 2008
- 5 000,00
10 000,00 15 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00 35 000,00 40 000,00 45 000,00 50 000,00
2004 2005 2006 2007 2008
84
L’évolution des dépenses de l’ENSAPLV – 2003-2008 Dépenses 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Dépenses de fonctionnement hors loyers 1 969 513 2 210 319 2 080 757 2 157 938 2 203 986 2 507 924 Loyers 180 922 225 749 1 188 459 1 031 485 1 082 159 1 152 552 Dépenses de personnel 1 907 551 2 065 403 2 172 337 2 519 693 2 817 202 2 370 824 Dépenses d'investissement 497 738 605 765 588 278 453 671 426 227 299 199 Total des dépenses 4 555 724 5 107 236 6 029 830 6 162 787 6 529 574 6 330 500
Evolution des dépenses de l'école 2003-2008
-
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
années
monta
nts
dépenses de fonctionnement
dépenses de personnel
dépenses d'investissement
loyers
Répartition des dépenses 2008
2 507 924 fonctionnement
1 152552 loyers
299 199 investissement
2 370 824 personnel
85
L’évolution des loyers – 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Subvention accordée pour les loyers 187 000 189 500 864 500 1 061 500 1 061 500 1 061 500 dépenses de loyers 180 922 225 749 1 188 459 1 031 485 1 082 159 1 152 552
Evolution des loyers 2003-2008
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
subvention reçueloyers
86
L’évolution du Fonds de roulement – 2003-2008
ANNEE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 FONDS DE ROULEMENT
850 810,71 879 358,32 638 008,88 723 287,23 678 920,17 468 769,39
TOTAL BUDGET 4 061 364,00 4 542 139,00 4 950 524,00 4 872 112,00 4 808 032,00 5 326 351,00 NOMBRE DE JOURS D’AUTONOMIE
75 69 46 53 51 32
Fonds de roulement - 2003-2008
- 200 000,00 400 000,00 600 000,00 800 000,00
1 000 000,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008années
monta
nts
fonds de roulement
Les jours d’autonomie – 2003-2008
Jours d'autonomie
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2003 2004 2005 2006 2007 2008
jours d'autonomie
87
Les statistiques du service financier - 2008
STATISTIQUES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bons de commande 1083 NR NR 690 791 781 767 837 813 703
Mandats 1987 2287 2312 2224 2407 2744 2677 2656 2688 2699
Rejets Mandats 49 175 106 28 53 60 37 36 30 35
% erreurs 1,26% 2,20% 2,19% 1,38% 1,36% 1,12% 1,30%
Ordre de Paiement 0 NR NR 180 190 159 148 196 178 158
Titres de recettes 26 69 82 75 80 130 187 145 213 394
Rejets Titre de recettes 0 7 0 0 4 0 10 4 1 3
% erreurs 0,00% 5,00% 0,00% 5,35% 2,76% 0,47% 0,76% Les variations - 2008
Variations 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Bons de commande 101 -10 -14 70 -24 -110
Mandats 183 337 -67 -21 32 11
Rejets Mandats 25 7 -23 -1 -6 5
Ordre de Paiement 10 -31 -11 48 -18 -20
Titres de recettes 5 50 57 -42 68 181
Rejets Titre de recettes 4 -4 10 -6 -3 2 Pourcentage - 2008
% 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 Bons de commande 15% -1% -2% 9% -3% -14% Mandats 8% 14% -3% -1% 1% 0% Rejets Mandats 89% 13% -82% -2% -10% 14% Ordre de Paiement 6% -16% -6% 25% -11% -14% Titres de recettes 7% 63% 76% -53% 52% 97%
88
10. Les services pédagogiques a. La bibliothèque Le fonds et les bases En 2008, le fonds de la bibliothèque s’est enrichi de 820 volumes, dons et achats confondus. Comme tous les ans, les dons viennent pour partie des éditions de la Villette, auxquels s’ajoutent cette année un don important de la documentation de l’Inventaire de la région Ile-de-France et d’un ancien enseignant, ainsi que des dons des ENSA de Versailles et de Paris-Malaquais, et de quelques particuliers. La base référence comprenant 24600 volumes, toutes les nouvelles acquisitions n’ayant pas encore été exemplarisées. Cet accroissement correspond à 0,30 volume par étudiant inscrit à l’école et 0,40 par lecteur inscrit à la bibliothèque. Les achats s’élèvent à 12 000 Euro, soit exactement la même somme que l’année dernière. Cette somme équivaut à 4,53 Euro par étudiant inscrit à l’école, soit une légère augmentation due à la baisse des effectifs, et 5,85 Euro par lecteur inscrit à la bibliothèque. 201 mémoires de 5e année soutenus en 2007 et 191 soutenus en 2008 ont été déposés à la bibliothèque, portant à 1846 le nombre total de ces mémoires conservés. Ils sont saisis dans la base de la bibliothèque sous forme rapide (auteur, titre, année). Les références des 217 TPFE de 2006 sont maintenant disponibles sur la base Archires. 600 des TPFE soutenus en 2007 sont enregistrés dans la base de la bibliothèque, ce qui ne correspond pas encore à la totalité. Les références de 4761 TPFE de l’ENSA de Paris- La Villette soutenus entre 1981 et 2006 sont maintenant consultables sur la base Archires. La saisie rétrospective a été suspendue en 2007 étant donné l’afflux de TPFE, elle devrait reprendre dès que possible. En ce qui concerne les PFE, les étudiants rendent maintenant un fichier PDF de leur travail en plus de l’exemplaire papier. Ces fichiers sont destinés à être accessibles à partir de la base de données dans laquelle seront saisis les PFE, un champ de la fiche descriptive étant réservé au lien avec le document numérisé. Il suffit donc de cliquer pour pouvoir consulter le document dont on vient de lire la description. Il reste à
déterminer les modalités pratiques du stockage de ces fichiers sur un serveur et des conditions de leur consultation dans le respect du droit d’auteur. Un peu plus de 80 ressources en ligne sont décrites dans la base et les dossiers documentaires, constitués essentiellement de coupures d’articles du journal Le Monde, sont régulièrement enrichis. Le fonds de polycopiés, qui n’est plus alimenté et est largement devenu obsolète du fait du départ en retraite de nombre d’enseignants aux cours desquels il correspondait, va faire l’objet d’un tri avant versement au centre d’archives intermédiaires de Fontainebleau. Le fonds des diplômes d’UP2 qui avaient été confiés en 1986 à la fermeture de l’école à la section de la documentation La Villette consacrée aux diplômes va également être versé à ce même centre. Le fonctionnement Au cours de l’année 2007-2008, 2049 lecteurs se sont inscrits (c’est à dire ont emprunté au moins une fois) à la bibliothèque soit à peu près le même nombre que l’année précédente (2058), dont 72 étudiants Erasmus et 88 enseignants. La bibliothèque a été ouverte 174 jours soit 5,5 jours de plus que l’année précédente pour 1296 heures, soit 22 heures de moins que l’année précédente, puisque les plages d’ouverture de la bibliothèque ont été légèrement réduites. Les prêts à domicile semblent maintenant être atteints par l’érosion connue par tous les établissements universitaires : 17 579 contre 20 332 l’année dernière, soit une baisse d’environ 12%. La moyenne des livres empruntés par lecteur inscrit à la bibliothèque est de 8,57 contre 9,87 l’année dernière. Il s’agit là d’un phénomène observé partout et qu’on peut semble-t-il mettre en relation avec le fait que les étudiants privilégient la recherche sur Internet, avec laquelle ils ont l’illusion de tout trouver. On ne peut que souligner une fois encore la nécessité absolue de la formation à la recherche documentaire.
89
On constate par ailleurs que, malgré la modification de la grille pédagogique due à la dernière réforme, la courbe des emprunts par jour de la semaine reste la même. Les jours où sont effectués le plus d’emprunts restent cependant les mêmes (mardi et vendredi). Le prêt sur place (des documents exclus du prêt à domicile) enregistre lui aussi une baisse : 2105 contre 3621 en 2006-07, soit une douzaine par jour, ou une baisse de près de 42 %. On peut peut-être mettre cette baisse en relation avec le fait que les étudiants ne soutenant plus de TPFE, en consultent également moins. Mais cette supposition demande à être confirmée. Le prêt inter-établissements a également diminué, passant de 137 transactions à 101 (58 demandes reçues et 43 demandes émises) en 2007-2008, soit une baisse de plus de 26%. En effet, la grande majorité des prêts inter-bibliothèques concernait jusqu‘à maintenant les TPFE. En dehors des autres ENSA, les prêts se sont effectués majoritairement avec l’INSA de Strasbourg et ponctuellement avec la SEMAPA, l’APUR, le CRESSON, laboratoire de l’école de Grenoble. Un inventaire des ouvrages a été effectué, comme tous les deux ans, aux mois de juillet et septembre. 29 ouvrages ont disparu, soit exactement le même nombre que lors de l’inventaire 2006. Il faut d’ailleurs signaler que sur les 29 signalés manquants en 2006, 6 ont été retrouvés par la suite. On peut donc considérer qu’entre 10 et 15 ouvrages disparaissent chaque année, un chiffre qui n’est pas excessif si on considère le nombre d’étudiants, sachant qu’une bibliothèque qui ne verrait aucun ouvrage disparaître reste du domaine de l’utopie. On constate également la perte de trois ouvrages. Les ouvrages perdus sont ceux qui, régulièrement empruntés, ont été perdus par leur emprunteur. L’informatique La version 3.8 du logiciel Loris a été reçue, mais pas encore installée en raison de quelques problèmes survenus sur d’autres sites l’ayant installé. La société Ever qui développe le logiciel implanté à la bibliothèque (LORIS/DORIS) a annoncé qu’elle arrêtait la maintenance en décembre 2008. A la suite d’une négociation avec le club des utilisateurs de ce logiciel, la date a été repoussée à la fin 2009.
Cette échéance très proche donne à l’occasion de l’ensemble des bibliothèques des ENSA de réfléchir à sa réinformatisation en lien avec la mise en place d’un portail inter écoles permettant entre autres l’interrogation multicatalogues et l’échange de notices.
comparaison des emprunts de 2003-04 à 2007-08
0 1000 2000 3000 4000
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
nbre d'emprunts
2007-082006-072005-062004-052003-04
90
b. Le centre de documentation Le fonctionnement et le fonds Ouvert tous les jours de 10h à 18h, excepté le mercredi (14h-18h), le centre de documentation recense 344 titres de revues et périodiques français et étrangers dont 156 abonnements en cours. Les domaines couverts sont l’architecture, la construction, le patrimoine, l’aménagement et l’urbanisme, l’art, le design, le paysage et les jardins, les sciences humaines et sociales. 156 CD-ROM géographiques, techniques et bibliographiques, 820 cartes et plans, des guides et des annuaires, des dossiers thématiques et 9 encyclopédies juridiques et techniques régulièrement mises à jour complètent l’offre documentaire. Pour l’année scolaire 2007/2008, 1151 prêts à domicile de revues ont été enregistrés, ainsi que 1578 prêts pour consultation sur place de Cdroms, cartes, atlas, POS et autres ressources. Trois nouveaux abonnements à des périodiques ont été souscrits et 9 Cdroms acquis dont la totalité du plan parcellaire parisien au 1/1000e et le plan local d’urbanisme versions 2008. Les abonnements en cours, titres payants et gratuits confondus, ont enrichi les collections d’environ un millier d’unités et 144 numéros des titres les plus consultés ont été reliés dans 35 volumes. Le centre qui participe au réseau national des écoles d’architecture en étant coproducteur de la base de données ARCHIRES (dépouillement des revues d’architecture et d’urbanisme) a, à ce titre, versé 67 notices de la revue « Histoire urbaine » dans la base. L’informatique Neuf postes informatiques permettent la consultation des catalogues informatisés du fonds. Le service dispose de 2 scanners A3 et d’un photocopieur pour la reproduction des documents. En collaboration avec le service informatique les photographies aériennes et les plans numérisés disponibles en accès indirect sur Cdrom sont progressivement transférés sur le réseau Intranet de l’école et une version bêta d’un moteur de recherche et de téléchargement de fichier est en cours de test.
c. La vidéothèque - diathèque Le fonctionnement et le fonds Le fonds s’est accru de 301 DVD (268 achats et 33 dons). Ce qui représente un total de 461 documents: - 295 films documentaires - 90 films de fictions - 63 films-essais ou films expérimentaux (longs métrages) - 13 courts métrages Ont été souscrits également 4 abonnements (Cahiers du cinéma, Images documentaires, Positif, Télérama) et 1 adhésion à une association professionnelle (Images en Bibliothèques). Par ailleurs, la vidéothèque rassemble un total de 3.124 supports vidéo : - 1.588 DVD (50.8 % des supports) - 1.507 vidéocassettes (48.3 % des supports) - 29 CD-ROM (0.9 % des supports) Elle possède aussi un fonds de diapositives (9.697 diapositives réparties en 154 programmes thématiques) et un fonds d’archives sonores : le fonds Pierre Mariétan-LAMU composé de 87 CD-audio. La vidéothèque compte 568 inscrits répartis comme suit : - 510 étudiant(e)s de l’ENSAPLV, - 22 Erasmus entrants, - 33 enseignant(e)s - 3 personnels administratifs. Elle a dénombré 4077 emprunts (3739 informatisés, 338 papiers) = 7,2 documents par emprunteur. 375 personnes sont venues consulter sur place et ont visionné 619 vidéos et DVD et quelques programmes de diapositives. Il est à noter que le nombre d’inscrits est en légère augmentation soit 568 personnes contre 520 en 2006-2007. A l’inverse, on constate une baisse des consultations sur place 375 personnes contre 619 en 2006-2007 et une légère diminution des documents empruntés 4070 emprunts contre 4892 en 2006-2007.
91
Les modes d’acquisition Tous les documents conservés à la Vidéothèque sont acquis dans le respect du droit d’auteur. Environ 80% des achats se font auprès de l’ADAV, une centrale d’achat réservée aux secteurs culturels et éducatifs non-commerciaux, ou auprès d’éditeurs/diffuseurs institutionnels. Les 20% restant doivent être négociés au cas par cas et faire l’objet d’une convention avec les ayants droit (producteur, distributeur, réalisateur). La collection est définie par une politique documentaire qui correspond à la pluridisciplinarité de l’enseignement dispensé dans notre école. Environ 20% du fonds sont constitués sur demande des enseignants et des étudiants pour ce faire un cahier de suggestions est à leur disposition. Les réseaux La Vidéothèque fonctionne avec le logiciel Loris, commun à la plupart des ENSA, administré, pour l’ENSAPLV, par la Bibliothèque. Elle est connectée en réseau avec la Bibliothèque de l’ENSAPLV et avec les médiathèques des autres ENSA. Son catalogue est interrogeable sur internet. Elle copilote, avec l’ENSA de Nancy, la Commission «Audiovisuel» des écoles, qui est un réseau de veille documentaire et de négociation groupée d’achats de droits d’auteur. Elle est membre de la Commission «Thesaurus» des ENSA (outil de veille et de mise à jour permanente du vocabulaire normalisé de description des documents). Elle est membre de l’association Images en Bibliothèques, un réseau de médiathèques créé sous l’égide du Ministère de la culture, pour laquelle elle fournit un travail régulier d’analyse et d’évaluation de films documentaires. d. L’atelier photo Le fonctionnement L’atelier photo fonctionne sous la responsabilité d’un photographe titulaire et a pour objectif d’aider les étudiants à pratiquer la photographie, et ce dès la première année de leurs études. Sa fonction principale est de soutenir l’étudiant dans sa démarche, en mettant à sa disposition du matériel et des espaces adaptés à la réalisation de projets incluant l’image photographique. L’atelier photo gère l’organisation de l’atelier (planning studio/laboratoire N&B), le suivi et l’entretien du matériel et des locaux, ainsi que le prêt du matériel photo.
Il assure une fonction pédagogique en mettant en place, pour les étudiants, des ateliers spécifiques (prises de vue/laboratoire N&B/suivi de projet photographique), et en intervenant ponctuellement dans des cours ou encore en participant à des voyages d’études. Il assure aussi une mission de conseils pour les enseignants souhaitant mettre en place un projet photographique. L’atelier photo est aussi très impliqué dans la politique et le choix des expositions présentées au sein de l’école en tant que commissaire d’exposition ou en tant que conseiller pour le choix du programme. Depuis octobre 2008, l’atelier photo est directement impliqué dans la pédagogie avec la mise en place d’un cours optionnel en photographie à partir du cycle Master. 35 étudiants ont suivis cette formation à raison de 3h30/semaine. Dans le cadre de ce cours, les étudiants étaient amenés à fréquenter assidûment l’atelier une vingtaine de fois/semestre afin de réaliser leurs exercices, ce qui représente 700 visites. L’intérêt suscité par le nouveau cours photo et l’usage de la photographie dans d’autres cours, ont entraîné une augmentation de la fréquentation et une activité constante de l’atelier photo. A ceci s’ajoute la fréquentation assidue d’une vingtaine d’étudiants passionnés par la photographie et fidélisés par l’atelier. Toutefois la fréquentation de l’atelier par les étudiants dépend, comme pour les autres services, du calendrier scolaire. On observe des pics de fréquentation importants en décembre-janvier et en mai-juin. En dehors de ces périodes, 3 à 6 personnes par jour fréquentent l’atelier. Par ailleurs, le prêt de matériel est relativement actif et quasi quotidien. On peut l’estimer à environ 500 demandes (appareil numérique et appareils argentiques, pied photo, matériel d’éclairage). D’autre part l’atelier photo participe aux différentes manifestations de l’école comme la présentation du travail des étudiants du cours photo lors des journées « portes ouvertes ». L’atelier photo réalise régulièrement des reportages sur les activités (cours, expositions, conférences, colloques) et services de l’établissement. Une trace photographique de la vie de l’école est ainsi sauvegardée et archivée. Ces documents photographiques illustrent la plupart des documents de documentation ou de communication produits par l’ENSAPLV.
92
e. L’atelier vidéo Le fonctionnement L’atelier vidéo dispose de matériels et de tables de montages analogiques et numériques, avec les logiciels adaptés. Il permet aux étudiants de s’initier à la vidéo et de réaliser des films aux standards quasi-professionnels. Le studio vidéo de l’ENSAPLV est un véritable carrefour de communication et d'échanges entre les enseignants et les étudiants qui viennent pour préparer leurs projets. Le taux de fréquentation annuel en moyenne est de 20 enseignants et 400 étudiants. L’atelier vidéo fonctionne en articulation institutionnalisée avec des unités d'enseignements ainsi que dans le cadre d'un laboratoire d'approfondissement des projets (ouvert à tous les enseignants et étudiants sur projet précis ). Il assure une assistance pédagogique (caméras , bancs de montage numériques, prises de son, notion d'éclairage….). Par ailleurs, il organise des sessions de formation sur les logiciels de montage numérique. pour les projets et les unités d'enseignements (en moyenne 6 sessions; d'autres peuvent être programmées à la demande des étudiants). Par ailleurs, il assure les prises les enregistrements (vidéo et son) des différentes manifestations de l’école : conférences, colloques, séminaires, expositions et interventions d’enseignants ou de personnalités externes (soit 30 par an). Le matériel Chaque machine dispose des mêmes logiciels, Première pro, Final Cut, After-effets, Photo-shop, Flash ainsi que des logiciels permettant la création de DVD. Tous les ordinateurs sont en réseau et disposent d’un serveur vidéo de stockage. L’atelier dispose également de 6 caméras DV dont 5 Dvcam, éclairage de prise de vues, 10 micros, 2 perches, 10 pieds, 4 Tascam dr1 , moniteur de tournage, mixette, dat, 1 caméra super 8, 1 caméra Hi8 ... Ses missions L’atelier vidéo assure également les missions suivantes : - Planification des occupations des bancs de montages numériques pour les rendus des enseignements , diplômes, mémoire (selon le type de projet la moyenne du temps passée est de 2 jours à 20 jours sur un poste) - Prêt du matériel (caméra, prise de son, éclairage…..) et assistance technique et conseils en réalisation vidéo :
- Montages vidéo pour les cours, conférences, diplômes, expositions, et séminaires. - Montage et réalisation des films sur les différentes manifestations de l’école ainsi que les associations sur support numérique (DVD) Les projets sont répertoriés, stockés et archivés au studio-vidéo afin de servir de base et de support pour les enseignements futurs (7 DVD déposés a la vidéothèque). f. L’atelier maquette Le fonctionnement L’atelier maquette est ouvert 35 heures par semaine pour une présence journalière de 15 à 30 étudiant(e)s sous la responsabilité du responsable d’atelier. Une nocture est organisée un soir par semaine jusqu’à 22 heures. Les étudiant(e)s apportent leurs matériaux et reçoivent un accompagnement pédagogiques, des conseils. Ses missions L’atelier maquette : un lieu de recherche, de production, mais aussi d’échange et de convivialité. Les étudiant(e)s disposent de 120m2, équipé de machines et d’outils divers pour réaliser des maquettes et des prototypes (mobilier, structures, art plastique….). Le cours de maquette Le cours de maquette du premier semestre s’adresse à une cinquantaine d’étudiant(e)s de troisième année de premier cycle. Il apporte un savoir faire à travers des sujets adaptés utilisant tous les matériaux et échelles. Les conditions matérielles d’espace et de sécurité obligent à limiter à 50 le nombre d’inscrits. Le cours du second semestre de première année de second cycle propose de faire une analyse constructive d’un bâtiment manifeste à travers sa réalisation en maquette volume. Le cours d’architecture navale L’atelier est le berceau du groupe architecture navale. Il est le point de rendez-vous, des corrections en petit comité de projet de navire (dans le cadre du PFE et du DPEA). C’est aussi le lieu privilégié des échanges autour du lien géométrie/forme et construction. Les travaux représentatifs y sont exposés et servent de supports pédagogiques.
93
Le cours d’objet en béton UHP moulé L’atelier est un lieu également investi par le cours de conception et de réalisation d’objet en béton ultra haute performance. Des moules, des maquettes et des prototypes de meubles et des objets béton y sont ainsi réalisés. Les équipements L’atelier maquette est équipé de scies sur table, de raboteuses et de dégauchisseuses, de scies ruban, de lapidaires, de ponceuses à bande, de tours et de fraiseuses, de perceuses à colonne, de cabine de peinture et de compresseur, d’aspiration centralisée, de fils chaud et électroportatif divers et de trois postes informatiques. L’atelier maquette a également pour projet d’acquérir un robot fraise\fils chaud à commande numérique et une machine à découpe laser. Ces équipements très complets permettent de réaliser des maquettes avec toutes sortes de matériaux à des échelles très variées. Par ailleurs, des travaux ont été programmés sur les deux prochaines années : la mise aux normes d’hygiène et de sécurité et l’augmentation de sa capacité d’accueil. g. La reprographie Le fonctionnement La reprographie permet d’éditer les cours et les polycopiés. Ouvert tous les jours, l’atelier de reprographie est géré par une personne à temps plein. Il réalise deux millions de copies par an. Par ailleurs, plusieurs photocopieurs en libre service au sein des locaux sont mis à la disposition des enseignant(e)s et des étudiant(e)s. h. L’informatique Le personnel Le service informatique est composé de six personnes réparties sur deux sites et bénéficie de l’aide des chercheurs du laboratoire ARIAM et de stagiaires ponctuels pour le développement d’applications spécifiques. Ses activités couvrent les trois sites de l’ENSAPLV (avenue de Flandre, avenue Jean Jaurès et rue de Cambrai). Ses missions Il maintient l’ensemble des machines (environ 350 postes) et assure le bon fonctionnement du réseau
(commutateurs, routeurs… soit 45 machines. Il garantit la maintenance de la messagerie et la protection du réseau face aux multiples attaques émanant de l’extérieur. Il établi une charte de bonne conduite pour l’ensemble des postes (installation sauvage, destruction de fichiers, respect des répertoires…). Il installe et maintient l’ensemble des postes dédiés aux équipes et laboratoires de recherche (environ 40 postes). En 2008, un groupe de travail a été constitué afin de définir un nouveau site Internet et mettre en place un Intranet pour les administratifs, les enseignant(e)s et les étudiant(e)s de l’ENSAPLV. Le matériel L’ENSAPLV compte 26 serveurs informatiques, dont son propre serveur Internet (administratifs, pédagogiques, recherche…), son serveur de courriel, les serveurs des laboratoires de recherche de l’école et des Editions de la Villette. Il administre également les serveurs de courrier et le serveur DNS des ENSA de Val de Seine, Belleville et Marne La Vallée. L’ENSAPLV dispose de quatre salles de cours équipées de 80 postes informatiques (avec un ensemble de 40 logiciels pédagogiques), dont trois ont été redéployées rue de Cambrai, annexe de l’école. Il assure la maintenance et la gestion de 350 ordinateurs, 200 imprimantes et traceurs, 90 portables (dont 49 dédiés à la Recherche et 10 à l’administration), 196 logiciels et environ 250 machines diverses (commutateurs, routeurs, armoires techniques et petits matériels…). Tous les sites de l’ENSAPLV sont équipés en WIFI (liaison internet sans fil haut débit). Le budget informatique en 2008 (pédagogie, administration, recherche) Domaines Budget Matériel 116 800 Logiciel 44 000 Consommables 35 000 Réparation 8 000 Maintenance 6 000 TOTAL 209 800
94
Les réalisations en 2008 En 2008, une salle de cours a été installée avec un processus de virtualisation (vmware) des machines. L’accueil positif des enseignants et des étudiants permet d’envisager la mise en place de ce dispositif sur l’ensemble des salles de cours en 2009. Le débit Internet est passé de 2 Mbt/s à 4 Mbt/s et un nouveau serveur de courrier de type Webmail a été déployé. Un module de saisie de notes pour les enseignants a été développé permettant ainsi la consultation des résultats via un Intranet pour chaque étudiant. Par ailleurs, un comité de pilotage inter-service a été constitué afin de concevoir un nouveau site Internet en vue de son déploiement courant 2009. Les perspectives Une étude est actuellement en cours afin de mettre en place pour toutes les salles de cours de l’ENSAPLV le processus de virtualisation. L’augmentation du débit Internet devrait également permettre d’accéder à 10 Mbt/s. Enfin, une réflexion est menée actuellement sur la mise en place d’un système de paiement par carte pour les imprimantes et traceurs. i. Le libre service informatique Le fonctionnement Le libre service informatique est ouvert cinq jours sur sept aux étudiant(e)s. Il est encadré par un responsable et des moniteurs qui en assurent le bon fonctionnement et l’utilisation et la réservation des machines du libre service. Les étudiants sont invités à fournir les consommables. Le matériel Le libre service informatique compte 120 postes de travail (de type Pentium 3 et 4) en libre service, dotés de logiciels professionnels. Il compte également deux traceurs A0, deux imprimantes laser A3 noir et blanc et un scanner de diapositives. Chaque machine du libre service informatique dispose des mêmes logiciels que les salles de cours informatiques et est reliée au réseau de l’école afin de permettre la gestion des droits d’accès, des licences, les connexions à Internet et le partage des données.
Les données (fichiers Autocad, image jpeg…) sont sauvegardées sur les disques durs des machines des salles de cours dans des bibliothèques portant le nom de l’étudiant. Ainsi, elles peuvent être lues et modifiées, par la suite, sur les machines du libre service informatique.
96
11. La communication a. Les supports de communication La publication d’un dépliant actualisé en 2008 présentant en 10 pages l’ensemble des activités de l’école a permis de disposer d’un support de communication pour présenter l’école. Il a été imprimé à 3000 exemplaires. Une version en anglais a également été éditée, imprimée à 1000 exemplaires. Pour faciliter la vie des étudiants et en particulier des nouveaux entrants dans les différentes années, un livret de l’étudiant a également été rédigé et imprimé à 1000 exemplaires dans sa version actualisée en 2008. Il comprend un abécédaire d’environ 120 entrées sur la vie pédagogique, les bourses, des renseignements pratiques et un trombinoscope du personnel administratif. b. La journée portes ouvertes Suite au succès de la journée Porte Ouverte organisée en 2007, une journée “portes ouvertes” s’est déroulée le 15 mars 2008 dans l’objectif de mieux faire connaître l’école aux futurs candidats aux écoles d’architecture. Cette journée a permis aux visiteurs de rencontrer des enseignants, de questionner le personnel administratif et de voir un panel de travaux d’étudiants Suite à l’affluence très importante (plus de 2000 visiteurs) 5 réunions d’informations ont été organisées et 500 dossiers d’inscription ont été distribués sur place. c. Les actions de communication externe L’ENSAPLV a participé au Salon de l’Etudiant et au salon des formations artistiques organisé au parc des expositions de la porte de Versailles. Elle a organisé une réunion d’information pour les conseillers d’orientation de la SNCF.
Le site Internet de l’école, www.paris-lavillette.archi.fr s’est enrichi en 2008 de nouvelles actualités et de nouvelles rubriques et a évolué pour constituer un outil d’information et de gestion au quotidien. Il a reçu environ de 25000 à 30000 visites par mois en 2008. ANNEES 2007 2008 PAGES VUES 1 377 471 1 215 474 VISITES 302 884 340 425 VISITEURS 293 486 269 918
RECORD ABSOLU DE PAGES VUES
VISITES VISITEURS
14 168 (20/06/2007)
2 934 (11/02/2008)
1 859 (11/02/2008)
Si l’on constate une légère baisse du nombre de pages vues, le nombre de visites est, en revanche, en constante augmentation. Un groupe de travail a été constitué pour définir et préparer la refonte du site Internet, avec le double objectif d’en faire un outil de communication international pour l’ENSAPLV et un outil pour la vie quotidienne des enseignants, des étudiants et du personnel administratif de l’établissement. La signalétique de l’école a été repensée. Un calicot portant le nom de l’école a été apposé début 2008 à l’entrée extérieure et sous le porche d’entrée de l’école. Une carte de vœux originale a été éditée pour les années 2008 et 2009. Enfin, une brochure présentant de manière synthétique l’ensemble de l’offre pédagogique de l’école a été publiée.
97
d. Les expositions L’ENSAPLV dispose d’une salle d’exposition ouverte au public où alternent en permanence la présentation de travaux d’étudiants, de résultats de workshops internationaux et des expositions invitées sur des thèmes touchant à l’architecture, à la ville et aux expressions plastiques. La salle d’exposition est équipée de : - 3 vidéo projecteurs - 4 lecteurs DVD et CD + 1 lecteur VH - des projecteurs amovibles sur rails. Une douzaine d’expositions ont été présentées dans la galerie en 2008. Janvier 2008 - du 9 janvier au 8 février : L’OULIPO ET LA VILLE Conception et réalisation d’Emmanuelle Bouyer, architecte et Xavière Bouyer, plasticienne L'exposition présente la rencontre de L'Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle) avec la ville sous ses différentes formes : leurs écrits sur et à partir de la ville, mais aussi leurs interventions dans la ville. : livres, textes, projets réalisés ou potentiels dans l'espace urbain, des films, des objets , des cartes issues de jeux sur la ville. Plusieurs lectures et ateliers d’écriture ont été organisés dans l’école. Février 2008 - PASSERELLE V Exposition : L'expérience Karosta (Lettonie) Exposition Bilan de l'expérience de quatre étudiants de l’école autour d'un projet architectural en Lettonie. Partenaires : L.N .Pinton - F. Marchand - E. Valentin - T. Labat, Passerelle V/Exyzt Mars 2008 - du 10 au 16 mars : VIVRE AUTREMENT : LA RUE REBIERE - du 18 au 28 mars : ARCHITECTURE NAVALE Exposition des derniers travaux sous la direction de Dominique Presles, Commissaire de l’exposition : Pascal Hannequin. Avril 2008 - du 1 au 18 juin : EXPOSITION AUTOUR DU TRAVAIL D’ALAIN CAVALIER : LE REGARD A L’ŒUVRE Commissaires de l’exposition : Jean Desmier, enseignant et Géraud Sarret, étudiant.
Par ailleurs, chaque jour ont été projetés des films d’Alain Cavalier et d’autres cinéastes (Van Des Keuten, Dieutre, Kawase) s’inscrivant dans les thématiques suivantes : regards sur l’autre - portraits, regards sur soi, autoportraits, regards croisés… Une rencontre avec Alain Cavalier s’est déroulée le 9 avril. Mai-Juin 2008 - du 13 au 6 juin : LE DESSIN D’ARCHITECTURE Exposition de Didier Ghislain Architecte de formation, donc attentif aux espaces et à leur représentation, Didier Ghislain est fasciné depuis toujours par les problèmes de la perception, de la vision, de l'illusion... Commissaire de l’exposition : Christian Morandi, enseignant - du 7 au 10 juin : ARCHIVOILE Exposition des 39ème et 40ème Course de l’Edhec –2007-2008 - 20 juin : PASSERELLE V La Merigue, chantier total de Bastien Gache et Tiffany Timsiline en Ardèche - du 23 juin au 11 juillet : CONNAISSEZ-VOUS PARIS : TERRITOIRE ? Présentation des travaux d’étudiants de première année de premier cycle sous la direction de Philippe Duboy, architecte et historien et de Valérie Jouve, plasticienne, enseignants de l’école. Octobre 2008 - du 13 au 25 octobre : ATELIERS INTERNATIONAUX ET COOPERATIONS Exposition des ateliers sur l’argentine, le Brésil, la Bolivie, Cuba, la Bosnie l’Egypte, l’Ethiopie, l’Italie, le Vietnam avec une présentation des travaux de première année de second cycle de 2006-2008 de l’Atelier El Alto (Bolivie). Novembre 2008 - DOMICILES : Gilles Raynaldi : dans le cadre du Mois de la photo Gilles Raynaldi utilise son approche documentaire pour répondre à une question nouvelle : que trouve-t-on derrière les portes, les fenêtres , les grilles que nous longeons chaque jour ? A quoi ressemblent les intérieurs de toutes ces habitations ?
98
- ERASMUS Présentation et bilan des travaux d’étudiants partis dans les universités d’architecture à l’étranger au cours de l’année universitaire 2007/2008. Décembre 2008 - DJAKARTA Présentation des travaux d’étudiants du DPEA "MAP : Métropole d’Asie Pacifique". Hors les murs - à partir du 5 juin : Marie Compagnon, Christine Papin et Christian Morandi Une exposition des travaux réalisés par les étudiants de première année de premier cycle sur le thème du cirque a été organisée dans le hall de l'Académie Fratellini - Quartier du Landy, rue des Cheminots 93210 Saint-Denis la Plaine. - Par ailleurs, dans le cadre de l’enseignement de projet de seconde année de second cycle, une exposition sous la direction de Fiona Meadows et Mongi Hammami a été organisée à la Maison de la Vie Associative sur le site du Hanul à Saint-Denis au 19 rue de la Boulangerie. Cette exposition s’est déroulée dans le cadre de la semaine de l’égalité à Saint-Denis. e. Les conférences 23 janvier - L’ARCHITECTURE MODERNE A SAO PAULO
Francisco Segnini - Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université de Sao Paul
10 mars - MONDIALISATION ET PROFESSION D’ARCHITECTE Gaétan Siew, architecte et président de l’Union internationale des architectes (UIA)
13 mars - L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE EN BOIS, UNE REPONSE AU DEVELOPPEMENT DURABLE Jean-Claude Bignon, architecte , directeur du CRAI, ENSA de Nancy :
26 mars - DE L’IMPORTANCE DU DESSIN Claude Parent, architecte
27 mars - PAYSAGES URBAINS, UNE FRANCE INTIME 9 avril - Rencontre avec Alain Cavalier 11 avril - L’ARCHITECTURE ENVIRONNEMENTALE
Alan Short 18 avril - TEMPS ESPACE ET CHIFFRES EN CHINE : LA
NAISSANCE DU SENTIMENT DE L’ESPACE Zhang Yukun, professeur, directeur de l’école de Tianjin
Les cycles de conférences du 13 mai au 6 juin
- L’EXERCICE DU REGARD ET LA REPRESENTATION L'ENSA de Paris la Villette a organisé durant le mois de mai 2008 un cycle de conférences sur le thème des représentations autour de l'exposition de Didier Ghislain "le dessin d'architecture". - 18 heures : conférence sur le thème "ARCHITECTURE D'UN DESSIN ANIME" de Frédéric Nagorny, professeur à l'école des Gobelins. - 19 heures : conférence sur le thème : "LA REALISATION NUMERIQUE" de Marie-Anne Fontenier et Philippe Meis de l'école "SUPINFOCOM Valenciennes".
13 mai amphithéâtre 302 de l’école
Ces conférences ont été illustrées par la projection de films réalisés par les étudiants de ces deux écoles et par la projection du film "Persépolis", réalisé par Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud.
20 mai à 18 heures amphithéâtre 11 de l’école
- Conférence de Didier Ghislain "LE DESSIN D'ARCHITECTURE" suivie d’une visite de l’exposition consacrée à une rétrospective de son œuvre.
28 mai amphithéâtre 11 de l’école
- Soirée consacrée à la REALITE VIRTUELLE * 18 heures, conférence de Jean-Pierre Peneau, architecte, chercheur, ancien directeur du CERMA sur le thème " vers une imagerie fonctionnelle" ; * 19 heures, conférence qui présentera "LA SALLE IMMERSIVE LE CORBUSIER " par Eric Lebegue, chercheur au CSTB.
26 novembre
- IMAGES HABITEES PHOTOGRAPHIES DE L’INTERIEUR Philippe Bonnin, directeur de recherches au CNRS, IPRAUS.
99
Centre Sud 31 janvier - LA PRESENTATION DU LIVRE
"La favela d’un siècle à l’autre" Mythe d’origine, discours scientifiques et représentations virtuelles de Licia Valladares, professeur de sociologie à l'université de Lille-Let membre du laboratoire Clersé Valladares Licia. Discutante / Modératrices : Agnès Deboulet, sociologue, ENSA la Villette Merril Sineus, architecte, ENSA la Villette - "HENRI COING, RETOUR DANS L’ILOT N°4" En 1960, le plan d'urbanisme de Paris prévoit de démolir dix-sept îlots insalubres, identifiés depuis 1920 comme des territoires dangereux sur un plan sanitaire et social. L'un de ces îlots, le numéro 4, est situé dans le 13ème arrondissement de PARIS, Henri COING, sociologue, enquête sur la réaction des habitants face à la démolition et la reconstruction. Les réalisateurs l'interrogent 40 ans plus tard sur les lieux même de l'îlot disparu.
14 mai
Cette projection a été suivie d'un débat en présence de : Catherine TISSIER, réalisatrice, Henri Coing, sociologue et Yankel Fijalkow, géographe.
3 déc. - Débat "QUAND LA BANLIEUE EST POLITIQUE. BANDES, GHETTO URBAIN : RECITS ET ANALYSES". Autour de deux parutions et en présence des auteurs. - "J'ETAIS UN CHEF DE GANG", de Lamence Mazdou et Marie-Hélène Bacque, ed. la Découverte. - Et "GHETTO URBAIN, SEGREGATION, VIOLENCE, PAUVRETE EN FRANCE AUJOURD'HUI", de Didier Lapeyronnie. Ed. Robert Laffont.
100
12. Les Editions de la Villette Site Internet : http://www.paris-lavillette.archi.fr/editions/f/index.php Les Éditions de La Villette sont un département de l’ENSAPLV. Elles ont été créées en 1980 afin d'offrir au monde universitaire mais aussi aux professionnels des ouvrages fondamentaux sur les domaines relatifs à l’architecture, la ville et l’aménagement. Elles développent également une activité de promotion de la culture architecturale auprès de publics amateurs en publiant des écrits relevant de problématiques sociales, techniques ou esthétiques liées aux arts de l’espace. La politique éditoriale se concentre autour de trois axes : les ouvrages à vocation didactique, les textes fondamentaux modernes (auteurs du 19e et 20e siècle souvent traduits pour la première fois en français) et les essais liés à l’actualité du monde contemporain. Depuis leur création, quelques 120 ouvrages ont été publiés, plus de 90 sont encore inscrits au catalogue. En 2008, quelques 11 676 ouvrages ont été vendus via Volumen avec un taux de retour des livres de faible à comparer avec la moyenne nationale de la profession mais un fléchissement de tendance est apparu pour tout le quatrième trimestre. À cela s’ajoute des ventes directes pour un total de 859 ouvrages. Le franchissement de la barre de 12 000 ouvrages dans l’année est à remarquer. L’accord passé avec Volumen garantit aux publications des Éditions de La Villette d’être présentes ou connues de 770 points de vente ; en France et à l’étranger. La diffusion à l’étranger représente un total de 1 200 livres environ. Un pourcentage qui correspond à plus du double de la moyenne nationale. Les deux tiers de ce volume a été réalisé par le service export de Volumen, le dernier tiers résulte de l’action du Centre d’exportation du livre français (CELF). Environ 20% de ces exportations sont faites en direction du Maghreb. Par l’intermédiaire du Bureau international de l’édition française (BIEF), les Éditions de La Villette ont été présentes dans onze salons ou foires du livre à l’étranger : Casablanca, Jérusalem, Buenos Aires, Téhéran, Varsovie, Thessalonique, Séoul, Le Cap, Belgrade, Guadalajara, Alger, Taipei, Budapest et Francfort.
Les Éditions de la Villette ont été invitées par la Foire de Guadalajara dans le cadre de l’action menée par les éditeurs français en faveur du livre d’art. Les parutions de 2008 Onze ouvrages sont parus en 2008 : - Le Grand jeu à venir de Libero Andreotti, - La Critique architecturale de Rainier Hoddé et Agnès Deboulet, - Régionalisme de Jean-Claude Vigato, - La Construction fonctionnelle moderne d’Adolf Behne, - La Vérité en art de Philippe Sers, « Ruine » de Sophie Lacroix, - Paris Métropole, formes et échelles du Grand Paris de Philippe Panerai, Le Corbusier, moments biographiques, - Les Cahiers de l’école de Blois n° 6, eaV 13 et la revue L’Esprit des matériaux n°1 : Bétons. Ces quatre derniers titres étant réalisés en partenariat. Trois séances de l’émission Métropolitains sur France Culture ont été consacrées à des ouvrages des Éditions : l’une sur l’ouvrage de Mario Carpo L’architecture à l’âge de l’imprimerie et deux à l’ouvrage de Philippe Panerai Paris Métropole, formes et échelles du Grand Paris. S’y ajoutent des compte-rendus dans la revue Urbanisme et différents autres médias spécialisés. La revue Esprit à notamment sorti en bonne feuille un des chapitre de l’ouvrage de Philippe Panerai et consacré dix pages à l’auteur et dix pages de recension. Le site internet des Éditions reçoit une moyenne de 1600 à 1800 visites par mois. 80% des visiteurs proviennent de France, 10% d’Europe et les 10% qui restent, se répartissent entre les autres continents. Cela constitue une augmentation de près de 15% par rapport à l’année précédente.
101
13. Les associations Plusieurs associations hébergées à l’ENSAPLV sont venues conforter par leur action le bilan pédagogique de l’école. Le Centre Partir Le Centre Partir a pour mission de former les architectes à l’intervention sur le bâti rural ancien par l’intermédiaire de stages sur le terrain en liaison avec des antennes régionales. A ce jour près de 1800 étudiants et jeunes architectes ont participé à ces stages. Atelab Atelab est une structure composite opérationnelle de recherche rapprochant les domaines de l’architecture et de l’urbanisme dans une démarche pluridisciplinaire. Didattica Didattica travaille à la croisée de l’architecture et de l’éducation et organise notamment des actions de sensibilisation à l’architecture en milieu scolaire. Pédagogies et Architecture Pédagogies et Architecture a pour objectif le développement et la sensibilisation à l’architecture et à la ville en milieu scolaire et en direction de la société. La Villette Etudiante L’association des étudiants, «La Villette Étudiante», a pour vocation d’agrémenter la vie étudiante par des spectacles, des soirées, des expositions, des activités ou encore des rencontres. Elle contribue à la réalisation ou au soutien de projets étudiants. L’association invite tous les étudiants à venir discuter de leurs envies, mais également des divers problèmes rencontrés dans l’école. Le local de l’association La Villette étudiante se situe au rez-de-chaussée près de l’atrium. Il est ouvert à tous et une permanence hebdomadaire y est assurée. Tout au long de l’année, l’association La Villette Étudiante propose les activités suivantes :
Les Jeudis de la K’Fet Alternance de concerts, de projections, de performances ou encore de soirée à thèmes présentées dans la cafétéria. Ces soirées ont lieu généralement tous les 15 jours le jeudi soir. Les partenariats Le sport Une demande pour bénéficier d’un créneau horaire dans un gymnase parisien a été formulée au début de l’année 2008, permettant aux étudiants de l’école de bénéficier d’un lieu pour se retrouver collectivement, se divertir et se dépenser. La demande de l’association est de pouvoir utiliser cet équipement trois fois (deux heures) par semaine, pour permettre une diversité des sports proposés (basketball, football et volley). La Coupe transversale Le tournoi inter école d’architecture, nommé «Coupe Transversale» est une rencontre sportive annuelle entre des délégations représentant les différentes Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture de France. Il se déroule essentiellement sur deux jours. Son but est de réunir les étudiants en architecture dans un contexte amical autour d’un évènement sportif fédérateur : football, volleyball, basketball. La volonté est d’organiser un week-end sportif qui pourra être réorganisé chaque année par différentes écoles. Le tournoi préparé en 2007 s’est déroulé à Grenoble les 3 et 4 mai 2008. Une cinquantaine d’étudiants ont participé à cet événement, et ont ramené à l’école la coupe du tournoi de basket-ball. Le paintball En 2008, l’association a développé cette activité au vu de l’engouement et des demandes exprimées l’an passé. Les expositions et les projets L’association soutient les projets étudiants souhaitant un appui logistique, financier, etc. après présentation des projets aux membres de l’association.
102
Les soirées Le 8 février 2008, une soirée pour les derniers TPFE et les premiers PFE s’est déroulée. L’association souhaite réitérer cette expérience pour la nouvelle promotion 2008-2009. L’Architeuf La soirée annuelle de l’école, dite « Architeuf», s’est déroulée le vendredi 27 juin 2008. Pour la préparation de cette grande soirée, les étudiants ont été mis à contribution. Un concours d’affiche (Architeuf #08) a été organisé dans l’école, et des groupes d’étudiants se sont formés pour préparer la décoration de la soirée. Cette grande fête, attendue avec impatience par l’ensemble des étudiants de l’école et des autres écoles d’architecture parisienne a réuni plus de 2000 personnes. Archivoile L’ENSAPLV organise diverses activités nautiques : pratique du canoë, de la voile. Elle est également régulièrement engagée dans des compétitions de voile et notamment la course de l’EDHEC, via l’association Archivoile. Pour 2008, l’ENSAPLV subventionne cette course à hauteur de 3 000€.
103
Passerelle V Passerelle V est une association loi de 1901 créée en 2003 à vocation pédagogique et économique qui joue le rôle d’intermédiaire entre le monde professionnel et les étudiants. Elle gère ainsi directement des contrats de travail au profit des étudiants souhaitant travailler ou faire un stage dans une structure professionnelle. L’Association Passerelle V est liée à l’ENSAPLV par une convention de partenariat. Les chiffres clés de l’année 180 étudiants de l’ENSAPLV ont adhéré à Passerelle V en 2007-2008 contre 134 en 2006-2007. 351 conventions d’études ont été signées en 2007-2008 contre 355 conventions en 2006-2007. L’année universitaire a été ponctuée par la participation de l’association à la contractualisation de la mise en situation professionnelle de la récente formation HMONP. En 2007 – 2008, 35 étudiant(e)s ont effectué leur mise en situation professionnelle de six mois en agence via des conventions d’étude Passerelle V. Passerelle V en partenariat avec l’association REST’E a également mis en place, coordonnée et subventionnée le départ de douze étudiant(e)s pour la réalisation d’un stage chantier\ouvrier de deux semaines sur le site de la Mérigue, commune de Paysac, sud Ardèche. Deux étudiant(e)s ont réalisé un film documentaire sur les activités architecturales de l’association d’Architectes porteuse du projet. Une projection de leur travail s’est déroulée en juin à l’ENSAPLV. L’année 2008 se conclue par la conception et la préparation en ligne du site Internet de l’association www.passerellev.com. Les agences 210 agences ont fait appel au dispositif Passerelle V pour travailler avec des étudiants de l’ENSAPLV au cours de l’année universitaire 2007-2008.
Les activités en 2008 (année universitaire de référence 2007-2008)
Année d’étude Nombre de conventions signées
Premier cycle année 1 et 2 5 Premier cycle année 3 41 Second cycle année 1 70 Second cycle année 2 135 DPEA architecture navale 2 DSA Architecture 2 HMONP 35 Fin de cycle des DPLG 61* Total 351
Les nationalités (année universitaire de référence 2007-2008) Sur les 351 conventions, 263 ont été signées avec des étudiants de nationalité française. 62 conventions ont été signées avec des étudiants de nationalité hors CEE (Alégérie, Tunisie, Maroc, Corée, Japon, Vietnam, Chine, Mexique, Chili, Argentine). Enfin, 26 conventions ont été signées avec des étudiants de nationalité européenne (Espagne, Bulgarie, Grèce, Italie, Pologne, Roumanie). Les adhésions L’adhésion à Passerelle V se fait par année scolaire à partir du moment où l’étudiant(e) a trouvé une structure dans laquelle il va travailler et lors de la signature de sa convention avec Passerelle V. Une fois son adhésion souscrite, l’étudiant(e) peut effectuer de façon multiple ou non, des missions tout au long de l’année scolaire, dans la limite de 130 jours étude par année civile et d’un cumul de 13.000 € net de revenus. Les missions de période longues peuvent aller jusqu’à quatre mois renouvelable une fois dans l’année scolaire maximum. Etant donné le caractère singulier du nombre de mission par étudiant(e), la seule donnée «nombre d’adhérents» n’est donc que partiellement représentative de l’activité de ceux-ci au long de l’année. La répartition géographique des agences Sur 351 conventions signées, 247 ont été signées avec des agences parisiennes (75), 90 avec des agences localisées en région parisienne et 14 avec des agences en province. Globalement, il s’agit d’agences d’architecture-urbanisme et de bureau d’études.
104
L’organisation des missions d’étude
Année universitaire 2007-2008
Nombre de conventions signées
Septembre 2007 44 12,5 Octobre 2007 52 14,8 Novembre 2007 38 10,8 Décembre 2007 27 7,6 Janvier 2008 32 9,1 Février 2008 32 9,9 Mars 2008 35 9,9 Avril 2008 26 7,4 Mai 2008 17 6,2 Juin 2008 22 6,2 Juillet 2008 22 6,2 Août 2008 4 1,1 Total 351
Il est à noter que les périodes où un grand nombre de conventions ont été éditées se situent en septembre et novembre. C’est en effet la période où les ADE de la HMONP établissent leur contractualisation Passerelle V pour la mise en situation professionnelle. Le nombre d’étudiants en poste
Année universitaire 2007-2008
Nombre d’étudiants en poste
Septembre 2007 57 Octobre 2007 62 Novembre 2007 72 Décembre 2007 80 Janvier 2008 84 Février 2008 88 Mars 2008 92 Avril 2008 97 Mai 2008 73 Juin 2008 53 Juillet 2008 39 Août 2008 24 Total 821
Les mois de mars, avril et mai concentrent les plus forts moments d’activités de Passerelle V, étant donné qu’aux conventions des ADE de HMONP en poste depuis l’automne s’ajoutent toutes les conventions signées le reste de l’année pour d’autres missions.
La durée moyenne des conventions / prix jour étude Nombre de conventions signées De moins d’1 mois 135 De 1 à 2 mois 73 Entre 2 et 4 mois 108 De 6 mois (MSP-HMONP) 35 TOTAL DES CONVENTIONS SIGNEES 351
Nombre de conventions signées avec un prix jour-étude Minimum de 103 € HT 124 Compris entre 104 et 120 € HT 83 Compris entre 121 et 150 € HT 98 Compris entre 151 et 200 € HT 46 TOTAL DES CONVENTIONS 351
La nature des travaux effectués par étudiant(e) Types de projets sur lesquels interviennent les étudiant(e)s pendant leur mission Construction logements collectifs 74 Equipements publics 69 Equipements privés 67 Construction réhabilitation logement individuel
69
Aménagements urbains 53 Projets à l’étranger 19 Les étapes du projet sur lesquels interviennent les étudiant(e)s pendant leur mission Concours 42 Plans coupes façades en APD-DCE-PRO
143
Dossiers de permis de construire 57 Suivi de chantier 32 Perspective, imagerie 3D 37 Etudes, esquisse, APS, schéma directeur
32
Maquettes 8