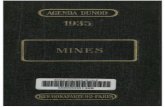ramanantsoaManamiharyB_AGR... - Université d'Antananarivo
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of ramanantsoaManamiharyB_AGR... - Université d'Antananarivo
Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’Ingénieur Agronome
Option « Elevage »
ETUDE DES FACTEURS DE RISQUE DANS LA CONSERVATION DU LAIT FRAIS LE LONG DE LA CHAINE DE COLLECTE.
Cas du lait livré à l’usine « SOCOLAIT Antsirabe ».
REGION VAKINANKARATRA
Par
RAMANANTSOA Manamihary Brunelle
Soutenu le 15 Mars 2017
Membres du jury :
Président du jury: Monsieur RANDRIANARIVELOSEHENO Jules Arsène.
Tuteur : Monsieur RANARISON Jean.
Examinateur : Monsieur RABEARIMISA Rivo Nirina
Examinateur : Monsieur RALAMBOMANANA Justin.
Promotion AMBIOKA (2008 - 2012)
Université d’Antananarivo
Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques
Mention « Sciences Animales »
********
Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’Ingénieur Agronome
Option « Elevage »
ETUDE DES FACTEURS DE RISQUE DANS LA CONSERVATION DU LAIT FRAIS LE LONG DE LA CHAINE DE COLLECTE.
Cas du lait livré à l’usine « SOCOLAIT Antsirabe ».
REGION VAKINANKARATRA
Par
RAMANANTSOA Manamihary Brunelle
Soutenu le 15 Mars 2017
Membres du jury :
Président du jury : Monsieur RANDRIANARIVELOSEHENO Jules Arsène.
Tuteur : Monsieur RANARISON Jean.
Examinateur : Monsieur RABEARIMISA Rivo Nirina
Examinateur : Monsieur RALAMBOMANANA Justin.
Promotion AMBIOKA (2008 - 2012)
Université d’Antananarivo
Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques
Mention « Sciences Animales »
********
Je dédie ce travail
Spécialement à mon père et à ma très chère mère qui se sont toujours sacrifiés pendant toutes leurs vies afin que je réussisse dans mes études.
Egalement. A mon époux Bruce RAVELOJAONA A ma fille Evenne RAVELOJAONA A mes soeurs : Brunette RAMANANTSOA, Brayène RAMANANTSOA
et Bruellah RAMANANTSOA,….. ……….pour leur grand soutien.
Et à la grande famille.
Merci infiniment !!!
“Raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy.” Salamo 127: 1a.
UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO / ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES
MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES POUR L’OBTENTION DU DIPLOME D’INGÉNIEUR AGRONOME
OPTION ÉLEVAGE
Auteur : RAMANANTSOA Manamihary Brunelle
Titre : Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long
de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine « Socolait Antsirabe ».
Contacts: +261 33 40 840 28 /+261 34 40 848 09 .
RESUME
Le lait est l’un des aliments le plus convoité dans la consommation humaine. Mais ce produit, à l’état
frais, est sensible au niveau microbiologique et constitue ainsi un milieu favorable au développement
de germes à plusieurs sources de contaminations. L’un des objectifs de l’usine « Socolait »
est de minimiser les facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte
d’où l’objet de l’étude. La connaissance du contexte le lait et la qualité du lait, les caractéristiques
de la région de Vakinankaratra, l’optimisation de l’organisation de la collecte, l’usine « Socolait »
et son réseau de collecte, a permis de bien situer l’étude. Suite aux enquêtes dans le réseau laitier
de « Socolait Antsirabe » limité par Ambohibary, Betafo, Manandona et Andanomanelatra, 130 échantillons
de lait prélevés sont retenues pour l’analyse microbiologique durant la saison de pluie (du fin Octobre
jusqu’au début Janvier de l’année suivante) dont 77 échantillons de lait auprès des éleveurs, 32 échantillons
de lait auprès des précollecteurs et 21 échantillons de lait auprès des collecteurs. Le but étant la recherche
de la flore mésophile totale dans le lait sur gélose Plate Count Agar à 30°C durant une incubation de
72 heures .Les résultats ont montré que les taux de germes dans le lait pour les trois niveaux : éleveurs,
précollecteurs, collecteurs sont successivement 0,338 106
UFC/ml; 4,49 106
UFC/ml; 16,7 106
UFC/ml
avec une moyenne générale de 4,00 106
UFC/ml. Ces valeurs valident que les moyens de conservation
du lait notamment lors du stockage, lors du transfert et lors du transport chez les éleveurs
et les précollecteurs ont des effets sur la qualité du lait. Les paramètres les plus influençables sont d’une
part la nature du contenant, le taux de contamination du contenant en plastique est 4 fois supérieur à celui
en aluminium ; d’autre part l’importance de l’ouverture qui rend facile ou difficile le nettoyage, le taux
de contamination d’un contenant à ouverture étroite de diamètre inférieure à 5 cm, est 44 fois supérieur
à celui de la large ouverture de diamètre supérieure à 15 cm. Le temps de conservation et/ou de transport
du lait affecte aussi la qualité du lait, le taux de contamination pour un lait de longue conservation
ou d’un long trajet est supérieur par rapport à un lait de court trajet. Par ailleurs, le circuit de collecte affecte
également le taux de germes surtout dans le circuit où la collecte s’effectue avec plusieurs intermédiaires
(précollecteurs I et II). Ainsi, des actions prioritaires d’hygiène pour les éleveurs et des outils de
suivi-évaluation ont été mis en place pour réduire au minimum le taux de germes dans le lait.
Mots clés : Lait, collecte de lait, contamination, bonne pratique d’hygiène, Vakinankaratra.
FAMINTINANA
Ny ronono dia anisan’ireo sakafo tena ankafizin’ny olombelona. Kanefa ny ronono avy noterena
dia mora itoeran’ny loto. Ity farany anefa dia mora miroboroboro rehefa mahazo aina ny mikraoba.
Ny iray amin'ireo tanjona ny orinasa “Socolait” anefa dia ny hampihena ny fidiran’ny loto ao amin’ny
ronono eo amin'ny fotoana fanangonana azy manomboka eny am-piterena ka hatrany amin’ny mpangona
farany, ary izany indrindra no tena iompanan’ity fikarohana ity. Ny fahafantarana ny ronono
sy ny kalitaony, ny fomba fanangonana ronono, ny toetra mampiavaka ny Faritry Vakinankaratra,
ny orinasa “Socolait” sy ny tambajotra fanangonana ronono dia manampy amin’ny fametrapetrahana tsara
ny asa ho hatao. Taorian'ny fanadihadiana tao amin'ny tambajotra fanangonana ronono voafaritry
Ambohibary, Betafo, Manandona sy Andanomanelatra dia miisa 130 ny santionan-dronono manankery
voaangona sy voatana tamin’ny fotoanan’ny fahavaratra (volana Octobra ka hatramin’ny volana
Janoary),77 ny santionan-dronono avy amin’ny mpiompy, 32 ny santionan-dronono avy any amin’ny
mpanangona ronono mpanelanelana ary 21 ny santionan-dronono avy any amin’ny mpanangona ronono.
Ny antony dia ny fikarohana ny Flora Mesofila rehetra ao anaty ronono izay hatao anaty “gélose Plate
Count Agar” amin’ny maripàna 30°C izay mikotrika mandrity ny 72 ora. Ny vokatra dia mampiseho
fa ny tahan'ny bakteria ao amin'ny ronono ho an'ny ambaratonga telo: mpiompy, mpanangona ronono
mpanelanelana sy mpanangona ronono dia ireto telo misesy ireto 0,338 106 UFC / ml; 4, 49 10
6 UCF /
ml; 16.7 106 UCF / ml eo ho eo amin’ny 4, 00 10
6 UCF / ml. Ireo tarehimarika ireo no mampiseho
fa ny karazana fitehirizana sy / na ny fitaterana ny ronono dia anisan’ny miteraka loto ao amin’ny
ronono. Ny akora nanamboarana ny fitehirizana ny ronono no anisan’ireo mampitombo betsaka ny loto,
izany hoe ny loto ateraky ny fitehirizana vita amin’ny akora plastika dia avo 4 heny noho ny fitehirizana
vita amin’ny akora “aluminium”. Eo ihany koa ny refin’ny lavaky ny fitehirizana ronono, ny lavaka kely
refy (diametra latsaky ny 5 sm) dia sarotra diovina nohon’ny lavaka manana refy lehibe (diametra
mihoatra ny 15 sm), ary avo 44 heny ny tahan’ny loto amin’ny lavaka kely refy noho ny lavaka manana
refy lehibe. Ny fotoana fitehirizana sy / na fitaterana ny ronono no anisan’ny lafin-javatra mavesa-danja
ihany koa eo amin'ny fandotoana ny ronono amin’izay toerana rehetra hanangonana azy, arak’araka
ny mahalava ny fotoana itehirizana ny ronono no mampitombo ny loto. Eo ihany koa karazana zotra
itateranany ronono mahatonga ny firoboroboan’ny loto indrindra fa eo amin’ny ilay zotra be mpanangona
ronono mpanelanelana (mpanangona ronono mpanelanelana anankiroa I sy II). Noho izany,
lohalaharan’ny hetsika natao dia fametrahana ny lalàna mifehy ny fahadiovana indrindra ho an'ny
mpiompy. Eo ihany koa ny fanaraha-maso ny fombafombam-pahadiovana rehetra amin’ny alalan’ny
fitaovana “grilles” hitsarana ny fahadiovana natao hoan’ny mpiompy, mpanangona ronono mpanelanelana
sy mpanangona ronono.
Teny mivohitra: ronono, fanangonana ronono, fandotoana ronono, lalàna mifehy ny fahadiovana,
Vakinankaratra.
ABSTRACT
Milk is one of the most coveted foods in human consumption. However, this product in the fresh state
is sensitive to the microbiological level and thus constitutes an environment favorable to the development
of germs with several sources of contamination. One of the objectives of the Socolait plant is to minimize
the risk factors in the preservation of fresh milk along the collection line from which the subject
of the study is concerned. Knowledge of the context, in particular the milk and milk quality,
the characteristics of the Vakinankaratra region, the optimization of the collection organization,
the Socolait plant and its collection network, . Following the surveys in the “Socolait Antsirabe” dairy
network limited by Ambohibary, Betafo, Manandona and Andanomanelatra, 130 milk samples were
collected for microbiological analysis during the rainy season (late October to early January of the year ),
Including 77 samples from breeders, 32 samples from pre-collectors and 21 from collectors. The aim
is to find the total mesophilic flora in the milk on Plate Count Agar agar at 30 ° C for 72 hours
in incubation. The results showed that the levels of germs in the milk for the three levels: breeders,
pre-collectors, collectors are successively 0.338 106
CFU / ml; 4.49 106 CFU / ml; 16.7 10
6 CFU / ml with
an overall average of 4.00 106
CFU / ml. These values validate that the means of preserving milk,
in particular during storage, during transfer and during transport in breeders and pre-collectors, have
an effect on milk quality. The most influential parameters are, on the one hand, the nature of the container,
the contamination rate of the plastic container is 4 times higher than that of stainless steel; On the other
hand the size of the opening which makes cleaning easy or difficult, the contamination rate of a container
with narrow opening (diameter inferior to 5 cm) is 44 times greater than that of the wide opening (diameter
superior to 15 cm). The milk preservation and / or transport time also affects the quality of the milk,
the contamination rate for a long-life or journey-type milk is higher than for short-haul milk.
Moreover, the collection circuit also affects the rate of germs especially in the circuit where the collection
takes place with several intermediates (precollector I and II).
Thus, priority hygiene actions for breeders and monitoring and evaluation tools have been put in place.
Key words: Milk, milk collect, contamination, good hygiene practice, Vakinankaratra.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page i
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS .................................................................................................................................................... III
LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES ................................................................................................ IV
GLOSSAIRE .................................................................................................................................................................... V
LISTE DES TABLEAUX ............................................................................................................................................ VI
LISTE DES FIGURES .............................................................................................................................................. VIII
LISTE DES ANNEXES ............................................................................................................................................... IX
INTRODUCTION .......................................................................................................................................................... 1
PARTIE I. CADRAGE DE L’ETUDE......................................................................................................................... 3
I.1. PORTRAIT DE LA REGION DE VAKINANKARATRA .........................................................................................................................4 I.1.1. Environnement physique ...................................................................................................................................................................4 I.1.2. Environnement humain ......................................................................................................................................................................6 I.1.3. Environnement économique .............................................................................................................................................................6
I.2. CONTEXTE DE LA FILIERE LAIT ..............................................................................................................................................................7 I.2.1. Production laitière mondiale ............................................................................................................................................................7 I.2.2. Production laitière au niveau nationale .......................................................................................................................................8 I.2.3. Production laitière de la région de Vakinankaratra ........................................................................................................... 10
I.3. GENERALITES SUR LE LAIT ET LA QUALITE DU LAIT ................................................................................................................ 14 I.3.1. Définitions du lait ................................................................................................................................................................................ 14 I.3.2. Composition globale du lait ............................................................................................................................................................ 14 I.3.3.Qualité du lait ......................................................................................................................................................................................... 15
I.4. OPTIMISATION DE L’ORGANISATION DE LA COLLECTE ........................................................................................................... 19 I.4.1. Notions de collecte.............................................................................................................................................................................. 19 I.4.2.Quelques types de collecte. .............................................................................................................................................................. 20 I.4.3. Méthodes de conservation du lait frais ..................................................................................................................................... 21 I.4.4. La collecte et commercialisation de lait à Madagascar....................................................................................................... 23
I.5.CONTROLE LAITIER ET PAIEMENT A LA QUALITE ...................................................................................................................... 24 I.5.1. Contrôle laitier...................................................................................................................................................................................... 24 I.5.2. Paiement à la qualité .......................................................................................................................................................................... 25
I.6. PRESENTATION DE SOCOLAIT ET DE RURALCAP CONSULTING .......................................................................................... 27 I.6.1. Présentation de SOCOLAIT ............................................................................................................................................................. 27 I.6.2.Présentation de la Société Rural Cap Consulting. .................................................................................................................. 30
PARTIE II. MATERIELS ET METHODES ......................................................................................................... 32
II.1. DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE ............................................................................................................................................. 33
II.2. SITUATION INITIALE DU RESEAU DE COLLECTE ....................................................................................................................... 34
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page ii
II.3. COMPLEXITE DU RESEAU DE COLLECTE ........................................................................................................................................ 34 II.3.1. Aléas du réseau de collecte ........................................................................................................................................................... 34 II.3.2. Acteurs de la collecte ....................................................................................................................................................................... 35 II.3.3.Chaîne de collecte ............................................................................................................................................................................... 36
II.4. Quantité de lait collectée ......................................................................................................................................................................... 37 II.4.1. Variation de la quantité de lait collectée. ................................................................................................................................ 39 II.4.2. Evolution de la teneur en « MG » et en « EST » ..................................................................................................................... 41 II.4.3.Evolution du taux de germes ......................................................................................................................................................... 41 II.4.4.Critères de qualité du lait et paiement à la qualité du lait chez Socolait.................................................................... 42
II.5. METHODES D’ENQUETE.......................................................................................................................................................................... 46 II.5.1. Etapes des enquêtes ......................................................................................................................................................................... 46 II.5.2. Fiches d’enquête ................................................................................................................................................................................ 46 II.5.3. Prélèvement sur terrain ................................................................................................................................................................. 46 II.5.4. Echantillonnage .................................................................................................................................................................................. 47
II.6.ANALYSES EXPERIMENTALES .............................................................................................................................................................. 48 II.6.1. Quelques notions sur l’analyse microbiologique ................................................................................................................. 48 II.6.2. Procédé d’analyse microbiologique et de calcul .................................................................................................................. 49 II.6.3. Hypothèses sur les facteurs de risque ...................................................................................................................................... 53
II.7. RECHERCHE DU TAUX D’EVOLUTION DES GERMES ET NOTATION IMPACT ................................................................ 54 II.6.3. Méthode de calcul du taux d’évolution .................................................................................................................................... 54 II.6.3. Méthode d’obtention de la « notation impact ». ................................................................................................................... 55
II.8. FACTEURS LIMITANT LA REALISATION DU TRAVAIL.............................................................................................................. 56
PARTIE III : RESULTATS ET DISCUSSIONS ................................................................................................... 57
III.1.VALIDATION DU TAUX D’EVOLUTION DE GERMES.................................................................................................................. 58
III.2. FACTEURS DE RISQUE SUR LA CONTAMINATION DU LAIT ................................................................................................. 60 III.2.1. Facteurs de risque liés à la traite .............................................................................................................................................. 60 III.2.2. Facteurs de risque liés au dépôt du lait au point de collecte. ....................................................................................... 76 III.2.3.Facteurs de risque liés entre le ramassage de lait et à la collecte au centre de collecte ................................... 81
III.3.NOTATION IMPACT DES FACTEURS DE RISQUE ......................................................................................................................... 82
III.4. EVOLUTION DU PAIEMENT A LA QUALITE. ................................................................................................................................. 84
PARTIE IV. RECOMMANDATIONS..................................................................................................................... 85
VI.1. MISE EN PLACE D’ACTIONS PRIORITAIRES ................................................................................................................................. 86
VI.2. OUTILS DE SUIVI-EVALUATION ........................................................................................................................................................ 88
CONCLUSIONS .......................................................................................................................................................... 92
REFERENCES ............................................................................................................................................................. 93
ANNEXES ........................................................................................................................................................................ I
REFERENCES DES ANNEXES ............................................................................................................................. XIX
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page iii
REMERCIEMENTS Nous n’avons pas pu réaliser seul ce travail. Ainsi nous tenons à remercier tous ceux qui
ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce mémoire en particulier :
- Monsieur RANDRIANARIVELOSEHENO Jules Arsène, Maître de conférences,
Enseignant Chercheur à l’ESSA et Chef de Mention « Sciences Animales » de nous avoir
accordé l’honneur de présider le jury à cette soutenance.
- Monsieur RANARISON Jean, Docteur Ingénieur, Maître de Conférences, Enseignant
chercheur à l’ESSA et tuteur académique de ce travail, pour ses précieuses contributions à
la réalisation de ce travail.
- Monsieur RABEARIMISA Rivo Nirina , PhD, Maître de Conférences, enseignant chercheur
à l’ESSA, pour avoir accepté de siéger parmi les membres du jury.
- Monsieur RALAMBOMANANA Justin, Maître de conférences, enseignant chercheur à
l’ESSA, pour avoir également accepté de siéger parmi les membres du jury.
- Madame PFEIFFER Hélène, Docteur Vétérinaire, Directeur de la Société
« RuralCap Consulting », Ancienne Responsable de la Collecte et du Développement du
Réseau Socolait et tuteur professionnel de ce travail, pour ses interventions lors de
l’accomplissement de ce travail. Et grâce aux soutiens matériels et financiers de la Société
« RuralCap Consulting », les activités ont pu être réalisées.
- Madame GROS Adelaïde, Actuelle Responsable de la Collecte et du Développement
du Réseau « Socolait » pour son soutien pour arriver à ce terme.
- Monsieur David DE LA FUENTE, Directeur d’usine de la Société « Socolait » pour son
accueil dans l’usine et sa collaboration lors de la réalisation de ce travail.
- Madame VEROMALALANIRINA Frederica et son équipe de techniciens de
« RuralCap Consulting » pour les accompagnements au quotidien lors des activités sur
terrain.
- Madame ANDRIANARILALA Aina, Responsable du Laboratoire « Socolait » pour son
accueil. Les travaux d’analyses au sein du Laboratoire de la Société « Socolait » ont été
vraiment essentiels pour la réalisation de ce travail.
- Mademoiselle Philippine DE LATTRE, une amie stagiaire pour ses conseils enrichissants
lors de l’élaboration de ce travail.
- Tous les enseignants de la Mention « Sciences Animales » et le personnel de l’Ecole
Supérieure des Sciences Agronomiques.
- Toute l’équipe du Service Collecte et Développement réseau « Socolait Antsirabe ».
- Toute l’équipe du Laboratoire « Socolait Antsirabe ».
- Tous les éleveurs, les précollecteurs et les collecteurs de Betafo, de Manandona,
d’Ambohibary et d’Andranomanelatra pour leur collaboration.
Un grand merci à tous
Brunelle
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page iv
LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES
AFNOR : Association Française de Normalisation
CAC : Commission du Codex Alimentarius
ESSA : Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques
CL : Contrôle laitier
CT : Coliformes totaux
DRZV : Département de Recherche Zootechnique et Vétérinaire.
EC: Escherichia Coli
FAO: Food and Agricultural Organisation
FAOSTAT: Food and Agricultural Organisation Statistique
FKT: Fokontany
FMT: Flore Mésophile Totale
FTM: Foibe ny Taontsarin’I Madagasikara
GDS: Groupement des Défenses Sanitaires
Hab : Habitant
HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point
IPROVA : InterPROfession Régionale de Vakinankaratra.
ISO: International Organisation for Standardisation
Kg: Kilogrammes
LP: Lactoperoxidase
PCA: Plate Count Agar
pH : Potentiel Hydrométrique
PPN: Produits de Premières Nécessités
PRN : Pie Rouge Norvégienne
TIAC : Toxi-Infections Alimentaires Collectives
UFC : Unité formant colonie
UPDR : Unité de Politique de Développement Rural
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page v
GLOSSAIRE
Lait cru : C’est un produit provenant de la traite d'une ou plusieurs vaches non traité
thermiquement au-delà de 40 °C ni soumis à un traitement d'effet équivalent.
Contaminant : Tout agent biologique ou chimique, toute matière étrangère ou toute autre substance
n’étant pas ajoutée intentionnellement aux produits et pouvant en compromettre la sécurité
ou la salubrité.
Contamination : L’introduction ou la présence d’un contaminant dans le lait ou les produits laitiers
ou dans un environnement des produits d’origine animale.
Désinfection : C’est la réduction du nombre de microorganismes présents dans l’environnement, au
moyen d’agents chimiques ou de méthodes physiques, jusqu’à l’obtention d’un niveau ne risquant
pas de compromettre la sécurité ou la salubrité des aliments
Réfrigération : C’est une technique de conservation à une même température de 4°C. Le froid
empêche la prolifération microbienne. Et pour que la conservation soit efficace, la chaîne du froid
doit être respectée.
Chaîne du froid, est le fait d’assurer une température basse (en général 0 - 4°C) en continu quelles
que soient les étapes subies (transport, stockage, etc.)
Exploitation d’élevage laitier : Appelée aussi ferme d’élevage laitier, désigne le lieu
et l’installation dans lesquels sont entretenus les animaux laitiers.
Femelles laitières : Femelles de toutes les espèces, de race locale ou améliorée, pouvant produire
du lait
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page vi
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Production laitière mondiale............................................................................................................ 7
Tableau 2: Evolution de la production laitière dans la région de Vakinankaratra entre 2000 et 2005. ........... 11
Tableau 3: Estimation de la production annuelle de lait par tête dans la région de Vakinankaratra (litres) 2000
à 2006. .............................................................................................................................................................. 11
Tableau 4: Répartition des vaches laitières par district suivant la race. ........................................................... 12
Tableau 5 : Variation de la composition du lait chez quelques mammifères (g/l). .......................................... 14
Tableau 6 : Huit composantes de la qualité du lait ........................................................................................... 15
Tableau 7: Caractéristique physico-chimique du lait. ...................................................................................... 18
Tableau 8: Augmentation de la conservabilité du lait par le système LP à différentes températures. ............. 22
Tableau 9 : Méthode de contrôle laitier ............................................................................................................ 24
Tableau 10 : Deux types de critères pris en compte pour le paiement du lait .................................................. 26
Tableau 11 : Normes européennes et tunisiennes pour le paiement du lait à la qualité ................................... 26
Tableau 12: Activités menées par RuralCap sur la collecte de lait. ................................................................. 31
Tableau 13 : Comparaison des trois maillons de la chaîne de collecte ............................................................ 35
Tableau 14 : Quantité de lait reçu par trimestre pendant l’année 2014/2015 ................................................... 38
Tableau 15 : calendrier de la disponibilité de biomasse fourragère avec quelques paramètres liés à la saison.
.......................................................................................................................................................................... 40
Tableau 16 : Teneur en MG et EST par mois en moyenne. ............................................................................. 41
Tableau 17 : Taux moyen de germes pendant l’année 2014/2015. .................................................................. 41
Tableau 18 : Critères sur la composition chimique. ......................................................................................... 43
Tableau 19: Composition du lait acceptable .................................................................................................... 43
Tableau 20 : Critère sur la qualité microbiologique du lait ............................................................................. 44
Tableau 21 : Classement de la qualité du lait selon le taux de Matière grasse et le taux d’extrait sec............. 45
Tableau 22 : Prix du lait pour l’année 2015 octroyé aux fournisseurs ............................................................. 45
Tableau 23 : Prix du litre du lait selon sa saison et selon le maillon qui effectue livraison ............................. 45
Tableau 24: Répartition des échantillons de lait frais par zone et par niveau. ................................................. 48
Tableau 25: Appareils utilisés pour l’analyse microbiologique. ...................................................................... 50
Tableau 26 : Règles de validation du comptage des colonies sur les valeurs de NBP1 et NBP2. ................... 51
Tableau 27 : Fiche d’enregistrement des résultats pour le dénombrement de FMT. ....................................... 53
Tableau 28 : Liste des hypothèses sur les facteurs de risque de la contamination du lait frais ........................ 54
Tableau 29 : Etapes lors de la collecte du lait. ................................................................................................. 55
Tableau 30: Evolution du taux de germes FMT à 30°C dans le lait depuis la traite jusqu’à l’usine en UFC/ml
.......................................................................................................................................................................... 59
Tableau 31 : Types de contenants à la sortie de traite ...................................................................................... 61
Tableau 32 : Taux de contamination selon le type de matériel ........................................................................ 61
Tableau 33 : Taux de contamination selon la dimension de l’ouverture .......................................................... 62
Tableau 34 : Taux de contamination selon la présence de fermeture ............................................................... 63
Tableau 35 : Taux de contamination selon la propreté visuelle du contenant .................................................. 65
Tableau 36 : Taux de contamination selon l’utilisation de détergent ............................................................... 65
Tableau 37 : Taux de contamination selon la pratique de séchage .................................................................. 67
Tableau 38 : Effet du séchage avec une lavette avant la traite ......................................................................... 69
Tableau 39 : Taux de contamination selon la note de propreté de la mamelle avant la traite .......................... 69
Tableau 40: Taux de germes selon la note de propreté des germes et le séchage des mamelles...................... 70
Tableau 41 : Effet de l’enlèvement des premiers jets ....................................................................................... 71
Tableau 42: Effet de la propreté des mains avant la traite sur le taux de germes dans le lait .......................... 72
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page vii
Tableau 43: Taux de germes par rapport au changement de contenant. ........................................................... 72
Tableau 44: Taux de germes selon l’état du sol du lieu de traite. .................................................................... 73
Tableau 45: Taux de germes selon la distance du lieu de traite par rapport aux bouses .................................. 74
Tableau 46 : taux de germes selon la présence de mouches environnantes ..................................................... 75
Tableau 47 : Exemple du lait qui chez le précollecteur pour aller chez le collecteur. ..................................... 77
Tableau 48 : Taux de germes en fonction des trois maillons en fonction de la chaîne collecte. ...................... 82
Tableau 49: Actions prioritaires d’hygiène conçues pour les éleveurs ............................................................ 87
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page viii
LISTE DES FIGURES Figure 1 : Représentation géographique de la région de Vakinankaratra. .......................................................... 4
Figure 2 : Répartition des vaches laitières dans la région de Vakinankaratra. ................................................. 12
Figure 3 : Schéma de tournées « en pétales ». .................................................................................................. 21
Figure 4 : Représentation hiérarchique globale de chaque activité de « Socolait ». ........................................ 29
Figure 5: Localisation des zones pour constituer le réseau de collecte de lait ................................................. 33
Figure 6 : Différents circuits dans le réseau collecte du lait frais. ................................................................... 36
Figure 7: Point de collecte du lait sise à Betafo avec un abri (ici bâtiment en dur). ........................................ 37
Figure 8 : Moyens de transports de lait frais. ................................................................................................... 37
Figure 9 : Evolution de la quantité de lait reçue par trimestre pendant l’année 2014/2015. ............................ 38
Figure 10 : Variation mensuelle de la quantité du lait reçue en 2015 .............................................................. 39
Figure 11 : Evolution du taux de germes au niveau des fournisseurs pour l’année 2014/2015. ...................... 42
Figure 12 : Schéma explicatif de l’analyse microbiologique du lait pour le dénombrement de FMT. ............ 52
Figure 13 : Taux d’évolution de germes selon certains facteurs au niveau de la production. .......................... 60
Figure 14 : Evolution du taux de contamination selon le type de matériel ...................................................... 62
Figure 15: Evolution du taux de contamination selon la dimension de l’ouverture. ........................................ 62
Figure 16 : Evolution du taux de contamination selon l’utilisation de fermeture contenant en sortie de traite
.......................................................................................................................................................................... 63
Figure 17: Evolution du taux de contamination selon l’état visuelle du contenant .......................................... 65
Figure 18 : Evolution du taux de contamination selon l’utilisation de détergent. ............................................ 66
Figure 19 : Effet du séchage des matériels sur le taux de germes .................................................................... 67
Figure 20: Grille de notation de la propreté des vaches au niveau du trayon et de la cuisse ........................... 68
Figure 21 : Effet du séchage de la mamelle avec une lavette avant la traite. ................................................... 69
Figure 22: Taux de germes en fonction de la note de propreté de la mamelle avant la traite. ......................... 69
Figure 23 : Taux de germes selon l’état du sol du lieu de traite ....................................................................... 73
Figure 24 : Evolution du taux de germes selon la position du lieu de traite par rapport aux bouses. .............. 74
Figure 25 : Evolution du taux de germes selon la quantité de mouches. ......................................................... 75
Figure 26 : Facteurs de risques au niveau de la collecte intermédiaire avec le taux d’évolution de germes . 77
Figure 27 : Evolution du taux de germes des deux types de laits ..................................................................... 78
Figure 28: Influence de la température sur le taux de croissance d'une souche bactérienne mésophile. Taux
exprimé en % du taux maximum ...................................................................................................................... 79
Figure 29 : Croissance microbienne ................................................................................................................. 80
Figure 30: Taux de contamination de germes selon les facteurs de risque au niveau du centre de collecte .... 81
Figure 31: Evolution du taux de germes selon le temps de conservation ......................................................... 81
Figure 32 : Evolution du taux de germes suivants les trois niveaux de la chaîne de collecte. ......................... 82
Figure 33 : Grille de suivi-évaluation des pratiques d’hygiène conçue pour les éleveurs. .............................. 89
Figure 34 : Grille de suivi-évaluation des pratiques d’hygiène conçue pour les précollecteurs. ..................... 90
Figure 35 : Grille de suivi-évaluation des pratiques d’hygiène conçue pour les collecteurs............................ 91
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page ix
LISTE DES ANNEXES Annexe 1 : Population de chaque district de la région de Vakinankaratra et évolutions selon les
projections. .......................................................................................................................................................... I
Annexe 2: Evolution des populations des districts par groupes d’âges dans le Vakinankaratra ......................... I
Annexe 3 : Nombres d’éleveurs et effectifs des cheptels à Vakinankaratra....................................................... II
Annexe 4: Production laitière moyenne annuelle des vaches (Cas de Vakinankaratra) ..................................... II
Annexe 5 : Quelques conditions intrinsèques (pH, potentiel d’oxydoréduction), et extrinsèques (température)
favorables aux développements des microorganismes dans le lait. ................................................................... III
Annexe 6 : Caractérisation du lait suivant sa qualité organoleptique ................................................................ III
Annexe 7 : Composition en protéines de la matière azotée. ............................................................................. IV
Annexe 8 : Composition globale de la matière grasse. .................................................................................... IV
Annexe 9 : Caractéristiques générales d’un centre de collecte. ........................................................................ V
Annexe 10 : Produits laitiers importés par Madagascar. .................................................................................. VI
Annexe 11: Mamelle et coupe d’un trayon ..................................................................................................... VII
Annexe 12 : Courbe de lactation ..................................................................................................................... VII
Annexe 13 : Moyens de transport pour la collecte traditionnelle du lait. ....................................................... VIII
Annexe 14: Facteurs de risque selon leur degré d’impact et selon les maillons (niveaux) ...............................IX
Annexe 15 : Fiche d’enquête conçue pour les éleveurs......................................................................................X
Annexe 16 : Fiche d’enquête conçue pour les précollecteurs. ..........................................................................XI
Annexe 17 : Fiche d’enquête conçue pour le collecteur ...................................................................................XII
Annexe 18 : Mode opératoire pour la préparation de l’eau peptonée, une solution de dilution. .....................XIII
Annexe 19 : Mode opératoire pour la préparation de la Gélose PCA ............................................................ XIV
Annexe 20 : Tests physico-chimiques effectués pour le lait. .......................................................................... XV
Annexe 21 : Liste des photos qui récapitulent les contenants ou récipients utilisés dans la collecte du lait. . XVI
Annexe 22 : Quelques photos qui illustrent le transport du lait. .................................................................... XVI
Annexe 23 : Avantages et inconvénients de chaque système de ramassage ou collecte de lait .................... XVII
Annexe 24 : Types de tank réfrigérant ......................................................................................................... XVIII
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 1
INTRODUCTION
Le lait de vache est un aliment complet, qui possède tous les nutriments nécessaires à la vie
(MEYER C. et DENIS J., 1999). Mais le lait constitue un milieu propice au développement
de micro-organismes pathogènes (SCHNEIDER E., 1972). C’est un produit sensible au niveau
microbiologique et est susceptible de nombreuses contaminations.
La consommation de lait et de produits laitiers de mauvaise qualité met en danger la santé
des consommateurs, c’est pourquoi les industriels laitiers sont de plus en plus stricts sur la qualité
de leur matière première. Le danger de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) est entre
autre un des risques encourus si le produit est contaminé. L’adoption d’un meilleur suivi
de la qualité de la matière première qui est le lait cru, le long de la chaîne de collecte du lait,
est indispensable pour minimiser le risque de contamination et atteindre les normes d’hygiènes
requises. La Société « Socolait » s’engage dans une démarche qualité exigeante et innovante pour
répondre au mieux aux attentes grandissantes des consommateurs tout en leur fournissant
les meilleurs produits aux normes internationales. Pour sa part, la Société « RuralCap Consulting »
œuvrant dans le développement rural, opère un partenariat avec « Socolait » sur la collecte du lait et
l’encadrement des éleveurs depuis 2012. Le réseau de collecte du lait est complexe et les sources
de contamination sont nombreuses. Notre étude s’efforcera d’apporter des éléments concrets
de réponse à la question suivante : quelles mesures peuvent être mises en place tout au long
de la chaîne de collecte pour diminuer la charge microbienne du lait frais le long de cette chaîne
de collecte depuis la traite jusqu’à l’usine de transformation ?
Plusieurs facteurs de risque de contamination du lait aux différents stades de sa collecte entrent
en jeu, ce qui nous a poussés à réaliser ce travail, dont l’objectif principal est de minimiser
les facteurs de risque de contamination du lait frais le long de la chaîne de collecte. Les objectifs
spécifiques sont de :
- Définir la situation actuelle de la chaîne de collecte du lait frais.
- Identifier les facteurs de risque les plus critiques dans la conservation du lait frais
le long de la chaîne de collecte.
- Maîtriser ces facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de cette chaîne de
collecte.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 2
A cet effet, ce travail va comporter quatre parties. En premier lieu, un cadrage général qui
donne un aperçu sur le portrait de la région de Vakinankaratra, le contexte de la filière lait,
les généralités sur le lait et la qualité du lait, l’optimisation de l’organisation de la collecte,
le contrôle laitier et le paiement à la qualité et la présentation de la Société « Socolait » et
de la Société « RuralCap Consulting ». Ensuite, la partie matériels et méthodes qui comprend
la délimitation de la zone d’étude, la situation initiale du réseau de collecte, la complexité du réseau
de collecte, les méthodes d’enquêtes, les analyses expérimentales, la recherche du taux d’évolution
des germes et de la notation impact, et les facteurs de risque sur la contamination du lait. Puis vient
ensuite la validation des résultats avec leurs interprétations respectives et leurs discussions.
Et à la fin, quelques recommandations seront avancées sur la mise en place des actions prioritaires
pour les éleveurs concernant les bonnes pratiques d’hygiène. Des grilles de suivi-évaluations
de la bonne pratique d’hygiène sont également proposées pour les trois niveaux (éleveur,
précollecteur, collecteur) de la chaîne de collecte.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 3
PARTIE I. CADRAGE DE L’ETUDE
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 4
I.1. PORTRAIT DE LA REGION DE VAKINANKARATRA
I.1.1. Environnement physique
I.1.1.1. Localisation géographique de la région de Vakinankaratra (CREAM, 2013)
Vakinankaratra est une région qui se situe sur les hauts plateaux de Madagascar.
Elle est délimitée à l’Est par les régions d’Alaotra-Mangoro et d’Atsinanana, à l’Ouest par la région
de Menabe, au Nord par les régions d’Analamanga, d’Itasy et de Bongolava, et au Sud par la région
d’Amoron’i Mania. Géographiquement, la région de Vakinankaratra est localisée par
les coordonnées suivantes : 18°59’ et 20°03’ de latitude Sud et 46°17’ et 47°19’de longitude Est.
Figure 1 : Représentation géographique de la région de Vakinankaratra.
-Ci-contre: KASPRZYK (2008)
-En haut à gauche: DUBA (2010)
-En haut à droite : RABEMANAMBOLA
(2007) (modifié par l’auteur)
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 5
La région de Vakinankaratra est subdivisée en sept districts selon le découpage administratif
dont deux urbains (Antsirabe I et Ambatolampy) et cinq ruraux (Antanifotsy, Faratsiho, Antsirabe
II, Betafo et Mandoto) (Cf. Figure 1). La superficie totale de la région est de 19 250 km²
(SOURISSEAU et al. 2016).
La région de Vakinankaratra au cœur du triangle laitier
La région de Vakinankaratra est la première zone productrice de lait de vache à Madagascar
(CREAM, 2013).Sa production laitière représente plus de 80% du lait du pays
(RABEMANAMBOLA, 2007). D’après sa localisation dans la figure 1, la région de
Vakinankaratra se trouve au cœur du triangle laitier, une aire géographique comprise entre
Tsiroanomandidy (Moyen-Ouest), Manjakandriana (Est) et Ambalavao Tsienimparihy (Sud)
(MAEP UPDR, 2004). Ainsi les plus grandes zones laitières de Madagascar se trouvent dans ce
triangle.
I.1.1.2.Caractéristiques biophysiques
I.1.1.2.1. Climat
La région de Vakinankaratra possède un climat tropical d’altitude (altitude supérieure
à 900 mètres) avec une température moyenne annuelle inférieure ou égale à 20°C (MAEP, 2003).
Ce climat se caractérise par l’alternance de deux saisons qui sont la saison pluvieuse moyennement
chaude (de Novembre à Avril) et la saison sèche relativement froide (de Mai à Octobre).
La pluviométrie annuelle varie de 1200 mm à 2000 mm selon l’altitude et l’exposition
(SOURISSEAU et al. 2016.). Ce climat est favorable à l’élevage des vaches laitières et à la bonne
production fourragère. Mais la diminution de la température pendant la saison sèche entraine
une réduction de la production de biomasse (KASPRZYK, 2008). Par contre, pendant la saison
pluvieuse, les fourrages sont très abondants, surtout entre Janvier et Mars.
I.1.1.2.2. Sol et couverture forestière1.
Le sol de la région est prédominé par deux types de sols: les sols ferralitiques qui couvrent
une grande partie de la région; les sols hydromorphes qui sont constitués de marais actuels et de
marais anciens modifiés par le drainage ou sols alluvionnaires issus du bassin versant
exclusivement basaltique.
La formation végétale de la région est caractérisée par des forêts claires sclérophylles de
montagne, des forêts denses humides de moyenne altitude, des marais à joncs (parfois à Viha) et
quelques vestiges de forêts galeries dans les bas-fonds.
1CREAM, 2013
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 6
I.1.1.2.3. Hydrologie2
Le réseau hydrographique de la région de Vakinankaratra est dense et assez hiérarchisé.
La région est traversée par le fleuve Mahajilo et ses affluents (le fleuve de la Mania, le fleuve de
Kitsamby, la rivière Sakay), ainsi que le Bas Mangoro et son affluent la rivière de l’Onive).
I.1.2. Environnement humain
I.1.2.1. Effectif3
En 1993, Vakinankaratra comptait 1,142 million de personnes, soit 9,35 % de la population
nationale. En 2013, selon les estimations4, ce taux n’était plus que 8,3 %. Cette diminution est
imputable à la croissance plus rapide de la capitale d’Antananarivo. La population au sein de
la région est très inégalement répartie avec des districts très peuplés et d’autres avec une population
peu nombreuse où le District d’Antsirabe II reste la zone la plus peuplée avec un effectif de
261 929 habitants en 1993(Cf. Annexe 1).
I.1.2.2. Composition ethnique et caractéristique de la population.
La composition ethnique des habitants de la région est constituée en majorité de l’ethnie
Merina depuis l’époque précoloniale et d’un brassage continu de l’ethnie Betsileo (CREAM, 2013).
La population est jeune, car la classe d’âge de 15 à 65 ans est la plus élevée (48% et 57%) par
rapport à la classe d’âge de moins de 15 ans et à la classe d’âge de plus de 65 ans (Cf. Annexe 2).
I.1.3. Environnement économique
L’environnement économique de la région est marqué par la cohabitation d’un tissu
industriel moderne et d’un secteur primaire en pleine explosion qui semble paradoxal
(RANDRIANASOLO, 2007). Certaines industries du pays y sont implantées telles que
les industries agroalimentaire (STAR, SOCOLAIT, etc.) et les industries du textile et de
l’habillement (Groupe SOCOTA-COTONA-COTONLINE, groupe CIEL avec AQUARELLE,
etc.).
Cependant, le principal secteur d’activité de la population reste le secteur primaire qui
représente 86% de la branche d’activité de la population de Vakinankaratra. Le reste ou 14 %
des emplois est orienté dans la confection, l’industrie agro-alimentaire, le bâtiment et travaux
publics, le commerce, etc. [INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI (2012) cité par
SOURISSEAU et al (2016)].
2 SOURISSEAU et al, 2016. 3 SOURISSEAU et al, 2016. 4 Selon les informations tirées de SOURISSEAU et al, 2016, il n’y a pas de recensement récent de la population, les données
démographiques disponibles sont des projections faites à partir du recensement de 1993.A cette date, la région n’existait pas, depuis
les districts ont changé. Ainsi, les chiffres sont ainsi reconstitués, avec des approximations.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 7
I.1.3.1.Agriculture
L’agriculture contribue à hauteur de 26,4% au PIB5 et emploie environ 68 % de la main
d’œuvre active (FAO, 2015). Ainsi, l’Agriculture, comme dans tout Madagascar, constitue l’activité
principale de la région de Vakinankaratra. En 2014, la Direction Régionale du Développement
Agricole évaluait la superficie cultivable à plus de 608 000 ha dont 20% en rizières (SOURISSEAU
et al, 2016). Les districts de Betafo et Mandoto regroupent près du tiers de cette superficie. Le riz
étant la principale culture vivrière de Vakinankaratra une production de 552 000 tonnes en 2010
(SSA6, 2012). Les autres cultures vivrières sont la culture de maïs, de haricot, de manioc, de patate
douce et la culture de pomme de terre.
I.1.3.2.Elevage.
En 2009, l’élevage la région de Vakinankaratra est dominé par l’élevage porcin avec plus de
125 000 têtes qui représentent un peu moins de 10 % du cheptel national. Viennent ensuite
l’élevage de volailles (1 390 927 têtes) et l’élevage bovin (324 607 têtes) avec des parts respectives
de 5,3 % et 5,1 % du cheptel national 7(Cf. Annexe 3). Deux zones d’élevage bovin peuvent être
distinguées qui sont la zone Ouest, à vocation d’élevage bovin extensif (Betafo Ouest) et qui est
surtout un lieu de polarisation commerciale des zébus ;et la zone laitière constituée essentiellement
de Antsirabe II, Antanifotsy et de Faratsiho (MAEP, 2003).
I.2. CONTEXTE DE LA FILIERE LAIT
I.2.1. Production laitière mondiale
A l’échelle mondiale, la production de lait de vache a connu une augmentation depuis
2010 (tableau 1). Sur Janvier-Avril 2016, la production a augmenté d’environ 3% selon
l’Observatoire de marché du lait de la Commission Européenne en 2016. Le cheptel laitier8 recensé
dans le monde en 2013 est de 272 millions de vaches laitières. Près de 40 % du cheptel vit en Asie,
14% en Europe et seulement un peu plus de 3% aux Etats-Unis.
Tableau 1 : Production laitière mondiale
Année 2010 2011 2012 2013 2014
Lait de vache en millions de tonnes 609,8 623,6 636,7 642,2 663,2
Source : Fédération Internationale du Lait (http://www.produits-laitiers.com/l-economie-laitiere-
dans-le-monde/consulté en Septembre 2016).
5Produit intérieur brute
6Service de la Statistique Agricole 7 MEI/CREAM/Monographie 2009 in CREAM, 2013. 8http://www.produits-laitiers.com/l-economie-laitiere-dans-le-monde/consulté en Septembre 2016.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 8
I.2.2. Production laitière au niveau nationale
I.2.2.1. Parcours de la filière lait à Madagascar
1840 : Introduction de Jean Laborde de reproducteurs de race laitière (Garonnaises,
Bordelaises et Bretonnes), naissance des races « Rana » (croisement entre les races reproducteurs
et les zébus malgaches).
Période coloniale : Installation des colons autour d’Antananarivo et d’Antsirabe et dans
le Moyen Ouest, introduction de différentes races plus performantes (Française Frisonne Pie Noire
(1945), Montbéliarde …) ; et mise en place des centres de recherches zootechniques et vétérinaires
(Kianjasoa…).
Entre 1929 et 1972 : Croisement entre le taurin limousin, le zébu afrikander et le zébu
malagasy donnant naissance à la race « Renitelo » [LHOSTE et coll. (1993) cité par
RAKOTOMANANA, (2005)] qui a pratiquement disparu.
1945 : Application de l’Insémination artificielle (IA) pour la première fois à Madagascar à
la station d’Andravoro. En 1952, transfert du centre à Anosimasina (RAKOTOMANANA, 2005).
1962 : Création du BCL (Bureau Central Laitier) par l’Etat malagasy sur
la recommandation de la FAO. Il a pour objectifs principaux de « Promouvoir et de Coordonner
toutes actions concernant le développement de la production laitière sur les Hauts-Plateaux
malagasy, la Valorisation, le Contrôle et la Commercialisation des Produits laitiers à Madagascar. »
[NORAD9, 1984 cité par RANDRIANOMENJANAHARY, 1993].
De 1963 à 2007, lancement de la CNIA (Centre National d’Insémination Artificielle)
fournissant des semences réfrigérées destinées à l’insémination artificielle. A partir de 1985,
rattachement du centre à la BCL. Le CNIA a généré la mise en place de deux fermes (Anosimasina
et Kianjasoa) et 14 sous- centres d’insémination (1985), contre 5 sous- centres en 2007 (MAEP,
2007).
1965 : Introduction de la race PRN par le missionnaire de la ferme Ecole Tombontsoa10
, et elle s’est
répandue dans la région de Vakinankaratra, puis sur l’île (depuis l’existence de FIFAMANOR en
1972) (RAKOTOMANANA 2005).
En 1972 : Création de FIFAMANOR suite à un accord entre le NORAD et l'Etat Malgache pour
intervenir sur deux volets : l'agriculture, et l'élevage laitier .C’est à partir de cette année qu’à
commencer l’Insémination Artificielle (IA) payante (CONSULTING PLUS, 2010).
9NOrwegian Agency for international Development. 10Une école agricole et professionnelle qui a été créée sous l’initiative du pasteur Rasolofoson David à Vakinankaratra. La mise en
place du projet a été aidée par la FLM (Eglise luthérienne de Madagascar) et la NorvegianMissionary Society .Elle a pour but de
former des jeunes provenant de familles modestes les initiant à l’agriculture et à l’élevage, dont la vache laitière.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 9
De 1985 à 1991, mise en œuvre du projet ROMANOR ou ROnono Malagasy NORveziana
(financé par la Norvège) en vue du développement de la production laitière (CONSULTING PLUS,
2010). Clôturé en 1991, ROMANOR est scindé en deux (ROMA et ROMINCO), ROMA (Ronono
Malagasy) s’occupe de la vulgarisation paysanne dans le triangle laitier et ROMINCO (Ronono
Malagasy Industrie et Commerce) assure la transformation et la commercialisation à travers
des opérations de collecte, de transformation et de commercialisation du lait produit sur les Hautes
Terres (MAHEFARISOA, 2012).
De 1991 à 1999, Création du PSE (Projet Sectoriel Élevage).C’est un projet élaboré par
l’Etat et la Banque Mondiale. Concrétisé en1993, il a pour but d’encourager la production de bétail
pour la consommation intérieure et les exportations (MAHEFARISOA, 2012).
En 2004, MDB ou Malagasy Dairy Board, un groupement d’intérêt économique fût crée.
MDB a pour but de promouvoir et de coordonner le développement de la filière lait à Madagascar.
En 2005, Madagascar a envisagé d’importer 20 000 vaches Holstein new zélandaises dont
les 900 têtes ont été débarquées en Mai 2005. Les vaches sont mises en vente par lot de 20 têtes qui
seront placées sur un terrain de 40 ha que l’Etat mettra à la disposition de l’investisseur.
(RAKOTOMANANA, 2005).
Il est à rappeler qu’en 1969 et 1990, le développement de l’industrie laitière malagasy est
influencé par l’évolution de la production laitière mondiale. Cette période a vu l’installation
d’industries laitières telles que le SMPL (« Socolait » actuelle) en 1970, la société TIKO en 1978
(RAKOTOMANANA, 2005).
En 2007, démarrage du projet de développement de la filière lait avec Land O’Lakes,
financé par l’USDA par le projet Food and Progress américain.
I.2.2.2. Production laitière nationale
La production nationale est évaluée autour de 50 millions de litres/an contre une
consommation accrue de 100 millions litres/an (MINISTERE DE L’ELEVAGE, 2014).
Cette consommation de lait est estimée à 5 Kg/hab./an (MAEP, 2004-2005) qui est bien inférieure à
60 kg/hab./an relatifs aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé. Le cheptel
bovin11
est à environ 10 millions de têtes, dont 1,8 millions de vaches laitières (dont la traite
s’effectue régulièrement ou occasionnellement). La consommation est faible par rapport à l’Afrique
de Sud12
(27,6 Kg/Hab./an en 2013) et à l’Algérie 13
(108kg/habitant/an). Actuellement, Madagascar
importe encore beaucoup de laits en poudre, de laits concentrés et de produits dérivés.
11FAO STAT 2013 (http://faostat.fao.org. consulté en Septembre 2016). 12http://www.produits-laitiers.com/les-apports-nutritionnels-en-proteines/ Consulté en Septembre 2016. 13http://matv.mg/filiere-lait-une-prodution-moyenne-de-100-millions-de-litres-par-an Consulté en Octobre 2016.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 10
I.2.2.3. Impact de la crise politique et économique de 2009 sur les élevages laitiers.
A la veille de la crise (2008), la filière lait a connu un essor remarquable, la production
de lait à grimpé de 45 millions de litres pour cette année. Mais au cours de l’année de crise (2009),
la production laitière a chuté pour atteindre 43 millions de litres de lait. La crise politique et
économique de janvier 2009 a eu des conséquences importantes sur la filière lait dans la région de
Vakinankaratra suite à la fermeture de l’usine TIKO qui occupait 50% de la collecte du lait et
les répercussions affectaient également les revenus des producteurs (PENOT et DUBA, 2011).
Suite aux évènements, beaucoup de vaches laitières ont été transférées dans d’autres régions dans le
cadre du projet PSDR (CONSULTING PLUS ,2010) ; et la hausse du prix du carburant a affecté
l’approvisionnement en intrants et en produits de premières necessités. L’effet se ressent au niveau
de l’alimentation du bétail.
Après la crise, la filière lait est en cours de redressement. La filière poursuit son effort
de restructuration avec la création de nouveaux débouchés (transformation) et l’apparition de petits
collecteurs privés. Les producteurs sont pour la plupart organisés en coopératives ou groupements
(SOURISSEAU et al. 2016). Les ONG14
, coopératives et autres structures d’appui sont très
dynamiques dans la reconstruction de la filière (CONSULTING PLUS, 2010). Des sociétés
de transformation tissent des relations contractuelles avec les producteurs.
I.2.3. Production laitière de la région de Vakinankaratra
I.2.3.1. Production et consommation.
La région de Vakinankaratra produit à elle seule près de 35,5 millions de litres de lait par an
[FIFAMANOR (2007) cité par RARIVOARIMANANA (2010)]. La production laitière présente
une variation saisonnière et peut diminuer jusqu’à 50% de celle de la saison des pluies en saison
sèche à cause de l’insuffisance des ressources fourragères durant cette période [FIFAMANOR
(2007) cité par RARIVOARIMANANA (2010)]. Mais la région reste la première zone productrice
de lait de vache à Madagascar (CREAM, 2013). Avec un retour de quelques années plutôt,en 2002,
une chute de production de lait est survenue due à la crise (RAHARIMALALA, 2016). Cette chute
de production a été breve car en 2003, la production a grimpé avec une quantité de 27 millions
de litres.
La majorité du lait produit dans la région du Vakinankaratra sont transformées en yaourt et
fromage par des transformateurs artisanaux, le reste est commercialisé à Antsirabe
(RARIVOARIMANANA, 2010).
14
Organisme Non Gouvernemental
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 11
Tableau 2: Evolution de la production laitière dans la région de Vakinankaratra entre 2000 et 2005.
Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Quantité de lait
produites en millions
de litres.
24 25.5 20.5 27 29 27,7
Auto consommation nd nd 4 6,6 4,6 3
Production
Commercialisée en
millions de litres
nd nd 16,2 20,2 24,2 24,6
Sources
IPROVA, 2003 et
ONUDI, 2007 cité par
RAHARIMALALA
(2016).
FIFAMANOR, Département
Vulgarisation in CONSULTING
PLUS ,2010.
I.2.3.2. Productivité par vache.
La production laitière de la région de Vakinankaratra est assurée principalement par
un cheptel bovin composé de vaches de race améliorée, notamment grâce aux actions
du FIFAMANOR qui depuis les années 1970 ont permis de diffuser des races (PRN, Rana) plus
productives que les vaches zébus, dans toute la région. De façon plus ponctuelle, la race
Prim’Holstein (anciennement Frisonne) a été aussi diffusée.
La production de lait frais par tête reste relativement inchangée depuis l’an 2000, qui tourne
autour de 2500 litres/an/vache (Tableau3) (CONSULTING PLUS, 2010).Cependant,
la performance laitière dépend du degré de sang, de l’alimentation et de la technique d’élevage
(MAEP UPDR, 2004) (Cf. Annexe 4).
Tableau 3: Estimation de la production annuelle de lait par tête dans la région de Vakinankaratra
(litres) 2000 à 2006.
Année de production 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Moyenne annuelle en
Litre/vache 2 502 2 549 2 066 2 576 2 783 2 604 2 486
Source : FIFAMANOR Département Vulgarisation in CONSULTING PLUS (2010)
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 12
I.2.3.3. Effectif et répartition du cheptel laitier
La région de Vakinankaratra compte 47 034 vaches laitières de race confondues, soit 30 %
de l’effectif de vaches dans le triangle laitier et 5,42 % de vache au niveau national.
Tableau 4: Répartition des vaches laitières par district suivant la race.
District Race locale 15
Race améliorée 16
Total des vaches
laitières
Betafo 7438 1086 8524
Ambatolampy 4475 155 4630
Antanifotsy 9588 700 10 288
Faratsiho 9773 105 9878
Antsirabe II 12269 1445 13 714
TOTAL 43 543 3491 47 034
Source: MAEP/ DMEESSA (2007) cité par CONSULTING PLUS (2010).
Source : Conception de l’auteur avec les données de MAEP/ DMEESSA (2007)
Figure 2 : Répartition des vaches laitières dans la région de Vakinankaratra.
I.2.3.4. Elevage laitier et culture fourragère
La majorité des exploitations possèdent entre 1 et 3 vaches laitières car l’élevage laitier
ne constitue pas l’activité principale des éleveurs. De plus, plusieurs exploitants adoptent la monte
naturelle pour les vaches laitières avec moins d’exigence sur la supériorité génétique du géniteur
(taureaux) (RARIVOARIMANANA, 2010). Néanmoins, l’introduction de races améliorées a
permis de développer et d’améliorer la production de lait où la production quotidienne par type
d’exploitation varie de 2 litres à 40 litres. (ANDRIAFEHIMIARISOA, 2009).
15un degré de sang 1/2 ou ayant de croisement avec la race améliorée. 16un degré de sang de plus de 3/4
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 13
La régulation de l’alimentation des vaches en fonction de la saison17
Les conditions agro-climatiques de Vakinankaratra sont propices à l’élevage laitier et
à la bonne production fourragère même si une réduction de la production de biomasse est constatée
pendant la saison sèche contrairement à la saison de pluie (KASPRZYK, 2008).
La culture fourragère est possible presque toute l’année [MANDIMBINIAINA, 2009 cité
par PENOT et DUBA (2011)] mais la majorité des exploitants régulent l’alimentation des vaches
laitières en fonction des deux saisons (saison sèche et saison pluvieuse). Lors de la saison pluvieuse,
le bétail est alimenté sur pâturage naturel ou cultivé, présentant des plantes fourragères (Aristida
rufescens) ou des graminées (Maïs, Pennisetum, Brachiaria, Chloris). Tandis que durant ; la saison
sèche, la production de biomasse est limitée en raison de la diminution de la température ;
les vaches laitières sont alimentées essentiellement par des résidus de cultures (paille de riz et paille
d’orge) et des graminées tempérées cultivées en contre-saison dans les rizières (avoine, ray-grass)
[FIFAMANOR, 2009 cité par PENOT et DUBA (2011)]. Pendant cette saison, un mauvais état
général des vaches est observé entrainant la diminution progressive de la production.
Les techniques de conservation de la biomasse (foin, ensilage…) commencent à être
utilisées par les éleveurs mais les méthodes de valorisation des pailles (traitement de la paille de riz
à l’urée) sont absentes. Toutefois, grâce à la proximité de la Brasserie STAR des drèches seront
disponibles toute l’année dans la zone d’Antsirabe et de Betafo (PENOT et DUBA, 2011).
L’utilisation des concentrés et des cultures fourragères varient en fonction de l’activité
principale de l’éleveur. D’une part s’il perçoit un salaire régulier, il a les moyens financiers
d’acheter ou de louer des terres afin de cultiver des fourrages et d’acheter des concentrés industriels
ou des matières premières pour sa propre fabrication (de concentrés). D’autre part, s’il est un simple
agriculteur, il peut préférer valoriser les résidus de ses cultures et les excédents vivriers produits sur
son exploitation [STARTER (2008) cité par RARIVOARIMANANA (2010)].
17PENOT et DUBA (2011).
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 14
I.3. GENERALITES SUR LE LAIT ET LA QUALITE DU LAIT
I.3.1. Définitions du lait
Le « lait » est un produit alimentaire très particulier, nombreuses sont les définitions de ce mot :
- Selon le Congrès international de la répression des fraudes alimentaires de Genève, en 1908 :
le lait est « le produit intégral de la traite complète et ininterrompue d’une femelle laitière bien
portante, bien nourrie et non surmenée ».
-Selon la FAO et l’OMS ,2005, le lait est « la sécrétion mammaire normale d’animaux de traite
obtenu à partir d’une ou plusieurs traites, sans rien y ajouter ou en soustraire, destiné
à la consommation comme lait liquide ou à traitement ultérieur » .
-« lait frais » : dans le dictionnaire de la langue française, le mot « frais » veut dire « nouvellement
produit ». Dans cette étude, le terme « lait frais » désigne le lait cru non conditionné, ni reconstitué
ni transformé (RANDRIATSARAFARA, 2008).
I.3.2. Composition globale du lait
D’une manière générale, le lait est composé en majeure partie d’eau avec une quantité de
902 grammes et une quantité estimée à 130 grammes de matière sèche totale. Le poids total
d’un litre de lait équivaut à 1032 grammes. Ainsi, le lait possède une densité de 1,032 à 15°C qui
est supérieure à la densité de l’eau. Cependant, la composition du lait n’est pas toujours constante
(Cf. Tableau 5). Celle-ci dépend de la race de l’animal, de son stade de lactation, de son âge et de
son alimentation (HERMIER et al, 1992).
Tableau 5 : Variation de la composition du lait chez quelques mammifères (g/l).
Eau Matière
Sèche Matière protéique
Matières
grasses
Glucide
Lactose
Matières
minérales Ca
18 P
19
total caséine albumine
Vache 900 130 30-35 27-30 3-4 35-40 45-50 8-10 1,25 0,95
chèvre 900 120 35-40 30-35 6-8 40-45 40-45 5-8 1,35 1
Brebis 860 190 55-60 45-50 8-10 70-75 45-50 10-12 1,9 1,5
Source
MINEL, DÉCRET N° 2011-588
réglementant la production primaire de lait
destiné à la consommation humaine
COURTET
LEYMARIO
S (2010).
18 Calcium 19 Phosphore
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 15
I.3.3.Qualité du lait
Lorsque la qualité est évoquée, surtout pour un produit aussi variable que le lait, de
multiples interprétations subjectives peuvent être adoptées selon les critères retenus pour la définir.
Mais l’ISO 9000 (1982) a défini la qualité comme étant une aptitude d’un produit ou d’un service à
satisfaire, au moindre coût et dans les moindres délais les besoins exprimés ou implicites des
consommateurs.
La qualité se divise en huit composantes (CORPET, 2014) :4 S+2R+1 T+1 E
Tableau 6 : Huit composantes de la qualité du lait
4S 2R TE
1) Sécurité : qualité
microbiologique
2) Santé : qualité nutritionnelle
3) Saveur : qualité organoleptique
4) Service : qualité d’usage
5) Régularité : qualité
constante
6) Rêve : qualités
transférées 20
7) Technologie : qualité apte à
la transformation
8) Ethique : prise en compte «
des autres » (du bien-être des
animaux, des producteurs, etc.)
Source : CORPET, 2014.
Cette première composante qui est la qualité microbiologique a pris toute l’attention de l’étude.
I.3.3.1. Qualité microbiologique du lait21
La nature de la flore microbienne du lait cru est à la fois complexe et variable
d’un échantillon à un autre (BOURGEOIS, 1996). Le lait au cours de la traite, du transport et du
stockage est contaminé par une grande variété de microorganismes.
I.3.3.1.1. Microorganismes banals
Ce sont les espèces de Bacilles Gram (-) qui ne présentent pas d’effet notable sur le lait et
ne sont pas utilisés en industrie laitière lait. Selon RAZAFINDRAHAGA(1997), le lait à la sortie
de la mamelle possède déjà un certain nombre de microorganismes banals provenant de la vache
même. Ce sont des germes qui sont indifférents à la qualité du lait (cellules mammaires,
leucocytes).
I.3.3.1.2. Microorganismes utiles
Les microbes du lait sont très variés notamment les espèces utiles (microorganismes utiles)
qui sont les ferments lactiques utilisés dans la transformation en industries laitières. Nombreuses
sont les bactéries existantes dans le lait telles que :
20
Produit devenant populaire par sa publicité, par sa communication de bouche à oreille devenant symbolique ou imaginaire 21
HERMIER et al, 1992.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 16
- Les bactéries lactiques : Ce sont les bactéries Gram (+) (coques ou bacilles) produisant
de l’acide lactique par fermentation des oses (fermentation lactique),tolérant des pH acides,
de niches écologiques anaérobies ou anaérobies facultatives et se montrant catalase négative.
Ce sont les lactocoques, les lactobacilles mésophiles et thermophiles et les entérocoques.
Leur rôle est d’acidifier le lait caillé, de participer à la formation du goût (production
d’arôme).Ils sont utilisés sous formes de levains sélectionnés.
- Les bactéries propioniques sont des bactéries à Gram+, elles participent à la formation du
goût et de l’ouverture des fromages à pâtes pressées cuites (Gruyère).
- Les microcoques et les staphylocoques non pathogènes (Staphylococcus equorum),
les bactéries corynéfores (Arthrobacter,..) sont les bactéries à Gram+.Ces bactéries ont un
rôle essentiel dans la formation du goût des fromages, notamment les fromages à croûte
fleurie ou mixte (Camembert).
I.3.3.1.3. Microorganismes responsables d’altération
Ces espèces inutiles peuvent être nuisibles dans le lait notamment :
- Les bactéries coliformes qui peuvent être responsables de gonflements précoces dans
les fromages, conduisant notamment en pâte molle, à des accidents (fromage à aspect
spongieux).
- Les bactéries psychrotrophes (genre Pseudomonas principalement mais également Bacillus)
peuvent produire des lipases et protéases extracellulaires, généralement thermostables.
Ces enzymes peuvent provoquer des défauts de goût dans les fromages (goût de rance,
amertume).
- Les bactéries butyriques (Clostridium tyrobutyricum) qui peuvent se développer dans
les fromages (à pâtes pressée cuite et non cuite) et donner des défauts de goût et d’ouverture
(gonflement tardif) par fermentation butyrique (production d’acide butyrique et
d’hydrogène).
I.3.3.1.4. Microorganismes potentiellement pathogènes
Ces germes peuvent provoquer des maladies aussi bien chez l’homme (pour la santé des
consommateurs) que chez l’animal (bactéries, levures, moisissures) certaines sont nocives.
Les microbes, des toxines, des polluants physiques ou corps étrangers, lorsqu’ils sont dans
les aliments, peuvent nous rendre malades voire être mortels (RAHARIMALALA, 2016).
La zoonose majeure transmise par le lait est la tuberculose (Mycobacterium tuberculosis
bovis), vient ensuite la brucellose (Brucella abortus) provoquant la fièvre ondulant.
Les bactéries pathogènes classiquement recherchés en contrôle qualité sont :
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 17
- Staphylococcus auréus produisent des entérotoxines dont l’ingestion provoque des
vomissements, souvent accompagnés de diarrhée.
- Salmonella typhii peut provoquer la typhoïde (typhus chez l’homme) [ROBERT(1979) cité
par RAZAFINDRAHAGA, 1997].
- Escherichia coli (toxi-infection alimentaire) provoquant une entérite (diarrhées)
- Listeria monocytogène peut provoquer la listériose qui atteint la femme enceinte (et peut
aboutir à un avortement), le nouveau-né et l’adulte immunodéprimé (septicémies,
méningites).
Néanmoins, les germes pathogènes peuvent être détruits par la pasteurisation. Le lait peut
être contaminé également par des résidus de médicaments ou de pesticides, des métaux lourds… qui
peuvent être néfastes aussi bien au niveau des consommateurs qu’au niveau des technologies.
(GILLIS, JC. 1996). L’aflatoxine M1 est aussi sécrétée dans le lait et peut causer des maladies chez
l’homme.
Bref, les microorganismes pouvant métaboliser les substances nutritives peuvent se
développer dans le lait si les conditions intrinsèques (pH, potentiel d’oxydoréduction, etc.), et
extrinsèques (température) leur sont favorables (HERMIER et al. 1992). (Cf. Annexe 5).
I.3.3.2. Qualité organoleptique
Le lait est un liquide opaque de couleur blanche, plus ou moins jaunâtre suivant la teneur
enβ-carotène de ses matières grasses (Cf. Annexe 6) [JOFFIN, 1992 cité par
ANDRIAFEHIMIHARISOA, 2009]. Avec une saveur douçâtre (agréable), le lait a une odeur faible
mais identifiable pouvant être variable en fonction de l’alimentation [FAO, 1995 cité par
RAHARIMALALA, 2016].
I.3.3.3.Qualités physico-chimiques
Les qualités physico-chimiques font références aux caractéristiques initiales du lait frais.
L’altération ou les traitements technologiques peuvent les modifier. Parmi ces facteurs, certains sont
liés à la fraîcheur du lait (la densité, le point de congélation, le pH), d’autres aux traitements subis
par le lait (la viscosité, la tension superficielle) [ALAIS, 1984 cité par
ANDRIAFEHIMIHARISOA, 2009].
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 18
Tableau 7: Caractéristique physico-chimique du lait.
Paramètres Unités Moyennes Valeurs extrêmes
Energie Kcal/litre 701 587 - 876
Densité à 15°C °C 1,032 1,028 – 1,034
ph à 20°C 6,6 6,5 – 6,8
Acidité titrable °Dornic 16 15 -17
Point de congélation °C - -0,54 à -0,58
Point d’ébullition °C - 100,15 -100,17
Chaleur spécifique à 15°C 0,940 – 0,38 -
Viscosité du lait entier à 20°C Centipoise 2,2 -
Indice de réfraction 40,2 -
Tension superficielle - 47 – 53
Conductivité électrique à 25°C Siemens 45.104 40 - 50.10-4
Potentiel d’oxydoréduction °C 0,25 +0,20 - +0,30
Source : ALAIS (1984) cité par ANDRIAFEHIMIHARISOA(2009)
I.3.3.4.Qualités nutritionnelles
Très riche en éléments en nutritifs (protéines, lipides, glucides, sels minéraux et vitamines) qui
sont présents à des concentrations satisfaisantes dans le lait pour la croissance et la multiplication
cellulaire, le lait constitue l’unique aliment naturel de démarrage de tous les jeunes mammifères
(ANDRIAFEHIMIHARISOA, 2009). La qualité nutritionnelle est surtout représentée par le Taux
protéique et Taux butyreux du lait22
. Le taux protéique (TP) de la matière azotée total et le taux
butyreux (TB) de la matière grasse conditionnent la valeur marchande du lait. Ils représentent
respectivement les teneurs en protéines et en matières grasses qui constituent la matière sèche utile
du lait. Si pour le producteur, ces deux critères sont à la base du système de paiement du lait à
la qualité, pour le transformateur, le TP et le TB sont essentiels pour l’obtention du fromage.
I.3.3.4.1. Taux protéique ou TP23
Le TP est une caractéristique importante du lait, plus le TP sera élevé par rapport à une
référence et plus le lait sera payé cher au producteur (paiement du point de TP). En effet, plus le TP
est élevé et plus le rendement de transformation fromagère sera bon. La dénomination « matières
azotées totales » ou MAT (33 g/L) regroupe les protéines (TP), ainsi que l’azote non protéique
(dont l’urée). Les protéines (32,7 g/L), parmi lesquelles la caséine (80 %), les protéines solubles
(albumines et globulines - 19 % - et des protéines diverses (enzymes) - 1 % -) en constituent
la fraction essentielle. Le lait constitue ainsi une importante source de protéines pour l'homme
(Cf. Annexe 7). 22COURTET LEYMARIOS 2010 23http://www.ulb.ac.be/sciences/cudec/LaitComposition.htmlconsulté enSeptembre2016.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 19
I.3.3.4.2. Taux butyrique ou TB
Le taux de matières grasses ou taux butyreux (TB) est variable selon les conditions d’élevage.
Les matières grasses (39 g/l) sont présentes dans le lait sous forme d'une émulsion de globules gras.
Pour le lait de vache, elles varient, en moyenne, entre 3,5 et 4,5 % (g/kg). Cette matière grasse est
constituée principalement de composés lipidiques. Le trait commun aux lipides est la présence
d'acides gras qui représentent 90 % de la masse des glycérides ; ils sont donc les composés
fondamentaux de la matière grasse. (Cf. Annexe 8).
Le rancissement est une indication familière de la détérioration des matières grasses.
I.4. OPTIMISATION DE L’ORGANISATION DE LA COLLECTE
I.4.1. Notions de collecte
I.4.1.1. Point de collecte24
I.4.1.1.1. Points de collecte simple
Ce sont des endroits sur le réseau de collecte où les éleveurs livrent le lait aux ramasseurs
(ou précollecteurs dans cet étude). C’est également un lieu plus ou moins fréquenté qui vise à
faciliter les tâches des précollecteurs et des éleveurs pour la transaction du lait et pour des raisons
de distance. Ce lieu doit se trouver ainsi sur un endroit où tous les éleveurs équidistants vis-à-vis du
précollecteurs.
En outre, il existe le « ramassage porte à porte » effectué par le précollecteur quand
l’habitation de l’éleveur se trouve sur le chemin du précollecteur lors du ramassage. L’installation
de ces points de collectes n’exige pas de dépenses. Néanmoins, l’idéal c’est de se placer dans
un abri, pour que le lait de mélange déjà collecté ne s’expose pas trop au soleil jusqu’à
l’achèvement du ramassage de tous les laits issus des éleveurs de la zone du précollecteur.
I.4.1.1.2. Point de collecte avec centre de réfrigération » ou « Centre de collecte réfrigéré25
Nommé aussi « centre de réception »26
où le lait cru est déchargé, analysé, éventuellement
refroidi, et stocké avant d’y être transformé ou d’être transféré vers l’usine de transformation. C’est
un lieu où l’éleveur direct (qui se trouve à proximité du centre de collecte) et les précollecteurs (qui
viennent juste de leurs points de collecte respectifs), livrent le lait.
24Référence aux travaux de RANDRIANOMENJANAHARY, 1993 25 Centre de collecte réfrigéré est géré directement par la laiterie selon RANDRIANOMENJANAHARY en 1993 mais actuellement
le CCR est en centre qui peut être géré par une personne indépendante (collecteur privé). 26 Selon Guide autocontrôle pour la collecte et le transport de lait cru ,2005.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 20
L’installation du centre de collecte (Cf. Annexe 9) est fixe, le mur est en duret le sol doit
être résistant, antidérapant et facile à nettoyer. L’eau doit être en abondance. Les équipements
sont le groupe électrogène en cas de coupure de l’électricité, les appareils de mesure (bidons, seau,
gobelet, etc), les appareils de contrôle (lactodensimètre, thermomètre, etc.), les matériels de
réception et de stockage (tank réfrigérant, bidons de 150 litres à 220 litres, tamis.
I.4.2.Quelques types de collecte.
I.4.2.1. Collecte différentielle
C’est une technique de collecte qui consiste à diviser les centres de collecte en zones de
collecte suivant la qualité du lait. Ainsi le lait collecté est rassemblé de manière à obtenir du lait
suivant leur qualité. Cette dernière est classée selon la grille de qualité prédéfinie. Cette technique
de collecte permet de prévenir la cross-contamination27
du lait de bonne qualité
(RAZAFINDRAHAGA ,1996) par le lait dit de moyenne et/ou de mauvaise qualité. Le lait de
bonne qualité reste ainsi en sécurité.
I.4.2.2. Collecte FAR IN FAST ou FIF
« Far in Fast » est un terme anglo-saxon:« Far » signifie : loin et « Fast » signifie : rapide
ou en avance. Ce type de collecte a pour principe de ramasser en avance les laits des zones les plus
éloignées de l’usine. C’est une stratégie qui minimise la durée de transport et qui permet de
prévenir l’altération du lait qui peut être causé par le temps de transport
(RAZAFINDRAHAGA ,1997).
I.4.2.3. Ramassage en pétales
Quand les infrastructures routières les permettent, les laiteries font l’organisation en pétale,
qui exige la position de la laiterie au centre de sa zone de collecte et que les producteurs se trouvent
dans un cercle autour de la laiterie. Ce type de ramassage permet d’obtenir une densité kilométrique
laitière élevée. Mais pour pallier les différences de quantité entre la période creuse et période de
pointe les laiteries modifient soit le nombre de pétales soit la fréquence de collecte (collecte des 48
heures ou collecte des 72 heures).
A Madagascar, les infrastructures routières ne permettent pas de réaliser cette organisation
en pétales, mais le défaut de matériel de conservation oblige les laiteries à effectuer les tournées de
ramassage quotidiennes.
27
Contamination croisée.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 21
I.4.3. Méthodes de conservation du lait frais
I.4.3.1. Conservation par le système lactoperoxydase28
Le système lactoperoxydase (LP) a principalement un effet bactériostatique dans le lait cru
(FAO/OMS ,2005).Cette méthode de conservation innovante a été créée à Cuba, par l’Ingénieur
Pastor Ponce Ceballo (PhD), du Centre National de Santé Agricole (CENSA).
I.4.3.1.1. Principe du système LP
Le lactoperoxydase est une enzyme endogène et abondante dans le lait cru avec un taux de
70 mg/l et un poids moléculaire est de 78000 daltons. Les deux composants essentiels au
fonctionnement de ce système sont le peroxyde d’hydrogène et de thiocyanate, naturellement
présents dans le lait à des concentrations variables. L’activation de la lactoperoxydase a un effet
bactériostatique sur le lait cru.
La méthode utilisée pour activer le système LP dans le lait consiste à ajouter environ 10 ppm
(parties par million) de thiocyanate au lait cru et une quantité équimolaire (8-9 ppm) de peroxyde
d’hydrogène selon la Fédération Internationale de Laiterie (RAZAFINDRAHAGA, 1996).
I.4.3.1.2. Pays qui adoptent le système LP
Le Kenya est l’un des pays qui adopte la conservation du lait par le LP. Les pays
producteurs des activateurs du système LP sont la Suède, le Cuba et la France. A Madagascar,
le système LP n’est pas encore en vigueur.
I.4.3.1.3. Avantages sur l’utilisation du système Lactoperoxydase
Prolongement sur le temps de conservation du lait
Du fait de l’effet bactériostatique sur le lait cru du système LP, ce système prolonge
effectivement la durée de conservation du lait cru pendant 7–8 heures à des températures ambiantes
28
www.ideassoline.org consulté en Novembre 2016
Source :
RANDRIANOMENJANAHARY,
1993.
Figure 3 : Schéma de tournées « en
pétales ».
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 22
d’environ 30°C ou plus longtemps à des températures plus basses si le lait cru est de bonne qualité
hygiénique. Ainsi, le système LP s’est révélé efficace dans la chaîne du lait, conservant la qualité
initiale du lait à la ferme jusqu’à son arrivée à l’usine laitière. L’effet inhibiteur du traitement
dépend de la température de stockage du lait soumis au système LP comme il est indiqué dans
le tableau 8.
Tableau 8: Augmentation de la conservabilité du lait par le système LP à différentes températures.
Température (°C) Durée (heures) Référence
31-35 4-7 PONCE et Al., 2005.
30 7-8 CAC, 1991b.
25 11-12 CAC, 1991b.
20 16-17 CAC, 1991b.
15 24-26 CAC, 1991b.
4 5-6jours ZAPICO et Al(1995) ; LIN et CHOW, 2000.
Source : FAO/OMS 2005
Le coût de conservation du lait est faible
La conservation du lait par le système LP est moins chère et ne nécessite pas une grande
dépense pour l’équipement et les installations de réfrigération [BARRAQUIO et al, 1994 cité par
FAO/OMS, 2005]. Au Kenya, le coût du refroidissement d’un litre de lait allait de 0,017 dollar
(grands refroidisseurs) à 0,032 dollar (petits refroidisseurs) tandis que l’application du système LP
était moins chère, 0,014 dollar [WANYOIKE et al. 2005 cité par FAO/OMS, 2005].
I.4.3.2. Conservation par le froid29
.
Le froid est l’agent de conservation le plus utilisé en matière de conservation lors
de la collecte et du transport. Plusieurs sont la méthode de « conservation par le froid », notamment
le procédé le plus ancien et le plus rudimentaire qui consiste à immerger les bidons de lait dans
de l'eau fraiche courante ou d’effectuer l'arrosage des bidons. Cependant, le procédé par immersion
n'est efficace que dans la mesure où l'eau est très froide et d'un gros débit. La réfrigération du lait
dans un camion-citerne réfrigéré et dans un tank réfrigérés ont également un autre moyen de
conservation par le froid.
I.4.3.2.1. Avantages et principes de l’utilisation de la réfrigération
La conservation du lait par le froid affecte moins la composition du lait et sa valeur
nutritionnelle (RAZAFINDRAHAGA, 1997). La réfrigération à basse température inférieure à 4°C
en continu du lait depuis la traite jusqu’à l’usine offre une bonne qualité bactériologique du lait.
29WEBER (FAO) 1985.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 23
Cependant, le lait étant un produit nutritif, sans la réfrigération, des germes, notamment les flores
mésophiles totales, vont se développer rapidement dans le lait. En outre, le lait possède une phase
bactériostatique dans les 2 à 3 heures qui suivent la traite (RAZAFINDRAJAONA, 1997). Après ce
laps de temps, si aucun traitement (réfrigération) n’a eu lieu, des bactéries acidifiantes appartenant à
la classe des mésophiles se développent (RANDRIATSARAFARA, 2008).
I.4.3.2.2. Cout de la réfrigération3031
La conservation du lait par le froid est un indicateur de progrès certain mais reflète des coûts
et investissements lourds. Les entretiens du matériel de réfrigération, les mains d’œuvres, l’énergie
utilisée32
qui alimente les matériels de réfrigération, génèrent des dépenses sans tenir compte de
l’installation d’un tank réfrigérant. Cependant, la conservation du lait par un tank alimenté en
électricité est plus économique en termes de capacité de stockage par rapport à un tank alimenté par
un groupe électrogène (RANDRIANOMENJANAHARY, 1993). Normalement, le prix du tank par
litre de lait logé diminue lorsque la capacité de la cuve augmente, sauf pour les appareils de petite
contenance. Le coût de réfrigération (C.R.) comprend :
les frais fixes : ils sont indépendants de la quantité de lait réfrigéré. Ils sont constitués par
l'amortissement du matériel et l'intérêt du capital investi,
les frais mobiles : ils sont proportionnels à la quantité de lait réfrigéré et comprennent les
dépenses d'énergie électrique, de produits de nettoyage et éventuellement de main-d’œuvre.
I.4.4. La collecte et commercialisation de lait à Madagascar.
La collecte de lait à Madagascar est soumise à divers obstacles notamment à la faible densité
laitière, aux différences de production entre la saison sèche et la saison des pluies, à l’état du réseau
routier (RANDRIANOMENJANAHARY, 1993). La collecte s’effectue de manière à ce que
les collecteurs ramassent quotidiennement le lait chez les éleveurs et l’acheminent jusqu’aux centres
de collecte (CITE ,2002 cité par RANDRIATSARAFARA, 2008), aux transformateurs ou
directement chez les consommateurs mais quelques éleveurs transportent eux-mêmes leurs
productions à ces clients (RANDRIATSARAFARA, 2008). Cependant cette technique de collecte
n’utilise pas une réfrigération continue, la chaîne du froid n’est pas respectée. Les collecteurs ou les
laiteries de Madagascar adoptent les moyens de transport léger qui ont l’avantage de manœuvrer
facilement sur des routes difficiles d’accès (RANDRIANOMENJANAHARY, 1993). Les camions
30 Référence aux travaux de RANDRIANOMENJANAHARY, 1993. 31 WEBER (FAO) 1985. 32Carburants et/ou électricité générée par un central hydroélectrique.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 24
citernes33
dédiés pour le ramassage en vrac continue ne sont pas maniables sur les infrastructures
routières de Madagascar.
I.5.CONTROLE LAITIER ET PAIEMENT A LA QUALITE
I.5.1. Contrôle laitier
Le contrôle laitier est un contrôle des performances individuelles pour améliorer l’aptitude
génétique du troupeau (QSA34
ENVL, 2009). La composition chimique individuelle du lait est
également à déterminer.
I.5.1.1. Contrôle Laitier Officiel 35
Par définition, le Contrôle Laitier Officiel (CLO) est une des méthodes qui ont pour but de
déterminer la production laitière d’une vache. Cette méthode est basée sur le passage, une fois par
mois dans chaque élevage, d’un agent qui s’occupe du Contrôle Laitier(CL). Il assiste à toutes les
traites opérées pendant une période de 24 heures consécutives. A chaque traite, il relève la
production individuelle de lait et prélève un échantillon de lait par vache pour effectuer l’analyse
(POLY et al. 1966 cité par RAHARIMALALA, 2016).
I.5.1.2. Organisation du Contrôle Laitier Officiel
Le contrôle de performance est organisé au niveau international dans plusieurs pays tels que
le Canada, la Suisse, l’Allemagne et la France. Ce qui justifie la présence du Comité international
pour le Contrôle de la productivité Laitière du Bétail. D’après le tableau suivant, la méthode 3 a été
choisie comme méthode standard de référence selon les conventions internationales. Cette méthode
est utilisée dans le monde entier (RAHARIMALALA, 2016).
Tableau 9 : Méthode de contrôle laitier
Méthode Durée de contrôle (heure) Intervalle de contrôle (jour)
1
2
3
4
5
24 (Matin et soir)
24 (Matin et soir)
24 (Matin et soir)
24 (Matin et soir)
24 alternativement (Matin et
soir)
14
21
30
42
30
Source: Cultivar(1990) cité par RAHARIMALALA (2016).
33
La longueur du parcours et l’existence de petits producteurs à effectif élevé rendent difficile l’utilisation de ces
véhicules.
34 Qualité et Sécurité des Aliments, Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon développée par Alain GONTHIER, Maître
conférences de QSA. 35
RAHARIMALALA, 2016.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 25
A Madagascar, le contrôle laitier officiel est inexistant. Néanmoins, des rapports d’activités
de certains organismes comme FIFAMANOR mentionnaient des activités de CL non officiel tels
que : les échantillonnages pour la détection des fraudes, le contrôle de la qualité bactériologique du
lait à la collecte et le contrôle des rendements des vaches particulièrement performantes
(FIFAMANOR, 1990).
I.5.2. Paiement à la qualité
Selon le site de QSA ENVL en 2009, le paiement du lait à la qualité est un paiement du lait
à partir de l’évaluation de la composition chimique du lait et de la qualité sanitaire globale du lait de
mélange.
Les critères de paiement du lait au producteur connaissent toujours des évolutions. Les
modes de paiement du lait sont conçus pour orienter la production laitière en fonction des besoins
technologiques. Cependant cette orientation de paiement du lait s’est détournée de plus en plus vers
les exigences en matière d’hygiène et de la qualité du lait (POUGHEON et SANDRA, 2001).
En se basant sur la qualité hygiénique et la composition du lait, chaque pays ou chaque groupement
laitier ont leur propre critère de paiement du lait.
Paiement à la qualité du lait en Europe
En Europe36
, le paiement à la qualité est déterminé par le Règlement (CE) n° 853/2004 du
29 avril 2004 fixant les règles d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.
Les critères pris en compte pour le paiement du lait sont mentionnées sur le tableau suivant :
36
Direction générale de l'Alimentation - Sous-direction de la sécurité sanitaire des aliments - Bureau des établissements de
transformation et de distribution DGAL/SDSSA/2014-599, 2014.République Française consulté en Novembre 2016
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 26
Tableau 10 : Deux types de critères pris en compte pour le paiement du lait
Les critères obligatoires
Les critères sanitaires
(règlement (CE) n°853/2004)
Les critères relatifs
à la composition du lait
-Germes à 30°C.
-Cellules somatiques (lait de vache
uniquement).
-Présence éventuelle de résidus
d’antibiotiques ;
-Matières grasses.
-Matières protéiques ;
-Point de congélation (pour les vaches
uniquement) qui permet de déceler la présence
anormale d'eau dans le lait.
Les critères facultatifs
-Dénombrement des spores butyriques,
-Indice de lipolyse,
-Point de congélation (pour les brebis et les chèvres),
-Composition en acides gras,
- Respect du cahier des charges d’un signe d’identification de la qualité ou de l’origine, etc.
Source :www.franceagrimer.fr/.../INT-%20DGAL_%20SDASEI_NS%202014-
393_final.pdfconsulté en Novembre 2016.
Les laboratoires dédiés à l’analyse doivent être reconnus et accrédités.
Comparaison de la norme Européenne sur le paiement du lait à la qualité avec celle de
la Tunisie.
Tableau 11 : Normes européennes et tunisiennes pour le paiement du lait à la qualité
Critères Normes européennes Normes tunisiennes NT 14-141-2004
MG (g/l) >38 >30
MP (g/l) >32 >28
Point cryoscopie(°C) -0,52 -0,52
Cellules somatiques/ml <400000 <500000
Source : PROMET (Société de Promotion et d’Etudes), 2008.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 27
I.6. PRESENTATION DE SOCOLAIT ET DE RURALCAP CONSULTING
I.6.1. Présentation de SOCOLAIT
I.6.1.1. Parcours de la Société
Depuis 1962, la date de création de BCL, la Société NESTLE S.A (nom obtenu en 1972)
pratique la collecte organisée et instituée par le BCL (RAKOTOMANANA, 2005). Les produits
initiaux fabriqués par NESTLE étaient le « Lait Concentré Sucré » (1972) et la farine de blé lactée
« FARILAC » (1980).L’usine a été nationalisée sous le nom de Société Malgache de Produits
Laitiers ou SMPL (laiterie-condenserie) en 1981.Le beurre, le yaourt, le lait frais pasteurisé
le fromage ont commencé à être fabriquer en 1989.La privatisation de la SMPL par le rachat par du
groupe KARMALY a été effectuée en 1992. Ce n’est qu’en 1993 que la nomination « Socolait »
« Société Commerciale laitière » est apparue.
En Avril 2000, la Société a été rachetée par le groupe SMTP37
puis rachetée par
des nouveaux Actionnaires Adénia SA-CA (Société Anonyme avec Conseil d’Administration) en
Avril 2012.Depuis, la gamme de produits s’est développée.
En 2012, la collaboration avec RURALCAP consulting, l’usine « Socolait » améliore son
réseau de collecte et assure l’accompagnement de la collecte à travers un service vétérinaire interne.
La collaboration avec les éleveurs et les centres de collecte de lait permet aujourd’hui de fabriquer
100 % de sa gamme de produits à base de lait frais, et à 33 % de celle de longue conservation38
.
Les produits mis sur le marché sont les yaourts brassés et yaourt à boire, le lait concentré sucré, la
farine infantile, le lait en poudre, les différents types de fromages (fromages à pâtes pressées,
fromages à pâte molle à croûte fleurie, etc.), la crème et le beurre. Conformément aux normes ISO,
un laboratoire équipé au sein de « Socolait » assure les analyses et les contrôles des produits
alimentaires. Par ailleurs, le partenariat avec l’Institut Pasteur de Madagascar de la société assure
également la qualité sanitaire de ces mêmes produits.
37
Société Malgache de Transformation des Plastiques 38
www.laverite.mg/economie/item/673-socolait-vers-une-part-de-marché-à-l’international.html consulté en Novembre
2016
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 28
I.6.1.2.La qualité des produits comme stratégies de développement.
Depuis le rachat de l’entreprise par Adénia SA-CA en 2012, les nouveaux actionnaires ont
mis la qualité des produits comme stratégie de développement de la Société. Des certifications vont
permettre à « Socolait » de s’inscrire dans une conquête du marché à l’exportation39
notamment:
- la certification « HACCP » (obtenue en 2014 et confirmée en 2015) qui fait de « Socolait »
la première industrie agro-alimentaire certifiée à Madagascar.
- la certification par la norme internationale relative à la sécurité alimentaire « ISO 22 000 ».
I.6.1.3. Production, besoin et importation de « Socolait »40
L’usine produits 100 tonnes de yaourt41
par mois. Quant à sa production de produits
commercialisés, elle est de 220 tonnes par mois. Cependant, les besoins en matière de lait frais est
de 7 à 8 millions de litres par an où l’offre est faible. A cet effet, la Société importe 400 tonnes de
poudre de lait. En dehors du lait frais, le lait concentré sucré est monopolisé par la société qui
fabrique environ 100 à 200 tonnes par an (RAKOTOMANANA, 2005).
39
http://www.laverite.mg/economie/item/673-socolait-vers-une-part-de-marché-à-l’international.html consulté en
Novembre 2016
40http://www.agencepresse-oi.com/socolait-passe-la-vitesse-superieure/ consulté en Novembre 2016
41Autres produits incluant le yaourt (220 tonnes).
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 29
I.6.1.4. Organigramme de la Société en générale
D’une manière globale, l’organigramme de « Socolait » se présente comme suit
Source : Informations tirées à partir de l’organigramme de « Socolait », 2016.
Figure 4 : Représentation hiérarchique globale de chaque activité de « Socolait ».
Direction :
Développement réseau
(au niveau National)
Direction :
USINE Antsirabe
Direction :
Administratif et
Financier
Direction :
Commercial
Marketing et Entrepôt
Production
Qualité
Collecte et
développement réseau
de collecte
Laboratoire
Recherche et
Développement
Technique
DIRECTION
GENERALE
Responsables
Ressources
Humaines
Chef
comptable
Responsable
Contrôle de
gestion
industriel
Responsable
région Nord
Responsable
système
d’information
Responsable
région Sud
Responsable
Grossiste
Centre
Responsable
Commercial
Centre
Directeur
Entreposage
et Logistique
Responsable
région Est
Responsable
Supply chain
Responsable
grand compte
Responsable
Administration
des ventes
Responsable
Trade
Marketing
Responsable
Contrôle de
gestion
logistique
commercial
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 30
I.6.2.Présentation de la Société Rural Cap Consulting.
I.6.2.1. A propos de RURALCAP Consulting.
C’est une Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle (SARLU) au capital
de deux millions d’Ariary. Son siège social se trouve à l’enceinte de Socolait Ambohimena
Antsirabe qui œuvre dans de développement rural créée à Madagascar en Mars 2012 dont
la gérance est tenue par Madame Hélène PFEIFFER. La Société propose des missions de conseil et
d’expertise selon le tableau suivant :
Missions
La gestion de projets
- Conception de projets.
- Coordination et mise en œuvre.
- Suivi et évaluation.
Les productions
agricoles et animales
- Formation continue de paysans et de techniciens
- Conseil technique en élevage et en agriculture liée à l’élevage
- Conseil en gestion d’exploitation agricole
- Appui aux filières
- Appui aux organisations paysannes
- Interaction agriculture-élevage-écologie
La santé animale
- Formation continue de vétérinaires, inséminateurs, etc.
- Prévention et traitement des maladies animales
- Réseaux de surveillance
L’agro-alimentaire et
agrotourisme
Hygiène et qualité des produits animaux et d’origine animale (abattage,
transport, transformation, commercialisation, traçabilité).
- Lait et produits laitiers
- Mise en valeur de la production à la ferme.
I.6.2.2. Collaboration SOCOLAIT - RURALCAP Consulting sur la collecte de lait
Dans l’organigramme de l’usine Socolait, le Département Collecte et Développement du
réseau de collecte joue un rôle stratégique pour l’approvisionnement en lait frais. En effet, ce
département est en étroite collaboration avec Ruralcap Consulting où les activités sont résumées sur
le tableau 12.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 31
Tableau 12: Activités menées par RuralCap sur la collecte de lait.
Au niveau de la
production
Au niveau de la collecte, du transport et du
stockage
Eleveurs Précollecteurs Collecteurs
Formations
Bonne pratiques
d’hygiène
Alimentation (fabrication
foin, cultures
fourragères, etc.)
Bonne pratiques d’hygiène
Tests du lait (alcool, densité, pH, etc.)
Conseils
Conduite d’élevage
Amélioration de la
rentabilité de chaque
éleveur
Organisationnelle
Maîtrise du réseau
(Eleveurs)
Traçabilité (nouveau
réseau)
Organisationnelle
Maîtrise du réseau
(Eleveurs direct et
Précollecteurs)
Notion de fiscalité
Suivis
Visites –conseils
individualisées.
Recensement
Prospection
Visites –conseils
individualisées.
Recensement
Visites –conseils
individualisées.
Litrage journalier
Contrôles et
suivis de la
qualité du lait
Au laboratoire :
-Analyse physico-chimique (matière grasse, extrait sec total, densité, pH, taux en
eau) et analyse microbiologique (pour le dénombrement de la Flore Mésophile
Total, E. Coli, Coliformes totaux).
-Contre les fraudes tels que le mouillage, la présence de carbonate, etc. recherche
de résidus (aflatoxine, antibiotiques, pesticides).
Sur terrain :
les analyses s’effectuent à l’aide d’un Milkoscope (matière grasse, extrait sec total,
taux en eau, température, etc)
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 32
PARTIE II. MATERIELS ET METHODES
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 33
II.1. DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE
La zone à étudier est délimitée par Ambohibary, Andranomanelatra, Betafo et Manandona.
Ces quatre lieux sont les réseaux de couverture de Socolait pour la collecte de lait. Le réseau se
relie de part et d’autres de la ville d’Antsirabe selon figure ci-dessous :
Source : Echantillon de la carte de Madagascar
Figure 5: Localisation des zones pour constituer le réseau de collecte de lait
La zone Ouest (zone limité par Betafo) est une zone à très forte densité d’élevage laitier et
avec de bonnes performances. Les producteurs sont expérimentés et le système d’élevage bien
organisé. L’aménagement des terrains escarpés en terrasses et l’existence de canaux d’irrigation
permet une forte production de fourrages de contre-saison.
La zone Sud(zone limitée par Manandona) est une petite zone d’élevage où la technique
est moins maîtrisée, l’élevage est plus extensif. Les volumes collectés sont faibles car la zone est
peu étendue.
La zone Nord comprend deux grands domaines incluant la zone d’Andranomanelatra.
Cette zone est caractérisée par plaine d’Ambohibary où l’on retrouve des similarités avec la zone
Ouest (population agricole « aisée », maîtrise des techniques d’élevage), et les autres zones plus
rurales, extensives, avec moins de surfaces irriguées et donc une production très saisonnée.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 34
II.2. SITUATION INITIALE DU RESEAU DE COLLECTE
Historiquement, plusieurs entreprises effectuent la collecte du lait dans la région de
Vakinankaratra notamment TIKO ELVAK, ROMANOR et SMPL (l’actuelle « Socolait »). A cette
époque, en 1993, la concurrence entre les entreprises existait déjà. Les accords entre les organismes
de collecte sur la délimitation de la zone existent peu. Cependant ROMANOR et SMPL ont mis
d’accord sur la division des zones de collecte. La partie Sud de Vakinankaratra appartient à SMPL
tandis que la partie Nord est à ROMANOR. Par ailleurs TIKO S-A a pris la charge d’effectuer
la collecte dans toute la région de Vakinankaratra dans toutes les zones accessibles par
l’intermédiaire des camions citernes de capacité de plus de 5000 litres.
(RANDRIANOMENJANAHARY ,1993).
En 2012, la collecte chez Socolait est réalisée de façon très irrégulière, auprès de quelques
gros collecteurs de Betafo. Courant 2012, ces collecteurs sont invités à livrer quotidiennement et
constituent le début du nouveau réseau de collecte Socolait. Le réseau a beaucoup évolué les
premières années, actuellement, il est stabilisé avec environ 1300 éleveurs en production, 1500
éleveurs au total et compte actuellement 10 centres de collecte avec 6 centres qui sont contractuels.
II.3. COMPLEXITE DU RESEAU DE COLLECTE
II.3.1. Aléas du réseau de collecte
Déjà installé et hérité des différents projets (BCL, etc.) qui se sont succédés à Vakinankaratra,
le réseau de collecte de « Socolait » avec les centres de collecte vont connaître des évolutions.
Des prospections, des accompagnements techniques, des vulgarisations effectuées au niveau
des éleveurs de la région de Vakinankaratra ont pour but d’élargir le réseau de collecte.
Cependant des aléas du réseau de collecte existent et sont dus à la concurrence avec les autres
collecteurs42
de laits qui n’appartiennent pas au réseau de collecte de « Socolait », à la difficulté
de transporter le lait à cause la route. Néanmoins des précollecteurs effectuent des portes à portes
pour les zones difficiles d’accès.
En outre, les éleveurs qui deviennent autoconsomateurs de lait, quand celui-ci n’est pas une
source de revenus ou si la quantité produite est faible 43
(inférieure à 1 litre). Ils ne livrent pas ou
plus ainsi de lait.
42 Ils fabriquent du fromage ou approvisionnent les petits transformateurs de fromages, les restaurants, les ménages et la ville
d’Antananarivo. Ils ne possèdent pas forcément de tank réfrigérant et la quantité de lait qu’il collecte n’a pas trop de marge. 43 Il se peut que la vache soit déjà âgée.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 35
La complexité de l’organisation de la collecte est accompagnée également d’une part, de
la discontinuité de la réfrigération qui est due à la présence des intermédiaires et d’autre part par
l’insuffisance des tanks au sein des centres de collecte. En effet, durant les périodes de grandes
productions (pendant la saison des pluies), la capacité des tanks n’étant pas suffisante,
le collecteur est parfois amené à conserver son lait dans des bidons non réfrigérés.
II.3.2. Acteurs de la collecte
Les acteurs ou les intermédiaires ou même les opérateurs de collecte sont généralement
le producteur, le précollecteur, le collecteur et l’usine de transformation. Cette dernière effectue la
collecte finale du lait pour en subir des traitements et des transformations à des fins commerciales.
Tableau 13 : Comparaison des trois maillons de la chaîne de collecte
Maillons Producteur Précollecteur Collecteur
Autre
nomination
Eleveur Collecteur intermédiaire Fournisseur de l’usine
Activités possesseur des vaches
productrices de lait.
Récupère le lait à la
ferme.
collecte les laits issus de la
ferme en effectuant le « porte
à porte » ou en ramassant sur
un point de collecte. Le lait
ainsi collecté est acheminé
directement vers un centre de
collecte.
collecte une grande quantité
de lait provenant des points
de collecte. Le lait collecté
est conservé et stocké dans un
tank réfrigérant au centre de
collecte.
Moyen de
récupération
et/ou stockage
du lait
(Cf. Annexe 21)
- Seau plastique
-Bidon aluminium
-Bidonplastique de
couleur blanche
Bidon plastique de
récupération de couleur bleue
en général (60 litres)
Bidon plastique de
récupération (160 litres, 200
litres ,220 litres).
Moyen de
transport
-A pieds
-A bicyclette
-Motocyclette
-A bicyclette
-Motorisé (motocyclette)
-A charrette
- Motorisé (en camionnette
ou fourgon).
Lieu de collecte A la ferme, le lait
provient de la traite
d’une ou plusieurs
vaches.
-Effectue du porte à porte
chez les producteurs.
-et/ou Ramasse le lait sur un
point de collecte
(généralement un lieu fixe).
au niveau d’un centre de
collecte.
Quantité de lait
collecté en litre
par jour
1 à 30 litres44
10 à 100 litres Supérieure à 500 litres
Ces données sont obtenues à partir des enquêtes sur terrain et lors de l’échantillonnage.
44
Variable en fonction du nombre de vaches et du degré de sang des animaux laitiers.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 36
II.3.3.Chaîne de collecte
La chaîne de collecte est représentée par l’existence de plusieurs d’intermédiairespour que
le lait arrive à destination de l’usine. Le flux du lait dans le réseau de collecte est réparti par trois (3)
types de circuits en fonction du nombre d’intermédiaires :
Le circuit N°1 : Le circuit est caractérisé par la proximité du centre de collecte par rapport au lieu
de traite où l’éleveur livre directement le lait au centre de collecte. Le trajet est relativement court
moins de 2 Km.
Le circuit N°2 : Ce circuit est caractérisé par l’éloignement de l’éleveur par rapport au centre
de collecte. Il est caractérisé par la présence de deux collecteurs ente l’éleveur et l’usine.
C’est un cas moins fréquent dans le réseau. La distance est relativement élevée plus de 5km.
Le circuit N°3 : C’est le circuit le plus fréquent. Il est caractérisé par un seul intermédiaire qui lie le
producteur avec le collecteur. Ce collecteur intermédiaire (ici précollecteur I) effectue
un ramassage sur un point de collecte ou effectue du porte à porte.
Figure 6 : Différents circuits dans le réseau collecte du lait frais.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 37
Source : Auteur
Figure 7: Point de collecte du lait sise à Betafo avec un abri (ici bâtiment en dur).
Lait transporté à bicyclette
Lait transporté par une charrette sur une route
boueuse et cahoteuse
Source : Auteur
Figure 8 : Moyens de transports de lait frais.
II.4. Quantité de lait collectée
La collecte annuelle de lait chez « Socolait » est de 2,5 millions de litres. La quantité de lait
réceptionnée à l’usine varie selon la saison. En 2016, la quantité moyenne de lait collecté par jour
est à environ 9000 litres par jour.
En 2014, la quantité reçue en lait est de 1,7 millions de litres45
tandis qu’en 2015 la collecte
a connu une légère augmentation de l’ordre de 2 millions de litres46
. L’année 2015 a connu
une augmentation en termes de lait reçu par rapport à l’année 2014.
45
Valeur exacte : 1 728 741,75 litres de lait en 2014. 46
Valeur exacte : 2 047 531,5 litres de lait en 2015.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 38
Tableau 14 : Quantité de lait reçu par trimestre pendant l’année 2014/2015
Quantité de lait reçu par trimestre (en litres) Année
2014 2015
1er
trimestre Janvier à Mars 571415 636590,50
2ème
trimestre Avril à Juin 507869,25 581888
3ème
trimestre Juillet à Septembre 328838,50 403 797,00
4ème
trimestre Octobre à Décembre 320618,50 425 256,00
Total 1728741,75 2 047 531,5
Source : RuralCap Consulting, 2015.
Source : traitement de l’auteur avec la base de données de RURALCAP Consulting.
Figure 9 : Evolution de la quantité de lait reçue par trimestre pendant l’année 2014/2015.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
JAN/FEV/MAR AVR/MAI/JUI JUI/AOU/SEP OCT/NOV/DEC
1 2 3 4
Qu
an
tité
de
lait
reç
u
exp
rim
é en
lit
re
Année par trimestre
2014
2015
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 39
II.4.1. Variation de la quantité de lait collectée.
La variation mensuelle de la quantité du lait reçue en 2015 est détaillée dans le tableau suivant :
Saison 2015 Quantité de lait collecté en litres
Pluvieuse
janvier 201 082,00
février 209 942,00
mars 225 566,50
avril 192 739,00
Sèche
mai 206 112,00
juin 183 037,00
juillet 163 934,00
août 138 914,00
septembre 100 949,00
octobre 125 587,00
pluvieuse novembre 128 799,00
décembre 170 870,00
Total 2 047 531,50
Source : Base de données de RURALCAP Consulting, 2015
La courbe générale d’une collecte annuelle présente un creux et un pic (pointe)
(RANDRIANOMENJANAHARY, 1993). Mais l’allure est en fonction de la quantité de lait
collectée. Le creux coïncide avec la saison sèche et la pointe avec la saison pluvieuse.
Source : Base de données de RURALCAP Consulting, 2015
Figure 10 : Variation mensuelle de la quantité du lait reçue en 2015
201082 209942
225566.5
192739 206112
183037 163934
138914
100949
125587 128799
170870
0
50000
100000
150000
200000
250000
plu
vie
use
plu
vie
use
plu
vie
use
plu
vie
use
sèch
e
sèch
e
sèch
e
sèch
e
sèch
e
sèch
e
plu
vie
use
plu
vie
use
janvier février mars avril mai juin juillet août septembreoctobrenovembredécembre
Variation de la quantité de lait par mois et selon la saison
Qu
anti
té d
e la
it r
eçu
en
litr
es
Pointe
creuse
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 40
Les variations sont explicitées par les points suivants :
II.4.1.1. Variation annuelle.
La quantité de lait collectée par l’usine Socolait présente des variations depuis son existence. La
variation annuelle de la quantité de lait collectée est en étroite liaison avec :
Variation annuelle de la quantité de lait collectée
Augmentation Diminution
-Evolution de l’effectif du cheptel laitier : en
augmentation.
-Evolution du nombre de producteur : en
augmentation.
-Amélioration génétique (race améliorée) :
productivité par vache élevée, production
laitière en augmentation
-Assèchement du climat
-Concurrence des autres entreprises laitières
devenant de plus en plus forte. Adhérence des
producteurs aux entreprises concurrentes.
-Quantité de lait répartie sur les entreprises
II.4.1.2. Variations mensuelles
La variation mensuelle de la quantité de lait effectuée par « Socolait » est due à plusieurs
paramètres qui sont cités sur le tableau 15.
Tableau 15 : calendrier de la disponibilité de biomasse fourragère avec quelques paramètres liés à
la saison.
MOIS
JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUI AOU SEP OCT NOV DEC
Biomasse47
Abondante Moyen Faible Moyen
saison4849
Pluvieuse Sèche Pluvieuse
température50
Chaude Froide Chaude
Alimentation
de la vache 51
Pâturage naturel ou cultivé Essentiellement de résidus de cultures
Pâturage
naturel ou
cultivé
Beaucoup de variétés de
fourrages disponibles Sous-alimenté
Beaucoup
de variétés
de fourrages
disponibles
Etat de la vache52
Bon état Mauvais état général
Production de lait53
Quantité élevée Diminution progressive Quantité
élevée
Source : Compilation de l’auteur.
47 KASPRZYK (2008) 48 KASPRZYK (2008) 49SOURISSEAU J. et al. (2016). 50SOURISSEAU J. et al. (2016) 51 FIFAMANOR(2009) cité par PENOT et DUBA (2011) 52 RARIV OARIMANANA (2010) 53 RARIVOARIMANANA (2010)
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 41
II.4.2. Evolution de la teneur en « MG » et en « EST 54
»
Les techniciens prennent des échantillons de lait au niveau du centre de collecte, de chaque
éleveur lors de la traite et aussi au niveau de chaque précollecteur. L’analyse milkoscope55
sur
terrain au niveau de ces trois acteurs est plus efficace pour déterminer les fraudes car des résultats
peuvent être observés directement notamment sur le test de mouillage, teneur en MP, teneur en MG,
etc.
566 échantillons de lait de vaches ont été prélevés par les techniciens sur des vaches de
degré de sang de plus et moins ¾ confondues depuis Mars 2015 jusqu’au Décembre 2015.
Les résultats d’analyses sur la teneur en MG et EST sont montrés dans le tableau suivant.
Tableau 16 : Teneur en MG et EST par mois en moyenne.
Teneur exprimée en %
Mois Moyenne de EST Moyenne de MG
Mars 11,28 3,60
Avril 11,89 3,93
Mai 11,92 3,90
Juin 11,32 3,66
Juillet 10,75 3,75
Aout 10,34 3,46
Septembre 10,25 3,46
Octobre 10,48 3,47
Novembre 10,97 3,73
Décembre 10,36 3,57
Total général 10,83 3,64
II.4.3.Evolution du taux de germes
Tableau 17 : Taux moyen de germes pendant l’année 2014/2015.
Source : Bases de données RURALCAP Consulting, 2015.
54 Extrait sec total 55
Milkoscope : une machine qui montre la densité, le taux de matières grasses, le taux de protéines, la teneur en eau, le taux
d’extraits secs totaux, le taux en solides totaux du lait.
Mois
Année
Janvier Fevr. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Septe. Oct. Nove. Déc. Moyenne
Taux moyenne de germes en (106 UFC/ml)
2014 13 9,15 5,42 3,14 3,57 2,84 2,89 4,43 2,10 2,55 2,25 2,25 5,01
2015 1,87 2,08 2,18 2,41 1,89 2,24 3,35 3,77 2,34 8,18 2,11 2,04 2,89
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 42
Source : Bases de données RURALCAP Consulting, 2015.
Figure 11 : Evolution du taux de germes au niveau des fournisseurs pour l’année 2014/2015.
II.4.4.Critères de qualité du lait et paiement à la qualité du lait chez Socolait.
Entrant dans le processus de l’ISO 22000 (Système de management de la sécurité des aliments),
la Société Socolait va conquérir le marché extérieur et la qualité des produits primes.
II.4.4.1. Analyses laboratoires interprofessionnel
L’usine Socolait est exigeante sur la qualité sanitaire à chaque étape de production et de la
transformation du lait. L’Institut Pasteur de Madagascar travaille en partenariat avec la société pour
assurer cette qualité sanitaire des produits. En outre, au sein de la Société, un laboratoire équipé
assure les analyses et les contrôles conformément aux normes alimentaires internationales à travers
le processus ISO.
II.4.4.2. Les critères de la qualité
II.4.4.2.1. Suivant la qualité organoleptique du lait
Le lait doit avoir une odeur caractéristique du lait frais (faible), une couleur blanc-crème. Le
goût doit être caractéristique du lait frais (agréable).
0
2
4
6
8
10
12
14Ta
ux
de
ge
rme
s e
n U
FC/m
l
Mill
ion
s
Mois
Evolution du taux de germes au niveau des fournisseurs pour
l'année 2014/2015
Taux moyende germesen 2015
Taux moyende germesen 2014
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 43
II.4.4.2.2. Suivant la composition chimique du lait
Les analyses de la teneur en matière grasse, de la teneur en matière protéique et en eau ajoutée
s’effectuent à l’aide d’un Milkoscope. Ces analyses sont des analyses individuelles qui s’effectuent
au niveau des éleveurs. Par ailleurs, ces contrôles de qualité sont importants pour la détection des
fraudes (mouillage, carbonate, etc.).
Tableau 18 : Critères sur la composition chimique.
Critère Norme Méthode d’analyse de routine
Critères officiels
Teneur en matière grasse 36 à 46 g/litre Milkoscope
Teneur en matière protéique 29 à 25 g/litres Milkoscope
Eau ajoutée < 3 % Milkoscope
Critères supplémentaires
Densité à 15°C 1,027 à 1,032 Lactodensimètre
Milkoscope
Teneur en solides totaux 11,2 à 13,8 % Milkoscope
pH 6,6 à 6,8 pH-mètre
Acidité totale 13 à 18 °D Acidimètre Dornic
Température à l’arrivée 4 à 10 °C Thermomètre
Source : Laboratoire Socolait, cahier des charges lait frais, 2015.
Le lait accepté doit avoir les critères suivants pour ses futures transformations en yaourt, en
fromage, etc. Ces critères peuvent être modifiés selon les exigences. Ainsi, le tableau suivant
résume les caractéristiques de la composition d’un lait acceptable.
Tableau 19: Composition du lait acceptable
Critère Base Critère Base
Teneur en matière grasse ≥ 36 g/litre Acidité totale 16 ± 2 °D
Teneur en solides totaux ≥ 116 g/litre Température à l’arrivée 7 ± 3 °C
Densité à 15°C ≥ 1,027 Présence de résidus d'antibiotiques Absence
pH 6,6 à 6,8 Présence de substances exogènes Absence
Source : Socolait, 2015
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 44
II.4.4.2.3. Suivant la qualité bactériologique du lait
Les analyses quotidiennes sur la qualité bactériologique s’effectuent dans le laboratoire de
Socolait et périodiquement dans le laboratoire de l’Institut Pasteur de Madagascar (pour des
comparaisons et des contrôles) selon les critères officiels et les critères supplémentaires.
Tableau 20 : Critère sur la qualité microbiologique du lait
Critère Norme Méthode d’analyse
Critères officiels
Teneur en germes à 30° C (pas encore en vigueur56
) Culture sur PCA
Présence de résidus d'antibiotiques Absence Tests rapides
Test caillage
Teneur en cellules somatiques (pas encore en vigueur) Comptage au microscope
Critères supplémentaires
Présence de substances exogènes Absence Recherches spécifiques
Source : Laboratoire Socolait, cahier des charges lait frais, 2015.
II.4.4.3.Paiement à la qualité du lait.
Le lait cru est livré à l’usine dans un véhicule destiné exclusivement à cet usage. Il est
conditionné dans des bidons, préférentiellement en inox ou aluminium, sinon en plastique,
hermétiquement fermés. La livraison se fait le plus rapidement possible, sans toutefois brasser
le lait. Le lait cru n’est pas stocké tel quel à l’usine : dès sa réception il est pasteurisé et conservé au
maximum 48 heures à +4°C dans des cuves en acier inoxydable. La Société « Socolait » effectue
la collecte de lait frais avec un paiement à la qualité. Socolait a établi des conditions très strictes qui
concernent l’hygiène de la collecte du lait chez les trois57
maillons de la chaîne de collecte. Le lait
collecté sera ainsi payé selon sa qualité.
Variation du prix du litre du lait en fonction du maillon et de la saison
La régularité du paiement et le jour de paye contribuent l’acquisition de confiance de la part
des producteurs. Le prix d’achat du lait varie selon le maillon de la chaîne de collecte, selon
la saison, et selon sa catégorie. En effet le prix pendant la saison pluvieuse est inférieur à celui de
la saison sèche. Cette différence de prix est en rapport avec l’alimentation de la vache. Pendant
56
Pour l’année 2015 57
Éleveur, précollecteur, et collecteur
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 45
la saison sèche le lait est de très bonne qualité en matière de teneur en matière grasse par rapport à
la saison pluvieuse .La teneur en matière azotée du lait d’une femelle sous-alimentée diminue tandis
que la teneur en matière grasse va augmenter [ALAIS(1965); LUQUET(1986) cité par
ANDRIAFEHIMIHARISOA, 2009].
Tableau 21 : Classement de la qualité du lait selon le taux de Matière grasse et le taux d’extrait sec
Source : Socolait, 2015
A propos du prix du litre du lait octroyé aux fournisseurs, il varie en fonction de la teneur en
matière grasse et du taux d’extrait sec du lait. Pour un lait de catégorie dite « NORMALE », le prix
du litre est de 1040 Ariary selon le tableau suivant. Le paiement à la qualité du lait est au bénéfice
des collecteurs, ces derniers auront des primes pour un lait de qualité supérieure en termes de taux
en extrait Sec et en matières grasses. Par contre, même pour un dur labeur, les éleveurs sont payés
au même prix pour des laits de différentes qualités.
Tableau 22 : Prix du lait pour l’année 2015 octroyé aux fournisseurs
Prix du litre de lait livré à l’usine pour les fournisseurs (collecteurs) (en Ariary)
Catégorie Saison pluvieuse Saison sèche
SUPERIEURE 990 1070
NORMALE 960 1040
DECLASSE 920 990
Source : Socolait, 2015.
Tableau 23 : Prix du litre du lait selon sa saison et selon le maillon qui effectue livraison
Maillon de la chaîne de collecte Prix du litre de lait
Saison de pluie Saison sèche
Eleveur- Collecteur 850 Ar 900 Ar
Eleveur- Précollecteur 700 Ar à 800 Ar 800 Ar à 900 Ar
Précollecteur - Collecteur 800 Ar à 950 Ar 950 Ar à 1000 Ar
Collecteur-usine 920 à 990 Ar 990Ar à 1040 Ar
Source : Socolait, 2015.
En général, le refus du lait est :
58
Sur décision du Service Collecte Socolait.
Catégorie Taux de matière grasse
ET
Taux d’extrait sec
Supérieure ≥ 3,9 % ≥ 12,2 %
Normale 3,9 %>3,6 %>3,6 % 12,2 %>11,6 %>11,6 %
Déclassé58
< 3,6 % <11,6 %
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 46
-Chez les éleveurs : le lait positif à l’alcool 70° (lait du soir, l’alimentation de la vache incomplète).
-Chez les pré collecteurs et des collecteurs : , apport en graisse, mouillage, apport de bicarbonate,
trajet.
II.5. METHODES D’ENQUETE
II.5.1. Etapes des enquêtes
L’enquête a été classée en deux étapes:
-l’enquête exploratoire qui consiste à obtenir des informations globales par des observations et
des écoutes. Cette étape d’enquête n’utilise pas directement des questionnaires préétablis.
- l’enquête semi-directive sur terrain permet l’accaparation des informations plus détaillées
auprès des différents niveaux de la chaîne de collecte par l’intermédiaire de fiches d’enquêtes.
L’enquête semi-directive est accompagnée par des prélèvements d’échantillons de lait frais
pour les futures analyses microbiologiques.
II.5.2. Fiches d’enquête
Les questionnaires de l’enquête (Cf. Annexes 15 ; 16 ; 17) sont caractérisés par
l’identification de chaque maillon, par la production de lait, par les techniques de réception de lait,
par les techniques de nettoyages des matériels, parles matériels utilisés dans la conservation du lait,
Pour le cas du maillon Eleveur ; les questions sont ciblées sur l’hygiène de la production
notamment sur la préparation des mamelles avant la traite, par l’observation sur la propreté
de la mamelle, des matériels, et du trayeur, sur la propreté du lieu de traite, etc.
Pour les deux autres maillons (précollecteurs et collecteurs), les questions se concentrent
surtout sur l’hygiène de la collecte avec les matériels utilisés pour la récupération et la conservation
du lait, et sur le transport.
II.5.3. Prélèvement sur terrain
La quantité de l’échantillonnage prélevée est de 10 à 25 ml pour une analyse microbiologique.
Le matériel de prélèvement sur terrain est un tube en verre préalablement stérilisé au laboratoire
muni d’un couvercle avec la mention du numéro de prélèvement d’échantillon et du code du niveau.
Le prélèvement d’échantillon du lait cru a été effectué dans la mesure du possible dans
des meilleures conditions d’asepsie pour éviter toute contamination extérieure avec utilisation
(malgré les facteurs limitant lors de l’échantillonnage et de l’analyse microbiologique) :
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 47
- Une baguette en fer muni d’un coton imbibé d’alcool a été flambée, la baguette est
maintenu dans une main et placé tout près de la zone de prélèvement. La flamme issue du
flambage limite la contamination extérieure autour de la zone lors du prélèvement de
l’échantillon de lait.
- Des gants en plastiques sont en vigueur pour une bonne asepsie lors du prélèvement ou à
défaut après lavage des mains et décontamination avec de l’alcool 70°.
- Un tissu propre lors des prélèvements a été utilisé pour que les mains ne se souillent pas
avec le lait qui peut être éclaboussé.
Les échantillons sont conditionnés et transportés dans une glacière jusqu’à destination du
laboratoire de l’usine Socolait pour subir l’analyse microbiologique.
Les analyses ont été réalisé le plus rapidement possible et au plus tard 12 heures après
le prélèvement. En principe, l’analyse consiste à dénombrer le taux de FMT. La méthode de
détermination de FMT pour l’analyse microbiologique au laboratoire de Socolait était basée sur
la norme ISO 7218 modifiée en octobre 2007, qui officialise l’utilisation d’une seule boite par
dilution.
II.5.4. Echantillonnage
Pour la validité des échantillons de lait et leurs résultats d’analyses, il est apparu que pour
diverses raisons de qualité de manipulation ou d’échantillonnage, certains résultats étaient aberrants
ou non fiables. Ils ont été retirés de la liste afin de ne pas fausser les moyennes.
Désignation Nombre d’échantillons Fiabilité des résultats
Echantillons retenues 130 Moyennement fiable et fiable
Echantillon rejetées 43 Non fiable
Total général des échantillons prélevés 173
Source : Bases de données de l’auteur.
Cent trente (130) échantillons de lait cru prélevés ont été ainsi retenues. Les prélèvements ont été
effectués par :
Vache où le lait est prélevé au niveau de la mamelle ou dans le contenant de traite chez
les éleveurs.
Groupe de vache obtenu à partir de lait de mélange dans un contenant chez les éleveurs.
Bidon de récupération (contenant de collecte) chez les précollecteurs.
Bidon de récupération (contenant de collecte) chez les collecteurs.
Tank au niveau des collecteurs.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 48
Tableau 24: Répartition des échantillons de lait frais par zone et par niveau.
Zones Eleveurs Précollecteurs Collecteurs
Nombre
total
N59
NT60
% N NT % N NT % N
Ambohibary 10 207 4,8 5 nd* - 3 1 300 18
Betafo 48 631 7,6 24 nd - 16 4 400 88
Andranomanelatra 11 398 2,7 2 nd - 2 1 200 15
Manandona 8 76 10,5 1 nd - 0 1 0 9
Nombre total 77 1312 5,8 32 nd - 21 7 300 130
*nd= chiffres non disponibles.
Source : Bases de données de l’auteur associées avec les bases de données de RURALCAP
consulting.
II.6.ANALYSES EXPERIMENTALES
II.6.1. Quelques notions sur l’analyse microbiologique
II.6.1.1.Flore Mésophile Totale ou FMT
Le Flore Mésophile Totale du lait cru sont des germes totaux61
qui regroupent
les microorganismes qui se développent à une température optimum de 30°C à 40°C dans le lait.
Le FMT est un indicateur sanitaire du lait. Son dénombrement reste la meilleure méthode
d’appréciation de la qualité microbiologique des aliments (RAKOTONIAINA, 2005).
II.6.1.2.Dénombrement
Le terme « dénombrement d’une flore » signifie que l’analyse microbiologique doit
permettre de quantifier dans l’échantillon une flore particulière. L’Unité Formant Colonie ou UFC
est une unité de dénombrement de la FMT mesurant le nombre de colonies apparaissant sur
une gélose macroscopiquement visible.
Chaque bactérie isolée donne naissance à une colonie ou UFC pour «unité formant colonie».
En effet, plusieurs bactéries peuvent être à l’origine de la formation d’une seule colonie qui ne peut
plus être qualifiée de colonie (pas de clone) mais alors d’UFC. Il s’agit de faire correspondre un
micro-organisme à une UFC puisque, dans certains cas, le développement de plusieurs micro-
organismes groupés peut conduire à une unique colonie. Les unités « UFC » et « germes » sont
différenciées par la méthode ou la manière de lecture des bactéries.
59
Nombre de l’échantillon 60Nombre total de la population de chaque niveau 61
http://www.comitedulait.be/prod01.htm consulté en Novembre 2016
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 49
II.6.2. Procédé d’analyse microbiologique et de calcul
La norme ISO 7218 modifiée en octobre 2007 est la méthode consacrée pour la méthode
d’analyse microbiologique avec la recherche de la FMT. Cette norme officialise l’utilisation d’une
seule boite par dilution.
II.6.2.1.Dilution
Le flacon contenant l'échantillon du lait est agité pendant dix secondes au moins avant les dilutions.
Dans tous les cas et quel que soit le flacon où le lait est contenu, l'ouvrir aseptiquement et flamber
l'ouverture.1 ml du lait ainsi préparé est prélevé aseptiquement à l'aide d'une pipette stérile en ayant
soin de ne pas plonger la pipette avant d'effectuer le prélèvement. La prise d'échantillon est
introduite aseptiquement dans un tube contenant 9 ml d’eau peptoné (Cf. Annexe 18) pour mille.
La pipette ne doit pas entrer en contact avec le liquide de dilution. Le tube est agité pour rendre
la dilution homogène à l’aide d’un agitateur automatique. Après agitation, des dilutions seront
effectuées (1/10, 1/100, 1/1000, etc.).
II.6.2.2.Ensemencement et incubation
Les ensemencements sont effectués sur une boîte de Pétri stérilisé, 1 ml de dilution retenue
pour l'examen est prélevé à l'aide d'une pipette stérile de 1 ml et introduit aseptiquement au centre
d'une boîte de Pétri. 10 ml environ du milieu gélosé de PCA, totalement liquéfié au bain marie
bouillant puis refroidi à 48°C environ, sont versés dans la boîte de Pétri ayant reçu immédiatement
auparavant 1 ml de dilution. Il ne doit pas s'écouler plus de quinze minutes entre le moment où le
lait est dilué et celui où la gélose est introduite dans la boîte de Pétri. Le mélange de “l'inoculum” et
du milieu de culture est réalisé immédiatement par agitation horizontale.
Les boîtes sont laissées au repos pendant une heure environ, puis retournées au moment
d'être introduites dans l'incubateur, afin d'éviter les condensations sur le couvercle. L'incubation à
l'étuve est réalisée à la température de 31°C avec une tolérance de 1°C en plus ou en moins.
La durée d'incubation est de soixante-douze heures. Le milieu de culture est la gélose PCA
(Cf. Annexe 19) avec un ajout de 1 g de lait écrémé en poudre par litre de milieu reconstitué.
Après incubation, la lecture sera effectuée. Si les colonies sont très nombreuses, le comptage est
effectué à partir de la moitié de la boîte ou un dixième de boîte.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 50
II.6.2.3.Appareillage.
Tableau 25: Appareils utilisés pour l’analyse microbiologique.
Paramètre Appareils Méthodes
Flore mésophile totale
Microorganismes à
cultivant à 30°C
Autoclave
Incubateur
Bain marie
Gélose PCA et 1 gramme de lactose.
Stérilisé à 121°C pendant 15 minutes.
Incubation en milieu solide à 30°C pendant 72heures.
Bain marie à 45°C (maintient en suspension du milieu stérilisé)
Source : Laboratoire Socolait
II.6.2.4.Calcul de la concentration en micro-organismes (UFC) :
Le dénombrement s’effectue à partir des boîtes qui contiennent 15 à 300 colonies. Le calcul de
la concentration en micro-organismes (UFC) présents dans l'échantillon essai est une moyenne
pondérée à partir des résultats de 2 dilutions successives.
Application numérique :
N = NBP1 + NBP2 = 153 + 31 = 184
(n1+ (0,1x n2)) x V x d (1+ (0,1x1)) x 1ml x 10-3
1,1 x 10-3
N =1,67.105
UFC/ml
Le comptage des colonies pour chaque boîte se trouve 15 à 300 colonies.
∑C
N =
(n1 + 0.1 x n2) x V x d
N : Concentration en UFC / ml
n1 : Nombres de boîtes retenues comptées à la dilution
retenue la plus faible (première dilution)
n2 : Nombres de boîtes retenues comptées à la seconde
dilution.
∑C: Nombre total des colonies dénombrées sur les
boîtes retenues.
V : volume de l’inoculum en ml qui équivaut à 1 ml
d:le taux de dilution de la première dilution retenue pour
les comptages sur boite.
Le facteur de dilution est égal à 1 000 si à la dilution
(1/1 000), le premier comptage est effectué.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 51
Tableau 26 : Règles de validation du comptage des colonies sur les valeurs de NBP1 et NBP2.
A la dilution
(n)
A la dilution
(n-1)
A la dilution
(n-2)
1ère
boîte 2ème
boîte 3ème
boîte
0 0 0
1-4 0 0
5-7 0-2 0
8-40 0-7 0-1
41-99 1-14 0-2
100-150 5-40 0-5
151-175 8-40 0-5
> 175 > 8 0-5
200-334 8-40 0-6
> 334 > 8 0-6
Source : Laboratoire Socolait, 2013.
NBP2 = 31
NBP1= 153
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 52
Le schéma suivant explique toutes les étapes de l’analyse microbiologique du lait :
Source : Conception de l’auteur
Figure 12 : Schéma explicatif de l’analyse microbiologique du lait pour le dénombrement de FMT.
N = NBP1 + NBP2 = 153 + 31 = 184 = 0,167.106
(1+0,1x1) x 1ml x d (1+0,1x1) x 1ml x 1,1 x 10-3
10-3
1ml
1ml 1ml 1ml 1ml
1ml 1ml 1ml 1ml 1ml
1ml
Dilutions exploitables
: deux dilutions
successives
Des tubes
contenant 9 ml
d’eau peptonée
chacun
Ensemencement
sur un milieu de
culture gélosé
PCA dans des
boîtes de Pétri
1/10 1/10000 1/100 1/100000 1/1000000
Dénombrement
Dilutions non
exploitables : nombre
de colonies supérieur
à 300 UFC
153 31 6 0 Incomptable
1/103=10
-3
Dilutions
1ml d’échantillon
de lait
Taux
de dilution
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 53
II.6.2.5. Modèle de fiche d’enregistrement des résultats pour le dénombrement de la FMT
Tableau 27 : Fiche d’enregistrement des résultats pour le dénombrement de FMT.
Date Nom
Dilutions
10-3
10-4
10-5
10-6
Résultat
BP62
1 BP2 BP1 BP2 BP1 BP2 BP1 BP2
15/12/2015 X 153 31 6 0 1,67.105
Utilisation d’une seule boîte par dilution
Source : Auteur (adaptation avec le modèle de référence de fiche d’enregistrement de Socolait)
II.6.2.6. Utilisation des résultats
Les données obtenues à partir des enquêtes et des résultats obtenues à partir des analyses
microbiologiques ont été rassemblées dans une base de données sous Excel. Pour les traitements
des données, l’utilisation du tableau et du graphe « croisé dynamique » a été très essentielle pour
la validation des résultats
II.6.3. Hypothèses sur les facteurs de risque
Ici, dans tout ce chapitre, la notation « germe(s) » traduit « la Flore Mésophile Totale » en
particulier. La variation de taux de germes est en effet due à la corrélation de plusieurs
variantes notamment les aspects intrinsèques (pH, potentiel d’oxydoréduction), et extrinsèques
(température) mais également de l’environnement (lieu de traite, trayeur, contenant de récupération,
etc). Dans des meilleures conditions, les germes vont effectivement se développer. Cependant, cette
étude exclus l’influence des aspects intrinsèques et extrinsèques.
Nombreux sont les facteurs qui influent le taux de germes dans le lait et afin de cadrer la
récolte d’informations et le plan d’échantillonnage, nous nous sommes basés sur plusieurs
hypothèses concernant les facteurs de risque. Nous avons cherché à récolter des informations
permettant de valider ou d’invalider les hypothèses suivant le tableau ci-dessous :
62 Boîte de Pétri
Taux de dilution
Facteur de dilution : 103
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 54
Tableau 28 : Liste des hypothèses sur les facteurs de risque de la contamination du lait frais
N° HYPOTHESES Niveau de la chaîne de
production / collecte
1 La propreté du lieu de traite influe sur le taux de germes
PRODUCTION :
A la traite
2 La propreté de la mamelle influe sur le taux de germes
3 La propreté du trayeur influe sur le taux de germes
4 L’élimination des premiers jets influe sur le taux de germes
5 La propreté du contenant influe sur le taux de germes
6 Le type de contenant influe sur le taux de germes
7 L’utilisation de couvercle influe le taux de germes
8 Un nettoyage approprié influe sur le taux de germes
9 La propreté du contenant influe sur le taux de germes COLLECTE
INTERMEDIAIRE :
Pré-collecte
10 Le type de contenant influe sur le taux de germes
11 Le temps (délai) influe sur le taux de germes.
12 Le temps (délai) de conservation influe sur le taux de germes CENTRE DE COLLECTE
II.7. RECHERCHE DU TAUX D’EVOLUTION DES GERMES ET NOTATION IMPACT
II.6.3. Méthode de calcul du taux d’évolution
L’expression du « taux d’évolution » de germes dans chaque niveau (collecteur-
précollecteur-éleveur) par rapport à l’étape qui suit est obtenue par la formule ci-dessous :
Avec: X1: Taux de germes d’une étape quelconque exprimé en UFC/ml
Exemple : étape N°2: Dépôt du lait au point de collecte.
X2 : Taux de germes qui suit cette étape quelconque exprimé en UFC/ml
Exemple : étape N°3: Dépôt du lait au point de collecte ou au ramassage sur place.
% = X2 - X1 X 100
X1
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 55
Selon le tableau suivant, les étapes sont énumérées de 1à 8 lors du trajet du lait lors de sa collecte :
Tableau 29 : Etapes lors de la collecte du lait.
N° Etapes Le trajet du lait lors de sa collecte.
1 Sortie de traite
A la ferme 2
Dépôt du lait au point de collecte
ou au ramassage sur place
3 Départ au point de collecte Lors du ramassage aux points de collecte.
4 Arrivé au centre de collecte
5 Lait en tank Lors du stockage du lait au centre de collecte.
6 départ centre
7 Lait arrivé à l’usine après passage
d’un centre A l’usine
8 Lait arrivé à l’usine après passage
de deux centres
Application numérique : (calcul de référence selon RAZAFINDRAHAGA, 1997).
En prenant un exemple et en se référant au tableau 30, l’étape qui suit le dépôt du lait au point de
collecte ou ramassage sur place (étape N°2) est le départ au point de collecte (étape N°3).
E2 est l’étape du lait au point de collecte ou ramassage sur place avec un taux de germes
X1=0,409. 106UFC/ml.
E3 est l’étape qui suit ce dépôt, c’est le départ au point de collecte avec un taux de germes
X2=3,14. 106UFC/ml.
% = X2 - X1 X 100 = (3,14. 106UFC/ml - 0,409. 10
6UFC/ml)X 100 = 668 %
X1 0,409. 106UFC/ml
II.6.3. Méthode d’obtention de la « notation impact ».
La notation impact permet de grouper chaque facteur selon les risques. Elle est classée selon
la valeur du X. Plus X est élevé plus son impact est grave. La notation impact « très critique » est
relative aux facteurs les plus critiques dans la contamination du lait frais. L’annexe représente les
résultats détaillés de cette notation impact.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 56
Soient A le taux maximum de germes d’un facteur de risque et B le rapport entre le taux maximum
de germes du facteur de risque et son taux minimum.
La classification croissante est comme suit :
Valeur de X
Faiblement critique moyennement
critique critique très critiques
X1 X2 X3 X4
X1<X2< X3<X4
II.8. FACTEURS LIMITANT LA REALISATION DU TRAVAIL
La réalisation de ce travail a été manifestée par quelques facteurs limitant notamment lors des
activités d’enquête et lors des analyses au laboratoire.
La réalisation de l’étude est surtout marquée par la descente sur terrain. Cette dernière est
caractérisée par des enquêtes et des prélèvements d’échantillon de lait. Les prélèvements sont
destinés à l’analyse microbiologique au laboratoire. L’inaccessibilité de certaines zones a perturbé
les prélèvements surtout durant la période de pluie. D’une part, les routes secondaires sont boueuses
et glissantes, ce qui rend difficile l’accès. Elles retardent ou annulent les prélèvements
d’échantillons de lait. D’autre part, le moyen de transport de lait est conditionné à l’aide d’une
glacière (avec un bloc de glace) où la température augmente au fur et à mesure de la longévité du
temps de transport et à l’exposition au soleil, ainsi le lait se réchauffe. Ceci aura un impact sur les
futurs résultats d’analyses.
Durant les analyses au laboratoire, la qualité de la manipulation lors des premières semaines
d’analyses microbiologiques ont a été médiocre. En effet, l’analyse microbiologique du lait doit être
effectuée avec beaucoup de prudence et exactitude surtout lors des dilutions ; avec un moindre
défaut de manipulation, les résultats obtenus après analyses seront faussés.
X = A X B
106
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 57
PARTIE III : RESULTATS ET
DISCUSSIONS
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 58
III.1.VALIDATION DU TAUX D’EVOLUTION DE GERMES
La contamination du lait frais par les germes entre le passage du lait dans le contenant
de traite et avant le départ du lait au point de ramassage par le précollecteur (entre étape 2 et étape
3) est très élevé par rapport aux autres étapes. La charge microbienne passe de 0,409. 106UFC/ml à
3,14. 106
UFC/ml selon le tableau ci-dessous. Le taux d’évolution pour passer de l’étape 2 à l’étape
3 est de 668 %. Au sein de ces deux étapes se cachent les principaux facteurs de risques de
contamination du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait
livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 59
Tableau 30: Evolution du taux de germes FMT à 30°C dans le lait depuis la traite jusqu’à l’usine en UFC/ml
* (Les données ne sont pas fiables et sont rejetées).
.
Le trajet du lait lors de sa collecte
A la ferme Lors du ramassage aux
points de collecte.
Lors du stockage du lait au
centre de collecte. A l’usine
Départ Arrivé Départ Arrivé Départ Arrivé - Arrivé
Etapes
1 2 3 4 5 6 7 8
Sortie
de
traite
Dépôt du lait
au point de
collecte ou au
ramassage
sur place
Départ
au point
de collecte
Arrivé
au centre
de collecte
Lait
en
tank
départ centre
Lait arrivé à
l’usine après
passage d’un
centre
Lait arrivé à
l’usine après
passage de deux
centres
Sous étapes -
Recueil
du lait dans
le contenant
de traite
Lait durant
le
chargement
camion.
Lait pendant le
déchargement
camion
Lait arrivé au quai
de réception avant
déchargement
camion
Eleveur 0,182.106 0,409. 10
6
0,338. 10
6
Précollecteur
3,14. 106 4,8. 10
6
4,49. 10
6
Collecteur
8,83. 106 11,3. 10
6 * 88,5. 10
6 16,7. 10
6
Taux moyens
des germes
(UFC/ml)
0,182.106 0,409. 10
6 3,14. 10
6 4,8. 10
6 8,83. 10
6 11,3. 10
6 * 88,5. 10
6 4. 10
6
Taux
d’
évolution
(%)
125 668 53 84 28 * -
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 60
III.2. FACTEURS DE RISQUE SUR LA CONTAMINATION DU LAIT
Les éléments qui interviennent dans la qualité microbiologique du lait sont les conditions
d’hygiène au moment de la traite (éventuellement du stockage à la ferme) et les conditions de
collecte et transport jusqu’au consommateur (RANDRIATSARAFARA, 2008).
III.2.1. Facteurs de risque liés à la traite
Néanmoins, d’après le tableau 30, la contamination se trouve surtout au niveau de la
production et le passage du lait au point de collecte ou au point de ramassage. Les différents
paramètres qui ont été notés lors des prélèvements, et leur impact sur le taux de germes sont les
suivants :
Figure 13 : Taux d’évolution de germes selon certains facteurs au niveau de la production.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
TYP
E D
E C
ON
TEN
AN
T
DET
ERG
ENT
OU
VER
TUR
E
SEC
HA
GE
MA
TER
IELS
BO
USE
S
ELEM
ENT
LAV
AG
E M
ATE
RIE
L
END
RO
IT
MA
TER
IEL
MEM
E Q
UE
TRA
ITE
PR
OP
RET
E C
ON
TEN
AN
T
PR
OP
RET
E C
UIS
SE
PR
OP
RET
E M
AM
ELLE
SEC
HA
GE
MA
MEL
LE
CO
UV
ERC
LE
ENLE
VE
PR
EMIE
RS
JETS
LIEU
DE
TRA
ITE
MO
UC
HES
PR
OP
RET
E H
AB
ITS
PR
OP
RET
E M
AIN
S
TRES CRITIQUECRITIQUE MOYENNEMENT CRITIQUE FAIBLEMENT CRITIQUE
Tta
ux d
'évolu
tion
de
ger
mes
en
%
Facteurs de risque classés selon la notation impact
Evolution du taux de germes
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 61
Le lait au moment sa sécrétion est absolument stérile. Mais passant par les différents canaux
de la mamelle, il se contamine par des microorganismes qui y sont présents. Malgré des traites
effectuées dans des conditions rigoureuses et avec des conditions très hygiéniques, il est impossible
d’avoir un lait stérile. Le lait est toujours faiblement contaminé dès la traite
(RAZAFINDRAHAGA, 1997).
Ainsi, les facteurs les plus critiques seront présentés dans le détail ci-dessous.
III.2.1.1. Le type contenant de conservation et/ou de transport influe sur le taux de germes.
Tableau 31 : Types de contenants à la sortie de traite
Influence du matériel en sortie de traite
Tableau 32 : Taux de contamination selon le type de matériel
Type de matériel (à ouverture large) Moyenne de Résultats
UFC/ml
Aluminium 0,0609 106
Plastique 0,283106
Total général 0,280 106
Désignation Type de
matériaux
Ouverture du récipient
Quantité de
germes en
UFC/ml
Taux par
rapport à
l’ouverture
étroite
Taux par
rapport à
l’absence de
fermeture Dimension Diamètre
2,68 106 0,622 10
6
Bidon jaune Plastique étroite Inférieure à 5 cm 2 ,68 106 1,00 0,23
Bidon blanc Plastique large
Supérieure à 15
cm
0,911 106 2,94 0,68
Seau Plastique large 0,243 106 11,04 2,56
Bidon
aluminium Aluminium large
0,0609 10
6 43,97 10,21
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 62
Figure 14 : Evolution du taux de contamination selon le type de matériel
Le taux de germes dans un contenant en plastique est 5 fois supérieur par rapport à un contenant en
aluminium.
Influence de l’ouverture
Tableau 33 : Taux de contamination selon la dimension de l’ouverture
Dimension de l’ouverture Diamètre de l’ouverture
en cm
Moyenne de Résultats
UFC/ml
Etroite Inférieure à 5 cm 2,68 106
Large Supérieure à 15 cm 0,276106
Total général 0,338 106
Figure 15: Evolution du taux de contamination selon la dimension de l’ouverture.
Le taux de germes dans un contenant à petite ouverture est 10,21 fois soit 10 fois supérieur par
rapport à un contenant à large ouverture. Et plus précisément le bidon jaune à petite ouverture
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
aluminium plastique large
Mill
ion
s
Type de matériel ou nature de matériiel
Tau
x d
e ge
rme
s e
xpri
mé
en
UFC
/ml
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
étroite large
Mill
ion
s
Dimension de l'ouverture du contenant
Total
Tau
x d
e ge
rme
s ex
pri
mé
en U
FC/m
l
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 63
représente un taux de germes de 43 ,97 fois soit 44 fois supérieur à un bidon aluminium à large
ouverture (Cf. Tableau 31).
Influence de fermeture du contenant
Tableau 34 : Taux de contamination selon la présence de fermeture
Fermeture Moyenne de Résultats
UFC/ml
Non (aucun fermeture) 0,622 106
Oui ( avec fermeture) 0,225 106
Total général 0,338 106
Figure 16 : Evolution du taux de contamination selon l’utilisation de fermeture contenant en sortie
de traite
L’absence de couvercle multiplie de 1 à 10 fois le taux de germes (Cf. Tableau 31).
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
non oui
Mill
ion
s
Utilisation de fermeture
Total
Tau
x d
e g
erm
es
exp
rim
é e
n U
FC/m
l
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 64
Interprétation:
- Matériaux : L’aluminium est plus isotherme que le plastique, et représente donc un
matériau avantageux. Ce type de matériaux est aussi plus solide tandis que les matériaux
plastiques peuvent présenter des griffures .Les griffures sont des nids à bactéries.
Selon RANDRIANOMENJANAHARY (1993), la nature du matériau de fabrication du
récipient :le récipient doit être soit en aluminium soit en chlorure de polyvinyle. Le Décret
n°64-530 DU 23 septembre 1964, Titre II – Article 6 interdit l utilisation de récipient en
zinc, en tôle galvanisée ou plombée, en cuivre non étamé, en métaux rouillés, en métal ayant
contenu des produits pétroliers pour le transport de lait (Journal officiel de la république
malagasy n°393 du 2 Janvier 1965). Cependant, l’effet du récipient sur la qualité du lait est
assez faible si le nettoyage est correct (SOLBERG et REFSHOL, 1989 cité par
RANDRIANOMENJANAHARY (1993)).
- Ouverture : un bidon à large ouverture est plus facilement lavable qu’un bidon à faible
ouverture. Ce dernier est donc moins propre, et contamine les laits. En effet, les résidus de
lait ou plus précisément les résidus de la matière grasse du lait, ne s’enlèvent pas facilement
sans un nettoyage approfondi et approprié (avec un détergent et une brosse).Ainsi, un
contenant à faible ouverture est un véritable nid bactérien contrairement a un contenant à
large ouverture qui aère le lait et qui permet le nettoyage à l’intérieur.
- Couvercle : un couvercle permet de limiter les contaminations extérieures : mouches,
poussières, pailles, poils, etc.…et participe ainsi à la protection du lait.
Selon les travaux de RAZAFINDRAHAGA en 1997, les ustensiles de traite (récipient, tamis,
etc.) apportent un taux de 106UFC/ml. Ce taux est destiné aux ustensiles qui ne sont pas nettoyés
correctement. Les microorganismes trouvés dans un ustensile mal nettoyé sont les microflores
lactiques, microcoques lactobacilles, Chromobactérium, Pseudomonas,etc.
Conclusion:
Le contenant idéal est donc un bidon à large ouverture, avec un couvercle, en matériau
aluminium ou plastique alimentaire non abîmé.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 65
III.2.1.2. La technique de nettoyage influe sur le taux de germes
Influence de la propreté visuelle du matériel
Tableau 35 : Taux de contamination selon la propreté visuelle du contenant
Propreté visuelle du matériel Moyenne de Résultats
UFC/ml
Propre 0,0794 106
Sale 0,767 106
Total général 0,338 106
Figure 17: Evolution du taux de contamination selon l’état visuelle du contenant
Les laits dans les contenants qui paraissent sales ont un taux moyen de germes 10 fois plus
élevé que ceux dans des contenants qui paraissent propres. Ainsi, l’aspect sale des contenants est
associé à une contamination plus forte (x10).
Effet de l’utilisation de détergent (savon de ménage)
Tableau 36 : Taux de contamination selon l’utilisation de détergent
Constat visuel
Détergents propre sale Total général
UFC/ml
absent
2,45 106 2,45 10
6
Présent (savon de
ménage) 0,0794 10
6 0,706 10
6 0,310 10
6
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
propre sale
Mill
ion
s
Etat visuel du contenant
Tau
x e
n g
erm
es U
FC/m
l
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 66
Figure 18 : Evolution du taux de contamination selon l’utilisation de détergent.
Si l’utilisation du détergent est absente, le taux de germes est très élevé de l’ordre
de 2,45 106UFC /ml par rapport à un taux de 0,310 10
6UFC/ml avec utilisation de détergents.
Les laits dans les contenants non nettoyés au savon présentent un taux moyen de germes 10 fois
plus élevé que ceux dans des contenants nettoyés au savon.
Interprétation
La séparation des souillures qui collent à la surface du contenant ou du récipient est plus
facile grâce à l’utilisation de détergent pour les matières grasses. Par contre, la caséine du lait
(matière protéique) est difficile à enlever sans additionner à une action de brossage. L’utilisation de
détergent accompagnée d’un brossage (à l’aide d’une brosse) et d’un bon rinçage à l’eau, est
importante pour que les matières azotées et les matières grasses du lait s’enlèvent plus facilement.
Ces actions évitent des dépôts de traces de matières grasses et de matières azotées qui pourraient
être de nouvelles sources de contamination du lait. Ces traces sont des milieux de multiplication de
germes.
Conclusion :
Le matériel doit être lavé avec du savon, brossé et rincé doit présenter un aspect propre au
visuel.
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
sale propre sale
absente savon
Mill
ion
s
Utilisation de détergent
Tau
x en
ger
mes
UFC
/ml
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 67
III.2.1.3. Le séchage d’un contenant avant usage influe le taux de germe
Tableau 37 : Taux de contamination selon la pratique de séchage
Pratique de séchage Moyenne de Résultats en
UFC/ml
Non 0,392 106
Oui 0,0148 106
Total général 0,338 106
Figure 19 : Effet du séchage des matériels sur le taux de germes
Les contenants humides qui ne sont pas séchés avant le recueil du lait, ont un taux de germes
26fois supérieurs par rapport à un contenant séchés
Interprétation
Même après lavage minutieux des contenants (détergent, brosse, eau) sans la dernière touche
de séchage, les restes d’eau de lavage sur le contenant absorbent des poussières, des téguments
fécaux des débris végétaux est favorise la multiplication des germes. L’eau elle-même est
probablement contaminée aussi.
Les matériels de traite, en d’autres termes, le seau à traire, le bidon de récupération ou de
rassemblement, les tamis, devraient faire l’objet d’un nettoyage et un séchage minutieux avant et
après chaque manipulation. Le nettoyage avec du savon et de la brosse réduit le taux de germes.
Mais ce taux va être augmenté si le séchage n’est pas effectué.
De ce fait, l’humidité d’un contenant va héberger des germes à nouveau. Ainsi, un
nettoyage et un rinçage appropriés accompagnés du séchage réduisent le taux de germes.
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
non oui
tau
x e
n g
erm
es
UFC
/ml
Mill
ion
s
Séchage de contenant
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 68
NB : Les éléments de lavage dites « complet » est en relation avec un procédé de nettoyage
approprié des matériels :
Utilisation du détergent
Utilisation de la brosse
Rinçage à l’eau froide et à de l’eau bouillante.
Séchage du contenant ou du récipient par égouttage
Le nettoyage dit « incomplet »pour cette étude est un procédé de nettoyage qui s’effectue seulement
avec de l’eau (simple rinçage à l’eau).
Conclusion :
Le contenant ou le récipient doit être correctement lavé puis séché par un égouttage.
III.2.1.4.La propreté de la mamelle influe le taux de germes.
Source: http://www.gds38.asso.fr/web/gds.../f462116a7be9a93cc125728f006b1568!Open
Document Consulté en Juin 2016.
Figure 20: Grille de notation de la propreté des vaches au niveau du trayon et de la cuisse
Tout d’abord connaître d’où vient le lait s’avère nécessaire pour aider à cerner la contamination
lié à la propreté de la mamelle. Il est alors à rappeler que morphologiquement, chez les bovins,
la mamelle ou pis est l’organe qui produit le lait .La mamelle comprend quatre quartiers séparés,
indépendants, terminés chacun par un trayon (Cf. Annexe 11) (MEYER, 1999). C’est à partir
des trayons que commence la contamination du lait. Ainsi, la note de propreté (Cf. Figure 20)
des mamelles est évaluée juste avant la traite.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 69
Tableau 38 : Effet du séchage avec une lavette avant la traite
Séchage de la mamelle avant la traite Moyenne de Résultats
en UFC/ml
non Sans lavette 0,246 106
oui Avec lavette 0,0435 106
Total général 0,188 106
Figure 21 : Effet du séchage de la mamelle
avec une lavette avant la traite.
Figure 22: Taux de germes en fonction de la note de
propreté de la mamelle avant la traite.
Tableau 39 : Taux de contamination selon la note de propreté de la mamelle avant la traite
Séchage mamelle
Note propreté mamelle Non Oui Total général en
UFC/ml
1 0,0412 106 0,00558 10
6 0,0214 10
6
2 0,152 106 0,0422 10
6 0,117 10
6
3 0,279 106 0,0399 10
6 0,219 10
6
4 0,390 106 0,262 10
6 0,37810
6
Total général 0,246 106 0,0435 10
6 0,188 10
6
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
non oui
Tau
x e
n g
erm
es
UFC
/ml
Mill
ion
s
Utilisation d'une lavette
Total
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
1 2 3 4 1 2 3 4
non oui
tau
x e
n g
erm
es
UFC
/ml M
illio
ns
Utilisation de lavette pour sécher la mamelle avant la traite
Total
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 70
Pour cette étude tous les éleveurs utilisent de l’eau de lavage chaude pour le nettoyage de la
mamelle.
Entre une note de 1 et une note de 4 de propreté de la mamelle, la contamination est
multipliée par 18.Le non séchage de la mamelleavec un tissu ou lingette propre après
lavageaugmente de 1 à 11 fois le taux de germes selon le tableau suivant.
Tableau 40: Taux de germes selon la note de propreté des germes et le séchage des mamelles.
PROPRETE
MAMELLE
NON SECHAGE
MAMELLE
NOTE En UFC/ml 0,246 106
4 0,378 106 0,65
3 0,219 106 1,12
2 0,117 106 2,10
1 0,0214 106 11,49
Interprétation :
Selon les travaux de RAZAFINDRAHAGA en 1997, les poussières (l’environnement, du
corps de la vache, du lieu de traite), les débris cutanés de l’animal (poils et peau) contiennent des
coliformes, Bacillus et clostridium.
En outre, la note de propreté de la mamelle est variable en fonction :
Du lieu de couchage de l’animal : propre ou sale (proximité des bouses, humidité du sol, etc.).
Les souillures de la mamelle et de la cuisse proviennent des bouses et des litières. En se couchant
dans un lieu sale, les bouses se collent sur les poils de la vache. Durant la traite, les souillures de la
mamelle et de la cuisse seront sèches et seront libérées par les mouvements de la queue ou par le
vent dans le contenant de traite. Ainsi, les souillures localisées au niveau de la cuisse et du trayon
contaminent le lait si le nettoyage de ces zones n’est pas approprié.
De la technique de nettoyage du trayon : minutieux ou non (eau chaude, utilisation du détergent,
bonne rinçage, utilisation de lingette propre, etc.). Mal réalisé, un nettoyage peut au contraire
véhiculer les souillures, et contaminer le lait. Le trayeur doit opérer correctement et bien sécher
à la fin.
Conclusion :
L’éleveur doit maintenir un niveau de propreté suffisant pour l’étable et pour sa vache en
général. Et il doit nettoyer efficacement la mamelle et la sécher avant la traite.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 71
Importance du trempage post-traite dans la prévention des mammites :
En fin de traite, le sphincter reste ouvert quelques minutes et peut constituer une voie
d’entrée de germes pathogènes vers la mamelle. Le trayon qui ne soit pas bien nettoyé correctement
risque de contaminer l’intérieur de la mamelle. Pour diminuer ce risque (SERIEYS, 1996), le
trayeur peut effectuer une désinfection post traite par trempage de l’extrémité des trayons dans une
solution désinfectante.
Importance de l’enlèvement des premiers jets de lait
L’enlèvement des premiers jets est parmi les risques mais dans notre étude ce facteur n’a pas été
apparu comme un facteur majeur, avec un taux d’évolution égal à 1 dans nos échantillons. Les
premiers jets de lait renferment des germes qui se sont accumulés depuis la dernière traite,
l’élimination de ces premiers jets réduit le taux de contamination.
Le lait est contaminé par deux sources, d’une part la contamination intra mammaire et d’autres
part la contamination extramammaire (WEBER F. 1985).La contamination intra mammaire est
caractérisée par l’entrée des germes par la voie ascendante et par la voie descendante dans la
mamelle (QSA63
ENVL 2009). La contamination par voie ascendante est caractérisée par l’entrée
des germes dans la mamelle par le canal du trayon. Les germes sont surtout banaux appartenant le
plus souvent aux genres Corynebacterium et Micrococcuset parfois de germes pathogènes. Ils sont
entraînés avec le lait au moment de la mulsion (WEBER F. 1985). La contamination par voie
descendante ou par voie endogène est due aux germes pathogènes notamment les agents de la
brucellose et de la tuberculose, qui parviennent dans la mamelle par la circulation sanguine
(WEBER F. 1985). Des leucocytes, et des constituants chimiques sont également présents (QSA
ENVL 2009).
Tableau 41 : Effet de l’enlèvement des premiers jets
Enlèvement des premiers jets
non oui
Total général
en UFC/ml
Moyenne de
Résultats
en UFC/ml
0,370 106 0,334 10
6 0,338 10
6
63 QSA (Qualité et Sécurité des Aliments) , Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon développée par Alain GONTHIER, Maître
conférences de QSA.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 72
La contamination au niveau de la mamelle se traduit par une contamination de germes
pathogènes, leucocytes, constituants chimiques (descendantes), bactéries de la peau du trayon et de
l’environnement (ascendantes). A cet effet le premier jet de lait est très contaminé. L’élimination
des premiers jets est importante pour obtenir un taux de FMT faible au début de collecte.
Le lait provenant d’un quartier malade de la mammite peut contenir jusqu’à 100.106
germes/ml. Les germes responsables des mammites : Staphylococcus auréus, Streptococcus uberis,
Streptococcus agalactiae (RANDRIANOMENJANAHARY, 1993).
Importance de l’hygiène du trayeur (mains surtout)
La propreté des mains influe le taux de germes : les mains sales souillent le trayon,
et les germes passent dans le lait lors de la traite. La propreté corporelle du trayeur est
indispensable, plus précisément les mains et les avant-bras.
Tableau 42: Effet de la propreté des mains avant la traite sur le taux de germes dans le lait
Le personnel qui n’a pas d’hygiène et qui manipule la mamelle peut transmettre au lait
des germes pathogènes comme les germes fécaux et le staphylocoque des mains sales
(RAZAFINDRAHAGA, 1997).
Importance du transvasement du lait d’un contenant de traite sur un contenant de
transport
Tableau 43: Taux de germes par rapport au changement de contenant.
Changement de contenant Moyenne de Résultats
en UFC/ml
Non 0,765 106
Oui 0,198 106
Total général en UFC/ml 0,338 106
Propreté des mains Moyenne de Résultats
en UFC/ml
Propre 0,287 106
Sale 0,451 106
Total général en UFC/ml 0,338 106
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 73
Interprétation :
Plus il y a de transvasement de lait, plus il y a introduction de facteurs externes(les souillures
des contenants) qui contamineraient le lait. Le fait de manipuler le lait tant de fois que des germes
s’introduisent dans le lait (poussières, souillures des contenants, mains).L’utilisation du contenant
de transport différente de la traite a un taux 4 fois supérieure par rapport a un matériel même que
traite.
Conclusion :
Le transvasement d’un contenant à un autre du lait augmente le risque de contamination.
III.2.1.5. La salubrité du lieu de traite influe sur le taux de germes.
Deux facteurs sont étudiés ici :
- L’humidité du lieu de traite
- La distance séparant le lieu de traite et l’étable.
Influence de l’humidité de lieu de traite
Tableau 44: Taux de germes selon l’état du sol du lieu de traite.
Lieu de traite Moyenne de résultats en
UFC/ml
humide 0,614 106
sec 0,0827 106
Total général en UFC/ml 0,338 106
Figure 23 : Taux de germes selon l’état du sol du lieu de traite
Le lieu humide est lié à un taux de germes 7 fois supérieur à celui d’un lieu sec.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
humide sec
Tau
x e
n g
erm
es
UFC
/ml
Mill
ion
s
Etat du sol du lieu de traite
Total
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 74
Influence de la proximité du lieu de traite et de l’étable.
Tableau 45: Taux de germes selon la distance du lieu de traite par rapport aux bouses
Distance par rapport aux bouses Moyenne de résultats
en UFC/ml
Loin Eloignement plus de 5 mètres 0,0968 106
Près Proximité moins de 1 mètre 0,643 106
Total général en UFC/ml 0,338 106
Figure 24 : Evolution du taux de germes selon la position du lieu de traite par rapport aux bouses.
Les matières fécales des animaux, qui en se couchant, la vache s’en imprègne et se colle sur
ses poils. Une fois secs ces excréments (au niveau de la mamelle, des cuisses et du flanc) vont être
libérés par le mouvement de la queue de la vache et tombe dans le contenant de traite. Ces fèces
apportent des germes Bacillus,Clostridium et Salmonelle(RAZAFINDRAHAGA, 1997)
La proximité des bouses intensifie de 1 à 8 fois ce taux, de même pour la multiplicité des mouches.
Impact de la présence des mouches
Les mouches sont des propagateurs de germes .Une simple baignade peut provoquer une
contamination massive du lait. Selon ESTE et MASON en 1908 cité par RAZAFINDRAHAGA en
1997, les mouches apportent des bactéries de 1 222 000 UFC/cm2 en moyenne. Certaines mouches
véhiculent une bactérie Actinomycespyogenes responsable de la plupart des cas de mammites
cliniques très graves avant le vêlage64
.
64
http://www.mp.chambagri.fr/LES-MOUCHES-a-l-origine-d.html publié le 3 mars 2011consulté en Juin 2016.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
loin près
Tau
x e
n g
erm
es
UFC
/ml
Mill
ion
s
Position du lieu de traite par rapport aux bouses
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 75
Tableau 46 : taux de germes selon la présence de mouches environnantes
Quantité de
mouches
environnantes
Distance par rapport aux bouses du lieu de
traite
loin près Total général
en UFC/ml
Beaucoup 0,0362 106 0,769 10
6 0,628 10
6
Peu 0,105 106 0,441 10
6 0,190 10
6
Total général
en UFC/ml 0,0968 10
6 0,643 10
6 0,338 10
6
Figure 25 : Evolution du taux de germes selon la quantité de mouches.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
beaucoup peu
Tau
x d
e g
erm
es
en
UFC
/ml.
Mill
ion
s
Quantité de mouches environnantes
près
loin
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 76
Interprétation
Par ailleurs, les fragments de fourrages et la litière apportent du Clostridium butyrique et des
lactobacilles d’après encore RAZAFINDRAHAGA en 1997.
L’eau utilisée pendant les traitements d’hygiènes effectué à la ferme (nettoyage de la vache,
des murs de l’étable, des ustensiles de traite, etc.) apporte également des germes pathogènes qui
provoquent la maladie comme la typhoïde. Ainsi, l’eau est également un vecteur de contamination.
Une étude réalisée à Franche – comté, sur le cheminement depuis l’étable jusqu’à la laiterie
à montré que la majorité des espèces bactériennes recensées dans le lait avait pour origine
l’environnement de la salle de traite (air, nourriture, trayon) (RAHARIMALALA, 2016).
L’étable humide favorise l’accumulation des souillures organiques, des poussières et
des insectes notamment des mouches qui peuvent s’introduire dans le lait et favorisant ensuite
la prolifération microbienne.
Plus la traite se trouve dans un endroit sec et loin des bouses, généralement hors l’étable,
plus le risque de contamination du lait est moindre.
Conclusion :
Un lieu de traite minimisant les risques de contamination sera : propre, sec, loin des bouses
et exempt de mouches.
III.2.2. Facteurs de risque liés au dépôt du lait au point de collecte.
La contamination du lait à l’extérieur de la ferme est d’autant plus redoutable qu’à
l’intérieur de la ferme.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 77
Figure 26 : Facteurs de risques au niveau de la collecte intermédiaire avec le taux d’évolution de
germes
III.2.2.1. Le temps (délai) de conservation influe sur le taux
Tableau 47 : Exemple du lait qui chez le précollecteur pour aller chez le collecteur.
Laits Taux en germes
en(UFC/ml)
Délai par rapport à
la traite Durée
Le lait de mélange A (70 litres) 0,210106
Temps initial 1heure 45minutes
0,125 106
Temps final 1 heure 45minutes 0,295 106
Le lait de mélange B (180 litres) 1,70 106
Temps initial 25 minutes 1 heure 20
minutes 0,900 10
6
Temps final 1 heure 45minutes 2,50 106
Total général 0,955 106
Deux échantillons distincts de laits A et B ont été suivis depuis le temps initial (attente du
précollecteur) jusqu’à un temps final (arrivé au centre de collecte).
0
20
40
60
80
100
120
140
DELAI OUVERTURE TYPE DECONTENANT
DETERGENT ELEMENTLAVAGE
MATERIEL
PROPRETECONTENANT
TRES CRITIQUE CRITIQUE
Tau
x d
'évo
luti
on
de
ge
rme
s e
n e
xpri
mé
en
%
Facteurs de risque catégorisés selon la notation impact
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 78
Figure 27 : Evolution du taux de germes des deux types de laits
Interprétation
Influence sur le lait de mélange avec plusieurs laits
Lors du ramassage, plusieurs laits se mélangent induisant à une « cross contamination65
».
En effet, le précollecteur ramasse quotidiennement les laits issus de plusieurs fermes dans le même
récipient. La règle d’hygiène pour la collecte de lait chez chaque éleveur est différente, d’autre s’en
soucie et d’autre ne s’en soucie pas du tout. Ainsi, chaque lait a son degré de malpropreté. Une fois
mélangé le lait de fort degré de malpropreté contamine le lait de faible degré de malpropreté d’où la
cross-contamination.
Par ailleurs, le ramassage de lait de différents jours de traite induit aussi la cross-
contamination. Les laits de traite durant le soir sont conservés dans un récipient plongé dans de
l’eau fraîche mais cela n’empêche pas la prolifération des germes dans le lait. Le lait du lendemain
est mélangé avec celle de la veille. Malgré les propriétés immunologiques du nouveau lait, ce
dernier sert une dilution pour le lait de la veille. Le mélange se trouve ainsi plus facilement
altérable. Une fois ramassé le lait se trouve à la limite supérieure de l’acidité normale.
65
Contamination croisée
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Temps initial Temps final Temps initial Temps final
01:00:00 01:45:00 00:25:00 01:45:00
Lait de mélange A Lait de mélange B
Tau
x d
e g
erm
es
en
UFC
/ml.
Mill
ion
s
Délai de conservation des laits de mélanges A et B par rapport au temps de traite .
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 79
Selon la FAO en 2002 cité par HANTANIRINA en 1997, la population microbienne du lait
de mélange à l’état cru ne doit pas dépasser 106UFC /ml. Une étude menée par le DRZV
66
Ampandrianomby sur la qualité du lait commercialisé dans région de Vakinankaratra en Mars 1998
a montré que le taux de FMT varie de 3. 106
à 30.106
UFC/ml .Ce résultat décrive une variation de
l’ordre de 10 unités ce qui implique que le degré de malpropreté de la région de Vakinankaratra est
très variable.
Influence de la température
Source : D'après RIVIERE, 1975 ; FAO
Figure 28: Influence de la température sur le taux de croissance d'une souche bactérienne
mésophile. Taux exprimé en % du taux maximum
Lorsque le milieu est favorable, c’est-à-dire qu’il y a présence de nutriments et que la
température, l’activité de l’eau et le pH sont adéquats, la croissance des microorganismes suit la
courbe suivante (figure 29).
66
Département de Recherche Zootechnique et Vétérinaire
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 80
Source :
http : //perso.calixo.net/~braun/conserve/thermobact.htm consulté en Aout 2016
Figure 29 : Croissance microbienne
Le lait à ce stade étant encore chaud, une conservation à température ambiante est le lieu
d’une forte multiplication des germes. En raison de la température du lait (37°C), de sa teneur
élevée en eau (87, 5%), de ses éléments nutritifs et de son pH proche de la neutralité (6, 6–6, 8) de
nombreuses bactéries y trouvent des conditions favorables à leur développement.
Celui-ci n'est généralement pas immédiat. Le plus souvent il ne commence que dans les 3 ou
4 heures qui suivent la traite lorsque le lait est maintenu à température ambiante. Ce comportement
désigné improprement sous le terme phase “bactéricide” ou phase “d'adaptation” est dû à la
présence dans le lait fraîchement trait de substances antibactériennes connues sous la désignation
générale de lacténines.
Ce délai passé, les bactéries entrent en phase de multiplication. Toutefois ce ne sont pas les
mêmes espèces qui prédominent en raison du rôle sélectif de la température. Lorsque le lait est
maintenu entre 20°C et 40°C, ce qui correspond souvent aux conditions ambiantes, ce sont
habituellement les bactéries mésophiles qui se multiplient. Parmi celles-ci les bactéries lactiques, en
particulier celles du genre Streptococcus, constituent habituellement la flore naturelle majeure du
lait.
Conclusion :
Le temps de conservation du lait à température ambiante doit être le plus réduit possible.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 81
III.2.2.2. Le type contenant de conservation et/ou de transport influe sur le taux de germes
Même conclusion que dans la partie III.2.1.1
III.2.2.3. La technique de nettoyage influe sur le taux de germes
Même conclusion que dans la partie III.2.1.2
III.2.3.Facteurs de risque liés entre le ramassage de lait et à la collecte au centre de collecte
Figure 30: Taux de contamination de germes selon les facteurs de risque au niveau du centre de
collecte
III.2.3.1. le temps (délai) de conservation influe sur le taux de germes
Figure 31: Evolution du taux de germes selon le temps de conservation
02468
1012141618
DELAI ALLUMAGE TANK TEMPS COMPLETSRECEPTION
TYPE DE TANK
TRES CRITIQUE CRITIQUE
Tau
x d
'évo
luti
on
de
ge
rme
sen
%
Facteurs de risques
Taux d'évolution de germes des facteurs liés au centre collecte
Total
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
00
:05
:00
00
:15
:00
00
:25
:00
00
:35
:00
00
:45
:00
01
:00
:00
01
:20
:00
01
:35
:00
00
:25
:00
00
:40
:00
00
:50
:00
01
:15
:00
01
:25
:00
01
:45
:00
01
:55
:00
02
:30
:00
03
:15
:00
00
:36
:00
01
:25
:00
01
:35
:00
03
:00
:00
E P C
Mill
ion
s
Total
Linear (Total)
Tau
x en
ger
mes
UFC
/ml
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 82
Tableau 48 : Taux de germes en fonction des trois maillons en fonction de la chaîne collecte.
Niveaux Moyenne de taux de germes en
UFC/ml.
Eleveur E 0,338 .106
Précollecteur P 4,49 .106
Collecteur C 16,7 .106
Total général 4,00 .106
Figure 32 : Evolution du taux de germes suivants les trois niveaux de la chaîne de collecte.
Nos résultats confirment que plus le délai n’augmente entre la traite et l’arrivée au centre,
plus le taux de germes n’augmente également. L’augmentation des germes est localisée entre le
ramassage du précollecteur et la réception du lait au centre de collecte. C’est le seul facteur le plus
critique pour ce maillon.
III.3.NOTATION IMPACT DES FACTEURS DE RISQUE
La notation impact est obtenue à partir du produit entre le taux maximum de germes par
facteurs de risque et le taux d’évolution des germes (ou taux).
0
5
10
15
20
E P Ctau
x e
n g
erm
es
(UFC
/ml)
Mill
ion
s
Maillon de la chaîne de collecte
Courbe d'évolution du taux de germes
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 83
N° Facteurs de risques Critères Taux Moyenne
(x106 UFC/ml)
Taux
Evolution Notation Impact
1
Pro
du
ctio
n :
trai
te
Type de contenant seau/alu 1,37 43,97 Tres Critique
2 Dimension ouverture étroite/large 1,48 9,71 Critique
3 Utilisation détergent absente/savon 1,38 7,91 Critique
4 Séchage matériels non/oui 0,20 26,53 Critique
5 Propreté contenant sale/propre 0,42 9,65 Moyennement Critique
6 Propreté mamelle sale/propre 0,20 17,68 Moyennement Critique
7 Humidité endroit humide/sec 0,35 7,42 Moyennement Critique
8 Distance avec bouses près/loin 0,37 6,64 Moyennement Critique
9 Eléments lavage matériels précaire/complet 0,20 10,89 Moyennement Critique
10 Séchage mamelle non/oui 0,25 8,16 Moyennement Critique
11 Propreté cuisse sale/propre 0,14 12,63 Moyennement Critique
12 Contenant même que traite non/oui 0,48 3,86 Moyennement Critique
13 Nuages de mouches beaucoup/peu 0,41 3,30 Faiblement Critique
14 Utilisation couvercle non/oui 0,42 2,76 Faiblement Critique
15 Lieu de traite dans/hors 0,27 3,42 Faiblement Critique
16 Propreté mains trayeur sale/propre 0,37 1,57 Faiblement Critique
17 Enlèvement premiers jets non/oui 0,35 1,11 Faiblement Critique
18 Propreté habits trayeur sale/propre 0,34 1,11 Faiblement Critique
19
Co
llect
e in
term
édia
ire
Temps (délai) 55mn/40 mn 14,10 118,64 Tres Critique
20 Type de contenant bidon jaune/bleu 9,41 7,46 Tres Critique
21 Dimension ouverture étroite/large 9,42 7,37 Tres Critique
22 Propreté contenant sale/propre 4,69 5,03 Critique
24 Eléments lavage matériels précaire/complet 3,56 3,96 Critique
23 Utilisation détergent absente/savon 5,65 1,61 Critique
25
Ce
ntr
e C
olle
cte
Temps (délai) 3 h /35 mn 20,20 15,40 Tres Critique
26 Type de tank cylindre/carre 14,50 2,03 Critique
27 Mode allumage tank manuel/automatique 14,30 1,52 Critique
28 Temps complets réception 6 heures/2 heures 8,87 1,11 Critique
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 84
III.4. EVOLUTION DU PAIEMENT A LA QUALITE.
Depuis le lancement du paiement à la qualité, les critères d’analyses ont connu
des évolutions. Notamment sur la cryoscopie et la lipolyse67
.
Pour la cryoscopie (du mouillage au point de congélation), l’unité d’expression des résultats
lors de son analyse a changé en degrés Celsius (°C), température correspondant au « point
de congélation du lait », au lieu d’être convertie comme précédemment en pourcentage d’eau dans
le lait. Les matériels, les méthodes et procédures d’analyses restent les mêmes.
Pour l’analyse de la lipolyse la méthode « par Infrarouge » présente le même niveau de
précision et de fiabilité que la précédente. Elle s’appuie sur des matériels déjà utilisés pour
la mesure d’autres composants du lait. Plus rapide, elle va permettre d’augmenter la fréquence
des analyses pour un meilleur suivi de la qualité, en passant d’une analyse par trimestre à 3 par
mois. Autre atout, elle concourt à la réduction des déchets de produits dans les laboratoires
interprofessionnels.
Une évolution 68
portant sur la qualité du lait est observée sur l’évaluation des apports
nutritionnels. Les chercheurs sont capables d’analyser très finement la composition du lait.
Par exemple, les acides gras selon leur profil (omega 3, omega 6...) et les protéines (alpha,
beta...).Mais la question qui se pose est : ces critères nutrition et santé seront-ils pris en compte dans
les analyses du lait à la ferme demain ?
67http://www.agri53.fr/bibliotheque_pdf/infos-conseils/lait/CilOuest_version_BD.pdf consulté en Octobre 2016.
68http://www.maison-du-lait.com/fr/filiere-laitiere/qualite-au-coeur-filiere-laitiere Consulté en Octobre 2016.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 85
PARTIE IV. RECOMMANDATIONS
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 86
VI.1. MISE EN PLACE D’ACTIONS PRIORITAIRES
La charge microbienne du lait devrait être aussi faible que possible, en fonction des règles
d’hygiène. C’est pourquoi l’hygiène est un moyen fondamental pour acquérir la qualité. Le tableau
qui va suivre est un récapitulatif des actions à mettre en place aux différents niveaux afin de limiter
la contamination.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait
livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 87
Tableau 49: Actions prioritaires d’hygiène conçues pour les éleveurs
HYGIENE DU
PERSONNEL HYGIENE DE L’ANIMAL HYGIENE DES LOCAUX HYGIENE DES MATERIELS
TRAYEUR VACHE LIEU DE TRAITE MATERIELS DE TRAITE, DE
STOCKAGE ET DE TRANSPORT
AV
AN
T T
RA
ITE
Bien laver et désinfecter les
mains et l’avant –bras avec
du savon et de l’eau, rincer
et sécher ensuite.
Le trayeur doit mettre des
vêtements propres ou dans
la mesure du possible
mettre une blouse pour plus
d’hygiène et mettre des
bottes (ce sera l’idéal).
Bien nettoyer le pis et le contour de la
mamelle qui pourraient être souillés avant
la traite avec de l’eau chaude propre, bien
rincer avec de l’eau toujours propre, et
sécher ensuite avec un tissu propre (un
tissu spécifique pour chaque vache est
l’idéal).
Bien nettoyer l’étable afin que le corps de
l’animal ne soit pas souillé.
Si plusieurs vaches sont à traire, bien
respecter l’ordre de traite en fonction de la
santé des mamelles : les vaches à mammite
et les vieilles vaches à la fin.
Isoler le lieu de traite et le lieu de vie.
Choisir un endroit sec et propre, loin
du fumier.
Bien nettoyer le lieu de traite avant la
traite :
-Raclage des bouses du sol.
-Renouvellement de la litière (pas
obligatoire).
Réserver des matériels spécifiques au
stockage du lait.
Bien nettoyer tous les matériels de traite,
de stockage et de transport avec un
détergent (ex : savon, liquide vaisselle) et
de l’eau chaude, par le biais d’un matériel
spécifique de nettoyage (ex : brosse).Bien
rincer avec de l’eau propre et sécher
ensuite.
PE
ND
AN
T T
RA
ITE
Les mains et les vêtements
doivent être propres lors de
la traite.
Veiller à maintenir la mamelle de la vache
propre.
Retirer les premiers jets de lait et les
examiner (détection des mammites).
Puis procéder à la traite, doucement.
On peut attacher la queue si celle-ci gêne.
Veiller à maintenir le lieu de traite
propre, bien aéré et sec :
-Absence d’humidité
-Absence de mouches
-Absence de bouses
La traite doit être faite dans le calme.
Veiller à maintenir les matériels propres et
secs.
Remarque : Utiliser des contenants à large
couverture pour faciliter le nettoyage et
avec un couvercle pour limiter
l’introduction des germes lors de la traite,
lors du stockage et lors du transport.
AP
RE
S
TR
AIT
E
Laisser la mamelle telle quelle.
En cas d’antécédents de mammite, utiliser
un produit de trempage des trayons.
Donner à manger pour que la vache reste
debout le temps que les sphincters du
trayons se referment.
Transférer la vache dans un endroit
sec et propre après la traite (aire de
parcage ou aire de repos propre)
Après chaque usage, nettoyer à nouveau
les matériels et les ranger dans un endroit
sec, en hauteur pour éviter les souillures.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 88
VI.2. OUTILS DE SUIVI-EVALUATION
L’évaluation doit se faire à une fréquence suffisante pour maintenir le niveau d’exigence et
alerter à temps en cas de dérive ; mais avec un espacement suffisant aussi pour permettre de
constater une évolution.
Ainsi les fréquences que je recommanderai sont :
- Centres : une suivi-évaluation par mois
- Précollecteurs : une suivi-évaluation par mois
- Eleveurs : une suivi-évaluation tous les trois mois
Les extraits de grilles d’évaluation des pratiques d’hygiène aux différents niveaux
de la chaîne de collecte sont montrés ci-dessous :
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 89
Source : Réalisation de l’auteur.
Figure 33 : Grille de suivi-évaluation des pratiques d’hygiène conçue pour les éleveurs.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 90
Source : Réalisation de l’auteur.
Figure 34 : Grille de suivi-évaluation des pratiques d’hygiène conçue pour les précollecteurs.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 91
Source : Réalisation de l’auteur.
Figure 35 : Grille de suivi-évaluation des pratiques d’hygiène conçue pour les collecteurs.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 92
CONCLUSIONS
Nombreux sont les sources de contaminations du lait frais qui révèlent des taux de germes
variables selon le type d’influence. Des hypothèses ont été avancées lors de la recherche
des facteurs de risque dans la contamination du lait frais.
- Au niveau de la production : l’influence du type de contenant, l’influence de la technique
de nettoyage, l’effet sur le séchage des matériels, l’influence de la propreté de la mamelle.
- Au niveau de la collecte intermédiaire : l’influence du temps d’attente, l’influence du type
de contenant, l’influence du type de nettoyage ou de la technique de nettoyage.
- Au niveau du point de ramassage jusqu’au centre de collecte : l’influence du temps
de conservation et de transport du lait.
Le travail consiste à valider ou d’invalider les facteurs de risque de contaminations du lait frais et à
les maîtriser pour diminuer la progression du taux de germes dans le lait durant sa conservation et
son transport. La contamination microbienne à la ferme est surtout liée à l’animal et aux matériels
de réception tandis que la contamination du lait au niveau de la collecte a un lien avec le temps
d’attente et le transport du lait frais. L’appréciation de la qualité du lait s’effectue par
un dénombrement de la FMT sous l’unité « UFC /ml ». Selon la notation impact, le type
de conservation et/ou de transport et le temps de conservation et/ou de transport sont les deux
facteurs les plus critiques sur les trois niveaux confondus. Le taux de germes dans le lait pour les
trois niveaux confondus (éleveurs, précollecteurs, collecteurs) a une moyenne générale de
4,00 106
UFC/ml. La validation des facteurs de risque dans la conservation du lait frais vont aider
aux contrôles laitiers lors de la collecte. De plus, la mise en place d’actions prioritaires sur
les bonnes pratiques d’hygiène, et des grilles d’évaluations sur les trois niveaux cités au-dessus vont
être des outils qui renforceront les contrôles. Les questions qui se posent sont : le coût d’analyse
laboratoire sera- il faisable organisationellement pour la part des éleveurs et des précollecteurs et si
oui les analyses seront-elles pérennes ? De plus, le paiement à la qualité serait- il toujours au
bénéfice des collecteurs? L’idéal c’est de connaître immédiatement la qualité microbiologique
du lait à la ferme sans passer à l’analyse de FMT microbiologique au laboratoire pour prévenir
la mauvaise qualité du lait et les fraudes.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 93
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIE
[1] ANDRIAFEHIMIHARISOA N, 2009. Contribution à l’étude comparative de la valeur
nutritionnelle du lait de vache (race Primholstein et Normande) et du lait de chèvre.
Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en sciences
agronomiques. Option Industries Agricoles et Alimentaires. ESSA.
[2] BILLON P, 2005. L’état des trayons : élément révélateur de la routine de traite et du
fonctionnement de la machine à traire. Journée Qualité de la Traite. Belgique
[3] BOURGEOIS C.M, 1996 « Microbiologie alimentaire. Aspect microbiologique de la
sécurité et de la qualité des aliments. » Edition sciences et techniques agroalimentaires p.
360
[4] CONSULTING PLUS, 2010. Etude de la sous filière « alimentation animale – fourrage et
provende » Rapport final.
[5] CREAM (CENTRE DE RECHERCHES, D’ETUDES ET D’APPUI A L’ANALYSE
ECONOMIQUE À MADAGASCAR), 2013.Monographie de Vakinankaratra.
[6] CORPET Denis, 2014. Qualité Aliments .INPT-ENVT.
[7] COURTET LEYMARIOS Florence, 2010. Qualité nutritionnelle du lait de vache et de ses
acides gras. Voies d’amélioration par l’alimentation. Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort.
Thèse pour le doctorat vétérinaire.
[8] DIR ELEVAGE, FIFAMANOR ,2010.Production annuelle de lait selon. Rapport de mise en
œuvre des priorités régionales cellules régionales de centralisation et d’analyse direction du
suivi évaluation des programmes
[9] DUBA Gaëlle, 2010. Modélisation et typologie des élevages laitiers dans le Vakinankaratra,
Madagascar. Master BGAE-SCIENCES pour l’environnement Spécialité Ecologie
fonctionnelle et Développement Durable.
[10] DUDEZ Philippe et BROUTIN Cécile, 2003. Assurer un approvisionnement régulier en
lait d'une unité de transformation africaine. GRET (Groupe de Recherche et d'Echanges
Technologiques) publié par Agridoc.
[11] FAO/OMS, 1960. Comité d’experts FAO/OMS de l’hygiène du lait, deuxième rapport.
[12] FAO/OMS, 2005. Avantages et risques potentiels du système lactoperoxydase pour la
conservation du lait cru. Rapport d’une réunion technique. Rome, Italie.
[13] FAO, 2015. Rapport spécial mission FAO/PAM d’évaluation des récoltes et de la sécurité
alimentaire à Madagascar.
[14] FÉDÉRATION NATIONALE DES ACTEURS DE LA FILIÈRE LAIT DU SÉNÉGAL,
2005. Guide maîtrise de la qualité dans la transformation laitière.
[15] FEDERATION SUISSE D’ELEVEUR DE LA RACE TACHETEE ROUGE, 1977.
Disposition d’exécution des épreuves de productivités laitière de la race tachetée rouge du
Sillental. 56 p.
[16] GILLIS JC, 1996. Les contraintes et besoins des transformateurs. In : CREAL, Quel(s)
Lait(s) pour demain ? Arilait-recherche, Paris, 23-28.
[17] Guide autocontrôle pour la collecte et le transport de lait cru ,2005.98 pages
[18] GUIDE DE BONNES PRATIQUES D’HYGIENE ET DE TRANSFORMATION
ARTISANALE DES PRODUITS LAITIERS AU SENEGAL, 2011.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 94
[19] HANTANIRINA H. Isabelle, 1997.Contribution à l’étude de la qualité bactériologique du
lait (flores totales et coliformes thermotolérants).Cas de la Commune d’Ambositra.
Département Elevage. Mémoire de fin d’études. ESSA. Université d’Antananarivo
Madagascar.
[20] HERMIER J, LENOIR J et WEBER F, 1992. Les groupes microbiens d’intérêt laitier.
Édition CEPIL. Paris
[21] KASPRZYK M, 2008. Diversité de système d’alimentation des troupeaux bovins laitiers à
Betafo, région Vakinankaratra. Mémoire de fin d’étude pour l’obtention de diplôme
d’agronomie d’ingénieur approfondie. Université de SupAgro Montpellier, France, 98p.
[22] MAEP/UPDR ,2003. Monographie de Vakinankaratra.
[23] MAEP/UPDR, 2004.Filière Lait. OCEAN CONSULTANT.
[24] MAEP, 2004-2005. Filière lait et politique laitière à Madagascar.47 p.
[25] MAHEFARISOA, 2012.Amélioration et sécurisation de la production laitière dans le
triangle laitier des hautes terres de Madagascar. Thèse fin d’obtenir le grade de Docteur en
Médecine Vétérinaire.
[26] MEYER C et DENIS JP ,1999. Elevage de la vache laitière en zone tropicale, CIRAD.
303 p.
[27] MINISTERE DE L’ELEVAGE DÉCRET N° 2011-588 réglementant la production
primaire de lait destiné à la consommation humaine.
[28] MINISTERE DE L’ELEVAGE, 2014.
[29] PENOT Eric et DUBA Gaëlle, 2011. Impact de la crise de 2009 sur les élevages laitiers
dans le Vakinankaratra, Madagascar. Atelier thématique " Agronomie et Ecosystème "
Programmes Corus, Aires-Sud et Aire Développement, Madagascar.
[30] PENOT Eric et RAZANAKOTO N. Michella. Mars 2012. Etude des circuits de
commercialisation du lait et de ses dérivés dans la Région du Vakinankaratra en 2011
[31] POUGHEON et SANDRA, 2001.Contribution à l’étude des variations de la composition
du lait et ses conséquences en technologie laitière. Thèse pour obtenir le grade de docteur
veterinaire école nationale veterinaire de Toulouse.
[32] POLY J et POUTOUS M, 1966 .La précision d’un contrôle laitier mensuel alterné.9ème
Congr .Inter.An .Zootech .15p.
[33] QSA ENVL, 2009. Hygiène de la production et de la collecte du lait.
[34] RABEMANAMBOLA M, 2007. Le triangle laitier malgache : contribution à l’étude
d’une filière alimentaire et de son description spatiale dans un pays en voie de
développement. Thèse Doctorat, Université Clermont Ferrant II. France. 332p
[35] RAHARIMALALA Julie Edwige M, 2016. Les facteurs déterminants de la qualité du lait
de vache dans les régions du Vakinankaratra et d’Analamanga. Thèse pour l’obtention du
titre de Docteur en Sciences Agronomiques.
[36] RAKOTOMANANA Hery Mahatana, 2005. La relance de l’insémination artificielle dans
le cadre de la production laitière dans la région d’analamanga. Cas du District
d’Antananarivo Atsimondrano. Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme
d’ingénieur en sciences agronomiques. Option Elevage. ESSA.
[37] RAKOTONDRANDRIANA M. Hasina, 2010. Appuis à la commercialisation pour
les acteurs de la filière lait de la région de Vakinankaratra pendant la saison des pluies.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 95
Mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme d’Ingénieur Agronome. Option
Elevage ESSA.
[38] RAKOTONIAINA H. ,2005. Maitrise des techniques d’analyses microbiologiques sur les
produits charcutiers dans le cadre d’autocontrôle d’une société. Institut Supérieur Protestant
Paul Minault.
[39] RANDRIANARIVAO, 2011.Etude de la filière lait sur la rive Ouest du lac Alaotra et de
la zone peri-urbaine d’Ambatondrazaka. Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du
diplôme d’ingénieur en sciences agronomiques. Option Elevage. ESSA.
[40] RANDRIANASOLO Jery, 2007. Caractérisation technico-économique de l’exploitation
agricole familiale associant élevage laitier et cultures en semis direct sous couverture
végétale permanente dans la région d’Antsirabe. Consolidation d'un pole de développement
rural durable Programme INTERREG IIIB Réunion – Océan Indien.
[41] RANDRIANOMENJANAHARY Gabriel, 1993. La collecte de lait effectuée par
ROMANOR : aspect organisationnel de ramassage dans la région de Vakinankaratra.
Mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme d’Ingénieur Agronome. Option
Elevage ESSA.
[42] RANDRIATSARAFARA, 2008. Commercialisation du lait frais et dérivés :
caractérisation des stratégies des acteurs dans l’approvisionnement de Commune Urbaine
d’Antananarivo. Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en
sciences agronomiques. Option Elevage. ESSA.
[43] RARIVOARIMANANA Harivololonirina Bakoly, 2010. Diversité des systèmes
d’alimentation des vaches laitières à Vinaninkarena et à Antsampanimahazo Faratsiho
Région Vakinankaratra. Mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme
d’Ingénieur Agronome. Option Elevage ESSA
[44] RAZAFINDRAHAGA H., 1997. Etude de la qualité microbiologique et proposition de
valeurs de références pour le lait frais collecté dans la région de Vakinankaratra. Cas de la
laiterie TIKO. Mémoire de fin d’études. Département Industries Agroalimentaires. ESSA.
Université d’Antananarivo Madagascar.104p.
[45] RAZAFINDRAJAONA J-M. Cours Industrie Laitière. ESSA-département IAA. Université
d’Antananarivo, 106p.
[46] REPOLIKA MALAGASY, 1965. Journal officiel de la République Malagasy n°393 du 2
Janvier 1965.
[47] SCHNEIDER E, 1972. La santé par les aliments, Editions SdT.77-Dammarie les Lys
France, p 196-197.
[48] SERIEYS, 1996. Efficacité des spécialités de pré- et post-trempage des trayons : les essais
de terrain. Bulletin des GTV 520, p 7-18.
[49] PROMET (Société de Promotion et d’Etudes), 2008.Etudes des déterminants de la qualité
du lait. Rapport finale.
[50] SOURISSEAU J-M, RASOLOFO P, BELIERES J-F, GUENGANT J-P,
RAMANITRINIONY H, BOURGEOIS R, RAZAFIMIARANTSOA T,
ANDRIANANTOANDRO V, RAMAROJAONA M, BURNOP P, RABEANDRIAMARO
H, BOUGNOUX N, 2016. Diagnostic Territorial de la Région du Vakinankaratra à
Madagascar. Etude pour le compte de l’Agence Française de Développement. Rapport Pays.
[51] SSA (Service de la Statistique Agricole), 2012.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte. Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études –Mention « Sciences Animales ». Page 96
[52] WEBER F. 1985. Réfrigération du lait à la ferme et organisation des transports.
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'Agriculture Rome(FAO).
WEBOGRAPHIE
[1] http://www.instat.mgconsulté en Juin 2016
[2] http://www.mp.chambagri.fr/LES-MOUCHES-a-l-origine-d.html publié le 3 mars 2011
consulté en Juin 2016.
[3] http://www.gds38.asso.fr/web/gds.../f462116a7be9a93cc125728f006b1568!Open Document
[GDS69
38 (2009)] consulté en Juin 2016.
[4] http : //perso.calixo.net/~braun/conserve/thermobact.htm consulté en Aout 2016.
[5] http://www.ideassoline.org (ONDINA LEON DIAZ et PASTOR PONCE CEBALLO. Pour
la conservation naturelle du lait : Le stabilak. Innovations pour le développement et la
coopération Sud-Sud IDEASS CUBA) consulté le 28 Septembre 2016.
[6] http://www.produits-laitiers.com/les-apports-nutritionnels-en-proteines/consulté en
Septembre 2016
[7] http://www.produits-laitiers.com/l-economie-laitiere-dans-le-monde/consulté en Septembre
2016
[8] http://www.ulb.ac.be/sciences/cudec/LaitComposition.htmlconsulté en Septembre 2016.
[9] http://www.produits-laitiers.com/l-economie-laitiere-dans-le-monde (Fédération
Internationale du Lait) consulté le Septembre 2016.
[10] http://faostat.fao.org. (FAO STAT, 2013) consulté en Septembre 2016.
[11] http://matv.mg/filiere-lait-une-prodution-moyenne-de-100-millions-de-litres-par-an
Consulté en Octobre 2016
[12] http://www.maison-du-lait.com/fr/filiere-laitiere/qualite-au-coeur-filiere-laitiere consulté
en Octobre 2016.
[13] http://www.agri53.fr/bibliotheque_pdf/infos-conseils/lait/CilOuest_version_BD.pdf
consulté en Octobre 2016
[14] http://www.laverite.mg/economie/item/673-socolait-vers-une-part-de-marché-à-
l’international.html consulté en Novembre 2016
[15] http://www.agencepresse-oi.com/socolait-passe-la-vitesse-superieure/ consulté en
Novembre 2016.
[16] http://www.comitedulait.be/prod01.htm consulté en Novembre 2016.
[17] www.franceagrimer.fr/.../INT-%20DGAL70
_%20SDASEI_NS%202014-393_final.pdf
Consulté en Novembre 2016.
69
Groupement Défense Sanitaire 70
Direction générale de l'Alimentation - Sous-direction de la sécurité sanitaire des aliments - Bureau des établissements
de transformation et de distribution), 2014.République Française .
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page I
ANNEXES
Annexe 1 : Population de chaque district de la région de Vakinankaratra et évolutions selon
les projections.
District Population Surface
km²
Densité habitant /km²
1993 2013 2030 1993 2013 2 030
Ambatolampy 169 045 256 164 389 440 1 673 101 153 233
Antanifotsy 218 609 307 944 468 159 2 759 79 112 170
Antsirabe I 125 763 238 478 362 552 121 1 043 1 978 3 008
Antsirabe II 261 929 406 353 617 769 2 427 108 167 254
Betafo 150 269 254 736 387 268 4 179 36 61 93
Faratsiho 129 661 193 301 293 871 1 934 67 100 152
Mandoto 86 322 146 333 222 466 4 748 18 31 47
Total 1 141 598 1 803 307 2 741 525 17 841 64 101 154
Source : SOURISSEAU J-M et al. , 2016.
Annexe 2: Evolution des populations des districts par groupes d’âges dans le Vakinankaratra
Année 1993 2015 2030
<15
ans
(%)
15-64
ans
(%)
65 ou
+ (%)
<15
ans
(%)
15-64
ans
(%)
65 ou
+ (%)
<15
ans
(%)
15-64
ans
(%)
65 ou
+ (%)
Ambatolampy 48.2 48.9 2.9 44.1 53.4 2.6 37.0 59.7 3.3
Antanifotsy 49.4 48.0 2.6 44.1 53.5 2.4 36.9 60.0 3.1
Antsirabe I 40.7 56.6 2.6 43.4 53.4 3.2 38.1 57.7 4.2
Antsirabe II 47.5 49.6 2.9 43.9 53.4 2.6 37.0 59.6 3.4
Betafo 47.0 50.6 2.4 43.4 54.3 2.3 36.8 59.6 3.6
Faratsiho 49.4 48.0 2.6 44.9 52.9 2.2 37.6 59.4 2.9
Mandoto 47.0 50.6 2.4 44.9 52.8 2.3 38.7 58.0 3.3
Source : Résultats de la projection démographique cités par SOURISSEAU J-M et al. , 2016.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page II
Annexe 3 : Nombres d’éleveurs et effectifs des cheptels à Vakinankaratra.
Eleveurs
Cheptel
bovin
Cheptel
porcin
Cheptel
ovin
Cheptel
caprin Volailles
Ambatolampy 11 812 30 919 806 702 18 113 170
Antanifotsy 13 055 53 685 12 768 2 709 107 137 880
Antsirabe I 2 105 8 630 1 861 23 0 25 345
Antsirabe II 15 928 57 656 39 218 640 97 131 127
Betafo 14 039 68 348 29 379 540 255 135 630
Faratsiho 11 640 50 071 14 619 2 637 0 668 580
Mandoto 10 103 55 298 26 701 279 289 179 195
Total
Vakinankaratra 78 682 324 607 125 352 7 530 766
1 390
927
Part dans le total
national 10,8 % 5,1 % 9,9 % 2,1 % 0,1 % 5,3 %
Source: MEI/CREAM/Monographie 2009 in CREAM, 2013.
Annexe 4: Production laitière moyenne annuelle des vaches (Cas de Vakinankaratra)
Degré de sang71
Production (litre/an) Durée de lactation (j)
Zébu malagasy 786 180
1/2 sang 1 164 180
3/4 sang 2 200 200
7/8 sang et race pure 3 749 220
Source : Rapport Etude d’impact des activités de FIFAMANOR, VALY Agri (2000) in MAEP-
UPDR(2004).
71 Le degré de sang permet de situer l’animal par rapport à la race pure.Exemple : L’animal à demi-sang (1/2) est donc un fruit de
croisement de deux races pures différentes. Le degré de sang augmente d’une génération à une autre. Plus il est élevé, plus l’animal
se rapproche de la race pure.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page III
Annexe 5 : Quelques conditions intrinsèques (pH, potentiel d’oxydoréduction), et extrinsèques
(température) favorables aux développements des microorganismes dans le lait.
Annexe 6 : Caractérisation du lait suivant sa qualité organoleptique
Caractère normal Caractère anormal
Caractère
observé Signification
Caractère
observé Signification
Couleur
Blanc mat Lait un peu
maigre Gris jaunâtre Lait de mammite
Blanc
jaunâtre
Lait riche en
crème Bleu jaune
Lait coloré par des substances
chimiques ou des pigments
bactériens
Odeur Faible Lait frais Putride, moisie,
rancie
Lait contaminé par des
moisissures
Saveur Agréable Lait frais
Saveur salée,
goût amer
Lait de mammite
Lait très pollué par des
moisissures
Consistance Homogène Lait pur
Grumeleuse,
Visqueuse,
coagulée
Lait de mammite ou lait pollué
Source : JOFFIN(1992) cité par ANDRIAFEHIMIHARISOA N (2009)
Potentiel d’oxydoréduction, un facteur intrinsèque Les quatre classes de microorganismes selon la
présence ou non de l’oxygène.
Classes Aérobies
stricts
Aéro-anaérobies
facultatifs
Anaérobies
stricts Microaérophiles
Développement en
fonction de l’oxygène
Seulement
en présence
d’oxygène
En présence ou en
absence
d’oxygène
Seulement en
absence de
d’oxygène
avec un taux
d’oxygène faible
Microorganismes Moisissures Coliformes
Staphylocoques Clostridium
Lactobacillus
Streptococcus
Niveaux de pH pour le développement des microorganismes
Groupes pH Min-Max pH Optimum
Bactéries 4,5- 9 6,5-7,5
Levures 2 -11 4-6
Moisissures 2- 9 -
Niveaux de température (°C) pour le développement des micro-organismes.
Groupes de microorganismes Minimum Optimum Maximum
Thermophiles 40 - 45 55 -75 60-90
Thermotrophes 15 - 20 30-40 45-50
Mésophiles 5 - 15 30-40 40-47
Psychrophiles -5 - +5 12-15 15-20
Psychrotrophes -5 - +5 25- 30 30-35
Source : HERMIER J et al, 1992.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page IV
Annexe 7 : Composition en protéines de la matière azotée.
% en protéines Concentration dans le lait
(g/l)
Caséines (total) 80 26,5
-caséine 40 13,5
-caséine 24 8
-caséine 12 4
-caséine 4 1
Protéines solubles (total) 20 6,5
Lactalbumine 12 4
Lactoglobuline 5 1,6
Immunoglobulines 2 0,6
Autres 1 0,3
Source :http://www.ulb.ac.be/sciences/cudec/LaitComposition.html consulté en Septembre 2016.
Annexe 8 : Composition globale de la matière grasse.
Composés lipidiques
(99,5 %)
Lipides simples
(98,5 %)
Glycérides Triglycérides (95-96%)
Diglycérides (2-3%)
Monoglycérides (0,1%)
Cholestérides (esters d'acides gras et cholestérol)
(0,03 %)
Lipides complexes (1 %)
Composés liposolubles
(0,5 %)
Cholestérol, acides gras libres et hydrocarbures divers
Vitamines Vit. E : 1,7 à 4,2 mg.(100 g)-1
Vit. A : 0,6 à 1,2 mg.(100 g)-1
Vit. D : 10 à 20 mg.(100 g)-1
Vit. K : traces
Source : http://www.ulb.ac.be/sciences/cudec/LaitComposition.html consulté en Septembre 2016
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page V
Annexe 9 : Caractéristiques générales d’un centre de collecte.
Bâtiment Equipements
-En dur avec les murs intérieurs et les plafonds
qui doivent être lisses et lavables.
-Sol résistant, antidérapant, facile à nettoyer -
Présence d’évacuations d’eaux usées,
-Accès bien aménagés pour éviter l’entrée des
poussières et des boues lors de la saison des
pluies.
-Une bonne ventilation doit permettre d'éviter
les condensations éventuelles.
Utilités : Eau, électricité,
Equipements :
-Groupe électrogène en cas de coupure de
l’électricité.
-Equipements de stockage d’eau
-Appareils de mesure : bidons, seau, gobelet,
jauges.
-Appareil de contrôle : lactodensimètre,
thermomètre, etc.
-Matériels de réception et de stockage : tank
réfrigérant, bidons de 150 litres à 220 litres, tamis
-Une cuve lavage
Source : RANDRIANOMENJANAHARY G, 1993
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page VI
Annexe 10 : Produits laitiers importés par Madagascar.
Q = Tonne V = Millier d'Ariary
Source : Service de la Statistique Agricole, 2012.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page VII
Annexe 11: Mamelle et coupe d’un trayon
Source : BILLON P ,2005
Annexe 12 : Courbe de lactation
La courbe de lactation est la phase de production du lait .C’est une courbe qui est
représentée par une graphique de la quantité de lait produite depuis le vêlage jusqu’au tarissement.
Même si nombreux sont les facteurs qui influencent le tracé de la courbe, celle-ci présente toujours
le même profil (MEYER C, 1999).
Courbe de lactation d’une vache
Source : MEYER C, 1999
. Avec : Pi : production initiale Pm : production maximal
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page VIII
Annexe 13 : Moyens de transport pour la collecte traditionnelle du lait.
Points forts Points faibles
Bicyclette
Moyen léger et rapide pour le transport de lait
C’est un moyen de transport traditionnel des
trayeurs-cyclistes (trayeur collecteur).
Ne peut porter que de quantités faibles de lait.
Dépourvu de système de réfrigération
Charrette
- Coût réduit (prix du bœuf faibles par rapport aux
chevaux ; 2 bœuf =1cheval).
- Peut porter de lait de mélange en grandes
quantités
- Accessibles aux zones difficiles, voies
contournées et défectueuses (cahoteuses)
- Trajet court moins de 12 km et moins de 3
heures.
- Installation de toit possible pour éviter
l’exposition directe au soleil des bidons contenant
le lait.
- Non motorisé, vitesse moins rapide : 3,5 km/h à 5
km/h (Ministère Français De Coopération, 1975).
- Son utilisation est à éviter pour un trajet de longue
distance de plus de 12 km.
-Dépourvu de système de réfrigération
En véhicules motorisés à deux roues (motocyclette)
-Vitesse plus rapides
-Accessibles aux zones difficiles (cahoteuses)
Ne peut porter que de faibles quantités de lait.
Dépenses en carburant
Dépourvu de système de réfrigération
En véhicules motorisés à quatre roues (fourgon, camionnette)
-vitesse plus rapides
-Peut porter de lait de mélange en grandes
quantités
-Vehicules : trajet long et à bon profil
Moyens de transport motorisé
Exemple : Pick up
-Accessibilité limitée des routes (seulement les routes
nationales ou les axes principales)
-Dépenses en carburant, entretien mécanique, etc.
- Dépourvu de système de réfrigération (simple
camionnette)
Source : Informations tirées des travaux de RANDRIANOMENJANAHARY G (1993).
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page IX
Annexe 14: Facteurs de risque selon leur degré d’impact et selon les maillons (niveaux)
Critères
Taux maximum de
germes
(x106 UFC/ml)
(A)
Taux d’évolution de
germes
Taux (taux max de
germes/taux min)
(B)
Obtention de
l’impact
Taux
(A) x (B)/ 106
Notation impact
1
EL
EV
EU
R
Type de contenant 2,68 429701% 43,97 117,8396
Très critique
2 Dimension
ouverture 2,68 87106% 9,71 26,0228
Critique
3 Utilisation détergent 2,45 69089% 7,91 19,3795
Critique
4 Séchage matériels 0,39 255349% 26,53 10,3467
Critique
5 Propreté contenant 0,77 86498% 9,65 7,4305 Moyennement
critique
6 Propreté mamelle 0,38 166809% 17,68 6,7184 Moyennement
critique
7 Humidité endroit 0,61 64245% 7,42 4,5262 Moyennement
critique
8 Distance avec
bouses 0,64 56436% 6,64 4,2496 Moyennement
critique
9 Eléments lavage
matériels 0,37 98887% 10,89 4,0293 Moyennement
critique
10 Séchage mamelle 0,45 71649% 8,16 3,672 Moyennement
critique
11 Propreté cuisse 0,27 116264% 12,63 3,4101 Moyennement
critique
12 Contenant même
que traite 0,76 28595% 3,86 2,9336 Moyennement
critique
13 Nuages de mouches 0,63 22973% 3,30 2,079 Faiblement
critique
14 Utilisation
couvercle 0,62 17648% 2,76 1,7112 Faiblement
critique
15 Lieu de traite 0,42 24184% 3,42 1,4364 Faiblement
critique
16 Propreté mains
trayeur 0,45 5733% 1,57 0,7065 Faiblement
critique
17 Enlèvement
premiers jets 0,37 1081% 1,11 0,4107 Faiblement
critique
18 Propreté habits
trayeur 0,36 1065% 1,11 0,3996 Faiblement
critique
19
PR
EC
OL
LE
CT
EU
R
Temps (délai) 28,00 1176441% 118,64 3321,92
Très critique
20 Type de contenant 16,60 64598% 7,46 123,836
Très critique
21 Dimension
ouverture 16,60 63734% 7,37 122,342
Très critique
22 Propreté contenant 7,82 40339% 5,03 39,3346
Critique
23 Eléments lavage
matériels 5,69 29613% 3,96 22,5324
Critique
24 Utilisation détergent 6,98 6127% 1,61 11,2378
Critique
25
CO
LL
EC
TE
UR
Temps (délai) 37,90 143998% 15,40 583,66
Très critique
26 Type de tank 19,50 10260% 2,03 39,585
Critique
27 Mode allumage tank 17,20 5177% 1,52 26,144
Critique
28 Temps complets
réception 9,32 1061% 1,11 10,3452
Critique
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page X
Annexe 15 : Fiche d’enquête conçue pour les éleveurs
IDENTIFICATION
Date : …………… Heure de Prélèvement : ……………. Heure de Traite : …………Code échantillon : ……………… Nom éleveur : ………………………………………………………………… Accès : □ facile □ difficile Adresse : tànana …………………………… fokontany…………………………… commune ………………………………….. Circuit du lait : □ direct □ indirect : nom Précollecteur : ……………………………………………………….
PRODUCTION DE LAIT
□ Lait individuel Nom vache : ………………………………… Race : …………………………………. Stade : ……………… Rang : …………….. Production Lait /j : …………. Note de propreté vache : mamelle : …………….. cuisse : …………
□ Lait mélange Nombre de vaches : ………… Production Lait : …………
ENVIRONNEMENT & LIEU DE TRAITE
□ Dans l’étable □ Hors étable □ Près des bouses/fumier □ Loin des bouses/ fumier □ Sale □ Moyen □ Propre □ Sec □ Humide Mouches □ Peu □Beaucoup □ Très beaucoup
MATERIEL DE TRAITE
Seau Usage : □ spécifique □ commun Etat : □ bon □ moyen □ mauvais Propreté : □ sale □ propre
Gobelet Usage : □ spécifique □ commun Etat : □ bon □ moyen □ mauvais Propreté : □ sale □ propre
Préparation matériel Nettoyage : □ action mécanique : ……………………………………….. □ produit chimique : …………………………………………… □ rinçage : □ eau propre □ eau sale ……………………………………………… □ séchage : …………………………………………………….. Stockage : □ en hauteur/ à l’abri / endroit propre □ par terre / endroit sale
PRATIQUE DE TRAITE
Préparation mamelle □ Lavage : □ Eau froide □ Eau chaude □ Savon □ Mamelle complète + autour □ Bas de la mamelle □ Trayons seulement □ Séchage : □ Chiffon propre □ Chiffon sale □ Tire les premiers jets à part Trayeur : Habits □ propres □ sales Mains □ propres □ sales
CONSERVATION- TRANSPORT DU LAIT
Lieu : □ à température ambiante : □ au soleil □ à l’ombre □ au frais : température = …. Filtrage □ oui □ non Tamis □ propre □ sale Matériel : □ même que traite □ différent : ………………………………………………………………….. Type : □ aluminium / inox □ plastique : ………………………………………………………………………… Protection des mouches □ non □ oui : □ couvercle □ sachet Ouverture : □ large □ étroite Moyen de transport : □ aucun (ramassage sur place) □ à pied □ à vélo □ en charrette □ à moto □ en voiture Temps de transport : …………….. aller
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page XI
Annexe 16 : Fiche d’enquête conçue pour les précollecteurs.
IDENTIFICATION
Date : …………………………… HP72 : …………………. Code échantillon : …………………………………
Nom PC (PréCollecteur): ………………………………………………………………… Accès : □ facile □ difficile
Adresse : tanana ……………… fokontany …………………………………………… commune …………………………………..
Circuit du lait : □ direct : nom Collecteur : ………………………………. □ indirect : nom PC2 : ………………….
RECEPTION DU LAIT
Nb ramassages / jour : □ 1 □ 2 Quantité / jour : ……………………… Nb éleveurs :
……………………………
Matériel de test : □ Alcool 70° □ Alcool 90° □ lactodensimètre
Fréquence de test : □ systématique □ souvent □ parfois □ jamais
Mode de ramassage : □ porte à porte □ lieu de rendez-vous fixe
Temps complet pour une tournée : ……… Le lait déjà reçu attend : □ au soleil □ à l’ombre □ n’importe
MATERIEL DE RECEPTION & TRANSPORT
Préparation matériel : Nettoyage : □ action mécanique : …………………………… □ produit chimique : ……………………………… Quand le matériel est-il nettoyé : …………………………………………………………………………………………………. □ rinçage : □ eau propre □ eau sale ………………………… □ séchage : ……………………………………….. Stockage : □ en hauteur/ à l’abri / endroit propre □ par terre / endroit sale Matériel : Ouverture : □ large □ étroite Etat : □ bon □ moyen □ mauvais Propreté : □ sale □ propre Filtrage □ oui □ non □ parfois Tamis □ propre □ sale Type, Volume et Nombre : □ aluminium / inox : …………………………………………………………………………………. □ plastique : ……………………………………………………………………………………………..
PRECOLLECTEUR
Habits : □ propres □ sales Mains : □ propres □ sales
CONSERVATION ET TRANSPORT
Lieu : □ à température ambiante : □ au soleil □ à l’ombre □ au frais : température = ………..°C Moyen de transport : □ à pied □ à vélo □ en charrette □ à moto □ en voiture Temps de transport : …………….. aller
72
Heure de Prélèvement
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page XII
Annexe 17 : Fiche d’enquête conçue pour le collecteur
IDENTIFICATION
Date : …………………………… HP : …………………. Code échantillon : ………………………………… Nom C : ………………………………………………………………… Accès : □ facile □ difficile Adresse : tànana ………………………… fokontany ……………………………… commune …………………………………..
RECEPTION DU LAIT
Quantité / jour : …… Nb E directs/quantité lait : …..………… Nb Précollecteur/ quantité lait : ………… Matériel de test : □ Alcool 70° □ Alcool 90° □ lactodensimètre Fréquence de test : □ systématique □ souvent □ parfois □ jamais Filtrage □ oui □ non □ parfois Tamis □ propre □ sale Temps complet pour une réception : ………………..
LIEU DE RECEPTION
Accès extérieur : □ bétonné □ gravier □ terreEvacuation de l’eau : □ bonne □ moyenne □ mauvaise
Intérieur : □ brique □ enduit □ peinture □ carrelage Propreté : □ propre □ moyen □ sale
Mouches : □ peu □ beaucoup □ très beaucoup
MATERIEL DE RECEPTION
GOBELET Usage : □ spécifique □ commun Etat : □ bon □ moyen □ mauvais Propreté : □ sale □ propre
SEAU Usage : □ spécifique □ commun Etat : □ bon □ moyen □ mauvais Propreté : □ sale □ propre
TANK Nettoyage tank : Fréquence de nettoyage : …………………………………………… □ action mécanique : ……………………….. □ produit chimique : ……………………………………………………… □ rinçage : □ eau propre □ eau sale …………………………………………… Tank : Etat : □ bon □ moyen □ mauvais Propreté : □ sale □ propre Volume et Nombre : ……………………………………………………………………………………..
PERSONNEL
Habits □ propres □ sales Mains □ propres □ sales
Equipement de travail □ bottes □ blouse □ autre : ………………………………………..
CONSERVATION DU LAIT
Allumage du tank : □ dès le début de la réception □ après …... heures
Température cible : ……. Mise en route automatisée : □ oui □ non
Temps de conservation : ………… heures
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page XIII
Annexe 18 : Mode opératoire pour la préparation de l’eau peptonée, une solution de dilution.
Domaine d’utilisation
L’eau peptonée tamponnée est un diluant destiné à la préparation des suspensions mères
de laits en poudre et concentrés, de yaourts, de produits laitiers, de produits d’origine animale et
d’autres produits alimentaires. Il est aussi employé pour effectuer les dilutions en vue de l’examen
microbiologique.
Principes
La méthode préconisant le préenrichissement des salmonelles est utilisée pour la revivification
des microorganismes ayant subi des dommages au cours des traitements industriels de conservation
des aliments tels que : atomisation, pasteurisation, ajout de conservateurs, pressions osmotiques
élevées, fortes acidités...
Le chlorure de sodium maintient l’équilibre osmotique.
Le milieu est tamponné au moyen des phosphates.
Préparation
Mettre en solution 25,5 g de milieu déshydraté dans 1 litre d’eau distillée ou déminéralisée.
Agiter lentement, jusqu’à dissolution complète.
Répartir en tubes ou en flacons.
Stériliser à l’autoclave à 121°c pendant 15 minutes.
Mode d’emploi
Préparation des solutions ou des suspensions mères
Refroidir à 25°c.
Introduire aseptiquement 10 ou 25 g de produit à analyser dans un flacon taré contenant 90 ou 225
ml de milieu ainsi préparé.
Homogénéiser parfaitement au moyen d'un appareil de broyage de façon à obtenir une suspension
mère ou un bouillon de pré enrichissement.
Incuber en respectant le protocole analytique approprié.
Préparation des dilutions décimales
Introduire 1 ml de suspension mère dans un tube contenant 9 ml de milieu ainsi préparé.
Homogénéiser parfaitement.
Recommencer l’opération jusqu’à l’obtention de la dilution souhaitée.
Stockage / conservation
Milieux déshydratés : 2-30°c
Source : http://www.biokar diagnostics.com/.../FT_BK018_131_BM010_056_057_131_132_v12.p.
consulté en juin 2016.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page XIV
Annexe 19 : Mode opératoire pour la préparation de la Gélose PCA
Domaine d’utilisation
La gélose glucosée à l’extrait de levure, appelée par les Anglo-Saxons “Plate Count Agar” ou PCA,
est utilisée en bactériologie alimentaire pour le dénombrement des bactéries aérobies psychrotrophes,
mésophiles dans le lait, les viandes, les produits à base de viande, les autres produits alimentaires, ainsi que
pour l’analyse des produits pharmaceutiques, des produits cosmétiques et de leurs matières premières.
Principes
Les substances nutritives apportées par la Tryptone, les facteurs vitaminiques de l’extrait de levure et le
glucose (source énergétique) favorisent la croissance de la plupart des bactéries à dénombrer.
Préparation
- Mettre en suspension 20,5 g de milieu déshydraté dans 1 litre d’eau distillée ou déminéralisée.
- Porter lentement le milieu à ébullition sous agitation constante et l’y maintenir durant le temps nécessaire
à sa dissolution.
- Répartir en tubes ou en flacons.
- Stériliser à l’autoclave à 121°C pendant 15 minutes.
Une liquéfaction partielle de l’agar entraînera inévitablement une altération significative de la consistance du
gel du milieu solidifié, après stérilisation et refroidissement.
Mode d’emploi
- Avec les milieux prêts-à-liquéfier ou bien si le milieu est préparé à l’avance à partir du milieu déshydraté,
faire fondre la gélose pendant le minimum de temps nécessaire à sa reliquéfaction totale.
- Refroidir et maintenir à 44-47°C.
- Transférer 1 ml du produit à analyser et de ses dilutions décimales successives dans des boîtes de Pétri
stériles.
- Couler 10 à 15 ml de milieu.
- Homogénéiser parfaitement.
- Laisser solidifier sur une surface froide.
- Couler éventuellement 4 mL de gélose blanche stérile (Agar bactériologique à 15 g/L).
- Laisser solidifier à nouveau.
- Incuber :
à 30°C pendant 72 heures pour la recherche des microorganismes mésophiles.
à 55°C pour les microorganismes thermophiles.
à 6,5°C pendant 10 jours pour les microorganismes psychrophiles.
En bactériologie laitière, il est recommandé d’ajouter 1 g de lait écrémé en poudre par litre de milieu
reconstitué.
Lecture
Procéder au comptage des colonies pour chaque boîte contenant entre 10 au minimum et 300 colonies au
maximum, suivant les normes appliquées. Lorsqu’elles sont cultivées sur PCA additionné de lait, les
bactéries caséolytiques forment un halo plus clair autour de chaque colonie (protéolyse de la caséine du lait).
Source : http://www.solabia.com/solabia/produitsDiagnostic.nsf/0/.../FT_BK144_BM015_033_v8.pd...
consulté en juin 2016.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page XV
Annexe 20 : Tests physico-chimiques effectués pour le lait.
Test à l’ébullition :
Prendre un échantillon du lait et le porter à ébullition. Si le lait tourne (formation de grumeaux), le
transformateur doit refuser de prendre ce lait car il tournera lors de la pasteurisation et ne pourra
donc pas supporter les températures nécessaires à l’élimination des germes.
Test à l’alcool :
Prendre un échantillon de lait de 10 centilitres et le mélanger avec 10 centilitres d’alcool à 60°.
Mélanger l’ensemble. Si des grumeaux se forment (« coagulation »), il faut refuser le lait car cela
indique la présence probable de germes. Néanmoins, il est possible que le lait qui coagule au test à
l’alcool supporte la pasteurisation. Ce n’est donc pas un test complètement fiable.
Test de densité :
Prendre un échantillon de lait de 0,5 litre, le refroidir à 20°C puis le mettre dans l’éprouvette livrée
avec le lactodensimètre et enfin plonger le lactodensimètre dans l’éprouvette. On peut aussi relever
la température du lait et, après avoir lu la valeur, faire les corrections nécessaires en fonction de la
température (tables de corrections fournies avec le lactodensimètre). Les valeurs de références sont
en effet données pour un lait à 20 °C.
Pour éviter des erreurs de lecture, il est nécessaire de se mettre bien en face du lactodensimètre,
les yeux à la hauteur de la zone de lecture. La valeur lue sur le lactodensimètre (colonne lait entier)
doit être comprise entre 1,030 et 1,034 (20 °C).
Un lait dans lequel on aurait rajouté de l’eau aura une valeur inférieure à 1,028 (par exemple 1,025).
Le contrôle de la densité permet donc de vérifier que le lait n’a pas été mouillé.
Test d’acidité :
La mesure de l’acidité permet de savoir si les réactions d’acidification ont commencé (indicateur de
l’activité des bactéries lactiques, fermentation). Ce test a l’avantage d’être très facile à mettre en
œuvre et de donner un résultat immédiat. A la sortie de la mamelle, le lait sain a une acidité
naturelle comprise entre 15° et 21° Dornic.
A l’arrivée dans la laiterie, la mesure de l’acidité du lait permet de vérifier que la fermentation n’a
pas commencé et que la charge microbienne n’est pas trop élevée. Au cours du procédé de
transformation, il est également utile de surveiller l’augmentation de l’acidité. Dans les procédés de
fabrication des yaourts, des caillés, des crèmes, la mesure de l’acidité Dornic est utile pour vérifier
la bonne activité des ferments lactiques et stopper les fermentations au bon moment.
L’augmentation de l’acidité du lait lorsqu’elle est involontaire est un signe de mauvaise hygiène et
d’un développement intense de micro-organismes (mauvais refroidissement, mauvaise
pasteurisation, durée trop longue du transport, par exemple).un
Source :http://www.infotpa.gret.org/fileadmin/fiches/agridoc36.pdfconsulté en juin 2016.et de
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page XVI
Annexe 21 : Liste des photos qui récapitulent les contenants ou récipients utilisés dans la collecte
du lait.
Bidon plastique blanc à
ouverture large.
Bidon d’huile en
plastique à ouverture
étroite (20 litres)
Bidon en aluminium à
ouverture large
Bidons plastique bleus à
ouverture large de différentes
capacités (60 à 220 litres)
Seau plastique à
ouverture large (15 litres)
Sans fermeture
spécifique.
Bidon plastique bleu à
ouverture large (60 litres)
Source : compilation de l’auteur.
Annexe 22 : Quelques photos qui illustrent le transport du lait.
Eleveur qui transporte le lait frais avec un
contenant en aluminium à Betafo.
Eleveur qui transporte le lait frais avec un
contenant en plastique à Betafo.
Source : Cliché de l’auteur
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page XVII
Annexe 23 : Avantages et inconvénients de chaque système de ramassage ou collecte de lait
Avantages Inconvénients
AA.. Les véhicules faits un « aller à vide » .Le ramassage s effectue pendant le retour.
- L’habitude pour les traites entre 6h30 et 7h30 chez
les producteurs ne sont pas encore changée car les
travaux agricoles et la sortie du troupeau les obligent à
traire tôt. Ceci permet aussi d apporter le lait très tôt
pour éviter le rayonnement solaire lors du transport.
Le véhicule est ménagé car la charge n’augmente
qu’au fur et à mesure de l’approchement de la laiterie.
Ce système présente un retard de 30 minutes
environ par rapport à son inverse.
Les collecteurs (ramasseurs) pourraient être plus
fatigués et pourraient prendre moins d’attention à
la fin de la tournée, cela peut infliger de
conséquences graves sur la qualité de lait aux
derniers point de collecte.
BB.. Le ramassage se fait pendant le « aller ».Le véhicules fait le retour sans arrêt mais pendant
certain moment le ramassage est effectué pendant l’aller dans une portion de route et pendant
le retour dans la portion restante.
L’attente du lait, exposé au soleil est encore
acceptable car le véhicule arrive au point de collecte
dans le délai de 3 heures après la traite .Ce système est
convenable au départ relativement tard à la laiterie, et
sur une distance de plus de 50km.
Le véhicule supporte la charge totale de lait
ramassé dans la longueur totale de l’axe de
ramassage
CC.. La tournée de ramassage suit un trajet en « en cadre de raquette »
Ce système permet un gain de temps considérable car
le véhicule effectue exactement la longueur du réseau.
Le véhicule est aussi ménagé dans ce cas car il ne
supporte la charge maximale qu’après le dernier point
de collecte le plus proche de la laiterie
Ce cas exige un réseau routier ayant la forme du
schéma de tournée de ramassage
DD.. La livraison du lait à la laiterie .Le retour au village de départ est effectué sans arrêt : ce
système est surtout adopté pour le transport en charrette.
Le lait obtenu est encore plus frais par rapport aux
systèmes sus-indiqués car le lait est ramassé
immédiatement après la traite et le délai de transport
est assez court
Le système de ramassage par charrette ne convient
qu’à distances relativement courtes inférieures à
10 km
ABD ont pour commun, un inconvénient de distance, le ramassage est effectué sur le double de la
longueur du réseau ce qui entraîne une diminution de la densité kilométrique.
Source : Informations tirées des travaux de RANDRIANOMENJANAHARY G (1993).
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page XVIII
Annexe 24 : Types de tank réfrigérant
Tank réfrigérant cylindrique
Tank réfrigérant demi-cylindrique
Source: Cliché JAPY in WEBER (FAO) 1985.
Etude des facteurs de risque dans la conservation du lait frais le long de la chaîne de collecte.
Cas du lait livré à l’usine SOCOLAIT ANTSIRABE.
Mémoire de fin d’études – Mention « Sciences Animales ». Page XIX
REFERENCES DES ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
[1] ANDRIAFEHIMIHARISOA N, 2009. Contribution à l’étude comparative de la valeur
nutritionnelle du lait de vache (race Primholstein et Normande) et du lait de chèvre.
Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur en sciences
agronomiques. Option Industries Agricoles et Alimentaires. ESSA.
[2] BILLON P, 2005. L’état des trayons : élément révélateur de la routine de traite et du
fonctionnement de la machine à traire. Journée Qualité de la Traite. Belgique.
[3] CREAM (CENTRE DE RECHERCHES, D’ETUDES ET D’APPUI A L’ANALYSE
ECONOMIQUE À MADAGASCAR), 2013.Monographie de Vakinankaratra.
[4] HERMIER J, LENOIR J et WEBER F, 1992. Les groupes microbiens d’intérêt laitier.
Édition CEPIL. Paris
[5] MAEP/UPDR, 2004. Filière Lait. OCEAN CONSULTANT.
[6] MEYER C et DENIS JP, 1999. Elevage de la vache laitière en zone tropicale, CIRAD. 303
p.
[7] RANDRIANOMENJANAHARY Gabriel, 1993. La collecte de lait effectuée par
ROMANOR : aspect organisationnel de ramassage dans la région de Vakinankaratra.
Mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme d’Ingénieur Agronome. Option
Elevage ESSA.
[8] SOURISSEAU J-M, RASOLOFO P, BELIERES J-F, GUENGANT J-P,
RAMANITRINIONY H, BOURGEOIS R, RAZAFIMIARANTSOA T,
ANDRIANANTOANDRO V, RAMAROJAONA M, BURNOP P, RABEANDRIAMARO
H, BOUGNOUX N, 2016. Diagnostic Territorial de la Région du Vakinankaratra à
Madagascar. Etude pour le compte de l’Agence Française de Développement. Rapport Pays.
[9] SSA (Service de la Statistique Agricole), 2012.
[10] WEBER F. 1985. Réfrigération du lait à la ferme et organisation des transports.
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'Agriculture Rome (FAO).
WEBOGRAPHIE
[1] http://www.biokar-diagnostics.com/.../FT_BK018_131_BM010_056_057_131_132_v12.p.
consulté en juin 2016.
[2] http://www.solabia.com/solabia/produitsDiagnostic.nsf/0/.../FT_BK144_BM015_033_v8.p
consulté en juin 2016.
[3] http://www.infotpa.gret.org/fileadmin/fiches/agridoc36.pdf consulté en juin 2016.
[4] http://www.ulb.ac.be/sciences/cudec/LaitComposition.html consulté en Septembre 2016.