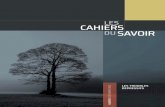L’échange comme mode d’acquisition, l’exemple des collections du Musée des Confluences
Quelques remarques d’archéologie spatiale concernant la distribution géographique des enceintes...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Quelques remarques d’archéologie spatiale concernant la distribution géographique des enceintes...
Néo.
Sous la direction deRoger JOUSSAUME et Jean-Marc LARGE
Sophie CORSON, Nelly LE MEUR et Jean-Pierre TORTUYAUX
Enceintes néolithiquesde l’Ouest de la France
de la Seine à la Gironde
Association des PublicationsChauvinoises (Mém. XLVIII),Chauvigny, 2014
1
Actes du colloque CrabeNéoEnceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Sommaire
– p. 7 –Organisation du colloque
Comité scientifiqueComité de lecture
Comité d’organisation et secrétariat du colloqueAuteurs
– p. 11 –Préface
Guy SAN JUAN, Christophe VITAL
– p. 15 –Avant-propos
Jean-Pierre TORTUYAUX
– p. 17 –
Colloque sur la Recherche Archéologique du Bâti et des Enceintes du Néolithique
“Les enceintes néolithiques de l’Ouest de la France entre Seine et Gironde”
Roger JOUSSAUME, Jean-Marc LARGE
– p. 21 –Excursion du 19 septembre 2012
Roger JOUSSAUME, Nelly LE MEUR, Jean-Marc LARGE
Fichier éditeur destiné à un usage privé
Fichier éditeur destiné à un usage privé
– p. 27 –SESSION 1 : ARCHITECTURES
NÉOLITHIQUE MOYEN, RÉCENT ET FINAL
Premières reconnaissances du site du Castel à Barneville-Carteret (Manche) et de ses structures internes – p. 29
Cyrille BILLARD, Fabien DELRIEU, Nicolas LE MAUXavec la collaboration de
Axelle GANNE, Sophie QUEVILLON, Anne ROPARS
Données préliminaires sur les structures internes de l’enceinte de Goulet “Le Mont” (Orne) – p. 51
Cyrille BILLARD, François CHARRAUD, Axelle GANNE, Cécile GERMAIN-VALLÉE, Emmanuel GHESQUIÈRE, Guillaume HULIN, Fanny JUDE, Chantal LEROYER,
Cyril MARCIGNY, Nancy MARCOUX
Enceintes du Néolithique moyen 1 et du Néolithique moyen 2en Normandie : exemples récents – p. 63Emmanuel GHESQUIÈRE, Cyril MARCIGNY
L’enceinte néolithique de Sublaines (Indre-et-Loire) – p. 83Éric FRÉNÉE, Morgane LIARD, Tony HAMON
Le site des 4 Chevaliers à Périgny (Charente-Maritime).Présentation et contexte chrono-culturel d’une enceinte du Néolithique moyen du Centre-Ouest de la France – p. 99
Ludovic SOLER
Le Priaureau à Saint-Gervais (Vendée).Un exemple de l’évolution d’une enceinte du Néolithique récent – p. 117
Benoît POISBLAUD
Occupation, architecture et fonction d’une enceinte fossoyée du Néolithique récent. Apport des fouilles récentes du site de
Bellevue à Chenommet (Charente) – p. 131Vincent ARD
L’enceinte du Néolithique récent/final de Basly “La Campagne” (Calvados).Un habitat groupé, ostentatoire et défensif ? – p. 149
Nicolas FROMONT, Guy SAN JUAN, Jean-Luc DRON, Michel BESNARD
2
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Fichier éditeur destiné à un usage privé
Sommaire
La Chevêtelière (L’Île-d’Olonne et Saint-Mathurin, Vendée).Présentation du site et représentation SIG tridimensionnelle. Interprétation stratigraphique – p. 163 (Article non parvenu)
Patrick PÉRIDY, Mathieu HILLAIRET
Les enceintes néolithiques de La Rue des Venelles à Chaillé-les-Marais (Vendée)et de Matheflon à Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire) – p. 165
Bertrand POISSONNIER
Éperons barrés du Néolithique récent en contexte insulaire : l’île d’Yeu (Vendée) – p. 179
Audrey BLANCHARD
– Session 1 – Échange collectifArchitectures – Néolithique moyen et récent – p. 193
Les bâtiments sur poteaux plantés de l’enceinte de la fin du Néolithique à Avrillé “rue des Menhirs” (Vendée) – p. 201
Nicolas FROMONT, Philippe FORRÉ, Vincent ARD, Klet DONNART
Trois, voire cinq nouvelles enceintes à proximité du Marais d’Olonne. Données préliminaires sur l’occupation et les berges du marais aux “Caltières”
et à “la Goujonne” à Olonne-sur-Mer (Vendée) – p. 215Nicolas FROMONT, Philippe FORRÉ, Mathieu HILLAIRET, Carole VISSAC, Denis FILLON
Les enceintes du Néolithique récent et final dans les régions de la Loire moyenne : état de la question – p. 227
Tony HAMONavec la participation de Nicolas FOUILLET, Rolland IRRIBARRIA
– Session 1 – Échange collectifArchitectures – Néolithique moyen et récent – p. 237
– p. 253 –SESSION 2 : ENVIRONNEMENT
Les composantes du paysage et des territoires au Néolithique moyen : deux exemples dans la plaine sédimentaire bas-normande – p. 255
Emmanuel GHESQUIÈRE, Cyril MARCIGNY
3
Quelques remarques d’archéologie spatiale concernant la distributiongéographique des enceintes néolithiques du Centre-Ouest de la France et
des marges du Massif armoricain – p. 273Gwenolé KERDIVEL
– Session 2 – Échange collectif – Environnement – p. 291
La place des coquillages marins dans les enceintes néolithiques de l’Ouest de la France : bilan quantitatif et notion de territoire – p. 293Catherine DUPONT, Vincent ARD, David CUENCA SOLANA, Yves GRUET,
Gwénaëlle HAMON, Luc LAPORTE, Sandra SICARD, Ludovic SOLER
– Session 2 – Échange collectif – Environnement – p. 307
L’exploitation de la végétation ligneuse sur le site de Champ-Durand, Nieul-sur-l’Autise (Vendée) au Néolithique récent – p. 309
David AOUSTIN
– Session 2 – Échange collectif – Environnement – p. 317
La question de l’utilisation du torchis dans l’aménagement des enceintesnéolithiques du Centre-Ouest de la France : exemples comparés des
enceintes de Champ-Durand à Nieul-sur-l’Autise (Vendée) et de Bellevue à Chenommet (Charente) – p. 321
Marylise ONFRAY
– Session 2 – Échange collectif – Environnement – p. 335
– p. 337 –SESSION 3 : FUNÉRAIRE
Représentations différentielles d’ossements humains et fonction funéraire des fossés – p. 339
Patricia SEMELIER
Les dépôts humains en contexte d’enceinte néolithique.De nouveaux regards sont-ils possibles ?
Le cas du Centre-Ouest de la France – p. 351Ludovic SOLER
– Session 3 – Échange collectif – Funéraire – p. 363
4
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Fichier éditeur destiné à un usage privé
Sommaire
– p. 369 –SESSION 4 : COMPLEXES TECHNO-CULTURELS –
TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE, LITHIQUE
Des enceintes qui ne manquent pas de sel.Les vases de “type Champ-Durand” comme témoins d’une activité spécifique
aux pourtours des Marais poitevin et charentais – p. 371Vincent ARD, Olivier WELLER
De l’opale résinite débitée par pression au Néolithique récent en Vendée – p. 387
Justine PAPON, Jacques PELEGRIN
Du début du Néolithique moyen au Néolithique récent en Normandie et dans les îles Anglo-Normandes :
chronologie et sites enclos – p. 405Cyril MARCIGNY
– Session 4 – Échange collectifComplexes techno-culturels – Technologie céramique, lithique – p. 419
L’apport de l’expérimentation à la lecture des grands fossés ouverts – p. 427Bertrand POISSONNIER
Étudier différemment les ensembles fossoyés néolithiques.Regards croisés entre géophysiciens et archéologues – p. 437Vivien MATHÉ, Vincent ARD, François LÉVÊQUE, Adrien CAMUS
– Session 4 – Échange collectifComplexes techno-culturels – Technologie céramique, lithique – p. 449
– p. 453 –SESSION 5 : RÉFLEXIONS
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France : une archéologie des fossés ? – p. 455
Luc LAPORTE, Catherine BIZIEN-JAGLIN, Jean-Noël GUYODO
Synthèse du colloque – Perspectives de recherches – p. 489
5
Fichier éditeur destiné à un usage privé
273
Actes du colloque CrabeNéoEnceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Quelques remarques d’archéologie spatialeconcernant la distribution géographique desenceintes néolithiques du Centre-Ouest de laFrance et des marges du Massif armoricain
Gwenolé KERDIVEL
Résumé La concentration d’enceintes fossoyées dans le Centre-Ouest a été maintes fois signalée. Cet étatde fait a conduit de nombreux préhistoriens à s’interroger : état de la recherche ou témoins d’uneréalité archéologique ? Cet article est l’occasion de discuter cette réalité à l’échelle de l’Ouest de laFrance. Il s’agit de comparer ici les découvertes de structures fossoyées observées en prospectionaérienne dans deux secteurs-tests, permettant de coupler des substrats chrono-géologiquementdifférents et des zones bien couvertes par la prospection aérienne. L’analyse permet d’attester quele grand nombre d’enceintes fossoyées du Centre-Ouest est une originalité indiscutable de cetterégion, bien qu’elle résulte probablement d’un palimpseste d’occupations s’échelonnant sur un peumoins d’un millénaire.
Quant aux différents choix d’implantation, il est difficile d’être péremptoire en raison de fortesdisparités entre les effectifs des différentes phases du Néolithique. Par ailleurs, l’actuel Maraispoitevin, dont la configuration durant cette période reste encore mal connue, vient compliquer unpeu plus la lecture. Toutefois, l’hypothèse d’enceintes investissant de plus en plus les points hautsapparaît la plus vraisemblable, avec toutefois une tendance à s’éloigner des cours d’eau. Les enceintessont bâties de préférence sur des substrats jurassiques, dont la qualité des sols est bien connue. Enrevanche, l’implantation en contexte géologique primaire reste toujours ponctuelle et témoigned’enceintes de fonctions légèrement différentes. Pour finir, on note une dégradation progressivedes sols environnant les enceintes, d’après certains critères tels que la texture et l’acidité.
Mots-clefs : enceintes, prospection aérienne, analyses spatiales, occupation de l’espace, Néolithiquemoyen, Néolithique récent, Néolithique final.
Fichier éditeur destiné à un usage privé
A. Introduction
Depuis le début des années 80, la prospec-tion aérienne s’est particulièrement développée enFrance, conduisant à la multiplication des découvertesd’enceintes, notamment dans le Centre-Ouest de laFrance, sur le pourtour du Marais poitevin (Marsac1991 ; 1993 et 1996). En parallèle, les travaux de terrainsur ces enceintes se sont multipliés, notamment pouralimenter la discussion sur les groupes culturels duNéolithique récent de l’Ouest de la France (Burnez1976 ; Joussaume 1981 ; Cassen 1987). L’émulationsur ce sujet est alors totale dans le sillage des travauxde C. Burnez ou de R. Joussaume, avec la multiplica-tion des fouilles et des monographies ou articlesmonographiques de site (par exemple : Burnez 2006 ;Joussaume 2012). Les chercheurs s’interrogent alorstrès tôt sur la signification de cette surreprésentationdes enceintes dans cet espace. Certains vont insistersur l’intérêt de s’installer sur des terrains aux bonnesdispositions agricoles, d’autres vont proposer desinstallations en lien avec la production saline (Scarre
Abstract The concentration of ditched enclosures in West Central France has often been pointed out,which led many prehistorians to wonder whether this observation was just due to today’s site countor actually revealed an archaeological reality. This article is an opportunity to investigate this subjectwithin the whole of Western France. The methodology used here is to compare the discoveries ofditched structures enabled by aerial prospection in two test-sectors, so as to link different chrono-geological substrates with zones well-covered by air survey. Results bring evidence that the largenumber of ditched enclosures in West Central France is an indisputable originality of the region,although it probably results from a palimpsest of successive occupations over nearly a millennium.
It is difficult to firmly assert what led to the choice of the locations for the monuments, becausetheir numbers vary considerably throughout the various Neolithic phases. Besides, things are stillmore complicated with the Marais poitevin as we know little about its physical features during theperiods concerned.
However the hypothesis of enclosures occupying more and more hilltops is the most likely one,with a tendency to keep away from rivers. Enclosures are built preferentially on Jurassic substrata,known for the quality of their soils. In contrast, locations in a primary geological context are mostoften particularities, and such enclosures testify to slightly different functions. To conclude, it isworth mentioning the gradual degradation of the soils surrounding enclosures, an observation basedon certain criteria such as texture and acidity.
Key-words : enclosures, aerial archaeology, spatial analysis, occupation of space, Middle Neolithic,Recent Neolithic, Final Neolithic.
274
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
1982 ; Cassen 1987). La nature réellement domestiquede ces enceintes est alors régulièrement posée, bienque finalement cela fasse peu de doutes (Joussaume,Pautreau 1990). C’est aussi la réalité historique decette concentration d’enceintes qui va faire coulerbeaucoup d’encre, certains n’y voyant qu’un état dela recherche à relier à la nature du substrat parexemple (Cassen, Scarre 1997).
Le travail de synthèse proposé est l’occasion derevenir sur ces questionnements à la lumière d’unrécent travail d’analyses spatiales sur la distributiondes gisements néolithiques de l’Ouest de la France,complété depuis (Kerdivel 2012a).
La problématique que nous nous fixons consisteà discuter la réalité historique de cette concentrationd’enceintes et de définir quelques-uns des choix quiont pu conduire à l’implantation de ces enceintes au cours du Néolithique récent. Pour ce faire, nousallons engager des analyses spatiales et géostatistiques sur ces gisements. Précisons d’emblée que celles-ci, pourtant très simples, vont permettre d’asseoir(définitivement, selon nous) la réalité archéologique
Fichier éditeur destiné à un usage privé
recoupés par des substrats essentiellement fluides ;cela par un simple examen visuel des donnéesprojetées via un logiciel SIG. Par conséquent, lessecteurs considérés ne sont pas continus. Sur le Massifarmoricain, par exemple, les communes concernéessont au nombre de 204 et se distribuent dans quatre départements : Loire-Atlantique, Mayenne,Sarthe et Maine-et-Loire. Celles du Bassin aquitainsont au nombre de 294 et se distribuent sur le seuldépartement de Charente-Maritime (fig. 1). Au total,les territoires explorés ont des surfaces sensible-ment comparables : 4 674 et 4 657 km² (fig. 2). Nousn’avons pas jugé bon de tronquer les territoirescommunaux pour avoir des surfaces égales.
Quelques remarques d’archéologie spatiale concernant la distribution géographique des enceintes néolithiques du Centre-Ouest de la France et des marges du Massif armoricain
275
Fig. 2 – Carte de situation des secteurs nord et sud étudiés et des structures fossoyées toutes périodes recensées à la basePATRIARCHE (CAO et DAO : G. Kerdivel).
de cette concentration autour du Golfe des Pictons. Ladiscussion portera sur les choix d’implantations pourles enceintes des marges du Massif armoricain de laManche à la Charente, pour profiter d’un état deslieux solide (Kerdivel 2012a).
B. Réalité archéologique desconcentrations d’enceintes dans le Centre-Ouest
Afin de discuter cet aspect, nous avons opté pourune méthode simple : utiliser des zones bien pros-pectées en aérien à la fois sur le Bassin aquitain et surle Massif armoricain, tout en tenant compte à la foisde la nature des substrats et de la prospectabilité desterrains.
B.1 Les données utilisées
En premier lieu, il a fallu choisir des zones bienprospectées dans les deux grandes entités géologiquesconsidérées, le Massif armoricain et le Bassin aquitain,respectivement dénommés secteur nord et secteursud.
a. Les données environnementales et administratives
Les données utilisées pour la réflexion cartogra-phique sont de trois types :- les données administratives produites par l’IGN(GeoFLA ©) ;- les données pédologiques issues de la base SISE ©(Système d’Information des Sols d’Europe) produitepar l’INRA et établie au 1/1 000 000 ;- les données CORINE Land Cover © produites parl’Institut Français de l’Environnement (IFEN) et établiesau 1/100 000 à partir de données datées de 2006.
Les données administratives utilisées en prioritévont être les territoires communaux. En effet, dansl’absolu, il nous aurait fallu prendre en considéra-tion les plans de vol de chaque prospecteur aériendont nous exploitons les résultats, or cela s’est avéréimpossible, car cette information n’est quasimentjamais communiquée aux différents Services régionauxde l’Archéologie. Pour pallier cela, nous avons pris en considération l’ensemble des communes où uneoccurrence de gisement est signalée, en limitanttoutefois notre sélection aux territoires communaux
Fig. 1 – Effectifs des communes concernées par l’analyse selonles départements et les secteurs concernés.
Fichier éditeur destiné à un usage privé
Les données CORINE Land Cover ont été mises à profit de la même manière que pour nos travauxprécédents (Kerdivel 2012a, tableau 3, p. 27) ; le seul inconvénient de ces données étant le seuil de 25 ha de la plus petite unité cartographiée. Nousdistinguons trois classes de terrain : les prospecta-bles, les potentiellement prospectables et les nonprospectables ; dont la proportion entre secteursétudiés s’avère différentielle (fig. 4A). Les terrainsprospectables permettent la prospection au sol etaérienne. Ainsi, pour le secteur nord, 60% des terrainssont potentiellement ou nettement prospectables,alors que ce taux atteint 80 % pour le secteur sud.Cette différence induit un déséquilibre en faveur dusecteur sud pour la prospection aérienne. Il importedonc de prendre en compte cette information lors del’interprétation des résultats.
Les données pédologiques de la base SISE sontemployées non pas pour leurs informations pédolo-giques, mais pour les données qu’elles recensent
276
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
A
B
Fig. 4 – Histogrammes cumulésprésentant pour chaque secteur étudiéles superficies cumulées des terrains
selon leur prospectabilité (A) et selonla nature du substrat (B)
(DAO : G. Kerdivel).
Fig. 3 – Effectifs des communes concernées par l’analyseselon les départements et les secteurs concernés.
Fichier éditeur destiné à un usage privé
Autre spécificité, le comblement progressif du Maraispoitevin depuis le Néolithique a dû contribuer à la disparition de plusieurs enceintes néolithiques ;celle de Boube à Saint-George-de-Didonne (Charente-Maritime) en est une bonne illustration. Nousinvitons donc le lecteur à garder en mémoire cettesituation. Nous verrons plus loin que ce biaisn’impacte guère la validité de la démarche et qu’il ne fait qu’en renforcer les résultats.
Les principaux types d’indices de sites fossoyés,toutes périodes confondues, pris en compte sont aunombre de trois après traitement : enclos, enceinteset fossés. Il y en a 1 265 dans le secteur nord et 1 436dans le secteur sud, soit des effectifs largementcomparables. Il faut noter l’existence de plusieurseffets de grappes dans les deux secteurs étudiés (fig. 2) qui ne seront pas analysés ici, bien qu’ilspermettent de soupçonner un biais spécifique encoreindéterminé, influençant les lieux de découverte destructures fossoyées.
B.2 Analyses et résultats
Afin de répondre à la question de la réalitéarchéologique de la concentration des enceintesnéolithiques dans le Centre-Ouest, nous avons menéune série d’analyses récurrentes pour chacun dessecteurs, en confrontant les données archéologiques à la nature de l’occupation du sol et à la nature du substrat, pour finalement comparer les résultats pour le Néolithique, d’une part, et les autres périodesprotohistorique et historique, d’autre part.
L’ensemble des indices de sites fossoyés décou-verts en prospection aérienne se distribue sur desterrains majoritairement prospectables ou plus oumoins prospectables à plus de 80 % dans les deuxsecteurs, atteignant plus de 95 % dans le secteur sud(fig. 5A). On observe donc qu’il y a un faible impactde la différence de capacité à la prospection desterrains sur la découverte d’indices de sites. Toutefois,près de 17 % des indices de sites du secteur nord ontété découverts sur des terrains non prospectables.Comment expliquer cette apparente contradiction de découverte de sites sur des terrains défavorables àla prospection ? Le seuil de 25 ha pour la plus petiteentité cartographiée est probablement à mettre encause, tout comme les décalages de dates de créationde la base CORINE Land Cover : ainsi, 6 sites sontsignalés en zones industrielles et commerciales et
Quelques remarques d’archéologie spatiale concernant la distribution géographique des enceintes néolithiques du Centre-Ouest de la France et des marges du Massif armoricain
sur le substrat [MAT1]. Il faut souligner ici l’échellede constitution de cette donnée (1/1 000 000) quiimplique immanquablement une forte imprécision et une perte des nuances locales. Toutefois, un fondsgéologique adapté (1/50 000) ne nous est pas encoredisponible, même si nous espérons résoudre ceproblème dans les années à venir. Sur ce problème de substrat, nous avons opté pour une distinctionbinaire : “fluide”/rocheux déjà proposée par le passé(Cassen, Scarre 1997). Ici, le substrat fluide renvoie à une roche-mère facile à creuser, au contraire d’unsubstrat rocheux. À partir des données SISE, nousavons classé les substrats reconnus sur cette base.Ainsi, les substrats rocheux reconnus ne sont que dedeux types (grès et granite), alors que les substrats“fluides” sont plus nombreux : alluvions, terrasses,calcaires divers, marnes, craies, schistes, etc. (fig. 3).Le secteur nord est donc le seul à recouper un sub-strat “rocheux” (577 km²) et un substrat “fluide” (4 097 km² ; fig. 4B). Le secteur sud ne recoupe quedu substrat fluide sur 4 633 km², les 24 km² perduscorrespondant à des surfaces où l’information n’estpas disponible en raison d’une mauvaise correspon-dance entre les jeux de données.
b. Les données archéologiques
Pour le secteur nord, nous nous sommes tournéessentiellement vers les travaux de G. Leroux (Inrap),mais aussi vers ceux de quelques-autres : P. Péridy, A. Braguier (bénévoles), etc. Pour le secteur sud, lesintervenants en prospection aérienne sont tout aussinombreux : J. Dassié (bénévole) ; M. Marsac (SRANantes).
Nous sommes parti des données de la basePATRIARCHE, en demandant spécifiquement lesentités archéologiques correspondant à des struc-tures fossoyées quelles que soient leurs datations(préhistorique, protohistorique ou historique) pourl’ensemble de la région des Pays de la Loire et dudépartement de Charente-Maritime. Parmi les donnéeslivrées étaient mentionnées les circonstances de ladécouverte, ce qui a permis de ne retenir que lesdonnées provenant de la prospection aérienne oud’une photo-interprétation. Il faut reconnaître unbiais à ce travail, résidant dans le décalage entre lesdonnées des Pays de la Loire établies à partir de la base PATRIARCHE (état 2012) et celles pour laCharente-Maritime (état 2007). Cela induit quecertains sites néolithiques ont largement été vérifiés,comme en Charente-Maritime, mais pas les autres.
277
Fichier éditeur destiné à un usage privé
278
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
A
B
B
A
Fig. 5 – Histogrammes cumulésprésentant pour chaque secteurétudié les effectifs cumulés des
structures fossoyées toutes périodesrecensées selon la prospectabilité des
terrains (A) et selon la nature dusubstrat sous-jacent (B) (DAO : G. Kerdivel).
Fig. 6 – Graphique de secteursprésentant les proportions et les
effectifs de structures fossoyées selonqu’elles sont attribuées au Néolithique
ou à une autre période (A) ethistogrammes cumulés présentant les
proportions et les effectifs de structuresfossoyées selon qu’elles sont attribuéesau Néolithique ou à une autre période
selon les secteurs étudiés (B) (DAO : G. Kerdivel).
Fichier éditeur destiné à un usage privé
C. Éléments de caractérisation de larépartition des enceintes aux margesdu Massif armoricain
C.1 État documentaire et distribution spatiale desgisements considérés
L’espace documenté pris en considération réunitneuf départements entiers (Manche, Calvados, Orne,Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres et Vienne) et deux tronqués (Charente etCharente-Maritime), soit un espace s’étendant de laManche au fleuve Charente et situé à la fois sur le Massif armoricain et sur les Bassins parisien etaquitain.
a. État documentaire
Les sites ceinturés sont au nombre de 267 aprèsun dépouillement bibliographique général, augmentéde celui des travaux récents. Il est difficile d’envisagerde les présenter tous exhaustivement (pour de plusamples explications, cf. Kerdivel 2012a).
Une bonne majorité d’entre eux (n = 188, soit70,4 %) ne peuvent pas être datés précisément d’unedes phases du Néolithique, s’il s’agit d’ailleurs biende sites néolithiques ! En effet, ces sites ont une attri-bution chronologique fondée sur une comparaisontypo-morphologique des plans d’enceintes (fossésinterrompus et parallèles) ou au mieux sur l’existenced’un rare mobilier datable du Néolithique, découvertfortuitement dans leur enceinte, ce qui ne constituepas vraiment des éléments de datation convaincants.
Pour le Néolithique moyen (4300-3800 av. J.-C.),nous avons retenu 12 sites (14% des gisements datés)dont 5 incertains, ceux déjà présentés (ibid.), auxquelsnous pouvons ajouter celui du Castel/Cap de Carteretà Barneville-Carteret (Manche ; Billard et al., cevolume, p. 29).
Ce colloque est l’occasion pour nous de tenter une approche plus précise en distinguant les deux dernières phases du Néolithique, récente etfinale. Ainsi, avec 56 enceintes, le Néolithique récent(3800-3000 av. J.-C.) est l’étape qui voit ce phéno-mène augmenter le plus fortement (64 %). Il fautnoter que deux d’entre elles ont été occupées au cours de l’étape précédente avec plus ou moins decertitudes ; celle de La Prée Noire au Bernard (Vendée ;Rousseau 2000) et celle des Loups à Échiré (Deux-
Quelques remarques d’archéologie spatiale concernant la distribution géographique des enceintes néolithiques du Centre-Ouest de la France et des marges du Massif armoricain
peuvent avoir été vus sur des zones enherbées avantleurs constructions … Le problème est sûrementcomparable pour les sites en prairies (n = 202) ou envergers (n = 2). Par ailleurs, certaines localisations de sites n’ont pas pu être vérifiées à l’occasion de cet article (et encore moins celles des sites nonnéolithiques), or il est évident que certaines erreursperdurent aussi dans la base PATRIARCHE.
Si on s’intéresse maintenant aux substrats, onconstate que l’essentiel des indices de sites fossoyés a été découvert sur des substrats “fluides” (fig. 5B) ;seuls 6 d’entre eux sont inscrits sur un substratrocheux. Ce résultat reflète bien le choix que nousavons fait pour définir les secteurs analysés (cf. plushaut). Cela permet d’établir nettement que la fluiditédu substrat ne pourra pas être mise en cause quant à la présence ou l’absence d’enceintes néolithiques,puisque les substrats dits problématiques ont étévolontairement écartés de l’analyse.
Si on en vient maintenant à l’analyse propre-ment dite, on observe d’abord la très faible part dessites néolithiques (n = 100) par rapport aux sitesfossoyés datés des autres périodes (n = 2601 ; fig. 6A).Toutefois, les résultats apparaissent plus flagrantsquand on observe la ventilation par secteur (fig. 6B).En effet, les enceintes attribuables au Néolithiquedans le secteur nord ne sont qu’au nombre de 3 contre97 dans le secteur sud, alors que le nombre d’indicesde sites fossoyés d’autres périodes chronologiques estsensiblement équivalent. De tels résultats apparais-sent suffisamment signifiants sans avoir à recourir àdes tests statistiques plus complexes (Chi²). Commenous l’avons vu, la fluidité du substrat ne peut pasêtre mise en cause ni, d’ailleurs, la nature de l’occupa-tion des sols.
Cela permet, selon nous, d’attester sans ambiguïtéla réalité historique du phénomène des enceintes quise développe plus largement dans le Centre-Ouest aucours du Néolithique récent.
279
Fichier éditeur destiné à un usage privé
280
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Fig. 7 – Cartes de distribution des enceintes selon l’étape duNéolithique considérée avec les enceintes datées du Néolithique latosensu (CAO et DAO : G. Kerdivel).Basly La Campagne (14) construite et occupée au Néolithique final ; Mondeville ZAC du MIR (14) construite et occupée auNéolithique final ; Saint-Martin-de-Fontenay Le Diguet (14) construite et occupée au Néolithique moyen ; Soumont-Saint-Quentin Le Mont-Joly (14) construite et occupée au Néolithique moyen (incertaine) ; Chenommet Les Grands Champs (16)construite et occupée au Néolithique récent ; Merignac Le Cluseau (16) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ;Authon-Ébéon Chemin de Saint-Jean (17) construite et occupée au Néolithique récent ; Benon La Fontaine Miraculeuse (17)construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Blanzac-les-Matha Fief Conteau (17) construite et occupée auNéolithique récent (incertaine) ; Courçon d’Aunis Les Pieds de Cresse (17) construite et occupée au Néolithique récent ; Dolus-d’Oléron La Perroche (17) construite et occupée au Néolithique final ; La Brée-les-Bains Pointe des Boulassiers (17) construiteet occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Landrais Les Cordons ou le Gué Viaud (17) construite et occupée au Néolithiquerécent (incertaine) ; Landrais le Gué Charreau ou Marais de Chabon (17) construite et occupée au Néolithique récent ; LongèvesL’Angle (17) construite et occupée au Néolithique récent ; Longèves Pied-Lizet I (17) construite et occupée au Néolithique final(incertaine) ; Lozay Le Tablier (17) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Marans La Grande Bastille (17)construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Nuaillé-d’Aunis La Mastine (17) construite et occupée au Néolithiquerécent ; Saint-Georges-d’Oléron Ponthezières (17) construite et occupée au Néolithique final ; Saint-Laurent-de-la-Prée LeVillage/Sondages 1 et 4 (17) construite et occupée au Néolithique récent ; Saint-Séverin-sur-Boutonne Le Châtellier (17)construite et occupée au Néolithique final ; Surgères Cornet (17) construite et occupée au Néolithique moyen (incertaine) ;Taillebourg Domaine de la Brossardière (17) construite et occupée au Néolithique final (incertaine) ; Tonnay-Charente 7, ruePierre Berne (17) construite et occupée au Néolithique final ; Villedoux L’enceinte du Rocher (17) construite et occupée auNéolithique récent ; Distré Les Murailles 2 (49) construite et occupée au Néolithique moyen ; Seiches-sur-le-Loir Matheflon(49) construite et occupée au Néolithique récent ; Barneville-Carteret Le Castel/Cap de Carteret (50) construite et occupée auNéolithique moyen ; Goulet Site 7 (61) construite et occupée au Néolithique moyen ; Juigné-sur-Sarthe La Croix Sainte-Anne(72) construite et occupée au Néolithique moyen ; Airvault Les Fourneaux ou Repéroux (79) construite et occupée auNéolithique récent (incertaine) ; Brioux-sur-Boutonne Virollet (79) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ;Coulon Le Coteau de Montigné (79) construite et occupée au Néolithique récent, puis au Néolithique final ; Échiré Les Loups(79) peut-être construite au Néolithique moyen, développée et occupée au Néolithique récent ; François Coteau du Breuil (79)construite et occupée au Néolithique récent ; Frontenay-Rohan-Rohan Le Champ Fiard (79) construite et occupée au Néolithiquerécent (incertaine) ; Marnes Le Chafaud (79) construite et occupée au Néolithique moyen (incertaine) ; Niort La Rousille/Létrin(79) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine), puis au Néolithique final ; Prin-Deyrancon Terre de Claigne(79) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Saint-Généroux Le Clos du Logis (79) construite et occupée auNéolithique final ; Saint-Hilaire-la-Palud Prairie de Saint-Hilaire (79) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ;Saint-Maxire Le Haut de Croisette (79) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Saint-Maxire Le Parc (79)construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Saint-Maxire La Tourniote (79) construite et occupée au Néolithiquerécent (incertaine) ; Taizé Les Châteliers (Maulais) (79) construite et occupée au Néolithique final ; Thorigné Les Forgettes(79) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Thouars Fertevault (79) construite et occupée au Néolithiquerécent (incertaine) ; Villiers-en-Plaine Bellevue ou les Sablières (79) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ;Vouillé Les Champs Rouges (79) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Vouillé La Pommeraie (79) construiteet occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Auzay Éperon des Châtelliers du Vieil-Auzay (85) construite et occupée auNéolithique récent ; Avrillé Rue des Menhirs (85) construite et occupée au Néolithique final ; Chaillé-les-Marais rue des Venelles(85) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Lairoux Jauger (85) construite et occupée au Néolithique récent(incertaine) ; Landevieille La Gaubretière 2 (85) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Le Bernard La PréeNoire (85) construite et occupée au Néolithique moyen, puis au Néolithique récent ; Le Gué-de-Velluire Le Haut du Tertre(85) construite et occupée au Néolithique final ; Le Langon La Caboge III (85) construite et occupée au Néolithique récent(incertaine) ; Les Magnils-Reigniers Le Jardinet (85) construite et occupée au Néolithique récent, puis au Néolithique final ;L’Île-d’Yeu Pointe de la Tranche (85) construite et occupée au Néolithique récent ; L’Île-d’Yeu Pointe de Ker Daniaud (85)construite et occupée au Néolithique récent ; Maillezais Abbaye Saint-Pierre (85) construite et occupée au Néolithique récent ;Mareuil-sur-Lay-Dissais Camp de l’Ouche du Fort (85) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Mouzeuil-Saint-Martin Pijouet (85) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Nieul-sur-l’Autise Champ-Durand (85)construite et occupée au Néolithique récent ; Saint-Benoist-sur-Mer Les Groix (85) construite et occupée au Néolithique récent ;Saint-Gervais Le Priaureau (85) construite et occupée au Néolithique récent ; Saint-Mathurin La Chevêtelière (85) construiteet occupée au Néolithique récent, puis au Néolithique final ; Talmont-Saint-Hilaire Les Viollières (85) construite et occupée auNéolithique récent ; Vix Maison de la Chaume (85) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Antran La CroixVerte (86) construite et occupée au Néolithique final ; Antran La Croix Verte (86) construite et occupée au Néolithique moyen(incertaine) ; Aslonnes Camp Allaric (86) construite et occupée au Néolithique final ; Availles-en-Châtellerault Port à Chillou(86) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Beaumont La Tricherie (86) construite et occupée au Néolithiquefinal ; Chauvigny Plan Saint-Pierre (86) construite et occupée au Néolithique moyen ; Lesigny La Rabatelle (86) construite etoccupée au Néolithique récent, puis au Néolithique final ; Leugny Les Grandes Varennes (86) construite et occupée auNéolithique récent ; Migné-Auxances Temps Perdu (86) construite et occupée au Néolithique récent (incertaine) ; Saint-Georges-les-Baillargeaux Les Varennes (86) construite et occupée au Néolithique récent ; Vouillé Les Chavis (86) construite et occupéeau Néolithique final.
Fichier éditeur destiné à un usage privé
phénomène fortement culturel, dont le point derencontre doit se trouver quelque part sur le littoralméridional de la Bretagne, où se mêlent réutilisationsde monuments funéraires, enceintes et constructionsde nouveaux monuments (Blanchard 2012).
Les enceintes semblent devenir moins nom-breuses au Néolithique final (fig. 7). En revanche, ellesse rencontrent au nord (Basly, Mondeville) commeau sud (Dolus-d’Oléron, Saint-Séverin-sur-Boutonne,etc.), avec toutefois un vaste secteur, l’ancienneprovince du Maine, où elles n’ont pas encore étéreconnues. Il faut ici souligner les fortes similitudesentre la carte de distribution du Néolithique moyenet celle du Néolithique final, avec des répartitions de points très comparables. Tout porte à croire que lephénomène ayant conduit à une émulation géné-ralisée dans le Centre-Ouest, avec la multiplicationd’enceintes, n’agit plus du tout au Néolithique final,où les formes de l’habitat semblent évoluer d’ailleurs,avec l’émergence du phénomène des grands bâtimentscollectifs. On notera que les cas de réoccupationsd’enceintes artenaciennes ou campaniformes se multi-plient sans pour autant que l’aspect ceinturé du siteait été la raison de cette réoccupation (Burnez 1996 ;Sicard et al. 2002 ; Joussaume 2012).
Ces cartes permettent déjà de dresser quelquesaxes pour une recherche future. À y regarder de plusprès, il est difficile d’envisager des sondages systé-matiques sur chacune des occurrences d’enceintes non datées. Toutefois, quelques-unes mériteraient uneexploration ponctuelle, notamment les enceintessarthoises, comme celles de Neuvy-en-Champagne oude Rouessé-Fontaine, pour lesquelles la répartitionrenvoie à ce que l’on connaît pour les enceintesnormandes du Néolithique moyen. Sur le Massifarmoricain, les enceintes des Mauges (sud-est duMaine-et-Loire), très regroupées dans la vallée del’Èvre et ses affluents, mériteraient une attentionparticulière afin de confirmer d’abord leur datationet tenter ensuite d’expliquer les raisons de ce groupe-ment.
C.2 Analyses environnementales
Afin de dégager des tendances caractéristiquesdans l’implantation de ces enceintes, nous avonschoisi de les corréler à divers éléments du paysage : le substrat géologique, la topographie, la proximité aux cours d’eau et les sols actuels. Il faut souligner icique ces corrélations se font par le biais d’approches
Quelques remarques d’archéologie spatiale concernant la distribution géographique des enceintes néolithiques du Centre-Ouest de la France et des marges du Massif armoricain
Sèvres ; Burnez 1996). Il faut toutefois noter que 25d’entre elles sont de datation incertaine, car elles n’ontpas fait l’objet d’interventions archéologiques autresque des prospections ou que les opérations archéo-logiques n’ont pas livré de mobilier caractéristique. Si on écarte le phénomène des grands bâtimentsenclos type Antran ou Beaumont, 19 sites (22%) sontdatables de l’étape finale du Néolithique (3000-2400av. J.-C.), dont huit sont occupés dès le Néolithiquerécent, par exemple le Coteau de Montigné à Coulon(Deux-Sèvres ; Large 1980), la Rousille à Niort (Deux-Sèvres ; Marsac 1993), le Jardinet aux Magnils-Reigniers(Vendée ; Sicard et al. 2002) et La Chevêtelière à Saint-Mathurin (Vendée ; Péridy 1999).
b. Distribution spatiale des enceintes
Les enceintes datables, avec plus ou moins decertitude, du Néolithique sont bien plus nombreusesau sud de la Loire qu’au nord et se concentrent très majoritairement sur les bassins secondaires ettertiaires, notamment dans le Thouarsais et le Centre-Ouest (fig. 7). Cela renvoie d’ailleurs à ce que l’on vaobserver pour chacune des étapes du Néolithique.
Au Néolithique moyen, les enceintes se distri-buent sur l’ensemble de l’aire étudiée, avec toutefoisquelques nuances (fig. 7) : elles se distribuent plusrégulièrement dans les parties sédimentaires au sudde la Loire, alors qu’au nord elles sont installées plutôtà l’interface entre le Massif armoricain et le Bassinparisien.
Au Néolithique récent, les enceintes se concen-trent au sud de la Loire dans le Centre-Ouest, le longdu littoral vendéen et les actuels Marais poitevin etmarais de Rochefort, ainsi que le long de certainscours d’eau, comme le Divet, la Charente ou la Vienne(fig. 7). Le seul cas reconnu au nord de la Loire estcelui de Matheflon à Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire). Cette distribution n’apparaît pas anodine etmérite que l’on s’y attarde. Nous avons déjà soulignéla complémentarité spatiale entre les phénomènesmonumentaux du Néolithique récent et final que sont les architectures funéraires nouvelles (alléescouvertes, allées sépulcrales et sépulture à entréelatérale) et les enceintes domestiques (Kerdivel2012a). Cela est encore renforcé par ces cartes où estdistinguée la phase récente de la phase finale duNéolithique, avec toujours l’Anjou comme zone pivot, à laquelle on peut ajouter le littoral avec l’îled’Yeu (fig. 8). Il semble donc qu’il faille y voir un
281
Fichier éditeur destiné à un usage privé
282
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
!
!
!
!!
!
!
!
! !!!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!
!
!!
!
!!
!! !!!!!! ! !!!!
!!!!
!!
!
!
! ! !!
!
!!!!!!
!
!
! !!!!!
!
! !!
!!!
!! ! !!
!
! !!
!!!
! !
0 50km
Secteur étudié
Massifs anciens
Hors étude
Interpolation (krigeage)Monumentalisme funéraire
Monumentalisme domestique
0 10050km
Gisements interpolés! Certain
! Incertain
Secteur étudié
Massifs anciens
Hors étude
82 % de certitude
?
Fig. 8 – Carte d’interpolation spatiale employant laméthode du krigeage des phénomènes monumentauxdu Néolithique récent : enceintes domestiques au sud etsites funéraires au nord (CAO et DAO : G. Kerdivel).
Fig. 9 – Histogrammes groupésprésentant les proportions de
densité d’enceintes selon l’étapedu Néolithique considérée etselon le substrat concerné,
extrait de la base SISE (DAO : G. Kerdivel).
Fichier éditeur destiné à un usage privé
classique fossé est remplacé par un talus dont lesmatériaux proviennent de ramassages sur l’estran oud’une extraction sur place à partir des affleurementsou des fronts de taille ouverts opportunément sur les falaises, selon des techniques connues depuis bien longtemps pour les monuments mégalithiques(cf. Blanchard, ce volume, p. 179). D’ailleurs, l’existenced’une structure fossoyée pour ceinturer l’espace n’estpas complétement exclue, comme cela a été reconnuà Groh-Collé à Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan ;Blanchard 2012 ; Blanchard, communication orale).L’enceinte de la Rue des Menhirs à Avrillé (Vendée ;Fromont, Forré 2011) n’est cependant pas confrontéeaux mêmes problématiques, puisqu’elle a été installéesur un substrat granitique altéré.
Si l’on s’intéresse maintenant aux substratssecondaires et tertiaires, on peut constater leur forteprédominance pour les trois phases considérées du Néolithique (successivement 75, 89 et 95 %). Siaucun type de substrat ne se dégage franchement au Néolithique moyen, cela n’est plus le cas à partirdu Néolithique récent, avec des enceintes construitesen majorité sur des calcaires : 73 % au Néolithiquerécent et 60 % au Néolithique final ; fait d’ailleursdéjà observé (Scarre 1982). Il faut aussi considérer la forte progression des enceintes installées sur desformations alluvionnaires anciennes ou plus récentesau Néolithique final, qui pourrait s’avérer être unfacteur culturel (25 %). C’est d’ailleurs le cas desenceintes artenaciennes les mieux connues que sontcelles de Ponthezières à Saint-Georges-d’Oléron et La Perroche à Dolus-d’Oléron (Charente-Maritime ;Laporte 2009).
Quelques remarques d’archéologie spatiale concernant la distribution géographique des enceintes néolithiques du Centre-Ouest de la France et des marges du Massif armoricain
géostatistiques, par phases du Néolithique. Or, l’effectifde gisements au Néolithique moyen ainsi qu’au finalest encore trop faible pour assurer des statistiquesincontestables. Nous proposons donc au lecteur delire ces résultats comme un appui à la réflexion. Parailleurs, nous ne nous attarderons pas sur la métho-dologie mise en œuvre pour ne pas trop alourdir cetarticle.
a. Distribution des gisements selon le substratgéologique
La répartition des enceintes selon le substratgéologique a été obtenue grâce à une jointure spatialeentre les données de la base SISE et notre base dedonnées de sites (fig. 9). Par la suite, nous avons eu à corriger au cas par cas certains résultats à partir dudépouillement des cartes géologiques via Infoterre ©compte tenu de l’imprécision de la base SISE.
Pour les gisements du Massif armoricain, onobserve qu’ils sont proportionnellement plus nom-breux au Néolithique moyen (25 %) qu’aux autresphases du Néolithique (respectivement 10 et 5 %).Nous avions avancé plus haut l’hypothèse d’unefluidité du substrat permettant plus facilement soncreusement. On constate que cela est très vraisem-blable pour le Néolithique moyen, avec une implanta-tion sur des substrats primaires lités de schistes, degrès ou de micaschistes. En revanche, au Néolithiquerécent, deux enceintes sont installées sur des substratsgranitiques ou assimilés, théoriquement plus difficilesà décaisser. Il s’agit en l’occurrence des deux sites de l’île d’Yeu (Vendée), où, comme en Bretagne, le
283
Fig. 10 – Histogrammes cumulésdes positions topographiques desenceintes selon l’étape duNéolithique considérée (DAO : G. Kerdivel).
Fichier éditeur destiné à un usage privé
b. Position topographique des enceintes
Il est apparu plus pertinent de discuter de laposition topographique des sites dans leur environ-nement immédiat plutôt que de discuter, par exemple,de leur position NGF, trop tributaire de la situa-tion géographique. Pour ce faire, cette position a étédéterminée selon trois classes (haute, médiane etbasse) en dépouillant les cartes topographiques et enprojetant les points sur la BDALTI © de l’IGN (fig. 8).Toutefois, des méthodes géomatiques plus rigoureusessont en cours de développement afin de supprimerl’effet subjectif que peut produire cette méthode(Kerdivel 2012a).
Au Néolithique moyen, la majorité des enceintesse situent en position haute (66,7 %), atteignant 75% si on les cumule avec celles en position médiane.En même temps, un quart d’entre elles se situe enposition basse et renvoie aux enceintes de plaines ou de terrasses alluviales déjà signalées (Joussaume,Pautreau 1990). Il faut peut-être y voir des fonctionsdifférentes selon les cas.
Au Néolithique récent, la tendance à la positionélevée se renforce, atteignant 89,3 % des enceintes, si l’on cumule positions basse et médiane. Il fauttoutefois noter que cette dernière position topogra-phique est très prisée par les bâtisseurs d’enceintes duNéolithique récent, ce qui reste encore à interpréter :proximité d’un substrat adéquat pour les matériaux,etc.
Au Néolithique final, 95% des enceintes adoptentune position élevée, ce qui exprime le renforcementde la tendance amorcée déjà au Néolithique moyen.
c. Proximité des enceintes par rapport au réseauhydrographique
Pour ces analyses, nous avons utilisé le fonds BDCarthage © et attribué une distance entre le point
centroïde de l’enceinte et le cours d’eau. Dans le casd’enceintes vastes, une méthode plus adaptée quiprenne en compte les surfaces sera à développer dansun avenir proche.
Comme nous l’avons déjà signalé, le réseauhydrographique est bien plus dense sur le Massifarmoricain que sur les Bassins parisien et aquitain(fig. 11 ; Kerdivel 2012a). Ainsi, pour 500 points aléa-toirement répartis sur le secteur étudié, la distancemoyenne à un cours d’eau est très variable selon sasituation géologique : 351m sur le Massif armoricain,692 m pour les Bassins parisien et aquitain. Cesrésultats constituent les distances étalons. Concernantces distances moyennes, nous proposons aussi lesécarts-types concernés, qu’il faut interpréter selon leur situation à la moyenne : s’ils sont inférieurs, les effectifs de distances sont homogènes ; s’ils sontsupérieurs, ils sont hétérogènes. Dans le cas de nosdistances étalons, l’écart-type pour les effectifs dedistances sur les bassins secondaires et tertiairess’avère supérieur à la distance moyenne, ce qui estsystématique pour les écarts-types obtenus parailleurs. En fait, ils montrent systématiquement desvaleurs plus élevées que les moyennes obtenues, ce que nous pouvons attribuer à l’hétérogénéité despaysages de ces secteurs, où les grandes plaines, plusspécifiquement jurassiques (Plaine de Caen, Vienne,etc.), montrent des réseaux hydrographiques encoreplus distants que les autres zones secondaires ettertiaires.
On observe ainsi que les enceintes du Néolithiquemoyen du Massif armoricain, si l’on exclut l’enceintedu Castel à Barneville-Carteret (Manche), sont enmoyenne à 220 m d’un cours d’eau et celles sur les bassins secondaires et tertiaires à 282 m, soit bien au-dessous de nos distances étalons. Il sembledonc y avoir une réelle relation entre enceinte duNéolithique moyen et cours d’eau. Le cas du Castel, à 882 m du cours d’eau le plus proche, démontre,
284
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Fig. 11 – Distances moyennes et écarts-types correspondant entre les centroïdes des enceintes et les cours d’eau les plus proches.
Fichier éditeur destiné à un usage privé
nombreuses sur ces bassins (par exemple la vallée des Maléons à Nieul-sur-l’Autise ; Joussaume 2012) etdont on ne sait pas réellement si elles ont été en eauxou non au cours de l’Holocène.
Au Néolithique final, les deux enceintes connuessur le Massif armoricain, situées en Vendée, se trou-vent entre 180 et 223 m d’un cours d’eau, c’est-à-direplus proches que pour notre distance étalon. C’estd’ailleurs la même tendance de rapprochement aucours d’eau que l’on observe sur les bassins secon-daires et tertiaires, avec des enceintes à 442 m enmoyenne d’un cours d’eau pour une distance étalonde 692 m.
d. Sols actuels et enceintes
Afin d’observer la relation entre les sols actuels et les enceintes, nous nous sommes tourné vers la base IGCS de Poitou-Charentes déjà disponible et traitée, ce qui implique qu’un grand nombred’enceintes datées et considérées ici sont exclues del’analyse ; seules restent 5 enceintes du Néolithiquemoyen, 38 enceintes du Néolithique récent et 13 duNéolithique final. Les critères pouvant être observéssont la profondeur, l’hydromorphie, la texture,l’acidité et l’indice d’exploitabilité des sols (Kerdivel2012a). De tous ces critères, les plus pertinents àdiscuter ici sont les trois derniers présentés dans cetordre afin de permettre de pondérer les résultats dela texture. En effet, les autres sont probablement lesplus délicats à prendre en considération tant le risquede modification structurelle est grande, puisquel’hydromorphie a pu évolué depuis le Néolithique, de même que la profondeur des sols, soumis à uneprobable érosion dans plusieurs cas.
Méthodologiquement, nous avons généré unbuffer de 2 500 m de rayon (soit 19,63 km²) autourde chaque enceinte et défalqué, si nécessaire, les zonesnon documentées hors la région Poitou-Charentes. Demême, nous avons retranché de la surface du bufferles zones anthropisées, artificielles ou de formationsrécentes. Par la suite, nous avons calculé la surface detel ou tel critère au sein de ce buffer. Pour chaquecritère, la surface cumulée a été observée et trans-formée en pourcentage par rapport à la superficiecumulée des buffers. Ainsi, les résultats sont présentéssous la forme de graphiques par période.
Il faut préciser que les enceintes se concentrentsur un substrat calcaire jurassique, formant le socled’un sol aux qualités agricoles bien reconnues,
Quelques remarques d’archéologie spatiale concernant la distribution géographique des enceintes néolithiques du Centre-Ouest de la France et des marges du Massif armoricain
s’il en était besoin, que les Néolithiques ont dûprivilégier d’autres critères d’implantation.
Comme pour la position géologique des enceintes,la relation de celles-ci aux cours d’eau change radica-lement au Néolithique récent, puisqu’on observe,alors, un éloignement généralisé. Ainsi, sur le Massifarmoricain, les six sites se trouvent à 8 km enmoyenne d’un cours d’eau ! Ce résultat est dû auxdeux sites de l’île d’Yeu, qui se distingue de nouveauet sur laquelle il n’existe pas de cours d’eau recenséssur BD Carthage, ce qui semble être un problèmeprégnant sur l’île (Chiron 2007). Toutefois, la situationest similaire sur les îles bretonnes (Groix, etc.) ou surcertaines presqu’îles (Groh-Collé). Si on écarte ducalcul les sites îliens, on constate que les enceintes sesituent à 454m en moyenne d’un cours d’eau, c’est-à-dire qu’elles en sont plus éloignées si l’on considèrenotre distance étalon pour le Massif armoricain … Onobserve un phénomène similaire avec les enceintessur les bassins secondaires et tertiaires. Ici, elless’installent à 674m d’un cours d’eau, soit une distanceproche de notre étalon (692 m), s’éloignant nette-ment des résultats obtenus pour le Néolithique moyen.Or, l’écart-type associé à cette moyenne (1 215 m) esttrès élevé et démontre une forte hétérogénéité dansles résultats. Les enceintes semblent donc s’éloigner des cours d’eau, de manière toute relative cependant ;les distances restant courtes : un homme pouvantraisonnablement faire l’aller-retour en une demi-heure quand l’eau se trouve à un kilomètre ! En outre,des solutions de captage d’eau sont parfaitementenvisageables : ainsi, le site de l’Étoile à Mondeville(Calvados) a livré une structure interprétée commeun puits, datée de cette étape du Néolithique(Chancerel et al. 2006). Il faut aussi garder à l’espritque le Marais poitevin influe partiellement sur cesrésultats, sans qu’il soit possible d’estimer réellementdans quelle mesure. Les travaux de N. Weber ontconduit à proposer une carte des chenaux et valléesincisées sur les côtes charentaises et sous le Maraispoitevin, mais celles-ci n’ont pas été conservées sousun format actuellement exploitable sous SIG (Weber2004 ; Weber, communication orale).
La surprise pour le Néolithique récent vientfinalement de l’écart-type obtenu sur les distances pourles enceintes des bassins secondaires et tertiaires …Ce dernier semble démontrer que la proximité aucours d’eau n’est pas un critère fortement discri-minant dans le choix d’implantation des enceintes au Néolithique récent. Toutefois, il nous faudravérifier à l’avenir la proximité avec les vallées sèches,
285
Fichier éditeur destiné à un usage privé
puisqu’il s’agit largement de terres franches (69 %),neutres (77 %), faiblement hydromorphes (56 %) etsuffisamment profondes pour permettre le dévelop-pement racinaire des plantes (58 % ; Ibid.).
Ainsi, en considérant en premier lieu la texturedes différents sols observés dans l’environnement des sites (fig. 12), on constate plusieurs phénomènes :l’augmentation progressive, mais lente, des surfacesde sols “lourds” très argileux dans l’environnementproche des enceintes passant de 3 à 7, puis 8 % et lephénomène de “flux-reflux” des surfaces de terresfranches avec une présence plus importante de ces dernières dans le périmètre des enceintes duNéolithique récent. Cela pourrait s’interpréter commeun phénomène culturel lié à des sites domestiques où se pratique l’agriculture nécessitant des solséquilibrés, à moins que cela ne résulte d’un meilleuréchantillonnage statistique.
Si l’on s’intéresse à la question de l’acidité dessols, on observe une augmentation progressive, pourdes taux encore faibles, de la superficie de sols acidesdans le périmètre des enceintes. Celle-ci est d’ailleursrenforcée par l’augmentation plus forte des sols peu acides entre les phases récente et finale duNéolithique. Cela démontre, comme la multiplicationdes sols lourds, que les enceintes sont implantées dans des territoires de plus en plus hétérogènes,impliquant probablement des méthodes et des organi-sations de l’agriculture et de l’élevage plus variées.
Bien sûr, il reste la possibilité que ces deux carac-tères résultent de la dégradation progressive que cessols n’ont pas manqué de subir depuis le Néolithiqueen raison notamment de leur situation topogra-
phique. Toutefois, ce paramètre reste difficile à estimeren l’absence de travaux spécifiques.
De cette “hétérogénisation” progressive des sols rencontrés dans l’environnement des enceintesentre les phases moyenne et finale du Néolithique, on trouve un bon exemple au travers de l’indiced’exploitabilité des sols, où la part des indices 3 et 4va crescendo au cours du Néolithique, même s’il faut rester prudent quant à son emploi comme nousl’avons rappelé plus haut. Il n’en demeure pas moinsque la tendance est frappante.
D. Synthèse et perspectives
Il nous semble qu’il faille retenir en premier lieu que la concentration de sites ceinturés attribuésau Néolithique lato sensu, dans le Centre-Ouest, n’esten aucun cas un artefact de la recherche due àd’improbables zones plus prospectées que d’autres ou à des terrains facilitant leurs découvertes. Il semblebien s’agir d’une réalité archéologique, qu’il esttentant de dater plus spécifiquement du Néolithiquerécent, bien qu’il faille rester prudent sur ce point. Àpartir de là, un tel phénomène apparaît résolumentculturel, avec des groupes humains préférant des sitesceinturés et pour lesquels les habitats “ouverts” sontencore rares (Bel Air aux Herbiers, Vendée, Hinguant,2000 ; Ors à Château-d’Oléron, Charente-Maritime,Cassen 1987).
Si la question a pu longtemps faire débat, plusprobablement pour de mauvaises que de bonnesraisons, il est maintenant avéré que les sites ceinturés
286
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Fig. 12 – Histogrammes cumulés des superficies de sols dans l’environnement des enceintes (buffer de 2,5 km de rayon) selon l’étapedu Néolithique considérée : A. Texture ; B. Acidité ; C. Indice d’exploitabilité des sols (DAO : G. Kerdivel).
A B C
Fichier éditeur destiné à un usage privé
cette phase. Ces deux derniers éléments fonctionnentassez bien avec l’idée de sites voués (au moins partiel-lement) à l’agriculture et/ou à l’élevage. Toutefois, lechoix de positions topographiques plutôt élevées pour l’installation de ces sites tend à démontrer unattrait particulier pour une telle situation, éminem-ment stratégique, même si l’existence d’enceintes deterrasses renvoie à des situations similaires issuesd’autres contextes (Beeching et al. 2000). Cet attrait a d’ailleurs ponctuellement conduit les populations à privilégier une installation sur des formationsgéologiques primaires marquant le paysage (Soumont-Saint-Quentin, Calvados, Edeine 1970 ; Juigné-sur-Sarthe, Sarthe, George, Kerdivel 2012). Le casparticulier de l’enceinte de Barneville-Carteret est à relier à sa position littorale, déjà partiellementeffective au moment de son occupation.
Au Néolithique récent, les sites ceinturés semultiplient et permettent une discussion sur des basesstatistiques plus assurées. Ceux-ci sont implantésessentiellement sur des substrats calcaires, d’ailleursles substrats secondaires et tertiaires dominenttoujours, malgré une progression certaine sur leMassif armoricain. Dans le secteur étudié, il faut noterici les premiers cas (île d’Yeu) d’enceintes installéessur des substrats nécessitant de mettre en œuvre desméthodes d’extraction de blocs plutôt connues pourl’architecture mégalithique que pour les habitats,remplaçant par là le fossé par un talus. Si les sitesceinturés s’installent sur des substrats où se dévelop-pent des sols propices à l’agriculture, on observetoutefois une légère “détérioration” de la qualité dessols environnant les enceintes. Cela permet d’envisagerdes pratiques agro-pastorales plus diversifiées ou desfonctions radicalement autres. En effet, il faut noterl’éloignement de ces enceintes par rapport aux coursd’eau, phénomène d’ailleurs général au Néolithiquerécent/final à mettre en relation avec une probableaugmentation démographique (Kerdivel 2012b).Toutefois, en contexte insulaire ou littoral, lesenceintes n’ont pas d’approvisionnement continu en eau courante. L’occupation des enceintes doitnécessairement s’envisager ponctuellement avecl’apport depuis le continent de plusieurs ressources(bois, etc.) ou des systèmes de captage d’eau. Sur lesplateaux calcaires, la proximité des enceintes aveccertaines vallées sèches, pour profiter d’un reliefmarqué, a peut-être pu être un critère plus discri-minant que la proximité au cours d’eau, mais cettehypothèse sera à vérifier dans l’avenir. En effet, undéplacement des sites ceinturés vers des positions
Quelques remarques d’archéologie spatiale concernant la distribution géographique des enceintes néolithiques du Centre-Ouest de la France et des marges du Massif armoricain
sont des sites “domestiques”. Il reste maintenant àpréciser ce que l’on entend par ce terme, les enceintesayant pu être autant des lieux de rassemblementponctuels pour un groupe humain, comme les sitesde terrasses rhodaniennes (Beeching et al. 2000), quedes sites d’habitat ancrés (au sens d’A. Whittle 2001)ou encore que des sites logistiques occupés épisodi-quement (Blanchard 2012). Pour aller plus loin danscette réflexion, il importe de prendre en comptel’ensemble des critères disponibles, tant dans lasphère domestique (architecture, culture matérielle)que funéraire. Or, l’objectif ici est avant tout d’établirun état des lieux et des perspectives pour la rechercheportant sur ces sites ceinturés. Nous proposons doncplutôt de renvoyer le lecteur à des travaux de synthèseintégrant la dimension spatiale et offrant justementune réflexion sur ces questions (Laporte 2009 ;Kerdivel 2012a ; Blanchard 2012).
Nous souhaitons aussi souligner l’impérieusenécessité d’interroger les enceintes, phénomènemonumental de la sphère domestique, au regard des architectures funéraires monumentales (alléescouvertes, allées sépulcrales ou sépultures à entréelatérale) construites justement au moment de lamultiplication des premières dans le Centre-Ouest, auNéolithique récent. En l’état des données disponibles,vues depuis les marges du Massif armoricain, leursdistributions spatiales s’excluent mutuellement etsont complémentaires. Toutefois, la rencontre de cesphénomènes monumentaux se fait justement dans la péninsule armoricaine et méritera une attentionparticulière à l’avenir. À ce propos, les travaux encours sur l’île d’Yeu (Vendée) verseront sûrement denouveaux éléments pour expliquer la cohabitation de ces phénomènes, qu’il faudra considérer toutefoisavec prudence compte tenu des spécificités propres au contexte insulaire (travaux en cours d’A. Blanchardet d’A. Chauviteau).
Au Néolithique moyen, malgré un biais lié aufaible nombre d’individus, les enceintes se répartissentde manière différente entre le nord et le sud de laLoire. On observe ainsi qu’aucun substrat géolo-gique spécifique n’apparaît réellement discriminant,si ce n’est une préférence (générale durant toute lapériode) pour les substrats secondaires et tertiaires. À peine peut-on évoquer un relatif attrait pour dessols de bonne qualité agricole (terres franches, aciditélimitée), au moins d’après les observations faites surla seule région Poitou-Charentes. Il faut aussi noterque les sites ceinturés apparaissent particulièrementdépendants de la proximité d’un cours d’eau durant
287
Fichier éditeur destiné à un usage privé
plutôt dominantes (haute et médiane) est indéniableet participe au caractère ostentatoire de ces architec-tures. En revanche, il faut noter une légère diversifica-tion des positions topographiques avec une part plusimportante des positions médianes et une diminutiondes sites en position basse. Cette situation est peut-être à mettre au crédit du Marais poitevin, dont lamise en place a pu effacer quelques sites. Cette diver-sification probable des positions topographiquess’explique peut-être par une multiplication de statutsdifférentiels ou de fonctions différentes pour ces sites.
Au Néolithique final, l’explosion du nombred’enceintes dans le Centre-Ouest retombe, mais onnote un retour à la construction d’enceintes danscertains secteurs, où ces architectures domestiquesétaient parfois absentes (Normandie). L’effectif posed’ailleurs quelques difficultés pour asseoir les obser-vations. Les sites privilégient encore les substratssecondaires, avec toutefois une augmentation de lafréquentation des formations récentes, type terrassesanciennes, marais maritimes en formation, etc.D’ailleurs on constate, en parallèle, une accentuation de la “dégradation” des sols environnant les sites avec une diminution des terres franches et uneaugmentation des sols lourds, battants ou séchants,ainsi qu’une légère tendance à se rapprocher des cours d’eau par rapport à ce que l’on observait auNéolithique récent, fait cependant plus marqué sur le Massif armoricain. Le choix d’une positiontopographique élevée se renforce encore une fois.Tout porte à croire qu’une rupture forte interviententre le Néolithique récent et le Néolithique final,avec des populations repliées sur leur territoire, bienqu’elles soient intégrées à des réseaux d’échanges pourquelques éléments de la culture matérielle (Laporte2009).
E. Conclusion
Pour conclure, nous pensons avoir proposé une méthode permettant d’asseoir définitivement laspécificité du Centre-Ouest pour ce qui est du nombred’enceintes reconnues. Il est maintenant temps de se concentrer sur les raisons qui expliquent cettedifférence. Certaines ont d’ailleurs déjà été avancées,par exemple la production de sel.
Nous avons proposé quelques tendances dansl’implantation de ces sites par rapport à différentscritères environnementaux (géologie, hydrographie,
topographie, pédologie) permettant une lecture de ladynamique spatiale concernant les seules enceintessur une période de plus de 1 500 ans. Il faut cependantreplacer cette forme d’occupation de l’espace avec les autres reconnues en intégrant mieux le phasagerécent/final comme nous venons de le faire pour les enceintes (Kerdivel 2012b). De même, il reste àmodéliser plus précisément ces résultats en prenanten compte l’ensemble des éléments de la culturematérielle, afin de replacer les populations occupantces enceintes dans des réseaux plus larges et ainsimieux définir l’organisation de ces sociétés humaines(Blanchard 2012). De même, des pistes de recherchefuture pour améliorer notre connaissance de cesphénomènes ont été ébauchées, passant inévitable-ment par l’investissement de territoires encore peuexplorés, comme le Maine-Anjou, par exemple.
Remerciements
L’auteur souhaite remercier pour leurs relectures attentivesÉric Burgaud, Josiane Ducoin et Jean-Noël Guyodo(Université de Nantes).
Bibliographie
Beeching et al. 2000 : BEECHING (A.), BERGER (J.-F.),BROCHIER (J.-L.), FERBER (F.), HELMER (D.), SIDIMAAMAR (H.) – Chasséens : agriculteurs ou éleveurs,sédentaires ou nomades ? Quels types de milieux, d’éco-nomies et de sociétés ? In : LEDUC (M.), VALDEYRON(N.), VAQUER (J.) dir. – Sociétés et espaces : actualités dela recherche. Actes de la 3e Rencontre Méridionale dePréhistoire Récente, Toulouse (6-7 novembre 1998),Archives d’Écologie Préhistorique, Toulouse, 2000, p. 59-79.
Blanchard 2012 : BLANCHARD (A.) – Le Néolithiquerécent de l’Ouest de la France (IVe - IIIe millénaires avantJ.-C.) : productions et dynamiques culturelles. Thèse dedoctorat de l’Université de Rennes 1, 2012, inédit.
Burnez 1976 : BURNEZ (C.) – Le Néolithique et leChalcolithique dans le Centre-Ouest de la France. SociétéPréhistorique Française, Mémoire 12, Paris, 1976, 374 p.
Burnez 1996 : BURNEZ (C.) dir. – Le site des Loups àÉchiré, Deux-Sèvres. Conseil général des Deux-Sèvres etMusée des Tumulus de Bougon, Bougon, 1996, 256 p.
Burnez 2006 : BURNEZ (C.) – Font-Rase à Barbezieux et Font-Belle à Segonzac (Charente). Deux sites duNéolithique récent saintongeais Matignons/Peu-Richard.Archaeopress, BAR International Series 1562, Oxford, 2006,490 p.
288
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Fichier éditeur destiné à un usage privé
Kerdivel 2012b : KERDIVEL (G.) – Vers un modèle depeuplement : apports et limites d’une archéologie spatiale à petite échelle dans le Nord-Ouest de la France au Néoli-thique. In : BERTONCELLO (F.), BRAEMER (F.) dir. –Variabilités environnementales, mutations sociales. Nature,intensités, échelles et temporalités des changements. XXXIIe Rencontres internationales d’archéologie et d’histoired’Antibes (20-22 octobre 2011), APDCA, Antibes, 2012, p. 301-307.
Laporte 2009 : LAPORTE (L.) dir. – Des premiers paysansaux premiers métallurgistes sur la façade atlantique de laFrance (3500-2000 avant J.-C.). Association des Publica-tions Chauvinoises, Mémoire XXXIII, Chauvigny, 2009, 810 p.
Large 1980 : LARGE (J.-M.) – Sondage sur le campnéolithique du Coteau de Montigné à Coulon (Deux-Sèvres), Bulletin de la Société Historique et Archéologiquedes Deux-Sèvres, t. 13, n° 2-3, 1980, p. 293-307.
Marsac 1991 : MARSAC (M.) – Inventaire archéologiquepar photographie aérienne des abords du Golfe des Pictons.ADANE-Bordessoules, vol. 1, Saint-Jean-d’Angély, 1991, 120 p.
Marsac 1993 : MARSAC (M.) – Inventaire archéologiquepar photographie aérienne des abords du Golfe des Pictons.ADANE-Bordessoules, vol. 2, Saint-Jean-d’Angély, 1993, 104 p.
Marsac 1996 : MARSAC (M.) – Inventaire archéologiquepar photographie aérienne des abords du Golfe des Pictons.ADANE-Bordessoules, vol. 3, Saint-Jean-d’Angély, 1996, 128 p.
Péridy 1999 : PÉRIDY (P.) – Les enceintes néolithiques àfossés interrompus entre Loire et Marais poitevin, Bulletinde la Société Préhistorique Française, t. 96, n° 3, 1999, p. 421-426.
Rousseau 2000 : ROUSSEAU (J.) – L’enceinte néolithiquede La Prée Noire, commune du Bernard (Vendée), Journéepréhistorique et protohistorique de Bretagne, Rennes, 2000,p. 22-24.
Scarre 1982 : SCARRE (C.) – Settlement Patterns andLandscape change: the Late Neolithic and the Bronze age ofthe Marais poitevin area of Western France. Proceedings ofPrehistoric Society, t. 48, 1982, p. 53-75.
Sicard et al. 2002 : SICARD (S.), BRAGUIER (S.),DUPONT (C.), GOIN (R.), RICHE (C.), ROUSSEAU (J.),SELLAMI (F.), SIDÉRA (I.) – L’enceinte néolithique duJardinet aux Magnils-Reigniers (Vendée), Internéo, n° 4,Paris, 2002, p. 131-146.
Weber 2004 : WEBER (N.) – Morphologie, architecture des dépôts, évolution séculaire et millénaire du littoralcharentais : apports de la sismique réflexion combinée à dessuivis bathymétriques et validée par des vibrocarottages.Thèse de doctorat en Géologie Marine, Université de LaRochelle, 2004, 372 p., inédit.
Quelques remarques d’archéologie spatiale concernant la distribution géographique des enceintes néolithiques du Centre-Ouest de la France et des marges du Massif armoricain
Cassen 1987 : CASSEN (S.) – Le Centre-Ouest de la Franceau IVe millénaire av. J.-C. Archaeopress, BAR InternationalSeries 342, Oxford, 1987, 390 p.
Cassen, Scarre 1997 : CASSEN (S.), SCARRE (C.) dir. – Les enceintes néolithiques de La Mastine et Pied-Lizet(Charente-Maritime). Fouilles archéologiques et étudespaléo-environnementales. Association des PublicationsChauvinoises, Mémoire XIII, Chauvigny, 1997, 196 p.
Chancerel et al. 2006 : CHANCEREL (A.), MARCIGNY(C.), GHESQUIÈRE (E.) dir. – Le plateau de Mondeville(Calvados) du Néolithique à l’âge du Bronze. Maison desSciences de l’Homme, DAF, 99, Paris, 2006, 205 p.
Chiron 2007 : CHIRON (T.) – Quel risque de pénurie d’eau sur les îles du Ponant ?, Norois. Environnement,aménagement, société, t. 202, 2007, p. 73-86.
Edeine 1970 : EDEINE (B.) – Nouvelles datations par le C14 concernant la Basse-Normandie, en particulier leChasséen et le Rubané Récent, Bulletin de la Société Préhis-torique Française, Comptes rendus des séances mensuelles,t. 67, n° 4, 1970, p. 114-120.
Fromont, Forré 2011 : FROMONT (N.), FORRÉ (P.) –Avrillé “rue des Menhirs” (Vendée), diagnostic d’un habitatceinturé de l’Artenac (Néolithique final), Bulletin de laSociété Préhistorique Française, t. 108, n° 4, 2011, p. 757-761.
George, Kerdivel 2012 : GEORGE (E.), KERDIVEL (G.),avec les collaborations de GUYODO (J.-N.), HAMON(G.), LENORMAND (A.), MENS (E.) – Habitat et sited’extraction de silex au début du Néolithique moyen. Lessites de la Croix-Sainte-Anne à Juigné-sur-Sarthe et duCamp de César à Vion (Sarthe). In : LABRIFFE (P.-A. de),THIRAULT (É.) dir. – Produire des haches au Néolithique :de la matière première à l’abandon. Actes de la table rondede Saint-Germain-en-Laye (16-17 mars 2007), SociétéPréhistorique Française, Séances 1, Paris, 2012, p. 173-190.
Hinguant 2000 : HINGUANT (S.) – Les Herbiers. Bel Air 1, Bilan Scientifique des Pays de la Loire. 2000, p. 79-80.
Joussaume 1981 : JOUSSAUME (R.) – Le Néolithique del’Aunis et du Poitou occidental dans son cadre atlantique.Thèse d’État, Travaux du Laboratoire d’Anthropologie,Préhistoire, Protohistoire et Quaternaire Armoricains,Rennes, 1981, 625 p.
Joussaume 2012 : JOUSSAUME (R.) dir. – L’enceintenéolithique de Champ-Durand à Nieul-sur-l’Autise (Vendée).Association des Publications Chauvinoises, Mémoire XLIV,Chauvigny, 2012, 685 p.
Joussaume, Pautreau 1990 : JOUSSAUME (R.), PAUTREAU(J.-P.) – La Préhistoire du Poitou. Éd. Ouest-France Univer-sité, Rennes, 1990, 599 p.
Kerdivel 2012a : KERDIVEL (G.) – Occupation de l’espaceet gestion des ressources à l’interface massifs anciens/bassinssecondaires et tertiaires. L’exemple du Massif armoricain et de ses marges au Néolithique. Archaeopress, BAR Inter-national Series 2383, Oxford, 2012, 362 p.
289
Fichier éditeur destiné à un usage privé
Whittle 2001 : WHITTLE (A.) – From mobility to sedentism:change by degrees. In : KERTÉSZ (R.), MAKKAY (J.) dir. –From the Mesolithic to the Neolithic. Proceedings of the
International Archaeological Conference held in theDamjanich Museum of Szolnok (September 22-27 1996),Archaeolingua Alapitvany, Budapest, 2001, p. 47-461.
290
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Fichier éditeur destiné à un usage privé