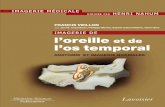Imagerie des traumatismes fermés du thorax
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Imagerie des traumatismes fermés du thorax
Feuillets de Radiologie 2007, 47, n° 2,95-107© 2007. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
Feuillets de Radiologie © 2007. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés 95
Imagerie des traumatismes fermés du thorax
N. Cherni, S. Jouini, A. Labib, S. Briki, R.M. Zo’o, Y. Moison, Y.-T. Joubert
Service d’imagerie médicale, centre hospitalier d’Évreux, 17, rue Saint-Louis, 27000 Évreux.
Correspondance :N. Cherni,
à l’adresse ci-contre.
Email : [email protected]
Les traumatismes fermés du thorax représentent la pre-
mière cause de décès chez l’adulte de moins de 45 ans [1].
Quatre-vingt-cinq pour cent de ces traumatismes sont secon-
daires à des accidents de circulation et moins souvent à des
agressions physiques ou des accidents de sports violents [1-3].
La prise en charge de ces traumatismes nécessite une colla-
boration multidisciplinaire dans laquelle le radiologue à un
rôle central puisqu’il a la responsabilité de l’interprétation
immédiate du bilan radiologique d’entrée de ces patients. Le
cliché standard du thorax en incidence antéro-postérieure
réalisé chez un patient en décubitus dorsal, reste toujours au
premier plan dans l’évaluation initiale des lésions thoraciques,
permettant de détecter celles qui nécessitent un traitement
3333mise au point 3333thorax
Résumé SummaryLes traumatismes fermés du thorax (TTF) représentent la pre-
mière cause de décès chez l’adulte jeune. La plupart sont secon-
daires à des accidents de circulation. La prise en charge de ces
traumatismes nécessite une collaboration multidisciplinaire dans
laquelle le radiologue à la charge de l’interprétation immé-
diate du bilan radiologique urgent. Le cliché standard du tho-
rax est toujours le premier examen d’imagerie demandé, per-
mettant d’éliminer immédiatement un pneumothorax sous
tension nécessitant un drainage urgent en salle de déchoquage.
Grâce à sa rapidité d’exécution, et à son excellente résolution
spatiale, la tomodensitométrie multibarrettes, est devenue la
pierre angulaire de l’exploration des TTF, une fois le patient sta-
bilisé, sur le plan respiratoire et hémodynamique. Cet examen
permet aujourd’hui, un bilan exhaustif de l’ensemble des lésions
du polytraumatisé, avec une excellente sensibilité et spécificité.
Le but de notre travail est de passer en revue l’aspect radiologi-
que et tomodensitométrique des différentes lésions traumati-
ques du thorax. Ces lésions seront classées et présentées en
fonction de leur compartiment anatomique.
Blunt chest trauma.
Blunt chest trauma is the leading cause of death in the young
adult. The large majority of these traumatic events occur during
road traffic accidents. The assumption of responsibility for these
events requires a multidisciplinary collaboration in which the
radiologist plays the role of immediate interpretation of the
urgent radiological assessment. The chest radiograph remains
the initial screening test, allowing immediate diagnosis of ten-
sion pneumothorax requiring urgent drainage in the Emergency
Room. Owing to its rapidity and its excellent spatial resolution,
multi-slice CT plays a key role in the radiological work-up. This
examination allows a fast and exhaustive assessment of the
trauma patient with very high sensitivity and specificity.
The purpose of this article is to review the various radiological
and CT patterns of blunt chest lesions. The most common lesions
will be classified and displayed according to their anatomical
compartment.
Mots-clés : Thorax, Traumatisme Key words: Chest, Trauma
Imagerie des traumatismes fermés du thorax
96
immédiat [4]. L’échographie, réalisée en urgence et au lit du
patient à la recherche de lésions traumatiques intra-abdomi-
nale, permet grâce à l’utilisation de la voie sous xiphoïdienne,
la recherche d’un hémopéricarde ou d’un hémothorax. Dans
certains cas, la voie intercostale antérieure permet de dia-
gnostiquer des lésions traumatiques cardiaques ou aortiques.
La tomodensitométrie multicoupe permet un bilan complet, à
condition que le patient soit hémodynamiquement stable ou
stabilisé. Elle détecte plus de 80 % des lésions passées ina-
perçues sur les radiographies standard du thorax, et elle
modifie la prise en charge des patients dans 19 % des cas [5].
Les reconstructions bidimensionnelles jouent un rôle de pre-
mier plan dans l’évaluation de certaines structures anatomi-
ques, telles que le rachis. Les reconstructions bi et tridimen-
sionnelle sont également très utiles dans la transmission des
résultats aux urgentistes et chirurgiens, permettant une infor-
mation concise, simple et complète [3, 4]. Dans ce travail, les
lésions traumatiques les plus fréquentes seront classées et
présentées en fonction de leur compartiment anatomique.
Traumatismes de la paroi thoracique
Les traumatismes de la paroi thoracique regroupent l’emphy-
sème sous-cutané et les fractures du cadre osseux.
Les fractures costales
Ce sont les lésions les plus fréquentes, rencontrées dans plus
de 80 % des traumatismes fermés du thorax. Elles sont mul-
tiples dans la majorité des cas et ne sont détectées que dans
moins de 40 % des cas sur les radiographies standard. Leur
individualisation est facilitée par le scanner multicoupe avec
reconstructions volumiques (fig. 1). L’échographie réalisée
avec une sonde linéaire haute fréquences (12 MHz) peut être
utile dans ce contexte en dehors de toute urgence. En posant
la sonde sur la paroi thoracique, en regard du point doulou-
reux indiqué par le patient lui-même, il est possible de visua-
liser la solution de continuité corticale qui apparaît sous forme
d’une ligne hyperéchogène interrompue. L’échographie est
aussi sensible que la radiographie standard dans cette indica-
tion et, permet de plus de détecter un éventuel décollement
pleural associé minime souvent non détecté par les radiogra-
phies [6]. Cependant, cette technique reste de pratique moins
courante dans les circonstances d’urgences. Sur le plan médi-
cal, l’utilité de la recherche de ces fractures réside dans :
• la détection de lésions sous-jacentes associée : pneumo-
ou un hémothorax nécessitant un drainage rapide, lésions
parenchymateuses pulmonaires nécessitant une surveillance
du fait de leur évolution imprévisible ;
• la prévention des complications potentielles sous-jacente :
hémorragie à bas débit des vaisseaux intercostaux ou mam-
maires internes pouvant nécessiter une embolisation endo-
vasculaire ultérieure [4, 7].
Par ailleurs, la recherche de fracture des dernières côtes est
indispensable du fait de l’association fréquente à des lésions
traumatiques diaphragmatiques, rénales, hépatiques ou splé-
niques. Les fractures des premières côtes surviennent sou-
vent dans des accidents violents, source de traumatisme
sévère. Leur gravité réside dans leur proximité des vaisseaux
cervicaux et des voies aérodigestives qui peuvent être lésés
soit directement, soit secondairement par l’hématome post-
traumatique.
Les fractures sternales
Elles représentent 5 % des TTF. La visualisation directe de la
fracture sternale est rarement possible sur les radiographies
de face. Si l’état du patient le permet, les radiographies du
sternum de profil sont souvent plus sensibles [4, 7]. Ces fractu-
res peuvent se traduire par des signes indirects et non spécifi-
ques tel qu’un élargissement du médiastin, en rapport avec un
hématome rétrosternal. Ce dernier est secondaire à une lésion
des vaisseaux mammaires internes ou leurs branches, et pose
un problème de diagnostic différentiel avec un hémomédias-
tin ou un hémopéricarde secondaire à un traumatisme myo-
cardique ou de l’arche aortique, rares mais de très mauvais
pronostic. La tomodensitométrie avec injection de contraste
est très utile dans ces circonstances. Elle permet de faire la part
des choses et visualise parfaitement le trait de fracture au
niveau du sternum grâce aux reconstructions 2D et 3D (fig. 2).
Les volets costaux
Ils représentent environ 1 % des traumatismes fermé du tho-
rax. Par définition, un volet costal est constitué par au moins
trois fractures costales adjacentes, chacune des côtes concer-
nées étant fracturée en au moins deux points distincts. Surve-
nant généralement dans des accidents violents entraînant
un traumatisme thoracique sévère avec phénomènes de
compression. Il en résulte une désolidarisation de la paroi
thoracique, entraînant une respiratoire paradoxal conduisant
à une défaillance respiratoire d’aggravation rapide et à la
mort dans 40 % des cas [4-6], leurs mise en évidence est faci-
litée par les reconstructions volumiques au scanner (fig. 3).
L’emphysème sous-cutané
Il est observé dans 15 % des TTF environ. Les mécanismes
sont multiples : souvent secondaire à une fracture costale
N. Cherni et al.2222mise au point
Feuillets de Radiologie © 2007. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés 97
entraînant une déchirure pleurale, parfois répondant à
l’extension d’un pneumomédiastin ou d’une lésion traumati-
que trachéo-bronchique dans les accidents les plus sévères,
rarement d’origine iatrogène (drainage de pneumothorax,
intubation trachéale traumatique). L’emphysème est généra-
lement visible sur les radiographies standard (fig. 4), se tra-
duisant par des hyperclartés se projetant sur les parties mol-
les et le tissu adipeux sous-cutané. La tomodensitométrie est
plus sensible pour détecter les emphysèmes sous-cutanés
minimes sans traduction radiographique, ainsi que les éven-
tuelles lésions associées : pneumothorax, lésion pulmonaire
sous-jacente masquée [4, 8, 9].
Traumatisme du diaphragme
Les lésions traumatiques du diaphragme sont de diagnostic
difficile et passent souvent inaperçues à l’admission. Témoi-
gnant souvent d’un traumatisme très sévère, les signes radio-
graphiques sont non spécifiques [10, 11]. Ils représentent 8 %
A B
C D
Figure 1. A : Fracture de l’arc postérieur de la 7e côte droite non visualisée sur les radiographies standard. B : En fenêtre parenchymateuses, en trouvele pneumothorax associé masqué par l’emphysème sous-cutanée. C : Intérêt des reconstructions 3D volumiques pour la mise en évidence de cettefracture costale. D : Un autre patient victime d’un TTF sévère. Intérêt des reconstructions 3D volumiques dans la mise en évidence des fractures despremières côtes non visualisées sur les radiographies standard.
Imagerie des traumatismes fermés du thorax
98
des traumatismes fermés du thorax. La rupture se produit le
plus souvent dans les régions postérolatérales [4, 10, 11]. Les
radiographies du thorax en incidence antéropostérieure peu-
vent montrer une ascension de la coupole diaphragmatique,
une déformation localisée de la coupole, un aspect de
« pseudo-diaphragme » en rapport avec des limites floues du
diaphragme, ou des clartés digestives en position intra-thora-
ciques. En cas de rupture diaphragmatique gauche, la sonde
nasogastrique décrit un trajet intra-thoracique anormal en J
inversé. L’association à des fractures des dernières côtes est
fréquente. La tomodensitométrie est beaucoup plus sensible.
Une acquisition thoraco-abdominale suivie par des recons-
tructions multiplanaires, montre un épaississement ou une
interruption localisée du diaphragme, dont les berges sont
Figure 2. A : Fracture du manubrium sternal lors d’un TTF, non visualisé sur les radiographies standard. B : Meilleure visualisation sur les reconstruc-tions volumiques. C, D : Fracture médio-sternale lors d’un TTF, non visualisé sur les radiographies standard, meilleure visualisation sur les reconstruc-tions volumiques centré sur la fracture. E : Élargissement du médiastin sur la radio pulmonaire suite à un TTF. F, G, H : Scanner réalisé à la suite. Visua-lisation d’une fracture sternale avec hématome rétrosternal sans lésion aortique.
A B C
E FD
G H
N. Cherni et al.2222mise au point
Feuillets de Radiologie © 2007. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés 99
soulignées par des franges graisseuses provenant de la cavité
abdominale. En cas de rupture diaphragmatique, le scanner
montre les viscères abdominaux herniés à travers la rupture
plutôt que la rupture elle-même. Les viscères abdominaux
herniés sont l’estomac, l’intestin grêle ou le côlon réalisant le
signe du « collet ». Le foie aussi peut être intéressé et adopte
alors une configuration en « champignon » ou en « bouchon
de champagne ». La radiographie du thorax a une sensibilité
moyenne et une spécificité très limitée (fig. 5). La TDM avec
des reconstructions multiplanaires a une meilleure sensibilité
et une spécificité avoisinant les 100 % [4, 10, 11].
Traumatisme de la plèvre
Le pneumothorax
Il est présent dans 50 % des TTF. Il résulte le plus souvent de
la rupture traumatique d’une bulle d’emphysème, parfois
d’une lacération pulmonaire exercée par la côte fracturée, ou
d’un effet Maklin. Plus rarement, le pneumothorax est secon-
daire à une lésion traumatique de l’arbre trachéobronchique.
L’air une fois introduit dans l’espace pleural se répartit dans
les régions les moins déclives [4]. Les radiographies réalisées
A B
C D
Figure 3. A : Large contusion pulmonaire droite suite à un TTF avec multiples fractures costales. B, C, D : Fractures des costales multiples réalisant desvolets, bien visualisées avec les reconstructions 3D volumiques.
Imagerie des traumatismes fermés du thorax
100
en décubitus dorsal montrent des signes radiologiques dis-
crets mais spécifiques et peuvent détecter des pneumotho-
rax de faible abondance, sous forme d’hyperclartés linéaires
dessinant l’interface poumon-médiastin. La présence d’un
croissant aérique séparant le poumon de la coupole diaphrag-
matique indique un pneumothorax sous pulmonaire. Les
pneumothorax apicaux, d’observation difficile sur les clichés
réalisée en décubitus, sont classiquement observés sur les
radiographies obtenues en position debout. Dans ces circons-
tances, l’échographie réalisée au lit du patient avec une
sonde de haute fréquence, peut montrer le décollement pleu-
ral de faible abondance sous forme d’échos de réverbérations
sous pariétales, avec une sensibilité meilleure que les radio-
graphies standard [6], pour les pneumothorax de faible abon-
dance le scanner reste toujours le meilleur examen devant sa
haute sensibilité (fig. 6).
Selon la gravité, on reconnaît 3 formes de pneumothorax :
• les pneumothorax sous tension représentent 10 % des cas
environ. Ils génèrent un mécanisme de valve à clapet au
niveau de la fuite d’air, de pronostic très réservé et sont asso-
ciés à une mortalité élevée avoisinant les 40 %. La radiogra-
phie standard montre un refoulement du médiastin vers le
côté controlatéral, et un collapsus du poumon ipsilatéral qui
doivent faire pratiquer un drainage urgent. La tomodensito-
métrie a la même sensibilité que les clichés standard du tho-
rax dans ces situations et ne doit pas retarder le drainage ;
• dans les pneumothorax de moyenne abondance, les clichés
standard sont suffisants pour la détection ;
• les pneumothorax de petite abondance peuvent être occul-
tes, non détectés sur les radiographies standard et visualisés
seulement au scanner. Leur volume peut atteindre 500 milli-
litres, nécessitant un drainage pleural percutané si une venti-
lation mécanique est envisagée [4, 6].
L’hémothorax
Il est présent dans 40 % des cas environ, d’abondance et de
gravité variables. L’hémothorax de petite abondance résulte
souvent d’une lacération parenchymateuse pulmonaire
directe ou d’une lésion des vaisseaux intercostaux ou mam-
maires internes. Les lésions traumatiques des gros vaisseaux
médiastinaux ou du cœur donnent lieu à un hémothorax de
A
B
C
Figure 4. A : Radiographie pulmonaire de face montre des hyperclartés de densité aérique décollant les parties molles sur l’hémi thorax droit.B, C : Scanner thoracique en coupes axiales et coronales et en fenêtrage parenchymateux objective l’infiltration aérique des parties molles et unpneumomédiastin associé.
N. Cherni et al.2222mise au point
Feuillets de Radiologie © 2007. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés 101
grande abondance, représentant un facteur pronostic majeur
avec une mortalité de 30 %. En fonction de l’abondance de
l’hémothorax, on observe sur les radiographies standard une
augmentation diffuse de l’opacité de la plage pulmonaire et
un comblement du récessus costophrénique. En cas d’épan-
chement de faible abondance, on note un effacement de la
coupole diaphragmatique avec accumulation du sang dans le
sillon latéral entre le poumon et le gril costal. En cas d’épan-
chement de grande abondance, on visualise une « coiffe api-
cale » (fig. 7).
Traumatisme pulmonaire
Les lésions parenchymateuses pulmonaires post-traumati-
ques représentent 15 % des TTF. Elles signent un traumatisme
sévère, et sont de mauvais pronostic. Elles sont associées à une
mortalité élevée (34 % environ), ce qui justifie leur recherche
systématique sur le bilan radiologique initial. Il n’existe pas de
corrélation directe entre les anomalies radiologiques trouvées
et l’état clinique du patient. On distingue les contusions et les
lacérations pulmonaires. Les contusions pulmonaires sont des
altérations de l’épithélium alvéolaire et de l’endothélium capil-
laire des septa du parenchyme pulmonaire, avec œdème et
hémorragie interstitielle et intra-alvéolaire subséquentes
entraînant une désorganisation de l’architecture pulmonaire.
Ces anomalies sont souvent multiples et de topographies péri-
phériques localisées en position sous-pleurale. Elles se tradui-
sent par des hyperdensités en verre dépoli, de répartition hété-
rogène, mal limitées et confluentes par endroit, sans
systématisation particulière et ne contenant pas broncho-
gramme aérique. Leur principale caractéristique est leur carac-
tère migrant. Elles apparaissent quelques heures après le trau-
matisme et atteignent leurs gravités maximales vers 48 à 72 h,
puis régressent lentement sur plusieurs semaines en laissant
A
B
C
Figure 5. A, B : Scanner thoraco-abdominal après opacification digestive en coupes axiales et en coupes coronales c montrent une rupture diaphrag-matique postéro-latérale gauche suite à un TTF associée a une ascension de l’estomac et de la graisse omentale.
Imagerie des traumatismes fermés du thorax
102
A B
Figure 6. A : Pneumothorax minime apical gauche non visualisé sur les radiographies standard. B : Pneumothorax droit avec emphysème sous-cutanédéjà observé sur les radiographies mais la contusion parenchymateuse pulmonaire et le pneumomédiastin ne sont visualisés que sur le scanner.
B
A
C
Figure 7. A : Radiographies thoraciques (face et profil) debout réalisées après un TTF montrent un hémothorax droit avec un niveau horizontal, on noteaussi l’emphysème sous-cutané très étendu associé. B : Scanner thoracique montre un hémothorax gauche déclive et des foyers de verre dépoli etquelques images nodulaires en rapport avec des contusions post-traumatiques. C : TTF le scanner montre un hémothorax bilatéral, un pneumothoraxgauche, des foyers de contusion parenchymateuse avec emphysème sous-cutané et fracture costale.
N. Cherni et al.2222mise au point
Feuillets de Radiologie © 2007. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés 103
parfois quelques images séquellaires. Elles peuvent évoluer
vers une altération profonde du parenchyme pulmonaire en
cas de lésions importantes conduisant au décès (fig. 8). Les
lacérations pulmonaires représentent des altérations majeu-
res de l’architecture normale du parenchyme pulmonaire
impliquant des ruptures alvéolaires et des déchirures vascu-
laires, pouvant conduire à la formation d’hématome intra-
pulmonaire. Ce dernier se traduit par une opacité arrondie sur
les examens d’imagerie peuvent se surinfecter ou s’excaver,
et évoluer vers un pneumatocèle ou pseudokyste (cavité
remplie d’air contenant parfois un niveau hydroaérique). Ces
lésions sont souvent masquées par des contusions pulmonai-
res expliquant leur évolution imprévisible [4].
Traumatisme du médiastin
Le pneumomédiastin
Il est observé chez 10 % des patients, souvent suite à un trau-
matisme sévère. Il est souvent le résultat d’un effet Macklin.
Il est associé à un pneumothorax dans 50 % des cas et à un
emphysème sous-cutané dans 60 % des cas qui peut le mas-
quer. Il peut revêtir différents aspects radiologiques. Parmi
ces nombreux aspects radiologiques, la présence d’air dans le
ligament pulmonaire se manifestant comme une bande claire
verticale, localisée d’un côté ou de l’autre de la ligne médiane
et s’étendant du hile pulmonaire à la convexité diaphragma-
tique. Un emphysème médiastinal peut s’étendre au-delà
du médiastin, et créer un emphysème sous-cutané et muscu-
laire, un rétro pneumopéritoine, un pneumopéritoine, voire
un pneumorachis (fig. 9) [4].
Les lésions trachéo-bronchiques
Elles sont présentes chez environ 1 % des patients victimes
d’un TTF. Dans la majorité des cas, elles sont situées à proxi-
mité de la carène et de la portion proximale des bronches
souches. Ces lésions sont souvent concomitantes à des lésions
fatales et la mortalité globale avoisine 80 %. Les signes radio-
logiques sont aspécifiques : élargissement du médiastin, pneu-
A B
Figure 8. A : Radiographie pulmonaire montre une hyperdensité enverre dépoli touchant le champ pulmonaire gauche en rapport avecune contusion pulmonaire étendue post-traumatique. B : Scannerthoracique montre un décollement pleural minime, un emphysèmesous-cutané, et des anomalies parenchymateuses pulmonaires sousforme d’images nodulaires et des condensations en rapport avec unecontusion pulmonaire. C : Hémothorax bilatéral, plus important àdroite avec des foyers de condensations parenchymateuses post-traumatique d’installation secondaire.
C
Imagerie des traumatismes fermés du thorax
104
momédiastin, pneumothorax persistant malgré un drainage
convenable. Parfois, il s’agit d’un emphysème sous-cutané,
d’un hémothorax, d’un piégeage ou au contraire d’une atélec-
tasie [4]. La tomodensitométrie multicoupe détecte 94 %
des ces lésions alors que la lésion trachéo-bronchique elle-
même est rarement mise en évidence [12]. La bronchoscopie
reste l’examen de référence pour le diagnostic des traumatis-
mes trachéo-bronchiques, notamment afin d’en préciser la
localisation et l’étendue. Elle permet aussi dans le même
temps un geste thérapeutique.
Les lésions aortiques
Elles sont présentes dans 1 à 2 % des cas des patients victimes
de TTF et admis vivant aux urgences [13]. Ils représentent la
lésion traumatique la plus létale dans les traumatismes fermés
du thorax. Le mécanisme le plus fréquent est une décélération
à haute vitesse entraînant une compression traumatique de
l’aorte entre le sternum et le rachis [3, 4]. Ces lésions trauma-
tiques de l’aorte thoracique peuvent être transmurales et
immédiatement fatales ou se limiter à l’intima et à la
média, créant ainsi un pseudoanévrisme de diagnostic dif-
ficile sur le bilan initial, susceptible de se rompre à chaque
instant, entraînant une hémorragie rapidement mortelle. Ces
lésions aortiques nécessitent par conséquent un diagnostic
précoce et une prise en charge rapide et adéquate dans un
service de chirurgie vasculaire. Dans 90 % des cas, les lésions
aortiques sont localisées sur la face antéromédiale de
l’isthme de l’aorte [3, 4]. Les signes radiologiques les plus fré-
quents en cas de rupture aortique sont : un contour irrégulier
ou flou du bouton aortique, un élargissement médiastinal
[14]. Les signes les plus sensibles sont le déplacement de la
ligne para-spinale gauche, l’effacement du bouton aortique
et l’hémomédiastin dont la sensibilité est de 86 % [13]. Les
radiographies standard ont une faible spécificité car la pré-
sence d’un élargissement médiastinal est fréquente chez les
patients victimes d’un TTF, du fait d’un hémomédiastin secon-
daire à des lésions vasculaires mineures sur fracture sternale
ou vertébrale, ou d’une distension de la veine cave supé-
rieure [4]. Les autres signes radiologiques de rupture aortique
plus spécifiques mais moins fréquents, sont un déplacement
vers la droite de la sonde nasogastrique, un déplacement vers
la droite de la trachée ou d’un tube endotrachéal, un déplace-
ment vers le bas de la bronche souche gauche, une coiffe
B
A C
Figure 9. A : Pneumomédiastin post-traumatique disséquant lesstructures anatomiques du médiastin, non visualisé sur les radiogra-phies standard masqué par l’emphysème sous-cutané extensif. B :Traumatisme thoracique associé à des fractures pariétales, un pneu-mothorax, et un emphysème sous-cutané, on note aussi un héma-tome rétrosternal associé à un pneumomédiastin. C : Les reconstruc-tions multiplanaires au scanner donnent une meilleure détection despneumomédiastin de faible abondance et apprécient l’extension.
N. Cherni et al.2222mise au point
Feuillets de Radiologie © 2007. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés 105
apicale gauche, un élargissement de la ligne para-vertébrale
gauche en rapport avec un hémothorax (fig. 10). L’échogra-
phie, réalisée rapidement et en urgence pour la recherche de
lésions traumatiques des organes intra-abdominaux permet
grâce à la voie sous xiphoïdienne, la recherche de collection
liquidienne pleurale ou péricardique et grâce à la voie inter-
costale le bilan des lésions cardiaques et de certaines lésions
aortiques [15].
A B C
ED F
G
Figure 10. A : Radiographie pulmonaire de face suite à un TTF montre un élargissement du médias-tin, une coiffe apicale gauche et un déplacement de la ligne para-vertébrale gauche en rapportavec un hémothorax évoquant un traumatisme aortique. B : Angioscanner aortique réalisé à lasuite, confirme la présence d’un hémomédiastin et l’extravasation du produit de contraste parl’intermédiaire d’une fissure au niveau de l’isthme aortique. C : Une artériographie a était réaliséeconfirme la lésion traumatique de l’isthme aortique sous forme d’un faux anévrisme sans extrava-sation active de produit de contraste. D : Une angio-IRM de contrôle réalisée trouve les même cons-tatations : un faux anévrisme au niveau de l’isthme aortique. E, F, G : Polytraumatisé avec TTF, lescanner réalisé avec injection montre une fissure avec fuite de produit de contraste au niveau del’isthme aortique créant un pseudo-anévrisme avec un hémomédiastin de faible abondance.
Imagerie des traumatismes fermés du thorax
106
Références1. Mullinex A, Folly D. Multidetector computed
tomography and blunt thoracoabdominaltrauma. J Comp Assist Tomo 2004; 28(suppl. 1): S20-S27.
2. Nourjah P. National hospital ambulatorymedical care survey. National Center forHealth Statistics, Hyattsville, Maryland, 1999,p. 304.
3. Schnyder P, Wintermark M. Radiology ofblunt trauma of the chest. Springer Verlag,Berlin, Heidelberg, New York, 2000.
4. Wintermark M, Schnyder P. Imagerie destraumatismes fermés du thorax. J Radiol2002 ; 83 : 123-32.
5. Salim A, Sangthong B, Martin M, Brown C, etal. Whole body imaging in blunt multisys-tem trauma patients without obvious sign-
sof injury: results of a prospective study.Arch Surg 2006; 141: 468-73.
6. Mao Z, Zhi-Hai L, Jian-Xin Y, Jian-Xin G, et al.Rapid detection of pneumothorax by ultra-sonography in patients with multipletrauma. Crit Care 2006; 10: R112.
7. Collins J. Chest wall trauma. J Thorac Ima-ging 2000; 15: 112-9.
8. Shanmuganathan K, Mirvis SE. Imaging dia-gnosis of nonaortic thoracic injury. RadiolClin N Am 1999; 37: 533-51.
9. Zinck SE, Primack SL. Radiographic and CTfindings in blunt chest trauma. J Thorac Ima-ging 2000; 15: 87-96.
10. Sliker CW. Imaging of diaphragm injuries.Radiol Clin North Am 2006; 44: 199-211.
11. Sangster G, Ventura VP, Carbo A, Gates T,et al. Diaphragmatic rupture: a frequencymissed injury in blunt thoraco-abdominal
trauma patients. Emerg Radiol 2007; 13:225-30.
12. Scaglione M, Romano S, Pinto A, Sparano, etal. Acute tracheobraonchial injuries: impactof imaging on diagnosis and managementimplications. Eur J Radiol 2006; 59: 336-43.
13. Ungar TC, Wolf SJ, Haukoos JS, Dyer DS, et al.Derivation of a clinical decision rule to ex-clude thoracic aortic imaging in patientswith blunt chest trauma after motor vehi-cule collisions. J Trauma 2006; 61: 1150-5.
14. Zinck SE, Primack SL. Radiographic and CTfindings in blunt chest trauma. J Thorac Ima-ging 2000; 15: 87-96.
15. Menaker J, Cusham J, Vermillion JM, Rosen-thal RE. Ultrasound-diagnosed cardiac tam-ponade after blunt-abdominal trauma-trea-ted with emergent thoracotomy. J EmergMed 2007; 32: 99-103.
Imagerie des traumatismes fermés du thorax
3333test de formation médicale continue
Feuillets de Radiologie © 2007. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés 107
Qu’avez-vous retenu de cet article ?Testez si vous avez assimilé les points importants de cet article en répondant à ce questionnaire sous forme de QCM.
1. Chez l’adulte jeune, les traumatismes fermés du
thorax mortel sont secondaire à :
A : Accidents de travail ;
B : Accidents de la voie publique ;
C : Agressions physiques ;
D : Accidents de sports violents ;
E : Intoxication alcoolique ;
F : Tentative de suicide.
2. En dehors de toute urgence vitale, l’échographie
percutanée, réalisée suite à un traumatisme fermé du
thorax, peut mettre en évidence :
A : Un pneumothorax ;
B : Un hémomédiastin ;
C : Une fracture costale ;
D : Un hémothorax ;
E : Une rupture diaphragmatique ;
F : Une lésion aortique.
3. L’utilité de la recherche d’une fracture costale dans les
traumatismes fermés du thorax réside dans :
A : La détection des lésions sous jacente
nécessitant une prise en charge rapide ;
B : La détection des lésions parenchymateuses
nécessitant une surveillance ;
C : Mise en garde des complications
hémorragiques potentielles à bas débit ;
D : Nécessité d’un traitement spécifique adapté ;
E : Détection des fractures des dernières et des
premières côtes ;
F : Risque de pseudarthrose et de déformation
thoracique secondaire.
4. Les lésions traumatiques du diaphragme suite à un
traumatisme thoracique fermé :
A : Sont de diagnostic facile ;
B : Passent rarement inaperçues à l’admission ;
C : Témoignent souvent d’un traumatisme très
sévère ;
D : Les signes radiographiques ne sont pas
spécifiques ;
E : La rupture se produit le plus souvent dans les
régions antéro-latérales ;
F : La TDM avec des reconstructions multiplanaires
a une sensibilité et une spécificité proche de
100 %.
5. Les lésions aortiques dans les traumatismes fermés du
thorax :
A : Représentent plus de 5 % des patients admis
vivant aux urgences ;
B : Elles représentent la lésion traumatique la plus
léthale ;
C : Souvent localisées sur la face antéromédiale de
l’isthme de l’aorte ;
D : L’échographie trans-thoracique peut détecter
une lésion aortique post-traumatique ;
E : Sont souvent associées à un
pneumomédiastin ;
F : Une fracture sternale est très fréquente.
Réponses : page 140