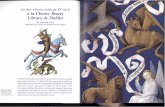Démocratie directe faits et arguments sur l'introduction de l'initiative et du référendum
Quand l'Islande joue aux dés : les enjeux de l'usage du tirage au sort en démocratie à travers...
-
Upload
sciencespo-lyon -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Quand l'Islande joue aux dés : les enjeux de l'usage du tirage au sort en démocratie à travers...
Quand l'Islande joue aux dés
Les enjeux de l'usage du tirage au sort en démocratie au travers de l'exemple du Forum National islandais
CORDIER Lionel M2 Spécialisation Globalisation & Gouvernance
2012-2013 Sous la direction de Philippe CORCUFF
Jury : Philippe CORCUFF, Nathalie DOMPNIER
et Jean-Louis MARIE Date de soutenance : 18 Juin 2013
3
Quand l'Islande joue aux dés
Les enjeux de l'usage du tirage au sort en
démocratie au travers de l'exemple du Forum
National islandais
4
"Entendre ce que démocratie veut dire, c'est entendre la bataille qui se joue dans ce mot :
non pas simplement les tonalités de colère ou de mépris dont on peut l'affecter, mais, plus
profondément, les glissements et retournements de sens qu'il autorise ou que l'on peut
s'autoriser à son égard." Rancière, La haine de la démocratie
" – Vous niez donc que la société fonctionne comme un jeu stratégique ? Le Minimax
était une brillante hypothèse. Il nous a donné une méthode scientifique, rationnelle, pour
percer à jour n'importe quelle stratégie et transformer le jeu stratégique en un jeu de
hasard auquel les méthodes statistiques des sciences exactes sont applicables.
- Quand même, marmonna Verrick, cette damnée bouteille jette un homme dehors sans
raison et élève à sa place un âne, un imbécile, un fou choisi au hasard, sans même tenir
compte de sa classe ou de ses capacités. " Philip K. Dick, Loterie solaire
5
Remerciements
À Philippe Corcuff, Yves Sintomer et Philippe Urfalino, pour leur aide précieuse tout au
long de l'écriture de ce mémoire
À Bjarni Snæbjörn Jónsson pour sa confiance, Guðrún Pétursdóttir pour sa gentillesse,
Ársæll Hjálmarsson pour la patience et l'aide à la traduction, et à tant d'autres Islandais
qui ont su m'aider et répondre à mes questions
À Loren dont l'aide et l'amitié m'ont été précieuses
À mon père, pour son éternel esprit de révolte et pour son aide
6
Sommaire
Sommaire ....................................................................................................................... 6
Partie I. Du député au jeu de dés : approche des théories philosophiques
et sociologiques du hasard en démocratie ...................................................... 18 I. Démocratie : itinéraire philosophique d'un mot face à l'apparente conflictualité
du hasard et de l'élection ............................................................................................................. 19 1. La démocratie rousseauiste : critique de la représentation et esquisse d'un système
idéal .................................................................................................................................................................... 19 2. Démocratie moderne ou aristocratie élective ? La prudence de Constant par l'usage
de la délimitation ......................................................................................................................................... 25 3. Dewey et l'indéfini démocratique : refus de l'essentialisation et ouverture d'un
champ d'expérimentations ...................................................................................................................... 30 II. Apports des sciences sociales sur le tirage au sort : procédures, fantasmes et
mutations historiques ................................................................................................................... 36 1. Revisiter l'idéal antique à la lumière de l'analyse socio-‐historique .................................. 37 2. Pourquoi le tirage au sort a disparu. Transformations conceptuelles et techniques
des systèmes de pouvoir occidentaux ................................................................................................. 42 3. Les apports des analyses statistiques : la démocratie est-‐elle un jeu comme les
autres ? .............................................................................................................................................................. 47 III. Le nouvel esprit du hasard : critiques de l'élection, mutations démocratiques et
expérimentations locales ............................................................................................................. 52 1. Pourquoi les élections ne suffisent plus ? Critiques et transformations de la
représentation ............................................................................................................................................... 53 2. Expériences et pièges de la démocratie participative ............................................................. 58 3. Jurys citoyens et assemblées tirées au sort : observations et premiers constats ...... 62
Partie II. La révision constitutionnelle islandaise et l'expérience du
Forum National : réveil d'un volcan ou simple nuage de cendres ? ........ 66 I. Contexte et enjeux locaux de l'expérience islandaise .................................................... 68 1. Esquisse de l'héritage historique et démocratique islandais ............................................... 69
7
2. Les Vikings des années 2000 : néolibéralisme à l’islandaise et faillite du contrôle
démocratique ................................................................................................................................................. 74 3. Un bourgeonnement démocratique ? Renouveau et multitudes des formes
d'engagement politique ............................................................................................................................. 78 II. Le tirage au sort à l’islandaise : descriptif et premières analyses de l'expérience
du Forum National ......................................................................................................................... 82 1. Aux origines du Forum National : acteurs, organisateurs et sources d'inspirations . 83 2. L'Assemblée Nationale de 2009 : échos et limites d'un premier test ............................... 87 3. La machine est lancée : déroulement du Forum National et premières observations
.............................................................................................................................................................................. 91 III. Quel avenir pour le cas islandais ? ..................................................................................... 97 1. Que faire du fruit du Forum ? La production citoyenne face aux institutions
traditionnelles ............................................................................................................................................... 97 2. Une constitution inaboutie et dépendante du pouvoir ......................................................... 101 3. Limites du tirage au sort islandais et limites de l'expérimentation démocratique .. 105
Conclusion ................................................................................................................ 108
Bibliographie ........................................................................................................... 110 Ouvrages ......................................................................................................................................... 110 Articles ............................................................................................................................................ 112 Ressources internet .................................................................................................................... 113
Annexes ..................................................................................................................... 114 1. Tableau récapitulatif de l'actualité islandaise depuis 2008 .................................... 114 2. Référendum sur la Constitution du 21 octobre 2012 ................................................. 118 3. Exemple d'une session du Forum National .................................................................... 119
8
Introduction
Democracia real, ya. S'il y avait un seul mot d'ordre à retenir parmi les
préoccupations exprimées par de larges pans de la société civile mondiale, celui-ci
figurerait en bonne position. Les Indignés espagnols ont su, par ces quelques mots,
traduire à la fois des réclamations d'ordre local propres à leur pays, et un constat
global sur l'état des systèmes politiques que nous jugeons habituellement comme les
plus avancés. Pourquoi aujourd'hui en venons-nous à réclamer une "démocratie réelle
maintenant", quelles représentations collons-nous sur ces termes lorsque nous les
entendons ? Les systèmes démocratiques sous lesquels nous vivons aujourd'hui
seraient-ils "faux", "irréels" ? Que traduit cette exigence de plus de démocratie,
quelles nouvelles utopies peuvent-elles contribuer à créer ?
Questionner le régime démocratique, ses sources de légitimité et ses
multiples variations, c'est faire également le constat de la crise actuelle des régimes
s'en réclamant au niveau global. La discussion et la remise en cause de l'idéal
démocratique censé fonder nos systèmes politiques est un sujet qui n'a jamais été
totalement évacué, mais il se pose aujourd'hui d'une façon particulièrement aigüe, et
ne se limite pas seulement aux pays occidentaux. S'agit-il d'une crise de croissance,
le système de la démocratie parlementaire continuant à essaimer dans le monde, ou
bien à l'inverse assiste-t-on à une dé-démocratisation de nos sociétés comme le
suggère Wendy Brown1 ? Qu'il s'agisse de la montée de l'extrême-droite en Europe
et aux USA, de l'avenir du mouvement des Indignés et du Printemps arabe, il semble
désormais vital de développer une véritable "ingénierie" de la démocratie, une
connaissance à la fois pragmatique et approfondie des qualités et défauts des
procédures démocratiques. Cette exigence est à distinguer des discours construits
autour du concept vaste et flou de "gouvernance". Car cette connaissance ne doit
1 BROWN W., "American Nightmare : Neoliberalism, Neoconservatism, and De-‐democratization", in Political Theory, vol. 34, pp.690-‐714, 2006
9
exclure sous aucun prétexte la question du sens mais bien au contraire se présenter
comme une forme de "philosophie appliquée". Elle doit par un jeu de miroirs
confronter les grands idéaux-types démocratiques forgées par les philosophes à
l'observation de terrain et au travail patient de la sociologie politique. C'est
notamment par ce jeu réciproque de question/réponse que nous pourrons construire
des modèles cohérents et de portée générale. L'opposition parfois faite entre théorie
et expérimentation est stérile lorsqu'elle refuse le caractère éminemment subversif de
la production de tout nouveau savoir.
L'expérimentation en démocratie possède ici un rôle clef, aux
croisées de la réflexion philosophique, de la sociologie politique et de matières aussi
diverses que l'éthologie, le management public ou la psychologie sociale. Or ce qui
nous intéresse et nous questionne dans la mise en œuvre de ces expériences se
constitue notamment des frottements entre l'innovation démocratique et les
institutions politiques traditionnelles. La recherche en science politique doit
contribuer à saisir et délimiter les terrains où les institutions publiques et les
multiples acteurs de la société civile se rencontrent, collaborent ou bien à l'inverse
s'affrontent. Sur ce point la question du tirage au sort en démocratie est
particulièrement emblématique, puisqu'après avoir été placée sous le boisseau durant
des siècles, elle ressurgit de façon nouvelle, affrontant parfois les quolibets d'une
partie de la classe politique2 mais également la curiosité des amateurs d'objets
théoriques exotiques. Le cas islandais du Forum National de 2010 reste aujourd'hui le
cas le plus récent et le plus ambitieux d'usage du tirage au sort comme processus de
décision politique. Il est fort à parier qu'il ne sera pas le dernier puisqu'il a déjà
commencé à essaimer à travers le monde, et que de nouvelles formes d'usages et
d'expérimentations du tirage au sort continueront encore à se créer et à se multiplier.
L'étude d'une technique de prise de décision politique implique aujourd'hui
d'adopter un point de vue international. D'une part il convient d'étendre le champ de
nos possibles en démultipliant le nombre d'expériences à examiner, et d'autre part
d'effectuer davantage le distinguo entre la part reproductible de chacune d'entre elles
2 La proposition de jurys citoyens durant la campagne présidentielle de 2007 par Ségolène Royal en est un exemple emblématique
10
et ce qui relève d'un contexte culturel particulier. Car enfin, à l'heure d'une
accélération du phénomène de globalisation et des échanges d'informations, le
phénomène islandais ne passe plus inaperçu et pose directement la question de sa
reproductibilité dans d'autres régions du globe.
Problématique, enjeux et hypothèses de travail
Le 22 Janvier 2009, plus de 2000 manifestants protestent devant l’Althing
(Parlement islandais) afin de réclamer la tenue de nouvelles élections et une
complète rénovation des institutions. Pour la première fois depuis 1949 et les
manifestations de protestations contre l’adhésion du pays à l’Otan, la police est
obligée de disperser les manifestants en usant de gaz lacrymogènes. Si la
mobilisation continuera de croître jusqu’à la démission effective du gouvernement
conservateur de Geir Haarde, il s’agit alors du point d’orgue des tensions entre
manifestants islandais et gouvernement, accusé d’avoir conduit le pays au bord du
gouffre économique. Après avoir développé son secteur financier de façon largement
incontrôlée, l’Islande subit de plein fouet les conséquences de la crise économique
mondiale de 2008. Explosion du chômage, faillites et appel au FMI déconsidèrent
comme jamais la classe politique aux yeux de la population.
C’est dans ce contexte exceptionnel de crise économique et politique que les
institutions publiques islandaises vont mettre en œuvre un ensemble de procédures
démocratiques inédites à l’échelle nationale, suite à une mobilisation d'une partie de
la société islandaise pendant plus de quatre mois. La Constitution islandaise de 1946,
inspirée par l’ancienne puissance colonisatrice danoise, est périodiquement l’objet de
critiques. C’est donc la question de sa réécriture qui est logiquement placé au centre
de ce processus faisant appel aux outils les plus aboutis de la démocratie participative
et délibérative, avec l’appui de la Première Ministre sociale-démocrate Johanna
Sigurdardottir et de son gouvernement. La tenue d’un "Forum national" constitué de
plus de mille citoyens tirés au sort, l’élection d’une Constituante dont le personnel
11
politique est exclu, et la tenue de plusieurs référendums en sont les symboles les plus
éloquents.
C'est sur l'usage du hasard dans le jeu démocratique que nous nous
concentrerons, et plus particulièrement sur l'usage fait du tirage au sort au sein du
processus constitutionnel islandais. Autrement dit quels sont les principaux
enjeux portés par l'usage du tirage au sort en démocratie, et plus
particulièrement ceux portés par l'expérience du Forum National islandais ?
Nous nous interrogerons sur la portée politique de l'usage du hasard, sur les
transformations du concept de démocratie qu'il traduit, y compris au sein de la
société islandaise. Le tirage au sort et le Forum National qu'il a contribué à former
seront donc abordés comme étant des révélateurs des enjeux de pouvoir entre les élus
et leurs administrés, car l'ensemble du processus constitutionnel et des mobilisations
politiques depuis 2008 témoignent de relations tumultueuses entre les citoyens
islandais et leurs institutions politiques.
Mettre l'accent sur l'usage du hasard en politique implique de partir de
l'outillage théorique et philosophique mise en œuvre depuis les Lumières afin de
produire la pensée démocratique contemporaine, pour ensuite observer ce que
l'utilisation du tirage au sort révèle des changements de conception de la démocratie
en Islande. Nous nous demanderons plus globalement si ce supposé changement du
paradigme démocratique n'est pas le révélateur d'une transformation plus globale, qui
sortirait du cadre islandais. À ce titre, plusieurs hypothèses de travail guideront la
rédaction de notre mémoire. Nous pourrons notamment nous interroger sur le rôle
qu'ont eu les citoyens qui n'étaient pas issus du cénacle politique traditionnelle ni
d'une élection. S'il convient de s'interroger sur l'état des relations que le tirage au sort
traduit entre les citoyens islandais et le pouvoir politique traditionnel, il faudra aussi
s'interroger sur la nature même de ce tirage au sort. Était-il vraiment conçu comme
une procédure démocratique, ou n'était-il pas tout simplement davantage perçu
comme une forme d'échantillon de la population ?
Il faudra au cours de notre travail intellectuel ne pas croire naïvement que le
monde des idées engendre celui des faits, et qu'en matière de philosophie politique
12
une connaissance approfondie des idéaux charriés par la démocratie marquerait
automatiquement les agissements de tout acteur politique. L'idée n'est pas d'opposer
de façon artificielle ce qui serait d'une part du côté de la théorie, de l'abstraction
philosophique et de l'autre du pur concret, de l'expérimentation, ici en Islande. La
réflexion par laquelle nous cheminerons tout au long de notre exposé tentera
davantage de s'orienter vers des idées et des faits de plus en plus aiguisés, de plus en
plus précis. Notre but est à chaque nouvelle étape de resserrer davantage notre
raisonnement, d'user d'une loupe là où nous observions des structures générales et
des idéaux-types et ainsi de nous rapprocher des objets "Islande" et "assemblée tirée
au sort".
Dans un premier temps nous nous intéresserons à la problématique du
tirage au sort en démocratie de façon philosophique, scientifique et globale. Nous
tenterons de porter une réflexion sur les inspirations philosophiques du tirage au sort,
et donc sur les liens étroits qu'il entretient avec certaines conceptions de la
démocratie. Car si le tirage au sort n'est en soi qu'une procédure politique, il porte en
lui davantage de significations qu'un simple tirage de papiers dans un chapeau. Il
conviendra donc de s'intéresser aux principaux idéaux-types de la démocratie forgés
par des penseurs tels que Rousseau, Constant ou Dewey. Chacun forme des images
différentes de la démocratie idéale, privilégiant tantôt le peuple, les élus, ou les
experts. En observant leurs écrits et les analyses qui en auront été faites, nous
trouverons des images symboliques de la démocratie qui continuent d'influencer le
comportement et le discours des acteurs politiques. Nous nous intéresserons par la
suite aux travaux contemporains de la science politique dans les domaines croisés de
l'innovation démocratique et des analyses faites du rôle du tirage au sort et des
élections. Enfin il conviendra d'évoquer certains cas d'expérimentations
démocratiques, de s'interroger sur la portée générale de telles expériences ainsi que
sur la notion même de démocratisation, de transformations de la démocratie à l'ère de
la globalisation.
13
Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons davantage à un cas
particulier, celui de l'Islande. Nous évoquerons tout d'abord le pays lui-même, son
histoire et la récente crise économique, politique et morale qu'il a dû traverser. Nous
nous intéresserons donc à l'arrière-plan historique, les conditions dans lesquelles s'est
construit le pays, puis il conviendra notamment d'aborder les protestations et les
débats qui ont eu lieu au cours des années 2008-2009 et d'observer sur quels
changements concrets ceux-ci ont débouché, mais également quelles visions de la
démocratie ils ont pu contribuer à porter. Nous nous intéresserons ensuite plus en
avant à la question du tirage au sort avec l'expérience faite du Forum National en
2010. Il conviendra tout d'abord de connaître ses origines, ses sources d'inspirations
en évitant absolument toute lecture qui prétendrait tracer avec certitude la généalogie
des idées qui l'auraient inspiré. Nous tenterons d'en saisir la portée et les
implications, au-delà des manifestations d'enthousiasme, d'indifférence ou de
scepticisme qu'il aura pu rencontrer. Nous essayerons d'en comprendre les
mécanismes et les inspirations. Enfin nous observerons tout simplement ce qu'il en
reste aujourd'hui, trois ans plus tard.
Thèmes abordés
Nous ne faisons ici qu'une présentation extrêmement sommaire des thèmes
qui seront travaillés plus profondément tout au long du mémoire. Il ne s'agit pour
l'instant que de les circonscrire de façon grossière pour distinguer les notions clefs
qu'ils portent avec eux et les exigences de réflexion auxquels ils nous mèneront.
Le concept de démocratie et ses représentations. Le tirage au sort interroge
directement les représentations traditionnelles que nous nous faisons de la
démocratie, de par la confusion que nous entretenons souvent entre cette dernière et
l'élection. C'est donc d'abord des différents usages du mot démocratie dont il sera
question. Par l'approche historique avec la confrontation des vues antiques et
modernes, et dans le même temps travail sur les grandes approches philosophiques
de la démocratie, en particulier au travers des œuvres de Rousseau, Dewey et
14
Constant. Si Rousseau préfère calquer ses théories sur la démocratie directe antique
et sur les petits Etats, Dewey, lui, entretient une vision plus expérimentale du
système démocratique, qui ne doit sa survie qu'à sa capacité à s'adapter et se
transformer. Il sera nécessaire également d'y placer en porte-à-faux les analyses de
Constant et sa défense de la démocratie représentative et du cens.
Il est évident qu'il faudra à tout prix éviter au cours de notre réflexion
d'aligner ces réflexions offertes par la philosophie politique pour les énoncer
religieusement et ensuite clore le débat, tout comme on alignerait les pièces rares
d'un vieux musée. Nous l'avons déjà signalé, elles seront dans un premier temps
opposées, mises en contraste, comparées entre elles. Mais il restera surtout essentiel
de garder à l'esprit qu'elles ne correspondent la plupart du temps qu'à des formes
d'idéaux-types, forgées pour faciliter la compréhension humaine. Le terme d'idéal-
type est ici à prendre au sens wébérien3, c'est à dire comme une forme de modèle
théorique sensé faciliter les opérations de la pensée, une forme de "tableau de pensée
homogène"4. Il ne doit pas être confondu avec des réflexions qui feraient de la
démocratie un idéal, ici désirable, qu'il conviendrait d'atteindre. Il conviendra au
cours de notre travail de veiller à distinguer clairement ces deux lectures.
De plus au cours de notre mémoire nous distinguons la démocratie
traditionnelle, que nous qualifions parfois de "régime représentatif" en reprenant là
l'expression de Manin5, de l'idéal démocratique, que nous pourrions également
qualifier de "démocratie pure". La démocratie traditionnelle, ou représentative,
désigne donc avant tout des gouvernements se réclamant de l'idéal démocratique
mais dont les institutions restent la plupart du temps "imparfaites", voire se réclament
de procédures n'ayant originellement aucun lien avec la démocratie comme l'élection.
Nous opérons donc à trois distinctions : la démocratie comme idéal-type, la
démocratie comme idéal, et la démocratie comme institution.
Le hasard en politique et en philosophie. Dans le domaine scientifique, le hasard
3 WEBER M., Essais sur la théorie de la science [1904], Plomb, 1965, Paris 4 Ibid., p.181 5 MANIN B., Principes du gouvernement représentatif, Calmann-‐Lévy, 1995, 319 p.
15
reste ordinairement utilisé pour désigner une suite de causalités si complexes ou
chaotiques qu'elle reste hermétique à toute tentative de formulation et donc de
prédiction. Mais qu'en est-il dans le domaine politique ? Et quelles sont les pistes
ayant été tracées en philosophie pour aborder les thèmes du chaos et du hasard ?
Au niveau étymologique, le terme français provient de l'arabe al-zahr,
désignant le jeu de dés et se rattache donc davantage à la chance et au jeu. S'il a sans
doute emprunté à la langue castillane, les autres langues romanes usent davantage
dans leur expression courante de termes comme le sort ou la fortune. Ces mots, tout
comme l'usage de l'anglais "chance", désignent le hasard par ses résultats voire par
l'idée d'un destin, d'une volonté cachée derrière celui-ci. Une volonté qui aurait
délibérément laisser agir ce même hasard pour nous aider ou nous entraver.
Le hasard comme processus décisionnel semble ainsi relever d'un processus
"non-humain" pour reprendre Oliver Dowlen6 dont l'ensemble des qualités sont elles
mêmes des qualités "négatives". Le hasard en soi serait donc impartial, imprévisible,
dépassionné, dépourvu de toute émotion, amoral etc. Définir le hasard en des termes
positifs, qu'il s'agisse du domaine politique, philosophique ou mathématique, semble
être aujourd'hui encore une tâche extrêmement difficile.
Le recours au hasard peut également relever d'un refus volontaire de la prise
de décision : on accepte alors de laisser ce pouvoir à l'indiscernable, à l'inexplicable,
à une certaine forme de vide, cette contingence décrite par Rancière dans La Haine
de la Démocratie7. C'est cette difficile "domestication du hasard"8, pour reprendre
l'expression de Sintomer, qui peut aujourd'hui poser problème dans des démocraties
modernes qui plongent leurs racines dans l'âge des Lumières, posant la raison et la
logique comme des figures indépassables. Mais un système faisant véritablement
appel à la raison ne serait-il pas un système capable justement de prendre en compte
la part d'irrationnel dans son propre fonctionnement au lieu de la nier ? La
démocratie opère déjà par sa définition en une acceptation intrinsèque de certaines
6 DOWLEN O., The political potential of sortition, a study of the random selection of citizens for public office, Imprint Academic, 2008, 264 p., p.14 7 RANCIERE J., La haine de la démocratie, La fabrique, 2005, 112p. 8 SINTOMER Y., Petite histoire de l'expérimentation démocratique, tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours, La découverte, 2011, 296p. p.39
16
formes de contradictions, l'usage du hasard n'en serait-il pas une nouvelle forme, ou
tout du moins un révélateur puissant des contradictions consubstantielles à la
démocratie ?
L'Islande. Petit pays d'Europe septentrional de 103 000 km2, l'Islande
comprend l'une des densités humaines les plus faibles au monde avec environ 3
hab/km2, et compte 300 000 habitants dont la moitié dans sa capitale, Reykjavik.
Indépendant du Danemark depuis 1944, le pays possède toutefois l'une des traditions
parlementaires les plus anciennes au monde puisque l'Althing reste le plus vieux
parlement d'Europe, fondé en 930 peu après l'arrivée des premiers Vikings sur son
sol. Mais c'est surtout par la "révolution des casseroles"9 que le pays s'est fait
connaître après la crise. Les protestations de ses citoyens ont enclenché un cycle
inédit de jugement des responsables de la crise financière et économique traversée
par le pays et la mise en place d'un processus d'un tout nouveau genre dans la
rédaction de sa nouvelle constitution.
Au niveau politique, l'Islande est aujourd'hui un régime parlementaire
monocaméral, dont le Parlement, l'Althing, est constitué de 63 députés élus tous les
quatre ans à la proportionnelle. Depuis 1944 le principal parti de droite, le Parti de
l'Indépendance ou Sjálfstæðisflokkur, a gouverné sans discontinuer, souvent par le
biais de coalitions avec le Parti du Progrès, de centre-droit, et l'Alliance, parti social-
démocrate. La majorité s'est renversée brièvement de 2009 à 2013, avec l'accession
au pouvoir d'une coalition entre les sociaux-démocrates et les écologistes dans un
contexte de crise économique et social particulièrement aigu. Le président de la
République, également élu au suffrage universel tous les quatre ans, nomme les
ministres et a le pouvoir de dissoudre l'Althing. L'étendue de ses pouvoirs reste
toutefois sujet à débats, et si Ólafur Ragnar Grímsson, élu depuis 1996, s'est plutôt
cantonné à une fonction symbolique à ses débuts il s'est montré davantage actif ces
9 Terme utilisé notamment par Jérôme Skalski pour désigner les évènements de Reykjavik entre 2008 et 2009, elle s’inspire des « cacerolazos », manifestations typiques d’Amérique latine. Voir Skalski J, La révolution des casseroles, chronique d’une nouvelle Constitution pour l’Islande, Editions La Contre Allée, Septembre 2012, 102p. Il s'agit pour l'heure du seul ouvrage francophone à avoir traité de la crise islandaise.
17
dernières années, notamment en usant de référendums et par son refus de signer
certaines lois du gouvernement de Davíð Oddsson. Le monde politique islandais
restant peu connu, nous avons cru nécessaire de placer en annexe un bref
récapitulatif des derniers évènements connus par le pays ces dernières années.
Nous le constatons, l'Islande est un pays aux caractéristiques très
particulières : île particulièrement isolée, culture scandinave et faible population. Il
sera donc essentiel d'examiner davantage ce faisceau de spécificités pour comprendre
le rôle qu'elles ont pu jouer dans le nouveau processus politique islandais. L'Islande
reste un pays peu connu et il peut être facile d'y projeter un certain nombre de clichés
éculés sur les petites nations ou sur une culture scandinave souvent très idéalisée
dans nos pays. L'ouverture d'esprit devra donc être notre qualité première, il sera
nécessaire d'accepter notre ignorance devant un certain nombre de faits, parce qu'ils
nous seront inaccessibles au niveau linguistique ou bien parce qu'ils seront
circonscrits dans une culture interne qui ne peut être pénétrée en seulement quelques
mois de travail intellectuel.
18
Partie I. Du député au jeu de dés :
approche des théories philosophiques et
sociologiques du hasard en démocratie
Quelles sont les liens entretenus entre la procédure du tirage au sort et la
démocratie au sens large ? Le tirage au sort est-il fondamentalement démocratique
? Si oui, qu'est-ce qu'une telle relation nous indique sur la nature même des idéaux
démocratiques ? A l'inverse, le recours au hasard peut-il être utilisé au sein de
processus ne se réclamant pas de la démocratie ? Autant de vastes questions pour
lesquelles il sera nécessaire de circonscrire avec attention les réponses, de peur de
nous perdre. Le tirage au sort comme procédure politique doit rester notre fil
rouge pour nous permettre d'appliquer par la suite les débats qu'il soulève au cas
islandais. Nous observerons donc dans un premier temps différentes conceptions
de la démocratie et la façon dont celles-ci s'accordent au tirage au sort, pour
ensuite interroger plus prosaïquement la disparition de son usage au sein des
systèmes représentatifs occidentaux. Il sera nécessaire ensuite de s'interroger
davantage sur la notion de démocratie participative, de comprendre ses enjeux
contemporains. Le Forum national islandais semble en effet directement prendre
pied au sein de cette multitude d'expériences extrêmement diverses.
19
I. Démocratie : itinéraire philosophique d'un mot
face à l'apparente conflictualité du hasard et de
l'élection
Il s'agira dans un premier temps de questionner le concept de démocratie,
une notion qui semble parfois extensible à l'infini, proche du signifiant vide, en le
reliant à celui du tirage au sort comme procédé décisionnel. Le recours au hasard et
son caractère démocratique est la source d'une bataille des idées incessante, depuis sa
condamnation par Platon, sa réhabilitation par les penseurs des Lumières jusqu'à la
nouvelle valorisation qu'en fait Rancière. Si finalement peu de philosophes abordent
de front la question du tirage au sort, beaucoup en pensant à la démocratie
réfléchissent également aux sources de sa légitimité et à ses mutations.
Il ne s'agira pas ici de faire un historique des penseurs de la démocratie ou
du tirage au sort, les ouvrages sont légion dans ce domaine, mais de soulever plutôt
les idéaux types forgés à partir de quelques penseurs qui gardent aujourd'hui toute
leur pertinence et sont à la source des débats contemporains sur le caractère
démocratique du tirage au sort. On veillera ici avant tout à comprendre les
mécanismes de pensée ayant présidé à l’émergence des démocraties modernes afin
de saisir pourquoi le tirage au sort s’y voit réserver une place aussi étroite et
singulière. C'est par la suite que l'on se concentrera davantage sur la façon dont la
sociologie et la science politique ont abordé le problème de la démocratie et du tirage
au sort pour ce début de siècle.
1. La démocratie rousseauiste : critique de la représentation et
esquisse d'un système idéal
On a tout dit sur Rousseau. Considéré comme le principal inspirateur de la
République française avec l'écriture du Contrat social, on l'a donc logiquement
20
accusé d'avoir justifié la Terreur et le totalitarisme en théorisant l'existence d'une
volonté générale à laquelle l'individu ne saurait résister. A contrario certaines
analyses naïves en ont fait le nostalgique d'un mythologique état de nature. Nous
tenterons de sortir de ces tableaux caricaturaux de la pensée rousseauiste et de saisir
ce que les réflexions de Rousseau, prises avec toutes leurs nuances, peuvent nous
apporter pour penser la démocratie aujourd'hui et l'expérimentation du tirage au sort.
En effet la vision de la démocratie qu'a élaboré Rousseau au sein du Contrat
social est encore aujourd'hui fertile et nourrit les critiques des systèmes
représentatifs. Rousseau prend tour à tour des positionnements ambivalents d'une
part vis-à-vis de l'institution démocratique, dont il juge "qu'un gouvernement si
parfait ne convient pas à des hommes"10, et d'autre part à propos de la figure du
législateur en démocratie puisque selon lui "il faudrait des Dieux pour donner des
lois aux hommes"11. Ces paroles ne doivent pas laisser penser à une condamnation du
régime démocratique, car Rousseau décrit davantage le système démocratique
comme un gouvernement impossible à réaliser, jugeant ainsi que "il n'a jamais existé
de véritable Démocratie, et il n'en existera jamais"12, expliquant par la suite qu'elle
est contre "l'ordre naturel". La démocratie apparaît ici comme un idéal inatteignable,
ce qui ne signifie pas pour autant qu'il n'est pas désirable. Il voit à la réalisation de la
démocratie divers obstacles, à la fois dans le domaine technique de la gestion des
foules (taille, efficacité) mais également dans la nature humaine, en reprenant
Montesquieu et l'exigence de vertu des citoyens en démocratie exprimé dans De
l'esprit des Lois. En contrepartie Rousseau n'a de cesse de fustiger les représentants
et ne voit aucun inconvénient à opérer un mélange entre vote et tirage au sort sur le
modèle de la république de Venise13.
Ainsi Rousseau voit dans l'existence de représentants ou de députés le
symptôme d'un amollissement de la vie politique, d'un désintérêt des citoyens qui
préfèrent s'occuper de leurs affaires privées plutôt que du sort de leur nation. Il y
10 ROUSSEAUJ-‐J., Du contrat social [1762], Flammarion, 2011 256p., p.228 11 Ibid., p.203 12 Ibid., p.226 13 Ibid., p.264
21
fustige également le recours à l'argent par paresse, afin de payer soldats et
représentants, au lieu de faire la guerre et la politique soi-même14. Outre ces
considérations morales, Rousseau apporte également des arguments de logique pour
nier la possibilité d'avoir un gouvernement représentatif qui pourrait en même temps
garantir la liberté de ses propres citoyens. Sur ce point le Contrat social est clair :
"La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne
peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la
volonté ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n'y a point de
milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils
ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi
que le Peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle ; ce n'est point une loi".15
Contrairement à Benjamin Constant comme nous le verrons par la suite,
Rousseau ne croit pas au mythe de la représentation. La volonté générale, dans sa
définition même, ne peut émaner que du corps des citoyens et de personne d'autre.
On retrouve ici les racines du débat traditionnel entre souveraineté populaire (ici
défendue par Rousseau) et souveraineté nationale (défendue par Constant comme
nous l'observerons). De quelles racines provient une telle opposition ? Il faut pour
cela saisir que chez Rousseau les concepts d'égalité et de liberté sont intrinsèquement
liés et que l'égalité défendue par Rousseau ne souffre aucune exception. L'égalité
fonde le contrat social et en est la conséquence :
"(…) c'est qu'au lieu de détruire l'égalité naturelle, le pacte fondamental
substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu
mettre d'inégalité physique entre les hommes, et que, pouvant être inégaux en force
ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit"16
C'est cette même égalité, par le système du contrat social proposé par
Rousseau qui permet de définir la volonté générale, unique expression d'un ensemble
d'égaux : le peuple. Il semble donc impossible qu'un groupe plus petit au sein du
peuple, quel qu'il soit, puisse se prévaloir d'être à lui seul ce même peuple, de le
14 Ibid., p.250-‐251 Chapitre XV "des députés ou représentants" 15 Ibid., p.251-‐252 16 Ibid., p.189
22
"représenter". Cela romprait l'égalité de droit concomitante au pacte social et
ruinerait l'édifice de Rousseau. Ce dernier n'accepte que la possibilité du mandat
impératif17 et nie toute possibilité, comme nous l'avons déjà cité, de voir émerger une
autre source de la loi que la volonté générale, considérée non pas comme une
addition de volontés particulières mais comme une "personne publique" formée par
"l'union de toutes les autres"18. La souveraineté populaire est inaliénable et
indivisible, elle ne peut se déléguer19 sans quoi le corps politique s'annihile lui-
même.
Tout comme Montesquieu, Rousseau fait toutefois partie des Lumières qui
acceptent la possibilité d'élections, notamment par le biais du tirage au sort. Le terme
d'élection est ici à prendre à sa racine, comme simple expression d'un choix, et non
pas comme le résultat d'un vote, ce que nous confondons dans le langage actuel.
Reprenant Montesquieu qui affirme que "le suffrage par le sort est de la nature de la
démocratie"20, Rousseau estime de la même façon que le tirage au sort serait la
procédure la plus juste en démocratie :
"Les élections par sort auraient peu d'inconvénient dans une véritable
Démocratie où tout étant égal, aussi bien par les mœurs et par les talents que par les
maximes et par la fortune, le choix deviendrait presque indifférent. Mais j'ai déjà dit
qu'il n'y avait point de véritable Démocratie"21
Si Rousseau continue à postuler l'impossibilité de l'existence concrète d'une
"véritable démocratie", celui-ci démontre par contre de façon très simple les liens
intrinsèques entre égalité et tirage au sort. Ainsi l'usage du tirage au sort comme
processus de prise de décision dérive du constat d'égalité entre tous les citoyens, ou
17 Voir à ce titre ROUSSEAU J-‐J., Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réformation projetée [1772], disponible sur rousseaustudies.free.fr consulté le 06.06.13 Voir également ROUSSEAU J-‐J., Du contrat Social [1762], op. cit., p.190 Livre II chapitre I "En effet, s'il n'est pas impossible qu'une volonté particulière s'accorde sur quelque point avec la volonté générale ; il est impossible au moins que cet accord soit durable et constant ; car la volonté particulière tend par sa nature aux préférences, et la volonté générale à l'égalité." 18 Ibid., p.183 Livre I chapitre VI 19 Ibid., p.190-‐191 20 MONTESQUIEU, De l'Esprit des lois [1758], livre II Chapitre II 21 ROUSSEAU J-‐J., Du Contrat social [1762], op. cit., p.265 Livre IV Chapitre III
23
tout du moins de l'impossibilité de démarquer les citoyens entre eux, d'opérer à une
discrimination. Rousseau n'innove pas plus, mais l'on pourrait extrapoler, et se
demander si, au delà de l'impossibilité de la discrimination, il ne serait pas possible
également de théoriser cette fois un refus de la discrimination entre citoyens au
travers du tirage au sort. Autrement dit, pour aller plus loin que les analyses de
Rousseau et Montesquieu, nous passerions du "nous ne pouvons pas choisir" au
"nous ne voulons pas choisir", de l'expression d'une impossibilité à l'expression d'une
volonté, d'une morale publique où le choix des procédures de décision deviendrait
véritablement aveugle aux différences entre citoyens, leur accordant à tous les
mêmes capacités à gouverner. Autrement dit l'usage du sort ne serait alors plus un
choix par dépit, mais un choix réalisé volontairement, au nom de ce que le tirage au
sort "permet" et non pas de ce qu'il "empêche". Ce choix résulterait d'une forme
renouvelée du concept grec de l'iségorie, possibilité pour tout un chacun de
s'exprimer au sein d'une assemblée, et qui présuppose donc l'existence d'une
compétence politique chez chaque citoyen.
Rousseau ne considérant la démocratie que comme une sorte d'essence ou
de modèle théorique, il semble préconiser pour sa part un mélange entre vote et
tirage au sort. Le vote doit être utilisé pour les places demandant des "talents
propres"22, autrement dit des talents qui ne sont pas communs à tous les citoyens. Le
tirage au sort à l'inverse est dévolu aux tâches "où suffisent le bon sens, la justice,
l'intégrité, telles que les charges de judicature ; parce que dans un état bien
constitué ces qualités sont communes à tous les citoyens"23. Le portrait fait du bon
citoyen reste donc pour autant ambitieux. Rousseau considère qu'il est possible de
trouver chez chacun le sens de la justice et de l'intégrité. De plus s'il évoque la justice
comme domaine d'usage du sort, il ne limite pas pour autant son utilisation à ce
domaine comme cela est le cas dans nos systèmes représentatifs (l'usage du jury est
ainsi confiné à la sphère judiciaire).
22 Ibid., p.265 Livre IV Chapitre.III 23 Ibid.
24
Il nous reste enfin, au travers de l'œuvre de Rousseau, à tordre le cou aux
accusations faites au concept de volonté générale d'être la théorisation d'une dictature
du collectif. Cette précision rejoint notre recherche concernant la vision de la
démocratie entretenue par Rousseau, puisqu'elle se lie aux concepts de majorité et de
respect de la minorité. La volonté générale ne constitue pas l'expression de la
majorité, mais bien l'expression de l'intérêt de la collectivité. Ainsi : "on doit
concevoir par là, que ce qui généralise la volonté est moins le nombre de voix, que
l'intérêt commun qui les unit : car dans cette institution chacun se soumet
nécessairement aux conditions qu'il impose aux autres"24. La volonté générale est
davantage considérée comme l'expression d'un consensus que comme une dictature
de la majorité. De plus le second fait qui apparaît dans cette affirmation est qu'il n'est
pas possible de discriminer un groupe interne participant de cette même volonté
générale car elle ne peut se concentrer sur un objet particulier. En effet, procéder à
une différenciation au sein du peuple, c'est rompre avec sa nature :"la volonté
générale pour être vraiment telle doit l'être dans son objet ainsi que dans son
essence, (qu')elle doit partir de tous pour s'appliquer à tous"25. On perçoit ici ce que
l'on nommerait aujourd'hui une forme d'universalisme, le caractère général de la loi.
Ainsi pour Rousseau, le tirage au sort se trouve justifié dans son usage
comme un moyen de résoudre la question du nombre sans rompre pour autant le
binôme essentiel liberté/égalité qui lui est si cher et fonde une grande partie de sa
philosophie. Ici le tirage au sort est résolution du problème de la taille, mais aussi, et
Rousseau le perçoit, reconnaissance pour tout un chacun d'une certaine compétence
politique.
24 Ibid., p.196 Livre II Chapitre IV 25 Ibid., p.195 Livre II Chapitre IV
25
2. Démocratie moderne ou aristocratie élective ? La prudence de
Constant par l'usage de la délimitation
En sens inverse, quelles justifications ont été apportées par les penseurs
politiques quant à l'absence du tirage au sort dans les sphères de l'exécutif et du
législatif de nos systèmes actuels ? Pourquoi avoir fait de l'élection le point d'orgue
de l'esprit démocratique moderne ? Autrement dit pourquoi le régime représentatif,
hissé par les révolutions anglaise, française et américaine, est devenu le modèle le
plus abouti de démocratie aux yeux des élites occidentales ? Comment justifier un tel
glissement sémantique dans l'usage d'un mot qui était à l'origine antithétique avec
l'idée d'élection ?
La pensée politique de Benjamin Constant nous permet d'obtenir certaines
réponses à ces questionnements. Son parcours, marqué par le poids de l'expérience
politique et de la connaissance de ce qu'avait été la Terreur26 nous permet également
de saisir davantage une pensée qui peut sembler parfois datée. Si son discours sur "la
liberté des Anciens comparée à celle des Modernes"27 reste un classique de la
philosophie politique, il est plus difficile de comprendre l'actualité de ses "Principes
de politique"28 où celui-ci défend la monarchie constitutionnelle et l'usage du cens
dans la restriction du droit de vote. Pourtant l'exotisme historique ne doit pas
tromper. Nombre des raisonnements portés par Constant dans ce dernier ouvrage
résonnent étrangement avec certaines paroles actuelles. Ce sont les limites qu'elles
dessinent qui diffèrent, mais leurs chaînes logiques sont parfois identiques dans la
justification qu'elles opèrent du rôle de l'élu ou dans la défense de certaines
restrictions au droit de vote.
26 A ce titre, voir notamment TODOROV T., Benjamin Constant; la passion démocratique, Hachette Littératures, 1997 27 CONSTANT B., De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes [1819], Mille et une nuits, 2010 28 CONSTANT B., Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs (1815), Hachette Pluriel, 2006
26
L'un des mérites de la pensée de Constant est d'apporter une critique
aiguisée des systèmes de gouvernements de l'Antiquité à une époque où ils procurent
encore une certaine fascination et inspirent certains législateurs. Constant à l'inverse
y déplore l'état de guerre permanent et le peu de place laissée à l'initiative
individuelle et à la liberté personnelle. Son discours "De la liberté des Anciens
comparée à celle des Modernes", à travers la mise en évidence d'une transformation
du concept de liberté depuis l'Antiquité, apparaît comme une critique des visions de
la démocratie portées selon lui par Rousseau, Montesquieu ou l'abbé de Mably. Il est
notamment pour Constant l'occasion de critiquer la démocratie rousseauiste qui
fournirait "de funestes prétextes à plus d'un genre de tyrannie"29. Mais il opère
davantage cette critique par le biais des écrits de l'abbé de Mably, admirateur des
sociétés antiques, dont Constant affirme qu'il semblait regretter l'impossibilité pour la
loi de pouvoir régir complétement tous les aspects de la vie humaine30.
À l'inverse, Constant se présente comme un vibrant défenseur de l'individu
et de la sphère privée : "Nous sommes des Modernes, qui voulons jouir, chacun, de
nos droits ; développer, chacun, nos facultés comme bon nous semble, sans nuire à
autrui"31. Cet usage de la liberté individuelle est perçu comme étroitement liée à la
liberté politique. "La liberté individuelle (…) voilà la véritable liberté moderne. La
liberté politique en est la garantie ; la liberté politique est par conséquent
indispensable"32. L'exercice de la liberté politique constitue donc une conséquence
de l'exercice de sa liberté individuelle. Elle n'y est pas intrinsèquement liée, mais est
provoquée par la première. Voilà pour Constant le danger qui menace les systèmes
représentatifs aujourd'hui, où les citoyens accepteraient de se laisser guider par des
tyrans afin de ne pas avoir à exercer leur liberté politique et en croyant par là-même
garantir leur liberté, leurs droits individuelles. En percevant ce qu'il considère comme
un danger dans les écrits de Rousseau, la possibilité d'une souveraineté illimitée du
collectif, Constant pense la limitation du pouvoir en hissant le drapeau de la sphère
privée, et de la protection de l'individu contre le collectif.
29 CONSTANT B., De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes [1819], op. cit. p.24 30 Ibid., p.25 31 Ibid., p.34 32 Ibid., p.35
27
Il est évident que le portrait fait de la liberté chez ses contemporains, vue
comme une "garantie des jouissances qu'il (le peuple) chérissait"33, est perçu comme
essentielle dans la vision de la démocratie qu'entretient Constant. En craignant
d'enfermer la démocratie dans une définition unique, pure et éternelle, en se méfiant
des excès des foules, Constant se fait partisan de la modération, de la défense de la
propriété individuelle, du suffrage censitaire et du système représentatif. Si l'on suit
les analyses de Todorov34, Constant tente un dépassement des analyses de Rousseau
et de Montesquieu, en reconnaissant d'une part la légitimité de la volonté générale,
comme l'exprime de son côté Rousseau, et de l'autre la nécessité également de
prévenir les excès du pouvoir, à la fois en le divisant comme le préconisait
Montesquieu, mais également en le limitant. On peut estimer que Constant ne définit
pas la démocratie par un principe mais par une combinaison subtile entre l'expression
de la volonté générale et le respect de l'individu.
Si la démocratie peut être un danger pour l'individu en tombant dans l'excès
et le contrôle tyrannique, alors il faut en quelque sorte défendre la démocratie contre
elle-même. Pour sauvegarder l'individualisme, qui constitue par ailleurs une valeur
hérité de la révolution, Constant en appelle au gouvernement des élites terriennes,
qui guidées par leur conscience des intérêts collectifs du fait même de leur statut de
propriétaires, sauront éviter les excès du gouvernement démocratique. Plus
précisément, quel est le rôle dévolu aux élites ? Si selon Constant le seul pouvoir
légitime correspond à la volonté générale35, il l'est lorsque "le pouvoir du petit
nombre (est) sanctionné par l'assentiment de tous"36, autrement dit le gouvernement
représentatif peut tout à fait prétendre exprimer la volonté générale. A partir de cette
affirmation, plusieurs nouvelles interrogations se dégagent. Tout d'abord comment
choisir et agencer le gouvernement de façon à ce qu'il soit réellement représentatif, et
qu'entend-on même par l'idée de représentation ? Car la définition du "petit nombre"
33 Ibid., p.27 34 TODOROV T., Benjamin Constant; la passion démocratique, op. cit. p.33 35 CONSTANT B., Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs (1815), op.cit., p.14 36 Ibid.
28
pour Constant répond à des critères très particuliers, et puisqu'il faut désigner ce
"petit nombre", par quel biais le faire ? L'argumentation de Constant prend alors la
tournure des nombreux défenseurs des systèmes censitaires, pour exemple :
"Cependant il est désirable que les fonctions représentatives soient
occupées, en général, par des hommes, sinon de la classe opulente, du moins dans
l'aisance. Leur point de départ est plus avantageux, leur éducation plus soignée, leur
esprit plus libre, leur intelligence mieux préparée aux lumières. "37
Comme nombre de ses contemporains, Constant établit un lien quasiment
naturel entre l'état d'aisance et la capacité à gouverner. A la fois parce que "leur point
de départ est plus avantageux", mais également parce que "leur éducation (est) plus
soignée". Il s'agit là de deux affirmations qu'il n'aura de cesse de justifier au sein de
ces Principes de politique.
Il les justifie tout d'abord sur les liens entre vertu et argent, au travers d'un
argument qui reste encore d'actualité lorsqu'il concerne la rémunération des
représentants politiques. Constant estime38 ainsi que l'indépendance politique est liée
à l'indépendance financière, que l'existence d'un salaire pour les représentants risque
d'encourager ces derniers à ne désirer leurs postes que pour ses avantages matériels et
non dans l'optique de servir leurs électeurs. L'absence de compensation financière
dans le monde politique donne ainsi logiquement la place aux rentiers et aux
propriétaires.
Le deuxième aspect par lequel Constant lie la figure du bon représentant à
celui du propriétaire est celui de l'intelligence, des facultés intellectuelles39, qu'il
distingue peu des qualités morales. À la fois car ils auront été éduqués, mais
également car ils possèdent "le loisir indispensable à l'acquisition des lumières, à la
rectitude du jugement"40, rendu possible seulement par la propriété. On pourrait
disserter longtemps sur cette notion du loisir, mais toujours est-il qu'elle oppose la
classe des propriétaires à ceux de la classe dite laborieuse dont Constant affirme
qu'ils "ne sont ni plus éclairés que des enfants, sur les affaires publiques, ni plus
37 Ibid., p.100 38 Ibid., p.99 39 Ibid., p.115 40 Ibid., p.106
29
intéressés que des étrangers à une prospérité nationale, dont ils ne connaissent pas
les éléments"41. Les non-propriétaires directement comparés à des enfants, sont
traités ainsi en éternels mineurs, ni bons ni méchants, ignorant des véritables intérêts
de la collectivité. Si ces distinctions nous semblent aujourd'hui absconses, Constant
considère tout bonnement que l'exercice politique requiert de l'intelligence et une
forme de patriotisme, un amour pour la protection des intérêts de la collectivité. Ces
exigences sont encore d'actualité au cours de nos élections, même si nous ne
prétendons plus mesurer les qualités politiques directement à l'aune de l'argent ni les
circonscrire par le biais du suffrage censitaire42.
La description des critères permettant de repérer ces qualités reste d'ailleurs
une tâche ardue pour Constant. Celui-ci passe ainsi de nombreuses lignes à tenter
d'expliquer en quoi le propriétaire terrien est supérieur à l'étranger, au commerçant, à
l'industriel ou aux professions intellectuels. Celui-ci n'en tire que des conclusions
propres à son temps car la définition de la rectitude morale et des capacités politiques
est une source de débats constants et sans cesse changeants au cours de l'Histoire43.
Autrement dit si Constant aborde le problème du meilleur régime politique
au travers de l'élaboration d'un nouveau système inconnu des Anciens, la question de
la définition du bon représentant, elle, reste entière et n'acquiert rien de neuf. À
travers cette dernière se retrouve encore l'élaboration d'un critère objectif pour établir
une différence entre les citoyens, une vision aristocratique de l'exercice du pouvoir
sensée découler du pragmatisme libéral dont se réclame Constant. Ainsi pour lui,
seuls ceux qui sont en situation d'exercer leur liberté individuelle et politique sont en
capacité de la protéger. Cette conception de Constant, complétement incompatible
avec le tirage au sort, reste encore largement d'actualité. Les restrictions quant à la
41 Ibid., p.106 42 Les débats actuels portant sur le droit de vote des étrangers nous démontrent par ailleurs que la discussion de ces limites est finalement toujours d'actualité. 43 La légitimité pour gouverner est comme toujours supposée plus importante chez les forts, les plus âgés ou les plus intelligents, mais la ligne de démarcation entre le fort et le faible, le jeune et le vieux et entre ces catégories mêmes sont l'objet de discussions qui remontent à Platon et Les Lois où celui-‐ci recensait les différents titres à gouverner43. En énumérant les différentes formes de légitimité parmi lesquels se trouvaient celles issues de la filiation, de l'âge, de l'argent ou de la force, Platon donnait pour sa part sa préférence au gouvernement des sages, sages qui se doivent de guider les ignorants. Voir PLATON, Les Lois, III, 690a-‐690c
30
participation politique existent encore (âge, nationalité), et se retrouvent aussi dans la
construction de l'image d'une élite experte. En étudiant davantage le processus
constitutionnel islandais, nous constaterons que ces logiques ont également été à
l'œuvre, notamment au travers de conflits de légitimité dans l'élaboration de la
constitution entre spécialistes du droit et citoyens islandais.
3. Dewey et l'indéfini démocratique : refus de l'essentialisation et
ouverture d'un champ d'expérimentations
Nous constatons au fil de notre raisonnement que les motifs éthiques servant
à justifier l’existence des régimes se réclamant de la démocratie sont innombrables,
qu’il s’agisse de la recherche de la liberté pour Rousseau, du bonheur de tous chez
Bentham44 ou du respect des libertés individuelles pour Constant. Dans ces
conceptions, la finalité du système politique semble préexister à sa formation et
justifier à la fois son existence et sa structure. Elles peuvent ainsi argumenter en
faveur de l’élection, du tirage au sort ou du suffrage censitaire en se référant à des
principes immanents contenus dans la nature humaine. Cet usage de la nature faisait
dire à Dewey qu’elle sert trop souvent en sciences sociales à former des
raisonnements tautologiques45, et risque de rendre inefficiente et stérile la pensée
démocratique. En analysant davantage les particularités du système démocratique,
n’est-il pas possible de dégager d’autres chaînes logiques qui puissent nous permettre
d’échapper à ces circularités ? Ne faut-il pas à cet égard prendre distance par rapport
à Rousseau et Constant et supposer que les idées ne préexistent pas forcément à la
formation de tout nouveaux systèmes politiques ? Que ces derniers ne naîtraient pas
plutôt de diverses raisons matérielles, de coalitions hétéroclites d’intérêts et de
causes dont les acteurs politiques n’ont pas conscience ?
C’est ce que nous nous proposons de faire en explorant les analyses de
Dewey qui tente de décrire la démocratie comme un fait, et non comme la résultante
44 ZASK J., "Introduction" in DEWEY J., Le public et ses problèmes [1927], Folio, 2010 p.12 45 J. DEWEY, Le public et ses problèmes [1927], op.cit., p.90
31
claire et objective d’un projet politique46. En analysant les conditions d’émergence
de la démocratie moderne, celui-ci tente de décrire également les mécanismes du
vote et relativise ainsi sa portée symbolique.
Une fois débarrassé des oripeaux d’une lecture téléologique de l’histoire de
la démocratie, nous pourrons détacher la démocratie de l’idée de progrès, de son
perfectionnement inévitable. Face à l’autoritarisme, la démocratie reste davantage
l’exception au regard de l’histoire humaine que la règle. Il en est de même pour le
tirage au sort, procédure phare de la démocratie athénienne puis placé sous le
boisseau durant des siècles. Les techniques démocratiques suivent l’agencement et la
transformation des intérêts des acteurs politiques, elles se font et se défont. Nous
devons donc éviter de voir l’usage du hasard comme l’ultime accomplissement du
"moins pire de tous les régimes", mais questionner plutôt de façon très prosaïque les
motivations et les conséquences de son usage.
La construction mythique que forment nos sociétés autour du concept de
démocratie est à peu de choses près la suivante : après avoir connue une longue
éclipse de deux mille ans, victime des vicissitudes de l’Histoire, la démocratie
ressurgit de ses cendres lors de l’époque moderne. Née d’un temps mythique où
Grecs et Romains étaient davantage vertueux, où les dimensions modestes des cités
étaient plus propices à son développement47, elle aurait été revitalisée et ré-adaptée
grâce aux réflexions des Lumières d’une part, et grâce aux révolutions nationales de
l'époque moderne d’autre part. A partir de cet instant historique, la démocratie fait
donc corps à corps avec l’idée du progrès. La démocratisation des sociétés
occidentales, puis de celles du monde semble inévitable, se confond avec l’extension
du suffrage aux masses populaires, aux noirs, puis aux femmes, le droit de vote étant
devenu son symbole le plus éminent. Les révolutions sont des accélérations
soudaines de ce mouvement, tandis que les coups d’Etat, la répression et les
dictatures sont des freins, des facteurs accidentels qui seront inévitablement aplanis
46 Ibid., p.169 47 Voir notamment RANCIERE J., La Haine de la Démocratie, op. cit. p.48
32
par le travail du temps. Autrement dit la démocratie doit vaincre ou disparaître à
jamais.
Voilà de façon grossière la vision que nous entretenons de l’histoire de nos
institutions. C’est la même vision linéaire qui nous fait fantasmer une Antiquité
vertueuse, habile et féconde face à un Moyen-Âge obscur (et dont les contributions
aux systèmes parlementaires sont souvent oubliées). Corrélé à la notion de progrès,
cette démocratie fantasmée s’ouvre progressivement à l’expression des foules pour
répondre à l’idéal qui la fonde. Bâtie dans ses premières versions antiques par
quelques concepteurs politiques et philosophes géniaux48, elle renaît de la même
façon comme le fruit de constructions complexes des esprits des Lumières. Dans ces
vues, l’idée, l’essence démocratique préexistent à l’existence du système.
Nous pourrions signaler également qu’une telle lecture de l’Histoire reste
scandaleusement centrée sur le monde occidental, oblitérant les milliers d’autres
systèmes d’organisation du pouvoir imaginés par l’espèce humaine49. Cette remarque
n’est pas des moindres, puisque l’Occident aujourd’hui, dans sa tâche messianique de
propagation de la démocratie (ou plutôt de la conception qu’il en a) contribue encore
à propager de telles vues. Ce comportement nie l’aspect expérimental inhérent à la
démocratie et il nie également la diversité de ses formes. En Europe déjà, un bras de
mer a suffit pour voir émerger d’une part une monarchie constitutionnelle et
confessionnelle basée sur la Common Law et de l’autre une république laïque,
centralisée et basée sur le droit latin. Comment alors, avoir la naïveté de croire qu'il
n'existerait pas d'autres formes démocratiques complétement différentes d'un supposé
modèle standard occidental qui resterait aussi à définir. Autrement dit, il est sans
doute temps pour nous de prendre conscience que la "technologie démocratique"
n’est pas l’unique apanage des cultures occidentales et qu’il nous reste par exemple
énormément à apprendre des travaux de l’anthropologie politique.
48 Alors que l’on sait aujourd’hui que Clisthène et tant d’autres ont surtout rénové et systématisé des pratiques qui leur préexistaient 49 Voir à ce sujet notamment CLASTRES P., La Société contre l'Etat, Editions de Minuit, 1974
33
C’est à cette tâche que nous convie Dewey. En déconstruisant et
recadrant l’histoire des systèmes démocratiques, nous sommes invités à penser la
démocratie non plus comme une "idée claire et nette"50 mais davantage comme le
fruit d’expérimentations continuelles.
Pour cela, il convient dans un premier temps pour Dewey d’isoler le fait qui
l’intéresse, et ainsi de procéder à une distinction entre ce qui serait la "démocratie
éthique" et la "démocratie politique". Comme nous l'avons écrit, il s'agit pour Dewey
d'étudier un fait, et non un concept, même s'il a conscience que les frontières sont
bien plus floues qu'il n'y paraît entre ce qui relèverait du domaine éthique et du
domaine politique. Voilà pourquoi il décrira de façon très pragmatique la démocratie
politique comme "un mode de gouvernement, une pratique spécifiée pour
sélectionner des fonctionnaires et en contrôler la conduite en tant que fonctionnaires" 51, autrement dit une définition qui "contient en gros tout ce qui est pertinent pour
une démocratie politique". Ce qui intéresse donc Dewey dans un premier temps, ce
sont davantage les procédures de gouvernement que les comportements éthiques qui
vont en découler. Et c'est cette intuition qui lui permet par là même de discuter la
question des finalités historiques de la démocratie.
Ainsi Dewey explique :
« Or les théories et les pratiques relatives à la sélection et au comportement
des fonctionnaires publics qui constituent la démocratie politique ont été établies
contre l’arrière-plan historique auquel nous venons de faire allusion. En premier
lieu, elles représentent un effort pour neutraliser les forces qui ont si lourdement lié
la possession de l’autorité à des facteurs accidentels et non pertinents ; en second
lieu, elles expriment un effort pour neutraliser la tendance à user du pouvoir
politique en faveur de finalités privées au lieu de finalités publiques. Discuter du
gouvernement démocratique en général et indépendamment de son arrière-plan
historique, c’est rater son but et rejeter tout moyen de critique intelligente. En
adoptant un point de vue distinctement historique, nous ne dérogeons pas aux
revendications importantes et mêmes supérieures de la démocratie comme idéal 50 J. DEWEY, Le public et ses problèmes [1927], op.cit., p.170 51 Ibid., p.169
34
éthique et social. Nous limitons la discussion afin d ‘éviter « le grand mal », la
confusion de faits qui doivent être distingués." 52(je souligne)
Cet extrait est particulièrement emblématique et nous permet d'ajouter de
nouvelles branches à notre raisonnement. Dans un premier temps Dewey signale que
la distinction qu'il a opérée entre "démocratie éthique" et "démocratie politique"
n'empêche nullement de réfléchir sur le premier de ces concepts. En effet Dewey
dégage par la suite des termes essentiellement moraux en signalant notamment
qu'aucun régime politique n'incarne "quelque bien absolu et incontestable"53.
Autrement dit, considérer la démocratie, qu'elle soit éthique ou politique, comme un
régime bon en soi est une erreur. Et ce pour au moins deux raisons possibles et liées.
Premièrement la démocratie est un régime changeant, comment donc être
certain que la structure démocratique défendue est "la bonne" ou du moins "la plus
parfaite" ? Pourquoi ne pas imaginer qu'il puisse exister des régimes répondant plus
parfaitement à nos exigences ? Considérer la démocratie comme un régime à la
définition stable, autrement dit l'inclure dans un raisonnement conservateur, n'est-ce
pas prendre le risque de détruire toute possibilité d'adaptation du système en
devenant sourd aux critiques de ce même système, et le condamner à l'enkylosement,
à une dérive autoritaire voire à sa disparition54 ?
Deuxièmement parce que si la démocratie est instable c'est qu'elle n'a
pas d'essence véritable, ou tout du moins la définition même de cette essence est
source de débats et de conflits, elle est "insaisissable" pour reprendre également les
analyses de Lefort55. La démocratie constitue "un complexe de forces rivales"56, le
fruit d'intérêts divergents et conflictuels. Pour jouer sur les tautologies, on pourrait
affirmer que la démocratie possède par nature une nature changeante.
52 Ibid., p.169 53 Ibid. 54 L'usage de la démocratie comme d'un totem ou d'un dieu mériterait d'ailleurs d'être davantage exploré dans ses conséquences schizophréniques. Un gouvernement menant une guerre en Irak au nom de l'extension de la démocratie peut ainsi en venir à cautionner des actes eux-‐mêmes contraire à ses propres "valeurs démocratiques"… 55 Voir à ce sujet LEFORT C., L'invention démocratique, Fayard, 1981 56 J. DEWEY, Le public et ses problèmes [1927], op.cit., p.170
35
La définition stricte adoptée par Dewey se rattache au raisonnement
darwiniste qu'il souhaite y appliquer. Ainsi "c'est en vertu d'un accident politique
qu'on est parvenu à la sélection des dirigeants et leur attribution de pouvoirs"57, et
Dewey de citer d'autres formes adverses de gouvernement telles que la gérontocratie
ou le principe dynastique, ayant toujours trouvé bien plus d'échos au cours de notre
histoire. La démocratie serait donc un accident de l'Histoire mais un accident
"réussi". Adaptation évolutive, elle survit car elle répond à un certain nombre
d'intérêts au sein d'une population humaine donnée. Dewey pense la démocratie
comme système apte à la compétition par sa capacité à adapter ses propres
institutions tandis que le noyau dur de la démocratie, ici décrit par les termes "idéal
typique et social" n'est pas décrit ou nommé, Dewey s'y refusant sciemment. Et il le
fait sans doute avec raison puisque par là-même il évite de figer l'idéal démocratique
dans un marbre dont il ne pourrait plus s'extraire pour continuer à se modifier, étant
le fruit d'une expérimentation indéfinie.
57 Ibid., p.163
36
II. Apports des sciences sociales sur le tirage au sort :
procédures, fantasmes et mutations historiques
Nous avons dans un premier temps décrit les apports de la philosophie
politique et illustré les positions idéologiques qui traversent les débats sur la
démocratie et le tirage au sort au travers de trois productions idéalisées. Il convient
désormais d'observer davantage quels ont été les apports des sciences sociales dans
l'analyse du tirage au sort lui-même, mais également dans la construction
mythologique qui l'entoure. L'analyse philosophique nous a permis de prendre
connaissance des batailles d'idées présentes autour du mot "démocratie". Nous
l'avons constaté, certaines de ces conceptions sont plus favorables que d'autres à
l'introduction du tirage au sort. Si Rousseau estime qu'il est des tâches où les citoyens
peuvent tous prétendre à exercer le pouvoir, Constant considère que nous ne sommes
pas égaux dans notre capacité à gouverner. Ces paris sur la nature humaine ne sont
pas du goût de Dewey. Ainsi celui-ci fait de l'expérimentation démocratique une
nécessité inhérente à la nature de ce régime.
L'usage des sciences sociales doit nous permettre désormais de nous
concentrer davantage sur le tirage au sort en tant que processus décisionnel et comme
porteur de sens. Le domaine d'étude du champ démocratique reste si vaste qu'il est
impératif de nous limiter aux effets, perceptions et usages du tirage au sort. Nous
passerons ainsi par l'analyse socio-historique et les méthodes qualitatives de la
sociologie, mais il conviendra également de comprendre les apports plus récents des
mathématiques et des études statistiques dans ce qui semble être un retour en grâce
de l'usage du tirage au sort.
Dans un premier temps nous revisiterons les images fantasmées du tirage au
sort, notamment au travers de son exemple le plus connu, à savoir le modèle grec.
Comprendre les motifs avancés de sa disparition dans des systèmes se réclamant de
la démocratie nous permettra également de connaître les représentations que le tirage
37
au sort charriait alors avec lui. Enfin nous nous intéresserons également aux apports
des sondages et de l'analyse statistique, qui ont considérablement modifié nos
perceptions et nos connaissances du comportement des foules et de la prise de
décision collective. Elles ont ainsi transformé nos perceptions de la démocratie et
initié par là la mise en œuvre de plusieurs expériences.
1. Revisiter l'idéal antique à la lumière de l'analyse socio-‐historique
Nous l'avons vu, Constant se méfiait déjà de ceux qui prétendaient vouloir
imiter le modèle grec en omettant les spécificités de leur époque et de leurs
contemporains. Si l'Antiquité suscite aujourd'hui beaucoup moins d'enthousiasme
politique, Athènes par contre reste le principal et bien souvent le seul modèle connu
d'usage à grande échelle du tirage au sort en démocratie. L'usage du hasard,
systématisé et théorisé, y est vu comme l'une des procédures phares notamment au
travers des institutions de la Boulé et de l'Héliée. Bernard Manin, dans les Principes
du gouvernement représentatif58, nous montre toutefois qu'il s'agit d'un enjeu bien
plus complexe et que nous serions imprudents de projeter sur le système athénien des
conceptions politiques aux significations très différentes pour cette époque, telles que
les notions d'égalité, de réputation ou de mérite politique. En revisitant l'usage de ces
concepts, Bernard Manin nous permet également de saisir leurs effets sur notre
époque et de comprendre cet étrange retour en grâce du tirage au sort.
Nous explorerons par la suite davantage l'histoire de l'utilisation du hasard,
pour comprendre qu'il n'a jamais été limité au seul monde grec. Yves Sintomer, à
travers sa Petite histoire de l'expérimentation démocratique59, nous montre que cette
procédure a connu de nombreuses utilisations et que ses significations ont
énormément varié au fil du temps. Cette première approche du tirage au sort par les
sciences sociales doit donc nous permettre de dégonfler tout excès d'enthousiasme ou
de scepticisme à l'égard de cette procédure. Pour comprendre le tirage au sort, 58 MANIN B., Principes du gouvernement représentatif, Calmann-‐Lévy, 1995, 319 p. 59 SINTOMER Y., Petite histoire de l'expérimentation démocratique, tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours, La découverte, 2011, 296p.
38
l'observer avec honnêteté dans ses avantages et ses défauts, il convient avant tout
d'en retracer l'histoire et la multiplicité des usages. Nous comprendrons ainsi qu'une
procédure décisionnelle ne doit pas toujours être confondue avec le système politique
qui en use.
Nous ne rentrerons pas dans les détails les plus complexes du
fonctionnement de la démocratie athénienne, cela n'est pas notre propos. Il suffira de
savoir qu'aux côtés de l'Ecclésia, assemblée du peuple où les citoyens votent
directement propositions de lois, décrets et traités, les membres de l'Héliée (ou
tribunal du peuple) et de la Boulé, ou (Conseil des 500) ainsi que les Archontes sont
désignés au sort. Pour les décrire grossièrement, l'Héliée joue notamment le rôle de
tribunal pour les affaires civiles, tandis que la Boulé propose les lois et supervise
l'ensemble de la machinerie administrative athénienne. Le tirage au sort prévu pour
désigner les membres de ces institutions s'applique aux volontaires de plus de 30 ans,
désignés au sein du corps des citoyens, autrement dit les hommes libres de 20 ans et
plus60 dont sont exclus les métèques.
Or selon Bernard Manin, le principe cardinal qui préside avant tout au choix
du tirage au sort semble être la nécessité de la rotation des charges61, davantage mis
en avant que l'application stricte d'une forme d'égalité. La rotation entre gouvernants
et gouvernés doit permettre à tout membre du corps citoyen de prendre ses décisions
en envisageant la possibilité de se retrouver du côté de ceux qui devront en subir les
effets. Elle apparaît comme un outil visant à prévenir toute tyrannie, car elle détruit
toute barrière infranchissable, toute hiérarchie entre celui qui ordonne et celui qui
obéit, chacun pouvant se retrouver à la place de l'autre. Mais une telle exigence
réclame donc une rotation fréquente et une population restreinte sur laquelle
s'appliquer62, ce qui était le cas à Athènes. Le tirage au sort est préféré à l'élection
pour répondre à cet objectif, car l'élection limiterait aux individus les plus populaires
l'occasion d'accéder aux responsabilités. La possibilité de voir tout un chacun dans
60 Il s'appuie pour étayer cette affirmation notamment sur HANSEN M. H., The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, Blackwell, Oxford, 1991 61 MANIN B., Principes du gouvernement représentatif, op.cit., p.44 62 Ibid., p.48
39
les deux positions de gouvernant et gouverné serait donc faussée, ce que Manin
qualifie de "conflit potentiel entre principe électif et principe de rotation"63. Le
principe de rotation est donc perçu comme le principe sous-jacent à l'usage du tirage
au sort.
Nous le percevons également au fil de notre démonstration, il existe bien
entendu un lien entre égalité et tirage au sort, mais il semble qu'il ait été beaucoup
plus difficile à démontrer pour les Grecs (et il le reste encore aujourd'hui), car encore
eût-il fallu s'entendre déjà sur le concept d'égalité. Platon et Aristote distinguent ainsi
égalité arithmétique et égalité géométrique, autrement dit une égalité où les citoyens
sont égaux "à tout égards"64 tandis que l'égalité géométrique (ou proportionnelle
pour Platon) est une distribution qui prend en compte les besoins différents de
chacun. Si le tirage au sort est lié à l'égalité, il ne s'agit d'aucune de ces formes.
Bernard Manin la rattache davantage à "l'égale probabilité d'obtenir un bien"65,
autrement dit une égalité en terme de probabilité. La probabilité ayant été
conceptualisé seulement à partir du XVIIème siècle, il n'était donc pas possible pour
les Grecs d'établir un lien clair entre tirage au sort et égalité. Il était par contre tout à
fait concevable qu'il fût impossible de calculer le mérite ou la vertu politique qui
aurait permis de différencier parmi les citoyens ceux aptes à gouverner et les autres.
C'est cette reconnaissance, critique implicite de l'élection, qui fait du tirage au sort
l'outillage le plus adapté à la répartition des charges politiques.
Nous constatons ainsi que les liens entre tirage au sort et égalité n'ont pas
toujours été clairs et évidents. D'autres principes sont parfois convoqués pour
justifier de son utilisation. Si aujourd'hui on met en avant l'aspect démocratique de
cette procédure (mais nous l'avons vu, le concept de démocratie est lui-même un
véritable champ de bataille), le tirage au sort a également été utilisé à d'autres
instants de notre histoire, et pour des motivations différentes. Cette procédure
décisionnelle, utilisée également durant le Moyen-Âge, passe alors plutôt pour être
63 Ibid., p.49 64 Ibid., p.56 65 Ibid., p.59
40
un procédé de résolution des conflits. Les procédures extrêmement complexes
élaborées durant la République de Venise, mais également à Florence ou sous la
Couronne espagnole nous montrent que l'on en use aussi pour éviter les
affrontements entre factions familiales et entre groupes sociaux.
A Venise le tirage au sort est utilisé du XIIIème siècle jusqu'à la fin de la
République en 179766. Son usage atteint une complexité encore jamais renouvelée
depuis, et un savant mélange entre hasard et élections. Le Grand Conseil alterne ainsi
vote et tirage au sort pour le choix du doge, de telle sorte qu'il est impossible d'en
prévoir le résultat. C'est donc le caractère d'impartialité et de neutralité qui préside
avant tout à l'usage du tirage au sort à Venise. L'utilisation du hasard est également
observée à Florence, afin d'endiguer le chaos résultant des luttes entre familles et
entre corporations dans l'accès aux postes à responsabilités. Il semble même possible
d'y deviner l'existence d'autres principes justifiant son usage. On l'observe au travers
d'une rotation rapide des responsabilités, l'impossibilité de cumul des mandats ou
l'obligation de rendre des comptes en fin de législature67. Mais c'est surtout
l'émergence du Grand Conseil en 1494 qui voit émerger de nombreux débats dans la
cité sur les équilibres à atteindre entre élections et tirage au sort et sur les qualités
requises chez un bon gouvernant68. L'inclusion de la petite bourgeoisie, voire d'une
partie des classes populaires au sein de certaines charges publiques permet à nombre
de Florentins de s'enorgueillir de leur système politique. Mais même si l'idée selon
laquelle tous les citoyens doivent avoir le même accès aux charges publiques est
fréquemment partagée69 le gouvernement florentin reste en grande partie de caractère
oligarchique. La cooptation et la tenue de discussions en dehors des cercles officiels
du pouvoir restent la règle.
66 SINTOMER Y., Petite histoire de l'expérimentation démocratique, tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours, op.cit., p.56 67 Ibid., p.63 68 DOWLEN O., The political potential of sortition, a study of the random selection of citizens for public office, op.cit., p.108 69 Ibid., p.115-‐116
41
Enfin la pratique de" l'insaculación", une forme de tirage au sort, au niveau
municipal en Espagne du XIVème au XVIIIème siècle reste à signaler70, tout comme
celle opérée à l'échelle des "Cortes", ou parlements espagnols durant le XVIème
siècle. Le système municipal, s'inspirant des techniques italiennes, relève également
d'une procédure destinée à atténuer les conflits. Mais il est également l'occasion de
permettre à chaque groupe social d'être représenté. Le tirage au sort permet de
recréer un microcosme de la communauté, pour reprendre Sintomer71. On retrouve
ici, étrangement, l'un des arguments qui est aujourd'hui à nouveau utilisé pour
justifier de l'usage du hasard : le fait que le tirage au sort permette, appliqué à un
grand nombre de citoyens, de représenter un "échantillon" de la société. Toutefois la
comparaison s'arrête là. Les Espagnols du Moyen-Âge ignoraient tout du mécanisme
de probabilité et d'échantillon représentatif, et le choix des groupes destinés à être
représentés reflétait l'organisation des guildes et des corporations d'alors, chaque
personne n'étant pas considéré dans son individualité mais par le groupe social
auquel elle appartient. La volonté de pacifier les relations sociales, elle, reste
présente.
Nous le constatons, le tirage au sort a fréquemment été utilisé tout au long
de notre histoire. Et il est probable que d'autres usages aient également eu cours hors
d'Europe et sans doute au sein de systèmes politiques variés. Car si nous pensons son
usage strict comme le plus démocratique, cela reste principalement dû aux réflexions
des philosophes. Platon, Aristote, Rousseau ou Montesquieu ont été amenés à penser
à des formes "pures" des régimes politiques, et eux-mêmes en contrepartie en
proposaient des formes mixtes. Nous constatons que le tirage au sort a eu sa place au
sein de gouvernements mixtes72, y compris dans des gouvernements à dominante
oligarchique voire, nous l'avons vu pour l'Espagne, monarchique. En soi, le tirage au
sort ne signifie rien. Il n'est qu'un procédé de gouvernement. Il convient d'observer le
dispositif général qui l'entoure, le pouvoir accordé à ceux que sa main choisit mais
70 SINTOMER Y., Petite histoire de l'expérimentation démocratique, tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours, op.cit., p.79 71 Ibid., p.83 72 Nous reprenons ici l'expression de Rousseau, voir ROUSSEAUJ-‐J., Du contrat social [1762], op.cit., p.235 Livre III Chapitre VII
42
aussi les desseins qu'il traduit. Sur le modèle pragmatique et expérimental de Dewey
nous éviterons donc de réduire l'idéal démocratique, à prendre ici en termes moraux,
à un procédé décisionnel.
2. Pourquoi le tirage au sort a disparu. Transformations conceptuelles et
techniques des systèmes de pouvoir occidentaux
Dans ce cas comment comprendre la disparition totale de l'usage du hasard
dans les domaines législatif et exécutif des gouvernements occidentaux à partir du
XVIIIème siècle ? Cette disparition a-t-elle un lien avec les glissements du terme
"démocratie" dont, nous l'avons vu, il convient de ne pas le réduire trop vite à cette
procédure ? Ces interrogations amènent immanquablement à faire basculer nos
interrogations sur un autre type de procédé, à savoir le procédé électif. Toutefois il
sera nécessaire d'éviter tout élargissement imprudent. Nous devrons donc avant tout
nous demander comment les concepteurs des systèmes démocratiques modernes ont
fait triompher l'élection, et quels intérêts a pu servir l'introduction du mécanisme
électoral. Nous devons interroger à la fois le glissement sémantique, les justifications
morales et pratiques apportées par ces acteurs mais également les intérêts matériels et
sociaux qui se trouvaient promus par l'introduction du vote. Nous avions déjà pu en
percevoir certaines facettes avec le discours porté par Constant en faveur du système
représentatif et sa défense de la figure du bon propriétaire. Un tel intérêt doit nous
permettre de comprendre le caractère incongru que possèdent aujourd'hui les
propositions d'introduction du tirage au sort.
Les philosophes des Lumières n'oblitèrent pas encore le tirage au sort et
l'abordent comme un procédé de la même importance que l'élection. Rousseau ou
Montesquieu évoquent son utilisation, mais aucun n'en préconise un usage unique.
Nous l'avons vu chez Rousseau par exemple, où il suggère plutôt de le mêler à
l'élection et de le réserver surtout aux tâches politiques les plus simples73. La
confiance dans le tirage au sort reste ambivalente, semblable à celle que l'on place 73 ROUSSEAUJ-‐J., Du contrat social [1762], op.cit., p.265 Livre IV Chapitre III
43
dans la sagesse des foules ou dans les capacités politiques de l'homme du commun.
Ainsi les révolutions anglaise, américaine et française seront venues sonner le glas de
la possibilité d'user du hasard. Celui-ci, perçu comme un système archaïque, se
trouve disqualifié pour plusieurs raisons. On y compte notamment l'invention de la
fiction de la représentation au travers de parlements élus, la disparition du principe
de rotation mais également l'émergence de professionnels de la politique.
En justifiant de l'usage du vote et de l'élection, les participants aux
révolutions du XVIIème et XVIIIème siècles consacrent le principe de souveraineté
nationale, ils affirment que la volonté générale peut se déléguer par l'intermédiaire de
représentants dont les conditions d'éligibilité apparaissent souvent plus restrictives
que celles accordés au citoyens pour voter. Nous ne referons pas ici le débat entre
souveraineté populaire et nationale, celui-ci a déjà été évoqué en décryptant les
œuvres de Rousseau et Constant. Toutefois il est à signaler que l'invention des
régimes représentatifs consacre l'affrontement entre le principe électif et le principe
de rotation, et la défaite de ce dernier. Par l'analyse de la pensée d'Harrington,
Bernard Manin montre que c'est l'élection à intervalles réguliers qui désormais est
jugée suffisante pour permettre à tous de participer à la vie politique74. Il suffit que le
système politique permette aux meilleurs parmi les citoyens d'accéder aux
responsabilités politiques et aux électeurs de pouvoir voter fréquemment. Le vote par
intervalle est perçu comme une participation politique suffisante qui convient à la
majorité des citoyens. S'y conjugue également une confiance bien plus marquée dans
la capacité des masses à pouvoir désigner les plus méritants par le biais de l'élection75
à l'inverse du hasard vu comme une procédure irrationnelle.
Mais le mouvement le plus large contrariant l'usage du hasard semble être
l'émergence d'une classe d'élus. Sa défense se mêle aux raisons évoquées
précédemment. Elle se mêle également au discours sur les liens entre vertu et aisance
des représentants. Constant justifie cette émergence en comparant les représentants à
74 MANIN B., Principes du gouvernement représentatif, op.cit., p.95-‐96 75 Ibid., p.100
44
des intendants76 : les élus doivent être au service des citoyens qui ne peuvent pas
consacrer leur temps aux affaires politiques et préfèrent l'utiliser pour le commerce.
La politique est donc une tâche qui requiert savoir-faire et connaissance, comme
n'importe quel ouvrage industriel ou artisanal. C'est cette conception qui mènera peu
à peu à la professionnalisation du monde politique.
De plus l'élection, on le perçoit peu à peu à l'époque, a tendance à désigner
les membres des classes sociales les plus aisées77. S'il s'agit d'un lieu commun
aujourd'hui pour les sciences sociales, les mécanismes de violence symbolique et de
légitimité culturelle sont bien sûr inconnus à l'époque et le choix des électeurs est
perçu comme la désignation rationnelle des meilleurs. Ce constat de la corrélation
entre éligibilité et position sociale est d'ailleurs loin d'être évident à ses départs, ce
qui incite les concepteurs d'élections à établir des restrictions de richesse pour
pouvoir être élu représentant, comme nous l'avons vu avec Constant78. Cette
corrélation entre appartenance aux classes aisées et possibilité de se voir élu est plus
rapidement observée aux Etats-Unis79 puis son constat gagne l'Europe. Les critères
d'éligibilité tombent peu à peu au cours des siècles suivants et s'accompagnent d'un
élargissement du corps d'électeurs, l'usage de la procédure élective ayant démontré
qu'elle ne remettait pas fondamentalement en cause l'ordre social. Elle permet de
garantir ce que Manin qualifie de principe de distinction des régimes représentatifs.80
Autrement dit : la mise en place délibérée de "citoyens distingués" à la tête des
fonctions politiques durant le XVIIIème siècle. Si en Grande-Bretagne la
représentation politique est conçue comme une façon d'avaliser une autorité
"naturelle", la France révolutionnaire est le lieu des mesures les plus explicites
formulées dans l'optique d'une différenciation entre citoyens qualifiés de "passifs" et
"actifs". L'élaboration par la Constituante de 1789 du cens d'éligibilité, ou "condition
du marc d'argent", doit éviter l'accès au pouvoir de n'importe quelle personne issu du
corps d'électeurs en limitant le nombre de potentiels représentants à 1% de la 76 CONSTANT B., De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes [1819], op. cit. p.39 77 MANIN B., Principes du gouvernement représentatif, op.cit., p.92 78 CONSTANT B., Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs (1815), op.cit., p.105 79 MANIN B., Principes du gouvernement représentatif, op.cit., p.169 80 Ibid., p.124
45
population totale81. Il est toujours complexe de connaître les raisons menant à une
telle discrimination, les plus altruistes en appellent à la stabilité de l'Etat, mais
également à la lutte contre la corruption, toujours dans l'idée selon laquelle le citoyen
non-propriétaire serait moins vertueux, plus fasciné par l'argent et ainsi plus facile à
corrompre. Ces classes d'arguments font écho à d'autres, plus intéressants où cette
fois ce sont les propriétaires qui défendent eux-mêmes leur vertu sous prétexte qu'en
possédant la terre ceux-ci partageraient les mêmes intérêts que ceux garantissant la
permanence et la sauvegarde de l'Etat. En proclamant "l'Etat c'est nous", les
propriétaires ne mettent-ils pas en lumière des liens intrinsèques entre la nature
même de l'Etat, l'histoire de sa formation, et la position de ses dirigeants ?
Enfin et surtout, l'élection se conçoit comme l'expression d'une volonté,
tandis que le tirage au sort, par nature, n'en est issu d'aucune. Or les régimes
représentatifs semblent se rattacher à un second principe, celui de consentement82. Ce
principe, inspiré de la philosophie de Locke trouve également ses sources dans
l'établissement des assemblées médiévales et dans la réglementation progressive de
l'usage du sort opérée par l'Eglise au cours des siècles. Si les théories du contrat
social ayant inspiré le législateur se basent sur l'expression du consentement des
gouvernés, alors elles demandent bien à ces mêmes gouvernés d'exprimer une
volonté, or l'expression d'une volonté ne peut s'obtenir par l'usage du hasard.
Le principe de consentement se confond avec la notion de participation
politique et supplante l'idée de rotation sur le temps long historique. Le Moyen-Âge
voit émerger des assemblées dans les royaumes occidentaux, assemblées de plus en
plus fréquemment convoquées pour permettre aux autorités de lever plus d'impôts
par l'application du principe dit Q.O.T, quod omnes tangit, ab omnibus tractari et
approbari debet. Issu du droit romain et redécouvert au XIIème siècle, cette notion
signifie que "ce qui touche tout le monde doit être approuvé par tout le monde"83.
81 GUENIFFEY P., Le Nombre et la Raison, La révolution française et les élections, Editions de l'EHESS, 1993, Paris, p.100 82 MANIN B., Principes du gouvernement représentatif, op.cit., p.115 83 ROSANVALLON P., La Contre-‐démocratie. La politique à l'âge de la méfiance, Seuil, Paris, 2006, p.129
46
Cette formule évoque une "approbation" et non une participation, ce qui permet ainsi
d'établir et justifier le glissement d'une participation aux responsabilités politiques
qui serait permise à tous sur base du tirage au sort, à l'expression régulière d'un
consentement opéré par les administrés par le biais du vote ou de l'élection de
représentants.
Enfin nous l'avons déjà signalé, le tirage au sort n'est censé être l'expression
d'aucune volonté, y compris d'une volonté surnaturelle ou fictive. Il aurait été
pourtant possible d'y voir l'expression d'une volonté divine, comme cela était le cas
lors de son usage sous la Rome antique84, mais une telle utilisation s'est vue frappée
d'interdiction par l'Eglise. L'usage du sort n'est vu comme moralement acceptable
dans les sociétés médiévales occidentales que lorsqu'il est dénué de tout caractère
religieux, autrement dit lorsque l'on ne le voit que comme la pure manifestation du
hasard. Il ne pouvait donc pas être utilisé pour le choix de ses représentants dans un
système basé en parti sur le consentement, et ce d'autant plus dans des sociétés qui en
appelle à la Raison, et déplace la source de la souveraineté de Dieu et/ou son
représentant au peuple lui-même.
Nous le constatons donc, le tirage au sort a disparu peu à peu car celui-ci
s'est vu cantonné au rôle d'une procédure d'évitement des conflits. Le caractère
égalitaire qui pouvait être décrypté dans sa fonction aura été en quelque sorte court-
circuité par la proclamation du droit de vote comme principe d'égalité et comme
expression du consentement. Ces conceptions semblent encore très prégnante dans
nos sociétés, et si la question du tirage au sort revient dans le débat démocratique, il
serait intéressant de voir si cette configuration est rediscutée ou bien si la justification
de l'usage du hasard prend d'autres chemins.
84 MANIN B., Principes du gouvernement représentatif, op.cit., p.115 Si nous n'avons pas évoqué le tirage au sort à Athènes comme démonstration de la volonté des dieux c'est qu'il a été démontré que son usage n'avait tout simplement rien de religieux, voir HANSEN M. H., The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, op.cit.
47
3. Les apports des analyses statistiques : la démocratie est-‐elle un jeu
comme les autres ?
Nous l'avons vu, la procédure du tirage au sort en politique a connu une
histoire mouvementée au fil des siècles en occident. Son usage s'est tari avec
l'émergence des systèmes représentatifs, à l'exception du domaine judiciaire, où il
reste encore utilisé pour la création des jurys, inspirés en France par les exemples
américain et anglais. Le tirage au sort s'est ainsi vu confiner à des tâches précises (le
jugement en cour d'assise) et exclure de celle de produire des règles générales
concernant l'ensemble de la société (domaine législatif). Nous l'avons constaté, le
procédé du tirage au sort était désomais largement engoncé dans le seul rôle de
garant d'impartialité, au détriment de la possibilité qu'il donnait aussi d'accorder à
tous l'égale probabilité d'accéder aux fonctions politiques ou de refléter plus
fidèlement l'opinion générale. La notion d'échantillon représentatif reste, elle,
inconnue jusqu'à la fin du XIXème siècle, tandis que les calculs statistiques et l'usage
des probabilités restent encore des disciplines jeunes à l'heure des révolutions du
XVIIIème siècle. Or ce sont principalement ces domaines, conjugués à l'élaboration
des premiers sondages au XXème siècle qui vont contribuer à impulser une nouvelle
réflexion sur la question du hasard en politique, voire même à sa domestication, au
travers de nouvelles expérimentations démocratiques.
Concevoir qu'une assemblée tirée au sort puisse représenter une version en
miniature de la société dans son ensemble est une idée nouvelle et sa démonstration
scientifique donne de nouveaux gages à l'utilisation du tirage au sort. Elle se lie au
débat habituel sur le rôle du représentant. Le représentant doit-il être une sorte
d'image-miroir du peuple ? Mais s'il est choisi parmi les meilleurs, n'a-t-il pas plutôt
prétention, par ses capacités jugées supérieures, à guider la nation ? Il est ici
intéressant de constater que des progrès en mathématiques ont permis par ricochet de
bousculer les représentations politiques traditionnelles. Ainsi l'extension du champ
des connaissances humaines provoque des effets contradictoire et chaotiques, la
réflexion sur les probabilités et sur le concept d'échantillon représentatif est venu
impacter certains concepts de science politique. Le développement des calculs de
48
probabilités s'appuie notamment sur les travaux de Pascal du XVIIème siècle et par
la suite sur ceux de Condorcet. Il prend par la suite son essor à partir du XVIIIème
siècle avec son application croissante aux jeux de hasard, développement qui conduit
d'ailleurs à l'élaboration des premières loteries nationales dont la Loterie royale de
France85 en 1777 qui reste jusqu'à aujourd'hui une source non négligeable de revenus
pour l'Etat.
En parallèle la comptabilisation des populations nationales prend son essor
et s'accompagne d'une amélioration des outils statistiques mis à la disposition de
l'Etat. Paradoxalement, en prétendant gérer leur population, les administrations
doivent non plus considérer leurs nationaux en ensemble de guildes, d'ordres ou de
corporations mais comme des individus, pris un par un et tous égaux en leur qualité
de simple individu. Le développement des recensements au XIXème siècle, la
tentation d'utiliser des moyennes et ce que l'on nomme alors des "échantillons
typiques" créent débat. On y trouve d'une part les partisans de l'existence d'un
individu moyen dévoilé par les statistiques comme Quételet mais aussi le docteur
Villermé, et d'autre part les partisans d'un individu dont les spécificités ne sont pas
réductibles à l'outil statistique, comme Claude Bernard86. Quételet notamment tente
d'élaborer des calculs statistiques en s'appuyant sur la loi des grands nombres de
Bernoulli, élaborée en 1713. Cette loi mathématique, à l'origine du concept
d'échantillon représentatif stipule tout simplement que si nous tirons au hasard un
grand nombre de fois par exemple des boules noires et blanches dans une urne dont
nous connaissons le rapport numérique, ce même rapport entre boules blanches et
noires s'observera également dans l'ensemble des tirages réalisés. Mais l'usage des
probabilités appliqué à la démographie humaine ne peut pas permettre de prendre en
compte les spécificités et les besoins de chaque terrain87, elle ne peut tout au plus que
servir à donner des tendances collectives impossibles à appliquer à un seul individu.
L'usage du hasard sera finalement progressivement admis dans l'étude statistique à
85 SINTOMER Y., Petite histoire de l'expérimentation démocratique, tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours, op.cit., p.140 86 DESROSIERES A., La politique des grands nombres Histoire de la raison statistique, La découverte, 2010, 460 p., p.110-‐111 87 Ibid., p.114
49
partir du début du XXème siècle88 mais sous des conditions restrictives qui excluent
notamment l'usage de quotas. Ainsi l'emploi du hasard dans les statistiques diffère
des sondages où la question de la constitution de l'échantillon représentatif par quotas
reste aujourd'hui encore sujet à débats. De même la question ou non de quotas selon
le genre ou l'origine géographique s'était posée pour le Forum National d'Islande de
2010 ou pour les expériences de tirage au sort réalisées en Colombie Britannique89.
De façon générale, l'élaboration des sondages, et l'âge d'or qu'ils connaissent
aujourd'hui ont énormément contribué à populariser l'idée selon laquelle un petit
groupe de personnes, numériquement réduit au millier la plupart du temps, pouvait
permettre d'apprendre de l'ensemble d'une population. Le succès croissant des
enquêtes d'opinion a permis aux instituts de sondage de jouer un véritable rôle
politique et de prétendre, aux côtés de l'élection et du référendum, dire la "réalité de
l'opinion publique"90.
Les premières années d'élaboration des enquêtes d'opinion auront toutefois
été laborieuses, notamment vis-à-vis du monde universitaire mais également dans
l'élaboration de méthodes statistiques fiables, élaboration qui tenait alors plus de
l'intuition que de véritables logiques mathématiques. La forme des sondages ne cesse
de varier et de suivre des méthodes différentes durant les années 4091. Pour exemple
les échantillons pris diminueront au fil du temps jusqu'à atteindre la barre
traditionnelle et symbolique de 1000 personnes (nombre qui ne connaît d'ailleurs
aucune justification statistique en soi). Par la suite les sondages gagnent peu à peu en
légitimité, notamment par la prédiction réussie de l'élection de Roosevelt en 1936. Si
jusqu'à aujourd'hui leur usage reste encore sujet à polémiques, force est de constater
qu'ils semblent avoir rempli une place jusque là laissée vacante dans nos systèmes
politiques. En prétendant donner sans cesse l'avis de ce que serait l'opinion
88 BLONDIAUX Loïc, La fabrique de opinion Une histoire sociale des sondages, Le Seuil, 1998, Paris, p.170-‐171 89 SINTOMER Y., Petite histoire de l'expérimentation démocratique, tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours, op.cit., p.182 90 BLONDIAUX Loïc, La fabrique de opinion Une histoire sociale des sondages, op.cit., p.15 91 Ibid., p.176
50
publique92, ils ont sans doute contribué également à renforcer cet argument d'autorité
jusque là difficilement saisissable. En opposant incessamment les sondages et les
données de l'opinion publique face à l'argumentation des experts, à des députés qui
"connaissent le terrain", n'ont-ils pas légitimé à nouveau l'opinion du citoyen lambda
?
Enfin l'étude des nombres, outre la multiplication des expériences que nous
citerons par la suite comme les sondages délibératifs de Fishkin, donne parfois des
résultats étonnants. En prenant comme base un modèle simplifié d'assemblée et du
comportement de ses représentants, des chercheurs en statistiques, en physique, en
économie et en science politique de l'Université de Catane93, en Italie, ont tenté de
démontrer que dans certains cas l'introduction d'une part de tirage au sort dans un
système monocaméral permettait à celui-ci de prendre davantage de décisions
favorables à l'intérêt général. Cette étude reste bien entendu très expérimentale, mais
elle a le mérite de bousculer nos idées reçues. En usant d'un diagramme de Cipolla
qui répartit les individus en fonction de l'importance qu'ils donnent à leur intérêt
personnel et leur intérêt général, l'équipe de Pluchino a tenté de démontrer94 que dans
un système de bipartisme, plus la différence entre ces deux partis étaient élevée, plus
un nombre élevé de représentants tirés au sort était nécessaire afin de contrer le
principe de Peter95 et promouvoir ainsi une meilleure efficience96 de l'assemblée. En
prenant bien entendu toutes les précautions d'usage, cette étude tend ainsi à 92 Avec toutes les précautions d'usage portant sur sa réalité ou sa qualité d'artefact, voir BOURDIEU P., « L'opinion publique n'existe pas », in Les Temps modernes, 29 (318), janv. 73 : 1292-‐1309 93 PLUCHINO A., GAROFALO C., RAPISARDA A., SPAGANO A., CASERTA M., "Accidental Politicians: How Randomly Selected Legislators Can Improve Parliament Efficiency", in Physica A 390, 2011, 3944-‐3954, disponible sur arxiv.org/abs/1103.1224 consulté le 10.06.13 Ce groupe s'est également fait connaître plus récemment en affirmant que l'usage du hasard dans la gestion des marchés financiers était plus efficace que les décisions de traders. 94 Ibid., p.17 95 On entend par principe de Peter une conséquence perverse des systèmes hiérarchique humains que l'on traduit grossièrement par le fait que "tout employé tend à s'élever dans la hiérarchie jusqu'à son niveau d'incompétence maximal". Elle désigne ici le fait que le système partisan promeut des décisions que les représentants n'auraient pas prises de façon indépendantes car les jugeant trop mauvaises. 96 Cette étude entend par "efficience" un plus grand nombre de décisions favorables à l'intérêt général
51
démontrer que l'introduction de hasard dans le jeu démocratique permettrait de
"l'améliorer".
La question de l'usage du hasard a ainsi le mérite d'être posé, et il serait très
intéressant d'observer les suites qui seront données à la démonstration de l'équipe de
Pluchino, Elle montre que les modèles statistiques n'ont pas fini d'interroger nos
pratiques politiques et que c'est par un dialogue incessant entre toutes les sciences
que nous pouvons espérer faire avancer le champ de nos savoirs et améliorer nos
systèmes politiques.
52
III. Le nouvel esprit du hasard : critiques de l'élection,
mutations démocratiques et expérimentations
locales
La connaissance des liens entre démocratie et tirage au sort est longtemps
restée cantonnée à quelques spécialistes du système athénien et de la philosophie
grecque. Pourtant, parallèlement à une remise en question croissante des systèmes
électoraux contemporains, l'idée du tirage au sort essaime également à nouveau au
sein de certains groupes alternatifs, par exemple en France au travers des figures
d'Etienne Chouard97 ou du Mouvement Colibris98, récemment lancé par Pierre
Rabhi. Ces réclamations d'une constituante formée par tirage au sort sont
originales, au sens où elles proviennent d'une base citoyenne alors que les
améliorations se réclamant de la démocratie participative ou délibérative
proviennent plus communément des instances politiques elles-mêmes.
Nous tenterons donc de savoir tout d'abord pourquoi les systèmes se
réclament de la démocratie font aujourd'hui l'objet de critiques particulièrement
acérées, pour ensuite aborder la question de la démocratie participative et de la
gouvernance vue comme solutions à la crise politique actuelle. Il conviendra d'en
dégager les apports et les critiques, et également de comprendre les liens entre
tirage au sort et la volonté affichée par une grande diversité d'acteurs "d'améliorer
la démocratie". Cela sera également l'occasion pour nous d'évoquer les premières
expériences de tirage au sort qui ont précédé l'expérience islandaise et de
97 Voir notamment etienne.chouard.free.fr/Europe consulté le 10.06.13 Etienne Chouard, autodidacte dont les opinions ont été fortement médiatisées à l'occasion du référendum sur la Constitution européenne, est depuis devenu un fervent défenseur de l'usage du tirage au sort. Si ses propos semblent avoir un certain écho, certaines de ses interventions semblent pêcher par excès d'enthousiasme et des explications très monocausales. 98 colibris-‐lemouvement.org/revolution consulté le 10.06.13
53
comprendre plus globalement le contexte général dans lequel ces expériences ont
été menés.
1. Pourquoi les élections ne suffisent plus ? Critiques et transformations
de la représentation
Parler de la crise de nos systèmes politiques est presque devenue un lieu
commun, crise s'ajoutant à la liste innombrable de celles que notre époque est
censée traverser. La faillite de l'esprit démocratique, l'inertie, la surdité ou la
corruption des élites politiques sont fréquemment dénoncés et vus comme des
causes patentes de la multitude d'autres défis que doivent affronter nos sociétés
post-modernes. Ces critiques relèvent parfois de cette rengaine désabusée sur la
politique et les politiciens, "tous incapables", qui finalement semble avoir toujours
existé. Mais d'autres indicateurs doivent également nous mettre la puce à l'oreille.
Il ne s'agit pas seulement d'une vieille antienne, mais également d'un véritable
trouble qui traverse nos sociétés, et notamment les sociétés occidentales.
La supposée crise des régimes représentatifs s'observe par plusieurs
indices, que nous expliquerons par trois grandes tendances observées dans
l'évolution de ces régimes. Ces tendances semblent s'appliquer autant de façon
interne, dans la structure même des systèmes représentatifs, que de façon externe,
dans les transformations du comportement des électeurs et l'émergence de
nouvelles manières de faire de la politique. De façon générale les indices qui nous
font traditionnellement diagnostiquer un affaissement des régimes représentatifs
nous font plutôt prendre conscience qu'il s'agit non pas tant d'une crise mais plutôt
d'une transformation, d'une métamorphose et d'une complexification de nos
systèmes politiques et d'un jeu démocratique qui ne se limite plus à l'élection.
Enfin ces tendances peuvent également être liées à des raisons beaucoup plus
profondes et plus pessimistes, que nous pourrions qualifier de
54
"superstructurelles", à savoir pour Wendy Brown99 ou Guy Hermet100 l'entrée de
nos sociétés dans un régime de délitement progressif de l'idéal démocratique.
La baisse tendancielle du taux de participation aux élections est la
preuve la plus ressassée de la crise du politique. Si elle témoigne notamment d'un
décrochage des classes populaires et d'un certain désintérêt pour la chose
publique, la réalité reste bien sûr beaucoup plus complexe. Les études sur
l'abstention nous montrent que la volatilité de l'électorat s'accroît et qu'elle se lie à
des comportements stratégiques chez l'électeur. Ce dernier tend ainsi à estimer
l'importance d'une élection et à ne pas voter lors de l'absence de véritables enjeux.
De façon plus large la baisse de la participation dans les instances politiques
traditionnelles se traduit aussi par ce que Bernard Manin qualifie "d'érosion des
fidélités partisanes"101. Cette érosion se manifeste par la réduction du nombre
d'adhérents dans les partis politique et un affaiblissement des attaches partisanes
mais elle ne doit pas pour autant laisser croire à un affaissement global du rôle des
partis. Ces derniers restent toujours les maîtres du jeu de la démocratie
représentative, un système qui a progressivement fait des partis ces briques
élémentaires.
Autre cause interne qui vaut aux systèmes représentatifs d'être vertement
critiqué, la composition des assemblées peine à représenter la diversité de leurs
pays. En France la part de femmes à l'Assemblée nationale en 2012 est encore
limitée à 26,9% tandis qu'au niveau local 13% des maires sont des femmes102.
Alors que les employés et ouvriers représentent la moitié de la population active,
3% seulement des députés proviennent de ces catégories socio-professionnelles103,
un constat identique à l'échelle locale. Contrairement à la représentation féminine,
la quantité d'élus issue de ces milieux n'a fait que baisser depuis un siècle. Les
99 W BROWN, op.cit. 100 HERMET G., L'Hiver de la démocratie, Paris, Armand Colin, 2007 101 MANIN B., Principes du gouvernement représentatif, op.cit., p.310 102 Voir haut-‐conseil-‐egalite.gouv.fr consulté le 10.06.13 103 ROUBAN L., Les députés de 2012 : quelle diversité ?, Note de recherche CEVIPOF, n° 8, 5 p. disponible sur cevipof.com consulté le 10.06.13
55
catégories d'âge les plus jeunes sont également sous-représentées à tous les
échelons. Enfin la représentation des "minorités visibles" reste quasiment
inexistante hormis pour les départements d'outre-mer, tout comme pour les
minorités sexuelles où seuls trois parlementaires sur plus de 900 assument leur
différence d'orientation sexuelle104. Ces inégalités au sein des assemblées sont
particulièrement aigües en France mais persistent également dans la plupart des
régimes représentatifs. L'Islande toutefois reste à la pointe en terme de parité
homme/femme, une parité rendue possible notamment grâce à l'action dans les
années 90 de la Kvenna Listin ou "Parti des femmes" qui avait fait de l'accès des
femmes au pouvoir un des points centraux de son programme et a sans doute
contribué à sensibiliser les Islandais à la question de la représentativité.
Ces contradictions nous ramènent aux débats sur la fonction de la
représentation. Si le mécanisme électoral est censé sélectionner les meilleurs et
établir ainsi un principe de distinction, ne faut-il pas accepter ces inégalités ? Cela
ne signifie-t-il donc pas que les hommes cadres âgés, blancs et hétérosexuels ne
sont pas plus aptes à gouverner ? Notre société semble se montrer de plus en plus
sensible à ces différences de traitement et refuse peu à peu une telle hypothèse.
Mais dans ce cas, cela signifie qu'il nous faut voir une autre fonction aux
assemblées élues, qui serait de représenter au sens strict le corps électoral, d'être
un miroir en miniature de ce dernier. Or nous l'avons vu, un tel objectif n'avait
jamais été prévu par les fondateurs des démocraties modernes, bien au contraire
l'extension du suffrage s'était opéré car on constatait qu'elle ne bouleversait pas la
composition des corps élus…
À ces contradictions internes au système représentatif dont nous n'avons
fait qu'effleurer les enjeux, il faut ajouter que les rapports entre les structures de
gouvernement et les nouvelles formes de militantisme politique ont aussi
fortement évolué ces dernières années. A la manière d'un contrefort, Pierre
104 ZAPPI S., "Sergio Coronado appelle les députés homosexuels à "sortir du placard"", in lemonde.fr, le 05.07.12 consulté le 10.06.13
56
Rosanvallon décrit ainsi une "contre-démocratie"105 dont l'existence viserait à
pallier les défauts des démocraties traditionnelles et surtout à surveiller et prévenir
tout ce qui serait jugé comme un dépassement des prérogatives d'un
gouvernement supposé démocratique. Cette analyse des contre-pouvoirs permet
ainsi de mieux saisir la dynamique de nouveaux mouvements politiques, et l'on
peut par exemple citer les projets mis en œuvre par l'association islandaise
Citizens Foundation. Son projet de Skuggathing106107 ou "parlement fantôme",
permet, en plus d'améliorer l'interaction des Islandais avec leur élus, de suivre
davantage leur action, mais également de les surveiller et de pointer leurs
faiblesses. Ainsi la contre-démocratie se glisse entre les intermittences de
l'expression démocratique traditionnelle, qui ne se réalise qu'à l'occasion de
l'usage du vote. Elle est l'expression d'une défiance et d'une vigilance accrues vis à
vis des instances traditionnelles. La surveillance, ici, se hisse en valeur
démocratique lorsqu'elle est l'expression d'une inquiétude, d'un contrôle exercé
par le citoyen sur l'activité de ses parlementaires108. Elle se mêle également à un
autre fait, celui selon lequel il est tout simplement beaucoup plus simple en terme
de ressources pour de simples citoyens d'exercer une critique et un contrôle sur un
pouvoir plutôt que de tenter de le renverser et de prendre sa place. Cette action,
cette "puissance du refus" s'incarne ainsi dans une forme de "souveraineté sociale
négative"109, négative au sens où elle constitue une forme de réaction face aux
pouvoirs traditionnels.
Dans un registre plus polémique, le système représentatif est également
accusé aujourd'hui de se dessaisir progressivement de l'idéal démocratique qu'il
prétendait incarner. Les critiques de Wendy Brown à cet égard sont
particulièrement virulentes.
105 ROSANVALLON P., La Contre-‐démocratie. La politique à l'âge de la méfiance, op.cit. 106 betraisland.is, voir aussi citizens.is, consultés le 10.06.13 107 Ce projet a notamment été mis en œuvre par Smári McCarthy, activiste islandais et un des fondateurs du Parti Pirate Islandais dont les centres d'intérêts portent notamment sur les nouvelles formes de démocratie et l'usage du crowdsourcing. 108 ROSANVALLON P., op.cit., p.36 109 ROSANVALLON P., op.cit., p.20
57
Par l'étude des dynamiques politiques étatsuniennes, celle-ci réfute l'idée
d'une démocratisation progressive des régimes représentatifs qui modifieraient le
fonctionnement de leurs institutions en conséquence. Tout comme Dewey
considère que la démocratie reste un régime soumis aux turpitudes de l'Histoire,
elle estime qu'aujourd'hui nous sommes rentrés dans une phase dite de "dé-
démocratisation". Cette phase se crée par l'addition de deux logiques politiques
qui par leurs actions défont cette dimension démocratique, à savoir les idéologies
néolibérale et néoconservatrice. Ainsi le néolibéralisme et l'entrée de la rationalité
économique dans tous les aspects de la vie impulseraient une dé-démocratisation
par quatre aspects110, à savoir une dévalorisation de la participation politique ; une
transformation des problèmes politiques en problèmes individuels auxquels le
marché saurait, lui, répondre ; l'illusion du choix entretenue chez un citoyen
considéré avant tout comme consommateur ; et enfin une re-légitimation de l'Etat
à travers une vision entrepreneuriale de ses fonctions, une application de
méthodes managériales111. C'est ce dernier aspect qui nous intéressera par la suite,
l'élaboration du Forum National islandais ayant trouvé son inspiration notamment
dans les processus de management d'entreprises. Son usage corrobore-t-il ou
réfute-t-il les observations de Brown ? Il sera nécessaire d'en parler.
Ces derniers constats et les critiques radicales qu'ils formulent appellent
bien entendu de plus amples développements. Nous les creusons déjà au long de
notre mémoire par l'évocation des critiques apportées contre le tirage au sort, nous
l'examinerons également à travers la critique de la gouvernance et la mise en place
d'une gestion rationnelle de la prise de décision collective. Dans tous les cas, nous
constatons que le principal symbole de nos régimes représentatifs, à savoir le vote,
est lui même remis en cause et source de débats.
110 BROWN W., op.cit. p.703 111 BROWN W., op.cit., p.705
58
2. Expériences et pièges de la démocratie participative
Nous l'avons signalé, le concept démocratique et les régimes représentatifs
sont sujets à des changements inédits en ce début de siècle. Ils sont également l'objet
de tentatives pour les transformer de l'intérieur notamment au travers
d'expérimentations dans le champ de ce que l'on nomme désormais démocratie
participative ou démocratie délibérative. De définition extrêmement imprécise, ces
termes semblent désigner aujourd'hui toute forme de participation démocratique
opérée en lien avec des institutions publiques et hors des mécanismes traditionnels
des élections et du référendum. Ces formes d'expériences se distinguent également
par le discours de reconnaissance de la compétence du citoyen, de la prétention à
vouloir accorder à tout un chacun de pouvoir participer activement à la vie
publique112. A priori les expériences de tirage au sort menées aujourd'hui relèvent de
ce champ, et pour cela il convient de comprendre les implications de ce concept tout
comme les usages qui en sont faits par les institutions politiques traditionnelles. En
effet il arrive aussi que la démocratie participative sonne comme un concept
marketing creux, utilisé afin de légitimer des décisions d'ores et déjà prises. Le
discours sur la compétence du citoyen apparaît ainsi comme ambivalent, masquant
parfois d'autres enjeux de pouvoir qu'il convient de saisir.
Aujourd'hui l'encouragement des citoyens à la participation provient ainsi
principalement d'une volonté institutionnelle, du "haut" et parcourt un mouvement
descendant. Mais l'émergence du concept de démocratie participative dans les années
60 relevait plutôt de mouvements et d'associations locales dont le but était de peser
continuellement dans le jeu politique, et non pas seulement à l'occasion des
élections113. En France, les autorités locales se sont depuis largement appropriées le
terme pour en faire un outil de gestion territorial et de consultation des habitants,
mais ce mouvement n'est en rien particulier à notre pays et traverse aujourd'hui tous
112 BLONDIAUX, Le Nouvel Esprit de la démocratie, op.cit., p.89 113 Ibid., pp.15-‐16
59
les continents114. Pour n'en citer que l'expérience la plus connue, le Budget
Participatif de Porto Alegre au Brésil, en fonction depuis plus de 20 ans, a essaimé
jusqu'en Seine-Saint-Denis. Intégrant des outils de démocratie directe dans la gestion
d'un budget municipal, cet outil et ses limites ont depuis été analysés par des
générations de politistes et de sociologues115. Parfois confondue avec la notion de
gouvernance avec qui elle partage un certain flou, la démocratie participative
bénéficie de l'augmentation des flux d'idées et de dispositifs due à la globalisation.
Elle se caractérise également par la constitution de "professionnels de la
participation"116, et notamment d'entreprises de communication qui tentent ainsi de
se faire une place au sein d'un nouveau marché.
Les critiques portant sur les expériences de démocratie participative mettent,
elles, en avant les usages de ces procédures par les élus et les administrations
publiques. Tout d'abord, celles-ci restent la plupart du temps cantonnées à l'échelle
locale. La compétence du citoyen n'est pas jugée suffisante pour s'exercer sur des
enjeux plus globaux117. Ce manque de confiance dans la participation des citoyens
est une donnée récurrente et traduit avant tout une peur des pouvoirs publics de
"perdre le contrôle" et de se laisser ainsi dépasser par la machine qu'ils auraient eux-
mêmes enclenchée. Elle se traduit par un encadrement souvent très fort des
délibérations pour prévenir ainsi toute possibilité de débordement ou de remise en
question des autorités organisatrices de ces expériences118. La présence des citoyens
peut ainsi apparaître comme servant uniquement à donner un vernis de légitimité à
des décisions déjà prises, comme par exemple dans le cas des enquêtes publiques en
France. Ces dernières semblent se reposer avant tout sur le vieil adage "participer
c'est accepter". Cette nature ambivalente de la démocratie participative oblige ainsi
Loïc Blondiaux à établir le constat suivant :
114 Ibid., p.18 115 Voir notamment FEDOZZI L., O poder da aldeia : gênese e história do orçamento participativo de Porto Alegre, Tomo editorial, Porto Alegre, 2000 et GRET M. & SINTOMER Y., Porto Alegre. L'Espoir d'une autre démocratie, La Découverte, 2002, Paris 116 BLONDIAUX, Le Nouvel Esprit de la démocratie, op.cit., p.22 117 Ibid., p.69 118 Ibid., p.74
60
"Ces nouvelles formes de participation peuvent être pensées à la fois comme
des instruments de dressage et de libération, comme des technologies visant à
canaliser les mécontentements populaires et comme des lieux où une contestation de
l'ordre établi peut trouver à s'exprimer et à se renforcer"119
Nous pouvons nous demander toutefois dans quelle mesure les expériences
de démocratie participative ne pourraient pas à long terme déborder leur cadre
normatif. Si celles-ci dérivent d'une crise de la démocratie traditionnelle et d'une
mutation des valeurs qui la fondent alors elles concourent déjà à la mise en évidence
de cette même crise, elles en sont les symptômes explicites. Nous devons bien
entendu nous garder de toutes prophéties sur l'avenir de nos gouvernements
représentatifs, nous souvenir de Dewey et du fait que la démocratie reste avant tout
une expérimentation permanente en soi. Mais la démocratie participative, en
reconnaissant à chaque citoyen une compétence politique accrue, ne montre-t-elle
pas que nos conceptions du citoyen et de ses capacités apparaissent désormais en
rupture avec les conceptions portées lors de l'élaboration des premiers régimes
représentatifs ?
D'autres critiques portent sur les procédures mêmes des outils de la
démocratie participative. Car ces derniers n'échappent pas non plus à certaines
dynamiques sociales telles que l'inclusion plus importante des classes moyennes et
aisées au sein de ces dispositifs, a contrario des plus pauvres, des plus jeunes ou des
étrangers. Lorsque le dispositif tente de pallier ces différences, celles-ci se retrouvent
dans les mécanismes de prise de parole et d'argumentation. Il est évident que de tels
dynamiques ont dû se trouver aussi à l'œuvre lors de la mise en place et du
déroulement du Forum National islandais. Il sera toujours intéressant de comprendre
comment les organisateurs ont tenté de les désamorcer.
Il reste également capital de ne pas considérer comme allant de soi l'idée
que le rêve de tout citoyen serait d'avoir l'opportunité de pouvoir s'exprimer et influer 119 Ibid., p.48
61
davantage sur la politique de son pays. L'idée d'une "démocratisation souhaitée et
souhaitable" ne doit pas sonner comme une évidence. Comme l'ont montré plusieurs
études120, nombreux sont les citoyens aspirant seulement à voir leurs représentants
travailler correctement. Comme Rosanvallon nous le démontre, il s'agit de distinguer
ici la volonté d'empêcher et la volonté de gouverner121. Les expériences de
démocratie participative se trouvent dans la plupart des cas être impulsées par les
institutions politiques elles-mêmes, qui croient par là répondre à une demande de
leurs administrés.
Autre donnée qu'il s'agira d'observer pour notre exemple islandais, les
tentatives pour éviter tout conflits tout comme la croyance dans l'obtention d'un
consensus général marquent les expériences de démocratie participative. Ces
dernières ne seraient que la solution à un blocage technique, un simple souci de
communication. Elles tendent ainsi à oblitérer de véritables divergences politiques,
des désaccords de fonds qui traversent également notre société comme les différentes
conceptions de l'égalité, le poids de la protection de l'environnement etc. Ces
conceptions de la délibération tendent également à opposer ce qui relèverait du
domaine de l'échange pur et rationnel d'arguments et le domaine de la rhétorique, de
l'art oratoire. En faisant de la délibération une "discussion", pour reprendre les termes
utilisés par Philippe Urfalino122, c'est-à-dire en excluant les éléments d'une
négociation, les expériences de démocratie participative et délibérative prennent le
risque d'ignorer des éléments qui restent irréductibles. Ainsi :
" (…) la délibération est plutôt l’argumentation en situation de décision
collective. Or dans une décision collective ainsi conçue, les participants ne sont pas
nécessairement égaux et tour à tour orateurs et auditeurs ; il n’est pas non plus
toujours exigé que soit respectée la force du meilleur argument. De manière
120 Notamment HIBBING J. et THEISS-‐MORSE E., Should Work, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, cité par BLONDIAUX L., Le Nouvel Esprit de la démocratie, op.cit., p.30 121 ROSANVALLON P., op.cit, p.21 122 P. URFALINO, « La délibération n'est pas une conversation », in Négociations 2/2005 (no 4), p. 99-‐114.
62
générale, la situation de décision collective requiert beaucoup moins d’exigences
normatives qu’une conversation."123
Autrement dit, c'est en reconnaissant les inégalités de fait dans la
délibération publique et c'est en les codant et les cadrant que nous pourrions gagner
en transparence et en efficience dans la procédure. Un tel constat, tous comme ceux
réalisés précédemment, s'applique bien entendu aussi aux assemblées ou aux jurys
tirés au sort. Nous l'avons vu, en soi le tirage au sort n'est qu'une procédure, ses
usages peuvent être multiples et peuvent parfaitement contrevenir à la réalisation
d'idéaux démocratiques.
3. Jurys citoyens et assemblées tirées au sort : observations et premiers
constats
L'usage du hasard pour former des assemblées ou des jurys fait partie des
procédures utilisées dans les expériences de démocratie participative. Il est donc
légitime de nous demander quelles sont les expériences ayant précédé l'élaboration
du Forum National islandais. En les décrivant et en décryptant leurs enjeux nous
saisirons mieux au passage le mécanisme de globalisation des idées et la façon dont
les expérimentations politiques peuvent essaimer et se diffuser dans les endroits les
plus inattendus. Nous devrons également veiller à ne pas outrepasser nos hypothèses
en imaginant que tels des dominos chaque expérience de tirage au sort influerait sur
la suivante. Nous le verrons par la suite, l'association Mauraþúfan (La Fourmilière)
qui a initié l'expérience islandaise n'a pas directement puisée son inspiration au sein
de ces précédents. Il faut donc plutôt les étudier afin de comprendre pour quelles
raisons les pouvoirs publics, eux, ont accepté ces expériences d'assemblées et se
demander s'il est possible d'y voir des analogies avec le cas islandais.
Il est un fait que jusqu'ici nous avons peu évoqué et qui semblait contrarier
notre affirmation selon laquelle le tirage au sort était devenu non miscible avec les 123 Ibid., §32
63
régimes représentatifs. Il s'agit du fait que son usage a en réalité bien perduré au sein
de nos institutions, mais dans un unique domaine. Nous parlons bien entendu de la
tenue des jurys dans le domaine de la justice, qu'il s'agisse par exemple des jurys
d'assises en France, ou bien des jurys populaires étatsuniens, dont les membres sont
tirés au sort. Si son usage est toléré c'est parce que le rôle des jurés n'est pas de faire
la loi mais de juger, autrement dit de relier la norme générale au cas particulier du
tribunal. Or il s'agit par contre d'une compétence dont les fondateurs des démocraties
modernes ont estimé qu'elle était présente dans l'ensemble du corps électoral. Il s'agit
du sens commun124, ou la capacité à juger ses concitoyens et leurs actes. Issu de la
tradition anglaise, les jurys judiciaires se voient introduits également par les
révolutionnaires français qui s'en inspirent en 1791. Ils connaîtront surtout leur âge
d'or aux Etats-Unis où ils menacent même d'empiéter sur la loi125 pendant le XIXème
siècle. Un premier exemple qui montre qu'il est parfois bien complexe de distinguer
ce qui serait du "sens commun" et de la capacité à créer la loi…
Mais si nous évoquons ici la question des jurys, c'est d'une part parce qu'il
s'agit d'un exemple emblématique de diffusion des pratiques politiques, mais aussi
parce que les jurys restent indirectement à l'origine de nouvelles expériences d'usage
du hasard, comme celles des jurys citoyens durant les années 70. On définit un jury
citoyen comme un groupe de personnes relativement restreint (jusqu'à une vingtaine
de participants), sélectionnés par la sort et volontaires qui doivent délibérer face à
une question posée sur une période relativement courte (quelques jours tout au plus).
Ces jurys, aux formes variables, sont testés par Deniel en Allemagne, et au même
moment par Ned Crosby aux Etats-Unis, qui s'inspire directement des jurys de la
sphère judiciaire126. Les jurys citoyens se développent peu à peu, se trouvent utilisés
le temps de résoudre des problèmes précis et locaux mais prennent aussi racine de
façon plus continue, comme à Berlin entre 2001 et 2003127. Si leur champ de
124 SINTOMER Y., Petite histoire de l'expérimentation démocratique, tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours, op.cit., p.124 125 Ibid., p.105 126 Ibid., p.158-‐159 127 A. ROCKE et Y. SINTOMER, « Les jurys de citoyens berlinois », in BACQUE H., REY H. et SINTOMER Y., Gestion de proximité et démocratie participative, éditions La Découverte, Paris, 2004
64
compétence reste encore très limité, leur usage tend toutefois à s'étendre, notamment
dans le monde anglo-saxon. La diversité des opinions permise par l'usage du sort, la
difficulté pour les politiques de manipuler une telle procédure permettent sans nul
doute de concourir à ce succès grandissant.
La multiplication des expériences de démocratie participative a permis
également de se diriger vers des délibérations au public beaucoup plus large, par
exemple par le biais des sondages délibératifs. Ces derniers dérivent davantage des
sondages d'opinions que du système des jurys judiciaires. Leur logique diffère de
celle des sondages au sens où l'échantillon représentatif choisi (généralement
supérieur à 200 personnes) sélectionné donc de façon aléatoire (avec l'usage plus ou
moins prononcé de quotas) a cette fois l'occasion de débattre et réfléchir un temps à
la question posée. Développés par Fishkin en 1988 qui en a déposé la marque, les
sondages délibératifs128 se caractérisent par l'organisation de cercles de discussions
en petits groupes, ainsi que de sessions plénières où des questions pesées et pensées
par chaque sous-groupe sont posées à des groupes d'experts et de politiques qui
doivent y répondre. Un sondage est alors réalisé à la fin des débats et comparé à un
premier sondage ayant été réalisé en amont. Il permet ainsi de savoir ce que serait
l'opinion éclairée d'un public, et permet souvent d'observer de larges changements
dans son jugement. S'ils requièrent un financement conséquent qui se compte en
centaines de milliers de dollars, plusieurs sondages délibératifs ont été depuis réalisés
aux Etats-Unis et dans le monde, en Corée du Sud, en Bulgarie ou au Brésil129.
La première expérience d'assemblée tirée au sort à grande échelle a été
réalisée quant à elle pour la première fois en Colombie Britannique130, au Canada, en
2004. Cette procédure inédite a été mise en place dans l'optique d'un changement de
la loi électorale. Il avait été alors considéré que les représentants élus ne pouvaient
être juges et parties, et ne devaient donc pas modifier une loi qu'ils auraient pu
128 Voir cdd.stanford.edu consulté le 01.06.13 129 Ibid. 130 BLONDIAUX, Le Nouvel Esprit de la démocratie, op.cit., p.90
65
modifier à leur propre avantage. Pour la constitution de cette assemblée l'usage de
quotas en fonction de l'âge et du genre pour le choix des 160 membres est à signaler
tout comme le choix d'y intégrer deux Amérindiens afin de satisfaire à la
représentation de cette minorité ethnique131. La tenue des réunions de travail et des
sessions plénières de l'assemblée constituée ont été particulièrement médiatisées
durant l'automne 2004 et le choix du nouveau système électoral proposé ensuite au
référendum le 17 mai 2005. Toutefois celui-ci ne fait que frôler le pourcentage
d'approbation minimum nécessaire (60% des suffrages exprimés) et se termine donc
sur un échec. Le modèle d'assemblée tirée au sort reste par contre fertile et fait naître
d'autres initiatives, par exemple en Irlande suite également à la crise financière132.
L'initiative irlandaise est particulièrement intéressante car elle semble avoir certains
points communs avec l'expérience islandaise. Née également d'une association
citoyenne, "We the citizens" en mai-juin 2011, elle a abouti notamment à la mise en
place d'une "convention constitutionnelle" comptant à la fois des parlementaires mais
aussi un nombre conséquent de citoyens tirés au sort133 dans l'optique de réviser
certains points de la constitution irlandaise. Ce processus est toujours en cours et
demandera bien sûr une attention particulière à l'avenir. Contrairement à l'Islande, il
permet ainsi à des membres tirés au sort de siéger bien plus longtemps qu'une seule
journée dans l'optique d'une révision constitutionnelle. L'expérience islandaise reste
toutefois la seule pour l'instant à avoir été réalisé jusqu'au bout à l'échelle d'un Etat,
et c'est à cette expérimentation à la fois discrète et étonnante que nous allons
désormais nous intéresser.
131 SINTOMER Y., Petite histoire de l'expérimentation démocratique, tirage au sort et politique d'Athènes à nos jours, op.cit., p.182 132 wethecitizens.ie consulté le 02.06.13 133 constitution.ie consulté le 02.06.13
66
Partie II. La révision constitutionnelle
islandaise et l'expérience du Forum
National : réveil d'un volcan ou simple
nuage de cendres ?
Pour cette deuxième partie, il s'agira de placer en miroir les idéaux-
types face au réel, à l'expérience démocratique elle-même. C'est ici le cas de l'Islande
qui nous intéresse puisque ce pays a été la source d'un certain nombre d'innovations
démocratiques après la crise économique qu'il a dû traverser depuis 2008. Nous
pouvons citer en pagaille le jugement de politiques et banquiers jugés responsables
de la débâcle financière islandaise, des manifestations incessantes devant le
Parlement par des citoyens habituellement peu enclins à la protestation, ou l'écriture
d'une nouvelle Constitution opérée à l'aide des derniers outils de la démocratie
participative et délibérative, etc. Pour notre part, nous nous cantonnerons à la
question du Forum National puisque nous y interrogerons l'usage en son sein du
tirage au sort. Sans nier le caractère novateur de ce nouvel outil institutionnel, il
conviendra d'y porter un regard critique et de repérer ses limites. L'objet "Forum
National" apparaît d'ailleurs beaucoup plus intéressant dans les potentialités futures
qu'il dégage que dans la place qu'il prenait au sein d'un processus constitutionnel
semé d'embûches et loin d'être terminé. Il reste toutefois indissociable du processus
qu'il a initié.
Le Forum National constitue la première chaîne du processus ayant
enfanté une nouvelle constitution pour l'Islande. Née d'une collaboration entre les
autorités politiques et l'association citoyenne Mauraþúfan (surnommée la plupart du
temps the Anthill, c'est à dire la Fourmilière) elle a ainsi permis la tenue d'une
67
assemblée de 1000 citoyens sélectionnés aléatoirement dans toute la population
nationale, ce qui constitue à ce jour une première mondiale. Rassemblés pendant une
journée, ces citoyens, suivant des séquences et une organisation minutieuse qu'il
conviendra de décrire, ont produit un rapport d'environ 700 pages jouant le rôle d'un
manuel d'instruction pour le futur conseil constitutionnel. Ceux-ci ont ainsi dégagé
les grandes valeurs qu'ils souhaitaient voir inscrites au sein de la nouvelle
constitution mais ont également formé de nombreuses propositions pour pallier aux
défaillances du pays. Inspiré de travaux statistiques comme les sondages délibératifs
de Fishkin mais également des techniques de management entrepreneurial, cette
assemblée s'illustre comme une première démocratique, mais également comme une
expérience d'intelligence collective.
Pour saisir les tenants et aboutissants de cette expérience, il conviendra dans
un premier temps de saisir les enjeux propres au pays, de comprendre sa culture
politique et la façon dont celle-ci a pu aider ou entraver les nouveaux processus
décisionnels mis en œuvre. L'Islande constitue, de par sa population et son territoire,
un objet géographique et politique particulièrement atypique. Une attention
particulière sera accordée au contexte de crise économique et social que l'Islande a
connu ces dernières années, car c'est dans cette atmosphère de profonde remise en
question sur l'avenir du pays que sont nés de nouvelles pistes de réflexions et
d'actions protestataires et démocratiques.
Notre analyse se poursuivra en se concentrant davantage sur le dispositif du
Forum National. Il conviendra d'en dégager d'une part les sources d'inspirations
théoriques et d'autre part le cheminement de l'association Mauraþúfan, de la première
expérience d'assemblée à celle d'une collaboration avec le Parlement islandais. Il
nous faudra évoquer cette organisation, la mise en œuvre et les résultats de cette
assemblée, ses rapports avec le Parlement, mais également l'impact médiatique de
celle-ci dans le pays et à l'extérieur.
68
I. Contexte et enjeux locaux de l'expérience
islandaise
L'Islande reste encore un pays largement méconnu. Située aux
confins septentrionaux de l'Europe, l'île volcanique se présente plutôt comme une
destination touristique originale ou comme la terre natale de groupes post-rock
nébuleux. Peuplé de seulement 300 000 habitants dont la moitié habite dans la
capitale, Reykjavik, l'Islande mérite pourtant davantage d'attention. A la fois parce
qu'elle pourrait bien constituer, comme l'indique Tomasson134 une sorte de version
miniature de nos sociétés, ou bien à l'inverse représenter une sorte de cocktail social
original dont il serait impossible de trouver un autre mélange. Dans les deux cas, on
peut légitimement se demander si ce pays ne constituerait pas une source de
créativité pour l'ingénierie sociale et démocratique.
Que les expériences islandaises soient reproductibles ou non, elles
ont le mérite de déranger avec insolence nos cadres cognitifs et de nous obliger à
repenser, à parcourir de nouveau des sentiers réflexifs que nous croyions connus.
Pour saisir dans toute sa complexité l'esprit d'innovation islandais, il convient de
comprendre le chemin historique parcouru par cette île. De même, et pour reprendre
Dewey, il est nécessaire de saisir "l'arrière-plan historique" de l'Islande afin de
comprendre les logiques de son "gouvernement démocratique"135. Il est nécessaire
également de percevoir que les institutions islandaises sont la résultante de siècles
d'histoire particulièrement durs et tourmentés. L'Islande semble faire office de
creuset où se seraient réunis certains des éléments historiques les plus emblématiques
de notre continent, tels que la colonisation, la pauvreté et l'exploitation par la
métropole, l'empreinte de la Guerre froide et des Etats-Unis et un rapport tout
particulier à l'environnement. Ce sont ces évènements que nous tenterons notamment
de dégager afin de comprendre l'existence de cultures insulaires particulièrement
vivaces et prolifiques dans ce pays. 134 TOMASSON, "Iceland as The First New Nation", in Scandinavian Political Studies, 10, 1975 135 DEWEY J., op.cit., p.169
69
Il conviendra enfin de retracer avec précision les dernières années
agitées qu'aura vécu le pays. Nous évoquerons la bulle financière et la libéralisation
des services bancaires qu'a connu l'Islande durant les années 90 et 2000, et nous
tenterons ensuite de comprendre le déroulement de la crise socio-économique et
politique qui a suivi. La crise de 2008-2009 a mis en lumière la faillite des
institutions publiques islandaises à apporter une réponse cohérente et démocratique
face au gouffre dans lequel menaçaient de tomber les Islandais. La "révolution des
casseroles" a été une réponse puissante et massive face à l'urgence. Elle a également
impulsé un cycle original d'innovation politique dont nous ne faisons que commencer
à mesurer les conséquences.
1. Esquisse de l'héritage historique et démocratique islandais
L'Islande figure historiquement comme le dernier pays européen à avoir
été colonisé par des êtres humains. L'île n'est peuplé qu'à partir du IXème siècle et
possède ainsi une histoire originale qui lui vaut le surnom de "First New Nation" par
Tomasson136, visage étrange d'une Amérique qui aurait été colonisée durant l'ère
médiévale…
Hormis quelques rares excursions durant l'Antiquité romaine et l'existence
de possibles communautés religieuses d'origine irlandaise, les premiers véritables
villages de Vikings ne sont présents qu'à la fin du IXème siècle. Les figures des
premiers colons d'origine norvégienne Ingólfur Arnarson et Hjörleifur Hródmarsson,
sont devenus partie prenante de l'Histoire nationale et ont droit à leurs statues dans le
centre-ville. Le pays connaît par la suite plusieurs vagues d'immigration, mêlant
colons aux origines scandinaves, écossaises et irlandaises. L'Islande devient donc le
creuset d'un mélange entre cultures vikings et celtiques, ce qui reste encore peu
souligné lorsque l'on observe le récit historique officiel offert par le Musée nationale
d'Histoire d'Islande. La religion chrétienne, elle, ne s'installe véritablement qu'en
l'année 999, où l'Althing décide d'en faire la religion officielle de l'île, mais permet la 136 TOMASSON, op. cit.
70
perpétuation des pratiques païennes dans le cadre privé. Le calme apparent de la
conversion du peuple islandais contraste fortement avec les soubresauts qu'aura
connus le reste de l'Europe du nord.
Aujourd'hui encore, l'Islande se vante d'avoir à sa tête le plus ancien
Parlement au monde. De fait dès les premières années de son histoire, l'Islande se
constitue en nation mais non pas en monarchie. Les familles présentes sont
organisées autour de chefferies dont les leaders décident de former ensemble un
parlement national et indépendant en 930, l'Althing. L'Islande constitue ainsi une
forme de république médiévale, système oligarchique dominé par de grandes familles
en proie aux luttes de pouvoir. Ce système de résolution des conflits laisse une large
autonomie à chaque chefferie et fonctionne plusieurs siècles avant de voir éclater les
guerres civiles qui mèneront à l'affaiblissement du pays et à sa soumission à l'autorité
royale norvégienne.
Le pays connaît à ses débuts une période particulièrement florissante.
Tout d'abord en terme d'exploration géographique, avec l'établissement de nouvelles
colonies au Groenland et la découverte de l'Amérique par Leifur Eirksson, dit le
Chanceux. Dans le domaine intellectuel, l'Islande devient le lieu d'écriture de
nombreuses sagas et la production de documents écrits reste impressionnante par
rapport à une population d'insulaires extrêmement restreinte137.
À partir du XIIIème siècle le pays perd donc son indépendance suite à des
dissensions internes, au profit de la couronne de Norvège puis du Danemark.
L'Althing perd peu à peu toute prérogative, jusqu'à disparaître pour un temps au
XIXème siècle. L'arrivée de la peste noire au XVème siècle puis l'imposition
violente de la Réforme par la couronne danoise contribue à affaiblir le pays et le font
entrer dans une période durable d'appauvrissement. Le Danemark met en place un
monopole royal sur les échanges commerciaux de l'île et l'Islande connaît également
de violentes éruptions volcaniques des monts Katla, Helka et Laki. La mise en place
d'un système colonial de dépendance vis-à-vis de la métropole danoise, conjuguée à
cette série de violentes catastrophes naturelles entament sérieusement l'économie 137 BOYER R., L'Islande médiévale, Editions Les Belles Lettres, 2001 p.159
71
locale et le nombre d'habitants chute à son plus bas niveau depuis la colonisation
avec environ 40 000 personnes présentes à la fin du XVIIIème siècle.
Cette situation n'empêche pas le pays de voir apparaître sur son sol de
nombreux écrivains et intellectuels138, usant de la langue islandaise et sauvegardant
le riche patrimoine culturel local que le reste de la Scandinavie tente également de
s'approprier. Le renouveau indépendantiste ne prend véritablement forme qu'à partir
du XIXème siècle, conduit par Jón Sigurðsson, héros national et leader pacifiste pour
l'indépendance du pays, dont la femme fait aujourd'hui figure de première féministe
du pays. Le roi danois Christian VIII redonne vie à l'Althing sous forme d'une
assemblée consultative en 1843, puis ses successeurs octroient à l'Islande une
première constitution laissant au pays et au Parlement une large autonomie en
matière de politique intérieure. Enfin l'Acte de l'Union de 1918 reconnaît l'Islande
comme un royaume, bien que se trouvant encore sous la tutelle danoise.
La Seconde Guerre Mondiale voit le Danemark envahi par l'Allemagne
nazie en avril 1940. L'Islande acquiert alors une position stratégique qui perdurera
jusqu'à aujourd'hui. Considérant le risque de voir les Allemands contrôler
l'Atlantique nord, l'île est envahie par les Britanniques en mai 1940 puis par l'armée
américaine en 1941. L'irruption soudaine d'un nombre de soldats correspondant à la
moitié de la population civile139 provoque un choc considérable et durable dans la
culture islandaise. En parallèle, l'Althing nomme un régent à la tête du pays puis se
prononce pour l'indépendance totale en 1942, avalisé par un référendum national en
1944 et accepté par le Danemark à la sortie de la guerre. Une nouvelle constitution
islandaise140 rentre alors en vigueur la même année. Il s'agit en réalité de la même
constitution que celle qui avait été accordée par le Danemark, elle-même très
fortement inspirée de la monarchie constitutionnelle danoise. Elle ne fait donc que
remplacer le titre de roi par celui de président et instaure une république 138 On pourra citer notamment Einar Sigurdsson, poète (1538-‐1626), mais également Hallgrímur Pétursson, poète également (1614-‐1674), ou Björn Jónsson, historien (1574-‐1655) parmi tant d'autres. 139 HJALMARSSON J., History of Iceland, from the Settlement to the Present Day, Forlagid, 2012 p.157 140 Disponible en français sur mjp.univ-‐perp.fr consulté le 03.06.13
72
parlementaire pourvue pour seule assemblée de l'Althing. La nature de cette
constitution, copiée sur l'ancien colonisateur danois, fera débats à plusieurs reprises,
à la fois parce qu'elle est souvent considéré comme un apport extérieur qui ne peut
donc rassembler la population islandaise autour de ses propres valeurs, mais
également parce que certaines répartitions du pouvoir restent floues. Les juristes sont
notamment partagés sur l'étendue des pouvoirs conférés au président de la
République, puisque s'il joue traditionnellement un rôle davantage symbolique
certains lui concèdent une capacité d'action bien plus importante en suivant la
constitution à la lettre141.
Au niveau international, les Etats-Unis resteront finalement présents sur
le territoire islandais jusqu'en 2006, par la gestion de la base militaire de Keflavík.
Cette installation, ainsi que l'adhésion du pays à l'Otan en 1949 à la suite de la
Norvège et du Danemark provoqueront de violentes manifestations devant le
Parlement, dont la virulence servira de point de comparaison pour les manifestations
de protestations de 2008-2009. Cette coopération de l'Islande avec les Etats-Unis
s'explique par l'absence d'une force armée nationale islandaise combinée aux tensions
récurrentes de la Guerre Froide. L'Islande, par sa position centrale dans l'Atlantique
nord, occupe tout comme le Groenland une place stratégique entre les deux
superpuissances. Il est à noter que le pays occupera sans doute à nouveau une
position particulière dans l'avenir. L'ouverture de nouvelles routes commerciales
provoquée par le réchauffement climatique et la fonte des glaces, l'exploitation de
nouveaux gisements miniers en Arctique laisse présager l'apparition d'un nouveau
Grand Jeu des puissances dans cette zone.
Enfin concernant la maîtrise de ses mers, l'Islande s'est faite remarquer à
plusieurs reprises durant les "guerres de la morue" de 1950 à 1975, ou "Cod Wars".
Le pays a repoussé à plusieurs reprises les limites de ses eaux territoriales jusqu'à
200 miles afin de lutter contre la surpêche due notamment à la présence de navires
britanniques et allemands. Après une violente confrontation avec la marine
141 Les débats portent sur l'article 26 de la Constitution et la possibilité pour le président de la République de refuser de contresigner une loi votée par le Parlement
73
britannique et l'intervention de la Cour Internationale de Justice, l'Islande est
reconnue dans son droit et le droit de la mer davantage précisée.
Parallèlement l'Islande connaît après la guerre le même chemin que la
plupart des Etats d'Europe occidentale. Modernisation des techniques d'agriculture et
de pêche, ouverture progressive au tourisme et nouveaux moyens de communication
ouvrent progressivement le pays au monde. L'Islande connaît une augmentation
progressive de son PIB jusqu'à atteindre dans l'avant-crise la tête des classements
internationaux en terme de richesse produite par habitant mais également par son
IDH142. Le pays connaît une augmentation de sa population, l'arrivée de migrants du
monde entier et une densification de ses villes143. La société islandaise se transforme
également, et les féministes islandaises obtiennent progressivement d'importantes
avancées de leurs droits à l'occasion de grandes manifestations en 1975 aboutissant
notamment à l'obtention du droit à l'avortement et à l'égalité salariale. Le mouvement
se constitue ensuite au sein d'un parti féministe, l'Alliance des femmes ou "Samtök
um kvennalista" qui propose des candidats féminins aux élections municipales et
parlementaires et gagnent ainsi plusieurs sièges à l'Althing et aux conseils de
Reykjavik et Akureyri durant les années 80. L'Islande sera également le premier pays
du monde à voir élue à sa tête un chef d'Etat féminin, Vigdís Finnbogadóttir en 1980.
Il ne semble pas anodin d'évoquer ici les luttes sociétales ayant eu lieu en
Islande. En effet celles-ci semblent avoir eu un impact important sur les mœurs
islandaises, et ont sans doute inspiré certains modes d'actions des protestations de
2008-2009. Par exemple si l'homosexualité est légale depuis la sécession du pays en
1940, la fin progressive de toutes discriminations légales s'opère au cours des années
1990144 jusqu'à l'adoption d'un contrat de partenariat civil en 1996 puis du mariage en
2010, illustré par un vote unanime du Parlement et le mariage de la Première ministre
Jóhanna Sigurðardóttir avec sa compagne le lendemain. Hörður Torfason, acteur
142 Voir les rapports de l'ONU sur hdr.undp.org/fr/statistiques consulté le 10.06.13 143 Jón Hjálmarsson parle ainsi d'un "nouvel âge de la colonisation" HJALMARSSON, op. cit., p.202 144 KRISTINSSON Thorvaldur, Iceland : Homosexuality and the Law, in gaypride.is consulté le 10.06.13
74
chanteur et activiste politique, s'illustre particulièrement dans ces combats militants.
A la fois comme première homme à avoir fait connaître publiquement son
homosexualité en 1975145 à une époque où le pays était encore marqué par le
conservatisme moral, mais également comme l'un des principaux investigateurs et
inspirateurs des protestations islandaises de 2008 et du mouvement espagnol du 15-
M146. A contrario il semble important de signaler également que l'Islande n'a
pratiquement jamais connu sur son sol la présence d'un véritable parti communiste,
peut-être en raison de l'influence des Etats-Unis. Le parti dit de l'Alliance du peuple,
qui pouvait s'en rapprocher, s'est fondu en 1998 avec les sociaux-démocrates au sein
du parti de centre-gauche Samfylkingin, l'Alliance sociale-démocrate. Il n'existe donc
a priori pas de véritable culture communiste en Islande, et les militants de l'extrême-
gauche semblent davantage marqués par les luttes environnementales et sociétales.
2. Les Vikings des années 2000 : néolibéralisme à l’islandaise et
faillite du contrôle démocratique
Afin de comprendre le contexte de 2008 et les mouvements politiques ayant
traversé le pays, il convient de saisir davantage l'atmosphère économique et social
qu'avait connu le pays les années précédentes. Si l'opulence semblait régner, cette
période fait aussi parfois l'objet d'un constat peu amène de la part de certains
islandais147.
L'émergence du secteur financier islandais, responsable en grande partie
de la violence de la crise supportée par l'île, s'opère progressivement à partir du début
des années 90. Quelques têtes de proue s'illustrent dans la libéralisation et la
privatisation croissante des services islandais, et gagnent le surnom de "New
145 DEL GIGANTE Lawrence, "How a Gay Rights Maverick Helped Topple Iceland’s Govt" in ipsnews.net consulté le 10.06.13 146 FONTAINE Paul, "You Cannot Put Rules On Love", in grapevine.is le 4.08.12 consulté le 10.06.13 147 Voir notamment le reportage de Thibault POMARES, "Takk la crise" sur latelelibre.fr consulté le 10.06.13
75
Vikings"148. Parmi ces figures, la plus emblématique reste celle de David Oddsson,
maire de Reykjavik puis Premier Ministre de 1991 à 2004, admirateur des politiques
de Thatcher et Reagan. Issu du Parti de l'Indépendance, le parti conservateur de
droite, il engage notamment des politiques de privatisations du secteur de la pêche,
secteur clef de l'économie du pays, ainsi qu'une réforme du système fiscal local
favorable aux hauts revenus149. Mais il ouvre surtout l'Islande à l'EEE, Espace
Economique Européen, et adapte ainsi la législation nationale aux directives
européennes concernant le secteur financier afin d'ouvrir l'Islande aux apports des
capitaux internationaux.
Le développement du secteur bancaire islandais s'accélère au cours des
années 2000, ce qui vaudra au pays le surnom de "Tigre nordique". Sous les derniers
mandats d'Oddsson la privatisation du secteur bancaire est engagée et réalisée
complétement en 2003 tandis que l'endettement des particuliers, des entreprises et
des collectivités explose150. Le recours au prêt devient une pratique courante dans la
vie quotidienne islandaise et permet aux habitants d'accéder aux standards de vie les
plus élevés tout en multipliant les marques de consommation ostentatoire. Les
secteurs de l'économie sociale comme l'éducation ou la santé restent quant à eux à
l'abri, permettant ainsi de maintenir le consensus politique sur l'action néolibérale du
gouvernement.
David Oddsson passe ensuite à la tête de la Banque centrale d'Islande, tandis
que Halldor Asgrimsson puis Geir Haarde, des deux partis de la coalition de droite,
se succèdent au poste de Premier ministre jusqu'en 2009. Cité comme un exemple de
réussite l'Islande commence pourtant à connaître ses premiers soubresauts
économiques dès 2006. Présenté comme un modèle de conversion à l'économie
financière, le modèle islandais comme à se fissurer avec une chute brutale de la
valeur de la couronne islandaise, engendrant premières faillites et chute du marché
des obligations. Mais les banques renchérissent en s'ouvrant davantage à
l'international. Landbanski propose notamment la banque en ligne Icesave à des
148 SKALSKI J., La révolution des casseroles, chronique d'une nouvelle Constitution pour l'Islande, Editions La Contre Allée, Septembre 2012, p.32 149 Ibid., p.35 150 Ibid., p.36
76
contributeurs étrangers, et crée avec les principaux établissements bancaires islandais
des filiales en Europe et notamment au Luxembourg.
Le mois d'octobre 2008 voit plonger l'Islande dans la crise économique
mondiale avec une violence et une rapidité inégalée. En une dizaine de jours le pays
fait face à un tremblement de terre financier qui voit plonger les trois principales
banques du pays Glitnir, Landsbanki et Kaupthing et la mise en place d'une loi
d'urgence le 6 octobre 2008 afin de prendre temporairement le contrôle de ces
établissements par le FME (Autorité de Supervision Financière), organisme public
chargé de garantir la sécurité du marché financier national. La taille de ces banques
étant trop importante, atteignant dix fois le PIB de l'Islande, il est impossible pour
l'Etat de garantir l'ensemble des dépôts. Il se cantonnera à ceux de ses nationaux, ce
qui lui vaudra d'être placé un temps sur la liste des Etats terroristes par le
gouvernement britannique. L'économie nationale enregistre une récession de 10%
l'année suivante conjuguée à une montée en flèche de l'inflation151. Dans un même
temps le chômage passe de 3 à 10% en un an, l'émigration de premiers Islandais
commence tandis que le pays doit demander de l'aide au FMI et à l'Europe.
Comment expliquer une telle chute ? S'il a fallu agir rapidement pour sauver
ce qui pouvait l'être, les questions ont rapidement fusé, et le travail rendu public en
2010 de la Commission d'investigation sur la faillite des banques152 reste exemplaire.
Après des mois de travail, cette commission créée par le Parlement islandais a ainsi
mis en évidence un nombre élevé de dysfonctionnements au sein du secteur bancaire
islandais, mais également au cœur même de l'administration politique. Elle s'est
trouvée complétée par deux autres commissions chargées d'enquêter plus avant sur
des points sensibles de l'économie islandaise, tels que la fragilité de ses caisses de
dépôts et les mécanismes d'endettement de ses ménages153, dont les résultats restent
151 MENDEZ PINEDO E., La revolución de los vikingos, Editorial Planeta, Novembre 2012 p.51 152 Rapport disponible en partie en anglais sur rna.is/eldri-‐nefndir/addragandi-‐og-‐orsakir-‐falls-‐islensku-‐bankanna-‐2008/skyrsla-‐nefndarinnar/english consulté le 10.06.13 153 MENDEZ PINEDO, op. cit., p.56
77
encore à analyser, tout comme le passage en justice d'un certain nombre de
responsables bancaires à la fin de l'année 2012154.
Les milliers de pages de rapport font un constat sans appel : l'ouverture
du pays au marché financier mondial a provoqué un gonflement des banques que les
services de contrôle de l'Etat ont été incapables de suivre, ayant eux-mêmes fait
preuve d'une "extrême négligence"155. L'administration publique n'a rien fait lorsque
les indicateurs ont commencé à tourner au rouge en 2006, elle a au contraire continué
à rassurer les banques et à leur faciliter l'accès à de nouveaux marchés. Ces dernières
ont également profité d'une législation excessivement permissive, et les conflits
d'intérêts semblent avoir été légion au sein des conseils d'administration bancaires
tout comme au sein de l'administration publique chargée de leur contrôle. Quant au
reste des acteurs de l'Etat, ils n'ont eu ni la force ni le courage de s'opposer à un
secteur financier atteint par la folie des grandeurs.
Il semble ici évident que cette défaillance de contrôle provient en partie
d'un système politique dominé par des logiques oligarchiques, et où la structure
démocratique n'a pas été assez solide pour éviter le pire. L'Islande n'a pas fini de
désigner les responsables de sa crise, mais peut-on raisonnablement penser qu'il ne
s'agit là que des errements passagers d'une dizaine de fils de bonne famille ? Il est
sans doute nécessaire que l'ensemble du pays réfléchisse également, qu'il comprenne
qu'il ne s'agit pas seulement de responsabilités individuelles mais également d'une
action publique qui a failli, où le contrôle démocratique des élites a été anesthésié.
Elvira Méndez Pinedo, professeur de droit européen à l'Université d'Islande
évoque dans son livre La revolución de los vikingos publié en 2012 un pays "capturé
et fasciné par le néolibéralisme"156. Pour ce faire elle évoque notamment un récent
succès de librairie islandais, un ouvrage de Andri Snær Magnason Dreamland – A
Self Help Manual For A Frightened Nation157 où derrière l'abondance matérielle le
154 "La justice islandaise va poursuivre d'anciens dirigeants de banque" in lemonde.fr le 26.03.13 consulté le 10.06.13 155 "Islande : la commission d'enquête sur la crise bancaire rend son rapport" in euronews, le 12.04.10 consulté le 10.06.13V 156 MENDEZ PINEDO, op. cit., p.34 157 SNÆR MAGNASON A., Dreamland: A Self-‐Help Manual for a Frightened Nation, Citizen Press Ltd. London, 2008
78
jeune écrivain fait la description d'une société désorientée et passive, où l'absence de
réflexion à long terme des citoyens islandais amène à suivre aveuglément le modèle
économique néolibéral. La multitude de reportages réalisés après les protestations
islandaises recoupe souvent cette analyse, celle d'un peuple qui se serait fait dépassé
par lui-même, entraîné par l'hybris de l'économie globalisée. Il y a sans doute dans
ces retours une forme de relecture du passé, une interprétation post-traumatique où le
peuple islandais aurait été puni par là où il aurait pêché. Il faut tout autant se méfier
de ces lectures hâtives, même si elles ont au moins le mérite d'affirmer que la crise
connue par l'Islande, par delà les dégâts occasionnées, aurait contribué également à
éveiller une conscience politique longtemps engourdie.
3. Un bourgeonnement démocratique ? Renouveau et multitudes
des formes d'engagement politique
Lorsque nous avons abordé le parcours historique de l'Islande, nous avons
insisté à la fin de ce bref panorama sur le profil particulier qu'avaient pris les luttes
sociétales en Islande durant le dernier quart de siècle. Pour comprendre les formes de
l'engagement politique des Islandais, il conviendrait sans doute d'analyser les
rapports étroits que ces habitants semblent avoir tissé au fil du temps avec l'Europe et
l'Amérique du Nord. Une telle démarche serait trop large et nous mènerait bien trop
loin. Toutefois on peut de façon plus modeste signaler que certains militants
politiques islandais ne partaient pas de zéro et se sont inspirés de diverses formes
d'actions collectives du monde occidental.
Nous l'avons expliqué, l'entrée de l'Islande dans la crise a constitué un choc
brutal pour l'ensemble de la population. Toutefois, rapidement après l'état d'hébétude
et de comptabilisation des dégâts, une partie croissante des Islandais s'est peu à peu
interrogée, a débattu et s'est mobilisée, estimant que les institutions censées les
représenter n'avaient pas pleinement joué leur rôle et que le gouvernement se devait
de démissionner. Il serait maladroit de prêter davantage d'intentions aux milliers
d'Islandais qui se sont alors rassemblés devant le Parlement durant quatre mois en
79
signe de protestations. Les idées ont fusées, les exigences étaient multiples et l'on ne
saurait confondre la diversité des opinions alors exprimées avec une masse informe
qui aurait exigé unanimement plus de démocratie et une meilleure gestion des
finances du pays. Certes les mots d'ordre ont existé, et nous les évoquerons par la
suite, mais ils ne doivent pas faire oublier que chaque individu s'en ait saisi
différemment.
La "révolution des casseroles" ou Búsáhaldabyltingin démarre avec
l'organisation d'un "One man's protest" organisé sur la place d'Austurvöllur, faisant
face au Parlement. Des premières protestations avaient déjà eu lieu devant le siège de
la Banque nationale afin de demander la démission de son directeur David Oddsson,
mais c'est l'initiative de protestation musicale d'Hördur Torfason qui va véritablement
prendre racine, inaugurant ainsi un rendez-vous hebdomadaire où chaque samedi la
foule sera de plus en plus imposante, se réunissant notamment autour du mouvement
Raddir fólskins, Voix du peuple. En installant un micro devant le Parlement, en
incitant chacun à s'y exprimer et en réunissant autour de lui un certain nombre
d'artistes et d'intellectuels, Hördur Torfason lance ainsi une dynamique qui monte
peu à peu en importance, se conjugue aux nombreuses réunions et aux débats
organisées à travers la ville. Si de nombreuses associations et mouvements naîtront
par la suite, il n'est alors pas possible de voir émerger un mouvement unique et
homogène. De même il est possible de distinguer un certain nombre de meneurs et de
personnalités plus actives tels Hördur Torfason comme nous l'avons cité mais
également Birgitta Jonsdottir, Thorarinn Einarsson ou Katrín Oddsdóttir. Mais il
n'existe pas d'autorité naturelle lors de ces rassemblements, pas de personne
symbolisant à elle seule les mécontentements du peuple islandais.
Résolument pacifistes, les manifestations atteignent leur point d'orgue fin
janvier158 après avoir connu une brève accalmie lors des fêtes de fin d'année. Les jets
de projectiles sur le Parlement, l'entrée de groupes d'action au cœur du bâtiment, les
heurts avec une police en sous-effectifs deviennent fréquents. Le gouvernement de
Geir Haarde décide finalement de jeter l'éponge après la démission de plusieurs de
ses ministres et laisse donc la place libre. Un gouvernement provisoire de coalition 158 SKALSKI J, op. cit., p.50
80
entre les sociaux-démocrates et les Verts est mis en place et se trouve conforté lors
des élections législatives anticipées début février 2009 tandis que la droite perd pour
la première fois sa position majoritaire dans une défaite historique. Issu des
protestations populaires, le Mouvement des Citoyens ou Borgarahreyfingin réussit
lui à obtenir quatre députés. La question de la réforme de la Constitution fait partie
de ses exigences, tout comme pour l'ensemble des partis de gauche, même s'il
n'existe encore aucun consensus sur la méthode à employer pour cette réécriture.
Les évènements charrient avec eux débats d'idées ou borgarafundir,
et nouveaux mouvements politiques de citoyens pour qui les institutions
traditionnelles ont perdu toute légitimité. Le Théâtre National d'Islande devient le
lieu de nombreux débats politiques. La parole se libère d'elle-même après les pièces
jouées, les citoyens y voient le reflet de leur propre société et une dénonciation de la
corruption des élites locales. Il y sera réalisé également la lecture continue de
l'ensemble des 8000 pages du rapport d'investigation de la Commission chargée
d'enquêter sur la faillite des banques islandaises159, afin de porter à la connaissance
du public l'ensemble des dysfonctionnements du système économique et politique
islandais. Aussi curieux que cela puisse paraître, la crise économique a provoqué une
hausse de la fréquentation des théâtres et des lieux culturels de Reykjavik selon les
dires de Melkorka Tekla Ólafsdottir, chargée de la programmation du Théâtre
national. Il est difficile d'élaborer des hypothèses solides pour comprendre un tel
phénomène, mais l'on ne pourra s'empêcher par contre de penser à combien
l'analogie entre le jeu théâtral et le jeu politique peut être parfois pertinente, le théâtre
et le parlement ayant ici interverti leurs rôles…
Parallèlement un bourgeonnement sans pareil de souhaits de changements et
de réformes envahit le débat public. La modification de la Constitution de 1944 reste
l'action politique la plus demandée mais d'autres initiatives naissent également. Nous
pouvons citer entre autres l'Initiative Islandaise pour des Médias Modernes, ou IMMI
(aujourd'hui "International Modern Media Institute"), portée désormais par le Parti
Pirate et Birgitta Jónsdóttir. Cette initiative vise à donner à l'Islande la législation la 159 Entretien avec Melkorka Tekla Ólafsdóttir
81
plus avancée dans la protection de la liberté d'expression et d'information et dans la
protection des lanceurs d'alertes au niveau international160. Il est possible d'évoquer
également l'Initiative Islandaise pour la Réforme Financière, qui vise à modifier et
sécuriser la gestion des flux financiers dans le pays au travers d'une dizaine de
propositions portant notamment sur la transparence des transactions, la séparation
entre banques de dépôts et d'investissements etc. La Fondation des Citoyens161, ou
"Citizens Foundation", se propose quant à elle de promouvoir la "démocratie réelle"
et la "démocratie électronique" ainsi que d'améliorer les rapports des habitants de
Reykjavik avec leur municipalité au travers de l'usage des NTIC. Elle a également
encouragé l'élaboration d'un "Shadow Parliament" ou Parlement fantôme qui permet
aux internautes d'assister et de réagir directement aux propositions de lois faites au
sein de l'Althing. Son usage progresse aujourd'hui mais elle attend encore de passer
certains seuils critiques de participation selon Smári McCarthy162, un de ses
concepteurs.
Nous voyons ici quelques exemples de participation citoyenne ayant
été provoqués par l'arrivée de la crise. Nous n'allongerons pas plus la liste ici, mais
ces initiatives montrent combien la crise islandaise a créé dans son sillage une
kyrielle de propositions visant d'une part à pallier certains défauts structurels des
institutions islandaises et d'autre part à améliorer ce qui pouvait fonctionner. La
légitimité des élus politiques et de l'Althing s'est trouvée tellement disqualifiée
qu'une multitude de simples citoyens islandais s'est vue en droit de revendiquer une
capacité de jugement et de proposition au moins égale à celle des premiers.
Autrement dit la compétence politique n'est plus la prérogative de quelques élus. En
démontrant leur incapacité à gouverner le pays ils ont placé par là-même cette
compétence politique au niveau de tout un chacun, et chacun devient en droit de
proposer et d'élaborer de nouveaux horizons politiques au pays.
160 À l'heure même où ces lignes sont écrites, Edward Snowden, l'ancien employé à l'origine des révélations sur les écoutes faites par la NSA et la CIA, envisage de demander le droit d'asile en Islande avec l'aide du IMMI 161 Voir citizens.is consulté le 10.06.13 162 Entretien avec Smári McCarthy
82
II. Le tirage au sort à l’islandaise : descriptif et
premières analyses de l'expérience du Forum National
Nous avons mis en lumière l'héritage historique dont pouvait se prévaloir
l'Islande mais également les évènements récents qui ont conduit les institutions à
tester de nouvelles formes de prises de décision collective. La révolution des
casseroles a provoqué une floraison d'idées et d'associations citoyennes, l'arrivée
d'une nouvelle coalition politique au pouvoir a ouvert une fenêtre d'occasions
inédites dans l'histoire du pays. Nous allons désormais nous intéresser au cœur de
notre propos, à savoir l'expérience d'assemblée citoyenne réalisée conjointement avec
les autorités en novembre 2011. Il s'agit d'une expérience brève mais intense, dont
l'aspect novateur et expérimental doit être examiné. Il s'agit d'en comprendre à la fois
les racines, autrement dit savoir d'où a germé une telle idée, pour ensuite connaître le
chemin qu'elle a parcouru dans les esprits pour réussir à se retrouver légitimée et
soutenue. L'élaboration de cette partie s'est trouvée face à de nombreuses difficultés,
à la fois méthodologiques mais aussi linguistiques et culturelles. Par exemple le
Forum National concerne des sujets qui relèvent avant tout de politique intérieure, ce
qui explique que la grande majorité des documents l'évoquant ne soient que rarement
traduits en anglais. De même dans un souci de clarté nous avons choisi de privilégier
les informations portant sur des faits et sur le déroulement du Forum National plutôt
que sur les représentations que s'en faisaient leurs différents acteurs. Les données
recueillies notamment par le biais d'entretiens restent trop éparses et ambivalentes
pour en tirer de véritables conclusions. S'il nous arrive de citer ces entretiens, ceux-ci
viennent seulement corroborer des informations déjà obtenues par d'autres voies et ils
doivent avant tout être considérés dans leur fonction illustrative. Les questions
soulevées ici restent ainsi encore nombreuses et appelleraient sans cesse à des
explorations plus poussées.
83
1. Aux origines du Forum National : acteurs, organisateurs et
sources d'inspirations
Afin de comprendre et saisir l'objet "Forum National", nous souhaitons en
décrire le processus d’émergence et ses rapports avec la première assemblée tirée au
sort organisée durant l'année 2009. Il s'agit également de comprendre comment le
tout jeune gouvernement islandais a accepté d’utiliser cette expérience et de lui
permettre d'initier une révision de la Constitution.
L'idée du Forum National connaît une genèse particulièrement
mouvementée puisqu'elle naît dans le contexte de l'après-crise économique et
politique de l'Islande. Le constat d'un échec des institutions à représenter les
aspirations de leurs citoyens traverse l'esprit de plusieurs manifestants d'Austurvöllur
et les incitent à se regrouper en associations pour réfléchir à de nouvelles façons
d'organiser la prise de décision collective. C'est notamment le cas de l'association La
Fourmilière, ou Mauraþúfan, composée d'une dizaine de personnes qui se veulent de
toutes orientations politiques, qui mènera une première expérience d'assemblée tirée
au sort, celle de l'Assemblée Nationale de 2009, ou Þjóðfundur 2009, avec l'aide de
la compagnie Agora et sera ensuite rejointe par le groupe Alda163 pour la mise en
œuvre du Forum National de 2010.
Si la Fourmilière s'est constituée de façon informelle et ne compte que peu
de personnes en son sein, Agora se définit elle comme une compagnie à but non
lucratif, une "société d'innovation islandaise"164 dans le domaine notamment du
"crowdsourcing"165. Son fondateur, Guðjón Már Guðjónsson, semble être également
le principal initiateur de l'association La Fourmilière166 et surtout à l'origine d'une
partie du financement de l'expérience d'assemblée tirée au sort de 2009167, expérience
informelle ayant été menée hors du contrôle des pouvoirs publics. Guðjón Már
163 en.alda.is consulté le 5.06.13 164 agora.is consulté le 4.06.13 165 le "crowdsourcing" désigne les processus de travail collaboratif à grande échelle. Wikipédia en est un exemple bien connu. 166 Entretiens avec Larús Ymir Oskarsson et Bjarni Jonsson, membres de la Fourmilière 167 Entretien avec Larús Ymir Oskarsson
84
Guðjónsson est un entrepreneur ayant fondé un certain nombre d'entreprises de
télécommunications et de travaux publics, il est également à l'origine du "Ministère
des idées"168, ou Hugmyndaráðuneytið, un groupe de réflexion censé faciliter la
communication entre entrepreneurs et surtout à l'origine de nombreux projets
d'échanges et de forums169 disponibles en code source libre sur des sujets variés dont
notamment celui de la démocratie et de l'intelligence collective. L'un de ses projets
d'innovation pour une "démocratie active"170, datant de 2009, établit notamment un
parallèle étonnant et inattendu entre la nation islandaise et une entreprise. L'Islande
doit ainsi se pourvoir d'une "vision", tout comme General Motors dont le nombre
d'employés équivaut d'ailleurs au nombre d'habitants de l'île… Cette irruption du
discours du management entrepreneurial peut sembler surprenante, mais il est en
réalité extrêmement présent dans les deux expériences d'assemblées.
L'un des principaux élaborateurs du Forum National 2010 et de l'Assemblée
Nationale de 2009 a produit récemment un travail de recherche171 qui nous permet
d'en savoir plus sur les sources d'inspiration de ces assemblées tirées au sort. Bjarni
Jonsson évoque172 ainsi parmi elles la "Spiral dynamics theory", issu apparemment
des travaux des professeurs Beck et Cowan173. Cette théorie en psychologie
évolutionniste semble vouloir expliquer les suites de phases adaptatives par
lesquelles passerait tout groupe humain et expliciter les façons de passer à une phase
supérieure. Bjarni Jonsson cite également le concept de "structural coupling" et
d'autopoïesis parmi ses inspirations, concepts développés notamment par Maturana et
Varela174. Ces termes servent avant tout à décrire les mécanismes d'adaptation des
168 theministryofideas.is consulté le 4.06.13 169 Pour exemple l'organisation de conférences TED, voir tedxreykjavik.com consulté le 5.06.13 170 Un certain nombre ce ceux-‐ci sont disponibles sous forme de diapositives sur fr.slideshare.net/gudjon/ministry-‐of-‐ideas-‐overview-‐of-‐grassroot-‐projects-‐in-‐iceland-‐june-‐2009 consulté le 5.06.13 171 SNÆBJORN JONSSON B., Public Communicative Engagement and Conscious Evolution of Human Social Systems, Reykjavik, 2013 Cette thèse ne sera disponible au grand public que fin juin 2013. Nous avons eu la chance de pouvoir accéder à son contenu avant sa publication effective, peu de temps avant le rendu de ce mémoire. 172 SNÆBJORN JONSSON B., op. cit., p.13 173 BECK D. E., & COWA C., Spiral dynamics:Mastering values, leadership, and change. Cambridge, MA Blackwell Business, 1996 174 MATURANA, H., & VARELA, F., The tree of knowledge: The biological roots of human
85
groupes humains, l'autopoïesis par exemple désignant la capacité d'un organisme à
pouvoir s'adapter à son environnement. Affirmant vouloir lier son expérience du
management et ses recherches en sciences sociales, Bjarni Jonsson souhaite ainsi
définir davantage les dynamiques et l'évolution des systèmes sociaux humains d'un
point de vue résolument holistique175 au travers de l'exemple du Forum National.
Certains aspects du discours de Bjarni Jonsson relève clairement du
vocabulaire du management entrepreneuriale, voire du développement personnel. Il
est ainsi question par exemple de sublimer "l'énergie négative du conflit"176 en
recherchant de nouvelles formes d'organisations humaines. Á travers son écrit, et
dans des échanges oraux177 il est également possible de percevoir chez Bjarni
Jonsson une forte croyance dans l'idée qu'il serait possible d'atteindre des formes de
consensus, que le conflit ne serait qu'une forme d'incompréhension qu'il s'agirait
d'éclaircir. Le challenge serait donc de trouver les formes de débats et de dialogues
les plus abouties.
Parallèlement il cite également Machiavel dans la peinture que ce dernier
fait du comportement des foules178 mais également Dewey dans un discours de 1937
où celui-ci évoque les liens entre démocratie et intelligence collective179. Cet extrait
choisi qui affirme que la démocratie relève de la "foi en l'intelligence humaine" et du
pouvoir de "l'expérience collective", nous montre qu'il peut être envisageable
d'établir des passerelles inattendues entre philosophie politique et management. Par
ailleurs ce choix de citation n'est pas anodin et nous permet directement de nous
relier aux premières réflexions de notre mémoire. Les écrits de Dewey, s'ils refusent
understanding. Boston, MA Shambala, 1987 175 SNÆBJORN JONSSON B, op. cit., p.20 176 Ibid., p.26 177 Entretien avec Bjarni Jonsson 178 SNÆBJORN JONSSON B, op. cit., p.25 179 SNÆBJORN JONSSON B op.cit., p.58, Conférence de Dewey en 1937 “Democracy as a Way of Life,” : "The foundation of democracy is ... faith in human intelligence and in the power of pooled and cooperative experience. It is not belief that these things are complete but that, if given a show, they will grow and be able to generate progressively the knowledge and wisdom needed to guide collective action." issue de CASPARY, W-‐ R., Dewey on Democracy, Cornell University Press, 2000 p. 198
86
de définir l'objet de la démocratie, encouragent par contre à tester et à comprendre les
dynamiques et les mécanismes des foules.
Si par exemple la croyance dans l'obtention irrémédiable d'un consensus
pourrait sembler naïve, force est de reconnaître qu'une telle vue a permis pourtant
d'obtenir une adhésion importante au projet du Forum National. En plaçant les débats
du Forum National dans une optique plus large que les débats politiques du
quotidien, en souhaitant dépasser les orientations politiques de ses membres, la
Fourmilière et le processus pour une nouvelle Constitution ont réussi là où l'Althing
avait échoué depuis 1944, à savoir définir une nouvelle base de valeurs pour les lois
du pays.
Il est à noter enfin que l'usage du tirage au sort et de certaines techniques de
démocratie participative l'ont été pour la rédaction d'une Constitution. Or un tel texte
se prête particulièrement au jeu. D'abord parce qu'en général il prétend provenir
directement du peuple et parler en son nom. Mais aussi parce qu'il est toujours
possible de s'interroger sur la légitimité d'une institution qui modifierait elle-même le
texte qui régit ses propres fonctions. Nous l'avons vu avec l'expérience en Colombie
Britannique, il peut être perçu comme plus logique et légitime d'éviter aux élus d'un
parlement de redéfinir eux-mêmes les termes de leur mandat et de leur élection.
Les sources d'inspirations et les modalités de la constitution du Forum
National sont diverses et variées. Elles relèvent surtout de mécanismes informels :
rencontres, discussions, choix de groupe, rencontres entre responsables politiques et
responsables d'associations. Il est difficile de qualifier leur influence, encore plus de
les répertorier. De même pour ses sources d'influence, on constate que l'idée du
Forum National était difficilement prédictible, que l'idée du tirage au sort a dû passer
par tout un chemin de légitimation scientifique.
87
2. L'Assemblée Nationale de 2009 : échos et limites d'un premier
test
La première assemblée a été tenue le 14 novembre 2009. Si le
gouvernement n'a pas pris l'initiative de ce premier projet, il reste par contre à
l'origine d'environ un quart des financements d'une organisation dont le coût s'est
élevé à environ 217 000$180, le reste ayant été financé par des fonds privés et
notamment les associations cités précédemment. Sa tâche, plus large et imprécise que
celle du Forum National sera de définir "les valeurs de l'Islande" et le futur souhaité
pour le pays. Elle rassemblera environ 1200 personnes volontaires et choisies au
hasard sur l'ensemble de la population islandaise, en respectant certains quotas d'âge,
de genre et de localité. Toutefois contrairement au Forum National, les refus essuyés
n'obligent pas les organisateurs à renvoyer un courrier à une personne du même âge
et du même lieu, ce qui crée de premiers biais dans ce qui est censé être un
échantillon représentatif de la société islandaise et réduit le nombre des plus jeunes et
des plus âgés au sein de l'assemblée au profit des classes d'âges de 40 à 60 ans181. De
même, et cette fois comme le Forum National, l'existence de quotas en fonction des
revenus, de l'origine sociale, ne sont pas appliqués non plus. Aux 1200 Islandais
s'ajoute ici 300 personnes choisies, représentants d'institutions, d'entreprises et
d'associations, et notamment de celles ayant participé financièrement au projet. De
même, ce biais ne sera pas reproduit pour la deuxième expérience, peut-être
justement parce qu'il pose de sérieuses questions quant à la prétention de faire de
l'Assemblée Nationale de 2009 une "mini-Islande". A quoi bon sélectionner un
échantillon représentatif si cela implique par la suite de le modifier ? Bjarni Jonsson
semble esquisser une première réponse en affirmant qu'il s'agissait là d'une mesure
davantage stratégique, faite pour gagner le soutien des autorités économiques et
politiques du pays182.
180 Voir participedia.net/en/cases/national-‐assembly-‐iceland-‐2009#ftnt16 consulté le 5.06.13. Il s'agit d'une contribution de l'association Alda, récapitulant l'expérience islandaise 181 SNÆBJORN JONSSON B, op. cit., p.56 182 SNÆBJORN JONSSON B, op. cit., p.54
88
La critique de la composition de l'assemblée est peu présente et au contraire
on loue l'originalité et le caractère avant-gardiste du processus décisionnel ainsi que
la production de plus de 12 000 idées183 pour l'avenir de l'Islande. Si l'ensemble des
propositions est intéressant, même trié en neuf catégories il semble difficilement
utilisable et rassemble des propositions aussi diverses, larges et variées que "garantir
un congé de maternité de 12 mois", "l'indépendance énergétique", "une monnaie
stable et des médias libres" etc. L'ensemble de la production de l'Assemblée
Nationale était disponible à la fin de la journée sur internet (en islandais toutefois),
mais une véritable participation des internautes au processus semble par contre ne
pas avoir été mise en place, à l'inverse des travaux du Conseil Constitutionnel. De
façon générale les liens bâtis entre ces expériences et la sphère des nouveaux médias
sociaux sont souvent mis en avant, ce qui reste peu étonnant dans un pays
comptabilisant le plus grand nombre d'utilisateurs d'internet au monde par rapport à
sa population184.
Après avoir soutenu en partie l'Assemblée Nationale et observé l'écho
positif que celle-ci laisse derrière elle, le gouvernement de Jóhanna Sigurðardóttir
décide d'intégrer une procédure similaire à la révision de sa Constitution. Il reste
difficile de connaître les véritables liens qui ont présidé à cette ouverture
exceptionnelle d'un gouvernement sur d'autres modes d'élaboration constitutionnels.
Il semble que celle-ci se soit réalisée notamment suite aux propositions de plusieurs
députés membres de la coalition au pouvoir ayant pris contact avec La
Fourmilière185. La proposition semble avoir été faite également au gouvernement
précédent, en novembre 2008, qui n'a pas trouvé le temps d'y donner une suite avant
sa démission.
183 Voir notamment une brève présentation en anglais de la production de l'Assemblée sur thjodfundur2009.is/english 184 The Global Information Technology Report 2010–2011, 2011 World Economic Forum, p.372 chiffres de 2009 disponible sur weforum.org consulté le 10.06.13 185 Entretien avec Bjarni Jonsson
89
Le 16 Juin 2010 l'Althing, constituée de la nouvelle coalition au pouvoir des
sociaux-démocrates et des écologistes, adopte la loi 90.2010. Cette loi186 ou Lög um
stjórnlagathing, loi pour un parlement constitutionnel, explicite les mécanismes de
révision constitutionnelle adoptés. Elle permet la création du Forum National, mais
aussi du Conseil Constitutionnel (25 à 31 membres issus de la société civile) qui
s'inspirera des propositions réalisées par le Forum. Elle crée également un Comité
constitutionnel de 7 membres, chargé de piloter l'ensemble des opérations et
d'organiser les élections du Conseil Constitutionnel, tandis qu'un Comité de
préparation est également mis en place dont le rôle sera plus explicitement
d'organiser le Forum National et de faire le lien avec le Conseil Constitutionnel. Les
membres du Forum National qui devront être sélectionnés devront être des
nationaux, en possession de leurs droits civiques et leur choix doit respecter la parité
homme/femme. Quant au but du Forum National il doit être de focaliser l'attention
du public sur la Constitution et d'aider le Parlement dans sa réflexion. Enfin le
Parlement garde la main puisque le Conseil Constitutionnel doit par la suite lui faire
parvenir sa réflexion sous forme d'une proposition de loi que celui-ci validera ou
non. Nous pouvons résumer l'ensemble du processus par le schéma suivant :
186 Le texte traduit en anglais est disponible à l'adresse suivante : thjodfundur2010.is/other_files/2010/doc/Act-‐on-‐a-‐Constitutional-‐Assembly.pdf
90
Althingi désigne l'Althing, autrement dit le Parlement islandais. Celui-ci
nomme les membres du Comité Constitutionnel, chargé d'organiser et préparer
l'ensemble du processus d'élaboration de la nouvelle Constitution. Il prépare
notamment le Forum National (désigné ici sous le terme de "National Gathering") et
les élections pour la formation du Conseil Constitutionnel, à ne pas confondre avec
notre Conseil Constitutionnel français, il s'agit bien là d'une forme d'Assemblée
constituante. Ce conseil élu a changé de dénomination en cours de procédure
(passant "d'Assemblée constitutionnelle" à "Conseil Constitutionnel") après
invalidation de la Cour suprême. Afin d'être au plus clair dans notre exposé, nous
désignons l'assemblée tirée au sort en 2010 comme le Forum National et l'assemblée
constituante élue en 2011 comme le Conseil Constitutionnel.
La formation du Forum National187 s'opère donc par sélection au tirage au
sort à partir du registre national des électeurs inscrits. Chaque électeur tiré au sort a
le droit de refuser de participer, et s'il accepte, reçoit en compensation pour la
187 Les informations concernant le déroulement du Forum National proviennent notamment du document Tháttur Tjodfundur 2010, disponible sur le site du Forum National, thjodfundur2010.is repéré et mise à ma disposition par Gudrun Petursdottir, présidente du Comité Constitutionnel et dont la traduction a été possible grâce à l'aide de Ársæll Hjálmarsson, un ami.
91
journée une somme de 17 500 ISK, soit environ 110 €. Le coût total du Forum
National de 2010 est ainsi estimé à 100 millions de couronnes soit environ 600 000
euros, financé par des fonds publics.
La désignation de chaque participant se fait avec la prise en compte de 4
extras par personne. Autrement dit si une personne refuse, il doit être possible de
trouver quatre personnes derrière capables de pouvoir prendre sa place. Fin
septembre deux lettres différentes sont envoyées, l'une au participant direct et l'autre
au premier remplaçant potentiel (sachant qu'il s'en trouve normalement deux autres
encore pour "remplacer le remplaçant"). Au final 478 personnes sur 1000 ont accepté
directement de participer, tandis que 1191 personnes sur 4000 ont accepté la
possibilité d'être prises comme remplaçant. Le 5 novembre 2010 les remplaçants
ayant accepté sont convoqués pour prendre la place des absents. De même ici,
aucune indication n'est donnée quant à l'utilisation ou non de quotas suivant des
critères socio-économiques, ceux-ci concernent uniquement le genre, l'âge et la
localité. Or l'on sait que les populations les plus défavorisés tendent à moins
participer politiquement. Il est donc possible de trouver ici un premier biais par
rapport à la microsociété que prétend représenter le Forum National.
3. La machine est lancée : déroulement du Forum National et
premières observations
Le Forum National islandais ou Þjóðfundurinn 2010 est donc issu de la loi
90.2010 élaborée par l'Althing. Sa préparation et sa constitution débuteront dès le
vote de la loi et se poursuivront sur cinq mois, de juin à novembre 2010 jusqu'à la
date de sa tenue le 6 novembre. Celui-ci est censé réunir initialement 1000 personnes
choisies au hasard, auxquels s'ajoutent 200 personnes dont le rôle sera uniquement
d'aider au processus et à la bonne tenue des débats. Ces "facilitators"188, comme ils
188 "Facilitator's handbook" disponible sur agora.is en Creative Commons. Ce guide constitue une source d'information particulièrement riche sur l'organisation et le déroulement qui étaient attendus du Forum National
92
sont nommés, ne doivent pas interférer avec la parole des participants mais au
contraire veiller à ce que tout un chacun puisse s'exprimer librement. Le "facilitator"
est défini par ailleurs comme un "auditeur actif"189, qui doit prendre en compte
attentivement toutes les remarques et propositions qui seront faites au cours de cet
exercice et permettre à chacun de se sentir à la hauteur des débats. Il s'agit là d'un
point sur lequel nous reviendrons, la plupart des échos que nous avons du Forum
National mettent en avant cette mise en confiance des participants.
Le 6 novembre 2010, plus d'un millier de personnes se réunit à
Laugardalshöll, l'un des plus grands gymnases du centre de Reykjavik, afin de
discuter, proposer et débattre à propos de la Constitution islandaise et des
modifications à lui apporter. Le Forum National réunit ainsi des personnes de
l'ensemble du pays, où tous les âges sont présents, de 18 à 91 ans (le participant le
plus jeune et le plus âgé se trouvant d'ailleurs par un effet du hasard, à la même
table).
L'ensemble de la procédure doit durer huit heures, entrecoupée de pauses et
de sessions dont la durée n'excède jamais plus de 70 minutes. Le nombre de sessions
totales est de treize, chacune d'entre elles correspondant à une action précise réalisée
par chacun des groupes de huit personnes répartis en 128 tables de discussion. En
plus des "facilitators", chaque groupe de 16 tables est coordonnée par un "director of
the area", chargé de résoudre les problèmes qui pourraient subvenir et surtout de
fournir tout matériel manquant. Le plan suivant, où chaque cercle représente une
table de huit personnes, nous permet d'avoir une idée de l'organisation du débat.
189 "Facilitator's handbook", p.3
93
Chaque session de temps concerne des actions telles que la présentation de
soi-même et de ses idées, l'approfondissement et la justification de valeurs choisies
mais également des actions de synthèses des échanges. Autrement dit les huit heures
passées alternent entre moments d'émulation et de sélection des idées. Les
discussions sont initiées dans la matinée avec un thème vaste, "valeurs et
représentations de la Constitution" (session 1), puis précisent peu à peu leur objet,
évoquent ensuite "ce qui doit être contenu dans la Constitution" (session 2), puis
enfin dans l'après-midi impliquent une "spécialisation, discussion et
approfondissement" (session 6). Les valeurs jugées les plus importantes sont relevées
par le groupe de discussion par le biais d'un vote pondéré. On opérera de la même
façon par la suite avec celles dont on juge qu'elles impliquent le plus de changements
ou sont les plus innovantes. La première partie des débats sur les valeurs fait naître
d'abord une forme de "nuage des valeurs" :
94
La taille du mot est fonction du nombre de ses occurrences, autrement dit
plus une "valeur" aura été citée par des participants pour qu'elle soit présente dans la
nouvelle Constitution, plus celle-ci est grande. Pour indication le terme "jafnrétti"
désigne ainsi l'égalité des droits, tandis que "lýðræði" signifie démocratie, "frelsi" la
liberté, "mannréttindi" les droits de l'Homme etc. Comme nous l'a fait remarquer
Guðrún Pétursdóttir, la présidente du Comité Constitutionnel, une telle production
peut être la proie de bien des critiques En effet, si ce nuage permet d'avoir une vue
relative des valeurs qui peuvent préoccuper les Islandais, que peut-il apporter de plus
? Cela ne risque-t-il pas de rester cantonné au rôle de "gadget" ? Nous touchons ici
du doigt les limites de certaines formes d'expériences "d'intelligence collective", car
si une foule ou un groupe d'individus peut produire des données, il faut ensuite
procéder au travail et à l'interprétation de celles-ci. C'est ce que tente de faire le
Forum National dans un second temps.
La deuxième partie du Forum constitue notamment un approfondissement
autour de huit domaines de la constitution sur lesquels vont discuter des groupes
renouvelés de huit personnes. Ces huit grands domaines, élaborés par les
"facilitators" à partir des valeurs cités par les participants dans la matinée, se divisent
sur le modèle suivant :
- Ethique et moralité
- Droits humains
- Division du pouvoir, responsabilité et transparence
- Démocratie
- Environnement, protection et mise en œuvre
95
- Justice, Etat social et égalité
- Paix et collaboration internationale
- Pays et nation.
Chacun d'entre eux constitue une entrée où vont être placés des
propositions, réalisées soit de manière individuelle, soit par le groupe de travail.
Chaque proposition est classée en arborescence, et leur ensemble forme
ainsi une liste impressionnante de recommandations pour chacun des domaines cités
précédemment190191. Par exemple dans le premier domaine portant sur l'éthique et la
moralité, la proposition I.1 indique qu'il est nécessaire d'avoir une loi pour
réglementer et changer le salaire des parlementaires. La proposition I.1.1, une sous-
partie, explicite davantage cette proposition en indiquant également que cette loi
devra spécifier que les parlementaires ne doivent accepter aucun cadeau ou don de
qui que ce soit. Autre exemple concernant cette fois les propositions en matière
d'amélioration de la démocratie islandaise, la proposition suivant laquelle la
Constitution doit garantir l'égalité de tous les parlementaires et de tous les citoyens
dans leur accès au parlement et aux élections, etc.
Enfin le Forum National se termine avant 18h par la tenue d'une conférence
de presse pour présenter les principaux sujets soulevés au cours des débats. Des
retours ont également lieu et permettre de signaler les dysfonctionnements ayant pu
être observés. Les propositions principales sont publiées sur internet le jour
suivant192. Le document reprenant l'ensemble des contributions mis également en
ligne et transmis au futur Conseil Constitutionnel représente quant à lui plus de 700
pages de recommandations.
Nous le constatons, la procédure du Forum National regroupe des outils à la
fois très complexes et simples. Ceux-ci sont complexes, car il s'agit ici de gérer un
190 Cette liste n'est hélas disponible qu'en islandais, sur le site thjodfundur2010.is consulté le 03.06.13 191 Exemples de propositions disponibles en annexe 192 Disponible sur la page suivante : http://www.thjodfundur2010.is/frettir/lesa/item32858/ consultée le 03.06.13
96
groupe d'un millier de personnes, de coordonner et recueillir des opinions dont on
sait qu'elles seront très diverses, mais également de ne surtout pas donner
l'impression de diriger et répondre aux débats à la place des participants. Le Forum
National possède donc également une exigence de simplicité, dans le sens où il se
doit d'être accessible à tous et d'éviter de déborder des citoyens dont nombre d'entre
eux n'ont par ailleurs jamais lu la Constitution de leur pays. Il s'agit là d'une action
subtile pour garantir à la fois la simplicité du débat et l'ouverture à la parole, tout en
évitant de considérer les participants comme des inaptes au jeu démocratique.
Le document produit par le Forum National évoque à plusieurs reprises le
caractère positif de la participation, l'aspect enrichissant de la coopération et du débat
entre des Islandais venus des quatre coins du pays. De même, les organisateurs du
débat font surtout part du fait d'avoir dû accepter peu à peu de "perdre le contrôle",
de faire confiance aux citoyens présents. A de nombreuses reprises Guðrún
Pétursdóttir ou Lárus Óskarsson193 évoquent également leur confiance dans
l'intelligence des foules, le fait qu'une fois un dispositif lancé, le meilleur souci de ses
organisateurs doit être de le laisser devenir autonome. Il est intéressant de constater
que cette notion de "perte de contrôle" est récurrente, et concerne tout autant le
mécanisme de tirage au sort que la tenue même des débats du Forum National.
Discuter davantage les liens entre l'esprit pédagogique et l'esprit démocratique au
travers de cet exemple s'avèrerait être un sentier passionnant à prendre.
193 Entretien avec Gudrun Petursdottir, présidente du Comité Constitutionnel ; Entretien avec Lárus Ymir Óskarsson, membre de la Fourmilière
97
III. Quel avenir pour le cas islandais ?
L'expérience islandaise a-t-elle eu véritablement de l'écho ? Nous l'avons
vu, elle n'a été formée que le temps d'une journée et le fruit de son travail n'avait
aucune valeur d'obligation. Les documents produits ont toutefois été utilisés en
grande partie par le Conseil Constitutionnel et ont même été approuvés par le corps
électoral. Le Forum National islandais constitue de plus une première, à la fois dans
l'histoire du pays, mais également dans l'histoire démocratique comme étant la
première assemblée tirée au sort à l'échelle d'un pays, et formée dans l'optique d'un
processus constitutionnel. Si nous avons jusque là observé le Forum National "de
l'intérieur", avec tout ce qu'un tel processus peut porter avec lui d'enthousiasme et de
confiance dans la recherche de consensus, il convient désormais de montrer
davantage quelles en ont été les limites et les critiques, ainsi que ses conséquences à
long terme à la fois pour l'Islande et au niveau international.
1. Que faire du fruit du Forum ? La production citoyenne face aux
institutions traditionnelles
Qu'est-il advenu concrètement de la production du Forum National ? Quelle
réception a-t-elle eu dans les milieux politiques et dans le processus constitutionnel ?
Autant de questions auxquelles il convient de répondre pour savoir si le Forum
National n'aura été qu'une forme de "gadget participatif" ou aura véritablement
permis d'impacter sur la rédaction de la nouvelle Constitution. Pour comprendre cela
il convient de s'intéresser à la suite du processus constitutionnel et de saisir comment
le contenu produit par le Forum National s'est vu réapproprié par le Conseil
Constitutionnel puis par les Islandais eux-mêmes.
98
Les élections pour la formation du Conseil Constitutionnel suivent dans la
foulée la tenue du Forum National, puisque la campagne des 522 candidats qui se
présenteront commence le même mois, en novembre 2011, pour aboutir le 27
novembre à l'élection de 25 d'entre eux. Outre les critères classiques d'éligibilité, le
président, les ministres et les membres du Parlement n'étaient pas autorisés à se
présenter à cette élection, elle devait donc avant tout permettre la désignation de
citoyens issus de l'extérieur du cénacle politique habituel. La complexité de la
procédure élective, basée sur le système du vote transférable194, et le nombre de
candidats ont sans doute concouru au plus faible taux de participation jamais atteint
depuis l'existence de la République d'Islande, avec seulement 35,95% de
participation, soit le vote de 83 000 personnes. L'élection permet l'accès au Conseil
de 15 hommes et 10 femmes, issus pour la plupart de la capitale, souvent de
catégories sociales élevées195 et déjà connus au sein de la population. On y trouve
notamment des avocats, des professeurs, des journalistes, un directeur de théâtre,
mais également un syndicaliste, un pasteur, un fermier et une étudiante.
A cette faible participation qui fragilise la légitimité du Conseil
Constitutionnel, s'ajoute l'invalidation de l'élection par la Cour suprême le 25 janvier
2011 après saisine de plusieurs députés de l'opposition196. Déclarée nulle et non
avenue, elle considère que ces élections n'ont pas suivi les règles normales du jeu
parlementaire. Les motifs d'invalidation de la Cour suprême concernent surtout des
questions techniques sur la conduite du vote197. Cette décision, en plus de stopper un
temps le processus constitutionnel, fournit des motifs de méfiance vis-à-vis des
juges, considérés comme partiaux. En effet la majorité d'entre eux ont été choisis par
les partis de droite précédemment au pouvoir.
194 Explicatif disponible (en anglais) sur electoral-‐reform.org.uk/?PageID=483 consulté le 10.06.13. Le système de vote transférable consiste pour l'électeur à établir un ordre de priorité dans le choix de ses candidats. Il désigne ainsi les candidats qu'il souhaite favoriser si le premier qu'il a choisi n'a pas obtenu suffisamment de voix. 195 "Iceland Elections Results Announced" in icelandreview.com le 01.12.10 consulté le 10.06.13 196 " Iceland’s Constitutional Assembly Voting Invalid" in icelandreview.com le 25.01.11 consulté le 10.06.13 197 SKALSKI J., op. cit., p.71
99
Un mois plus tard, le groupe de travail formé par le Parlement pour résoudre
le blocage institutionnel recommande de transformer l'élection en nominations
directement effectuées par l'Althing. Le 24 mars l'Althing approuve la nomination
des 25 personnes qui avaient été élus, transforme l'Assemblée constitutionnelle en
Conseil Constitutionnel198. Le travail du Conseil constitutionnel commence début
avril, s'étendra sur quatre mois jusqu'à la remise solennelle de sa proposition de loi
constitutionnelle le 29 juillet à l'Althing.
Divisé en trois comités d'élaboration, le Conseil Constitutionnel travaille
notamment sur le modèle du wiki, chaque comité complétant directement un
document commun mis en ligne199. Ces trois comités suivent les trois grandes suites
de principes, à savoir : la transparence, la distribution du pouvoir et la
responsabilité200. La volonté de rendre le processus décisionnel le plus transparent
possible amène à un fort usage des NTIC, à une retransmission des réunions à la
télévision et à leur accès par internet. Les contributions faites par Facebook et
Twitter atteignent 3600 propositions, qui s'ajoutent aux 370 propositions envoyées
par lettres par des habitants islandais201.
Cette proposition de loi constitutionnelle202 reprend largement les
principales conclusions du Forum National203. Elle propose notamment un Parlement
davantage indépendant du gouvernement, tout comme par exemple l'impossibilité
pour les ministres d'être également députés, situation fréquemment rencontrée jusqu'à
aujourd'hui. Elle ouvre la possibilité de référendums citoyens, et opère à une
simplification du système de vote et à un rééquilibrage des régions qui auparavant
privilégiait les votes ruraux et avantageait les partis conservateurs. Elle introduit
également le principe de subsidiarité pour l'organisation territoriale, et opère au
198 SKALSKI J., op. cit., p.73 199 Par l'usage de GoogleDocs notamment, voir E. BERGMANN, "Reconstituting Iceland – constitutional reform caught in a new critical order in the wake of crisis", in academia.edu, January 2013, p.8 consulté le 10.06.13 200 E. BERGMANN, op.cit., p.7 201 Ibid., p.8 202 Disponible en anglais à l'adresse suivante stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp-‐enska.pdf consulté le 10.06.13 203 E. BERGMANN, op.cit., p.7
100
renforcement de l'indépendance de la justice en explicitant et complexifiant le choix
des juges. Enfin tout changement constitutionnel doit également être désormais
ratifié par un référendum, qui acquiert désormais une valeur obligatoire alors que
sous le régime de la Constitution de 1944 un référendum n'oblige en rien le
gouvernement, et une modification constitutionnelle se doit d'être validée par
l'Althing sous deux mandatures différentes.
De façon plus large, le Conseil introduit les droits sociaux ou droits de
"troisième génération" au sein de sa définition des droits humains et développe des
extensions inédites au droit environnemental, introduisant notamment la propriété
collective des ressources naturelles204.
Nous ne rentrerons pas davantage dans les détails des travaux du Conseil
Constitutionnel, il mériterait à lui seul une étude bien plus approfondie. Toutefois, il
peut être intéressant de signaler juste un point, soulevé par Jón Ólafsson également,
professeur de science politiques à l'Université islandaise de Bifröst205. Celui-ci
évoque ainsi un Conseil dont les membres ont exprimé ouvertement leur hostilité
envers les élites politiques et ont chercher à éviter tout lien avec le Parlement206 et
ses partis politiques. Paradoxalement, cette absence de liens a sans doute contribué à
entraver la procédure constitutionnelle puisque le Parlement garde bien le dernier
mot dans l'adoption de la nouvelle Constitution.
Ainsi la tenue d'un référendum le 20 Octobre 2012 sur les points principaux
de la nouvelle Constitution et son succès relatif n'auront pas été suffisants. Ce
référendum posait une série de six questions sur la production du Conseil
Constitutionnel et sur son contenu, notamment sur des points tels que la
nationalisation des ressources naturelles non encore exploitées, la séparation de
l'Eglise et de l'Etat etc207. Le taux de participation frôle les 50%, le Parti de
l'Indépendance appelle au boycott, mais le référendum recueille des réponses 204 Ibid. p.7 205 J. OLAFSSON, "Experiment in Iceland : Crowdsourcing a Constitution ?", in academia.edu, consulté le 10.06.13 206 Ibid., p.6 207 P. FONTAINE, "Iceland Says Yes To New Constitution" in grapevine.is le 22.10.12 consulté le 10.06.13
101
positives pour l'ensemble des questions effectuées. Or l'on constate que l'ensemble de
ces points avaient été justement soulevés et proposés par le Forum National, qui
avaient donc su capter les exigences du corps électoral.
L'élaboration de la nouvelle Constitution islandaise, le chemin chaotique
qu'elle suit, mettent en évidence des relations de pouvoirs complexes entre les
institutions politiques traditionnelles et l'émergence d'une sphère constituée du
Forum National et du Conseil constitutionnel que nous pourrions qualifier "d'extra-
politique". Cette qualification doit être comprise dans le sens où les participants de
ces expérience prétendent s'extraire du jeu politique, se prétendent parfois apolitiques
et réalisent pourtant des tâches habituellement vouées à un processus de politisation.
Pour le professeur Eirikur Bergmann208 ce processus fait partie d'un
"moment constituant", un instant particulièrement sensible dans l'histoire d'un pays
où l'on tente de redéfinir profondément ses valeurs fondatrices dans un moment de
crise économique et politique profonde. La ré-écriture islandaise constitue-t-elle une
forme d'anomalie historique ou bien sera-t-elle le symbole d'une nouvelle façon de
concevoir nos régimes politiques ? C'est en s'interrogeant sur son avenir et sur le
possible exemple que celle-ci a pu donner que nous saurons mieux éclaircir nos
interrogations.
2. Une constitution inaboutie et dépendante du pouvoir
Nous l'avons vu au cours de la description de ce processus, les obstacles à
l'élaboration de la nouvelle Constitution ont été nombreux. La possibilité de voir ce
nouveau texte véritablement adopté s'est considérablement réduite avec les élections
législatives du 27 avril 2013. Le retour de la droite au pouvoir, par le biais d'une
coalition entre le Parti du Progrès et le Parti de l'Indépendance menée par Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson, laisse a priori peu de doutes sur son avenir, ces deux
formations n'ayant jamais caché leur scepticisme voire leur opposition vis à vis de ce
texte. Le Parti de l'Indépendance notamment a toujours affirmé vouloir éviter une 208 E. BERGMANN, op. cit., p.1
102
"révolution de la constitution", et toute "modification hâtive"209 d'un texte qu'il juge
précieux. Le Parti du Progrès en appelle également à la prudence et envisage plutôt
que le texte produit par le Conseil Constitutionnel serve de modèle pour une autre
révision constitutionnelle210, cette fois opérée par des voies plus classiques.
L'absence de débats sur le fond du texte, la dénonciation de défaillances techniques
ne permettent pas de connaître les véritables motifs (s'il y en a) d'une telle entrave à
la nouvelle Constitution de la part de l'opposition. Il semble toutefois que les
changements de modalité de vote et la simplification du système électoral211 qui
découleraient d'une constitution proclament l'égalité de tous dans la représentation
réduirait la base électorale du Parti du Progrès. En effet traditionnellement celui-ci
compte davantage d'électeurs en milieu rural, eux-mêmes surreprésentés par la
répartition des députés en fonction de leur région d'élection. Dans la même ligne, la
volonté de déclarer les ressources naturelles encore non exploitées comme "propriété
de la nation" semble problématique pour le Parti de l'Indépendance, dont les
électeurs sont en partie issus du milieu de la pêche. Le risque d'un plus grand
contrôle des ressources halieutiques n'est pas un sujet anodin pour un pays qui base
encore une importante partie de son économie sur ce secteur212.
Enfin le sujet de la Constitution n'a été que peu présent durant la campagne
électorale d'avril 2013, au profit de celui de l'adhésion à l'Union européenne, de
l'avenir de la Couronne islandaise et des critiques de la gestion économique du pays
par le gouvernement social-démocrate et écologiste. Malgré une rémission
économique plutôt rapide et des méthodes économiques peu orthodoxes, les hausses
d'impôts et la hausse des prix semblent avoir plombé la popularité du gouvernement
de Jóhanna Sigurðardóttir. Mais c'est surtout l'enclenchement de l'adhésion à l'Union
européenne ainsi que les tentatives de règlements des plans IceSave finalement
réfutés par référendum par les électeurs qui ont probablement terni la légitimité de la
coalition sociale-démocrate et écologiste. La réécriture de la constitution est donc
209 "The Independance Party interviewed" in grapevine.is, le 8.04.13 consulté le 10.06.13 210 "The Progressive Party interviewed" in grapevine.is, le 8.04.13 consulté le 10.06.13 211 T. GYLFASON, "From Collapse to Constitution: the Case of Iceland", in CESifo Working Paper NO. 3770, June 2012, p.21-‐22 disponible sur ssrn.com consulté le 10.06.13 212 Statistiques de l'économie islandaise disponibles sur le site statice.is consulté le 10.06.13
103
passée en second plan et les dernières élections n'ont pas permis de savoir ce que
réalisera la droite à son égard une fois au pouvoir. Toutefois l'entrée de deux
nouveaux partis au sein de l'Althing, à savoir Avenir Radieux et le Parti Pirate
Islandais, tout deux issus de la "révolution des casseroles" permet de penser que cette
question continuera à être soulevée.
La demande d'un avis213 de la Commission de Venise, du Conseil de
l'Europe, sur la nature de la nouvelle constitution créée a également ranimé les
ardeurs de ses opposants. Demandée notamment par des membres du Parti de
l'Indépendance, la Commission de Venise pointe notamment dans ce nouveau texte
le risque de tomber dans un "régime parlementaire fort", mais aussi le manque de
clarté dans l'évocation faite des droits de troisième génération. Elle estime également
que les systèmes d'équilibre des pouvoirs sont trop complexes tout comme les outils
de démocratie directe (recours au référendum), et évoque "le risque de blocages
politiques et d'instabilité qui pourraient sérieusement miner la bonne gouvernance du
pays". Elle recommande au Parlement et à la législature suivante d'apporter des
modifications au texte avant de l'adopter. Si l'interprétation de la Commission de
Venise semble parfois alarmiste, il est également difficile de comprendre pourquoi il
serait nécessaire d'affiner la définition de certains principes de la nouvelle
Constitution. Sans tomber dans un débat de constitutionnalistes, une Constitution
offre en général un texte dont l'interprétation s'affine au fil des années grâce au
travail des juristes. L'imperfection d'une Constitution (en dehors peut-être de ses
modalités de modification) n'est pas en soi un motif suffisant pour ne pas l'adopter.
Un constat d'expertise peut-il réellement tenir face à l'expression de la légitimité
populaire ?
Enfin certains participants du processus constitutionnel pointent également
l'inertie de la coalition au pouvoir mais aussi une culture démocratique beaucoup
moins prégnante qu'on ne voudrait le croire. Thorvaldur Gylfason, un des membres
élus au Conseil constitutionnel, va jusqu'à estimer que l'Islande oscille constamment 213 Avis disponible sur le site de la commission, venice.coe.int consulté le 10.06.13
104
entre la démocratie occidentale et un système oligarchique "à la russe"214. Dans une
contribution à propos du cas islandais, il estime que de par ses dimensions, le pays
est particulièrement enclin à voir la cooptation, les liens amicaux et familiaux
impacter sur le fonctionnement des élites politiques et économiques. Il signale ainsi
les forts liens existant entre les avocats du pays et le Parti de l'Indépendance215, mais
également la réticence de certains experts issus de l'université à aider le Conseil
Constitutionnel dans sa tâche. Plus globalement, le comportement des grands médias
tout au long du processus constitutionnel est interprété par des partisans216 du
processus comme une preuve supplémentaire des liens importants qu'entretiennent
des titres comme Morgunblaðið, ou Fréttablaðið avec des membres de l'ancienne
opposition de droite. Il est vrai par exemple que Davíð Oddsson, ancien Premier
ministre issu du Parti de l'Indépendance, a été accepté en 2009 comme directeur de
rédaction à Morgunblaðið alors d'ailleurs qu'il était encore directeur de la Banque
centrale. De tels faits et de tels relations de pouvoir demanderaient sans doute de plus
vastes recherches.
De façon plus large, le Conseil Constitutionnel a tenté d'éviter toute réunion
spéciale avec des membres du Parlement ou du gouvernement. En souhaitant ainsi
mettre tous les contributeurs de la nouvelle Constitution sur un pied d'égalité217, le
Conseil exprime non pas tant une peur de l'influence politique, mais davantage la
volonté de gagner en légitimité et se présenter ainsi comme des "citoyens ordinaires".
Pourtant, nous le savons, le Conseil Constitutionnel regroupe plutôt des personnalités
qui étaient déjà connues au sein de la société islandaise. Thorvaldur Gylfason est lui-
même le fils d'un ancien ministre des finances. On perçoit toutefois cette volonté
récurrente, présente tout comme au sein du Forum National, de vouloir se détacher
de représentants politiques dont la proximité devient douteuse. Encore une fois il
s'agit d'incarner le véritable "citoyen islandais". La source de légitimité politique est
double et ambivalente, elle reprend finalement la schizophrénie de nos systèmes
214 Entretien avec Thorvaldur Gylfason, élu au Conseil Constitutionnel 215 T. GYLFASON, op.cit., p.35 216 Entretiens avec Larús Ymir Oskarsson membre de La Fourmilière, Thorvaldur Gylfason élu au Conseil Constitutionnel, et Smari McCarthy du Parti Pirate Islandais 217 T. GYLFASON, op.cit., p.38
105
électoraux : l'élu est à la fois supérieur par le fait que, choisi par le vote, il se
distingue par ses qualités, et en même temps en provenant de ce que l'on nommera
"la société civile", celui-ci prétend être "comme" le citoyen islandais lambda.
3. Limites du tirage au sort islandais et limites de
l'expérimentation démocratique
En prenant un point de vue plus générale, quelles sont les premières
conclusions sur le temps long que nous pouvons tirer de l'expérience du Forum
National ? Quelles sont les limites fréquemment citées dans la mise en œuvre de
cette procédure ?
Il est un premier point qu'il convient de discuter et qui revient fréquemment
lorsqu'est évoqué le cas islandais, à savoir celui de la taille. Le Forum National aurait
été possible en raison de la population réduite du pays. Tout comme la démocratie
directe dans sa conception rousseauiste, le tirage au sort ne conviendrait qu'à des
structures locales ou bien à de petits Etats pour des motifs d'organisation et de
contrôle. Nous pouvons en contrepartie citer Rancière évoquant le discours des
opposants au tirage au sort :
" Le tirage au sort, nous disent-ils, convenait à ces temps anciens et à ces
petites bourgades économiquement peu développées. Comment nos sociétés
modernes faites de tant de rouages délicatement imbriqués pourraient-elles être
gouvernées par des hommes choisis par le sort, ignorant la science de ces équilibres
fragiles ? (…) Mais la différence des temps et des échelles n’est pas le fond du
problème."218
Aujourd'hui l'Islande n'a plus grand chose à voir avec une "bourgade
économiquement peu développée", et l'argument de la taille reste difficilement
tenable. Certes la petitesse du pays est fréquemment mis en exergue pour évoquer
des institutions qui seraient plus "souples", à la force d'inertie moindre, qui sauraient
naviguer et innover plus facilement. Mais nous l'avons vu, l'argument de la taille 218 RANCIERE, op.cit., p.48-‐49
106
pourrait tout à fait être retourné et vu comme une contrainte et un frein lorsque le
faible nombre d'habitants provoque des situations de cooptations, d'ententes entre
différentes sphères du pouvoir par la présence de nombreux liens du sang ou de liens
amicaux. De plus le tirage au sort, de par son fonctionnement, ne possède aucune
limite quant à la population qu'il prétend représenter. Le système du Forum National
est tout à fait applicable pour des populations dépassant les 300 000 habitants, car si
la logique grecque de la rotation y perd son sens, la logique de l'échantillon
représentatif, elle, ne change pas. Le débat devrait davantage se déplacer sur les
règles et les quotas utilisés pour la constitution de tels assemblées et les moyens de
les initier, car en soi il est tout à fait envisageable de créer des assemblés d'un millier
de personnes pour des pays comme la France, les Etats-Unis voire des macro-régions
comme l'Europe.
Certains pays et certaines régions ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Ainsi,
et cela nous permet également d'aborder le point de la transmission des idées,
l'Irlande et l'Ecosse semblent vouloir s'inspirer directement du Forum National et du
processus constitutionnel islandais219. Déjà évoqué pour l'Irlande, les
indépendantistes écossais évoquent également en cas de victoire du oui en 2014 la
possibilité de rédiger une Constitution "impliquant le peuple d'Ecosse et un large
panel des institutions et de la société civile écossaise"220 221.
Il est à signaler que contrairement à d'autres expériences de démocratie
participative réalisées aujourd'hui, cette volonté de mettre en place des assemblées
tirées au sort semble trouver sa base dans un mouvement provenant des citoyens eux-
mêmes. Peut-on affirmer par là que les masses se ressaisissent de la question
démocratique ? Peut-on ici constater une forme de dépassement de la contre-
démocratie de Rosanvallon, où il ne s'agit plus seulement d'empêcher mais également
de reconsidérer la forme des institutions ? Ou bien est-ce tout simplement parce 219 Nous constatons d'ailleurs qu'il s'agit de deux régions entretenant de forts liens culturels avec l'Islande. 220 "A written constitution, drafted by a new constitutional convention for Scotland, involving the people of Scotland and a wide range of interests from across Scotland’s institutions and civic society." (je traduis) voir scotland.gov.uk/News/Releases/2013/02/transition-‐paper05022013 consulté le 10.06.13 221 Voir notamment l'initiative sosayscotland.org qui entretient des liens avec des membres de la Fourmilière.
107
qu'une "assemblée nationale tirée au sort" paraît être un projet plus porteur,
l'expression d'une forme bâtarde, inattendue, de l'imagerie démocratique
habituellement rattachée au symbole de l'assemblée ? Il est bien trop tôt pour nous
prononcer sur de telles questions, et il faudra pour cela saisir le temps long, observer
comment évoluent de telles initiatives.
L'expérience islandaise a-t-elle été un succès ? Aujourd'hui tout porte à
croire l'inverse. Le fruit de cette expérimentation, la nouvelle Constitution créée,
semble pour l'instant condamné à rester dans les limbes administratives de l'Althing
pour au moins quelques années supplémentaires. Il semble par contre qu'elle soit déjà
devenu un sujet "exotique", et cela en très peu de temps. Nous le signalions en
introduction, les réactions des médias internationaux vis-à-vis de cette expérience ont
souvent été peu mesurées, l'Islande restant un pays plutôt discret sur la scène
médiatique. Pour la France par exemple, le relais médiatique reste sporadique, et les
ouvrages accessibles au grand public francophone sur l'expérience islandais sont
extrêmement rares222. Les informations disponibles doivent donc être davantage à
chercher du côté anglophone ou hispanophone. Il convient aussi de se méfier
énormément de la masse considérable de documents produits sur le sujet sur le web,
où les informations non vérifiées fleurissent. Le terme même de "révolution des
casseroles" semble extrêmement exagéré. Les protestations de 2008 ont certes abouti
à la démission d'un gouvernement mais n'ont pas pour autant bouleversé l'ensemble
des institutions du pays, de même pour le processus constitutionnel. Les tentatives de
raccourcis sont fréquentes face à des évènements aussi complexes. Les donner à voir
dans toute leur nuance et éviter les conclusions hâtives sont des exigences auxquelles
nous devons impérativement nous tenir.
222 L'ouvrage de Jérôme Skalski reste pour l'instant le seul à dresser un premier tableau de l'expérience islandaise et du Forum National, mais édité en septembre 2012 celui-‐ci se trouve déjà dépassé par l'actualité. Pascal Riché de Rue89 a produit un petit document sur l'Islande de l'après-‐crise, mais les informations concernant le tirage au sort y sont extrêmement parcellaires.
108
Conclusion
Le mot démocratie est un mot redoutable. En étant utilisé à tort et à travers,
à la fois comme idéal de morale collective, comme instance indéfinie de
gouvernement ou propriété fondamentale du monde occidental, il a acquis au fil du
temps des définitions en tiroirs. Celles-ci se recoupent, se mordent, s'opposent au
sein du même mot. Il fallait au cours de notre réflexion établir une cartographie
minutieuse de ses significations, et pour cela le tirage au sort devait être notre fil
d'Ariane. D'autant plus que les champs auquel cette procédure est liée tels que
processus électoraux, formes de légitimités démocratiques, ou débat éternel entre
souveraineté générale et souveraineté nationale constituent des puits de discussions
sans fond qui ont mobilisé des générations de philosophes et de politistes.
Notre but premier était de saisir les enjeux portés par l'usage du tirage au
sort en démocratie. L'objectif était vaste et ambitieux, peut-être même trop. Le défi
principal de ce mémoire aura été de créer un ensemble de réflexions qui prennent
leur sens ensemble, dans leurs croisements et leurs connexions. Il était impératif
d'éviter le simple ressassé, l'alignement de réflexions éparses dans un pot pourri de
concepts réunis artificiellement entre eux. Nous avons ainsi constaté que si la théorie
tend à faire du tirage au sort et de la démocratie deux mots indubitablement liés, leur
relation est plus complexe dans la réalité. Utiliser le hasard n'est pas en soi un gage
de démocratie, car il faudrait déjà savoir véritablement ce que le qualificatif de
démocratie recoupe. De plus un tirage au sort comporte toujours des biais, et ceux-ci
sont rarement innocents. Il est apparu impératif de connaître l'ensemble des
contraintes techniques reliées à cette procédure, saisir ses enjeux sous-jacents, les
éventuels conflits de légitimité qu'elle charrie avec elle. C'est ce que nous avons tenté
de faire modestement avec le cas islandais. Les questions appelées par le cas
islandais sont nombreuses, nous avons tenté tout au long de notre réflexion d'ouvrir
109
de nouvelles pistes d'exploration. Il a été frustrant de ne pas pouvoir les suivre
davantage, le risque de créer des artefacts sur de simples intuitions, des "on-dit" et
des conversations pressées était trop grand. Le but de ce mémoire aura donc été
d'ouvrir des portes, et d'apporter avec lui de nouvelles brassées de questions.
Quel accueil et quel poids l'usage du tirage au sort a-t-il eu en Islande ? La
réponse doit être honnête et froide. Son impact a été faible et semble avoir davantage
suscité l'enthousiasme des milieux alternatifs européens que des Islandais eux-
mêmes. Faut-il pour autant jeter le bébé de l'expérimentation démocratique avec l'eau
de la déception politique ? Non sans aucun doute, car si l'expérience islandaise reste
limitée, elle constitue également une première mondiale, à la fois modeste et
ambitieuse. Il serait inconcevable pour la science politique et pour tous les
chercheurs en quête de nouveaux objets de passer à côté de cet événement. A la fois
en lui même, car il est suffisamment rare de voir aboutir de telles initiatives, mais
également pour l'ensemble des espoirs et des déceptions dont les protestations et la
nouvelle constitution ont été entourés. Dans l'un de ses ouvrages, Gunnar Karisson
qualifie l'Islande de "société marginale"223. Être en marge, être à l'écart, permet
d'accéder à des positions et des points de vue que la pensée commune nous permet
difficilement d'avoir. Les idées novatrices, en rupture avec leur temps, naissent
souvent dans les recoins oubliés. Par sa position, son histoire et les nouveaux
chemins qu'elle prend, l'Islande mérite davantage notre attention.
223 KARISSON G., Iceland's 1100 years: the history of a marginal society, Londres, C. Hurst & Co. Publishers, 2000, poche, 418 p.
110
Bibliographie
Ouvrages
BACQUE H., REY H. et SINTOMER Y., Gestion de proximité et démocratie
participative, éditions La Découverte, Paris, 2004
BECK D. E., & COWA C., Spiral dynamics:Mastering values, leadership, and change.
Cambridge, MA Blackwell Business, 1996
BLONDIAUX Loïc, La fabrique de opinion Une histoire sociale des sondages,Le Seuil,
1998, Paris
BLONDIAUX, Le Nouvel Esprit de la démocratie, Seuil, Paris, 2008
BOYER R., L'Islande médiévale, Editions Les Belles Lettres, 2001
CASPARY, W- R., Dewey on Democracy, Cornell University Press, 2000
CLASTRES P., La Société contre l'Etat, Editions de Minuit, 1974
CONSTANT B., De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes [1819], Mille
et une nuits, 2010
CONSTANT B., Principes de politique applicables à tous les gouvernements
représentatifs (1815), Hachette Pluriel, 2006
DESROSIERES A., La politique des grands nombres, Histoire de la raison statistique,
La découverte, 2010, 460 p
DEWEY J., Le public et ses problèmes (1925), Folio essais, 2010
DOWLEN O., The political potential of sortition, a study of the random selection of
citizens for public office, Imprint Academic, 2008, 264 p
FEDOZZI L., O poder da aldeia : gênese e história do orçamento participativo de Porto
Alegre, Tomo editorial, Porto Alegre, 2000
GRET M. & SINTOMER Y., Porto Alegre. L'Espoir d'une autre démocratie, La
Découverte, 2002, Paris
111
GUENIFFEY P., Le Nombre et la Raison, La révolution française et les élections,
Editions de l'EHESS, 1993, Paris
HANSEN H., The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes, Blackwell, Oxford,
1991
HERMET G., L'Hiver de la démocratie, Paris, Armand Colin, 2007
HJALMARSSON J., History of Iceland, from the Settlement to the Present Day,
Forlagid, 2012
KARISSON G., Iceland's 1100 years: the history of a marginal society, Londres, C. Hurst
& Co. Publishers, 2000, poche, 418 p.
LEFORT C., L'invention démocratique, Fayard, 1981
MANIN B., Principes du gouvernement représentatif, Calmann-Lévy, 1995, 319 p.
MENDEZ PINEDO E., La revolución de los vikingos, Editorial Planeta, Novembre 2012
227 p.
RANCIERE J., La haine de la démocratie, La fabrique, 2005, 112p.
RICHÉ P., Comment l'Islande a vaincu la crise, Reportage dans le labo de l'Europe,
Rue89 Versilio, Paris, 2013, 114p.
ROSANVALLON P., La Contre-démocratie. La politique à l'âge de la méfiance, Seuil,
Paris, 2006
ROUSSEAU, Du contrat social [1762], Flammarion 256p., 2011
SNÆBJORN JONSSON B., Public Communicative Engagement and Conscious
Evolution of Human Social Systems, Reykjavik, 2013
SKALSKI J., La révolution des casseroles, chronique d'une nouvelle Constitution pour
l'Islande, Editions La Contre Allée, Septembre 2012, 102p.
SINTOMER Y., Petite histoire de l'expérimentation démocratique, tirage au sort et
politique d'Athènes à nos jours, La découverte, 2011, 296p.
SNÆR MAGNASON A., Dreamland: A Self-Help Manual for a Frightened Nation,
Citizen Press Ltd. London, 2008
TODOROV, Benjamin Constant : la passion démocratique, Paris, Hachette littératures,
1997, 214 p.
WEBER M., Essais sur la théorie de la science [1904], Plomb, 1965, Paris
112
ZASK J., "Introduction" in DEWEY J., Le public et ses problèmes, Folio, 2010 p.12
Articles
BOURDIEU P., « L'opinion publique n'existe pas », in Les Temps modernes, 29 (318),
janv. 73 : 1292-1309
BERGMANN E., "Reconstituting Iceland – constitutional reform caught in a new
critical order in the wake of crisis", in academia.edu, January 2013
BROWN W., "American Nightmare : Neoliberalism, Neoconservatism, and De-
democratization", in Political Theory, vol. 34, pp.690-714, 2006
GYLFASON T., "From Collapse to Constitution: the Case of Iceland", in CESifo
Working Paper NO. 3770, June 2012
OLAFSSON J., "Experiment in Iceland : Crowdsourcing a Constitution ?", in
academia.edu, 2012
PLUCHINO A., GAROFALO C., RAPISARDA A., SPAGANO A., CASERTA M.,
"Accidental Politicians: How Randomly Selected Legislators Can Improve Parliament
Efficiency", in Physica A 390, 2011, 3944-3954,
disponible sur arxiv.org/abs/1103.1224
RACKE A., SINTOMER Y., "Les jurys citoyens berlinois et le tirage au sort : un
nouveau modèle de démocratie participative ? ", in BACQUÉ & REY (dir), Gestion de
proximité et démocratie participative, La Découverte, 2005 316 p., pp.139-160
ROUBAN L., Les députés de 2012 : quelle diversité ?, Note de recherche CEVIPOF, n°
8, 5 p.
TOMASSON, "Iceland as The First New Nation", in Scandinavian Political Studies, 10,
1975
P. URFALINO, « La délibération n'est pas une conversation », in Négociations 2/2005
(no 4), p. 99-114.
113
Ressources internet
Processus constitutionnel islandais :
stjornlagathing.is (Conseil Constitutionnel islandais)
thjodfundur2009.is (Assemblée Nationale de 2009)
thjodfundur2010.is (Forum National de 2010)
althingi.is (Site du Parlement)
Associations et mouvements :
agora.is (Organisation organisatrice du tirage au sort et des délibérations)
en.alda.is (Association Alda)
thepeoplesvoices.org (mouvement issu des protestations de 2008)
Principaux sites d'informations :
euronews
icelandreview.com
icenews.is
ipsnews.net
grapevine.is
lemonde.fr
Autres :
statice.is (Statistiques islandaises)
mjp.univ-perp.fr (Constitution islandaise en français)
hdr.undp.org/fr/statistiques (Travaux de l'ONU, statistiques mondiales)
rna.is/eldri-nefndir/addragandi-og-orsakir-falls-islensku-bankanna-2008/skyrsla-
nefndarinnar/english (Rapport de la commission d'investigation sur la faillite bancaire)
114
Annexes
1. Tableau récapitulatif de l'actualité islandaise
depuis 2008
Date Institutions Société civile Economie Politique étrangère
06.10.2008 Loi d'urgence permettant au FME (Autorité de Supervision Financière islandaise) de prendre directement le contrôle des banques sans les nationaliser.
Loi d'urgence permettant au FME (Autorité de Supervision Financière islandaise) de prendre directement le contrôle des banques sans les nationaliser.
08.10.2008 Le gouvernement britannique de Gordon Brown place l’Islande sur la liste des Etats terroristes pour bloquer les avoirs britanniques de la branche IceSave.
10.10.2008 Manifestation de 200 personnes devant la Banque centrale d’Islande pour demander la démission de David Oddsson, son directeur
11.10.2008
Initiative d’Hördur Torfason qui organise un « One man’s protest » en face de l’Althing, sur la « Place de l’Est », ou Austurvöllur.
18.10.2008 Rassemblement d’environ 2000 personnes à l’Austurvöllur
25.10.2008 * Nouveau rassemblement de 2000 personnes, de l’Austurvöllur au siège du gouvernement * Le mouvement Gauche-Vert soutient la mobilisation populaire.
08.11.2008 Rassemblement de 4000 personnes devant l’Althing
15.11.2008 Rassemblement de 8000 personnes devant l’Althing, jets d’œufs, de tomates et de papier toilette.
22.11.2008 *Suspension au balcon de l’Althing de l’affiche « FMI – Vendu » *Décoration du héros de l’indépendance islandaise Jón Sigurdsson avec des vêtements de femmes pour prendre contre-pied des discours virilistes des Néo-vikings *Manifestation devant le siège de la police pour réclamer la libération d’un militant. Il sera libéré et la foule dispersée au gaz poivre.
29.11.2008 Nouveau rassemblement de 5000 personnes
06.12.2008 1500 personnes sur Austurvöllur
08.12.2008 Entrée d’une trentaine de militants dans l’Althing, provoquant l’arrêt des travaux parlementaires. Parmi eux les « Neufs de Reykjavik sont arrêtés et poursuivis en justice.
09.12.2008 Quarante militants obstruent le passage des ministres à la maison du gouvernement.
11.12.2008 * Hördur Torfason et son mouvement, « La Voix du Peuple » porte plainte contre le gouvernement concernant le sauvetage par l’Etat de la banque Glitnir.
12.12.2008 Adoption d’un projet de loi déposé le 27.11.2008, portant sur la création d’une Commission spéciale d’investigation (SIC) avec nomination d’un procureur chargé d’examiner les malversations liées à la chute des banques islandaises.
13.12.2008 17 minutes de silences tenues par les manifestants d’Austurvöllur,
115
symbolisant les 17 années au pouvoir du Parti de l’Indépendance
20.12.2008 11 minutes pour symboliser les 11 rendez-vous hebdomadaires devant l’Althing
31.12.2008 Une manifestation de plusieurs centaines de personnes contraint le traditionnel show télévisé où sont présents les leaders politiques de se réfugier ailleurs.
10.01.2009 Reprise des manifestations, on dénonce également les coupes budgétaires dans le système de santé.
17.01.2009 Nouveaux rassemblements suivis de 6 autres dans tous le pays.
20.01.2009 * Rassemblement face à la réouverture de l’Althing. 2000 personnes présentes, la police anti-émeute intervient, dispersion au gaz-poivre, immobilisations et arrestations. Allumage d’un brasier dans le jardin de l’Althing.
21.01.2009 * Alliance sociale-démocrate, deux motions sont adoptées : - retrait de la coalition gouvernementale - demande d’élections anticipées
* Nouvelles manifestations organisées devant le siège du gouvernement, jets de yaourt, œufs, peintures et boules de neige. * Geir Haarde, Premier ministre, est pris à parti lorsqu’il tente de rejoindre sa limousine. * 3000 personnes devant l’Althing, une pancarte est accrochée sur l’Althing avec « Une trahison pour cause d’imprudence reste une trahison »
22.01.2009 Manifestations devant l’Althing de 2000 personnes, usage par la police de gaz lacrymogènes.
23.01.2009 Annonce de la tenue d’élections anticipées au mois de mai par Geir Haarde, qui annonce également qu’il ne se représenterait pas.
24.01.2009 6000 personnes devant l’Althing, demandant la tenue immédiate de nouvelles élections et une « nouvelle démocratie ».
25.01.2009 Démission du ministre du commerce Ingibjorg Solrun Gisladottir
26.01.2009 Démission du Premier Ministre Geir Haarde.
27.01.2009 * Convocation par le Président de la République, Grimsson des responsables de l’opposition. * Mise en place d’un gouvernement provisoire de coalition entre l’Alliance sociale-démocrate et le Mouvement Gauche-Vert * Evocation en conférence de presse de la volonté de réécriture de la Constitution. Le projet initial défendu est celui de l’élection d’une Assemblée, d’un Parlement ou d’un Conseil Constitutionnel.
31.01.2009 Dernière manifestation à Austurvöllur, chorales et ambiance festive
01.02.2009 * Entrée en fonction officielle de la nouvelle coalition, majorité relative de 27 députés sur 63. * Parmi les orientations du nouveau pouvoir, la nouvelle Constitution est clairement évoquée.
26.02.2009 Démission de David Oddsson de son poste de directeur de la Banque centrale d’Islande
13.03.2009 Présentation de deux projets de loi pour amender la Constitution existante et réformer la législation électorale.
25.04.2009 Elections législatives anticipées. Victoire historique de la gauche à l’Althing, pour l’Alliance sociale-démocrate et le Mouvement Gauche-Vert. Entrée du Mouvement des
116
citoyens 06.2009 Début de la préparation d’une
« Assemblée Nationale » organisée par l’Anthill
29.08.2009 « First Icesave bill », loi de sauvetage de la banque Icesave
« First Icesave bill », loi de sauvetage de la banque Icesave
04.11.2009 Projet de loi synthétique présenté devant l’Althing pour la réforme constitutionnelle. Evocation par Johanna Sigurdardottir de la possibilité d’une participation directe des citoyens à la prise de décision politique.
14.11.2009 Organisation de façon indépendante d’une « Assemblée nationale » par l’Anthill, préparé depuis 5 mois. Un rapport de synthèse des débats sera rendu public.
20.11.2009 Conseil ministériel décide d’un partenariat avec l’Anthill en vue d’engager un processus de révision constitutionnel
30.12.2009 « Deuxième loi Icesave » voté par l’Althing, qui prévoit déboursement de 3,8 milliards d’euros au Royaume-Uni et aux Pays-Bas
« Deuxième loi Icesave » voté par l’Althing, qui prévoit déboursement de 3,8 milliards d’euros au Royaume-Uni et aux Pays-Bas
05.01.2010 Pétition en ligne lancée par l’association « In Defence of Iceland » recueille 60 000 signatures pour récuser la « Deuxième loi Icesave »
06.03.2010 Référendum sur la « Deuxième loi Icesave », rejetée à 93%. Les épargnants britanniques et néerlandais ne seront donc pas remboursés. Le gouvernement doit renégocier avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
30.04.2010 Jon Gunnar Kristinsson, du « Meilleur Parti » est élu à la mairie de Reykjavik
16.06.2010 Adoption du projet de loi portant sur l’Assemblée constituante (25 à 31 membres issus de la société civile), dite Lög um stjórnlagathing En parallèle de l’assemblée Constituante, censée compter entre 25 et 31 membres, Est créé un Comité constitutionnel de 7 membres Un Comité de préparation qui devra organiser et alimenter le Forum National et faire le lien avec l’Assemblée Constituante
Été 2010 Création d’une « Société constitutionnelle », par un groupe de militants, le Stjórnarkrárfélagi∂ ou Constitutional society, afin d’accompagner et soutenir la réforme constitutionnelle
06.11.2010 * Organisation du Forum national/Rassemblement national sur la Constitution à la Laugardalshöll Arena en conformité avec Loi sur l’Assemblée constituante * Les délibérations donnent un rapport de 700 pages avec une série de conseils d’expertises pour la future assemblée constituante et les « valeurs fondamentales » évoquées par le Forum.
11.2010 Campagne pour l’Assemblée Constituante, présentation de 522 candidats
27.11.2010 Election de l’Assemblée constituante, 36% de taux de participation. Election de 15 hommes et 10 femmes. Personnes avec une certaine notoriété et issues surtout du secteur tertiaire.
25.01.2011 Invalidation par la Cour suprême d’Islande de l’élection de l’Assemblée constituante pour raison de « lacunes dans le déroulement de l’élection »
24.02.2011 Avis du groupe de travail formé par le gouvernement pour résoudre l’invalidité posée par la Cour suprême. Suggère que les députés de l’Althing choisissent eux-mêmes les membres de l’Assemblée Constituante
24.03.2011 Approbation par l’Althing de la résolution créant un Conseil constitutionnel composé des 25 membres désignés au cours de l’élection de l’Assemblée constituante
06.04.2011 Création officielle du Conseil Constitutionnel, divisé en trois groupes de travail et interagissant avec les Islandais par internet
27.07.2011 Transmission au Comité Constitutionnel de la
117
Proposition pour une nouvelle Constitution pour la République d’Islande
29.07.2011 Remise officielle de la Proposition au président de l’Althing
05.10.2011 Johanna Sigurdardottir, une semaine après la réouverture de l’Althing, se prononce en faveur d’un référendum
20.10.2012 Référendum de 6 questions concernant la nouvelle Constitution. Toutes les questions sont approuvées. Participation de 48%.
27.04.2013 Elections législatives. Le Parti du Progrès et le Parti de l'Indépendance arrivent en tête et reviennent au pouvoir en formant un gouvernement de coalition. Le Parti Pirate et le Parti de l'avenir Radieux rentrent au Parlement pour la première fois.
Ces données constituent un récapitulatif des ouvrages de Jérôme SKALSKI et
Elvira MENDEZ PINEDO.
118
2. Référendum sur la Constitution du 21 octobre
2012
1. Do you wish the Constitution Council's proposals to form the basis of a
new draft Constitution? Yes: 66.3% No: 33.7%
2. In the new Constitution, do you want natural resources that are not
privately owned to be declared national property? Yes: 82.5% No: 17.5%
3. Would you like to see provisions in the new Constitution on an established
(national) church in Iceland? Yes: 57.5% No: 42.5%
4. Would you like to see a provision in the new Constitution authorising the
election of particular individuals to the Althingi more than is the case at
present? Yes: 77.9% No: 22.1% (This question pertains to the ability of
unaffiliated politicians, or those from smaller parties, to run for parliament.)
5. Would you like to see a provision in the new Constitution giving equal
weight to votes cast in all parts of the country? Yes: 65.5% No: 34.5%
6. Would you like to see a provision in the new Constitution stating that a
certain proportion of the electorate is able to demand that issues are put to a
referendum? Yes: 72.8% No: 27.2%
Of the 236,941 in Iceland with the right to vote in this election, 115,814 took part,
giving a turnout of 48.9%
Source : grapevine.is
119
3. Exemple d'une session du Forum National
4th session: 15 min. A visit to new tables and personal introductions. Time 12:55 –
13:10
Each participant at the table gets one theme which he/she will bring over to a new table with new people who are addressing the same theme.
From the announcers: The facilitator prepares the participants for changing
tables. 1. There are eight zones (A-H) and one of the eight themes will be discussed in each zone. The
participants get a letter A-H which indicates which theme zone to go to. The participants at table A1 go to table B1, C1, D1 etc. One participant stays at his table.
o The participants may exchange themes between themselves if both parties agree.
o If a table is not fully occupied with eight participants, the theme that is not distributed is handed over to the zone master or runner who will take it to the right place.
From the announcers: Now the participants go to new tables where individual
themes are discussed further as well as what has been classified in the same
category. 2. The participants leave their table to go to their assigned tables. They take all their belongings
(handbags, glasses etc.).
3. The facilitator makes sure the table has been cleared and is ready for a new group.
4. The facilitator welcomes new people to his/her table. Everyone introduces himself/herself (name, where from, interests).
5. The facilitator asks the participants about their opinion of the National Assembly so far.
6. The facilitator briefly discusses the themes chosen at the meeting and especially the theme assigned to his/her table. The discussion goes on until a common understanding is reached about the essence of the theme.
Source : The "facilitator's handbook" agora.is