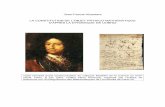Processus d'innovation: dynamique agroforestière et changement technique-Le cas de l'hévéaculture...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Processus d'innovation: dynamique agroforestière et changement technique-Le cas de l'hévéaculture...
1
Un produit, une filière, un territoire
Colloque International
Toulouse les 21, 22, 23 mai 2001
Thème : culture pérenne et signature sociale.
Processus d’innovation :
dynamique agroforestière et changement technique :
le cas de l’hévéaculture villageoise en Indonésie
E Penot
CIRAD-TERA
Département Territoires, Environnement, Acteurs
Programme THI (Tropiques Humides et Insulaires)
Contact : [email protected]
2
Processus d’innovation : dynamique agroforestières et changement
technique : le cas de l’hévéaculture villageoise en Indonésie
Résumé
L’hévéaculture villageoise indonésienne domine la production nationale de caoutchouc (73 %) et se caractérise par le “ jungle rubber ” : un système hévéicole agroforestier extensif adapté aux conditions des fronts pionniers et des paysans pauvres dans les iles de Sumatra et Kalimantan. L’Indonésie est aussi le berceau d’un grand nombre de systèmes agroforestiers, productifs et diversifiés, mis en oeuvre par des ethnies différenciées : Dayaks à Kalimantan, Malayu et Minang à Sumatra. Le cas des transmigrants javanais dans les zones de transmigration est particulier du fait d’un foncier limité et des caractéristiques des terres qui leur sont allouées. Néanmoins, toutes ces ethnies ont adopté le jungle rubber (ou d’autres techniques agroforestières pour les transmigrants) et ont profondément marqué le paysage local malgré des règles d’utilisation du territoire et des stratégies différentes selon leur origines. Les jungle rubber ont bien fonctionné comme une signature sociale des paysages. La permanence de l’utilisation de pratiques agroforestières dans les stratégies paysannes s’inscrit dans une logique d’adaptation aux contraintes locales et de mise en cohérence des systèmes techniques et des systèmes sociaux dans une situation qui a longtemps été celle des fronts pionniers. Faisant suite à un processus d’innovation endogène d’un petit nombre de planteurs intégrant pratiques agroforestières et clones à haute productivité, le projet SRAP a développé en approche participative une expérimentation en milieu paysan d’amélioration de la productivité des jungle rubber avec des systèmes de culture à base de clones : les RAS (Rubber Agroforestry Systems) qui constitue une étape nouvelle d’évolution des systèmes hévéicoles et du changement technique. Ces systèmes constituent des alternatives à de nouvelles cultures (le palmier à huile) dans le changement important du contexte économique des années 1990. Je tiens à remercier Jean Michel Yung, Bénédicte Chambon (CIRAD-TERA) et Marianne Carvalho (CIRAD-CP) pour leur aide et leurs remarques qui ont permis une amélioration importante de ce texte.
3
Processus d’innovation : dynamique agroforestières et changement
technique : le cas de l’hévéaculture villageoise en Indonésie
Introduction1
Les pratiques agroforestières qui constituent le modèle dominant de l’hévéaculture villageoise indonésienne se caractérisent par une trajectoire de continuité qui détermine le processus global et actuel d’innovation technique sur les systèmes de culture hévéicoles. Les processus de domestication et d’élaboration des innovations par ces sociétés paysannes créent une “ histoire des techniques ” dans un contexte ou agissent différents acteurs : état, organisations paysannes, communautés , petits planteurs, traders (collecteurs-marchands).... . Cette histoire n’est pas linéaire. Elle peut s’affiche par “sauts” (liés à des “boums” sur la culture) des infléchissements et des périodes d’inertie, des accélérations et, éventuellement, des ruptures (introduction de techniques exogènes par le biais de projets), et, enfin des phases d’intégration, aboutissant à la formation de systèmes techniques plus ou moins stables. “La non-linéarité du processus d’élaboration des techniques découle en partie de l’hétérogénéité et des histoires singulières des différents savoirs mobilisés” (Byé 1998). Nous allons examiner le processus d’innovation et le changement technique en analysant les rapports entre systèmes techniques et systèmes sociaux et leur évolution respective.
1 L’hévéa en Indonésie
1.1 Les petits planteurs dominent la production hévéicole grâce aux “ jungle
rubber ”.
L'Indonésie est le second producteur mondial de caoutchouc naturel derrière la Thailande avec une superficie de 3.5 millions d’hectares pour une production de 1.6 millions de tonnes. Plus de 1.2 millions de petits producteurs occupent 84 % de la superficie totale cultivée et contribuent pour 73 % de la production indonésienne (DGE 1998). Les revenus issus de l’hévéa représentent entre 60 et 90 % des revenus totaux pour les petits planteurs. L’hévéa a globalement permis la colonisation intérieure d’un partie des îles de Sumatra et Kalimantan depuis son introduction au début du siècle par les populations locales. Il a été également le support du développement pour une partie des programmes de transmigration (NES
2) ou de développement sectoriel gouvernementaux (SRDP/TCSDP
3).
L’hévéaculture des petits planteurs se caractérise par un système de culture particulier : le “jungle rubber”, un système agroforestier complexe
4, ou l’hévéa co-
existe avec un certain de plantes issues de la repousse forestière et dont les
1 Cette communication est issue d’un travail de thèse en Economie du Développement (Montpellier1) en cours
de finition. 2 NES = Nucleus Estate Smallholder Scheme .
3 SRDP = Smallholder Rubber Development project, et TCSDP = Tree Crop Smallholder Development Project.
4 Les “ systèmes agroforestiers complexes ” sont des agroforêts multistrates ou sont combinés un grand nombre
de plante , avec une biodiversité végétale assez importante et qui ressemble, en période mature, à des forêts
secondaires (définir par H de Foresta et G Michon, IRD).
4
produits sont valorisés : bois, fruits, légumes, plantes médicinales (voir encadré 1). Le terme consacré de “ jungle rubber ” est jugé péjoratif par certaines institutions locales alors qu’il s’agit bien d’un système de culture élaboré ou les ressources sont gérées par le producteur et non une simple jachère améliorée. Ces jungle rubber couvrent plus de 70 % des superficies plantées et constituent le modèle dominant de mise en exploitation pour les paysans non encadrés. Les jungle rubber ont représentés pour les paysans locaux en Indonésie une opportunité de stabilisation de l’agriculture et d’adaptation d’une plante de monoculture, l’hévéa, au sein de systèmes agroforestiers qui ont permis la définition d’une stratégie basée sur la minimisation du risque et l’optimisation du facteur travail (puis de la productivité du travail du système de culture hévéa). L’utilisation de stratégies agroforestières est donc liée à la réduction du facteur risque et à la “durabilité” ou “soutenabilité” du système jungle rubber. Les systèmes agroforestiers de par leur diversité et leur degré de complexité représentent généralement une adaptation remarquable au milieu physique et économique (souvent celui des fronts pionniers en fait). Ils condensent une somme d’innovations techniques issues de trajectoires techniques différentes, avec des histoires et des origines diversifiées. Le développement de ces systèmes hévéicoles agroforestiers illustre la permanence des stratégies paysannes centrées sur les “pratiques culturales agroforestières”
5.
Les systèmes agroforestiers sont donc nés quasiment en même temps que la monoculture de plantation en Indonésie selon des trajectoires techniques différenciées, mais avec une bien meilleure adéquation entre systèmes technique et système social à travers les jungle rubber pour les communautés locales par rapport au système de culture monoculture, trop exigeant en main d’oeuvre pendant la période immature de l’hévéa D’autre part, il existe un petit secteur de paysans possédant des plantations clonales en monoculture (10 % des superficies
6), récemment mis en place par le biais de
projets de développement gouvernementaux depuis 1973 avec crédit complet. Malgré un nombre limité de paysans touchés, ces projets ont permis la diffusion de thèmes techniques visant à promouvoir la monoculture et l’usage de plants clonaux à forte productivité
7. En outre, il apparait à la suite d’observations et d’enquêtes
qu’un certain nombre de planteurs en projet souhaitent conserver des pratiques culturales agroforestières qui ont fait leurs preuves en termes de “durabilité” des systèmes, de gestion et de limitation du risque et de coûts (Gouyon 1995), (Penot 1997) (Chambon, Comm pers). Le cas des transmigrants javanais est particulier .En effet, l’Indonésie a mis en place un vaste programme de transmigration officielle pour les populations Javanaises et Balinaises sans terres. Il leur est généralement alloué 2,5 hectares de terres défrichées sur les zones forestières encore peu peuplées de l’intérieur des terres de Sumatra et Kalimantan. Certains programmes intègrent des cultures pérennes tels
5 Nous définirons comme pratiques culturales agroforestières un ensemble de pratiques basées sur la combinaison
de plusieurs plantes, annuelles ou pérennes , multi-strate, avec une dynamique de production étalée dans le temps
qui s’illustre par une diversification des produits et des revenus de l’agroforêt. 6Les 15 % restants étant des plantations privées ou gouvernementale, les “estates”.
7 En moyenne , les clones produisent 1500 à 2000 kg/an/ha de caoutchouc naturel sec par rapport aux plants non
sélectionnée (seedlings) des jungle rubber qui produisent autour de 500 kg/ha/an.
5
les NES (Nucleus Estates Smallholder Schemes) basés sur le cocotier, le palmier à huile et l’hévéa qui ont généralement été des réussites. D’autres, comme c’est le cas pour certains zones à Ouest Kalimantan, sont orientées sur les cultures vivrières et ou les cultures pérennes étaient interdites. Ils ont alors été de cuisants échecs du fait de l’envahissement de leur terres par Imperata cylindrica et de l’impossibilité de cultiver ni cultures vivrières ni même d’implanter de jungle rubber qui ne peut être mis en place que immédiatement derrière une forêt ou une agroforêt. Les transmigrants javanais hors NES n’ont donc jamais eu l’occasion de développer des jungle rubber pour des raisons essentiellement techniques. Dès la tombée de l’interdit sur les cultures pérennes dans leurs zones en 1992, beaucoup ont essayé d’implanter des monocultures d’hévéa, le plus souvent non clonal par manque de capital et de disponibilité du matériel végétal, avec des cultures vivrières intercalaires pour tenter de valoriser la somme importante de travail investi. L'évolution des techniques sur les systèmes de culture à base d'hévéa a abouti dans les années 1990 au développement de deux systèmes de culture principaux : les jungle rubber et la monoculture d’hévéa. Enfin il est apparu récemment aux planteurs la nécessité d’une augmentation de la productivité des systèmes traditionnels par le biais de l’introduction du matériel végétal amélioré (les clones) au sein de “ systèmes agroforestiers améliorés ” qui puissent rester compétitifs face à de nouvelles opportunités de cultures. (monoculture de palmier à huile en particulier).
1.2 L’amélioration des jungle rubber : les RAS (Rubber Agroforestry Systems)
Les innovations techniques ou “objets techniques” permettant l’amélioration des jungle rubber sont centrés autour de deux thèmes techniques principaux : l’utilisation de matériel végétal amélioré (les clones) et les pratiques agroforestières. La problématique de l’amélioration des systèmes de cultures agroforestiers (du jungle rubber aux “ RAS ”, “ Rubber Agroforestry Systems ” ou systèmes agroforestiers hévéicoles améliorés) est donc celle de la faisabilité de l’introduction de matériel végétal amélioré (initialement sélectionné pour la monoculture) dans un ensemble de pratiques agroforestières dont les effets sur l’environnement sont (Penot 1998). Ces systèmes agroforestiers améliorés (RAS) constituent des alternatives qui illustrent la permanence des stratégies paysannes hévéicoles indonésiennes centrées sur l’utilisation de pratiques culturales dont les avantages économiques et écologiques sont importants. Plusieurs raisons permettent d’expliquer la permanence de ce choix technique par les planteurs : la minimisation conséquente des risques (faible investissement en capital et travail en période immature de l’hévéa), et la durabilité économique et écologique du système de culture agroforestier. D’autre part, la conservation d’une part importante de la biodiversité végétale pour les jungle rubber et certains RAS permettent aussi une valorisation de certains produits (bois et fruits entre autres) autorisant une diversification des revenus. Enfin, le “faciès forestier” des systèmes de culture hévéicoles agroforestiers permettent une meilleure conservation, voire amélioration de la fertilité des sols, une meilleure gestion de l’eau et l’absence d‘érosion. Nous avons donc une série d’avantages économiques (forte productivité du travail et garantie d’un revenu régulier), techniques (minimisation des risques) et écologiques (maintien d’une certaine biodiversité et de la fertilité des sols) qui expliquent le succès des jungle
6
rubber puis la continuation d’un processus d’innovation permettant l’amélioration de ces systèmes agroforestiers. Le maintien de ces pratiques culturales expriment la volonté des producteurs de conserver ces avantages techniques (facilité de mise en place) et économique (excellente productivité du travail). Dans les années 1980 puis 1990, “ l’effet démonstration ” des projets de développement hévéicoles a pleinement joué son rôle en montrant l’intérêt de cultiver des clones hautement productifs. Certains planteurs ont alors réintroduit des pratiques culturales agroforestières dans leurs parcelles en monoculture ou bien ont adapté des systèmes de type RAS que nous appellerons les “ RAS sendiri ” (ou RAS “ endogène ”). Cette évolution des systèmes de culture hévéicoles par certains paysans qui tentent de combiner matériel végétal clonal à haut niveau de production et maintien de certaines pratiques culturales agroforestières économisatrices d’intrants et de travail a été observé en particulier à Ouest Kalimantan (Schueller, Penot et al. 1997)
8. Nous avons pu également constater une telle tendance dans les
provinces de Nord, Sud et Ouest Sumatra. Une telle évolution représente une trajectoire originale de domestication même si elle apparaît limitée. L’expérimentation en approche participative développée par le SRAP dans 3 provinces
9 sur les systèmes RAS (voir encadré 2) a d’abord été basée sur une
tentative d’optimisation de ces “ RAS sendiri ” précédemment observés. Ces RAS expérimentés peuvent être considérés comme le point d’orgue d’un processus d’innovation paysanne depuis le début de l’introduction de l’hévéa dans la région et une tentative d’optimisation concertée de ce type de système. Cette expérimentation, et les conditions de sa mise en oeuvre au sein du projet SRAP (voir encadré 3), constitue donc un lieu d’observation privilégié pour analyser le processus d’innovation, les stratégies paysannes, la recombinaison des savoirs et les phénomènes de permanence et d’inertie de l’utilisation des pratiques agroforestières. Les RAS sont des systèmes de culture souples avec des niveaux d’intensification variés et non des paquets technologiques fixés. Les systèmes RAS ont donc été mis au point sur la base d’observations personnelles sur les “ RAS sendiri ” et dans le cadre d’une négociation avec les producteurs avant et pendant le processus d’expérimentation (approche concertée et participative). Cette expérimentation en milieu paysan des systèmes RAS a fonctionné comme un “lieu” ou a pu s’exprimer le processus d’innovation. Elle a clairement montré que l'information technique sur les clones, l'utilisation de certains intrants (herbicide et fertilisants pendant les 3 premières années), les techniques de greffage, de pépinières et de gestion des jardins à bois ont permis l'établissement de systèmes de culture performants et reconnus localement comme tels [Trouillard , 2001 #1045]. Cette expérience cristallise sur un pas de temps relativement court cette évolution et en constitue le point d’orgue. L’enjeu du développement de systèmes agroforestiers hévéicoles améliorés porte sur la replantation à terme de 2.5 millions d’hectares de jungle rubber vieillissants.
8 Si le cas de Ouest Kalimantan a été observé et bien documenté dans le cas du village de Sanjan par exemple,
mais aussi dans les projets de développement par B Chambon (thèse en cours) , les chercheurs de l’équipe SRAP
l’ont également observé dans d’autres provinces et en particulier à Nord et Sud Sumatra . On peut globalement
estimer a peut être 5 % (estimation personnelle) les paysans non encadrés (hors projet) ayant développés des
“ RAS sendiri ” ou systèmes agroforestier améliorés de type RAS développés de façon endogène. 9 Provinces de Ouest Kalimantan , Ouest Sumatra et Jambi.
7
2 Changement technique et société
2.1 Permanence de l’utilisation des pratiques agroforestières dans les
stratégies paysannes.
Les phénomènes de permanence, d’inertie ou de ruptures de l’utilisation des pratiques agroforestières peuvent s’expliquer localement, à un moment précis par des conditions économiques particulières. Mais l’analyse de leur évolution nécessite d’intégrer d’autres facteurs, sociaux, historiques, voire anthropologiques. Nous intégrons donc dans notre analyse sur le changement technique et ses modalités une perspective historique et une composante sociale en particulier à travers le suivi de l’évolution et du degré de cohérence entre système technique et système social que nous développerons plus particulièrement dans cette communication. Deux volets parmi d’autres nous paraissent majeurs quant à l’évolution du changement technique : d’une part : les savoirs et savoir-faire (la faisabilité technique), leur origine (individuelle ou collective), leur évolution et d’autre part le poids des systèmes sociaux dans les phénomènes d’adoption et d’innovation. Les pratiques sociales peuvent guider le choix qui est économique et technique. Elles expriment le plus souvent plutôt les nécessités d’un choix technique (riziculture irriguée : maîtrise du facteur travail par exemple...). En tous cas, elles illustrent des stratégies, individuelles et collectives, qui sont à l’origine de phénomènes de permanence (agroforesterie), d’inertie ou de ruptures. L’adoption récente du palmier à huile comme nouveau système de culture, en substitution ou en complémentarité, des systèmes hévéicoles en est un vivant exemple. Il n’y a pas de “neutralité sociale”. Tout système technique s’inscrit dans un système social. La cohérence entre les deux systèmes indique la stabilité (voire l’inertie après un certain temps) et l’adaptation (au sens résolution) du ou des problèmes de production. L’appropriation sociale des techniques revêt des formes multiples en fonction des situations agraires, quelquefois des ethnies mais le plus souvent plutôt des “ faits culturels ” et des stratégies économiques des producteurs et/ou des communautés rurales. Les innovations “réussies” sont celles qui s’inscrivent le plus naturellement dans ces systèmes sociaux en fonction de leurs contraintes et opportunités. Elles obéissent à des déterminants d’ordre techniques, sociaux et historiques qui génèrent une trajectoire particulière.
Le processus d’innovation ne réside pas seulement dans l’introduction de techniques (elle même issue de la “science”) ou de savoirs, mais de leur mise en oeuvre par différentes sociétés agraires à travers un processus “d’élaboration” prépondérant sur celui de la simple “introduction” ou “adoption” de l’innovation qui découle d’une histoire des savoirs et techniques et de leur application dans un contexte donné. Par élaboration nous entendons la construction d’une trajectoire plus complexe et pluri-factorielle incluant savoirs et techniques que la notion plus simple de “transfert” de techniques. En d’autre terme, on dépasse le clivage classique innovations exogènes/endogènes, ou la simple notion d’adoption d’une technique pour un système agraire sur une stratégie dominante de type pyramidale (descendante) qui a
8
pourtant constitué la base des projets de développement durant les trente dernières années. Le processus continu d’élaboration de l’innovation chez les petits planteurs hévéicoles aboutit à la conservation de certaines pratiques agroforestières (par opposition à la logique dominante de la monoculture), justifiées en termes de gestion du risque dans une perspective de rationalisation de l’utilisation des facteurs de production. Cette évolution endogène des jungle rubber aux “ RAS sendiri ”, avec concomitament l’intégration de monoculture d’hévéa, puis de palmier a huile (pour ceux qui ont eu accès aux programmes de développement) montre la plasticité des systèmes de production et la capacité importante d’évolution et d’intégration de certains opportunités des planteurs Les phénomènes d’apprentissage, l’élaboration d’un savoir faire, sont au coeur du processus d’élaboration et d’émergence des innovations et du changement technique. Ses déterminants constituent donc bien un objet de recherche. Les systèmes agroforestiers tirant leur justification sur les plans techniques et économiques, et pas seulement sur un plan écologique se trouvent alors confirmés par la rationalité des choix des petits producteurs
10.
Les stratégies agroforestières peuvent aussi s’exprimer sous forme de “trajectoires intégratrices” prenant en compte les contraintes et opportunités des systèmes de production et de leur environnement dans un processus d’innovations le moins
pertubateur possible des différents équilibres (social, écologique/durabilité...). Les phénomènes de continuité dans l’application de l’agroforesterie en hévéaculture paysanne peuvent s’expliquer non seulement par des avantages techniques évidents, mais aussi par cette mise en cohérence progressive entre nécessité de production, recherche de la stabilité des milieux (physiques mais aussi social) et formes d’organisation sociale initialement basé sur le contrôle des ressources, limitées, par la communauté. Finalement les jungle rubber se sont parfaitement bien intégrés dans les systèmes de production traditionnels Dayaks, Malayus et Minang au début du siècle qui étaient tournés vers l’agriculture sur brûlis et la collecte des produits forestiers non ligneux en forêt.
2.2 Les dynamiques de plantations La dynamique des premières plantations paysannes a clairement été créée au début par les cours élevés du caoutchouc. Après une phase de “ boum ” dans les années 1910-1930, la stabilité des prix sur le long terme a été un facteur déterminant dans les stratégies paysannes et dans la continuation de la dynamique initiale de plantation. Cependant, la variance des prix nominaux, l’influence des monnaies extérieures, et les phénomènes de crises sont toujours difficiles à appréhender dans leur globalité pour les planteurs. Le critère qui semble le plus pertinent est celui de la valeur du caoutchouc produit exprimé en kilo de riz car le prix du riz est resté longtemps le seul indicateur pertinent du pouvoir d’achat réel des populations rurales en zones pionnières. Cet indicateur nous est précieux pour comprendre sur un plan
économique la permanence de cette dynamique (figure 1). En effet, on constate sur 10
. Et pas seulement dans une vision “Rousseauiste” généralement trop réductrice comme on l’observe souvent
dans certains projets ou le maintien de la biodiversité par exemple prime sur l’évolution du niveau de vie des
planteurs.
9
le graphe que la courbe des prix du caoutchouc exprimée en kilo de riz est relativement stable depuis la fin de la seconde guerre mondiale alors que celle des plantations est exponentielle. La demande soutenue et un prix jugé suffisamment rémunérateur pour le planteur indonésien puisqu’il lui permet d’acheter globalement toujours la même quantité de riz (donc équivaut à un maintien global du pouvoir d’achat) explique alors effectivement cette dynamique de plantation qui ne s’est jamais arrêtée depuis l’introduction de l’hévéa au début du siècle en Indonésie. Finalement cette relative constance dans les prix sur le long terme, ou plus exactement leur expression en équivalent riz, crée un facteur supplémentaire de sécurité pour les producteurs qui justifie le maintien du jungle rubber comme système de base pendant une si longue période. Cette sécurité, liée à la durabilité et la facilité d’établissement de ce système de culture, explique cette remarquable dynamique de plantation. L’apparition d’autres alternatives de cultures ou d’activités, liées au développement économique du pays, a mis a mal ce sentiment de sécurité du fait de la faible productivité par hectare des jungle rubber. L’évolution de la production Indonésienne suit une progression régulière avec une légère augmentation depuis les années 1990 correspondant à la mise en production des surfaces clonales des projets mis en place depuis le début des années 1980. La production mondiale n’a cessé d’augmenter à l’exception de la période 1941-1946 correspondant à l’invasion japonaise et de la période troublées des années 1960.Cependant pourquoi l’Indonésie a-t-elle gardé ses jungle rubber alors que les pays voisins et les autres producteurs adoptaient massivement les clones et son corollaire habituel dans les projets la monoculture ? D’autres facteurs sont à rechercher dans l’histoire d’ordre individuels, collectifs (sociaux), culturels et politiques, et en particulier la stabilité politique et économique, l’individualisation des comportements et la perte graduelle du collectif sur l’individuel et les autres alternatives techniques ou économiques. En effet, les prix ont quelquefois eu des fluctuations importantes qui, finalement, n’ont pas joué à la baisse, sur le niveau des plantations toujours en expansion. Il y a donc d’autres facteurs explicatifs d’une telle dynamique et surtout, d’une dynamique qui est restée si longtemps basée sur les jungle rubber. Les années 1990 constituent une période d’accélération qui se terminera en 1997-99 par une crise économique et financière importante et qui aura des répercussions tant techniques que psychologiques sur le comportement des planteurs avec une très nette politique paysanne de diversification des sources de revenus [Penot, 2000 #641]. La fin des années 1990 constitue donc un tournant sur le plan des stratégies paysannes en fonction des prix en baisse tendancielle durable, des effets psychologiques de la crise et des nouvelles opportunités de culture qui sont offertes aux planteurs dont le palmier à huile est un exemple frappant.
2.3 Replantation et intégration des systèmes
Il existe une certaine plasticité des systèmes de production qui s’adaptent progressivement aux modifications du système de référence. Le passage aux clones, même en systèmes agroforestiers de type RAS, nécessite une ré-allocation des facteurs de production (le travail en particulier) et un capital d’investissement sur les 3 ou 5 premières années qui constituent une rupture en terme financier par
10
rapport aux systèmes basés sur les jungle rubber traditionnels où l’investissement en capital est nul et en travail réduit à quelques jours par an. Il y a donc là un saut technologique à intégrer. La replantation en système de culture clonal, agroforestier ou en monoculture, va donc se trouvé conditionnée d’une part par la capacité d’accumulation en capital (ou l’accès au crédit) du paysan, et, d’autre part, par les savoirs et les facteurs qui permettent l’adoption et l’appropriation des thèmes techniques, et en particulier : l’information technique sur les innovations techniques liées à l’emploi des clones et la disponibilité et la qualité du matériel végétal. La difficulté de reproduction du système hors projet (B Chambon, com pers), et l’absence de crédit et de possibilité d’investissement ont dès lors montré les limites de “l’approche projet “sectorielle. En effet, historiquement, l’intégration de l’hévéa s’est faite rapidement et sans heurt au début du siècle et la recomposition des savoirs s’illustre parfaitement dans la création d’un système agroforestier à base d’hévéa comme par exemple le “ tembawang ” pour le Dayaks l’était pour les fruitiers et les arbres à bois en remplacement de la forêt disparue (ou mieux en complément de la forêt) par la création d’un système de culture ou les ressources en bois et en fruits sont gérées par le biais des replantations . Il n’y eu donc pas effet de copie du modèle proposé (la monoculture) mais recomposition et intégration de l’hévéa dans un système intégrant la forêt, la sécurité et l’adaptation aux faibles moyens des paysans des fronts pionniers. Enfin on retrouve plus récemment une recomposition des savoirs avec l’intégration de certains éléments issus de la monoculture clonale et de ceux issus de l’agroforesterie spontanée ou organisée (cas des RAS). Les R.A.S. sont plus spécialement développés comme exemple de cette permanence du concept agroforestier dans les mentalités et dans les systèmes de gestion. Parallèlement, plutôt très récemment et cela n’est pas antinomique, se développe le sentiment du besoin de plus de sécurité, d’intégration de nouveaux systèmes de cultures performants pour diminuer la dépendance liée à la monoculture. Cette tendance débouche finalement sur l’adoption des systèmes qui ne sont pas forcément agroforestier ou transformables en systèmes agroforestiers, tel le palmier à huile. La recomposition des savoirs passe aussi sur le plan de l’évolution des exploitations paysannes par la recomposition des stratégies. Ces stratégies sont l’expression des trajectoires individuelles mais aussi celle des stratégies collectives dont le rôle est souvent primordial dans l’identification des tendances.
3 Changement technique et stratégies paysannes.
3.1 Technique et société La formation des techniques apparaissait comme une “ concrétisation ” pour Simondon, (Simondon 1958). Elle s’apparente au départ comme une adaptation (emprunt), puis comme le développement d’une véritable logique totalement différente de celle de la monoculture. Cette évolution est dynamique. C’est une logique d’acteurs, de producteurs qui finalement ne s’est pas opposée à une logique
11
de société. Les logiques individuelles ont façonné en partie cette logique de l’innovation. Les innovations qui réussissent sont apparemment celles qui s’adaptent le mieux aux pratiques sociales, du moins dans le monde en développement. La relation entre technique et société est donc bien au coeur de notre étude. Technique et société obéissent à des logiques parallèles et concomitantes. Elles peuvent cependant quelquefois apparaître paradoxales quand il existe par exemple plusieurs paradigmes pour un même faisceau de contraintes. Les relations entre individu et technique, entre individu et société et donc entre technique et société (l’individuel et le collectif) ont des logiques qui peuvent être différentes mais aussi interactives dans le processus d’innovation. Les technologies sur lesquelles reposent ces techniques sont indissociables des formes d’organisation qui les mettent en oeuvre. L’utilisation des techniques dans une société donnée aboutit à mettre en évidence des paradigmes technologiques sur lequel nous allons nous baser pour expliquer le changement technique. Sur la même réalité : il peut y avoir construction de deux paradigmes : basés sur des préoccupations théoriques différentes : 1) le paradigme Estate ou “grande plantation”, basé sur la maximisation du revenu selon un modèle technique théorique : la monoculture (Economie de plantation) et 2) le paradigme paysan : basé sur une meilleure valorisation des ressources tout en limitant les risques selon un modèle technique pratique et localement adapté : les pratiques agroforestières (Agriculture familiale). Dans le cas des jungle rubber et des RAS, le paradigme technologique endogénéise la technique. La permanence de certaines composantes techniques, les pratiques agroforestières en particulier, est basée sur la diminution du risque et l’optimisation de la productivité du travail. Les producteurs rationalisent leurs décisions en cherchant un équilibre entre optimisation ou meilleure valorisation des ressources et entre innovation et limitation des risques.
3.2 Stratégies paysannes Sur le plan agricole, les stratégies paysannes se sont développées en fonction des contraintes écologiques, des contraintes de foncier et de l’accès aux différentes technologies, voire au crédit permettant de les développer. Pour certaines ethnies, les Minang en particulier, l’organisation sociale et les modes de transmission des biens (régime matrimonial) ont pu jouer un rôle également déterminant dans l’évolution des stratégies paysannes.
Le tableau 1 permet de synthétiser l’information et les systèmes de culture développés par les populations locales. On remarque donc tout d’abord que nécessité faisant loi : le jungle rubber s’est imposé à toutes les ethnies (sauf les javanais sur les centres de transmigration du fait du statut écologique particulier des plaines à Imperata, anthropiques ou naturelles). C’est donc bien la contrainte en capital et en main d’oeuvre qui a poussé les planteurs, pionniers ou non, à adopter le jungle rubber. Le facteur culturel ou religieux, et indirectement ethnique, apparaît comme secondaire par rapport aux situations diversifiées que rencontrent les producteurs. Dans des situations de front
12
pionniers, le jungle rubber est apparu comme le système technique le plus adapté pour des paysans généralement sans capital d’investissement. De façon générale, le développement des jungle rubber a permis d’une part une amélioration sensible du niveau de vie des populations en zones pionnières puis en zones devenues traditionnelles. Il a permis une fixation de fait du foncier par l’acquisition de droits d’usufruits sur le long terme, et transmissibles, qui s’apparentent à une privatisation des terres. Il y a eu aussi une individualisation de fait des comportements puisque le jungle rubber ne demande pas la réalisation de travaux spécifiques à des moments précis avec une forte mobilisation de la main d’oeuvre comme cela est le cas pour l’agriculture sur brûlis qui est par définition un mode de mise en valeur faisant largement appel au travail communautaire. Le jungle rubber, symbole de la permanence des pratiques agroforestières dans les stratégies paysannes sur au moins un siècle a permis une individualisation des comportements et des choix techniques mais aussi économiques. Il y a eu de fait une atomisation des producteurs de caoutchouc, non regroupés en association puisque le droit d’association paysanne n’a pas été reconnu au moins jusqu’en 1998. L’individualisation des stratégies n’en a été que plus renforcée, partiellement au détriment des stratégies collectives classiques potentiellement différentes d’une ethnie à l’autre. Il apparait que le développement des jungle rubber n’est pas dépendant des spécificités ethniques.
3.3 Stratégies collectives et changement technique. L’organisation sociale des sociétés concernées a également contribué à l’identification des stratégies. La “ société Dayak ” n’est pas homogène et chaque groupe a ses règles plus ou moins proches. Le terme Dayak est un terme générique qui regroupe simplement les différentes populations de l’intérieur de Bornéo. Ainsi les Dayaks Biddayus de notre zone d’étude (Sanggau/Sintang) ont une société non centralisée ou le village est l’unité principale. Les Malayus de Kalimantan, dont beaucoup sont d’anciens Dayaks ayant rejoint la religion musulmane, ont conservé les pratiques culturales de leurs ancêtres Dayaks. Les Malayus de Sumatra, relativement proches des Javanais, ont développés des structures assez éclatées alors que les transmigrants Javanais ont essayé de recréer leurs structures traditionnelles javanaises dans les nouveaux villages des centres de transmigration avec d’ailleurs souvent un certain temps de retard (P Levang, Comm pers). Les Minang ont une organisation sociale très centralisée avec un régime de transmission matrilinéaire qui a poussé nombre de jeunes Minang à s’expatrier pour pouvoir conserver leur capital mais pas forcément à intensifier dans leurs terres ancestrales puisque la transmission matrilinéaire ne permet pas à leurs enfants d’en hériter. On pourrait dans une première typologie simplifiée regrouper les Dayaks et les Minangs, qui ont développé des agroforêts complexes, donc des traditions agroforestières fortes basées sur une véritable gestion des ressources, et les Malayus et Javanais, qui ont limité l’utilisation des pratiques agroforestières aux jardins de case (“ Pekarangan ”), hormis les jungle rubber. Effectivement, les Minang, société très structurée et les Dayaks, société tribale plus “libre” (en ce sens
13
moins “structurée”), ont développé des agroforêts complexes proches (“Tembawang”, ou agroforêts à bois et à fruits, à Kalimantan et agroforêts à durian/surian/cannelle à Ouest Sumatra (Michon, Mary et al. 1986) qui constituent des innovations remarquables en terme de système de culture et de gestion des ressources. Les Malayus n’ont pas développés d’autres agroforêt que celle des jungle rubber et nous avons vu que les transmigrants javanais ne pouvaient pas pour des raisons techniques en développer. Les Dayaks et les Malayus ont deux unités de structuration : le village et les “groupes de paysans (Kelompok Petani), que l’on pourrait qualifier de “groupes d’intérêt” : c’est à dire des paysans se regroupant pour des raisons d’affinités autour de certaines activités. Ces dernières peuvent être par exemple la mise en valeur d’une même zone, le même système cultural, des liens de parenté ou une proximité géographique .... cette structuration est très basique mais elle fonctionne bien. Le village possède un chef de village, un chef des terres (kepalah tanah), un “chaman” ou chef spirituel et un chef administratif représentant l’Etat ; le Kepala desa” (qui peut être différent du chef de village). Des structures comparables existent chez les Minang et les Javanais. Il existe donc un caractère collectif dans le processus d’innovation dû en partie à la cohérence des groupes. Effectivement, l’innovation, par exemple la production de matériel végétal amélioré (les clones) par les communautés rurales, une innovation organisationnelle [Trouillard , 2001 #1045], dépend en grande partie de l’organisation de la production et des rapports qu’établissent les groupes de paysans entre eux. Si le village est séparé en plusieurs tendances contradictoires, alors l’innovation sera rejetée. Par contre si le village adopte ensemble une politique commune, alors l’innovation sera intégrée (exemple : le palmier à huile). La dynamique d’innovation est donc liée à la cohésion sociale au niveau du village. Cette notion s’exprime d’ailleurs à travers le fait que les groupes souhaitent “ suivre ” (“ Ikut ” en indonésien ) une dynamique si celle-ci répond de façon claire à des contraintes locales. Le changement social, qui découle du changement technique avec une adaptation si nécessaire, dépend alors de plusieurs facteurs :
la souplesse initiale du modèle social,
la souplesse d’évolution de la communauté sur le droit foncier coutumier (Adat)
la capacité de la communauté à accepter, soit sur le plan individuel, soit sur le plan collectif, les évolutions des systèmes de culture et les actions de nouveaux acteurs (les projets par exemple). Le changement social, illustration de la mise en cohérence des systèmes sociaux aux systèmes techniques, qui accompagne le changement technique apparaît donc bien dans le cas du jungle rubber comme dépendant des conditions nécessaires à l’évolution technique plus qu’à des facteurs culturels ou ethniques. Le foncier par exemple, ses modes de ténure et son évolution sont d’ailleurs un critère extrêmement important de différenciation collective car il touche au bien le plus précieux de la communauté : son sol, donc son espace, son territoire. Le tableau 2 synthétise cette évolution des systèmes de production basés sur différents systèmes de cultures, les principales trajectoires prises et la mise en cohérence avec
14
les systèmes sociaux en particulier à travers deux critères principaux : foncier et organisation du travail.
Les Dayaks Bidayuh ont créé une ténure foncière et les lois qui la régissent, l’Adat, en fonction de leur besoin de contrôle de l’espace afin d’assurer la production et le reproduction de leur systèmes tout en conservant les marques d’individualisme qui sont les leurs. Ces deux derniers éléments ont très certainement favorisé l’adaptation des systèmes sociaux aux système techniques et l’intégration progressive de divers système culturaux sans heurts ni ruptures majeures. Il y a une réelle progressivité dans la mise en cohérence des systèmes techniques et sociaux pour les Dayaks Bidayuh. L’organisation du travail est passée d’une organisation globalement collective que nécessitait l’agriculture itinérante à une individualisation des travaux que requiert le système jungle rubber.
4 Une forte cohérence entre système technique et système social en pleine
évolution. Il y a effectivement toujours eu historiquement une relative cohérence entre système technique et système social. L’indivision des terres et le recours aux groupes de travail selon une organisation sociale très marquée par les cycles des cultures annuelles se retrouve bien adaptée aux contraintes de l’agriculture sur brûlis. L’individualisation progressive s’est développée avec les jungle rubber qui ne nécessitent plus une organisation collective des travaux collectifs et une forte capacité à mobiliser de la main d’oeuvre pour des travaux plus régulièrement répartis dans la journée et dans l’année. L’introduction récente du palmier à huile, nécessitant une organisation de la collecte n’a fait que réactiver la pratique du travail en commun pour la collecte des régimes en particulier (tous les autres travaux étant de nature plutôt individuelle). Seul les modes de rétribution ont changé. Ils sont basés maintenant sur la stricte réciprocité ou bien sur l’égalité des temps passés avec partage équitable dès la récolte par bloc. Les changements techniques importants : passage de l’agriculture sur brûlis à l’agriculture de plantation, d’abord par les jungle rubber, puis avec la diversification et le palmier à huile, et l’évolution interne des systèmes de culture ne s’est pas accompagnée de ruptures technologiques majeures et a donc permis une évolution progressive et douce des systèmes sociaux aux nécessités techniques de la production avec une nette tendance à l’individualisation des comportements permis par les cultures pérennes. Il y a donc aussi une certaine plasticité sociale quelque soit les groupes qui s’adaptent aux modalités des systèmes de culture choisis pour leur meilleure adaptation aux conditions locales. Finalement, la recomposition des savoirs, à la base du processus d’innovation, est particulièrement visible dans le cas des systèmes hévéicoles indonésiens des petits planteurs : d’abord par la création des jungle rubber au début du siècle, puis par leur amélioration progressive, ensuite par l’aboutissement que représente les RAS, objets techniques finalisés et optimisés issus de l’observation de l’évolution des pratiques culturales endogènes et de
15
l’application du concept agroforestier à une culture pérenne qui s’y prête plutôt bien. Cette recomposition des savoirs est la source du changement technique en hévéaculture villageoise ou pratiques locales et innovations techniques extérieures se retrouvent intégrées dans l’évolution des référentiels techniques hévéicoles. La possibilité de ce changement technique modèle les stratégies paysannes qui ont fortement évoluées dans les 20 dernières années avec une très nette accélération dans les années 1990. Ces stratégies ont débouché, outre l’intégration du changement technique sur les systèmes hévéicoles sur l”intégration du palmier à huile dans les systèmes de production, du moins pour une partie des planteurs (et la majorité de notre échantillon
11) avec une progressivité somme toute remarquable
L'intégration de l'agroforesterie comme ensemble de pratiques forestières (systèmes de culture) est considérée comme une optimisation d'une opportunité de culture à l'origine exogène (l'hévéa brasiliensis) dans le cadre économique d'un boom lié à une situation de front pionnier” : cette hypothèse semble avoir été vérifiée non seulement dans la première phase que constitue le front pionnier mais aussi dans la seconde phase que constitue la stabilisation du front pionnier. La capacité des planteurs à innover est forte tant que l'innovation permet de solutionner les contraintes majeures de l'exploitation agricole. L’introduction de l’hévéa a été progressive et finalement non perturbatrice des systèmes d’exploitation principalement de fait de l’adoption sous forme d’agroforêt requérant un minium de capital de travail quand le foncier n’était pas un facteur limitant. Dans les zones à agriculture stabilisée, avec maintenant deux voire trois générations de jungle rubber, l’adoption de la monoculture par certains planteurs n’a pas non plus généré de changement sociaux majeurs (grâce aussi à une politique de projets avec crédit complets). On observe une nécessaire évolution vers l’intensification des systèmes hévéicoles qui s’accentue dans les années 1980-90 avec l’augmentation globale des besoins, parallèlement aux autres opportunités de culture ou de source de revenus qui s‘offrent aux planteurs. Le système social une fois stabilisé, par exemple dès la seconde génération dans un système de front pionniers, est souvent un miroir dans lequel se reflètent les contraintes issues du système technique. Le système social s’adapte aux contraintes techniques et ses règles intègrent les nécessités du terrain et des activités qui régissent la communauté. Les “changements techniques” n’ont pas généré dans le temps de ruptures majeures mais au contraire ont résulté d’une adaptation progressive aux modifications de l’environnement économique. Les systèmes sociaux ont donc eu le temps de s’adapter à cette intégration progressive. Le champs social n’a donc pas été discriminant dans cette évolution. En d’autres terme, on pourrait qualifier cette évolution en simplifiant à l’extrême: l’économique a induit le technique : le social a suivi. On constate finalement une lente évolution des systèmes sociaux malgré un contexte indonésien économique et politique en pleine expansion et surtout en accélération depuis les années 1990. On peut cependant se poser la question de la limite de la flexibilité des systèmes et de leur mise en cohérence l’un l’autre si cette
11
Le SRAP a développé un réseau de fermes de références de 100 exploitations dans trois provinces : Ouest-
Kalimantan à Bornéo et Jambi et Ouest-Sumatra à Sumatra.
16
évolution du “ contexte de référence ” dépasse les possibilités “d’évolution sociale” et d’intégration. Les années 1995-2000, années de crise mais aussi années de pleine expansion des sociétés de palmier à huile ont montré une limite à cette flexibilité dans certains villages (en particulier à Kalimantan et Jambi). De même, l’absence de capital disponible suffisant pour nombre de planteurs a généré une certaine inertie des systèmes de productions avec d’une part le maintien des jungle rubber et d’autre part l’insuffisance de l’effet des projets de développement. Si on constate des périodes d’inertie après un changement technique progressif, inertie nécessaire à l’intégration sur longue période et surtout sur de larges espaces géographiques, il a toujours été constaté une capacité importante à innover et à relancer le processus. La dichotomie innovation-produit exogène ou endogène n’est donc pas pertinente. C’est l’adéquation de l’innovation produit à une contrainte particulière, quelque soit l’origine de l’innovation-produit, qui importe. Les facteurs d’évolution sont les suivants : évolution des besoins globaux et du revenu, diminution du risque agricole, augmentation de la productivité globale des systèmes de culture, optimisation du facteur travail et minimisation du capital investi/intrants. Le tableau 2 rappelle cette évolution des trajectoires techniques et les effets sur deux critères importants de la mise en cohérence des systèmes techniques et sociaux : le foncier et l’organisation du travail. A aucun moment, depuis le début du siècle, on ne constate de rupture significative nette entre les systèmes techniques, le changement technique, les nouvelles contraintes... et des modèles sociaux qui se révéleraient inadaptés pour les zones hévéicoles. Même dans les années 1990 ou on observe une accélération nette, d’une part des besoins des populations rurales, tant quantitatifs que qualitatifs, et d’autre part du changement global de l’environnement économique, on constate une souplesse et une flexibilité et une adaptation des modèles sociaux qui intègrent facilement le changement le plus important : le passage d’une société communautaire avec des règles communes basées sur la nécessité de mise en valeur agricole de façon commune (l’agriculture itinérante sur brûlis) à une société de plus en plus individualiste ou les stratégies sont identitaires et les décision le plus souvent prises au niveau de l’exploitation agricole. Un cadre communautaire reste cependant, plus ou moins élastique selon les ethnies. Mais il apparaît rarement contraignant au point de gêner le changement technique en cours. Finalement c’est certainement plus la somme des contraintes techniques qui oriente le choix technique et la définition d’une stratégie pour le petit planteur que son appartenance à une certaine culture ou ethnie. Le Dayak intensifie son système jungle rubber et ne se cantonne pas seulement dans les systèmes extensifs, le transmigrant Javanais adopte l’agroforesterie si elle lui permet de limiter les risques et d’optimiser son investissement si il est mis dans les mêmes conditions que le Dayak et ce d’autant plus que la recombinaison des savoirs (originels, traditionnels et exogènes) est facilitée. Et tant les Malayus, certains Javanais en transmigration spontanée et finalement intégrés aux Malayus à Sumatra
12, les Dayaks, que les Minangs ont développé initialement des jungle
12
L existe à Sumatra une longue tradition de migration javanaise spontanée aboutissant à un véritable métissage
Malayu/Javanais globalement facilitée du fait de la même religion (islam), de traditions assez proches etde la
proximité géographique entre Java et Sumatra.
17
rubber dans des situations culturelles, économiques, géographiques et écologiques assez différentes. Cependant, toutes ces situations avaient un point commun : au départ il s’agit de front pionniers, de front de colonisation avec, globalement, les mêmes contraintes pour tout le monde. Les différences apparentes entre techniques et ethnies résultent plus de leur environnement passé et de leur histoire ancienne qui a modelé leur référentiel culturel actuel. Par contre l’évolution récente est bien liée à un phénomène de véritable recombinaison des savoirs. Certains ethnies ont alors des savoirs plus élaborés sur certains systèmes techniques. Mais la recombinaison de ces savoirs aboutit généralement à des systèmes techniques proches. Ce sont alors aussi les externalités qui modifient les conditions mais les modalités du processus d’évolution et du changement technique sont les mêmes. Le tableau 3 propose une typologie de planteurs qui résume cette évolution par la définition de groupes stratégiques de planteurs. Cette typologie, issue d’une enquête réalisée en 2000 sur un échantillon de 120 planteurs montre la diversité des stratégies en fonction des possibilités d’innovations (production de matériel végétal par les planteurs eux mêmes, expérimentation RAS, palmier à huile en crédit complet par les sociétés privées ....) [Trouillard , 2001 #1045].
Conclusion
Les changements ont certes été très importants entre le début de siècle et la fin des années 1990 mais cette évolution a été somme toute extrêmement progressive. Le véritable changement “global ”, tant sur le plan de l’environnement économique que de l’offre d’alternatives techniques, s’est opéré dans les 20 dernières années. Plus précisément, en fait, depuis d’une part la concrétisation de “l’effet projet hévéa” et, d’autre part, l’accélération de l’économie indonésienne au début des années 1990 et l’apparition de nouvelles opportunités de culture (palmier à huile) qui ont alors profondément modifié le “ système de référence ” global et le cadre économique des zones hévéicoles.
On note une forte diversité des systèmes culturaux possibles, une capacité d’innovation très différenciée selon les modes d’organisation sociale du village qui détermineront des stratégies défensives ou offensives selon les situations. On est globalement passé d’une situation de zone à foncier quasi illimité basée sur l’agriculture sur brûlis, une organisation sociale forte centrée sur les groupes de travail communautaires et d’entraide et un foncier en indivision à une situation de foncier de plus en plus limité et individualisé, partiellement voire principalement redistribué avec des régimes de ténure proche de celle de la propriété privée, une organisation devenue plus faible et plus individualisée avec des systèmes de culture basés sur des cultures pérennes, d’abord le jungle rubber, puis les plantations clonales, le palmier à huile et enfin les RAS. La mise en cohérence des systèmes sociaux et des systèmes techniques s’est faite graduellement sur moins d’un siècle en 4 ou 5 générations avec pourtant des changements importants tant sur le plan des systèmes de culture, de l’organisation du travail que du foncier. Le foncier se caractérise par une privatisation accrue des terres liée à l ‘adoption généralisée des cultures pérennes. L’organisation du travail voit le passage d’une force de travail initialement communautaire à un emploi individualisé de la main d’oeuvre familiale disponible. Cette évolution des systèmes
18
sur longue période a mis en avant l’importance de la conjonction des stratégies individuelles, de plus en plus individualisées au fur et à mesure de l’importance des cultures pérennes dans l’appareil productif, et des stratégies collectives, non négligeables dans des sociétés rurales en évolution mais toujours proche de certaines traditions sociales ( religieuses, ethniques...), techniques (agroforestières..) et culturelles. Finalement, nous assistons à la mise en place très rapide dans certains villages, plus lentement dans d’autres, d’un continuum de stratégies différenciées allant de l’attentisme total à l’innovation diversifiée sur plusieurs systèmes de cultures en même temps. Le changement technique, faible entre 1900 et 1980 pour les systèmes hévéicoles avec la prédominance du jungle rubber, s’est accéléré par la mise à disposition de plusieurs alternatives techniques sur plusieurs plantes ou activités (hévéa clonal agroforestier ou non, palmier à huile, production de matériel végétal...).
On constate également une très nette accélération de l’histoire dans les années 1990 avec pour conséquences un développement important des sociétés de plantations, un désengagement de l’état et arrêt des projets, une crise économique, politique et sociale qui a globalement changé le paysage social des petits planteurs avec maintenant des possibilités plus grandes de structuration à terme, donc de réaction et surtout, d’adaptation aux nouvelles conditions de la production et aux nouveaux types de production et d’organisation sociale du travail et, enfin, de gestion de l’espace avec des stratégies plus individualisées que par le passé. Les trajectoires étudiées intègrent en effet ces facteurs.
Nous avons pu mesurer, sur un échantillon restreint, certes, mais aussi par l’intégration de résultats venant d’autres analyses contemporaines, ainsi qu’une observation à dire d’acteurs que la permanence de l’utilisation des pratiques agroforestières a été globalement maintenue entre 1900 et 2000. Mais nous sommes aussi à un tournant de l’histoire de l’hévéaculture indonésienne. Si notre analyse semble montrer qu’une majorité de planteurs conserve ce concept agroforestier dans des régions comme Kalimantan-ouest (ethnie Dayak) ou comme Pasaman Est (Ouest Sumatra avec l’ethnie Minangkabau) qui ont développé et maintenu une très forte tradition agroforestière, il n’en est pas de même dans la province de Jambi par exemple. Il est donc nécessaire de rester prudent sur l’évolution future des stratégies et sur cette permanence. Si il est certain que les jungle rubber ne vont pas disparaître du moins dans les zones encore pionnières, il semble par contre acquis que leur disparition progressive est programmée dans les bassins devenus traditionnels pour un remplacement vers des plantations clonales qui seront soit en monoculture (avec ou sans cultures intercalaires) ou agroforestières améliorées. Les producteurs ont donc maintenant le choix entre 3 alternatives pour améliorer la productivité des systèmes de culture : la monoculture d'hévéa, les systèmes agroforestiers à base d'hévéa (R.A.S.) et le palmier à huile. Le palmier à huile est le système de culture le plus récemment introduit par le biais d’une contractualisation avec les sociétés privées. Les plantations de palmier à huile des petits planteurs ont d’ailleurs été en partie faites sur d’anciens jungle rubber vieillissants et peu productifs. Les planteurs ayant pu acquérir des plantations de palmier à huile
19
(généralement 2 hectares par familles avec crédit complet) nous ont proposé une hypothèse séduisante : le financement de la replantation des jungle rubber vieillissants en systèmes agroforestiers améliorés par les revenus issus du palmier à huile. Nous observons en 2000 un double paradoxe : un secteur hévéicole toujours en croissance et prometteur à moyen et long terme malgré une conjoncture de prix défavorable et le paradoxe de voir les stratégies agro-forestières financées par une monoculture symbole mais rémunératrice (le palmier à huile). L’innovation ne réside pas seulement dans l’évolution des systèmes de culture mais aussi dans l’art de combiner stratégie et tactique au sein des systèmes productifs. Mais l’Indonésie est à la croisée des chemins en 2001. L’avenir nous dira si notre hypothèse de financement de la replantation des systèmes hévéicoles en RAS par les revenus issus du palmier à huile se vérifiera. L’histoire, même immédiate, se chargera de nous rappeler qu’il n’y a pas d’analyse économique fondée sans intégration des facteurs sociaux, humains, techniques et économiques qui génèrent cette histoire.
20
Encadré 1 : Les jungle rubber
Depuis le début du siècle, les petits planteurs de Sumatra et Kalimantan ont su développer un système agroforestier durable basé sur l'hévéa, le "jungler rubber", en intégrant un matériel végétal non sélectionné (les seedlings) dans une repousse forestière avec une véritable gestion des ressources. Ce système de culture a permis : i) la fixation de l'agriculture dans les zones basses des grandes plaines avec un niveau de production suffisant malgré l'emploi de matériel végétal non sélectionné (Gouyon and Penot 1995), : ii) une conservation importante de la biodiversité (De Foresta 1992a), (De Foresta 1992b) et ; iii) un maintien d'un environnement de type forestier avec les conséquences positives sur l’eau, le sol, sa structure et sa fertilité.. Les “jungle rubber” et les systèmes de production basés sur ces systèmes de culture ont été bien étudiés (Barlow and Muharminto 1982)(Budiman, Penot et al. 1994)(Dove 1993a)(Gouyon, De Foresta et al. 1993).(Penot and Gouyon 1995). Les “ jungle rubber ” ou agroforêt à hévéa sont des systèmes agroforestiers complexes
i ou l’hévéa constitue la principale source de revenu. Le système de
culture est établi sur la base d’une culture sur brûlis, en général le riz pluvial, ou les plants d’hévéas, sous forme de graines ou de jeunes plants (stumps non greffés) sont complantés avec le riz. Ces jeunes plants d’hévéa vont ensuite pousser en même temps que le recru forestier et donner une plantation qui sera saignée entre 8 et 13 ans après plantation (contre 5 à 6 ans pour une plantation en monoculture classique). La durée de vie de l’agroforêt est de 30 à 40 ans mais le système peut évoluer de façon différente. En effet, à la fin de la période productive de l”hévéa, l’agroforêt peut être coupée et replantée selon un cycle basé sur la durée de vie de l’hévéa. L’autre solution, pratiquée en partie par les Dayaks de Kalimantan, consiste à conserver la vieille agroforêt initialement basé sur l’hévéa et la faisant évoluer en agroforêt à bois et à fruits: le système passe du “jungle rubber” au “tembawang”. Les autres arbres associés d’importance économique sont essentiellement des espèces à fruits et à bois, et du rotin. Les jungle rubber ont été bien définis sur le plan botanique par H de Foresta, D Lawrence et S Werner(Lawrence 1996)(De Foresta 1997)(Werner 1997). Un certain nombre de produits forestiers non ligneux (donc autres que le bois, les “PFNL”) sont utilisés pour l’autoconsommation : artisanat, plantes médicinales, légumes, résines...Ils contribuent donc indirectement au revenu des exploitations et peuvent même, à terme, constituer des sources potentielles de revenus non négligeables (le rotin par exemple).
21
Encadré 2 : les systèmes RAS
RAS 1 : un jungle rubber avec des clones. RAS 1 est un jungle rubber dans lequel la seule modification apportée au système consiste au remplacement des seedlings d'hévéa traditionnellement utilisés par des clones adaptés. Ces clones doivent avoir une croissance rapide, être résistants aux maladies de feuilles et adaptés au régime d'exploitation (saignée) des petits planteurs. La biodiversité attendue de RAS 1 semble comparable à celle du jungle rubber (elle même assez proche de celle de la forêt secondaire). RAS 1 ne peut être réalisé que dans des zones de plantation ou de replantation qui ne soient pas dégradées, avec une biodiversité environnante qui soit suffisante, avec présence de forêts secondaires, agroforêt à fruits et bois (les “Tembawang” à Ouest-Kalimantan) ou vieux jungle rubber. Les arbres associés à l'hévéa seront donc ceux issus du recru naturel de la forêt, dont certains seront ultérieurement sélectionnés par le planteur (en général entre la 8ieme et la 10ieme année après plantation).
RAS 2 et 3 : des agroforêts à hévéas optimisées RAS 2 et 3 sont des systèmes agroforestiers complexes où les éléments de la combinaison hévéa et arbres associés sont choisis dès la plantation. La biodiversité est moindre et sélective (fruitiers et arbres à bois. Les densités de plantation sont de 550 hévéas/ha et entre 150 et 250 autres arbres associés. Une telle structure permet d'échelonner dans le temps des productions différentes : caoutchouc entre les années 5 et 35, bois pour pâte à papier entre les années 6 et 10 (arbres à croissance rapide), fruits entre les années 10 et 50 puis bois entre les années 40 et 50 (arbres à croissance lente).
RAS 2 : un système intensif centré sur les cultures intercalaires en période immature. Des cultures intercalaires sont cultivées durant les 3 ou 4 premières années de la période immature de l'hévéa. L'enjeu majeur est ici de maintenir la production de vivrier à un niveau compatible avec une bonne productivité du travail et un minimum d'intrants et de risques, pendant plusieurs années consécutives. RAS 2 est surtout conçu pour les zones de transmigration, les zones où le foncier est extrêmement limité et les zones fortement dégradées (savanes à Imperata...). C'est le système le plus intensif.
RAS 3 : une stratégie anti-Imperata Le planteur ne souhaite pas, pour diverses raisons, cultiver de cultures intercalaires. L'enjeu est alors de mettre en place un système de plantes qui permettront une bonne couverture et une protection du sol avec un minimum d'entretien en première année et pas ou peu d'entretien les années suivantes. Une telle combinaison fait appel à des plantes de couverture non grimpantes, plus ou moins auto-régulantes combinées à des plantes arbustives ou arbres d'ombrage à croissance rapide). RAS 3 peut être également considéré dans une stratégie anti Imperata pour la réhabilitation des savanes à Imperata.
22
Encadré 3
Le projet SRAP
Le projet SRAP, “Smallholder Rubber Agroforestry Project” a démarré en août 1994 ¨sur un programme de recherche basé sur la mise au point des systèmes RAS. Le projet a été créé avec la collaboration directe et effective dès le démarrage de quatre institutions : le CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le développement) auquel appartient l’auteur, l’ICRAF (International Center for Research in Agroforestry) : un centre de recherche international du CGIAR
13, le
GAPKINDO14
(Gabunan Karet Indonesia) ou association des professionnels du caoutchouc indonésiens ; une association non gouvernementale des usiniers du caoutchouc regroupant également un certain nombre de grandes plantations, et la recherche nationale hévéicole IRRI à travers la collaboration directe de deux chercheurs de la station de Sembawa
15.
L’objectif du SRAP, projet de recherche conjoint CIRAD/ICRAF, a été et est toujours d’optimiser ce type de systèmes de culture par une expérimentation concertée en milieu paysan et en approche participative avec des petits planteurs des régions de Sumatra et Kalimantan entre 1994 et 2001. Nous sommes donc ici dans un interface paysans/chercheurs/projets.
13
CGIARC = Consultative Group for International Aagricultural Research Centers. Ce groupe
regroupe 14 centres internationaux.
14Et en particulier Dr A.F.S. Budiman et Ir Leo Abam.
15Dr Gede Wibawa et Dr Hisar Bihombing.
23
Figure 1 : Valeur du kilo de caouchouc payé au producteur en équivalent kilo de riz Source (A Gouyon, IRSG, GAPKINDO, BPS)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
x 1
00
0 t
on
ne
s
0
1
2
3
4
5
en
éq
uiv
ale
nt
kg
de
riz
19001904
1908
19121916
1920
19241928
1932
19361940
1944
19481952
1956
19601964
1968
19721976
1980
19841988
1992
19962000
valeur kg caoutchouc en équivalent riz prod x 1000 t Indonésie
Valeur du kg de caoutchouc en kg riz
et production : Indonésie 1900/2000
24
Tableau 1 : Systèmes de cultures , ethnies et agroforêts. Ethnie Religion Systèmes de culture principaux Autres types d’agroforêt ou de
systèmes agroforestiers. Dayaks catholique Jungle rubber
Ladang Monoculture hévéa (projets SRDP/TCSDP)
Tembawang Pekarangan (plus ou moins développé)
Malayu/Jambi musulman Jungle rubber Ladang Riz irrigué si proximité d’une rivière monoculture hévéa (projets SRDP/TCSDP)
Pekarangan (plus ou moins développé) Eventuellement “pulau buah”( ancien pekarangan sur d’anciens sites de villages)
Javanais musulman syncrétisme
riziculture irriguée ladang monoculture hévéa (projet NES)
Pekarangan (très développé)
Minang (Pasaman Est)
musulman Jungle rubber Riziculture irriguée en bas fonds Ladang Canelle
Agroforêt à Surian/duriuan/canelle Jungle rubber Pekarangan
Kubus animiste chasse, pêche, cueillette 0
Indonésiens chinois
chrétiens ou boudhistes
pas d’agriculture. Pas de foncier. Activité commerciale (traders)
0
Ladang = agriculture itinérante. Pekarangan = jardin de case.
25
Tableau 2 : évolution des trajectoires et des systèmes de production
Période source de revenus et principaux
systèmes de culture foncier organisation du travail
avant 1900 Ladang (agriculture sur brûlis) indivision totale communautaire, entraide, Goton Royong (GR)
1900-1950 Ladang + Introduction jungle rubber, front pionniers, montée en puissance
Indivision + Usufruit long terme
Entraide, GT individuel
1950-1970 Continuation front pionniers + Stabilisation des bassins devenus traditionnels Le jungle rubber prime sur le ladang (qui devient orienté sur l’autoconsomation.
idem seconde génération de jungle rubber, (usufruit très long terme)
entraide sur ladang individualisation des stratégies avec le développement du jungle rubber
1970-1980 Premiers projets : échecs inertie des systèmes.
Erosion progressive des terres en indivision au profit de l’usufruit à long terme (jungle rubber)
Lente mais progressive individualisation des comportements
1980-1990 Seconde vague de projets : succès. Intégration des plantations clonales pour 15 % des planteurs Baisse du ladang Continuation du jungle rubber
-troisième génération de plantation (JR ou clonal) : passage progressif vers la propriété privée
érosion lente de l’utilisation du Gotong Royong
1990-2000 Spécialisation en hévéaculture. Baisse progressive du ladang Developpement du salariat temporaire. Intégration du palmier à huile Diversification
Statut de quasi propriété privée pour les terres en cultures pérennes. Distribution partielle ou complete des terres en Indivision.
Abandon progressif du Gotong Royon. Individualisation des stratégies sur hévéa. Regroupement sur palmier à huile
1997-2000 Crise asiatique et indonésienne Crise du caoutchouc Accentuation de l’évolution précédente.
26
Tableau 3 : typologie de planteurs par groupes stratégiques
Replanteurs pépiniéristes
replanteurs acheteurs replanteurs autonomes
Attentistes nouveaux planteurs
groupe 1 2-1 2-2 3 4-1 4-2 4-3 5
activité principale Hevea hévéa et palmier non agricole hévéa et palmier hévéa Hévéa hévéa cultures sèches off farm
production de matériel végétal
oui non non oui non Non non oui
type de stratégie offensive court et long terme
offensive offensive offensive défensive Défensive offensive offensive
type de système de culture en hévéa
Jungle rubber (JR) parcelles projet RAS sendiri
Jungle rubber (JR) parcelles projet monocullture RAS sendiri
monoculture Jungle rubber (JR) parcelles projet RAS sendiri monoculture
JR palmier
JR Monoculture projet
JR RAS
- monoculture seedlings et clonale + cultures intercalaires - RAS 2
Stratégies diversification diversification capitalisation
diversification capitalisation attente Attente capitalisation limiteé
plantation nouvelle
étape innovation opportuniste
opportuniste investisseur innovation opportuniste
inertie Inertie innovation innovation
changement technique
multiple hévéa clonal
hévéa agroforesteier non Non hévéa
agroforestier hévéa clonal type RAS 2
cohérence avec systèmes sociaux
forte moyenne indépendant forte faible Faible forte moyenne à faible
recombinaison des savoirs
forte moyenne faible forte faible Nulle forte moyenne
type de village Pariban Baru Sanjan
Enbaong Muara buat Rantau Pandan
Seppunggur
Pariban Baru Kopar Engkayu
Kopar Rngkayu
villages NES seppungur Bangkok
trimulia
Province Kalimantan ouest Kalimantan ouest Janbi Kalimantan ouest Kalimantan ouest Jambi Jambi Ouest Sumatra
Kalimantan ouest
27
Références bibliographiques Barlow, C. and Muharminto (1982). Smallholder ruber in South Sumatra, towards economic improvement. Balai Penelitian Perkebunan, Bogor, Australian National University. Budiman, A. F. S., E. Penot, et al. (1994). RAS as alternatives for smallholder in Indonesia Integrated rubber agroforestry for the future of smallholder rubber in Indonesia. Confèrence Nationale sur le caoutchouc, Medan (IDN), IRRI. Byé, P. (1998). Domestiquer le végétal. Construction et appropriation des techniques. Montpellier, INRA. De Foresta, H. (1992a). Botany contribution to the understanding of smallholder rubber plantations in Indonesia: an example from South Sumatra. Symposium Sumatra Lingkungan dan Pembangunan, BIOTROP, Bogor. De Foresta, H. (1992b). “Complex agroforestry systems and conservation of biological diversity: for a larger use of traditional agroforestry trees as timber in Indonesia, a link between environmental conservation and economic development. Proceeding of an international conference on the conservation of tropical biodiversity.” Malayan Nature Journal. De Foresta, H. (1997). Smallholder rubber plantations viewed through forest ecologist glassess. An example from South Sumatra. ICRAF/SRAP workshop on RAS (Rubber Agroforetsry Systems), Bogor. DGE (1998). “Statistik karet.” DGE, Jakarta. Dove, M. (1993a). “Smallholder rubber and swidden agriculture in Borneo: a sustainable adaption to the ecology and economiy of tropical forest.” Economic Botanic 47(2). Gouyon, A. (1995). Paysannerie et heveaculture: dans les plaines orientales de Sumatra: quel avenir pour les systemes agroforestiers? INA-PG. Paris, France, INA-PG. Gouyon, A., H. De Foresta, et al. (1993). “Does the jungle rubber deserve its name? An analysis of rubber agroforestry systems in Southeast Sumatra.” Agroforestry systems 22(3): pp 181-206. Gouyon, A. and E. Penot (1995). L'hévéaculture paysanne indonésienne : agroforêts et plantations clonales, des choix pour l'avenir, CIRAD / ICRAF. Lawrence, D. C. (1996). “Trade-offs between rubber production and maintenance of diversity: the structure of rubber gardens in West Kalimantan, Indonesia.” Agroforetry Systems(34): 83-100. Michon, G., F. Mary, et al. (1986). “Multistoried agroforestry garden system in West Sumatra.” Agroforestry Systems 4: 315-338. Penot, E. (1997). From shifting agriculture to sustainable rubber complex agroforestry systems (jungle rubber) in the peneplains of Sumatra and Kalimantan in Indonesia: innovations in local rubber based cropping systems. World Bank report "Indonesia : upland agricultural technology study. 1997/02, World Bank.
28
Penot, E. and A. Gouyon (1995). L'hévéaculture paysanne indonésienne: Agroforêt et plantations clonales : des choix pour l'avenir. Séminaire CIRAD-MES: succés et echecs des revolutions vertes, Montpellier (FR), CIRAD. Penot, E. Budiman, A.F.S. (1998). “Environmental aspects of smallholder rubber agroforestry in Indonesia : reconcile production and environment.” International Rubber Conference, May 1998, Paris, France: 22. Penot, E. Ruf F. (2000). Rubber cushions the smallholder : no windfall, no crisis. In "Agriculture in crisis : people, commodities and natural ressources in indonesia, 1996-2000 " edited by F. Gerard and F Ruf. CIRAD/CURZON. CIRAD/CURZON. Richmond, UK, Curzon Press, UK: p 237-266. Schueller, W., E. Penot, et al. (1997). Rubber Improved Genetic Planting Material (IGPM) availability and use by smallholders in West-Kalimantan Province. ICRAF/SRAP workshop on RAS (Rubber Agroforestry Systems), September 1997. Simondon, G. (1958). “Du mode d'existence des objets techniques.” Werner, S. (1997). Biodiversity of jungle rubber in West-Kalimantan. ICRAF/SRAP workshop on RAS (Rubber Agoforestry Systems), Bogor. Trouillard , K. (2001). Les systèmes agroforestiers à base d'hévéa clonal : une solution pour la relance des plantations villageoises: un système de culture complémentaire du palmier à huile. CNEARC, Mémoire de fin d'études Master of Science "développement agricole tropical : option valorisation des productions". Montpellier, CNEARC: 150 p. i