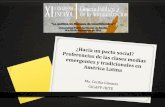LA CIRCULARITE DE LA NOTION « CHANGEMENT CLIMATIQUE » DANS LES MEDIAS FRANÇAIS, CONSTRUCTION DE...
Transcript of LA CIRCULARITE DE LA NOTION « CHANGEMENT CLIMATIQUE » DANS LES MEDIAS FRANÇAIS, CONSTRUCTION DE...
183
CHAPITRE 8
LA CIRCULARITE DE LA NOTION « CHANGEMENT CLIMATIQUE » DANS LES MEDIAS FRANÇAIS,
CONSTRUCTION DE CORPUS REPRESENTATIFS
Marion MAUGER-PARAT RESUME
Le concept controversé de changement climatique de nature anthropique est aujourd’hui largement débattu dans de nombreuses sphères de la société française : sphère scientifique, mais également sphères politique, religieuse, économique, sociétale. Ce processus de transmission de connaissances des scientifiques-experts vers le grand public-profane emprunte de nombreuses voies médiatiques et permet de construire différentes mises en narrations, ou histoires, qui elles-mêmes alimentent des imaginaires culturels. L’intérêt de notre travail de recherche est de comprendre les différentes manières dont se forment les représentations du changement climatique tout au long de ce processus de transmission. Cette contribution s’intéresse à la construction de notre matériau d’analyse, le corpus, et tente de répondre à la question méthodologique suivante : comment représenter scientifiquement un phénomène aussi complexe que le changement climatique en tant qu’objet de recherche par le biais de la construction d’un corpus ? INTRODUCTION
Depuis une vingtaine d’années, et malgré des certitudes confirmées par les rapports des climatologues, la question de la responsabilité anthropique dans l’évolution actuelle du climat est régulièrement remise en débat dans les médias. En juin 2010, sept mois après la Conférence des Parties1 de Copenhague, les médias continuent de porter la question climatique sur le devant de la scène médiatique et d’entretenir la controverse entre « climato-sceptiques » et « pro-GIEC ». Une enquête réalisée par l’institut de
1 Une Conférence des Parties (COP) est une réunion annuelle organisée par la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC), où se retrouve l’ensemble des représentants des pays faisant partie de l’ONU, afin de négocier les grandes problématiques résumées dans les rapports édités par le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC).
184
sondage Ipsos2 un mois après le sommet de Copenhague révèle l’opinion publique française vis-à-vis du changement climatique : 84 % des personnes interrogées croient en l’évolution du climat, et presque autant pensent qu’il s’agit d’un phénomène causé par l’homme. 77 % considèrent qu’il s’agit d’une réalité prouvée scientifiquement. Le problème climatique semble donc prégnant dans la société française. D’autre part, malgré un consensus affiché par voie de sondage, les climato-sceptiques continuent d’être représentés dans les médias.
Afin de mieux comprendre ce que les Français craignent, l’image qu’ils entretiennent du changement climatique et les solutions qu’ils pensent applicables, ces études quantitatives doivent être couplées à des analyses qualitatives, indispensables pour déceler la manière dont se construisent les représentations du changement climatique au travers des discours et images sollicités, non seulement du point de vue de l’opinion publique, mais également du point de vue des scientifiques qui contribuent à la construction de ces représentations, ainsi que du point de vue des médias qui se chargent de transmettre, et par là même de transformer ces discours.
Ces questions de représentativité d’une controverse scientifique dans les médias nous ont conduite à un travail de thèse en sémiologie3, se fondant sur l’interrogation suivante : comment se construisent les représentations du phénomène climatique de nature anthropique controversé dans le processus de circulation des savoirs, et partant, quels imaginaires culturels du changement climatique se font jour dans l’espace public ?
Le présent article a pour objectif de présenter les enjeux et questionnements théoriques et méthodologiques aboutissant à la construction des corpus d’analyse, selon notre compréhension de l’objet de recherche « changement climatique » au travers du parcours bibliographique.
Dans son travail de thèse en sociologie des médias, Jean-Baptiste COMBY (2008) met au jour les techniques de publicisation
2 Enquête Ipsos de janvier 2010 consultée à l’adresse suivante : http ://www.ipsos. fr/CanalIpsos/articles/2974.asp 3 « Des discours d’expert aux discours profanes : reformulation, vulgarisation, médiatisation du concept de changement climatique », sous la direction de J.-D. URBAIN, Université Paris Descartes, et le tutorat de F. FODOR, EDF R&D.
185
empruntées par l’enjeu climatique. Selon lui, cette publicisation allant de l’international au local passe par une « fait-diversification » de l’enjeu climatique dans les médias français. Il considère que les scientifiques ont joué un rôle important de légitimation du problème : « A partir du moment où quelques scientifiques ou experts participent activement à l’affirmation d’un consensus de la communauté scientifique sur la réalité des changements climatiques dus à l’activité humaine, l’information sur ces enjeux […] obtient une place rédactionnelle croissante » (79). Ces arguments permettent de révéler l’importance accordée au changement climatique par les médias d’information. Cependant, en pointant « l’affirmation d’un consensus », COMBY ne prend pas en compte la dimension controversée inhérente à l’enjeu climatique. Car si les scientifiques prennent de plus en plus la parole, c’est aussi pour tenter de pallier le mouvement grandissant des climato-sceptiques dans les médias. Ainsi, notre première hypothèse de recherche se fonde-t-elle sur l’idée que sans controverse ni débat, l’espace médiatique alloué au changement climatique serait plus réduit qu’il ne l’est actuellement. L’enjeu climatique bénéficierait toujours des grands événements internationaux pour voir son espace médiatique déployé durant une période donnée, cependant cet effet reste de courte durée, d’après ce que nous avons pu observer. En d’autres termes, nous pensons que la présence médiatique des climato-sceptiques influence les médias, qui continuent d’aborder en 2010 le problème du changement climatique.
Une seconde hypothèse, liée à la circulation de la notion de changement climatique dans les médias, est mise au jour suite au travail bibliographique : la mise en narration de l’imaginaire climatique est déployée dès la sphère scientifique, et non seulement dans les sphères médiatiques. Nous considérons que les médias amplifient, dramatisent, des « histoires » déjà présentes dans les discours des scientifiques, « pro-GIEC » ou « climato-sceptiques ». Cette hypothèse nous permet de réfléchir à la constitution des corpus d’un point de vue particulier, celui de la circularité d’une notion construite par l’usage de discours et d’images, dans le paysage médiatique français, et de réfléchir à une structuration spécifique des corpus.
186
En cela, la conceptualisation du corpus d’analyse est une part importante du travail de recherche, car elle conditionne la pertinence et valide le point de vue de recherche. La méthode de constitution de corpus propre à la sémiologie des indices permet de faire ployer la théorie en fonction de la pratique : HOUDEBINE (1999) explique que l’approche méthodologique proposée par cette sémiologie est ouverte et peut être modifiée en fonction des besoins de l’analyse. Si le chercheur parvient à justifier pour chaque étape de constitution du corpus sa validité et sa représentativité, le corpus peut alors être considéré comme pertinent. Un des objectifs de cet article est de voir de quelle manière la théorie houdebinienne se ploie afin de pouvoir représenter la réalité de circulation de la notion par son couplage avec d’autres théories issues de l’analyse de discours et de la sociologie, car la construction d’un corpus représentatif et pertinent intéresse nombre de sciences humaines et sociales. Ainsi, comme le propose la linguiste KRIEG-PLANQUE (2007), l’approche théorique et méthodologique de constitution de corpus que nous développons dans cet article se veut pluridisciplinaire ; le discours, linguistique ou iconique, reste le matériau d’analyse, tandis que les interprétations sont tournées vers les sciences politiques, l’histoire, la sociologie, la psychologie, etc.
Cette contribution s’intéresse donc à la construction du corpus et pose les interrogations sous-jacentes aux méthodes sémiologiques et discursives de pertinence, d’exhaustivité et de représentativité. Nous commencerons par balayer les théories prises à partie afin de comprendre l’enjeu théorique lié à la constitution de notre corpus. Nous nous intéresserons ensuite aux spécificités de l’objet de recherche, afin de saisir les conditions de réalités médiatiques de la notion « changement climatique ». Dans un troisième temps, notre regard se portera sur les solutions envisagées afin de valider scientifiquement notre démarche de constitution de corpus, processus qui permettra également de donner sa pertinence au travail de recherche. La partie suivante sera dédiée à l’application de ces solutions à notre objet, la notion « changement climatique ».
187
LES ENJEUX THEORIQUES Selon la synthèse de L’Observatoire Sociétal sur le thème du
changement climatique (FODOR, 2007), les inquiétudes liées à l’enjeu climatique semblent augmenter, tandis que les connaissances du phénomène restent faibles. En effet, « les connaissances des causes de l’effet de serre sont encore très lacunaires » pour les citoyens français. La sémiologie des indices donne à structurer, organiser des objets flous par nature, de par son fondement structuraliste, permettant de tendre vers une certaine objectivation de l’analyse. Cette théorie apparaît pleinement adéquate pour appréhender l’objet de recherche « changement climatique » du point de vue sémiologique. HOUDEBINE énonce clairement que le cadrage théorique permettant la construction d’une sémiologie des indices « doit penser ses conditions de scientificité d’autant que nous avons alors affaire à des objets aux contours mal définis, c’est-à-dire à ce que Abraham MOLES désigne comme une “science de l’imprécisˮ » (HOUDEBINE, 1999 : 219).
SAUSSURE (1916) considère la langue comme « un système qui ne connaît que son ordre propre » (43), la langue est une structure composée d’unités et régie par une « grammaire » particulière. Selon lui, « la linguistique n’est qu’une partie de cette science générale, les lois que découvrira la sémiologie seront applicables à la linguistique » (33). Tout système sémiologique est ainsi composé d’unités spécifiques et de règles qui les combinent. Afin de mettre au jour cette « grammaire », le linguiste se doit de travailler en « immanence »4, considérant dans son analyse toutes les données linguistiques, mais seulement ces données, délimitées par la construction du corpus.
La sémiologie des indices développée par HOUDEBINE se fonde sur le structuralisme saussurien pour valider scientifiquement la recherche. L’hypothèse de la structure permet de catégoriser, de structurer donc, des éléments flous et imprécis (HOUDEBINE,
4 Le principe d’immanence est développé par Louis HJELMSLEV, qui considère que tout recours aux faits extralinguistiques doit être exclu, parce que préjudiciable à l’homogénéité de la description. Ainsi, une fois le corpus constitué, celui-ci doit-il être appréhendé comme un tout autonome, sans recours aux événements extra-linguistiques. HOUDEBINE reprend ce concept à son compte, mais dépasse le principe dans la deuxième phase de l’analyse.
188
1999). Dans un second temps, elle s’appuie sur la sémiologie de la signification de BARTHES (1991), pour une interprétation du système sémiologique mis au jour, menant à une critique de la société dans laquelle prend place ce système. Cette étape de l’analyse, la phase interprétative, s’attache aux questions de sens et d’interprétation. Elle a pour objectif de déployer, du point de vue du récepteur, des sens possibles appelés « effet de sens », en s’appuyant d’abord sur la grammaire interne au corpus mise au jour lors de la description des données, puis sur la contextualisation du corpus, son rapport au social. Afin de conserver le caractère scientifique de l’étude dans la phase interprétative de l’analyse, chaque effet de sens doit être décrit et expliqué, dans le but de tracer le processus de mise en sens. Le rôle du sémiologue est de montrer que ce qui est évident et naturel aux yeux de tous, est en fait construit et imposé à nos sociétés.
La sémiologie des indices offre à voir la photographie d’une situation lorsque l’étude est dite synchronique, c’est-à-dire restreinte à un temps court. Dés 1970, André MARTINET ajoute à cette notion de synchronie le dynamisme, et tente ainsi de mettre au jour les possibles évolutions des usages. HOUDEBINE explique que « la synchronie est mouvante, hiérarchisée […] la langue n’apparaît plus comme un système où tout se tient, mais comme une co-existence de structurations à la fois stables et instables » (1985 : 7). Cependant, la synchronie dynamique n’est efficace que lorsque la période temporelle analysée est mise en parallèle avec une autre analyse synchronique. Il s’agira donc d’une analyse diachronique, qui compare deux analyses synchroniques dynamiques, et qui vérifie ainsi les hypothèses d’évolution des usages de la première analyse. En effet, MARTINET considère possible ce genre d’analyse à la condition qu’une décennie sépare les deux temps de l’analyse (1970 ; 1990). Dans le cadre de notre analyse, nous nous intéressons à l’étude des médias. WOLTON (1991) explique dans son texte sur Les contradictions de l’espace public médiatisé, que le temps des médias tend à devenir extrêmement court, réduisant « toutes les échelles de temps à celle de l’événement ». Une analyse des discours médiatiques sous le sceau d’une sémiologie synchronique dynamique ne permet pas de rendre compte de la circularité d’une notion dans le paysage médiatique. HOUDEBINE ressent bien cette lacune en développant
189
la notion d’épaisseur synchronique en lien avec l’idée d’une structure synchronique, concept qui approfondit les hypothèses d’évolution de la langue, des signes et des usages (1985). Elle tente de dégager les causalités d’une évolution de la langue, non seulement en fonction de la temporalité, mais également par rapport à d’autres signes sociaux. L’épaisseur synchronique autorise l’émergence d’idées prescriptives en donnant des indications sur les dynamiques en cours au sein d’une langue ou d’un idiolecte dans un temps long, mais pas de voir le chemin parcouru par une notion et / ou une image dans différents médias et dans un temps court. La sémiologie des indices ne permet donc pas de rendre compte de la circularité, donc de la valeur rétroactive d’une notion.
La question se pose de savoir comment rendre le principe de synchronie dynamique compatible avec une analyse des médias, dans une temporalité restreinte. Dans cette perspective nouvelle, le sémiologue pourrait ainsi travailler la construction d’une notion (discours et images confondus) par le biais de sa circularité médiatique, et rendre compte de son évolution au rythme des médias, c’est-à-dire dans un temps court (quelques mois, et non plus quelques décennies). En d’autres termes, nous nous demandons comment passer d’une méthodologie de photographie à une méthodologie (encore) plus dynamique de film, qui permettrait de rendre compte de la circularité d’une notion.
L’analyse de discours offre un recours à ce questionnement. A la suite de FAYE (1972) et d’EBEL et FIALA (1983), KRIEG-PLANQUE tente de modéliser un concept opératoire qui permet de rendre compte de la circularité d’une expression discursive dans les médias. KRIEG-PLANQUE définit le concept de formule ainsi : « Un ensemble de formulations qui, du fait de leurs emplois à un moment donné, cristallisent des enjeux politiques et sociaux que ces expressions contribuent dans le même temps à construire » (2009 : 7). Elle développe ensuite les quatre principales propriétés qui illustrent une formule telle que définie ici, propriétés que nous allons rapidement détailler.
Pour commencer, la formule est relativement stable dans sa forme. C’est une condition pour permettre au chercheur de la repérer dans l’espace public. On dira que l’expression est figée. KRIEG-PLANQUE prend – justement – l’exemple du développement
190
durable, supposant que cette expression a acquis le statut de formule. Elle en montre la richesse sémantique, ainsi que les très nombreuses formes dérivées qui en découlent : « alimentation durable, développement viable, durabilité, épargne responsable » (KRIEG-PLANQUE, 2010). Car la formule existe aussi au travers des multiples reprises dont elle est l’objet, reprises médiatiques qui engendrent forcément des modifications dans sa forme, mais minimales afin qu’elle reste reconnaissable. Son caractère figé permet ainsi la création de nombreux dérivés.
Ce que nous appelions « reprise » correspond à la deuxième propriété de la formule : la multiplicité des usages. En effet, « la formule n’existe pas sans les usages qui la font devenir comme telle » (KRIEG-PLANQUE, 2009 : 84). C’est lors du repérage dans les médias d’une série d’usages particuliers que l’expression commence à porter des enjeux allant au delà même du discours. L’expression préexiste à son statut de formule, et ce sont, entre autres, les usages qui l’érigent à ce statut particulier. Suite au repérage des usages, la formule se qualifie par deux points interdépendants : le fait qu’elle devienne un référent social d’une part, et le fait qu’elle soulève une polémique d’autre part.
L’expression candidate au rang de formule doit constituer un référent social, elle doit signifier quelque chose pour tout le monde au même moment. Cela n’implique pas que sa signification soit unique ou homogène, « au contraire, ses significations sont multiples, parfois contradictoires » (KRIEG-PLANQUE, 2009 : 93). L’accroissement de son utilisation dans les médias peut être un signe de sa mise en circulation ; la création de dérivés, comme vu plus haut, peut en être un autre. Enfin, la pluralité des médias peut constituer un dernier signe que l’expression est devenue un référent social. « Pour que l’on puisse dire que la formule est un signe connu de tous, il faut que l’on puisse en observer la présence dans des types de discours les plus variés possibles […] [La formule] est alors mise dans le pot commun de l’univers discursif pour entrer en conflit avec le sens qu’elle a ailleurs… » (99). En sortant de son domaine originel, la formule envahit l’espace public, et devient ainsi un passage obligé des médias, lors notamment du déploiement d’un débat sur le thème en question, ce qui renvoie à la dernière propriété de la formule : son caractère polémique. La formule est porteuse d’enjeux sociopolitiques forts : « Nous
191
entendons par là qu’elle met en jeu quelque chose de “graveˮ […] au sens où elle met en jeu l’existence des personnes ». Ce faisant, « elle participe au poids de l’histoire ». En effet, les formules sont porteuses d’une valeur de description des faits politiques et sociaux qui touchent directement les gens, et sont, par là même, chargées d’enjeux : à ce titre, elles deviennent le témoin de l’histoire, puisqu’elles sont amenées à marquer le champ médiatique dans lequel elles s’inscrivent.
Notre travail de thèse se construit autour de ces deux courants théoriques. La première étape analytique tente de montrer que l’expression « changement climatique », ainsi que ses dérivés et synonymes, peuvent être considérés comme une formule selon le concept développé par KRIEG-PLANQUE. Le matériau d’analyse est alors constitué de discours, de textes. Dans un deuxième temps, toujours analytique, et afin de coupler le concept de formule avec la théorie d’analyse d’images houdebinienne, nous tentons d’appliquer la méthodologie de KRIEG-PLANQUE à l’analyse d’images, dans le but de vérifier s’il n’existe de formules que linguistiques, ou bien si ce concept peut également être opératoire lors de l’analyse d’images représentant le changement climatique.
Selon ce qu’explique KRIEG-PLANQUE, les sources dont sont issus les corpus doivent être les plus diversifiées possibles. Cela n’est pas sans poser de problèmes au niveau de la construction des corpus : comment homogénéiser des corpus émanant d’entités médiatiques diverses et de natures différentes ? Sur quelle temporalité se fonder pour la sélection des corpus ? Quels critères communs sont à définir pour parvenir à représenter la circularité, et donc la diversité des représentations de la notion de changement climatique ?
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le changement climatique est tout d’abord une découverte scientifique, faite par ARRHENIUS en 1896. Le chimiste suédois formula une première loi sur l’effet de serre, dont la forme originale est : « Si la quantité d’acide carbonique augmente en progression géométrique, l’augmentation de la température suivra,
192
presque avec une progression arithmétique »5 (ARRHENIUS, 1896 ), loi qui n’a pas été invalidée depuis.
Une science, quelle qu’elle soit, tend vers une certaine objectivation au travers du recueil de données et de la méthodologie d’analyse. C’est l’un des points communs à toute science : le besoin éthique de tendre vers une certaine objectivation de la recherche, sans pour autant jamais parvenir à l’atteindre. Car le parcours scientifique n’est jamais neutre ni objectif : il résulte de choix. Le chercheur fonde ses hypothèses de recherche sur des savoirs investis par des croyances et des connaissances. Il met en doute sa propre vision du monde pour tenter d’appréhender le monde sous un nouveau paradigme qu’il aura contribué à créer. Pour autant, le parcours menant à la découverte d’un nouveau paradigme peut passer par des moments de crise. Les sciences sont confrontées à des controverses, « lot commun de la fabrication des savoirs, en tant qu’elle est structurante parce qu’au cœur des pratiques ordinaires et nécessaires de la science » (PESTRE, 2007 : 30). En d’autres termes, la controverse est constitutive d’une science légitime. Mais que se passe-t-il lorsque cette controverse se déporte vers l’arène médiatique ? Dans ce contexte, nous nous intéressons à l’analyse des controverses que LATOUR (1989) met en mots. Selon LEMIEUX, il cherche à comprendre « comment des pratiques de laboratoire en viennent à devenir des vérités socialement acceptées, comment elles en viennent à faire advenir un nouveau monde puis à peser sur lui et le transformer » (195). Cette conception de l’analyse des controverses permet de mettre au jour ce que nous appelons « le petit théâtre du climat français », c’est-à-dire les acteurs jouant un rôle dans la médiatisation de la controverse en France, les espaces et sphères dans lesquels se déroule la controverse, et les rapports de force qui en résultent.
Une controverse « renvoie à des situations où un différend entre deux parties est mis en scène devant un public, tiers dès lors placé en position de juge » (LEMIEUX, 2007 : 199). Elle revêt un caractère triadique : les deux groupes d’adversaires, et le public juge, constitué soit de pairs, en l’occurrence des scientifiques, soit d’une instance de pouvoir, soit de profanes, par l’entremise des
5 « If the quantity of carbonic acid increases in geometric progression, the augmentation of the temperature will increase nearly in arithmetic progression ».
193
médias : « Le développement des moyens de communication […] permet aux membres de ces différentes sphères […] de solliciter des appuis parmi les profanes (via les journaux, la radio, la télévision) » (LEMIEUX, 2007 : 199). Ainsi LEMIEUX propose-t-il d’appréhender la controverse en termes de dynamique de confinement et de publicisation6.
Dans un premier temps, nous observons la situation idéale de la controverse, telle qu’elle est souhaitée par le GIEC. Cette institution a pour mission d’évaluer sans parti pris et de façon méthodique les informations scientifiques, techniques et socio-économiques nécessaires pour comprendre les fondements scientifiques des risques liés au changement climatique d’origine humaine, et de cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement, pour ensuite envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation7. Cette instance composée de scientifiques ne fait pas de recherches : elle les synthétise, et prend le parti de communiquer vers « les décideurs » de manière consensuelle, ce malgré les débats ayant eu lieu en assemblée. Largement publicisée, la synthèse rédigée à l’attention des décideurs constitue le socle de connaissances sur lequel se fondent les négociations politiques internationales lors des Conférences des Parties. La controverse reste dans la sphère scientifique, le GIEC jouant dans ce contexte idéalisé le rôle du juge.
Dans un second temps, la controverse sort de son confinement pour interpeller les médias. Concernant la controverse climatique, un groupe de scientifiques décide de prendre la parole en outrepassant les procédures de validation scientifique, puisqu’ils communiquent directement au travers des médias, déplaçant ainsi le rôle de juge vers les profanes. Ces « climato-sceptiques » sont, selon les études en cours de GUILLEMOT, COMBY et AYKUT8, répartis en trois groupes. Le premier groupe de sceptiques rallie des scientifiques ayant une activité de recherche dans des sciences
6 Pour une théorisation du concept de « confinement », voir aussi CALLON et al. (2001). 7 Définition en partie issue du site Internet du GIEC : http://www.ipcc.ch/ home_languages_main_french.htm#1 8 Informations recueillies au séminaire de recherche du Centre Alexandre Koyré, dirigé par Amy DAHAN (16 mars 2010) : Controverse et changement climatique.
194
similaires à la science du climat9. Le deuxième groupe est représenté par des scientifiques hors du cercle de la climatologie et la critiquant : il s’agit selon eux d’une science jeune, qui n’a encore atteint son degré de maturité ni au niveau théorique, ni au niveau méthodologique. Le troisième groupe est constitué d’intellectuels émettant des opinions sur le sujet directement dans les médias10.
Dans un troisième temps, et par rétroaction, les scientifiques parties prenantes au sein du GIEC suivent le même parcours emprunté par les détracteurs de leurs travaux. Ils s’adressent directement aux médias et aux profanes sans utiliser la traditionnelle vulgarisation scientifique, type de discours employé lorsqu’il s’agit de transmettre des savoirs scientifiques à un public profane. Ils acceptent donc cette modification de « juge » des pairs (GIEC) vers les profanes (ou du moins vers les médias). Il est cependant à noter que la sphère politique ne prend pas part à la diffusion de la controverse médiatique, même si le détracteur le plus célèbre du travail des climatologues revêt maintenant un rôle politique. En effet, la synthèse à l’intention des décideurs ne montre à voir que très peu d’aspects controversés du problème climatique, et c’est de manière unanime que la classe politique française accepte les conclusions émises par le GIEC. Il n’existe pas, dans la sphère politique française, de contre-courant climato-sceptique.
Ainsi, les entités qui prennent la parole pour parler de la controverse climatique se sont multipliées. Les médias de vulgarisation, mais également les médias plus traditionnels, relayent cette polémique sur de nombreux supports. Prenant l’exemple de la presse quotidienne nationale (PQN) française, avant 1995, année de parution du deuxième rapport du GIEC, seulement deux des huit journaux nationaux11 relayaient l’information liée au climat : Le Monde et Les Echos. En 1995, on voit apparaître La Croix, La Tribune et Libération. Il faudra
9 Sciences du climat, paléoclimatologie, géophysique, géographie, géologie, économie, histoire des sciences… 10 Une spécificité française : les climato-sceptiques ne sont portés ni soutenus par aucune entité. Il n’existe à notre connaissance aucune contre-expertise française. 11 Aujourd’hui en France, La Croix, Les Echos, Le Figaro, Libération, L’Humanité, Le Monde, La Tribune.
195
attendre 1997 et la signature du Protocole de Kyoto pour que Le Figaro s’intéresse au problème climatique, 1999 pour L’Humanité et 2005 pour Aujourd’hui en France.
Schéma n°1 : Fréquence d’apparition de la notion « effet de serre » dans la PQN française depuis 198712
12 NB : les graphiques, schémas et tableaux présents dans cet article ont été construits et élaborés par nos soins.
196
En ne se fondant que sur la PQN française, force est de constater que les deux premières propriétés du concept de formule peuvent être assimilées à la notion de changement climatique. Commençons par la multiplicité des usages : le nombre d’articles publiés dans la seule PQN est nettement en hausse, tout comme le nombre de journaux s’intéressant à la problématique. Nous pouvons également remarquer deux moments forts, correspondant à l’apparition de deux termes dérivés liés à la controverse : 2007 avec l’apparition de « climato-sceptique » en parallèle de la parution du quatrième rapport du GIEC, et 2009 pour le mot « climate-gate », dérivé utilisé dès qu’un scandale d’ordre politique ou financier est révélé par la presse (cf. « Watergate » à l’origine de la notion en 1970 aux USA, « Angolagate » dans les années 1990 en France, ou « Rubygate » en 2011 en Italie). L’apparition de ce terme permet également de valider le caractère polémique de l’enjeu climatique. Ces trois points seront à vérifier par des analyses discursives plus poussées, cependant, nous pouvons d’ores et déjà formuler l’hypothèse que le caractère formulaire de la notion de changement climatique est bien à l’œuvre dans les médias français entre 2007 et 2010.
Dans une vision plus élargie des médias, et suite à l’observation des médias dans leur ensemble entre 2007 et 2010, nous pouvons délimiter un certain nombre de types discursifs qui nous intéressent pour structurer notre corpus : les discours allant de la didacticité (aspect pédagogique) à la narrativité (aspect dramatique). La construction de cet axe est la première étape de structuration des données à analyser, la trame de fond des corpus.
Schéma n°2 : Organisation des discours de transmission de connaissances scientifiques
197
LES CORPUS : QUELS OUTILS POUR HOMOGENEISER LEUR MULTIPLICITE ?
Le corpus est une simulation construite de l’objet de recherche, simulacre d’une certaine réalité que nous nous proposons d’étudier. En tant que tel, il doit répondre à un certain nombre de critères liés à la pertinence de l’analyse, à la représentativité de cette réalité, et au caractère exhaustif de l’échantillon. Selon le Dictionnaire de la linguistique de MOUNIN, « le corpus est un ensemble d’énoncés écrits ou enregistrés dont on se sert pour la description linguistique » (1974 : 89). DUBOIS complète cette définition : « Le corpus lui-même ne peut pas être considéré comme constituant la langue, mais seulement comme un échantillon de la langue » (1973 : 128). Il explique en outre que l’exhaustivité du corpus ne peut jamais être atteinte de par le caractère dynamique de toute langue. Il évacue la difficulté émanant de l’exhaustivité13 sans pour autant régler celle de la représentativité, qui pose le problème de la subjectivité de la recherche, et donc des choix opérés par le chercheur lors de la construction du corpus. GREIMAS parle du « caractère intuitif des décisions que le descripteur sera amené à prendre à cette étape de l’analyse » (1986 : 142). Et d’expliquer « qu’un certain nombre de précautions et de conseils pratiques doivent donc entourer ce choix, afin de réduire, autant que possible, la part de subjectivité qui s’y manifeste » (143). Précautions liées à la représentativité comme vu plus haut, et à l’homogénéité du corpus, qui semble dépendre des paramètres extrinsèques à l’acte de langage. Car la question se pose ici de savoir comment appréhender des données qui n’émanent pas des mêmes médias, qui ne recourent pas au même type de discours, qui sont assumées par des émetteurs différents et reçues par des récepteurs très variés. GREIMAS n’en dit pas plus à ce propos.
Pour HOUDEBINE, « le corpus est l’ensemble des données que le sémiologue construit en objet pour mener l’analyse sémiologique »
13 Il est à noter que l’exhaustivité s’applique au corpus une fois que ce dernier est construit et clos : c’est le principe d’immanence. Tous les éléments du corpus doivent être soumis à l’analyse de la même manière afin de prétendre à une véritable scientificité. MILNER l’explique en ces termes : « La théorie du corpus ne doit prendre en considération que les données du corpus, et elle doit prendre en considération toutes les données du corpus » (1989 : 120).
198
(HOUDEBINE, BRUNETIERE, 1994 : 273). Elle intègre pleinement le chercheur dans le processus de constitution du corpus, palliant ainsi la problématique de subjectivité : le caractère structural de la sémiologie des indices permet d’amoindrir cette subjectivité, tout en l’assumant comme telle. Selon la linguiste, le corpus s’homogénéise en fonction de critères de pertinence, ou des choix opérés et justifiés également par le chercheur. Ainsi, pouvons-nous avancer que le corpus s’homogénéise par le point de vue de recherche adopté, et que la représentativité est légitimée au travers de ces critères de pertinence. Les critères, internes ou externes au corpus, sont « les entrées qui permettent d’extraire du vaste champ de la réalité sociale des données » (273). Les critères internes peuvent être une expression (développement durable ou réchauffement climatique), un mot (enfant ou femme), une image qui revient régulièrement lorsqu’un sujet est abordé14. Les critères externes peuvent être référentiels (alcool, voiture), sociologiques (thématiques précises comme le sport), ou psychologiques (documents provoquant un affect particulier, comme le malaise), le chercheur faisant ici appel à l’ensemble des sciences humaines et sociales pour délimiter son corpus. Une fois ces critères établis et expliqués, le corpus peut se faire valoir comme représentant de l’objet de recherche. KRIEG-PLANQUE précise que la formule se repère dans des usages médiatiques très variés. Afin de représenter la diversité de la notion « changement climatique », nous devons multiplier les messages médiatiques de natures différentes dans lesquels apparaissent la notion, ses dérivés et ses synonymes. Cela multiplie d’autant le nombre de corpus à prendre en compte dans l’analyse. L’autre spécificité de notre recherche tient dans le fait que nous tentons d’analyser de manière séparée le texte et l’image, selon la proposition d’HOUDEBINE. Alors qu’elle revisite l’image Panzani étudiée par Roland BARTHES dans sa Rhétorique de l’image, HOUDEBINE reprend cette idée de BARTHES d’étudier le corpus en le stratifiant15. Elle suggère ainsi d’analyser de manière séparée la mise en scène, les couleurs, le référent iconique, et enfin le texte, système le plus signifiant selon elle (1994 : 59-60). Nous appliquerons la stratification à l’ensemble des corpus, considérant
14 Prenons ici pour exemple l’ours polaire pour le changement climatique. 15 Rappelons que la stratification est un concept proposé par HJELMSLEV (1984).
199
que texte et image constituent des corpus séparés, afin de pouvoir suivre notre parcours analytique, comme expliqué plus haut. Ainsi, pour chaque type de discours dégagé dans l’axe de recherche construit en amont (cf. schéma n°2), devons-nous nous assurer que les images et textes sélectionnés selon les critères de pertinence représentent bien à chaque fois le même type de discours.
L’apparente complexité de la constitution de nos corpus nous pousse à explorer une nouvelle manière de définir nos critères de sélection, notamment eu égard à la variété des discours sollicités. Tandis que les critères internes sont d’ordre linguistique, les critères externes doivent recourir à des éléments extralinguistiques. Patrick CHARAUDEAU considère que le sens naît à la jonction de l’intra et de l’extralinguistique. Il a conceptualisé sous le nom de « contrat de communication » l’ensemble des données extralinguistiques utiles à l’étude du sens. Nous considérons que ce concept peut également être un précieux outil pour l’élaboration de critères externes communs au texte et à l’image, en fonction de chaque type de discours. Les éléments délimitant le contrat de communication d’un type de discours permettent ainsi d’homogénéiser les corpus.
Selon CHARAUDEAU, il n’existe pas d’acte de langage en dehors d’un contexte. La langue s’inscrit dans une situation de communication, qu’il définit comme un cadre de contraintes psychosociales, un ensemble de conventions nécessaires, mais pas suffisantes à l’acte de langage. A force de récurrence d’usages, CHARAUDEAU a observé que ces situations pouvaient devenir des contrats de communication, assimilables à des types de discours, en fonction de certaines constantes qui permettent de structurer l’échange verbal, et reconnu par tous (12-13). Ce contrat de communication, « ordonnateur » d’un certain nombre d’instructions discursives utiles à la production et à l’interprétation de l’acte de langage, est constitué de quatre grandes classes (110) : la finalité du discours, sa visée ; l’identité sociale des communicants, leurs statuts, les rapports de force qu’ils entretiennent ; vient ensuite le propos de l’acte de discours, le domaine de savoir, le macro-thème et les micro-thèmes ; enfin, CHARAUDEAU s’intéresse aux circonstances matérielles de l’acte, le dispositif scénique, le lieu, le moment du discours.
200
Etudiant les discours médiatiques liés à la transmission de connaissances, CHARAUDEAU a pu ainsi élaborer le contrat de communication spécifique aux discours scientifiques, et ceux liés aux discours de vulgarisation, se scindant entre des situations tantôt didactiques, tantôt médiatiques. Il estime que les discours sont marqués différemment selon la finalité des supports dans lesquels ils apparaissent. Si le journal en question se réclame de la vulgarisation scientifique, son objectif sera plus didactique. A l’inverse, s’il s’agit d’un journal d’information généraliste, l’objectif sera plus lié à la captation du public. Selon CHARAUDEAU, dès lors qu’une information scientifique passe dans un média d’information, il ne s’agit plus exactement de vulgarisation, mais de médiatisation scientifique, qui devient une forme de vulgarisation dans laquelle l’aspect didactique du discours est réduit au profit de son aspect attractif, afin de répondre aux normes économiques du marché des médias. Son objectif est de raconter la science, de faire découvrir une vérité scientifique au travers d’une histoire. A l’inverse de la vulgarisation scientifique, apparaissant dans des médias s’en réclamant (Science et vie, La Recherche, etc.), la médiatisation d’un fait scientifique prend une place particulière dans l’axe de recherche proposé, car le contrat de communication de ce type de discours est hybride : il doit transmettre des informations d’ordre scientifique, mais son objectif est de former l’opinion du citoyen sur des sujets scientifiques qui pourraient soulever un débat. En cela, le discours de médiatisation scientifique concerne le cadre du politique, car les objets scientifiques médiatisés relèvent de faits de société qui touchent la santé, l’environnement, l’alimentation. L’objet de savoir, par nature scientifiquement non stable car débattu dans l’espace public, est dissocié de sa discipline et érigé en événement pour capter l’attention. On assiste alors à une désacralisation de l’objet de science, et de la science par là même (CHARAUDEAU, 2008 : 13).
Tout comme la publicité à l’égard d’un produit, la manchette d’un journal, appelée également « Une », tente de pousser à l’acte d’achat, répondant ainsi aux exigences commerciales des médias. Cette Une doit donc susciter intérêt et émotion, afin de sensibiliser le consommateur potentiel du journal. Concernant la presse quotidienne, BURGER (2006) montre que la visée de captation est
201
assumée par la titraille présente en Une et en début d’article, tandis que le corps du texte sert la finalité didactique du média, transformant ainsi le consommateur-lecteur en citoyen-lecteur. Nous pensons pour notre part que la double finalité ambiguë du média d’information est portée par l’ensemble des espaces alloués à un thème. Captation et pédagogie sont investies selon un continuum, eu égard à la mise en narration établie. Ces finalités sont mises au service de l’histoire racontée par le média en question. La Une serait donc la première phase de mise en narration dans l’unité spatiale du journal, et visible dès le premier instant par le lecteur-consommateur-citoyen, ainsi sensibilisé. Pour les raisons que nous venons d’évoquer, notre corpus se limitera donc aux journaux et magazines hebdomadaires qui annoncent en Une un texte sur le changement climatique.
Ainsi, notre axe de structuration des corpus se modifie-t-il en fonction des différents contrats de communication mis au jour par CHARAUDEAU.
Schéma n°3 : Les différents contrats de communication
Le dernier contrat n’a pas été étudié par CHARAUDEAU. Nous avons pour objectif d’élaborer ce contrat en fonction de nos propres observations, sur le modèle de ce dernier. Aussi, nous ne le traiterons pas dans cette contribution. Il semblerait cependant que le changement climatique ne soit pas le macro-thème de ce contrat, mais plutôt un prétexte à la narration, à l’image du film Waterworld (réalisé en 1995 par Kevin REYNOLDS). Le
202
changement climatique n’est qu’un élément mineur d’une mise en narration plus vaste, qu’il s’agisse d’un film, d’un roman ou d’affiches publicitaires. APPLICATIONS : QUELS CRITERES DE SELECTIONS ? QUELLE TEMPORALITE ? QUELLES DONNEES ?
La question préalable à toute analyse est de savoir quelles notions seraient susceptibles d’accéder au rang de formule. La première étape d’analyse, avant même les études quantitatives, serait donc une étude lexicale et sémantique afin de bien comprendre les univers de sens alloués au changement climatique dès sa définition. Le terme « climat » vient du latin clima, embrassant à l’origine le sens d’« inclinaison de la calotte céleste ». Il désigne « une zone terrestre déterminée par des facteurs géographiques » (REY, 1992 : 778). Au XVIIIe siècle, sa définition le qualifie « d’ensemble des conditions atmosphériques et météorologiques d’un lieu »(idem), reléguant la définition de lieu au second plan. Depuis lors et jusqu’à maintenant, la définition n’a pas changé. Aucun des dictionnaires consultés ne fait état des avancées scientifiques en climatologie sur les changements du climat. Premier constat : l’aspect scientifique du changement climatique n’est pas encore entré dans la norme que représentent les dictionnaires en langue française. C’est donc au sein de son domaine originel, la science, que nous cherchons la définition de l’expression « changement climatique », au travers d’un glossaire issu du site Internet du CNRS. Nous avons pu vérifier, suite aux analyses lexico-sémantiques et quantitatives de la PQN, que le terme clé qui définit le changement climatique dans l’ensemble des journaux depuis 1987 jusqu’à maintenant était « effet de serre »16. Ce terme apparaît en premier lieu dans la presse en 1987, et réapparaît avec une récurrence formidable dès qu’il y est question de changement climatique. « Effet de serre » sera donc le critère de pertinence interne à prendre en compte pour la sélection des corpus. Ajoutons à ce terme ses synonymes et dérivés mis au jour dans l’étude lexico-sémantique : méthane (CH4), dioxyde de carbone (CO2), gaz à effet de serre, climat, changements climatiques, variations climatiques, scénario climatique, etc. Cette
16 Voir également à ce propos l’article de Ferenc FODOR (2010).
203
liste, non exhaustive, est susceptible de s’allonger en fonction de potentielles découvertes d’ordre sémantique et lexical.
Si le repérage d’usages particuliers d’une notion se fait dans un temps long, au travers d’analyses quantitatives notamment, l’intérêt d’une recherche d’ordre qualitatif se pose dès lors que le linguiste a identifié le temps d’utilisation d’une formule, temps qui se révèle forcément plus réduit que celui de la construction de la formule, car « la formule prend place dans un continuum » (KRIEG-PLANQUE, 2009 : 115). Ainsi, les analyses suivantes sont-elles d’ordre quantitatif, et débutent au moment de l’apparition de la notion d’« effet de serre » dans le champ médiatique, c’est-à-dire en 1987. L’objectif est ensuite de se concentrer sur le moment pendant lequel la notion de changement climatique devient hypothétiquement formule. Sophie MOIRAND nomme cette période un « moment discursif », observant une multiplication nette des usages d’une expression, de ses synonymes et dérivés dans les médias (2007 : 133-134). Nous avons pu observer dans le schéma n°1 deux temps susceptibles de représenter ce « moment discursif ». Cependant, le premier temps date de 2007, lors de la parution du quatrième rapport du GIEC, période clé de l’histoire de la notion de changement climatique controversé s’il en est. Or, rappelons que notre hypothèse de départ repose sur l’idée que son aspect controversé permet à l’enjeu climatique de perdurer dans les médias sans événement international de grande ampleur. Nos observations de la presse nationale française nous permettent de conclure que le pic d’usages de la notion dans les médias fin 2009-début 2010 pourrait constituer une temporalité intéressante à étudier de ce point de vue. S’il est vrai qu’une Conférence des Parties est organisée en décembre de chaque année, nous n’avons pas remarqué de fluctuation particulière lors des mois de décembre précédent l’année 2009. En cela, la période entre octobre 2009 et avril 2010 semble pertinente pour l’analyse des médias, car marquée par une controverse scientifico-médiatique d’une part, et assez étendue dans le temps pour permettre à la notion de circuler dans différents médias d’autre part, qu’ils soient exclusivement scientifiques, de vulgarisation, d’information ou issus de l’industrie culturelle.
Nos corpus doivent se définir en fonction de types de discours mis au jour sur l’axe de structuration didacticité / narrativité.
204
L’homogénéisation de ces corpus s’établit au travers d’un ou de plusieurs éléments reconnaissables dans les contrats de communication de chaque type de discours, et traçables dans les médias invoqués.
L’élément du contrat de communication scientifique se fonde sur les instances de production et de réception, toutes issues de la même sphère de savoirs. En effet, lorsqu’un scientifique produit un discours, il s’adresse à ses pairs, d’autres scientifiques, qui partagent a priori les mêmes connaissances. Le premier type de discours à analyser s’homogénéise non seulement sur le critère interne lexical révélé plus haut, mais également sur l’instance d’émission (un scientifique, ou un groupe de scientifiques, ou un laboratoire de recherche), et l’instance de réception (encore un scientifique, un groupe ou un laboratoire). Ainsi, le premier groupe de corpus lié aux discours scientifiques se compose-t-il de textes et images émanant de scientifiques pour des scientifiques. Selon l’ensemble de ces critères, notre corpus discursif et iconique scientifique se compose de quatre présentations PowerPoint et de deux documents émanant de l’Académie des Sciences française. A l’heure actuelle, quasiment tous les chercheurs se prêtent au jeu de la présentation soutenue par un document PowerPoint, permettant d’illustrer les propos de l’orateur, de noter les idées-clés et les chiffres les plus parlants pour prouver ses propos. Car n’oublions pas que tout discours scientifique cherche avant tout à établir une vérité au moyen de preuves et d’argumentation. Vu son caractère visuel, une présentation PowerPoint sert aussi bien le corpus verbal que le corpus iconique. Les présentations liées aux quatre PowerPoint sélectionnés ont eu lieu dans l’année 2010, deux réalisées par des scientifiques reconnus comme des climato-sceptiques : Vincent COURTILLOT et Martine TABEAUD, et les deux autres par des scientifiques travaillant pour et avec le GIEC : Jean JOUZEL et Hervé LE TREUT. Les deux documents suivants ont été édités par l’Académie des Sciences, qui publie très régulièrement des fascicules sur des problématiques scientifiques afin d’en informer la communauté scientifique dans son ensemble. Dans le cadre de notre travail, nous avons pris la décision d’analyser un document de dix-neuf pages résumant les connaissances et incertitudes liées au climat édité en octobre 2010, ainsi qu’un fascicule datant de novembre 2009 intitulé Libre point
205
de vue d’académiciens sur l’environnement et le développement durable. Ce document ne traite pas spécifiquement du changement climatique, mais il offre l’avantage de regrouper des points de vue divergents sur différentes thématiques scientifiques, dont le changement climatique. Par ailleurs, seul le premier chapitre de ce document, « Les évolutions du climat » (1-24), nous intéresse pour notre analyse des discours scientifiques.
Concernant le type de discours vulgarisation scientifique, il apparaît que l’élément homogénéisant des corpus reste la visée du discours : porter à la connaissance du public des vérités scientifiques. L’aspect didactique est dominant dans ce genre de discours. Aussi pensons-nous que les médias se revendiquant de vulgarisation scientifique, dont la finalité du propos est clairement établie en amont, entrent complètement dans le cadre de notre recherche sur ce type de discours. Un certain type de presse se revendique de vulgarisation scientifique ; elle est classée dans la thématique « sciences » et s’adresse à tous les lecteurs de presse. Dans les quatorze titres de magazines classés dans cette thématique, la moitié s’intéresse à un domaine scientifique spécifique (psychologie, sociologie, aéronautique, espace, informatique, mathématiques). Nous nous fondons donc sur les magazines scientifiques dits généralistes : sept titres de presse (Pour la science, Science et vie, Sciences et avenir, La Recherche, L’essentiel de la science, Science magazine, Science Revue), ainsi que les éditions spéciales (Dossiers pour la science, Les cahiers de science et vie, Les dossiers de la Recherche).
Comme expliqué plus haut, nous nous sommes intéressée aux numéros qui faisaient remonter l’enjeu climatique en Une, d’octobre 2009 à avril 2010. Nous avons pu sélectionner six numéros de magazines scientifiques destinés au grand public et qui faisaient de l’enjeu climatique leur macro-thème :
1- Pour la science n°388 – « La montée des océans, jusqu’où ? », fév. 2010.
2- Pour la science n°390 – « Méthane : un péril fait surface », avr. 2010.
3- Science et vie n°1110 – « Spécial Climat », juin 2010. 4- Science et vie édition spéciale – « Climat », dernier
trimestre 2009. 5- Sciences et avenir – « Contrôler le climat », déc. 2009.
206
6- L’essentiel de la science n°8 – « Dossier spécial changement climatique », déc. 2009, jan.-fév. 2010.
Nous intégrons à notre analyse non seulement les unes, mais également les articles et illustrations, et tout élément traitant du climat à l’intérieur des pages.
Le contrat de communication lié à la médiatisation scientifique pose problème de par son ambiguïté latente. Le discours de médiatisation scientifique doit être à la fois explicatif et produire ses propres stratégies de captation pour forger sa crédibilité car il n’apparaît pas comme légitime à l’inverse d’un discours de vulgarisation scientifique. Dans ce contexte de contrat de communication hybride, le point stable sur lequel nous pouvons nous fonder pour développer un critère de pertinence externe reste la visée du discours. Nous devons sélectionner les médias selon leur fonction affichée et assumée : informer pour former l’opinion et susciter le débat autour d’une question scientifique. La presse quotidienne nationale et le magazine d’actualité répondent pleinement aux attentes de construction de notre corpus. Gardons comme repère le critère lexical interne et le fait de ne retenir que les journaux nationaux d’information et magazines hebdomadaires d’actualité qui font remonter en Une l’enjeu climatique entre octobre 2009 et avril 2010. Quarante-cinq unités de journaux sont ainsi répertoriées, comprenant tous texte et images.
Tableau n°4 : Présentation sommaire du corpus de médiatisation scientifique
Titre journal ou magazine Nombre de journaux Aujourd’hui en France 3 Charlie Hebdo 1 La Tribune 1 Le Figaro 3 Le Figaro Magazine 1 Le Monde 16 Le Nouvel Observateur 3 Les Echos 9 L’Express 1 Libération 3 Marianne 1 Paris-Match 2
207
Enfin, comme énoncé plus haut, nous ne nous avançons pas encore à déterminer plus avant le corpus que nous avons nommé « de réappropriation culturelle », car les situations de communication propres à ce contrat sont en cours d’observation afin de déterminer ses éléments constitutifs, sur lesquels nous nous appuyons en partie pour déterminer ce corpus.
CONCLUSION
Cet article ne présente pas un corpus clos et prêt à l’analyse : nous avons montré que le processus de recueil des données demande du temps et incite à une réflexion plus générale sur les théories prises à partie dans le travail de recherche. Quoique les critères de pertinence invoqués soient tous justifiés et stabilisés, il ne nous paraît pas improbable que la réflexion continue d’évoluer en fonction des résultats obtenus lors du recueil des données pour le contrat de réappropriation culturelle. Aussi avons-nous présenté dans cette contribution une simple étape de la construction du corpus.
Lors de la phase d’observation des données afin de construire notre corpus de médiatisation scientifique, nous avons pu voir que de nombreux journaux et magazines abordaient l’enjeu climatique sans que le thème apparaisse nécessairement en Une. Ces données participent également à la construction de l’imaginaire du changement climatique dans l’espace public, et pourraient tout à fait constituer un corpus connexe, nécessaire pour valider des hypothèses, notamment celles en lien avec la présence de l’enjeu en Une. Dans cette perspective, nous avons pu observer qu’un magazine d’actualité, Le Point, n’abordait jamais la problématique du climat en Une. Cependant, de nombreux éditos et articles reprenaient l’actualité du moment, notamment la COP de Copenhague, lors de la parution des magazines les 3, 17 et 22 décembre 2009, mais également très régulièrement en janvier, février et mars 2010. Cette récurrence, malgré l’absence du thème en Une, peut paraître intéressante à analyser, d’autant que Le Point publie habituellement des chroniques écrites par Claude ALLEGRE, ainsi que par Sylvie BRUNEL, climato-sceptiques notoires. Le Point pourrait ainsi constituer une unité de sous-corpus intéressante de par ce positionnement périphérique.
208
Schéma n°5 : Les corpus
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ARRHENIUS Svante, 1896, « On the Influence of Carbonic Acid in the Air
upon the Temperature of the Ground », Philosophical Magazine and Journal of Science, vol. 5, no41, pp. 237-276
BARTHES Roland, 1991, L’aventure sémiologique, Paris, Le Seuil, coll. « Points Essais », 360 pages
CALLON Michel, LASCOUMES Pierre, BARTHE Yannick, 2001, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Le Seuil
CHARAUDEAU Patrick, 2008, La médiatisation de la science. Clonage, OGM, manipulations génétiques, Bruxelles, De Boeck INA, 128 pages
COMBY Jean-Baptiste, 2008, Créer un climat favorable, Thèse de sciences sociales en information et communication sous la direction de Rémy Rieffel, Institut Français de Presse et Université Paris 2, 460 pages
DUBOIS Jean, 1973, Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse, 516 pages
EBEL Marianne, FIALA Pierre, 1983, Sous le consensus, la xénophobie, Lausanne, Institut de Science Politique, coll. « Mémoires et documents », 434 pages
FAYE Jean-Pierre, 1972, Langages totalitaires, Paris, Hermann, 771 pages
209
FODOR Ferenc, 2010, « Le défi climatique raconté par les médias », Politique de l’image, n°3
FODOR Ferenc (sd), 2007, L’observatoire sociétal. Changement climatique : entre prise de conscience et nécessité d’agir, Paris, document EDF R&D, 16 pages
GREIMAS Algirdas Julien, 2002 [1986], Sémantique structurale, Paris, PUF, 262 pages
HJELMSLEV Louis, 1984, Prolégomènes à une théorie du langage, Paris, Editions de Minuit , 231 pages
HOUDEBINE Anne-Marie, 1999, « Actualité de la sémiologie », in Christiane Legris-Desportes et Béatrice Fraenkel (sd), Sémiologie en entreprise, Paris, Dunod, pp. 215-234
HOUDEBINE Anne-Marie, 1994, « Panzani revisitée. Etude de sémiologie iconique », Médiascope, n°8 : « La publicité masque et miroirs », pp. 58-68
HOUDEBINE Anne-Marie, 1985, « Pour une linguistique synchronique dynamique », La linguistique 21 la linguistique fonctionnelle, pp. 7-36
HOUDEBINE Anne-Marie, BRUNETIERE Valérie, 1994, « Annexe 3 : Démarches – méthodologie », Travaux de linguistique, n°5/6, Université d’Angers, 334 pages, pp. 273-276
KRIEG-PLANQUE Alice, 2010, « La formule “développement durableˮ : un opérateur de neutralisation de la conflictualité », Langage et société, n°134 Varia, Maison des Sciences de l’homme, pp. 5-30
KRIEG-PLANQUE Alice, 2009, La notion de formule en analyse du discours, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 144 pages
KRIEG-PLANQUE Alice, 2007, « Travailler les discours dans la pluridisciplinarité. Exemple d’une “manière de faireˮ en analyse de discours », in Simone Bonnafous et Malika Temmar (sd), Analyse du discours et sciences humaines et sociales, Paris, Ophrys, pp. 57-71
LATOUR Bruno, 1989, La science en action, Paris, La Découverte LEMIEUX Cyril, 2007, « A quoi sert l’analyse des controverses », Mil neuf
cent, n°25 : « Comment on se dispute. Les formes de la controverse », pp. 191-212
MARTINET André, 1990, « La synchronie dynamique », La linguistique 26/2, PUF, pp. 13-23
MARTINET André, 1970, Eléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 221 pages
MILNER Jean-Claude, 1995 [1989], Introduction à une science du langage, Paris, Le Seuil, coll. « Points », 313 pages
MOUNIN Georges, 1974, Dictionnaire de la linguistique, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 340 pages
210
MOIRAND Sophie, 2007, Les discours de la presse quotidienne, Paris, PUF, 179 pages
PESTRE Dominique, 2007, « L’analyse des controverses dans l’étude des sciences depuis 30 ans », in Mil neuf cent, n°25 : « Comment on se dispute. Les formes de la controverse », pp. 29-43
REY Alain, 1992, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Robert, tome 1, 1381 pages
SAUSSURE Ferdinand de, 2005 [1916], Cours de linguistique générale, Textes et cours mis en forme et publiés par Charles Bally et Albert Sechehaye, Paris, Payot, 520 pages
WOLTON Dominique, 1991, « Les contradictions de l’espace public médiatisé », Hermes, n°10, pp. 95-114