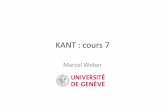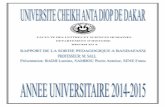Nouvelles méthodes pour l'analyse spatiale des sites archéologiques
Panorama des méthodes d’exégèse moderne et post-moderne du Qohélet
Transcript of Panorama des méthodes d’exégèse moderne et post-moderne du Qohélet
PAUL-MARIE FIDÈLE CHANGO, OP
15
Panorama des méthodes d’exégèse
moderne et post-moderne du Qohélet
L'une des deux questions majeures sur lesquelles s'est clos notre
précédent chapitre est : à quelle période de l’histoire d’Israël peut-on situer la
composition du Qohélet ? En y répondant il ne s'agira pas d'enfoncer une porte
ouverte en reprenant toute la question de la dation et de l'auteur du livre. On se
limitera simplement à élucider le plus rigoureusement possible les résultats qui,
en la matière, recueillent aujourd'hui l'adhésion majoritaire des exégètes.
De toute évidence, une telle étude n’est pas réalisable si la maîtrise des
méthodes exégétiques n’est pas de mise.
C'est pourquoi, un parcours assez rapide de la plupart des méthodes
exégétiques modernes et post-modernes bien connues nous permettra de mettre
suffisamment en lumière les réponses largement consensuelles des exégètes
dont nous faisons nôtres les enquêtes sur les questions de la datation de la
composition du livre. Ceci donnera l'occasion d'élucider la démarche
exégétique qui orientera nos propos au fil de ce cours.
2. 1 – Panorama des méthodes exégétiques d’analyse
du texte
Il existe différentes approches scientifiques pour étudier un texte
biblique. Les méthodes exégétiques les plus connues de nos jours se regroupent
en 4 grands ensembles :
2. 1. 1 – Les méthodes synchroniques comme :
• L’analyse narrative ou narratologique
• L’intertextualité ou l’analyse canonique du texte
PAUL-MARIE FIDÈLE CHANGO, OP
16
2. 1. 2 –Les méthodes diachroniques qui sont :
• La critique des formes du texte
• La critique du genre littéraire du texte
• L’analyse rhétorique du texte
• La critique littéraire ou la critique des sourcesou la recherche la
préhistoire écrite du texte
• La critique ou l’analyse comparative
• La critique de la transmission des traditions du texte
• La critique de la composition et de la rédaction du texte
(Redaktionsgeschichte)
2. 1. 3 –La méthode anachro-synchronique à savoir :
• L’analyse pragmatique
2. 1. 4 –Les méthodes achroniques comme :
• L’analyse structuraliste
• L’analyse sémiotique
Au terme de cette énumération, une question demeure : quels sont,
d’une part, les éléments de convergence et, d’autre part, les spécificités de ces
différentes méthodes d’analyse exégétique ?
2. 2 – Convergences des méthodes d’analyse
exégétique : la critique de la constitution du texte
Toutes les méthodes d’analyse exégétiques que nous avons citées plus
haut suivent des étapes qui les caractérisent et les spécifient conformément à
leurs objectifs.
PAUL-MARIE FIDÈLE CHANGO, OP
17
Cependant, il y a un point commun à toutes ces méthodes. Il s’agit de la
critique de la constitution du texte. Elle s’articule grosso modo autour de 9
éléments qui sont :
• La délimitation du texte
• L’Analyse linguistique, syntaxique et stylistique ;
• L’analyse philologique et sémantique
• La traduction du texte
• L’unité, la structure et segmentation du texte
• L’Analyse du contexte littéraire immédiat en amont et en aval
du texte
• L’Analyse du contexte littéraire global voire canonique du texte
• L’Analyse comparative synoptique du texte
• La critique textuelle ou la reconstruction du texte original
En un mot, la critique de la constitution du texte permet de mettre en
lumière la nature intrinsèque du texte. Elle précise le texte à étudier et en
dégage les articulations formelles et logiques.
Ses résultats rendent le chercheur davantage prompt à déterminer avec
précision les méthodes exégétiques spécifiques qui lui permettront d’atteindre
les objectifs de ses enquêtes.
Ceci dit, quelles sont les spécificités de chacune de ces méthodes
d’analyse évoquées plus haut ?
2. 3 –Spécificités des méthodes exégétiques
d’analyse du texte
Nous examinons toutes les méthodes en considérant chacune des
catégories mises en évidence plus haut : synchronique, puis achronique, puis
anachro-synchronique et enfin diachronique.
PAUL-MARIE FIDÈLE CHANGO, OP
18
2. 3.1 – Les méthodes synchroniques
Elles s’intéressent au texte dans sa facture finale. Le lecteur questionne
le texte tel qu’il se présente. Et le texte, par lui-même, livre son sens. Ainsi, on
observera que les quatre démarches synchroniques que nous donnons en
exemple se limitent strictement au texte lui-même comme signe et comme
source suffisante de signification ou de sens.
2. 3. 1. 1 – L’analyse narrative ou narratologique
L’analyse narratologique est née des études littéraires des contes russes.
En effet le russe Vladimir Propp avait rassemblé une vaste collection de
contes.
Puis, en les analysant minutieusement, il avait remarqué que la quasi-
totalité des récits étudiés avait une forme d’organisation identique.
Ce fut alors la découverte des cinq éléments de la subdivision classique
(quasi universelle) de la trame des contes et récits :
• l’exposition ;
• le commencement de l’action ;
• le climax ou la complication de l’action ou encore l'incident
déclencheur ;
• la résolution de l’action ;
• la conclusion.
L’analyse narratologique biblique (généralement appliquée aux textes
narratifs) s’attache donc à mettre en lumière la mise en récit du texte à partir de
ces cinq éléments ou schéma narratif autour desquels s’organisent la trame
d’une narration et l’intervention des personnages ou protagoniste d’un récit.
En définitive, dégager le schéma narratif qui fait ressortir les cinq
niveaux du récit, c'est mettre en lumière les moments clés de l'enchaînement
PAUL-MARIE FIDÈLE CHANGO, OP
19
des événements. Ainsi l’analyse narratologique permet de mieux prendre
conscience du climax qui est le moment important du texte.
Le schéma narratif peut être complété par la mise à jour du schéma
actanciel qui permet d’identifier les rapports de force qui s'instaure entre les
personnages et qui font avancer l'action dans la trame du récit.
En effet, le schéma actantiel comporte un sujet(héro), un destinateur
(émetteur), un objet (objectif), un destinataire (récepteur), puis un adjuvant
(aidant) et un opposant (adversaire).
Bref, au regard de ces différents actants, le schéma actanciel fait
ressortir les relations : sujet — objet ; destinateur — destinataire ; opposant —
adjuvant ou favori.
Un exemple classique est souvent évoqué pour illustrer ces différents
rapports : Un vieil homme (émetteur et récepteur) demande à son petit-fils
(héros) de lui cueillir une ravissante fleur (objet) fleurissant dans un cirque. Le
petit garçon devra vaincre le terrible lion du cirque (opposant), mais sera aidé
par son père (adjuvant).
Le récit de Joseph en Gn 37 est également illustratif et fort évocateur de
ces rapports dégagés par le schéma actantiel.
2. 3. 1. 2 – L’intertextualité ou l’analyse canonique du texte
Elle considère le contexte canonique de l'Écriture Sainte comme la
clef d'interprétation du texte. Ici « la Bible s’explique par la Bible ».
Le texte est alors examiné au regard de sa position et de sa fonction
dans le contexte global du canon biblique.
2. 3.2 – Les méthodes diachroniques
En ce qui concerne les méthodes diachroniques elles sont davantage
connues sous le nom de méthode d’exégèse historico-critique. Leur présupposé
est lié au réalisme du mystère de l’Incarnation : « et le Verbe s'est fait chair et
PAUL-MARIE FIDÈLE CHANGO, OP
20
il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de
son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité» (FBJ. Jn 1,14).
L’Histoire du Salut est une véritable Histoire et non pas une mythologie. En
conséquence, le fait historique est une dimension constitutive de la révélation
chrétienne biblique qui peut dès lors être assidûment étudiée avec les méthodes
de la recherche historique.
À cet effet, les méthodes diachroniques tiennent compte, non seulement
de l'histoire en tant qu'arrière-plan du texte, mais aussi de l’aspect historique
qui marque l’évolution du texte dans sa composition, dans son développement
et dans sa transmission.
2. 3.2. 1 – La critique du genre
Elle permet de situer le genre littéraire du texte (prophétique – oracle de
malheur ou de bénédiction –, poétique, narratif, etc.). Et, à partir des
conventions et des situations sociologiques appropriées à chaque genre
littéraires, elle peut repérer voire préciser le contexte historique de l’émission
du texte, etc.
2. 3.2. 2 – La critique des formes du texte
Pour Gunkel, l’un des fondateurs de la critique des formes
(« Formgeschichte », histoire des formes), tout texte relatif à un peuple est
nécessairement enraciné, à l’origine, dans une situation sociologique
particulière et dans un contexte historique précis. Et la forme du texte en
question est toujours le reflet plus ou moins parfait de ce contexte d’émergence
du texte à objet collectif.
À cet effet, la critique des formes s'attache à passer le texte au crible des
formes littéraires. Ainsi, avec la critique des formes, le lecteur examine la
manière dont le texte analysé coïncide avec les postulats de la catégorie dans
laquelle le texte étudié est ordinairement classé pour en déduire des
hypothèses au sujet de l’auteur et du contexte historique d’émergence du texte.
PAUL-MARIE FIDÈLE CHANGO, OP
21
Par exemple, pour un texte à contenu historique évoquant deux nations
x et y, la critique des formes vérifie au regard de ce que disent les chroniques
des deux nations considérées (x et y), la manière dont le texte examiné répond
aux formes et critères des textes historiques de l’époque des deux nations x et
y.
Ainsi, de manière concrète, la manière dont les chroniques romaines
évoquent ou non le massacre des innocents devrait, selon notre exemple, aider
à vérifier l’authenticité du récit rapporté par les évangiles synoptiques qui
trouve un parallèle vétérotestamentaire en Ex 1,16.
Un autre exemple : ordinairement, les formes des textes législatifs d’un
peuple donnent généralement des éléments d’appréciation sur le contexte
socio-historique du peuple au moment de la composition et de l’adoption de ses
lois et constitutions.
2. 3.2. 3 – L’analyse rhétorique du texte
La méthode rhétorique s’intéresse à l’argumentation du discours, aux
moyens de persuasion employés dans le texte. Son postulat initial est que
l’auteur sacré utilise, comme système de communication, l’art oratoire appelé «
rhétorique ».
Un modèle classique du discours rhétorique comprend :
• Propositio
(qui peut être un enchaînement de
Exordium,
demonstratio
et même narratio)
• Explicatio
• Refutatio
• Applicatio
• Peroratio
PAUL-MARIE FIDÈLE CHANGO, OP
22
2. 3.2. 4 – la critique littéraire ou critique des sources
La critique littéraire ou critique des sources ou la recherche la
préhistoire écrite du texte s’attache à distinguer les sources utilisées par le
rédacteur du texte. En d’autres termes elle s’efforce, en fonction des motifs du
récit, de mettre en lumière les emprunts de l’auteur à des littératures
extrabibliques. Puis elle précise le milieu de production du texte et le contexte
historique de l’auteur ou des auteurs du texte. Dans les études des Évangiles
synoptiques l’établissement de la Source Q est un exemple des résultats de la
critique des sources.
2. 3.2. 5 – La critique ou l’analyse comparative
Les différents aspects de l’analyse comparative se résument en ceci :
établir un matériel de comparaison et repérer les éléments spécifiques qui
donnent lieu à la possibilité du rapprochement, puis mesurer le degré de
pertinence et d’incidence de ce matériel de base aussi bien sur l’échantillon
biblique que sur les documents de la littérature extrabiblique qui constituent le
second terme de comparaison.
2. 3.2. 6 – La critique des traditions du texte
La critique des traditions ou l'histoire de la transmission des traditions
du texte s'efforce de retracer l'histoire des traditions du texte. Elle accorde une
priorité aux stades pré-littéraires de la formation des traditions et évalue leur
mode de transmission jusqu'à la rédaction finale du texte.
On y expliquer, par exemple, la manière dont des légendes
indépendantes peuvent évoluer du stade oral vers des traditions littéraires plus
complexes.
Pour tout dire, la critique des traditions procède par des étapes qui
permettent de placer le texte étudié dans les courants de tradition, dont elle
PAUL-MARIE FIDÈLE CHANGO, OP
23
s’attache à préciser l'évolution ou le développement diachronique au cours de
l'histoire.
2. 3.2. 7 – La critique de la composition et de la rédaction du
texte(Redaktionsgeschichte)
Une fois que le lecteur a fini de distinguer les couches rédactionnelles,
les sources ayant contribué à la composition de son texte, puis les différentes
étapes de la tradition du texte, la critique de la rédaction lui permet de
s'intéresser à l'œuvre complète et à sa forme finale.
En conséquence, elle cherche à mettre en lumière les modifications que
le texte a subies avant d’être fixés dans son état final, c’est-à-dire le processus
par lequel le texte est arrivé à son édition définitive.
Ainsi, elle permet d’identifier non seulement la contribution personnelle
de l’auteur, mais aussi les orientations théologiques qui ont guidé son travail de
rédaction.
2. 3. 3– Exemple d’une méthode anachro-synchronique :
l’analyse pragmatique
Quant aux méthodes anachro-synchroniques, elles tentent de remonter
aux premiers lecteurs du texte pour établir la manière dont ces derniers ont
saisi le sens du texte. À la lumière du sens du texte pour les premiers lecteurs
les méthodes anachro-synchroniques tentent d’établir quel sens et quelles
interpellations le texte peut avoir pour le lecteur contemporain.
À cet effet, l’analyse pragmatique correspond à un questionnement
entre le texte et le lecteur lui-même. En un mot le lecteur questionne le texte
tout en se laissant questionner par le texte. Ici, on parle de « méthodes de
lecture » : on s’interroge sur les premiers lecteurs du texte. On se laisse
interpeller par leur compréhension et réaction face au texte. En un mot, on
PAUL-MARIE FIDÈLE CHANGO, OP
24
s'intéresse plus au lecteur qu'à l'auteur du texte tout en remontant aux tout
premiers destinataires du texte.
2. 3. 4 – Les méthodes achroniques
«L'auteur est mort», «le texte en soi», tels sont les slogans des teneurs
des approches achroniques. Ici, les questions des intentions de l'auteur, ou de
sa psychologie sont révolues. Le lecteur étudie donc le texte en lui-même sans
tenir compte des circonstances historiques de sa rédaction.
2. 3. 4. 1 – L’analyse structuraliste
Elle privilégie comme clef de lecture la structure profonde qui jalonne le
texte.
2. 3. 4. 2 – L’analyse sémiotique
La sémiologie ou sémiotique (du grec shmei/on, « signe ») est la science
des significations. La méthode sémiotique est donc la méthodologie des
sciences qui traitent des systèmes signifiants. En d’autres termes l’analyse
sémiotique s’attache à relever la manière dont les systèmes de signes sont
structurés dans le texte.
Ainsi, à partir du rapport entre les éléments perceptibles qui sont les
signes du texte (c’est-à-dire les signifiants) et leur sens (c’est-à-dire le signifié),
le lecteur identifie les carrés sémiotiques qui articule la narration ou le récit.
En un mot, le linguiste et sémioticien lithuanien Algirdas Julien
Greimas a créé le carré sémiotique en s’inspirant du carré logique d’Aristote.
Dans l’analyse du texte, le carré sémiotique fonctionne comme suit.
Tout d’abord, le lecteur commence par identifier dans son texte deux
concepts opposés, soit S1 et S2 (par exemple, masculin / feminin).
Ensuite, il retrouve une seconde paire de concepts opposés en lien
avec la première, soit ~S1 et ~S2(par exemple, non-masculin / non-feminin).
PAUL-MARIE FIDÈLE CHANGO, OP
25
Alors, le carré sémiotique lui permet d’établir les relations suivantes
entre les quatre concepts ainsi obtenus :
S1 et S2: opposition ou contrariété
S1 et ~S1, S2 et ~S2: contradiction
S1 et ~S2, S2 et ~S1: complémentarité ou implication
En définitive on observe que le carré sémiotique permet de raffiner les
analyses par oppositions. Ainsi le lecteur qui l’utilise peut faire passer le
nombre de classes analytiques découlant d’une opposition donnée de deux à
quatre à huit voire à dix. Et au fur et à mesure qu’il avance il obtient un
dévoilement spectaculaire du sens de son texte.
Schéma du carré sémiotique rempli à partir de l’opposition :
masculin/féminin, non-masculin / non-féminin
Masculin + Féminin « androgyne » « hermaphrodite »
Masculin « homme »
Féminin « femme »
Masculin
+
Non-
féminin « vrai
homme »
« macho
»
Féminin
+
Non-
masculin « femme
ultra-
féminine
»
Non-féminin « hommasse »
« macha »
Non-masculin « efféminé »
Non-féminin+ Non-masculin« ange »
Conclusion
PAUL-MARIE FIDÈLE CHANGO, OP
26
Au terme de ce parcours une question demeure : à quelle méthode
avons-nous, nous-même, davantage recours sur notre terrain de prédilection
qu’est le comparatisme des livres sapientiaux bibliques ?
Pour notre part, nous partageons entièrement la conviction de Luca
Mazzinghi exprimée en ces termes :
« continuo in ogni caso a ritenere che senza l’ausilio del metodo
storico-critico difficilemente sia possibile cogliere ciò che l’autore
intendeva communicare1 ».
Notre démarche sera donc historico-critique c’est-à-dire
diachronique : « l’une des tâches fondamentales de l’exégèse historico-
critique est d’éclaircir dans quelle mesure et comment les auteurs des textes
vétérotestamentaires, dans leurs réflexions et leurs écrits, ont été influencés par
des expériences historiques ainsi que par des traditions culturelles et
littéraires2 ». Cela requiert la méthode comparative.
Aussi, l’analyse comparative avec la littérature juive extra-biblique et
la philosophie grecque nous permettra-t-elle d’identifier la source littéraire ou,
du moins, les parallèles ou allusions auxquelles font référence les passages du
Qohélet que nous aurons choisis.
C’est pourquoi, les différents aspects que notre analyse doit prendre en
considération sont les suivants :
• établir, chaque fois et le plus rigoureusement possible, le
matériel de comparaison à étudier ;
• puis repérer les éléments spécifiques qui donnent lieu à la
possibilité des rapprochements observables ;
• et enfin mesurer le degré de pertinence et d’incidence de ce
matériel de base aussi bien sur l’ensemble du Qohélet que sur
les documents de la littérature extra-biblique qui constituent le
second terme de comparaison.
PAUL-MARIE FIDÈLE CHANGO, OP Docteur ès-Sciences Bibliques
Prof. d'Exégèse d'Ancien Testament
1 L. MAZZINGHI, Ho cercato e ho esplorato. Studi sul Qohelet (Bologna 2001) p. 10.
2 T. KRÜGER, « Le livre de Qohéleth dans le contexte de la littérature juive des III
e et II
e siècles
avant Jésus-Christ », RTP 131 (1999) p. 135.