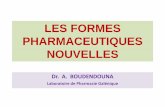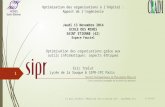Nouvelles reflexions sur les aires de distribution au Sahara central
-
Upload
independentresearcher -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Nouvelles reflexions sur les aires de distribution au Sahara central
121Cahiers de l’AARS — N° 13 — 2009
Introduction
Dans le dernier numéro des Cahiers de l’AARS (Gauthier, 2008), la présentation de nouvelles figurations de la zone libyenne de la Tassili-n-Azjer nous a permis de préciser les contours de l’aire de distribution des gravures en style du Messak sur les confins algéro-libyens. Des documents inutilisés jusque-là apportaient d’autres précisions quant à la fron-tière entre le monde du Messak et le monde « tassilien » (groupe Iheren-/Wa-n-Amil).
Un des marqueurs de l’ensemble culturel du Messak est l’ovaloïde dont nous avons révélé la présence assez importante dans le réseau d’oueds de cette frange libyenne de la Tassili-n-Azjer, et dans une moindre mesure, sur la façade orientale de la Tadrart.
C’est en direction de Sud (Djado, Ténéré) et du SSW (Tassili méridionale et occidentale) que l’extension de ce groupe culturel est la moins bien marquée, ou la moins bien connue. L’edeyen de Murzuq forme une limite natu-relle, à l’Est de laquelle on ne connaît, à l’heure actuelle, aucun des éléments caractéristiques du groupe culturel lié à ces gravures en style du Messak. Celles-ci sont encore assez abondam-ment représentées entre la passe de Tilemsin (Tehe-n-Tilemsin) et le col d’Anaï.
Nous écrivions alors : « Dans les tassili méridionaux, au sud de
la Tadrart algérienne et jusque vers le Djado, l’art pariétal, très abondant, est sensiblement différent de celui des pasteurs du Messak, tant au plan thématique qu’au plan technique (Hal-lier 1990, 1992, 1995, 1999). Parallèlement, sur le plateau qui prolonge le Messak dans la par-tie algérienne, les dernières manifestations de l’art du Messak (Hallier, 2000) sont détectées
quelques kilomètres seulement au Sud du col d’Anaï (cf. Fig. 15). La limite d’influence se situe donc entre celui-ci et la passe de Salvador vers la frontière Algérie-Niger.»
Gravures et monuments du DjadoCes paroles et les images d’ovaloïdes ont
inspiré une question à Ulrich Hallier, auteur de divers ouvrages sur l’art rupestre du NE du Niger et des confins nigéro-libyens, c’est-à-dire les régions méridionales voisines du Messak et de la Tadrart, en prolongement direct de l’aire que nous avons délimitée pour la culture du Messak1. Dans le même courrier, U. Hallier nous demande notre opinion sur la gravure que nous reproduisons sur la Fig. 1 et son éventuelle relation avec les ovaloïdes dont nous parlions.
Mauvais référencement, perte de mémoire, négligence ou un intéressant mélange de ces hypothèses ont fait que nous avons totalement et abusivement négligé, lors de notre analyse, la documentation réunie par Ulrich & Birgit Hallier dans leurs quatre livres pour ne retenir que quelques rares gravures parues dans des articles et ayant un rapport direct avec l’ob-
Yves Gauthier
Nouvelles reflexions sur les aires de distribution au Sahara central
Résumé : La prise en compte de documents inédits ou jusqu’alors négligés permet de préciser l’extension des œuvres rapportables à la civilisation du Messak et de suggérer une nouvelle séquence d’évolution des monuments lithiques (MTS/corbeilles > “L” > MAV), avec élargissement des aires de distribution correspon-dantes.
1. Pour les besoins de cette note, les auteurs ont bien voulu nous fournir des précisions sur la localisation des figurations présen-tées dans ce travail.
Fig. 1. Relevé d’un panneau provenant d’un affluent de l’Enneri Erentegé, plateau du Man-geni (Niger). Voir Hallier, 1995:83
122
Yves Gauthier
jet de notre étude. Un article de ces auteurs traitant précisément de l’extension du groupe culturel du Messak (Hallier 2000), aurait dû nous rendre plus vigilants et nous inciter à revoir cette littérature.
La forme de cet ovaloïde avec un étran-glement, son association avec un quadrupède dont les naseaux sont bien indiqués, l’utili-sation du double trait, sont autant d’éléments thématiques et techniques qui rapprochent cette gravure de celles en style du Messak. Les exemples d’animaux entrant ou sortant d’ova-loïdes sont connus par dizaines sur ce plateau (cf. Gauthier 1996, van Albada 2000, Le Quel-lecb 1998 & 1999), de même que les gravures en double contour.
Selon toute vraisemblance, cette gravure est à rattacher à l’ensemble du Messak, ce qui a des implications possibles sur la limite de l’aire de distribution du groupe correspondant vers le SSE. Notons qu’il existe dans cette même région un autre ovaloïde isolé (Hallier 1990 : t. 75). Dans le même message, U. Hallier nous interroge également sur un monument, publié lui aussi par ses soins et provenant de la même région au Sud de l’Edeyen de Murzuq (Oua-r-Tadjetdjet, plateau du Djado). Bien qu’ensablé (Fig. 2), ce monument est suffisamment appa-rent pour qu’il soit possible d’identifier une cor-beille assez classique avec un pourtour circu-laire de quelques mètres de diamètre, délimité par des plaques légèrement inclinées et fichées dans le sol, et avec une pierre dressée en son
centre. La présence de trois autres pierres dres-sées (de plus petite taille) à l’intérieur même du cercle et quelques autres pierres dépassant à peine évoquent les alvéoles circulaires, situées à l’intérieur et tangentes au cercle principal, que l’on trouve sur divers monuments en corbeille du Messak (Gauthier 2004 : fig. 3). Rappelons que ce type de monument est attribuable sans grand risque d’erreur aux auteurs des belles gravures de cette dernière région.
Là encore, nous aurions dû être plus vigi-lants et prendre ces données en compte.
L’étude des images satellites fournies par Google Earth semble confirmer la présence de corbeilles dans le secteur situé au SSE de l’Edeyen de Murzuq, mais seule une observa-tion sur le terrain permettra d’en être certain (cf. carte Fig. 23).
Inspiré par ces (re) découvertes, nous avons donc analysé avec plus de précision les ouvrages cités plus haut, à la recherche d’autres motifs de rapprochement de cette région de plateau et du Messak.
Plusieurs scènes méritent assurément d’être rapprochées des magnifiques gravures du Messak, au rang desquelles, ce person-nage suivi par un éléphant (Fig. 3). La palette qu’il tient a des équivalents au Messak : on la retrouve dans la main de personnages portant un masque de rhinocéros (Lutz 1995 : 153, van Albada 2000 : 110), ou dans celle d’un person-nage assis (Lutz 1995 : 142).
Fig. 2. Oua-r- Tad-jetdjet. Monument en corbeille à stèle centrale compor-tant de probables alvéoles circu-laires avec petites pierres dressées, tangente au cercle extérieur. Hallier, 1992:farb. 31.
Fig. 3. Environs de l’E. Telei.
Reproduction d’un paneeau comportant un personnage muni
d’un arc et d’une palette suivi par
un éléphant. Voir Hallier, 1995:81.
Fig. 4. Bassin supérieur de l’E. Blaka. Motifs géométriques ouverts et striés. Hallier, 1995:abb.8.
Fig. 5. Motifs géo-métriques ouverts
et striés. wadi Tilizaghen (Messak)
Nouvelles reflexions sur les aires de distribution au Sahara central
123
Fig. 7. Couple d’ovaloïdes verti-
caux. H~60 cm. O. I-n-Djeran. Photo
B. Weidmann.
De même, il est tentant de comparer des motifs digités elliptiques ou ovales, ouverts et striés, gravés devant un personnage d’I-n-Habeter (Jacquet, 1978 : 51) avec des motifs de forme équivalente provenant du Djado, un peu au Sud du monument précédent (Fig. 4) .
De tels motifs2 sont présents sur au moins trois autres sites du Messak: une scène avec plusieurs d’entre eux a été observée dans l’oued Tilizaghen (Castiglioni & Negro 1982 : 467). En 1995, en compagnie de Jean-Loïc Le Quellec, nous a en avons photographié deux panneaux sur le même site ou sur un site très proche (Fig. 5). À Bâb el Maknûsa, passe per-mettant l’accès à l’edeyen de Murzuq et au Messak, une gravure similaire est, en appa-rence, oblitérée par une girafe (Pauphilet 1953 : PL. xi) : ce sujet est à quelques centaines de mètres d’un éléphant au contour partielle-ment en double trait.
On objectera — non sans raison — qu’il faut se méfier des rapprochements hâtifs de motifs tellement simples qu’on peut les retrouver d’un bout à l’autre de la planète. Jörg Hansen vient de révéler l’existence dans les tassili du Sud de l’Ahaggar, à Wa-n-Rechla et dans l’oued Amidi (Hansen 2009 : fig. 376, 607, 609) de motifs semblables3. Plusieurs d’entre eux com-portent, en leur milieu, un trait additionnel qui recoupe les traits sub-parallèles à angle droit, trait présent aussi sur deux des mêmes motifs d’I-n-Habeter. Cet ajout les rend un peu moins banals. Les motifs de Wa-n-Rechla et de l’oued Amidi apparaissent dans une zone où figurent de magnifiques représentations d’éléphants et de bovins qui côtoient un personnage à masque de girafe : ces gravures s’inscriraient sans pro-blème dans l’ensemble des gravures en style du Messak. En résumé, tous ces motifs sont ver-ticaux et ouverts vers le haut à l’exception de ceux de Wa-n-Rechla qui sont orientés vers le bas. On remarquera au passage que ces motifs ne sont pas tous fermés et que deux sont coupés en deux par un trait médian aussi dans l’oued Tilizaghen, observation valable aussi pour un dernier motif de l’oued Tanget (voir plus bas).
Ajoutons encore que la majorité d’entre eux apparaissent au Messak ou à sa périphérie et sont à proximité ou dans un secteur où sont répertoriées des gravures assimilables, par le style, la technique ou le thème, à celles en style du Messak. Ce n’est pas le cas pour des motifs similaires relevés à Taar Doï, au Nord du Tibesti et publiés par Staewen-Schönberg (1966-1969).
Enfin, toujours pour cette région de pla-teaux entre le Djado et l’edeyen de Murzuq, on ne manquera pas d’être frappé par ces énig-matiques figurations géométriques, paraissant uniques (Fig. 6), réalisées au double trait : cette caractéristique technique est suffisamment développée au Messak voisin et (quasi) absente ailleurs pour qu’on puisse y voir, là encore, plu-tôt qu’une convergence fortuite, une trace de diffusion d’un style propre aux populations qui ont bâti les monuments en « corbeille ».
Tadrart algérienne 4
Divers documents, qui nous ont été com-muniqués aimablement par B. Weidmann en octobre 2008, apportent quelques nouveautés et viennent appuyer nos conclusions concer-nant les limites du groupe culturel du Messak au niveau de la Tadrart algérienne.
Un des panneaux les plus significatifs représente un couple d’ovaloïdes, gravés au pied d’une paroi d’un tributaire de l’O. I-n-Dje-ran (Fig. 7). À l’instar d’autres gravures de la région, ils sont partiellement enterrés, et dans l’hypothèse où le sol n’aurait pas été modifié par des fouilles sauvages ou des événements naturels, les strates supérieures et en contact avec ces ovaloïdes pourraient fournir une ou des dates bien précieuses pour le calage de ces groupes de gravures et pour leur position chro-nologique relativement à celles du Messak.
Ces deux ovaloïdes sont dans une configu-ration classique, à savoir, sur paroi verticale, sub-parallèles à faible distance l’un de l’autre, et avec un grand axe vertical (voir discussion in Gauthier 2008a). Celui de droite comporte une séparation horizontale. Au Messak, la
5. Pour la typologie et les caractéristiques techniques des ovaloïdes voir Le Quellec 1994, 1999.
Fig. 6. Bassin supérieur de l’E. Blaka (Niger). Motifs énigma-tiques gravés en double trait ; Hal-lier, 1995:abb.7c.
4. Nous ne pos-sédons pas toutes les publications relatives à la Tadrart algérienne. Certaines de ces gravures sont déjà dans la littérature. À notre connaissance, elle n’ont pas été pleinement prises en compte dans le cadre d’une étude des aires de diffu-sion. La plupart de ces scènes sont bien connues puisque des centaines de touristes et et chercheurs sillonent cet oued depuis des décennies.
3. « Ovales, parfois par deux, souvent ouverts dans leur partie supérieure et striés ». « Des-sins énigmatiques : gravures en forme de panier, fré-quentes dans la région » (Hansen, 2009 : 86 et CD).
2. Appelés arceaux à indentation par J.-L. Le Quellec (1993). Motifs à ne pas confondre avec les arceaux concentriques.
124
Yves Gauthier
partition des ovaloïdes est fréquente, même si, en règle générale, la séparation est plus souvent située vers la base5. Moins flagrants car moins visibles et moins spectaculaires, deux autres exemplaires isolés sont gravés, eux aussi, verticalement au pied d’une paroi du même oued (non montrés).
De nombreuses gravures qui ornent les parois de l’oued et ses tributaires mériteraient d’être signalées ici, dans le cadre de cette comparaison avec les régions voisines. Nous donnons quelques extraits des documents seulement, mais ils sont suffisants pour montrer, par leur présence en divers endroits, le degré de pénétration.
Fig. 8. Bovins gar-vés, partiellement
en double trait et en relief. Wa-n-Zawa-
ten, o. I-n-Djeran (Tadrart algérienne).Photo B. Weidmann.
Fig. 9a. Bovins par-tiellement en double trait avec indication
de l’épaule. Détail d’un panneau. Wa-
n-Ekli, o. I-n-Djeran (Tadrart algérienne). Photo B. Weidmann.
Fig. 9b. Autre détail du même panneau. La présence d’un double cornage (cornes pendantes et cornes en avant) indique une probable reprise avec piquetage de la surface endopé-rigraphique. Photo B. Weidmann.
Fig. 10. Buffle avec indication de
l’épaule. Wa-n-Ahar, o. I-n-Djeran. Photo
B. Weidmann.
Nouvelles reflexions sur les aires de distribution au Sahara central
125
L’utilisation de double trait pour le contour d’animaux a déjà été mentionné sur deux sites en bordure orientale de la Tadrart, notamment au site fezzanais (Striedter et al. 2005). La Fig. 8 donne deux autres magnifiques exemples avec un bovin aux cornes en avant et un autre, aux cornes en forme de lyre et portant un col-lier. Pour celui-ci, l’artiste ne s’est pas contenté d’utiliser le double trait: la paroi a été préparée (surcreusée et lissée) si bien que certains détails de l’animal sont en léger relief, particularité que l’on rencontre sur les gravures en style du Messak (Van-Albada 2000 : 68) et quasiment jamais dans les autres ensembles rupestres.
Un petit détail graphique concernant ces bovins déjà connus (Hachid 2000 : 289) mérite quelques commentaires. Sur ces gravures de l’oued I-n-Djeran, le relief de l’épaule est rendu par un trait continu qui poursuit, sur le corps, le tracé de la patte et se referme en arrondi sous la ligne dorsale (Fig. 11a-b). C’est une convention attestée au Messak (ex.: Gauthier 1996 : 31, 62; van Albada 2000 : 47, 79, 81) et pas ailleurs à notre connaissance. En effet si, par hasard, les traits des pattes se prolongent sur la robe, jamais (?) ils ne se referment sous la ligne dor-sale comme sur ces animaux (Fig. 9-10), sauf au Messak et ici, dans la Tadrart algérienne. D’autres gravures, au contour en double trait, provenant d’un affluent de l’oued I-n-Ezzan et de l’oued Iberdjen proposent le même traite-ment du train avant (Tauveron 2005 : 19-20). L’utilisation de ce procédé graphique confirme bien le parallèle Messak-Tadrart déjà établi sur d’autres critères spécifiques.
À Wa-n-Ahar, un buffle est gravé face à deux personnages au pied d’une paroi (Fig. 10). Même s’il est partiellement enterré, le train avant est bien visible : le haut de la patte et l’épaule sont figurés avec le même procédé graphique et cet animal est à inclure dans le même ensemble. Les buffles sont d’une grande rareté au Sahara central, sauf au Messak (Gau-thier 1996 : 50, 128, van Albada 2000 : 45) d’où l’on croirait que celui-ci provient, avec ce cor-nage vu de dessus (de profil généralement chez les autres bovins).
Si l’identification des corbeilles est délicate sur les images satellitaires, elle est en revanche bien plus aisée sur photographies. Quatre cor-beilles ont été repérées sur les rives ou ter-rasses de l’oued I-n-Djeran et ses tributaires (Fig. 11a-b). Même si elles ne comportent pas de stèle centrale, elles présentent les carac-tères habituels de ces monuments : circulaires, quelques mètres de diamètre, délimitation par des plaques fichées en biais dans le sol. Ces monuments comme les autres documents pré-sentés dans cet article sont indiqués sur les
cartes (Fig. 23-25). Profitons de cette occasion pour souligner la présence, dans cette même région entre Tadrart et Messak, d’un monu-ment en « L » (Fig. 12) 6.
Oued Tanget
J. Perez et M. Amat-Chantoux ont eu la chance, dans les années 1970, de parcourir l’oued Tanget, dans le Nord de la Tassili-n-Azjer centrale, entre l’Oued Djerat à l’ouest et Fort Tarat vers la frontière libyenne à l’est. Parmi les nombreux documents rapportés figurent une vingtaine de panneaux gravés, la plupart en trait poli et à patine totale sinon très accentuée. Éléphant, bovins, hippopotame, girafes, addax, âne ou encore personnage à tête de canidé (Gauthier 1996 : 126) sont représen-tés, ainsi que des motifs géométriques.
Fig. 11a . Corbeilles sur une terrasse d’un tributaire de l’o. I-n-Djeran. Photo B. Weidmann
Fig. 11b . Détail d’une corbeille sur une terrasse d’un tributaire de l’o. I-n-Djeran. Photo B. Weidmann.
Fig. 12 . Monu-ment en forme de ”L”. Environs de Wa-n-Zawaten. Photo B. Weidmann
6. Pour la définition et la distribution, voir Gauthier 2002.
126
Yves Gauthier
Sur certains animaux du Messak, la com-missure des lèvres est particulièrement tra-vaillée, soulignée qu’elle est par un double, voire un triple trait en arc, demi cercle, méandre ou en spirale (Fig. 13). Les exemples les plus typiques apparaissent sur des éléphants (Gau-thier 1996 : 50, 99) dont l’oued Tanget a livré un exemplaire (Fig. 14). De façon plus exception-nelle, ce travail sur la commissure des lèvres est reproduit sur le plus grand (3.6m, Fig. 15) des hippopotames du Messak, qui occupe un panneau de l’oued Taleschut. Sur les panneaux qui lui font suite, vers l’aval, on dénombre une vingtaine d’autres hippopotames, dont des mères suitées. C’est probablement la plus grande concentration en hippopotames de tout le Messak et certainement du Sahara. Le traitement de la commissure des lèvres est différent et se transforme sur ces autres ani-maux en goutte d’eau qui termine le trait de la gueule (Fig. 16). Notons que sur le grand hip-popotame, les spirales délimitent une forme similaire. Au Messak, ce traitement en goutte d’eau semble réservé à ces pachydermes et à quelques théranthropes à tête de Lycaon.
De façon prémonitoire, nous écrivions à propos des hippopotames : « au Messak, la séparation entre les mâchoires est soulignée par un motif typique en forme de goutte d’eau. Hasard ou marque d’une influence inter-régio-nale, ce motif se retrouve sur un spécimen gravé dans l’o. Tanget (nord-ouest du Tassili-n-azjer) » (Gauthier et al. 1996 : 61).
Cette manière si spécifique de traiter la commissure des lèvres existe, dans l’état actuel du dossier, au Messak et nulle part ailleurs
Fig. 13. Traitement en trait multiple de la commissure des lèvres sur un éléphant de l’oued Alamas (Messak). Un relevé complet est disponible (Gauthier et al., 1996:50).
Fig. 14. Éléphant de l’oued Tanget. Commissure des lèvres en méandre et double trait. Le pli de l’aine est lui aussi en double trait. Un autre pachyderme est discer-nable en arrière plan. Photo P. Amat-Chantoux.
Fig. 16. Hippopotame de l’oued Taleschut (Messak). Commissure des lèvres en « goutte d’eau ». Panneau voisin de celui de la Fig. 17.
Fig. 15. Un trait multiple délimite une forme de goutte d’eau sur la geule de cet hippopotame du w. Taleschut (Messak). Voir relevé (Gauthier 1996 : 61).
Fig. 17. Hippopotame de l’ouedTanget. Commissure des lèvres en « goutte d’eau ». Photo P. Amat-Chantoux.
Nouvelles reflexions sur les aires de distribution au Sahara central
127
si ce n’est à l’oued Tanget (Fig. 17). En l’ab-sence de tout autre élément de rapprochement, le hasard d’une invention indépendante serait certainement une bonne explication à la pré-sence de cette gravure à l’oued Tanget. Compte tenu de la présence de divers autres points de convergence tant artistiques que thématiques ou stylistiques — inconnus jusque là — sur les sites voisins de cet oued et dans les régions avoisinantes, nous aurions tendance, mainte-nant, à privilégier l’hypothèse d’une relation plus ou moins directe de l’auteur avec ceux des gravures en style du Messak.
Wishful thinking, déformation liée aux thé-matiques de nos recherches7 ou réalité, nous nous interrogeons sur le lien possible entre un autre motif géométrique subrectangulaire (Fig. 18 & carte Fig. 23) et ceux discutés supra et provenant du Messak, du plateau du Djado (Fig. 4-5) ou bien encore de Wa-n-Rechla. Dans ces deux derniers secteurs, ils sont plus arrondis, ovaloïdes. Comme plusieurs de ces derniers, celui de Tanget comporte une série de traits internes sub-parallèles et un trait médian. Et, comme eux, il apparaît dans un secteur où existent aussi des éléments rattachables au groupe culturel du Messak sur lequel nous avons focalisé notre attention.
Le plateau d’IharhaïenLes inventaires font apparaître que les pein-
tures, de la Tassili-n-Azjer, sont bien plus nom-breuses que les gravures. Ces dernières sont prépondérantes néanmoins sur quelques rares secteurs comme Ti-n-Terert et l’oued Djerat principalement. Ailleurs elles atteignent rare-ment la qualité artistique et technique de ces deux grands secteurs et des sites, bien connus, d’I-n-Debiren et Terarart, aux environs de Dja-net, ou alors elles sont très diffuses, comme à l’oued Tanget. De récentes observations ten-dent à montrer que cette densité est peut-être sous-estimée.
Si, sur le plateau d’Iharhaïen, les peintures sont particulièrement nombreuses avec quelques originalités comme nous avons pu le consta-ter dernièrement 8 les gravures sont loin d’être absentes. Des bovins, des girafes, des béliers sont représentés sur de grandes dalles ainsi que divers personnages. Parmi ceux-ci des individus à tête de léporidé comme on peut en voir au Djerat. La maîtrise des artistes rejoint celle des auteurs des figurations monumentales de ce même Dje-rat, de Ti-n-Terert ou du Messak. Deux person-nages ont particulièrement attiré notre attention, le premier sur le site d’Amelrar (Civrac et al.; ce volume : fig. 104-106), et l’autre à Afifar Ti-n-Tataït (id. fig. 122-124). Tous deux tiennent une hache, sont affublés d’une queue, et sont dotés de
8. présentation à la Réunion AARS de Joigny, Mai 2009 (voir aussi l’article de Civrac et al. dans ce même volume).
Fig. 18. Motif géométrique strié à séparation centrale. Oued Tanget. Photo P. Amat-Chantoux
7. Sur ce sujet, lire l’analyse de J.-L. Le Quellec (2007).
Fig. 20. Monu-ment en « L » de Ti-n-Akh. Photo M.-A. Civrac.
Fig. 19. Oued I-n-Erahar, Messak. Personnage gibbeux à tête animale, affublé d’une queue et brandis-sant une hache.
128
Yves Gauthier
phallus hors norme, trois caractéristiques qu’ils partagent avec une série d’êtres au corps parfois difforme — tel celui d’Amelrar — provenant du Messak et de l’oued Aramat (Fig. 19 et Gau-thier 1995 : fig. 2-4). À notre connaissances, des êtres réunissant ces trois caractéristiques sem-blent inconnus ailleurs. Pourtant, en y regardant mieux, on constate qu’un personnage de l’oued Djerat (Lhote, 1976 : n° 1271), à la tête inachevée, réunit deux des éléments : petite queue et phallus hypertrophié. Et l’objet qu’il brandit dans la main gauche pourrait fort bien être une hache, élar-gissant ainsi les motifs de rapprochement entre toutes ces régions. Pour en terminer avec le plateau d’Iharhaïen, mentionnons enfin deux monuments en « L » de Ti-n-Akh (Fig. 20, et v. Civrac et al. 2009).
Monuments en « L »Dans des études précédentes, nous nous
demandions si ces monuments en « L » étaient une exclusivité du Fezzan, avec une distribu-tion dont le barycentre serait centré sur le Mes-sak (Gauthier 1995, 2002). Les données les plus récentes bouleversent ces conclusions et impo-sent de rectifier très sérieusement l’aire de dis-tribution de ces constructions dont la fonction, en l’absence de tout travail scientifique (incluant des fouilles) et de publication, reste mystérieuse.
Ces nouvelles informations intè-grent les monuments détectés sur les bandes hautes résolution de Google Earth, (apparues bien après notre première analyse), ceux d’une publication obtenue dernièrement (Müller-Karpe 1981) et d’autres signalés depuis par des voyageurs. En 2002, une tren-taine de monuments de ce type figuraient à notre inventaire: l’effectif est maintenant porté à 90 dont 74 d’orientation connue (28 auparavant).
L’apport le plus important concerne la Tassili-n-Azjer où une quarantaine de ces monuments sont maintenant répertoriés (cf. carte Fig. 25). Une bonne partie est distribuée au sud de Djanet, vers les sites d’I-n-Debi-ren et de Terarart (la « vache qui pleure ») et sur une bande en bordure du plateau, juste à l’est de Djanet. Quatre ou cinq sont aux alen-tours de Dider/Ti-n-Terert, deux sont à proxi-mité d’Amelrar, et trois autres sont signalés (Müller-Karpe 1986, G. & S. Lachaud, M-A. Civrac, com. pers. 2008) dans le lit même de l’oued Djerat (Fig. 21). B. Weidmann nous en a signalé un juste au nord du site de Wa-n-Zawa-ten (Fig. 12). Ils sont aussi fréquents dans la région de l’Aramat où nous en avons observés de nouveaux en 2008 (cf. carte). La plupart de ces monuments à antenne en « L », dont ceux du Messak, est située dans des secteurs où nous avons noté des gravures qui, à un titre ou à un autre, peuvent être mises en relation avec celles en style du Messak, à l’exception cependant de Ti-n-Terert.
DiscussionCette proximité fréquente nous a amené
à nous interroger sur le lien potentiel entre ces monuments et le groupe culturel du Mes-sak, la question étant celle d’une attribution des deux phénomènes aux mêmes auteurs. La situation est plus compliquée qu’il n’y paraît. Les bandes hautes résolution ont révélé la présence de ce type de construction jusqu’en Ahaggar, à Otoul et au nord de ce village (un et trois exemplaires respectivement) et nous en avons observé un en bordure de l’oued Iherwen en Immidir (Fig. 22). Les images satellites en révèlent plusieurs autres dans ce massif. Un exemplaire isolé est localisé sur la Hamada-el Hamra. Si la proximité géogra-phique monuments-gravures se vérifie bien à Iherwen, elle n’est pas vraie pour les autres monuments de l’Immidir ni pour ce monu-ment de la Hamada-el Hamra. De même,
Fig. 21. Deux monument en « L » de l’oued Djerat. Un à gauche, derrière le personnage, et l’autre à droite de son compa-gnon, en avant du tumulus. Photo S. & G. Lachaud.
Fig. 22. Monument en « L » situé en bordure de l’oued Iherwen (Immi-dir). Photo Y. & C. Gauthier
Nouvelles reflexions sur les aires de distribution au Sahara central
129
on trouvera difficilement, dans les parages d’Otoul, Ahellegen et Aguennar (NNE de Tamanrasset) des gravures assimilables à celles auxquelles nous nous intéressons.
Sauf à trouver des indices de diffusion du groupe culturel auteur des gravures en style du Messak dans ces trois régions, il n’y a pas lieu, comme nous l’avions pensé un moment, de faire le parallèle entre ces monuments en « L » et ce groupe.
À ce stade, il est bon de résumer les faits et documents décrits ici et dans nos articles antérieurs:
1/ On constate que ce groupe occupe principalement le Messak avec de très fortes concentration de monuments en « corbeille », et la récurrence de thèmes (ovaloïdes, femmes à chapeaux conique, théranthropes...) ou techniques (double trait, bas-relief, polissage intégral) (Gau-thier 2008a).
2/ On retrouve ces marqueurs avec des concentrations notables dans la région de l’oued Aramat (ovaloïdes surtout, chapeau conique, corbeilles), sur la façade orientale de la Tadrart libyenne et plus encore au sud de la Tadrart algé-rienne entre le col d’Anaï et I-n-Ezzan (Gauthier 2007a, 2008a).
3/ Ces marqueurs ou d’autres (lippe en goutte d’eau et/ou trait multiple, per-sonnages armés d’une hache et affublés d’une petite queue, ovaloïdes ouverts et striés) se manifestent de façon plus dif-fuse dans les parages de Djanet, au Dje-rat et sur le plateau du Djado.
4/ En dehors du Messak, ces marqueurs ne sont jamais présents massivement ni simultanément sur un même site.
5/ En dehors du Messak, les peintures sont largement dominantes et les sites gravés sont beaucoup moins importants en termes quantitatifs sauf dans la Tadrart algérienne, laquelle peut être considérée comme une extension du Messak, et au Djerat.
6/ Les sites rattachables à la culture du Messak par des aspects thématiques, techniques ou rituels sont tous compris dans l’aire de distribution des monu-ments en « L » (Fig. 23-25) à l’exception des quatre sites du Djado (Enneri Blaka, E. Teleï, E. Erentegé et Oua r Tadjetdjet). Soulignons que pour ces derniers, un ou deux marqueurs au mieux sont présents sur les panneaux.
7/ L’aire de distribution des « L » couvre presque intégralement celles des Monu-ments en trou de serrure (MTS) et des
Fig. 23. Distribution des signes ovaloïdes striés (rond blancs cerclés noir) et des monuments en « L » et apparentés (carré noirs; couleurs inver-sées pour ceux mentionnés dans le texte ou illustrés).
130
Yves Gauthier
corbeilles. (Fig. 25a) Le non recouvre-ment concerne un « L » (Hamada-el -Hamra), une corbeille (Oua r Tadjetd-jet) et une vingtaine au plus de MTS (sur plus de 600 !) en limites ouest et SSW.
8/ Nous avons conclu, avec les données actuelles et les datations obtenues sur des MTS de l’Emi Lulu (voir Annexe I) et des sépultures du Messak, que ces corbeilles et ces MTS sont contempo-rains pour une bonne part et sont l’œuvre de deux groupes culturels distinct (Gau-thier 2006) : l’un auteur des gravures en style du Messak et l’autre auteur des peintures en style d’Iheren de la Tas-sili-n-Azjer et de la Tadrart (cf., dans ce volume, l’article de J.-L. Le Quellec pour les appellations).
9/ L’aire de distribution des « L » est totale-ment incluse dans celle des Monuments à antennes en « V » (MAV) (Gauthier 2007b, 2008a) dont elle recouvre la plu-part des zones à haute densité (Fig. 25b).
10/ Les datations des MTS et corbeilles d’une part et celles des MAV d’autres part délimitent des fourchettes d’exis-tence sans recouvrement aucun (Gau-thier 2006 : fig. 22). Le fossé temporel
entre les deux, largement supérieur à un millénaire, correspond plus ou moins avec la durée de l’Aride Post-Néolithique !
Un scénario est compatible avec tous ces faits et avec une extension des aires de distri-bution: celui d’une uniformisation des popu-lations avec diffusion /assimilation de petits-groupes issus du Messak, dans les contrées à l’Ouest et vers le Sud, sous la pression des changements climatiques.
La séquence de succession des monuments serait donc :
MTS / corbeilles > « L » > MAVavec un élargissement des aires de distribu-
tion correspondantes.L’hypothèse d’une diffusion à partir du
Messak a le mérite d’expliquer aussi la quasi absence de peintures sur ce plateau pour toutes les périodes. En effet, une diffusion vers le Messak aurait été plus vraisemblablement — mais pas forcément — accompagnée d’une importation et d’une assimilation du concept de peinture. L’absence, au Messak, de pein-tures Caballines, très certainement attachées aux bâtisseurs des MAV (Gauthier 2008a : 119) est un des indices du sens possible de diffu-
Fig. 24. Localisation des documents mentionnés dans le texte : gravures (cercles noirs pointés); ovaloïdes (0) - celui de Hallier et ceux de notre précédent article); corbeilles (étoiles). Limite reconnue en 2008 du style du Messak (ligne noire).
Nouvelles reflexions sur les aires de distribution au Sahara central
131
Fig. 25. a/Localisation des Monuments en trou de Serrure (ronds noirs), des corbeilles (cercles blancs) et aire de distribution des monuments en “L“ (trait noir épais); b/localisation des Monuments à antennes en “V“ et aire de distribution “L“.
132
Yves Gauthier
sion. Ce schéma explique aussi une dilution des marqueurs caractéristiques du groupe cultu-rel du Messak dans le temps et dans l’espace, les mœurs évoluant par contact avec d’autres populations et aussi avec le climat qui impose d’autres modes de vie et de pensées, à distance du centre principal. À supposer qu’il résiste au temps et aux analyses futures motivées par l’apport de nouvelles informations ou interpré-tations, ce scénario a l’avantage de combler le millénaire qui sépare, sur l’échelle tempo-relle, l’extinction des MTS et l’apparition des MAV. Les populations n’ont certainement pas disparu du Sahara central pendant cet Aride Post-Néolithique et les Monuments en « L » pourraient correspondre à cette étape inter-médiaire. Nos connaissances actuelles ne nous permettent pas de dire quel(s) monument(s) funéraire(s) — rien ne dit, ni n’infirme, que les «L » soient des sépultures — pourrai(en)t être attaché(s) à cette époque. Pas plus que nous ne sommes capable, à ce jour, d’identifier un étage rupestre ayant une distribution voisine de celle des monuments en « L » et susceptible d’être une production des mêmes auteurs.
Dans nos articles antérieurs, nous avons pro-posé la coexistence de deux groupes distincts (peintres bâtisseurs de MTS à l’ouest et gra-veurs érigeant des corbeilles à l’est), postulant le tracé d’une frontière franche entre ces deux mondes (Gauthier 2006). Les apports récents nous ont conduit à moduler ce jugement 1/ en déplaçant la limite et 2/ en acceptant une zone de transition plutôt qu’une opposition brutale (Gauthier 2008). Dans nos conclusions nos évoquions la possibilité d’une diffusion vers des régions plus occidentales. (ibid. : 103). Les éléments apportés ici confirment une progres-sion très nette du groupe culturel du Messak vers le Sud et, comme en témoignent la densité de gravures et la présence de corbeilles, avec une probable installation sur la pointe méri-dionale de la Tadrart à l’image de ce que nous avons constaté dans la région de l’oued Ara-mat. Ces deux régions ont pu servir de relais vers des destinations plus lointaines. Les gra-vures de l’oued Tanget au Nord et du secteur de Djanet (Terarart, I-n-Debiren) au Sud viennent en effet appuyer l’hypothèse d’une progression plus occidentale en jetant des jalons supplé-mentaires en direction du Djerat et de la tassili centrale (Ti-n-Terert et plateau d’Iharhaïen).
En revanche, vers le SSE, en direction du Djado ou du Tibesti, même s’ils sont nets, les indices de présence du groupe culturel du Messak sont infiniment plus rares et très dispersés, donnant l’impression de tentatives sans lendemain contrastant avec la situation de la Tadrart méridionale.
Il reste à souhaiter que de nouveaux docu-ments issus des différentes régions discutées dans ce travail viennent éclairer les débats et apporter des précisions sur la chronologie rela-tive. Pour ce qui est de la chronologie abso-lue, la plus grande prudence est de mise (voir Annexe I).
ANNEXE IDatation des MTS
Dans le numéro 28 de la Lettre du CRIAA un article (Saliège et al., à paraître) proposant de nouvelles datations sur les MTS déjà datés de l’Emi Lulu (Niger), est signalé. Ces data-tions, basées sur un principe différent du pré-cédent, conduiraient à des âges différents de ceux publiés par François Paris (1996). Ces nouvelles datations modifieraient donc notre tableau chronologique (Gauthier, 2006 : 22). Nous attendons la sortie de l’article pour réa-gir et rectifier, le cas échéant, nos conclusions.
Si ces nouvelles datations remettent en cause notre cadre chronologique, elles ont des répercussions autrement plus importantes. Il est fort probable en effet qu’elles mettent à mal l’essentiel des conclusions de la thèse de Paris (co-auteur de cet article à paraître), la même méthode, basée sur l’utilisation de la fraction carbonatée des os (l’hydroxycarbo-nate-apatite ou HCA) ayant été appliquée lar-gement : 70 des 94 datations sont effectuées ainsi (Paris 1996 : 270-271). D’autres travaux ont par la suite procédé selon cette première méthode (HCA), travaux qui sont eux aussi sujets à caution.
Si les datations basées sur la HCA sont incorrectes, il importe que les équipes ins-titutionnelles impliquées dans ces datations apportent des clarifications sur les différentes méthodes et convainquent la communauté que la dernière est meilleure que les précédentes.
À ce stade en effet, il est légitime de se demander si une troisième méthode ne condui-rait pas à d’autres résultats.
Une réponse floue à ce questionnement jet-terait le doute sur les travaux de ces équipes émanant de grands organismes scientifiques et sur ceux des chercheurs ayant utilisés des data-tions basées sur la HCA ou tout autre procédé qui n’aurait pas été validé par une confronta-tion avec des datations AMS ou C14 classiques.
Nouvelles reflexions sur les aires de distribution au Sahara central
133
ANNEXE IIOrientation des Monuments en « L »
L’augmentation de la base de données a conduit à un quasi triplement du nombre d’orientations connues (74 contre 28 aupara-vant) pour les Monuments en « L ». Il nous a paru important de vérifier les règles d’orienta-tion sur un plus grand nombre.
Pour une définition de l’orientation de ces constructions, nous renvoyons le lecteur à notre publication antérieure (Gauthier 2002 : 140) et retenons comme mesure l’angle ω entre la partie principale de l’antenne et la direction Nord. Comme pour d’autres types de construc-tion et pour rendre aisée la comparaison, il est plus judicieux de considérer l’angle ω+90° qui tombe dans la moitié orientale de la rose des vents (cf discussion in Gauthier, 2008b). Les deux références sont données dans la Fig. 26).
L’histogramme des orientations (données brutes, non corrigées pour la présence de relief alentour) a une forme gaussienne centrée sur l’est (<or>=93°) ou sur le nord selon l’échelle retenue. Pour la première, nous avons indiqué les positions extrêmes de la lune et du soleil au lever. Rappelons que la présence de relief (à l’est dans ce cas) retarde l’apparition de l’astre et décale les azimuts toujours vers le sud. Trois azimuts sont à des azimuts plus grands que la valeur maximale pour la lune.
Pour ces trois monuments observés avant que nous ayons réalisé leur importance sur les orientations, nous n’avons pas relevé les hau-teurs des reliefs. Le décalage est de 5-6° seu-lement pour deux d’entre eux. Le troisième est bâti sur la berge orientale de l’oued I-n-Ehed, i.e. sur une pente orientée à l’ouest, et donc à l’ombre le matin. Ceci explique probablement le décalage d’environ 15°. À l’autre extrémité de la distribution, trois monuments sont juste
en limite de l’intervalle balayé par la lune à son lever. Le décalage de 2-3° est parfaitement acceptable : a/ les bâtisseurs n’avaient pas de laser à leur disposition pour un alignement par-fait ; b/ ce décalage est dans la marge d’erreur des mesures ; c/ il y a souvent un flou du même ordre de grandeur lié au choix des points rete-nus pour la mesure.
En clair, seul un monument peut poser un réel problème vis à vis des limites pour la lune. Si l’on rajoute que la distribution balaye intégralement l’intervalle en question, on peut légitimement envisager un alignement des monuments en « L » sur la lune à son lever 9. L’hypothèse d’un alignement sur le soleil levant est plus problématique, beaucoup plus de monuments se trouvant hors des limites possibles et avec des écarts beaucoup plus grands, notamment aux petits angles.
Il n’y a pas de différence significative avec nos résultats antérieurs (Gauthier 2002 : fig. 14a) qui portaient sur 28 monuments du Fezzân uniquement : même forme gaussienne, balayage intégral du secteur angulaire défini par les positions extrêmes de la lune, et même position pour le sommet. Il n’y a donc pas de variations régionales dans ces règles d’orien-tations pas plus qu’il n’y en a au plan architec-tural. Tous ces monuments font certainement partie d’un ensemble homogène culturelle-ment, ce qui justifie la discussion sur les aires présentée ci-dessus.
Erratum. Profitons de cette occasion pour rectifier une erreur de numérotation dans notre article précédent. Les ovaloïdes des figures 18, 19 et 20 auraient dû porter en fait les numéros 20, 21 et 22 respectivement.
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier Ulrich Hallier pour ses questions pertinentes qui nous ont permis d’élar-gir le débat, et pour la permission de reproduire diverses illustrations. Pour la toponymie et l’iden-tification des sites de l’oued I-n-Djeran nous avons bénéficié de l’aide de Jean-Loïc Le Quellec qui a aussi attiré notre attention sur certains motifs digi-tés et procuré plusieurs clichés et des informations qui ont facilité notre analyse. Nous sommes rede-vable aussi envers J. Perez (décédé), P. Amat-Chan-toux et B. Weidmann qui nous ont communiqué des documents photographiques et des indications précieuses sur la localisation de sites rupestres dont certains totalement ignorés, y compris dans les milieux spécialisés, voire inédits. Sauf indication contraire, les photos sont des auteurs.
Fig. 26. Orientation des Monuments en « L ». Référence vers le Nord (en bas, ω) et vers l’Est (en haut, ω+90°). Les lignes verticales indiquent les positions du soleil levant aux solstices d’été et d’hiver (trait plein) et les positions extrêmes de la lune sur un cycle de 19 ans (pointillé).
9. Pour le choix du lever (ou lieux du coucher) et de la direction est plutôt qu’ouest, voir discussion in Gauthier, 2008b et références incluses.
134
CastiGlioni Alfredo et Angelo & Giancarlo neGro, 1986. Fiumi di petra. Varese : Edizioni Lativa, 366p.
CivraC Marie-Anne, Pierre Desnos, Gianna Giannelli, Nicole honoré, Gérard laChauD, Suzanne laChauD, Fabio MaestruCCi, Françoise sauthier Delabre, Claude-Noële vaison, 2009. « Diversité de l’art rupestre dans la région d’Iharahien (Tassili Nord). » Les Cahiers de l’AARS, 13 : 37-80.
CRIAA, lettre d’information, 28, http://perso.menara.ma/vernet.avignon_1/
Gauthier Yves & Christine, 2002. « Monuments à antenne en L ou apparentés — une originalité du Fezzân ? Architecture, orientation et distribution. » Sahara 13 : 136-147.
——— 2007a. « Quelques gravures des confins algéro-libyens et du Messak, Contribution à l’étude des aires de distribution. » Les Cahiers de l’AARS 11 : 51-64.
——— 2007b. « Monuments funéraires sahariens et aires culturelles. » Les Cahiers de l’AARS 11 : 65-78.
——— 2008a. « Art rupestre, monuments funéraires et aires culturelles : nouveaux documents concernant le Messak, le sud-est du Fezzân et l’oued Djerat. » Les Cahiers de l’AARS 12 : 89-104.
——— 2008b. « À propos des monuments à alignement du Sahara. » Almogaren 38 : 27-88.
———, Alain Morel & Thierry tillet, 1996. L’art du Sahara. Paris : Seuil, Paris, 140 p., 82 photos couleur.
hallier Ulrich W. 1990. Die Entwicklung der Fels-bildkunst Nordafrikas. Untersuchungen auf grund neuerer Felsbildfunde in der Süd-Sahara (1). Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 150 p., 164 ill., 8 p. coul.
——— 1995. Felsbilder früher Jägervölker der Zentral-Sahara. Rundköpfe — Schleifer — Gravierer —Pün-zer. Untersuchungen auf grund neuerer Felsbild-funde in der Süd-Sahara (3). Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 198 p., 207 ill.
hallier Ulrich W. & Brigitte C., 1992. Felsbilder der Zentral-Sahara. Untersuchungen auf Grund neue-rer Felsbildfunde in der Süd-Sahara (2). Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 249 p., 492 ill., 47 p. coul.
——— 1999. Rundköpfe als Punzer und Maler — Die ersten Felsbildkünstler der Sahara ? Untersuchun-gen auf grund neuerer Felsbildfunde in der Süd-Sahara (4). Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 313 p., 130 ill.
——— 2000. « Die geographische Verbreitung der ‘Mes-sak-Kunst’ / The geographic extension of the ‘Mes-sak art’ ». Stone Watch Magazin 5: 26-36.
hansen Jörg, 2008. Tassili. Paris : Somogy, 566 p. + CD.
JaCquet Gérard, 1978. « Au cœur du Sahara libyen, d’étranges gravures rupestres. » Archéologia 123 : 40-51.
le quelleC Jean-Loïc, 1993. Symbolisme et art rupestre au Sahara. Paris : L’Harmattan, 638 p.
——— 1994. «Nouvelles données sur les ‘ovaloïdes’ gra-vés de la région du Messak libyen. » Société d’Études et de Recherches Préhistorique, les Eyzies 43 : 57-83.
——— 1999. « A Saharan example in rock art symbo-lism : the engraved ‘ovaloids’ of the Messak (SW Fezzan Libya), Actes du Congrès NEWS’95, sym-posium 2a : « semiotics, signs and symbols », Torino, 30 Août-6 Septembre 1995, p. 95 et CD (file : / news95/2a/lequellec/quell.htm, 11 pages).
——— 2007. « Perceptions et attentes dans les études d’art rupestre. » Les Cahiers de l’AARS 11 : 113-124.
——— 2009. « À propos du nom donné à quatre styles de peinture rupestre au Sahara central. » Les Cahiers de l’AARS 13 : 183-188.
haChiD Malika, 2000. Les premiers Berbères. Entre Méditerranée, Tassili et Nil. Aix-en-Provence : Ina-Yas/Édisud, 317 p.
Müller-Karpe Andreas, 1986. « Archäologische Denkmäler des Oued Tissalatine (Süd-Algerien). » Beiträge zur algemeinen und vergleichenden Archäo-logie 8 : 177-212.
paris François, 1996. Les sépultures du Sahara nigérien, du Néolithique à l’islamisation. Bondy : ORSTOM éditions, 2 vol., 621 p.
pauphilet Didier, 1953. « Les gravures rupestres de Maknusa, Fezzan. » Travaux de l’Institut de Recherches Sahariennes 10 : 107-120.
salièGe Jean-François, Antoine ZaZZo & François paris, à paraître. « Chronologie des monuments à couloir et enclos d’Emi-Lulu. Datations croisée de l’émail dentaire et des os des squelettes des humains inhu-més. ». Poster présenté au colloque de l’Académie des sciences Les déserts d’Afrique et d’Arabie : envi-ronnement, climat et impact sur les populations 8-9 septembre 2009.
staewen C., sChönberG F., 1966-69. « Schematische Felsgravierungen am Taar Doi in Nord-Tibesti (Tschad). » Jahrbuch für Prähistorische und Ethno-graphische Kunst, Berlin, 22: 93-97.
strieDter Karl Hei,z & Michel tauveron, 2005. « Traces de l’art rupestre fezzanais dans la Tadrart algérienne. » In bariCh Barbara E., Thierry tillet, Karl Heinz strieDter [eds.], Hunters vs. pastoralists in the Sahara: material culture and symbolic aspects, Oxford, Archaeopress, 65 p. (British archaeological Reports — International Series ; 1338 / Actes du 14e Congrès de l’Union internationale des sciences préhistoriques et pro-tohistoriques, Liège 2001 : colloque/symposium 15.1), p. 15-23.
tauveron Michel, [2005]. La Tadrart, paysage de la pré-histoire algérienne. Cahier de l’exposition « Djazaïr, Une année de l’Algérie en France », slnd, 32 p.
van albaDa Axel & Anne-Michèle, 2000. La mon-tagne des Hommes-chiens : l’art rupestre du Messak libyen. Paris : Seuil, 120 p.
Bibliographie