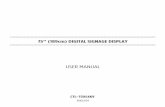La question du Sahara Occidental en 2013
Transcript of La question du Sahara Occidental en 2013
Dossier géopolitique – Master II Responsable de programmes
internationaux
La question du Sahara occidental - Quarante années de conflit
Démantèlement du camp de Gdeim-Izik dans le Sahara occidental - Novembre 2010
Emilie Queyraud
Année 2012- 2013
Correcteur : Mr Karim Emile Bitar
2
Le conflit qui oppose le Maroc à la population sahraouie est l’un des plus vieux conflits qui perdurent dans monde. Au début des années 70, alors que l’Espagne coloniale souhaite se retirer du Sahara occidental, le Maroc revendique son « droit historique » sur les provinces du grand sud1 et organise la célèbre « Marche Verte » de 1975 afin de prendre le contrôle sur ce territoire, alors même que l’avis rendu par Cour Internationale de Justice à la requête de l’Assemblée Générale des Nations Unies, n’a pas établi sa souveraineté sur le Sahara2. Les accords de Madrid permettent l’annexion de l’ancienne colonie par le Maroc et la Mauritanie en 19763. Mais le Front Polisario, crée en 1973, s’y oppose et proclame dès 1976 l’indépendance de la République Arabe Sahraouie Démocratique4 en s’appuyant sur le principe du droit des peuples à disposer d’eux mêmes, dans la lignée de la célèbre résolution 1514 de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrant l’existence de ce droit5. C’est ainsi que le Front Polisario et le Maroc se sont ouvertement affrontés sur ce territoire jusqu’en 1991. Si le Front Polisario a pu tenir tant d’années sans qu’il n’y ait aucun vainqueur, c’est parce qu’il y a un troisième acteur fondamental dans ce conflit : l’Algérie. La capacité de résistance et l’efficacité de cette résistance du Front Polisario face au Maroc est principalement due au soutien de son allié algérien qui lui a apporté pendant les affrontements une aide matérielle et logistique importante, et lui apporte toujours une aide financière6. En effet, au delà de la question de la reconnaissance du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui portée par le Front Polisario et soutenu par l’Algérie depuis quarante ans, le conflit du Sahara occidental est également un véritable affrontement entre le Maroc et l’Algérie depuis la période des indépendances7. En 1991, date de la résolution 690 du Conseil de Sécurité des Nations Unie8 ordonne le cessez-le-feu et prévoit l’organisation d’un référendum sur l’autodétermination, dont la MINURSO9, créée par cette même résolution, est chargée. Depuis cette date, aucun référendum n’a été organisé et les deux camps restent figés sur leurs positions sans arriver à s’entendre, séparés par un mur de protection, le Berm10. Le Maroc opposé à l’idée d’un référendum sur l’autodétermination, propose un référendum sur l’autonomie au sein du Royaume. Il refuse les négociations « sans conditions préalables » imposées par la résolution 1754 du Conseil de sécurité 11 et refuse qu’on lui parle d’indépendance. Quant au Front Polisario, il a fait une contre-proposition qui ne rejette pas
1 Provinces de Oued Eddahab-Lagouira, Laayoune-Boudour-Sakia et Guelmin-Smara. 2 C.I.J, Avis consultatif, Sahara occidental, 16 octobre 1975, Recueil C.I.J 1975, p. 12. 3 La Mauritanie s’est retirée du conflit en 1979. 4 Ci-après, la RASD. 5 Résolution 1514 (XV) – Déclaration sur l’Octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Assemblée générale des Nations Unies, 14 décembre 1960. 6 Lucile Martin, « Le dossier du Sahara occidental », Les Cahiers de l’Orient, Printemps 2011, n°102, p. 43-57, p. 45. 7 Khadija Mohsen-Finan, Rémy Leveau, « L’affaire du Sahara occidental », Etudes, 2009, n° 1, p. 11-22. 8 Résolution 690 (1991) - La situation concernant le Sahara occidental, Conseil de Sécurité des Nations Unies, 29 avril 1991. 9 Mission des Nations Unies pour le Référendum au Sahara Occidental. 10 Le Berm est le mur de sable qui sépare la partie contrôlée par le Maroc de celle contrôlée par le Front Polisario. Il a été érigé par les autorités marocaines entre 1980 et 1987 afin de contrer les offensives du Front Polisario. 11 Résolution 1754 (2007)- La situation concernant le Sahara occidental, Conseil de Sécurité des Nations Unies, 30 avril 2007.
3
totalement l’offre marocaine mais qui insiste sur la discussion sans conditions préalables. Ainsi, depuis 2007, le statu quo est maintenu. L’année 2012 a été marquée par la visite de plusieurs délégations internationales sur le territoire du Sahara occidental. Tout d’abord, la visite d’une délégation du Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights en août dernier qui s’est soldée par un rapport pour le moins dénonciateur de la situation des droits de l’Homme sur ce territoire, particulièrement du côté marocain12. Ensuite, la première visite au Maroc du rapporteur spécial du Secrétaire Général des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, M. Juan E. Mendez13, qui s’est entre autre rendu à Laâyoune, a été une occasion de plus de rappeler les violations des droits humains commises par les autorités marocaines au Sahara occidental et dans le reste du Maroc14. Enfin, la visite de Christopher Ross- l’envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations Unis pour le Sahara occidental et médiateur officiel du conflit, auquel les autorités marocaines avaient retiré plus tôt dans l’année leur confiance afin de trouver une solution mutuellement acceptable pour les deux parties au conflit15- a constitué, selon Christiane Perregaux16, un événement rupture car il a pu accéder et écouter la société civile sahraouie. Aujourd’hui, l’envoyé spécial du Secrétaire Général poursuit et multiplie les visites et consultations avec les parties prenantes afin de préparer une nouvelle phase de négociation afin que les pourparlers reprennent de manière directe entre le Maroc et le Front Polisario. Il se rendra en ce sens en Afrique du Nord à la fin du mois de Mars 201317. Mais le premier trimestre de cette année ne laisse rien présager de positif quant à une reprise des pourparlers, notamment du côté marocain. En témoigne d’abord le procès des 25 sahraouis devant les tribunaux militaires de Rabat- Salé. Le verdict prononcé le 17 février 2013 par le tribunal militaire les a jugé coupables de « constitution de bandes criminelles » et de « violences sur les forces de l’ordre ayant entrainé la mort avec préméditation et mutilation
12 Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, « Rapport préliminaire sur les violations des droits de l’Homme dans le Sahara occidental », 3 septembre 2012, consulté le 6 mars 2013, disponible sur : http://rfkcenter.org/images/attachments/article/1703/Observation%20pr%C3%A9liminaires%20-%20Centre%20RFK%20-%20Fran%C3%A7ais.pdf 13 M. Juan E. Mendez a effectué sa mission au Maroc du 15 au 22 septembre. Pour un résumé de sa visite, consulter : Centre d’actualité de l’ONU, « Maroc : des progrès restent à faire pour mettre fin à la torture, selon un expert de l’ONU », 24 septembre 2012, consulté le 6 mars 2013, disponible sur : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=28990&Cr=maroc&Cr1=#.UUhw-dGcHQZ 14 Juan E. Mendez Rapporteur spécial sur la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport de mission au Maroc, 28 février 2013, consulté le 6 mars 2013 disponible sur : http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-53-Add-2_fr.pdf 15 Khadija Mohsen-Finan, « Le Maroc se prive de la « bienveillance » de l’ONU », affaires-strategiques.info, 29 mai 2012, consulté le 8 mars 2013, disponible sur : http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article6636 16 Chritiane Perregaux est membre du Bureau international pour le respect des droits humains au Sahara occidental. Ces propos ont été recueillis lors de la conférence internationale sur « Le respect des droits de l’Homme au Sahara occidental- Pour la mise en place d’un processus de protection de la population civile sahraouie et de surveillance du respect des droits de l’homme au Sahara occidental » qui s’est tenue au Palais du Luxembourg le 2 février 2013. 17 Centre d’actualités de l’ONU, « L’envoyé de l’ONU pour le Sahara occidental se rend en Afrique du Nord pour préparer la reprise des pourparlers », 15 mars 2013, consulté le 18 mars 2013, disponible sur : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29982&Cr=sahara&Cr1=#.UUhurNGcHQY
4
de cadavres »18. Certains d’entre eux ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. Ces 25 militants sahraouis avaient pour la plupart été arrêtés lors du démantèlement du camp de Gdeim Izik qui avait provoqué des affrontements meurtriers entre les forces de l’ordre marocaines et les résidents du camp. Selon plusieurs organisations de défense des droits de l’Homme, les normes internationales du droit à un procès équitable auxquelles le Maroc est lié n’ont pas été respectées19. Ensuite, nous apprenons qu’au début du mois de mars 2013, quatre euro députés membres de l’Intergroupe sur le Sahara occidental souhaitant se rendre dans cette région dans le cadre d’une mission d’enquête sur la situation des droits de l’Homme, ont été expulsés par les autorités marocaines, qui ont pointé du doigt le déséquilibre de la délégation sur la question. Elles ont ensuite précisé qu’elles n’étaient pas contre la venue d’une délégation européenne équilibrée (c’est-à-dire ne dénonçant pas leurs actions dans le Sahara occidental). Aux vues de la préparation de la reprise des pourparlers et des évènements survenus au cours de ces dernières années, il s’agit donc de faire un bilan du conflit, de ses implications ainsi que de ses répercussions, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle régionale et internationale.
I- Bilan, implications, répercussions au niveau national Le bilan doit être fait au regard des trois parties prenantes fondamentales du conflit : le Maroc, l’Algérie et le Front Polisario à la tête de la RASD. Il doit en outre être réalisé sur deux éléments essentiels: les implications concernant la politique intérieure et les répercussions économiques nationales. Implications de politique intérieure Du côté marocain d’abord, les évènements récents liés à la question du Sahara évoqués sont-ils révélateurs d’une monarchie chérifienne qui se sentirait fragilisée ? On sait bien que la question sahraouie, avant d’être une question régionale et internationale, est d’abord une question de politique intérieure. Il en va de la sécurité et de l’équilibre intérieur du Maroc car ce dernier a fait de la question du Sahara occidental un des éléments fondamentaux de son unité nationale20, comme le confirme le préambule de sa constitution21. Le Maroc ne cèdera pas à un règlement en sa défaveur car il pourrait déstabiliser la monarchie et redonner l’impulsion susceptible de faire renaitre des revendications de réformes et des vagues de protestation plus fortes que celles qu’il a connu depuis le début du Printemps arabe. Cette
18 FIDH, « Verdict du tribunal de Salé contre 25 Sahraouis : la FIDH dénonce une procédure non conforme aux standards internationaux », 18 février 2013, consulté le 6 mars 2013, disponible sur : http://www.fidh.org/Verdict-du-tribunal-de-Sale-contre-12914 19 ibid. 20 Lucile Martin, op. cit. 21 « État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen. » Préambule (Paragraphe 3), Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011.
5
crainte de l’explosion sociale au Maroc est à redouter dans les années à venir, car les réformes impulsées par Mohammed VI au début du Printemps Arabe afin d’endiguer les vagues de protestation, n’ont pas été à la hauteur des espérances des Marocains qui disent d’ailleurs selon une étude récente, vouloir quitter leur pays pour près de la moitié d’entre eux 22. Ainsi, le comportement des autorités marocaines en ce début d’année 2013 ne serait-il pas une manière de renforcer la légitimité de l’Etat après avoir été un peu trop souple en 2012 ? On se souvient pourquoi Hassan II avait provoqué la Marche Verte en 1975. La Monarchie se sentait affaiblie. À cette époque, le Royaume connaissait des grèves d’ouvriers et d’étudiants et des émeutes. Le roi avait été victime de deux tentatives de coups d’Etat successifs quelques années plus tôt et n’était pas à l’abri d’en subir de nouveaux face à une classe militaire au combien puissante. La décolonisation du Sahara occidental offrait à Hassan II l’opportunité rêvée afin de consacrer la légitimité de son pouvoir et l’unité nationale du Maroc. Elle lui permettait également d’éloigner l’armée de Rabat, bien trop occupée à « administrer » cette région du grand sud et à y faire des affaires fructueuses. Comme le dit Saïd Haddad, à l’époque, « la reprise en main de l’appareil militaire fut également facilitée par le dossier du Sahara occidental, pour lequel 120 000 militaires sont mobilisés et qui permit au monarque de trouver un exutoire aux forces armées qui délaissent ainsi la scène politique marocaine »23. Ainsi, envisager le règlement du conflit impliquerait également pour le roi de trouver une solution afin d’occuper les Forces armées royales et les Forces auxiliaires présentes en masse depuis quarante ans dans le grand sud et dont la raison d’être est d’y maintenir le contrôle du Royaume. Il s’agirait de contenir leur sentiment d’humiliation en cas de règlement du conflit en défaveur du Maroc et de les maintenir en marge de la scène politique marocaine. Il est donc inenvisageable pour le Maroc d’envisager un règlement du conflit en leur défaveur à l’heure actuelle. De plus les manifestations quotidiennes démontrent le mécontentement de certaines franges de la population marocaine vis à vis de ceux qui la dirige sur de nombreux sujets. On pouvait donc s’attendre à un durcissement ou du moins, ne pas s’attendre à un réel relâchement sur la question du Sahara occidental. Elle reste encore à l’heure actuelle un élément fondamental de l’unité nationale et de la légitimité du système marocain. Mais les visites de délégations internationales dans le Sahara occidental au cours de l’année 2012 n’ont fait que renforcer la critique de la politique marocaine à l’égard de la gestion de cette question. Les rapports issus de ces visites prouvent non seulement que la situation des droits de l’Homme au Sahara occidental ne s’améliore pas, mais également que toute forme de contestation de la politique marocaine concernant le Sahara occidental est vivement réprimée. Ils ont en outre mis en évidence la contradiction des autorités marocaines quant à
22 Cette étude indique que 42 % des marocains interrogés (4000 migrants anciens ou potentiels) envisagent d’émigrer à long terme, pour des raisons économiques mais pas seulement. Cette étude a été réalisée par l’agence européenne European Training Foundation en partenariat avec l’Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur la Migration (AMERM), et les autorités marocaines. In European Training Foundation, « Migration et compétences – Le rôle des compétences dans le phénomène migratoire au Maroc», février 2013, consulté le 16 mars 2013, disponible sur : http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/94199E6A3A9FEB1AC1257B1E0030827F/$file/Report%20Migration%20and%20skills_Morocco.pdf. 23 Saïd Haddad, « Des armées maghrébines appelées à se renforcer », Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe (IRIS), février 2013, consulté le 23 mars 2013, disponible sur : http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/obs-monde-arabe/2013-02-obs-monde-arabe.pdf
6
l’évolution de la situation des droits de l’Homme sur son territoire. Depuis la fin des années de plomb, l’avancée est bien réelle en matière de droits de l’Homme au Maroc, excepté sur tout ce qui a un rapport avec le Sahara occidental. A titre de premier exemple, la politique de réconciliation après les années de plomb, initiée par Mohammed VI, n’a pas concerné les sahraouis qui ont été sous représentés lors des auditions publiques24 organisées par la l’Instance Equité et Réconciliation25. Cet écart entre l’évolution ressentie dans le reste du Maroc et celle dénoncée dans la région du Sahara occidental se traduit en outre par une présence en masse de la police et de l’armée exerçant sur les populations manifestant pacifiquement des brutalités et restant impunis. La torture et les traitements inhumains et dégradants, la criminalisation de toute critique de la politique gouvernementale sur cette question restent largement d’actualité. Les personnes qui oseraient parler de l’organisation d’un référendum n’ont qu’à bien se tenir, s’ils ne veulent pas être poursuivis pour trahison. Enfin, la liberté d’association est quasi inexistante pour les organisations sahraouies qui ont interdiction de fonder un parti politique sur une revendication autonomiste, comme cela est écrit à l’article 7 dans la Nouvelle Constitution de 201126. Si les autorités marocaines tentent de faire bonne figure quant à l’évolution positive de la situation des droits de l’Homme dans le Sahara, par des initiatives telles que l’ouverture à Laâyoune d’un bureau de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, organe public « indépendant », les critiques se font vives dans les enceintes internationales, notamment au sein du Conseil des Droits de l’Homme. Sans aller jusqu’à confirmer la thèse du Front Polisario qui considère le dossier du Sahara occidental comme un instrument au service du maintien d’un système inégalitaire au Maroc, en maintenant le sentiment de siège et de menace contre la société marocaine permettrait de maintenir un ordre répressif en assimilant toute critique interne à une tentative de division de la nation, analyse qui semble un peu datée après les évènements du Printemps arabe, il semble qu’il faille donner l’importance qui se doit à la dimension sécuritaire pour le Maroc qu’a le maintien du statu quo et le maintien de sa position sur la question du Sahara occidental.
Le Front Polisario, de son côté, existe grâce au conflit, mais le manque de contenu à son projet politique commence à l’affaiblir. En dehors de ses revendications territoriales, il ne semble rien proposer d’autre et, selon Khadija Mohsen-Finan,27 il commence à en payer le prix de son influence auprès de la population sahraouie. Il paye également le prix d’un échec du règlement du conflit après près de quarante années à la tête de la RASD. Pour l’ensemble de ces raisons, il a du faire face à des vagues de contestations au sein de sa population. Manifestations devant le siège du Polisario ou dans les camps de Tindouf, création du groupe
24 Les sahraouis n’ont représenté que 2% des personnes auditionnées alors que les trois régions du Sahara occidental avaient fait 23, 58 % des demandes auprès de l’Instance Equité et Réconciliation. In Khadija Mohsen-Finan, « Sahara occidental : divergences profondes autour d’un mode de règlement », L’année du Maghreb, 2009, n° V-2009, p. 553-559. 25 ibid. 26 « Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou, d’une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux Droits de l’Homme. Ils ne peuvent avoir pour but de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l’unité nationale et l’intégrité territoriale du Royaume », Article 7, Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011. 27 Khadija Mohsen- Finan, politologue et chercheure associée à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), est spécialiste du Maghreb et des questions méditerranéennes.
7
de la « Jeunesse de la révolution sahraouie » qui appelle à la reprise de la lutte armée ainsi qu’à l’arrêt des contacts avec le gouvernement marocain depuis la décision des tribunaux militaires ayant condamné 25 sahraouis en février dernier, et qui dénonce le clientélisme et la corruption à l’œuvre au sein du Polisario, sont autant de signes attestant sa fragilité. Les soulèvements dans les camps sont révélateurs des difficultés accrues des populations à y vivre. Il est difficile voire impossibilité pour le Polisario de mettre en place une réelle stratégie de développement autour d’activités agricoles, base de l’économie sahraouie, et autour de l’exploitation de ses sols riches en minerais28 alors qu’une grosse partie de la population vit dans des camps, qu’une autre partie de la population sahraouie est hors du territoire qu’il contrôle et que de nombreuses zones restent minées. De plus, il risque de payer le prix de la diminution drastique de l’aide au développement donnée par les Espagnols afin d’aider les populations des camps. Enfin, ce dernier doit payer les conséquences de la mauvaise réputation qu’est en train de lui faire le Maroc, en disséminant dans les enceintes internationales l’idée qu’il aurait des connexions avérés avec AQMI, le réseau Al Qaeda au Maghreb islamique29. Ces rumeurs ont été transformées en un réel soupçon par un rapport de l’European Strategic Intelligence and Security Center30. Mais il faut bien sûr rester méfiant quant à ces allégations car cela signifierait que le Front Polisario aurait pris le risque d’un discrédit politique total tant sur la scène intérieure que sur la scène internationale, en s’alliant à de telles activités.
Quant à l’Algérie, elle peut se voir transposer dans une certaine mesure l’analyse faite pour le Maroc, en terme de maintien du système et de la stabilité du pouvoir en place. Si pour Alger, la position qu’elle tient sur la question du Sahara occidental est affichée comme « une question de principe et de solidarité avec un peuple victime de la colonisation »31, elle est surtout nécessaire afin de légitimer le pouvoir en place, la puissance de l’armée et de susciter un sentiment d’unité nationale32. Si le gouvernement algérien a pu jusqu’à aujourd’hui faire en sorte de contenir les contestations par une politique de redistribution des richesses de la rente pétrolière, cette politique n’est pas durable et reste très aléatoire33. Si les traumatismes de la guerre civile restent encore très prégnants dans l’esprit des Algériens, au point de croire que le gouvernement n’a pas trop de craintes à avoir pour les prochaines années, Maroc comme Algérie devront tôt ou tard concentrer toutes leurs forces sur le développement économique de leur pays et de contenter les aspirations de leurs populations. En effet, le conflit du Sahara occidental a de lourdes répercussions sur leurs économies nationales.
28 Lucile Martin, op.cit. 29 Khadija Mohsen-Finan, op.cit. 30 Giacomo Morabito, « Sahara occidental. Le risque d’une absence de solution », Institut MEDEA, 18 juin 2012, consulté le 6 mars 2013, disponible sur : http://www.medea.be/2012/06/sahara-occidental-le-risque-dune-absence-de-solution/ 31 ibid. 32 Luis Martinez, « Frontières et nationalisme autour du Sahara occidental », CERISCOPE Frontières, 2011, consulté le 6 mars 2013, disponible sur : http://ceriscope.sciences-po.fr/node/62. 33 ibid.
8
Répercussions sur les économies nationales et accroissement des contestations
Le conflit du Sahara occidental a de lourdes répercussions sur les économies du Maroc et de l’Algérie. La stratégie de sécurisation du Sahara occidental a couté très cher au Maroc depuis le début du conflit. Le coût des 120 00034 à 160 00035 militaires marocains mobilisés dans cette région, la construction et l’entretien du Berm, mais également la politique de développement de la région du grand sud (incitation économique des Marocains à s’installer dans la région, construction d’infrastructures de base)36 sont autant d’argent dépensé qui ne sert pas au développement économique et social du reste du pays. Le budget marocain consacré à la défense représente 3, 5 % de son PIB37 et les dépenses depuis le début du conflit sont estimées à 2, 4 milliards de dollars rien qu’en infrastructures de base38. Si les autorités marocaines ont justifié ces dépenses auprès de leurs populations comme un « investissement »39, le constat est celui de l’absorption de la croissance du PIB par le conflit40. Une partie de la société civile marocaine considère de plus en plus que le conflit du Sahara représente un coût qu’il ne peut plus se permettre car le reste du Maroc est en demande de développement. Selon Fouad Abdelmoummi, membre de l’Association Marocaine des Droits de l’Homme, « le cout de ce conflit est simplement le non-développement du Maroc »41. Ainsi, Rabat commence à être fragilisé sur la légitimité de sa gestion du conflit, qui est loin de faire l’unanimité chez les Marocains à l’heure actuelle, surtout chez les jeunes, et dont beaucoup ressentent que leur situation économique et sociale se rapproche des celle des jeunes sahraouis42. En effet, la changement de configuration des contestations de la population sahraouie a été constaté depuis les évènements de Gdeim Izik, qui avaient réuni plus de 20 000 personnes et démontré une forte capacité de mobilisation et de retentissement sur la scène internationale43. Ce changement s’est manifesté par le passage à des manifestations pacifiques des jeunes sahraouis dans les camps sur fond de dénonciation de la corruption des autorités mais surtout des mauvaises conditions économiques et sociales (accès à l’emploi, logement) ne leur offrant pas de perspective d’avenir44. Ces revendications se rapprochent sensiblement des revendications exprimées par les jeunes du reste du Maroc, notamment celles des « diplômés chômeurs » et du « mouvement du 20 février ». Le regroupement de l’ensemble des contestataires du système est un scénario qui s’avère de plus en plus plausible. Un autre scénario plausible est celui de l’exacerbation des tensions
34 Saïd Haddad, op.cit. 35 Lucile Martin, op.cit. 36 ibid. 37 Saïd Haddad, op.cit. 38 International Crisis Group, « Western Sahara : The cost of the conflict », Rapport Moyen Orient/ Afrique du Nord, 2007, n°65, consulté le 19 mars 2013, disponible sur : http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/North%20Africa/Western%20Sahara/65_western_sahara___the_cost_of_the_conflict.ashx 39 ibid. 40 ibid. 41 ibid. 42 Carmen Gomez Martin, « Sahara occidental : quel scénario après Gdeim Izik ? », L’année du Maghreb, 2012, n°VIII- 2012, p. 259-276. 43 Ces événements ont été rapportés lors du second Examen Périodique Universel du Maroc en 2012 devant le Conseil des Droits de l’Homme 44 Carmen Gomez Martin, op.cit.
9
intercommunautaires. Les tensions entre étudiants marocains et sahraouis sont réelles, comme en témoignent les incidents dans les différents quartiers universitaires du royaume, notamment à Rabat, Marrakech et Agadir au cours des dernières années. Un grand nombre d’étudiants marocains semblent avoir de plus en plus de mal à accepter les privilèges accordés par les autorités aux étudiants sahraouis, notamment parce qu’ils bénéficient d’aides diverses, et à l’inverse, un grand nombre d’étudiants sahraouis se sentent discriminés au sein de la société marocaine. Mais ces tensions vont bien au delà du cadre étudiant. La cohabitation est de plus en plus difficile entre Marocains et Sahraouis dans la région du Sahara occidental et le climat y est très tendu. Les frustrations augmentent au sein de la population sahraouie qui n’ont pas accepté la politique de marocanisation de leur territoire45 faite de discriminations de traitement entre marocains installés et sahraouis, mais aussi parce qu’elle les a obligé à se sédentariser, ce qui a provoqué des problèmes d’adaptation pour ces populations qui vivaient du pastoralisme, et qui ne peuvent pas non plus exploiter les terres sur de nombreuses zones. La guerre entre le Front Polisario et le Maroc durant près de vingt a laissé des mines46 que la MINURSO peine à retirer. Enfin, l’exploitation des ressources naturelles 47 du Sahara occidental par le Maroc ne favorise pas l’apaisement de tensions intercommunautaires alors que les inégalités sociales se creusent. Du côté algérien, la stratégie de soutien à tout prix de la revendication d’indépendance du Sahara occidental lui a également coûté cher. L’Algérie soutient financièrement le Front Polisario depuis sa création et la présence des camps de réfugiés sahraouis dans l’ouest du pays l’oblige à mobiliser plusieurs dizaines de milliers de soldats dans la région de Tindouf48. Depuis la diminution de l’aide humanitaire dans les camps, elle doit également soutenir plus fortement les besoins alimentaires des populations sahraouies sur son territoire49, alors même que la situation économique et sociale de sa propre population est loin d’être enviable. Si l’Algérie reste un pays riche et que sa rente pétrolière lui permet pour le moment « d’acheter une paix sociale » en redistribuant des subventions aux populations50, cette rente n’est pas éternelle et c’est le coût plus global de son conflit avec le Maroc qui commence à peser lourd, notamment sur la plan de la sécurisation de l’ensemble du Sahara et de l’intégration économique régionale.
Ainsi, si l’un des fondamentaux de l’unité nationale du Maroc et de l’Algérie est contesté par leurs populations, les régimes sont conscients qu’ils pourraient en payer le prix de leur stabilité au pouvoir. Quant aux répercussions économiques nationales du conflit, le prix revient sans hésitations au Maroc, quoi que l’Algérie comme le Maroc en payent lourdement le coût de l’absence d’intégration économique régionale.
45 Carmen Gomez Martin, op.cit. 46 Lucile Martin, op.cit. 47 Le Sahara occidental est riche en phosphate et en ressources halieutiques. 48 International Crisis Group, op.cit. 49 ibid. 50 Jacques Hubert-Rodier, « Pourquoi l‘Algérie est restée à l’écart du printemps arabe », Les Echos, 19 décembre 2012, p. 9, consulté le 23 mars 2013, disponible sur : http://www.lesechos.fr/19/12/2012/LesEchos/21337-036-ECH_pourquoi-l-algerie-est-restee-a-l-ecart-du-printemps-arabe.htm
10
II- Bilan, implications et répercussions au niveau régional et international
Le conflit du Sahara occidental a des répercussions au niveau régional et international. Répercussions au niveau régional Le conflit concernant le Sahara occidental a des répercussions sur la politique régionale. Il explique d’abord une grande partie de la politique diplomatique marocaine dans la région. Le Maroc est plus tourné vers l’Europe que vers le continent africain. Les Marocains disent souvent eux même se sentir plus proches de l’Europe que de l’Afrique et peu d’entre eux se sentent « Africains ». Le Maroc s’est longtemps privé de bonnes relations diplomatiques avec le continent africain, notamment avec l’Union Africaine51 dont il est sorti en 1984 après que la RASD ait été admise en son sein en 198252. Nombreux sont les Etats qui l’entourent qui ont reconnu la RASD. Mais les autorités marocaines ont tenté de remédier à ce handicap en développant des relations économiques avec l’Afrique subsaharienne depuis une quinzaine d’années, adoptant finalement une attitude plus pragmatique privilégiant les intérêts économiques du pays53. Le Maroc a donc fini par refuser l’isolement vis à vis des pays d’Afrique subsaharienne même si cette diplomatie reste seulement économique. Mais ce sont les relations entre le Maroc et l’Algérie, bloquées par de vieilles rancœurs, des conflits territoriaux et leur volonté de domination respective de la région Maghreb, qui ont les répercussions régionales les plus importantes. Le blocage sur la question du Sahara occidental empêche en partie de faire avancer l’Union du Maghreb Arabe54 et la région en paye d’autant le coût du non développement économique. Le commerce intra-Maghreb est très peu développé et représente seulement 2 % du commerce extérieur de chacun des pays le composant55. Le Maghreb en paye également le prix de ne pas peser plus de poids au sein des instances internationales, notamment dans le dialogue euro-méditerranéen afin de défendre au mieux les intérêts partagés des pays de la région. Le Maghreb en paye également le cout d’une relative inefficacité dans la lutte globale contre terrorisme islamiste ainsi que la lutte contre les trafics en tous genre, du fait du manque de coopération entre les différents pays de la zone56. Si les Etats Unis et la France sont des alliés sûrs du Maroc, où ils ont tous deux des intérêts économiques importants, les risques de déstabilisation de la région par le développement des 51 Le Maroc était l’un des pays fondateurs de l’Organisation de l’Union Africaine, fondée en 1963. 52 Ali Amar, « Pourquoi le Maroc n’est pas membre de l’Unité Africaine », 6 juin 2012, SlateAfrique.com, consulté le 23 mars 2013, disponible sur : http://www.slateafrique.com/88449/pourquoi-maroc-pas-membre-union-africaine 53 Nezha Alaoui, « La projection économique des pays du Maghreb sur l’Afrique subsaharienne », IFRI- Centre des Etudes économiques, 2010, consulté le 23 mars 2013, disponible sur : http://www.ifri.org/downloads/noteocpalaouidef.pdf 54 L’Union du Maghreb Arabe fut fondée en 1989 et regroupe l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie afin d’amorcer un processus d’intégration régionale. 55 International Crisis Group, op.cit. 56 ibid.
11
activités des groupements terroristes islamistes dans la région sont exacerbés par le conflit du Sahara occidental. Les Etats Unis ont assoupli leur position concernant le règlement du conflit en s’adossant à la proposition des Nations Unies d’une reprise des négociations sans conditions préalables afin de trouver une solution rapide. Pour les Etats Unis, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et au Maghreb ne pourra être efficace que si l’ensemble des Etats de la région coopèrent, et sont donc pour un rétablissement rapide des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc57. Selon l’Institut MEDEA, le Sahara occidental est en phase de devenir un lieu important de recrutement pour les organisations terroristes de la région58. La déstabilisation de la région déjà largement amorcée, comme en témoigne la situation dans le Nord du Mali, ne fait que renforcer la position des Etats Unis. La France, quant à elle, reste plus timorée quant à la formulation de recommandations aux autorités marocaines. Lors de sa dernière visite en Algérie, François Hollande a réaffirmé que la question devait être traitée aux Nations Unis afin qu’elles mettent en place des négociations entre les deux parties. Des intérêts diplomatiques font que le France n’affirme pas ouvertement son soutien à la position marocaine, d’autant plus cette fois puisqu’il était en Algérie, mais la réalité est que la France a toujours soutenu le Maroc. La raison fondamentale souvent évoquée par les spécialistes est celle des intérêts économiques. En effet, la France n’a jamais voulu que l’ensemble du Sahara occidental passe sous influence algérienne, voyant cela comme un élément de déstabilisation de son partenaire économique, politique et culturel marocain59. Mais la raison fondamentale de la position française sur le Sahara occidental est également liée à la relation froide entre la France et l’Algérie, qui sont tous deux incapables de passer ensemble à autre chose que leur douloureux passé en commun. Si l’on suit cette hypothèse, ce n’est pas seulement le conflit du Sahara occidental qui aurait des répercussions sur les relations entre l’Algérie et la France, comme le pense Lucile Martin60, mais c’est bien aussi parce que la France et l’Algérie ne s’entendent pas et que la France a de larges intérêts au Maroc, que la France a cette position sur le Sahara occidental. De plus, les perspectives de puissance de l’Algérie dans la région inquiètent. Elle est la mieux placée économiquement à l’heure actuelle afin de devenir le leader régional. Au sein de l’Union européenne, c’est bien les intérêts économiques qui ont primé jusqu’ici, et donc les échanges avec le Maroc, laissant donc de côté la question politique du Sahara occidental. Mais cette dernière ne peut plus être mise de côté désormais. Le rapport de force commence à changer au sein de l’Union européenne, notamment au sein du Parlement européen concernant la conservation des échanges avec le Royaume tels qu’ils l’ont été jusqu’à aujourd’hui. Le Parlement européen a en effet bloqué le renouvellement des accords de pêche avec le Royaume en mettant en cause la légalité internationale de ces accords qui incluaient les eaux du Sahara occidental qui concentrent près de la moitié des ressources halieutiques du Maroc. Les eurodéputés ont considéré que l’exploitation excessive des ressources de pêche, le faible rapport coût-bénéfices de l’accord, et l’absence de prise en
57 Lucile Martin, op.cit. 58 Giacomo Morabito, op.cit. 59 Lucile Martin, op.cit. 60 ibid.
12
compte des intérêts de la population sahraouie61. Des négociations ont lieu depuis fin 2011 afin de trouver un nouvel accord et le sixième round se déroulera dans les prochains mois, alors que l’Espagne tente de forcer l’accord afin que les pêcheurs espagnols, principaux bénéficiaires de l’accord, puissent retourner pêcher dans ces zones. Enfin, en dehors du changement du rapport de force au sein du Parlement européen, le parlement suédois en a également amorcé un en étant le premier des parlements des Etats membres de l’Union européenne, à avoir reconnu la République Arabe Sahraouie Démocratique. Cette reconnaissance par l’appareil législatif doit désormais être mise en œuvre par le gouvernement suédois qui semble encore bien loin de vouloir s’y conformer62. Au delà de ses répercussions régionales, le conflit a également des implications sur la scène internationale, principalement dans l’enceinte des Nations Unies. Répercussions sur la scène internationale Le constat principal est celui des échecs successifs des Nations Unies et de la MINURSO, l’un à parvenir à un accord entre les parties au conflit, l’autre à pouvoir exercer le mandat pour lequel elle a été créée. Le rôle de la MINURSO est de plus en plus remis en question car elle ne peut exercer le mandat pour lequel elle a été créée en 1991 lors du cessez-le-feu. Selon la résolution 690 du Conseil de Sécurité, elle a pour mandat principal d’identifier et d’enregistrer les électeurs, d’organiser le référendum de manière libre et équitable, et de proclamer les résultats63 tout en garantissant le maintien du cessez-le-feu. Or, le projet de référendum tel que prévu lorsque cette opération de maintien de la paix a été créée est mort et étant donné que l’organisation d’aucun référendum n’a été possible jusqu’à maintenant, elle ne peut assurer cette mission principale. Elle peut seulement garantir le maintien du cessez-le-feu, procéder au déminage de certaines zones, et encourager les mesures de réconciliation tout en assurant que les visites de familles puissent s’effectuer dans les différents camps dans de bonnes conditions64. Son mandat a été prolongé jusqu’au 30 avril 2013 par le Conseil de Sécurité et sera certainement encore prolongé après cette date au regard de la reprise des pourparlers se profilant et au regard de la crainte d’une déstabilisation de l’ensemble de la région du Sahel. Pourtant, le coût de cette mission pèse dans le budget des Nations Unies depuis plus de vingt ans à hauteur de 45 millions de dollars par an, auxquels s’ajoutent l’aide humanitaire des Nations Unies émanant du Haut Commissariat aux Réfugiés et du Plan Alimentaire Mondial à
61 RFI, « Accord de pêche : coup de froid entre le Maroc et l’Union européenne », rfi.fr, 15 décembre 2011, consulté le 23 mars 2013, disponible sur : http://www.rfi.fr/afrique/20111215-accord-peche-coup-froid-entre-le-maroc-union-europeenne 62 Jens Holm, député du Parlement suédois. Ces propos ont été recueillis lors de la conférence internationale sur « Le respect des droits de l’Homme au Sahara occidental- Pour la mise en place d’un processus de protection de la population civile sahraouie et de surveillance du respect des droits de l’homme au Sahara occidental » qui s’est tenue au Palais du Luxembourg le 2 février 2013. 63 Résolution 690 (1991) - La situation concernant le Sahara occidental, Conseil de Sécurité des Nations Unies, 29 avril 1991. 64 Site de la MINURSO, disponible sur : http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/minurso/
13
destination des camps et tous les autres coûts liés au travail du Conseil de sécurité sur la question, les missions des envoyés spéciaux65. Le constat est également celui de l’échec des négociations dans le cadre des Nations Unies afin de parvenir à un accord permettant de régler ce conflit qui perdure. Christopher Ross, actuel envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental a bien failli subir le même sort que ses prédécesseurs au courant de l’année 2012. Les autorités marocaines avaient retiré leur confiance au médiateur, arguant de sa partialité dans sa tentative de règlement du conflit66. Mais il n’a pas présenté sa démission et a finalement pu rétablir sa relation avec les autorités marocaines, comme en témoigne ses récentes visites au Maroc et dans la partie du Sahara occidental contrôlée par le Maroc, dans le cadre de la poursuite du processus de préparation à la reprise des pourparlers67. Ses prédécesseurs James Baker et Peter Van Walsum avaient quant à eux dû démissionner, le premier après le rejet de deux plans par les parties prenantes, et le second après la demande de son départ par le Front Polisario68. L’ensemble des tentatives de négociations afin de trouver un accord et l’ensemble des propositions faites depuis celui de la signature du cessez-le-feu en 1991, ont été un échec et ont même reculé. Si en 1991 le Maroc avait accepté l’idée de l’organisation d’un référendum sur l’autodétermination, il a fini par se rétracter en revenant à l’idée d’autonomie, du fait de l’impossibilité de trouver un accord sur la composition du corps électoral participant au référendum sur l’autodétermination69. Le constat est donc pour le moment celui de l’échec des Nations Unies à parvenir à trouver une solution mutuellement acceptable pour le Maroc et le Front Polisario. Si les efforts de Christopher Ross en la matière sont réels, le contexte actuel et la fragilité des régimes en place fait douter de la possibilité d’un règlement prochain du conflit.
---
L’issue du conflit semble à la fois lointaine et proche. Lointaine car, comme le dit Khadija Mohsen-Finan, « pour la monarchie marocaine, la cause sacrée de la récupération de « provinces sahariennes » a beaucoup trop lourdement hypothéqué la vie politique du pays pour que la monarchie s’engage dans une aventure électorale avant de s’assurer une franche victoire. Pour le Front Polisario, la consultation est capitale puisque, en cas d’échec, il cesserait d’exister en tant qu’acteur régional et international et serait tout simplement rayé de l’histoire. »70 . De plus, la défaite du Front Polisario signifierait également la défaite de l’Algérie. Ainsi, régler le conflit du Sahara occidental signifierait obligatoirement légitimer une partie et en délégitimer une autre, tant le conflit conditionne la stabilité de leur système politique. Si le Maroc venait à céder sur le Sahara occidental, en découlerait l’ébranlement 65 International Crisis Group, op.cit. 66 Khadija Mohsen-Finan, op.cit. 67 Centre d’actualités de l’ONU, « L’envoyé de l’ONU pour le Sahara occidental se rend en Afrique du Nord pour préparer la reprise des pourparlers », op. cit. 68 Khadija Mohsen-Finan, « Le Maroc se prive de la bienveillance de l’ONU », op.cit. 69 Khadija Mohsen-Finan, op.cit. 70 Khadija Mohsen-Finan, Rémy Leveau, op.cit.
14
voire la fin du système politique marocain. Si l’Algérie venait à céder, en découlerait également une remise en cause probable du régime de Bouteflika. Dans le contexte du réveil des peuples arabes et de l’enveniment de la crise au Sahel, ni le Maroc, ni l’Algérie, ni les pays occidentaux ne sont près à prendre le risque de déstabiliser encore plus la région. Le conflit risque donc de perdurer. Tout au mieux, si une issue intermédiaire au conflit devait être trouvée, il y a peu de chances qu’elle le soit dans la négociation entre le Front Polisario et le Maroc, mais plutôt entre le Maroc et une autre représentation de la volonté sahraouie, car au delà de la volonté des Etats Unis, de la France, des autorités marocaines, algériennes et sahraouies, il y a bien la volonté du peuple. L’issue du conflit pourrait en ce sens être proche. La voix du peuple sahraoui est placée au centre d’un espoir de résolution du conflit, tout comme ce fut le cas en Tunisie et en Egypte, car c’est bien le peuple, « en tant qu’entité libre et autonome (…) qui exprimera in fine sa volonté de vivre de manière indépendante ou dans le cadre d’une autonomie au sein du Maroc souverain »71. La voie de la jeunesse sahraouie et de l’ensemble de la jeunesse du monde arabe aura l’occasion d’en débattre et de s’exprimer lors du Forum Social Mondial de Tunis le 26 mars prochain.
71 Khadija Mohsen-Finan, « Le Maroc se prive de la « bienveillance » de l’ONU », op.cit.
15
Annexe 1 : Avis consultatif, Sahara occidental, Cour internationale de Justice, 16 octobre 1975 « Les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l’existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques d’allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental. Ils montrent également l’existence de droits, y compris certains droits relatifs à la terre, qui constituaient des liens juridiques entre l’ensemble mauritanien, au sens où la Cour l’entend, et le territoire du Sahara occidental. En revanche, la Cour conclut que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n’établissent l’existence d’aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d’une part, le Royaume du Maroc ou l’ensemble mauritanien d’autre part. la Cour n’a donc pas constaté l’existence de liens juridiques de nature à modifier l’application de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations Unies quant à l’application du principe d’autodétermination grâce à l’expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire »72. Annexe 2 : Cartes
72 C.I.J, Avis consultatif, Affaire du Sahara occidental, 16 octobre 1975, Recueil C.I.J 1975, p. 12.
16
Références :
I-‐ Articles :
Nezha Alaoui, « La projection économique des pays du Maghreb sur l’Afrique subsaharienne », IFRI- Centre des Etudes économiques, 2010, consulté le 23 mars 2013, disponible sur : http://www.ifri.org/downloads/noteocpalaouidef.pdf Ali Amar, « Pourquoi le Maroc n’est pas membre de l’Unité Africaine », 6 juin 2012, SlateAfrique.com, consulté le 23 mars 2013, disponible sur : http://www.slateafrique.com/88449/pourquoi-maroc-pas-membre-union-africaine Carmen Gomez Martin, « Sahara occidental : quel scénario après Gdeim Izik ? », L’année du Maghreb, 2012, n°VIII- 2012, p. 259-276. Saïd Haddad, « Des armées maghrébines appelées à se renforcer », Observatoire des mutations politiques dans le monde arabe (IRIS), février 2013, consulté le 23 mars 2013, disponible sur : http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/obs-monde-arabe/2013-02-obs-monde-arabe.pdf Lucile Martin, « Le dossier du Sahara occidental », Les Cahiers de l’Orient, Printemps 2011, n°102, p. 43-57, p. 45. Luis Martinez, « Frontières et nationalisme autour du Sahara occidental », CERISCOPE Frontières, 2011, consulté le 6 mars 2013, disponible sur : http://ceriscope.sciences-po.fr/node/62. Khadija Mohsen-Finan, « Sahara occidental : divergences profondes autour d’un mode de règlement », L’année du Maghreb, 2009, n° V-2009, p. 553-559. Khadija Mohsen-Finan, Rémy Leveau, « L’affaire du Sahara occidental », Etudes, 2009, n° 1, p. 11-22. Khadija Mohsen-Finan, « Le Maroc se prive de la « bienveillance » de l’ONU », affaires-strategiques.info, 29 mai 2012, consulté le 8 mars 2013, disponible sur : http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article6636 Giacomo Morabito, « Sahara occidental. Le risque d’une absence de solution », Institut MEDEA, 18 juin 2012, consulté le 6 mars 2013, disponible sur : http://www.medea.be/2012/06/sahara-occidental-le-risque-dune-absence-de-solution/
II-‐ Rapports : Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, « Rapport préliminaire sur les violations des droits de l’Homme dans le Sahara occidental », 3 septembre 2012, consulté le 6 mars 2013, disponible sur : http://rfkcenter.org/images/attachments/article/1703/Observation%20pr%C3%A9liminaires%20-%20Centre%20RFK%20-%20Fran%C3%A7ais.pdf Juan E. Mendez Rapporteur spécial sur la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport de mission au Maroc, 28 février 2013, consulté le 6 mars 2013 disponible sur : http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-53-Add-2_fr.pdf International Crisis Group, « Western Sahara : The cost of the conflict », Rapport Moyen Orient/ Afrique du Nord, 2007, n°65, consulté le 19 mars 2013, disponible sur : http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/North%20Africa/Western%20Sahara/65_western_sahara___the_cost_of_the_conflict.ashx