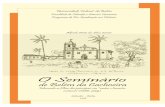Mémoire de J.-J. Pinto sur la psychothérapie des psychoses (1978)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Mémoire de J.-J. Pinto sur la psychothérapie des psychoses (1978)
JEAN-JACQUES PINTO
- - - - - - - - - -
À PROPOS DE LA PRISE ENCHARGE D'UN PSYCHOTIQUE :
RÉFLEXIONS CRITIQUES
_ _ _ _ _ _ _ _
MÉMOIRE POUR LECERTIFICAT D'ÉTUDES SPÉCIALES
DE PSYCHIATRIE
_ _ _ _ _ _ _ _
J U R Y :
MONSIEUR LE PROFESSEUR SUTTER MONSIEUR LE PROFESSEUR DARCOURT MONSIEUR LE DOCTEUR DESPINOY MONSIEUR LE DOCTEUR HAUSER MONSIEUR LE DOCTEUR TOSQUELLAS
_ _ _ _ _ _ _ _
MARSEILLE - 1978
INTRODUCTION
Nous relatons dans le présent travail la prise en charge psychothérapique d'un psychotique chronique sur une période de sept mois. Cette période s'étend du début de la relation psychothérapique jusqu'au moment où notre changement de service nous conduisit à passer le relais à d'autres thérapeutes, c'est-à-dire de janvier à juillet 1975.
Il s'agit pour nous de faire le bilan des facteurs qui sont intervenus pour modifier de façon notable et durable l'état psychique du malade. En effet celui-ci, clinophile, apragmatique et semi-mutique, a évolué vers une autonomie et un investissement du milieu extérieur jamais observés auparavant (Il n'a cependant pas encore pu quitter l'hôpital).
Un résumé de l'observation clinique permettra de situer où en étaient les choses lorsque la prise en charge fut décidée. Viendront ensuite des extraits détaillés des entretiens que nous avions pu transcrire alors ; ils constituent un matériel indispensable à l'interprétation des modifications observées. Puis, après avoir fait un rappel de la théorie lacanienne de la psychose, qui avait été à cette époque notre principale source d'inspiration, nous tenterons une interprétation des faits selon cette optique. Dans une quatrième partie nous exposerons les réflexions et critiques que nous ont inspiré tant le diagnostic clinique que les problèmes pratiques et l'orientation théorique choisie. Ceci nous permettra d'évoquer différents types de psychothérapies de psychotiques, d'examiner en quoi elles se ressemblent ou s'opposent, et de nous interroger sur le ressort de leur efficacité.
Nous conclurons sur ce que cette relation avec un malade psychotique nous a apporté sur le plan de notre expérience personnelle.
OBSERVATION AVANT LA PRISE EN CHARGE
Le dossier psychiatrique ne nous fournit que peu de renseignements sur l'histoire de M. Paul A... Nous savons seulement qu'il est né le 24 mars 1938 à Arles, d'un père policier décédé en 1945 et d'une mère qui n'exerçait pas d"activité professionnelle. Il a trois sœurs. Sa mère est actuellement remariée. Scolarisé jusqu'au certificat d'études, il est entré à l'hôpital à 15 ans, et n'a donc jamais travaillé.
Son certificat d'admission en Placement Volontaire, le 29 mai 1953, indique : "Troubles mentaux caractérisés par des colères violentes non motivées, avec cris, injures, menaces".
Et le certificat de 24 heures :
"Présente une attitude anormale d'indifférence souriante lorsqu'on lui fait reconnaître les troubles du caractère déjà anciens et qui auraient été en s'aggravant ces temps derniers. Les réactions auraient été agressives et violentes en particulier à l'égard de sa mère. Une observation plus prolongée permettra de préciser si l'évolution schizophrénique est en cours ou s'il s'agit de manifestations en rapport avec la période pubérale. D'autre part les renseignements font connaître qu'il existe dans le milieu familial certains éléments ayant pu provoquer et favoriser l'attitude de ce jeune garçon".
Le certificat de quinzaine confirme :
"Présente une importante instabilité psychomotrice avec rapidité dispersée de la pensée, mouvements involontaires (grimaces, tics faciaux) faisant penser parfois à un état sub-choréique. Troubles du caractère et de la conduite à localisation surtout familiale : indiscipline, refus du travail, hostilité parfois. Milieu familial dissocié et incompréhensif. Aspect indifférent et légèrement discordant. En réalité le contact affectif est maintenu, avec une certaine diminution du sens éthique. Possibilité d'un processus encéphalitique latent".
Deux ans plus tard, en 1955, le diagnostic de "démence précoce" est considéré comme certain. On ne mentionne pas de délire. Du point de vue thérapeutique on note une tentative d'insulinothérapie en
1955 (50 séances) sans résultat. Ensuite sont essayés différents neuroleptiques : Largactil de 1955 à 1961, Majeptil de 1961 à 1963, Melleril de 1963 à 1966. De l'Halopéridol, du Nozinan et du Dogmatil sont ajoutés entre 1973 et 1974, à la suite de périodes d'agitation ou de poussées interprétatives.
À son entrée dans notre pavillon, le 6 novembre 1975, il a le traitement suivant :
Haldol 150 gouttes Nozinan 75 gouttes Melleril 70 gouttes Neuleptil 15 gouttes Dipipéron 2 comprimés par jour Artane 5 2 comprimés par jour
Notons que l'observation nous fournit peu d'informations sur le plan psychiatrique. Il semble que le diagnostic de schizophrénie ait entraîné un désintérêt des soignants, qui ne s'occupaient plus du malade que sur le plan somatique et du point de vue occupationnel (ergothérapie).Aucun test psychologique n'a été pratiqué.
L'évolution s'est faite sur un mode déficitaire, le malade abandonnant peu à peu tout intérêt pour le sport, l'ergothérapie, les sorties en permission (avec visites à des prostituées à Marseille), pour aboutir à l'apragmatisme, à la clinophilie, au refus de contact et à un quasi-mutisme. C'est l'état dans lequel il se trouvait lorsque sa prise en charge psychothérapique a commencé.
COMPTE-RENDU DE LA PRISE EN CHARGE PSYCHOTHÉRAPIQUE
Avant de décrire dans le détail le déroulement de cette prise en charge, il est indispensable de préciser dans quel contexte elle s'est faite, comment elle s'est décidée et quelles en étaient les modalités pratiques.
A – LES CONDITIONS INITIALES
Le cadre institutionnelLes participantsL'indicationLa durée et la fréquence des entretiensLe contrôle de la psychothérapieLe remaniement de la chimiothérapie
B – DÉROULEMENT CHRONOLOGIQUE
A – LES CONDITIONS INITIALES
1) Situons d'abord le cadre institutionnel
— Le service dans lequel nous étions interne comprenait quatre pavillons. Deux changements notables venaient d'y survenir :
• la mixité des malades et du personnel infirmier avait été instituée tout récemment. Elle fut réalisée au cours du mois d'octobre 1974.
• Parallèlement se mit en place un réaménagement du mode d'admission des malades dans le service. Un tour de rôle devait permettre de modifier l'ancienne répartition en pavillons de chroniques, pavillons de "difficiles" ou de gâteux et pavillons d'entrants. On compléta cette initiative par la mutation de malades chroniques dans des pavillons ouverts. C'est ainsi que M. A... fut muté dans notre pavillon le 6 novembre 1974.
— L'équipe soignante venait de voir sa composition remaniée par la mixité récente. Elle comprenait des infirmiers et infirmières, une assistante sociale, un psychologue, le médecin-assistant, le médecin-chef, et nous-même, qui venions d'entrer en fonction dans ce pavillon.
Des réunions quotidiennes d'une durée d'une heure commencèrent à se tenir en fin de matinée, où l'on discutait tant des problèmes pratiques et institutionnels que des traitements et des prises en charges éventuelles.
2) Les participants à la prise en charge de M. Paul A. se désignèrent au cours d'une de ces réunions : Madame G. C., infirmière, déjà familiarisée avec les techniques d'entretien psychiatrique, et nous-même.
3) L'indication fut longuement discutée en équipe
— L'idée d'une prise en charge de malades considérés comme chroniques, donc quelque peu "oubliés", était envisagée favorablement dans l'ensemble, et même jugée nécessaire.
— Nous avions personnellement déjà l'expérience d'améliorations de malades chroniques vus régulièrement en entretiens. D'autre part des éléments intéressants concernant la prise en charge des psychotiques avaient été évoqués au cours d'un séminaire de C.E.S. sur les psychothérapies, et contribuèrent à l'élaboration d'hypothèses de travail que nous développerons dans la troisième partie.
— Du côté du patient, aucune demande ne s'était fait jour jusqu'alors. Mais ce point avait été discuté en équipe, et la suite nous confirma dans l'idée que la demande spontanée est impossible chez le psychotique et qu'il ne faut pas l'attendre pour entreprendre quelque chose avec lui : l'« énergie d'activation » doit être fournie, donnée par le thérapeute. Cependant M. A... accepta que nous allions le voir régulièrement.
4) La durée et la fréquence des entretiens ne furent donc pas au début l'objet d'un contrat thérapeutique. Nous voyions M. A. dans sa chambre presque tous les jours pendant environ une heure les quatre premiers mois, puis tous les deux jours environ. Lorsque sa demande propre émergea, dans le dernier mois de la période que nous décrivons, nous le vîmes dans un bureau, en lui fixant des rendez-vous précis d'une fois à l'autre.
5) Quant au contrôle de ce qui se passait dans la relation thérapeutique, il consistait essentiellement en une discussion en équipe pratiquement après chaque entretien. Bien qu'il ait été alors abondamment et soigneusement parlé de cette prise en charge, nous verrons dans le quatrième chapitre en quoi ce mode de contrôle prête à la critique.
6) Signalons pour finir qu'avant le début des entretiens, un remaniement du traitement médicamenteux avait été amorcé, consistant en une diminution de doses de neuroleptiques qui ne se justifiaient plus dans cette période où toute agitation avait cessé.
À la fin du mois de décembre, M. A... prenait quotidiennement :
– 100 gouttes d'Haldol fort – 2 comprimés de Dipipéron – 75 gouttes de Nozinan – 1 comprimé d'Artane 5
Il dormait sans hypnotiques.
DÉROULEMENT CHRONOLOGIQUE
1) "De la naissance à la parole" (Début janvier – Mi-avril 1975)
2) Le réveil du délire
3) Le remembrement symbolique
4) Le relais
1) "De la naissance à la parole" (Début janvier – Mi-avril 1975)
Pour cette période importante, nous ne disposons d'aucun compte-rendu écrit d'entretien, et ce pour deux raisons :
— À ce stade de son évolution il ne parlait pas, c'est nous qui lui parlions.
— Nous ne jugions pas utile de noter dans le détail le texte de nos interventions, considérant que leur impact tenait plus à leur énonciation qu'à leur contenu dont nous verrons qu'il était anodin.
En effet, partant de l'hypothèse qu'il était dans l'impossibilité de symboliser de lui-même son vécu psychique, nous résolûmes de le faire pour lui. Il nous paraissait cependant nécessaire de partir de quelque chose qui venait de lui, pour éviter que par la suite il ne se modèle trop sur des propos où nos projections personnelles auraient été trop évidentes. Nous choisîmes de décrire d'une façon aussi neutre que possible ses gestes, ses attitudes, ses mimiques, réalisant une sorte de "commentaire des actes" ou de miroir verbal. Par exemple : "Vous bougez la tête" – "Vous mettez la main droite dans votre poche" – "Vous nous regardez" – "Vous souriez".
Plus rarement il nous est arrivé d'imiter certains de ses gestes tout en les nommant. Ceci se passait à son chevet, dans sa chambre, car il avait refusé de nous accompagner dans un bureau. Il restait allongé sur son lit pendant toute la durée de l'entretien. Au bout de peu de
temps nous le vîmes commencer à se manifester par des hochements de tête. Quelquefois il disait "Oui" en souriant.
Dans un second temps, il se mit à nous désigner du regard des objets ou des photographies affichées au mur de sa chambre. Nous nommions alors ce qu'il indiquait, et il approuvait d'un signe de tête ou d'un "Oui".
Bientôt il commença à répéter les mots dont nous qualifiions ces objets, et à y associer d'autres mots, très progressivement.
Nous nous fixâmes alors sur ses propos, avec le parti-pris de donner inconditionnellement du sens à tout ce qu'il nous disait, à partir d'associations purement verbales faites par assonance (du type coq-à-l'âne, calembour) ou par contiguïté (le mot qui nous venait à l'esprit par "association libre"). Nous lui proposions ces mots d'un ton assuré et convaincu, comme si nous étions persuadés que cela voulait dire quelque chose. Il ne s'agissait donc pas d'interprétations fondées sur un repérage analytique classique (de type kleinien par exemple), mais plutôt d'une mise en forme arbitraire et systématique de tous ses dires, simplement destinée à engager un processus de communication.
C'est ce qui se passa en effet, puisqu'il se mit rapidement à augmenter son débit verbal, et à faire des phrases complètes, comme si un feed-back s'était établi du fait que nous valorisions a priori ses productions verbales (dont le contenu était alors très banal).
Au cours de cette première phase, nous avions continué à diminuer prudemment son traitement. L'Haldol fut diminué puis supprimé à la fin janvier ; il eut du Dipipéron jusqu'à la fin février. En mars son traitement consistait simplement en la prise quotidienne de 60 gouttes de Nozinan, et ce sans qu'aucune agitation ou symptomatologie délirante ne se manifeste.
Du début mars à la mi-avril, les entretiens se poursuivirent, avec des progrès continus mais assez lents dans les possibilités de verbalisation de M. A ...
2) Le réveil du délire
Nous nous référons ici simultanément aux notes détaillées prises pendant ou après les entretiens et aux données de la feuille de comportement tenue par les infirmiers. La mise en acte par le malade de certains contenus délirants mérite en effet ici autant d'attention que ses dires.
a) Récit détaillé des événements
b) Considérations cliniques sur le délire
a) Récit détaillé des événements
15 Avril 1975 (Claude, C., infirmière)
Vient spontanément me dire qu'il ne va pas bien. "Je suis incapable de me mettre à table, de manger, je ne peux pas bien m'expliquer ; hier les infirmières m'ont fait lever ; il faut que je me lève, je ne suis pas bien, couchéje vais mourir, qu'est ce que je vais devenir, qu'est ce qu'il faut faire ? Depuis hier je n'arrive pas à dormir, je ne pourrais plus partir en permission, je voudrais... je ne peux pas parler, j'ai confiance en vous".
Il reste un moment avec moi, je lui propose du lait qu'il accepte. Un moment après : "je me sens mieux, je vais dormir, je crois que je vais y arriver".
16 Avril 1975
À 14 H n'était pas couché : "ça va pas je dors la nuit, le jour ne n'y arrive pas ; j'ai peur de mourir -" s'est couché et levé à plusieurs reprises ; à table ne mange pas ; vomit le lait qu'il boit. -"Je voudrais ce que vous m'avez donné hier soir" (Renutryl).
5 Mai 1975
À la fin du repas s'est mis à gesticuler et à parler fort "Vive le cachot,
vive le cachot ; moi je ne travaille pas, je ne touche rien. Ici je mange du riz à la "con". On mange mal, on mange con. Ici je maigris". Était très excité, gesticulait.Dans l'après-midi me dit spontanément : "plus que trois jours, je pars, 3 jours chez ma mère". Semblait très content de cette permission.
19 Mai 1975 (nuit)
Depuis 3 H fait le va et vient dans le couloir. Paraît assez excité : voulait absolument voir l'interne pour lui faire voir son pied.
20 Mai 1975
Nous réclame l'ambulance, dit que c'est Pinto qui lui a dit d'aller à l'hôpital civil pour un petit bobo sous le pied.
21 Mai 1975
"Pinto veut qu'on m'opère de la tête. Depuis ce matin il le dit. Il me donne la petite bouteille (1) pour me faire opérer. Il ne ferait pas ça à ma mère ni à mes sœurs, ni à personne de l'hôpital. Moi je ne veux pas me faire opérer mais si Pinto y tient, je me laisserai faire. Je vais souffrir le calvaire. Avant j'aimais bien la petite bouteille maintenant non. J'aimerais mieux être en prison".
(1) ses remèdes sous forme buvable.
22 Mai 1975
Est sorti tout l'après-midi ; est resté dans l'hôpital ; nous avons dû aller le chercher, attendait l'ambulance pour être hospitalisé pour se faire ouvrir la tête.(Nuit) Est resté au rez-de-chaussée jusqu'à minuit. Attendait toujours l'ambulance qui devait l'amener à l'hôpital. S'est endormi vers 1 H.
23 Mai 1975
Est debout prés de la porte d'entrée, attend l'ambulance qui doit l'emmener à l'hôpital. Pinto veut le faire hospitaliser et tuer, on doit l'opérer de la tête, du pied et de deux dents. Ne s'alimente pas ; "ce n'est pas la peine, je vais partir à l'hôpital".
(Nuit) Toujours même comportement. Est resté au rez-de-chaussée jusqu'à 1 H debout derrière la porte. N'a pas dormi.
(Entretien) : "Hier soir et ce matin ma mère est venue. Je ne l'ai pas vue mais elle est venue. On doit m'arracher deux dents pourries et me les enfoncer dans la tête pour me la couper. Vous me torturez, vous, ma mère, et tout le monde. Ça m'em... de répéter toujours les mêmes choses. Je ris mais je suis malheureux. On va m'envoyer à la morgue. Je ne peux pas travailler car je ne veux pas. Le Nozinan ça sert à rien, je ne le veux plus. Je suis minable c'est pour ça que je ne suis pas amoureux. Je n'irai plus en permission car ma mère ne me veut plus. Je n'ai plus envie de la voir. Le bruit m'énerve (marteau des carreleurs). Je rigole car je ne peux pas faire autrement. Ce sont les infirmiers qui l'ont dit. Je suis mort sur ma chaise. Moi j'y tiens à aller à l'hôpital parce que vous me le dites. Ça durera jusqu'à ce que je sois dans le tombeau. Après je n'entendrai plus rien. (Il se lève). Vous me faites baver. Vous m'em...".
24 Mai 1975
Nous a suivis en ville (ballade avec des pensionnaires) pour aller à l'hôpital civil. En chemin nous a lâchés et est revenu au pavillon. Ensuite est monté dans l'ambulance qui allait chercher Monsieur L...25 Mai 1975
Refuse de s'alimenter. Attend debout l'ambulance qui doit le conduire à l'hôpital. Marmonne seul.
(Nuit) Mr A... était couché dans l'herbe dehors. A été ramené au pavillon et couché ; a bu deux boites de Renutryl.
b) Considérations cliniques sur le délire
Se donner ici quelques repères nosographiques nous sera utile tant pour l'interprétation de ce qui s'est passé que pour la discussion diagnostique que nous a inspiré ce cas.
— À ce stade il s'agit d'un thème de persécution : il se sent menacé dans son intégrité corporelle par sa mère et ses thérapeutes qui veulent se débarrasser de lui en le livrant au chirurgien.
— Le mécanisme paraît essentiellement intuitif et peut-être interprétatif (à partir de paroles concernant quelqu'un d'autre) mais probablement pas hallucinatoire : lorsqu'il dit « Hier soir et ce matin ma mère est venue. Je ne l'ai pas vue mais elle est venue », il s'agit de quelque chose qu'il sait, qu'il devine, plutôt que d'une perception sans objet. Par ailleurs rien n'évoque à ce stade un syndrome d'automatisme mental.
— La structure n'est pas systématisée : autour d'un malaise physique, probablement lié à un vécu de dépersonnalisation, se disposent des idées délirantes assez variables d'un jour à l'autre, qu'aucun raisonnement ne vient chercher à rendre vraisemblables.
— La thymie est très variable : angoisse au début, puis résignation sur un mode dépressif où subsiste une anxiété importante, puis début d'agressivité contre les persécuteurs qui ira en augmentant par la suite.
On peut penser qu'il s'agit là d'un délire de type paranoïde tel qu'il s'ébauchait à certaines périodes de l'hospitalisation, et tel qu'il a peut-être existé au début de la maladie sans que le malade le verbalise alors.
3) Le remembrement symbolique
Nous avons vu dans ce qui précède l'aggravation progressive de l'état du malade, liée au délire (refus d'alimentation, attente de l'ambulance à l'extérieur du pavillon). Nous prîmes l'initiative, le 27 mai, d'un abord direct du thème de morcellement qui l'angoissait tant : décrochant du mur un miroir, nous le lui présentâmes, en nommant les parties de son corps dans le miroir puis sur sa personne, en le désignant comme un tout qui portait un nom (son nom propre), et en lui disant qu'il était beau (en réponse à la conviction qu'on voulait se débarrasser de lui parce que sa mère le trouvait laid). Cette intervention, répétée le lendemain, produisit une diminution de l'angoisse (également liée à l'ajout d'anxiolytiques à son traitement) et un changement dans sa thématique délirante. Puis nous revînmes à notre mode précédent d'intervention au niveau verbal seulement. Voici le compte-rendu de cette phase :
27 Mai 1975
Ce matin cherchait à se jeter contre les voitures qui passaient devant lui. Il était assis dans l'herbe, prés du trottoir et du pavillon.
Vu par l'interne et G. C... Traitement augmenté.
Vers 14 H il est revenu au pavillon ; il disait que tout le monde était mort chez lui ; son père, sa mère, sa tante, Pinto les avait envoyés à l'hôpital où on les avait tués ; il n'avait plus de famille. I1 s'est laissé raser, puis s'est couché. I1 vacillait un peu (il avait eu X gouttes Nozinan + Tranxène 50 à 13 H). Au moment du repas il était endormi profondément dans son lit, un paquet de biscuits à la main.
(Nuit). A dormi.
28 Mai
Matin. Prise en charge par G.C... Discussion en réunion.
Après-midi : il a passé l'après-midi assis ou allongé dans l'herbe à l'extérieur du pavillon. Il n'a voulu revenir au pavillon que vers 17 H 30. Il s'est installé à table pour le repas mais n'a fait que grignoter. À une sollicitation d'A... qui l'invitait à manger des tomates en salade, il a projeté violemment son assiette sur la table : "Chez moi je mangeais des tomates avec de l'huile d'olive et puis je préfère les tomates farcies avec beaucoup de jus ; quand j'avais 15 ans je mangeais bien avec ma mère ; on allait au bord de la mer et après on se baignait ; à 15 ans j'étais beau, je mangeais bien. Depuis que je suis à l'hôpital, je suis mal, je suis mieux chez moi et ce sera comme ça jusqu'à la mort, je n'aime pas l'hôpital".
(Nuit) À la relève était au lit. Bon sommeil.
31 Mai
Réticent pour parler. Reste couché tout l'après-midi.
À 18 H est dans le hall, attend l'ambulance : "Vous savez pourquoi j'attends, je suis minable et j'ai honte de traverser la ville ; je pars en ambulance, j'ai une verrue plantaire, il faut m'arracher les dents, me crever les yeux. Pourquoi ?
– Avant je ne pensais pas à tuer les gens, maintenant j'y pense, je suis plus
minable qu'eux ; je préfère ne pas les voir ; il faut me crever les yeux. Je ne veux pas vous tuer. Avant je n'étais pas comme ça, je deviens fou".
1er Juin 1975
Assez fuyant et isolé.
2 Juin
Refuse l'entretien. Reste pratiquement toute la matinée dans le pavillon. A peu mangé à midi. "J'attends l'ambulance, dans 10 H ça sera fini". 10 H après : "c'est dommage, j'aurais préféré partir avec l'ambulance. Je suis trop laid pour traverser la ville à pied ; les gens se moquent de moi".
3 Juin
Peu bavard, reste couché tout l'après-midi, refuse l'alimentation du pavillon.
5 Juin
Reste un peu plus dans sa chambre. Accepte facilement son traitement. "Je n'aime pas le colis que j'ai reçu. Ce n'est pas ma mère, elle est morte. Je suis victime de ma mère et de ma tante. Je ne veux plus aller à Arles. Hier dans l'hôpital j'ai vu une voiture de police avec des pétards. Ils venaient me tuer. Ils auraient dû le faire. Quand j'étais jeune avec des copains on a fait des bêtises, moi on m'a interné, les autres sont dehors. C'est pour ça qu'ils venaient me tuer".Pendant que nous sommes avec les grands-mères, on entend Paul qui parle seul dans le couloir : "ma petite maman chérie ! ma petite maman chérie !".
L'entretien du 8 juin 1975 marque un tournant dans l'évolution de M. A... Il évoque pour la première fois son père. C'est à partir de ce moment que le texte des entretiens devient très abondant, riche en associations que nous analyserons dans la troisième partie. Paul parle sans discontinuer, nous laissant à peine le temps de placer nos interventions (toujours sur le mode de la synthèse arbitraire de sens).
8 Juin 1975
"À midi, il y a du gras-double. Je n'aime pas le gras-double. Mon père non plus n'aimait pas le gras-double. Il aimait le blanc de poulet. Il mangeait les bons morceaux de blanc.
Ma mère n'aurait pas dû épouser mon père. Je n'aurais pas dû naître. Ils n'auraient pas dû me faire. Ma mère m'a appelé Paul car ma tante s'appelait Pauline. Tout a commencé en 1945. Avec mon père, je faisais le con. Quand il est arrivé d'Allemagne, je lui ai donné des coups de pied dans les jambes. Pourtant il n'aurait pas dû mourir. Il voulait me mettre en pension jusqu'à 21 ans. Si ne j'étais pas venu au monde, je ne souffrirais pas le martyre. Quand j'arrivais de l'école, il fallait que je travaille, que je fasse mes devoirs jusqu'à 8 H le soir pendant que les copains allaient jouer aux boules".
En fin d'entretien, il vide complètement le contenu de ses poches et donne tout à Pinto en disant "ça a été long. On y sera enfin arrivés".
12 Juin 1975
"Je n'irai plus en permission. La permission, c'est l'hôpital civil.
On va me crever les yeux, me couper les jambes, les pieds. J'ai deux dents pourries, on va me les arracher sans m'endormir. Après on va me mettre le feu avec le briquet, dans les cheveux, aux jambes, où ils voudront.
Je préfère attendre couché, c'est moins pénible ; après ils avertiront ma famille.
Je fume moins, les cigarettes sont trop fortes, je trouve le tabac fort, je n'y trouve plus de goût et je n'arrive plus à faire sortir la fumée par mon nez, je ne me régale plus, je n'y arrive plus. Cela fait cinq jours, ou six jours, ou sept jours, ou huit jours.
15 Juin 1975
"Il vaudrait mieux que j'aie un pétard ou que la police me loge deux balles dans la tête. Après je n'entendrai plus rien. J'ai une tête comme ça la nuit et le jour. Je voudrais 10 francs pour m'acheter des cigarettes et puis je voudrais de beaux vêtements. J'aime bien la veste de ma mère, marron".
À 14 H. Paul arrive avec une échelle : "je viens du 2ème Pavillon Hommes où il y a G..., j'ai pris l'échelle pour prendre mes habits que j'avais jetés par la fenêtre ; ma mère me les lavera vendredi".Après avoir ramené l'échelle au 2ème Pavillon Hommes : "Je suis crevé, je vais dormir".
16 Juin 1975
L'infirmière : – Bonjour Paul, tu t'es déjà rasé ? (douché, parfumé, coiffé, etc...) – "Oui je suis bien rasé, mais ce matin c'est le tour de Pinto. Il faut qu'il se rase. Les coiffeurs ouvrent à 7 H 30. Et les remèdes pour Pinto, la petite bouteille pour être critiqué par tout le Pavillon. Et qu'il aille manger chez ma mère. Ma mère elle sent meilleur que moi. Elle met de la poudre. Moi je ne peux pas en mettre, je ne suis pas une femme. Pinto devrait se mettre du rouge aux lèvres.
En ville, il y a des nains bossus, ils ont de l'argent et ils mangent bien. Ils n'ont pas de remèdes".
17 Juin 1975
"Je pense au départ. Je souffre moralement. Ma ceinture tombe. Je risque de perdre mon pantalon dans le car, dans la rue. Les policiers me mettront en prison. (silence ...).
Je ne sais pas ce que je pourrais dire (il sourit).
– Pourquoi souriez-vous ?
– Je suis content que vous veniez me parler. C'est dur à expliquer.
Pinto veut m'envoyer à l'Hôpital. Pinto et d'autres. Mais je ne veux pas dire du mal. On veut m'arracher deux dents. Quand j'avais six ans, ma mère m'a amené chez le dentiste. J'ai attendu longtemps. On m'a fait une piqûre. C'est normal, c'est la vie.
Il y a 8 mois qu'on doit installer une glace pour voir quand on se rase.
– Ce matin vous disiez 9 mois ... (Il compte sur ses doigts, réfléchit)
– Non, c'est 9 mois.
La fille de ma sœur avait 2 ans et deux dents. On ne les voyait pas. Le dentiste lui a fait sortir, elle a crié, elle avait mal. Elles se voyaient bien après.
– Elle avait deux dents dehors.
– Oui.
J'ai envie de dire quelque chose.
Remarquez ça m'effrayerait bien plus. Sur le fait que j'ai dit des choses que je n'ai pas. C'est toute la vérité. Voilà : j'avais dit à Madame C... (infirmière) qu'on me crève les yeux et je n'ai rien, ils ne me font pas mal ; qu'on me coupe les jambes et je peux me promener.
Faites-moi tout ça sans m'endormir. Avec une scie.
Je réfléchis, je calcule (à ce moment-là il fait tomber la Sainte Vierge qui est sur la table de nuit).Je vais passer le calvaire. À l'hôpital civil, il n'y a pas de fous. Je suis fou de dire ça à Madame C...Quand on m'a opéré du pied, il y avait du pus. On m'avait endormi.
Ma permission est liquidée après ce que je vous ai dit. À moins que ma mère ne soit avertie que je vais à l'Hôpital Civil.
Il y a 4 ou 5 jours, j'étais content ... Pour aller mourir comme ça ... Je crois que je vous ai dit toute la vérité. Voilà.
Ils auront quand même un souvenir de moi, mes parents. Ils m'auront vu 37 ans et 3 mois. Téléphonez pour leur dire ce que vous allez me faire.
J'ai des idées dans la tìte. Avant je n'y pensais pas. Jamais. Depuis 6 ans je n'y avais pas pensé.
Je vais en permission toutes les cinq semaines. Je n'y pensais plus depuis 6 ans.
Si, une fois. Baumas, le boxeur, m'avait emmené à l'Hôpital Civil. On m'avait fait une piqûre pour mon abcès dentaire. Mademoiselle B... m'avait fait une piqûre. On m'avait fait une anesthésie générale. On m'avait attaché. La belle-sœur de Madame O... m'avait apporté à dîner. On m'avait opéré l'après-midi. Ma mère était venue me voir le jour même. J'étais content.
Voilà, ça sera pas grave. Elle sait qu'on va me crever les yeux, me couper les jambes, etc... et elle n'est pas venue. Peut-être ils me feront une piqûre et je ne la verrai plus jamais.
– Vous avez une dent contre votre mère. (il réfléchit longtemps).
– Vous pouvez marquer : je l'aimais bien quand j'allais en permission. Je
fumais, elle lavait mon linge.
– Vous avez une dent contre votre mère et c'est pour ça qu'on va vous l'arracher.
– C'est vous qui le dites. C'est vous, et moi, et l'infirmière, et tout le pavillon. Et sans m'endormir ...Le mari de ma mère avait de mauvaises dents. On lui a fait une piqûre, on ne lui a pas fait mal. Il n'a rien senti.
J'ai dit à ma mère de me mener chez le dentiste de Papa (c'est la première fois qu'il prononce ce mot). Elle n'avait pas voulu : "je ne veux pas qu'on te les arrache, ça va te faire mal, je suis malade". Elle avait dit tout ça.
Marquez : à 63 ans, 2 dents. On l'avait endormi. Voyez (il montre ses dents) : elles n'en ont pas besoin ... Et sans m'endormir ... ça me ferait plus mal que ce que m'avait dit ma mère. Elle me trahit complètement.
– Avec qui ?
– Elle me trahit avec mon père.
Il avait pas supporté son dentier 5 minutes. Et ça durera plus de 5 minutes. C'est difficile à supporter.
La vérité me soulage ... La vérité me soulage ...
En Allemagne, c'était moins pire. Ils n'ont pas fait ça. Ils mangeaient bien. Mon père était dans une ferme. Il mangeait du petit salé. Ma mère lui envoyait des colis. I1 n'a pas dû passer ce que je passe moi.
Je ne me rappelais plus. On l'avait opéré à Michel-Lévy. Au retour, il avait fait la sieste, il a dit qu'il ne se sentait pas bien. Ma grand-mère est montée et l'a trouvé mort. Une hémorragie. 27 de tension. Le sang coulait des oreilles. C'est ma mère qui me l'a dit. Et pourtant, il était brave. Il lisait des romans policiers. Il était dans la police.
Quand ils l'ont sorti dans le cercueil, les gens ont ouvert le poste à bloc, à bloc, ma mère me l'a dit.
– De quoi l'a-t-on opéré ? (Il calcule longtemps)
– D'un rein ; j'avais 7 ans.
– Vous voulez parler du Rhin, en Allemagne.
– Oui, Oui.
– Pourquoi remuez-vous ?
– Je remue pour remuer".
26 Juin 1975
(Paul est couché sur son lit).
"Je ne peux pas faire mieux que ça. Beaucoup font bien moins. Ou plutôt moins bien.Quand je sors, toutes les 2 ou 3 minutes, une voiture freine pour ne pas m'écraser.
Ma mère préfère me savoir sur mon lit. S'il m'arrive quelque chose ici, c'est l'Hôpital qui est responsable. C'est ma mère qui me le dit. Si je suis en permission et que je me fasse écraser, l'Hôpital n'y est pour rien. C'est la vérité. Au moins sur mon lit une voiture ne me passera pas dessus.S'il arrive autre chose, c'est une autre destinée de ma vie (il répète cette phrase).
Kopa est mort à l'âge de 6 ans (sic). Moi j'avais 7 ans quand mon père est mort. Il avait 42 ans.Si mon père était en vie, il serait bien moins content pour moi. Vous comprenez ? (I1 dit très souvent ces deux mots).
C'est le destin de ma naissance. Mon père et ma mère m'ont fabriqué comme ça. La faute est à moi par ma maladie et par ma naissance.
Eux, ils sont dehors, ils mangent bien. Ils ont de beaux vêtements, des robes à fleurs qui ne coûtent pas un franc. Ils vont en congé en Bretagne, en voiture. Si je m'étais fait écraser, je n'aurais plus de cachets. Il y a 23 ans que ça dure.
À l'Ergothérapie, je travaillais 6 heures par jour. M. X... m'engueulait quatre ou cinq fois, et si j'arrivais 5 minutes en retard il me disait qu'on me mettrait au 3 Bis et qu'on me rendrait aveugle.
Mme D... a dit à ma mère : "j'aime votre fils comme mon frère". Elle est venue à ma maison.Si je continue, quel résultat ça donnera ?
– Qu'est-ce que vous en pensez ?
– C'est pas brillant. C'est tout marqué dans le dossier vert. La brigadière vous le dira. Je suis rentré le 29 mai 1953.
Je ne veux pas de viande. À l'hôpital je n'en mange pas. Je ne veux pas de gras. Vous marquerez, mais ça ne changera rien au menu, alors je parle dans le vide (répète ces mots 4 fois).
La mort me donnera mieux à manger. C'est la guérison.
Mon vrai père avait un petit travail. De beaux habits. Il travaillait dans les bureaux, au service des étrangers. Il mangeait des cuisses de poulet, le blanc. Il est mort en mangeant ça. Il est mort en bien mangeant. Il y avait toute la police. En lettres dorées on a marqué : "mort pour la France".
30 Juin 1975
Posez-moi des questions. Ce sont les chefs qui posent des questions. Vous, l'infirmière, le docteur. Moi je suis malade, je suis jobard. Ma mère me ramènera un chapelet incassable d'Italie.
(Ensuite il évoque une analogie de situation entre lui et un malade nommé Lacroix).
Ma mère, je l'embrassais sept ou huit fois. Elle m'a donné la vie.
Quand je vais en permission, je suis fatigué (il montre ses jambes).
– La fatigue vous coupe les jambes.
– La fatigue me coupe les jambes.
Je me mets au fond du car complètement. Il y a des enfants et des filles. Toujours les mêmes. Un garçon blond aux yeux bleus. Je ne peux pas le voir. Il dit de moi : "il est jobard, il fume, il m'étouffe". Ils me regardent, ils me tirent la langue.
– Pourquoi choisissez-vous cette place ?
– Je ne sais pas.
Ma mère a une voiture, pour voyager.
J'ai dit à L... : "si vous me tuez, la police viendra, avec un pétard. Tu iras en prison".
2 Juillet 1975
"Ma mère, c'est la plus brave ... pour moi. C'est la plus brave, mais elle ne m'a pas appris de métier et je suis là.
Je ne peux pas travailler, je ne peux pas sortir. Elle, elle part en voyage. Mon père m'a dit : "on ne t'emmène pas car ce serait trop dangereux en voiture".
Je suis venu ici à 15 ans. Quand on m'a emmené ici, je pensais me jeter dans le Rhône ; je n'ai pas eu le courage. Je pensais à mes deux sœurs qui restaient, qui allaient faire l'amour ; à mon père qui allait coucher avec ma mère. J'étais en cellule, une petite lucarne avec trois barreaux. Je voyais des amoureux qui s'embrassaient. Et moi je suis ici.
J'avais un copain, il est devenu un grand chanteur. I1 chante comme Mariano. Madame C..., écrivez à ma mère pour lui dire que nous allons à Arles, avec le car. Vous paierez votre place, et nous irons voir ce copain, vous l'entendrez, il chante comme Mariano.
Ma mère a découpé des articles dans les journaux : "un petit maçon arlésien peut devenir un grand chanteur". (Il le répète plusieurs fois).
Et puis j'avais un autre copain, il est devenu un grand torero. Il s'est marié en Espagne avec une actrice.
Et un troisième, un footballeur professionnel. Vous voulez voir les articles, les photos ?"
5 Juillet 1975
"M. B... doit ouvrir le ventre au mari de ma mère (qui doit venir me voir à la fin du mois) et lui sortir les tripes.
Il doit me tuer également, ici, dans cette chambre. Voilà la vérité.
Si on me tue ici à l'Hôpital, tout le monde le saura, et tout Arles, tout Saint-Rémy. Toute la Provence. Ils le liront dans les journaux".
19 Juillet 1975
Ma mère m'a fait soigner par une doctoresse américaine, pendant 5-6 ans, le mercredi deux fois par mois. J'avais 30 ans.
Il y a 7 ans et 4 mois que je n'y suis plus allé. Jeanine Fournier, doctoresse américaine, blonde aux yeux bleus, née dans l'Ohio. C'est ma mère et mon beau-père qui m'y ont emmené. Ma mère m'a fait faire une radio de la tête, le mercredi, dans un salon à Arles, dans une maison. J'avais un pincement cervical. "Au bout de 3 mois il sera guéri" a dit le docteur "faites-le revenir". Mais je n'y suis pas retourné à cause de ma mère.
Ce médecin a soigné deux coureurs cyclistes : Francis Anastasi (deuxième au "Milan-San-Rémo") et son frère Jean, au genou.
La doctoresse a une maison sur la corniche à Marseille, une grande villa. Son mari a la même profession.
Ma mère doit me trouver un travail. Je lui donnerai ma paye. Je mangerai et resterai avec eux. Ils savent que je n'aime pas le gras-double. Mon beau-pére en raffole, moi pas. À Montperrin les cuisiniers sont payés pour faire à manger tout ce que je n'aime pas (reparle de gras-double et de poisson). J'aime le lapin en civet avec des petits champignons. Le deuxième mari de Maman est Italien. Il fait des pâtes à la sauce tomate. Il m'en donne deux assiettes.
Puis, puis, puis, puis, le dimanche, mes deux sœurs, leurs maris et leurs enfants, on mange un gros gâteau au dessert. L'après-midi, sieste puis goûter avec brioches et chocolat... Du chocolat ou bien des chichis bien sucrés, avec du café bien sucré. Quand je suis au lit jusqu'au dîner, ma mère me donne un panaché. La dernière fois qu'elle est venue, elle m'a porté une bouteille jaune, d'anis sans alcool, – j'en ai offert à Claude (une infirmière) –, et une grosse boîte de Ricoré avec du sucre... (Silence ...)
– Pourquoi nous dites-vous tout cela ?
– Je tenais à vous le dire. C'est niveau de catéchisme... 4 ou 5 cathédrales d'Italie... Vierge au cou. C'est la vérité. Ma mère a dit que dans 15 ans elle m'apportera un chapelet béni, rapporté de Saint Antoine de Padoue. J'en ai deux cartes postales sur ma table de nuit. Voilà. C'est comme cela.X... veut me frapper : "A... connasse" m'a-t-il dit lorsque je fumais une cigarette. Dans le jardin, je regarde les belles cuisses des infirmières. X... rentrait dans ma chambre. Il ne m'a jamais menacé de mort depuis novembre que je suis là.
J'ai 100 francs par mois. X... a plus d'argent que moi. Vous avez compris ? Et en plus que je voulais lui faire plaisir et que lui ne veut plus jamais me faire de pâtes. Pourquoi cela ? Je ne sais pas. N'importe comment, dans une semaine ou deux, mes parents seront au courant de la vérité. Il se peut que je meure, on me l'a dit : M. Y..., je suis rentré dans sa chambre et il me l'a dit. Il a dit que si on me mettait à Mondevergue ou ici, ça ne faisait rien. C'est tout pour l'heure qu'il est, pour maintenant. Remarquez que mon vrai père était policier, blond aux yeux bleus, commissariat central à Aix – si Y... me tue il sera tué lui aussi.
La police de Marseille a tué à l'aube, aux Baumettes ; ils ont coupé la tête à un assassin.
La guillotine pèse 37 kilos et j'ai 37 ans et 4 mois.
Je suis le préféré de l'infirmière Arlette. Je la connais depuis 1959. Voilà. Toutes les permissions, je lui envoyais des cartes d'Arles, tous les mois, avec "bons baisers".
Un jour j'ai été voir une "fille" à Marseille, Monique, rouquine aux yeux marrons. (Il commente ses ébats). Dans sa chambre, il y avait plein de photos de femmes nues. Elle m'a offert le café, deux pulls, un manteau pour l'hiver (couleur crème à petits carreaux rouges et noirs), un imperméable, des polos à manches courtes et à manches longues. Tout cela est dans le tiroir de la chambre de ma mère à Arles, lavé et repassé.
Mon nom c'est Paul, comme Paul Anka, Paul Newman, j'ai sa photo dans ma chambre... Paul, Paulette.
Ma demi-sœur s'appelle Josette, ma seconde sœur, Georgette. Ma troisième sœur a appelé son dernier Paul. Paul Sinibaldi... Paul Meurisse, artiste de cinéma. J'ai vu tous ses films sur une revue.C'est pas ma faute si je suis né Paul. Ma mère s'appelle Edmée, mon père Auguste. Moi c'est Paul, moins joli que Luis Mariano. Ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas demandé à venir au monde. C'est mon père et ma mère.
J'aurais préféré être comme Jacques Anquetil. Il est plus beau : blond aux yeux bleus, peau comme le lait. (Il cite toutes ses victoires). J'aurais aimé être comme lui. Il a la peau lisse. Je l'ai vu sur le Cours Mirabeau. J'ai un copain à moi qui est comme cela aussi. Il a 40 ans ce mois-ci. J'ai une photo de lui dans ma table de nuit. Il vend des fleurs. Il a perdu une fille de 13 mois. Il a 3 ans de plus que moi. Il a gagné le concours du plus beau bébé à Arles. I1 nage, danse, conduit. Il est ouvrier maçon.
Mon père était blond, un peu rouquin, avec les yeux bien bleus, comme le ciel.
Ma mère est brune car elle se teint, parce qu'elle a des cheveux blancs maintenant. Avec l'âge tout le monde vieillit.
Le petit de ma sœur est brun avec des yeux noirs (comme lui). Gina Lollobrigida a peut-être des cheveux blancs.
Ma mère m'a dit qu'elle a été à Paris. Elle a été prier sur la tombe de Piaf et de Sarapo, au Père Lachaise. Ils ont visité Versailles, les Tuileries, et ont fait une heure de bateau sur la Seine".
Ce dernier entretien donne le style de ceux que connurent les personnes qui nous relayèrent dans cette prise en charge : logorrhée incoercible (il nous poursuivait dans le couloir pour nous parler après la fin de l'entretien), abandon quasi-total du thème délirant, changement de comportement (il se levait, allait se promener en ville, faisait des achats, ne manifestait plus d'agressivité envers l'entourage).
4) Le relais
Il fut décidé en prévision de mon départ du pavillon en fin septembre (je n'avais pas vu M. A... pendant mon congé du mois d'août). À cet effet, je présentai à Paul la personne qui devait me remplacer aux côtés de Madame G. C..., et nous le vîmes une fois chacun jusqu'à mon départ. Depuis cette période, M. A... a été régulièrement suivi en entretiens une à deux fois par semaine.Sur le plan clinique l'évolution est favorable. Les thèmes insistants de la phase logorrhéique ont été progressivement abandonnés. Il n'y a eu aucun retour en arrière : tout ce qui avait été acquis dans la période précédente s'est conservé. Il n'est pas clinophile, va souvent en ville, communique volontiers avec les infirmiers et les autres pensionnaires du pavillon. Il n'a pu cependant conquérir une autonomie suffisante pour quitter l'hôpital et trouver un travail.Le fait le plus remarquable est l'absence de reprise délirante depuis deux ans et demi, alors même que son traitement ne comporte plus de médicaments antipsychotiques : il prend à l'heure actuelle 30 gouttes de Nozinan, 3 comprimés de Tranxène 50, et du Frénactil à la demande lorsque des tendances agressives réapparaissent. Cependant la possibilité d'une rechute ne peut être définitivement exclue.
3 INTERPRÉTATION DES DONNÉES OBSERVÉES
Nous avons signalé dans l'introduction que nos hypothèses de travail s'inspiraient de la théorie lacanienne de la psychose. Nous la résumerons donc avant de préciser ces hypothèses et de proposer une interprétation des effets observés dans la prise en charge de M.A...
A – RAPPEL DES DONNÉES LACANIENNES SUR LA PSYCHOSE
B – HYPOTHÈSES DE DÉPART
C – ESSAI D'INTERPRÉTATION TEXTUELLE
A – RAPPEL DES DONNÉES LACANIENNES SUR LA PSYCHOSE
Elles sont principalement exposées dans le chapitre des Écrits intitulé « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose ».
Nous avons également complété certains points à l’aide de deux articles parus dans la revue Scilicet (n°2-3, 1970) : « Le clivage du sujet et son identification » et « Pour une logique du fantasme ».
Le schéma que nous donnons comme support à ce rappel théorique est celui proposé par Lacan dans le texte cité, légèrement modifié (en fonction des notes de bas de page citées ci-dessous) de façon à le rendre plus explicite.
[ Rajout de 2009: Il est conseillé de l'ouvrir dans un nouvel onglet, de manière à pouvoir basculer aisément du texte au schéma et inversement. Voici d'abord le schéma original, puis le schéma développé. (note 14 de Lacan : "Peut-être y aurait-il intérêt à reconnaître [que] ce que le schéma R étale, c'est un plan projectif. Notamment les points dont ce n'est pas par hasard (ni par jeu) que nous avons choisi les lettres dont ils se correspondent m, M, i, I et qui sont ceux dont s'encadre la seule coupure valable sur ce schéma (soit la coupure m i I M... ), indiquent assez que cette coupure isole dans le champ une bande de Mœbius." Texte : « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose » in Écrits, Seuil, 1966) ].
« La condition du sujet S (Névrose ou psychose) dépend de ce qui se déroule en l’Autre A ». Le terme de “grand Autre” désigne chez Lacan le réseau des signifiants, régi par une logique combinatoire impliquant l'absence et le retour périodique de tout signifiant dans la chaine parlée, fonctionnement radicalement distinct de celui du corps. Ce fossé impossible à combler entre la logique du signifiant et le lieu du corps est un des aspects du réel.
Trois points particuliers de ce réseau des signifiants constituent le triangle du Symbolique : M désigne “le signifiant de l'objet primordial”, c'est-à-dire la mère en tant qu'elle est le premier individu réel à faire connaître à l'enfant en lui parlant le réseau de signifiants qui, du point de synchronique, n'est qu'un abstraction.
P représente la fonction paternelle (ou Nom-du-Père) qui n'est pas supportée par un individu réel, mais figure dans le discours de la mère. L'est l'ensemble des signifiants auxquels elle recourt pour signifier la Loi à elle-même d'abord, à l'enfant ensuite.
Cette loi consiste en ce que la jouissance est impossible pour tout sujet parlant. Chaque sujet a éprouvé la présence de la mère comme cette Chose confuse qui met fin à la tension que cause le besoin, mais cette Chose est à jamais perdue, et le signifiant qui invoque en vain son retour ne fait que rendre son absence plus sensible ("le signifiant est la mort de la Chose ").
La fonction paternelle rappelle l'existence de cette Loi à tout sujet, en la transformant en un interdit ("la jouissance est interdite à qui parle comme tel") mais permet simultanément au sujet de sortir de cette impasse par la voie du désir ("la fonction du Nom-du-Père est d'unir un désir à la loi").
À cette transgression que constitue le désir, le Nom-du-Père fournit un instrument : le Phallus symbolique, qui est, là encore, une fonction signifiante chargée à la fois de rappeler la loi (castration symbolique), substituer à la Chose perdue l'objet a ou objet du désir, et de mettre en place pour le sujet la chaîne du fantasme nécessaire à la réalisation du désir. Si la jouissance totale et permanente reste interdite, une jouissance partielle et transitoire devient ainsi possible grâce au fantasme.
L'objet du désir, venant en place d'un manque, n'a en lui-même aucune consistance. Il est éminemment changeant et insaisissable, à l'opposé de l'objet du besoin.
Ainsi, pour que le mirage du désir puisse s'établir, il faut que le Phallus symbolique masque le vide de l'objet par une illusion de consistance que désigne φ (le phallus imaginaire). C'est la fonction imaginaire de la castration, par laquelle le sujet croira momentanément pouvoir combler le manque et retrouver la Chose pour fusionner avec elle.
C'est ainsi que l'enfant, objet a du désir de la Mère, apparaît d'abord au point φ, où elle le situe dans son imaginaire comme ce qui pourrait
combler son manque. Mais comme elle se soumet à la Loi, elle accepte d'avance que la jouissance née de la fusion imaginaire avec son enfant doive cesser un jour, qu'il doive se détacher d'elle. Elle le voit donc d'un autre point, d'un point I situé dans le symbolique.
I représente donc l'Idéal du moi, troisième sommet du triangle du symbolique, défini comme le point d'où le sujet se voit aimable dans le discours de la mère. Cet Idéal du moi est fait de signifiants que le sujet cherchera à rejoindre par la voie de l'identification.
Cette sollicitation à "grandir" à "devenir quelqu'un" va d'abord engendrer une première identification à l'image du miroir i(a), qui est l'image de son corps et de tout semblable, notamment la Mère. C'est ce qui constituera le moi m, instance imaginaire pour Lacan. L'image spéculaire constitue le prototype du moi idéal imaginé comme tout-puissant car c'est aussi l'image de la Mère qui peut satisfaire à ce stade toutes les demandes de l'enfant. La crainte que cette image unifiée ne soit détruite correspond à l'angoisse de morcellement.
Le moi entretient avec son image des relations ambivalentes d' « agression érotisée » (couple amour-haine). Mais la circularité parfaite entre m et i(a) (la réponse de la Mère à toutes les demandes ) va se rompre lorsque la sexualité infantile naissante laisse la mère sans réponse sur ce qu'il en est du Désir du sujet. C'est ce qu'indique sur le schéma le plongement de la boucle m → i(a) vers le point I, montrant que ce n'est que par l'identification à l'Idéal du moi que le sujet retrouvera un chemin vers le signifiant de l'objet maternel M. L'identification terminée (la double boucle refermée sur elle-même), il reste un espace central, un vide, où l'enfant aura la possibilité de s'inventer un objet de désir avec des traits signifiants rappelant indirectement la Mère. Celle-ci est désormais interdite. L'interdit de l'inceste s'énonce : « Tu ne désirera pas celle qui a été l'objet de ton amour. » Le refoulement commence alors, contemporain de la résolution du complexe de castration.
Chez le sujet non psychotique, la fonction phallique est ce qui relie le sujet marqué par le signifiant ($) à l'objet du désir (a) pour constituer la chaîne du fantasme où sujet et objet peuvent s'intervertir.
Un des aspects de la fonction phallique est alors la métaphore, qui permet, par une transgression signifiante (substitution) de présentifier les signifiants de la pulsion autour de l'objet du désir, et de permettre ainsi, par l'évocation de l'image du corps, donc dans l'Imaginaire, l'illusion de retrouvaille de la Chose et la satisfaction du Désir.
Le fantasme devient l'élément organisateur de la Réalité psychique (désignée par R sur le schéma) que Lacan distingue nettement du Réel. C'est cependant au travers de cette Réalité que le sujet non psychotique peut entrevoir le Réel et en tenir compte.
Il importe, en résumé, de bien distinguer les trois niveaux que la psychose bouleversera :
– Le niveau de la relation imaginaire m � i (a) entre le moi et le moi idéal, repérable dans le discours par tous les énoncés grammaticaux commençant par "Je", donc revendiqués par le sujet.
– Le niveau du fantasme $ � a reliant le sujet a l'objet du désir, et repérable dans les énoncés grammaticaux qui n'ont pas "Je" pour sujet (Par exemple : "On bat un enfant"). C'est le champ de la Réalité psychique.
– Le niveau de l'Inconscient où figurent les signifiants M, I et P, qui est un discours non-grammatical régi par une logique purement combinatoire (lapsus, rêves, associations libres). Le fantasme se construit sur les associations inconscientes mais ne s'y résume pas puisqu'il est déjà une mise en forme grammaticale où peut jouer la métaphore.
Dans la psychose, il y a forclusion du Nom-du-Père, c’est-à dire que le sujet n’a jamais trouvé dans le discours de la Mère cette fonction symbolique lui permettant d’accéder au désir.
« Si à l’appel du Nom-du-Père répond une carence du signifiant lui-même (forclusion), la carence de l’effet métaphorique provoque un trou à la place de la signification phallique ».
Ce signifiant est appelé par le sujet dans toute situation triangulaire conflictuelle, que seule la castration symbolique permet de dépasser : « Pour que la psychose se déclenche, il faut que le Nom-du-Père, forclos, c’est-à-dire jamais venu à la place de l’Autre, y soit appelé en opposition symbolique au sujet ».
L’absence du signifiant P a pour corollaire l’absence de la fonction symbolique du Phallus. Les quatre points que cette fonction permettait de relier entre eux (cf schéma) ne peuvent plus “tenir” ensemble, ce que Lacan représente sur un autre schéma (dit schéma I) où ils figurent sur des lignes partant à l’infini de façon divergente.
Ainsi le désir de la Mère fait sentir son absence, le moi idéal et le moi sont impossibles à constituer, et l’Idéal du moi se dérobe au sujet. Le psychotique défaille donc dans ses tentatives pour se constituer un Imaginaire et une Réalité psychique, et quand il parvient à reconstituer quelque chose, c’est une pseudo-réalité délirante où le réel est déformé (« Ce qui est forclos du symbolique revient comme réel” dans l’hallucination ou le délire »).
Ce que Lacan résume ainsi :
« C’est le défaut du Nom-du-Père qui, par le trou qu’il ouvre dans le signifié, amorce la ascade des remaniements du signifiant d’où procède le désastre croissant de l’imaginaire, jusqu’à ce que le niveau soit atteint où signifiant et signifié se stabilisent dans la métaphore délirante ».
B – HYPOTHÈSES DE DÉPART
Elles peuvent se déduire des données théoriques qui précédent. Notons à ce propos qu'il n'existe pas à notre connaissance de technique codifiée des psychothérapies de psychotiques dans les textes lacaniens. Nous exposons donc ici les éléments de réflexion qui ont guide notre action pratique, en sachant qu'ils schématisent considérablement une théorisation complexe et subtile.
1) Il existe une "carence"de la fonction métaphorique chez le psychotique.
Il est donc inutile d'attendre qu'à la manière d'un sujet névrotique il livre dans ses associations libres la clef de ses symptômes. Le caractère déroutant, hermétique de ses dires vient peut-être de ce qu'il n'y a là rien à comprendre : les signifiants énoncés n'ont pu être relies entre eux par des chaînes inconscientes, ou seulement de façon très partielle dans les cas où le sujet a pu reconstruire quelque chose de sa réalité psychique sur un mode délirant. (On sait alors le danger des interprétations classiques qui déconstruisent ce fragile édifice).
Un entretien fondé sur l'écoute silencieuse a donc toutes les chances d'être inutile.
Il faut synthétiser du sens à la place du patient pour lui permettre de se constituer des fantasmes, une réalité psychique. Ces noyaux de sens peuvent n'être qu'un semblant, la simple juxtaposition de signifiants créant toujours un effet de sens surtout si elle est répétée. (À la différence d'autres types d'interprétations dont nous verrons qu'elles sont beaucoup plus ''grammaticales").
Il apparaît alors que la réponse du patient, plutôt qu'un changement de discours comme dans le cas d'une interprétation réussie chez un névrotique, consistera a nous fournir de plus en plus de matériel verbal "'a-signifiant" comme s'il nous encourageait à continuer pour lui ce processus de symbolisation.
Lorsqu'il commence de lui-même, et avec ses propres souvenirs et associations, à constituer des fantasmes de nature œdipienne, nous le laissons faire sans rien en interpréter, jugeant que cette névrotisation nécessaire doit se poursuivre et se consolider, mais nous continuons à lui constituer un "sous-sol" d'associations verbales a-grammaticales sur lesquelles il peut "s'appuyer" pour fantasmer. Nous agissons donc sur les parties de son discours qui échapperaient encore à cette symbolisation, en vue d'écarter au maximum le risque d'une rechute délirante portant sur ce qui n'a pu être symbolisé.
2) Si le sujet ne parle pas, on peut chercher à engager le processus de symbolisation en décrivant ce que nous percevons de lui : son image corporelle, ses gestes, ses mimiques. Ceci revient à verbaliser le non-verbal, ou encore à transformer l'« analogique » en « digital », si nous reprenons la terminologie de l'école de Palo-Alto.
Cette manière de procéder s'est révélée efficace dans une autre prise en charge conduite a la même époque : les entretiens fondés sur l'écoute pure n'avaient mené à rien chez une patiente schizophrène chronique, quasi-mutique, hospitalisée de longue date. Un jour où, commentant ses actes, nous énoncions qu'elle venait de se racler la gorge, elle répondit : « Oui, j'ai un chat dans la gorge ». Elle commença dès lors a pouvoir associer de façon non métaphorique sur ce chat qui symbolisait entre autres choses un enfant impossible à accoucher, mais qu'elle vivait hallucinatoirement comme présent dans une partie de son corps. Par la suite elle se mit a verbaliser abondamment, ce qui permit à la prise en charge de continuer sur le mode précédemment décrit.
C – ESSAI D'INTERPRÉTATION TEXTUELLE
1) La première phase
2) Le réveil du délire
3) Le remembrement symbolique
1) La première phase
Si nous l'avons dénommée "De la naissance à la parole" c'est pour montrer l'analogie entre notre rôle et le rôle maternel vis-à-vis de l'enfant qui ne parle pas encore. Le désir de la mère, déjà manifeste dans le fait de venir s'occuper de l'enfant avant même qu'il demande, apparaît aussi du fait qu'elle lui parle comme s'il comprenait déjà. Ce don de parole est le signe que l'enfant est attendu, qu'il a une place comme futur sujet parlant dans le désir de sa mère. L'enfant sent l'intérêt qu'on lui porte, mais le désir de la mère est pour lui une énigme. La prise de parole est un moyen pour lui de commencer à questionner l'adulte et de lui poser la question de sa venue au monde, de son existence.
Ainsi voit-on M. A... sortir du mutisme quand il nous perçoit couine le désirant (puisque nous lui parlons) et comme pouvant donner du sens à ses signifiants dont il ne sait que faire. Nous verrons plus tard se préciser le sens des premiers objets qu'il a proposé du regard à notre nomination (photos de toréadors, de coureurs cyclistes, de vedettes de cinéma).
2) Le réveil du délire
Trois sortes de facteurs sont probablement intervenus dans son déclenchement.
– La diminution du traitement psychotrope (notamment l'arrêt des neuroleptiques antipsychotiques). Cependant le malade n'avait plus que du Nozinan depuis fin février, et le délire n'a commencé que le 15 avril, soit un mois et demi plus tard. L'arrêt des neuroleptiques n'a donc joué que comme facteur permettant au délire de se manifester, sans être directement responsable de son apparition.
– Le fait que nous lui parlions de son corps : son délire porte principalement sur son corps, et commence par un malaise physique avec impression de mort imminente.
– Le fait qu'il s'est trouvé replacé par nous dans une situation où il avait à répondre sur le plan symbolique, comme Lacan le signale à propos du déclenchement d'une psychose. Il se serait alors manifesté une carence de l'effet métaphorique et une réponse sous la forme d'un délire, dans le cadre d'une véritable psychose de transfert.
Le délire peut s'interpréter dès lors :
– Comme une tentative pour reconstituer par la métaphore délirante une réalité psychique qui se dérobe à la saisie. L'angoisse de mort, de disparition imminente trouve à se symboliser dans le thème du morcellement du corps, et la mort vécue au présent est reportée dans un futur proche, ce qui la met déjà à une distance relative.
– Comme un moyen de communiquer avec l'autre, de lui parler : le délire succède au silence et aux associations banales. Même comme persécuteurs, nous existons beaucoup plus pour lui à présent (il nous nomme).
– Comme un texte où se lit dans le registre délirant ce qu'il ne peut symboliser comme le ferait un névrotique : l'absence de désir de sa mère, l'appel à un Père symbolique qui pourrait lui permettre d'exister – "Ce qui est forclos du symbolique revient comme réel".
a) Tentons d'analyser point par point l'installation du délire
Le 15 avril l'angoisse de mort apparaît de façon soudaine comme un vécu qu'il ne peut expliquer de façon précise. Il investit massivement de sa confiance l'infirmière à qui il s'adresse. Celle-ci, très intuitivement, le calme en prenant le rôle d'une bonne mère nourricière (elle lui donne du lait).
Le lendemain, il tient les mêmes propos, mais rejette déjà comme mauvais l'aliment qui symbolise le don d'amour maternel. Toute nourriture va progressivement lui apparaître comme insuffisante pour combler l'absence initiale d'investissement maternel, et il la rejettera avec mépris.
Le 5 mai, figurent dans ses dires à la fois le malaise corporel (« Ici je maigris ») rattaché à la mauvaise nourriture, et un appel à un signifiant évoquant son père (qui était policier). "Le cachot" serait ce contenant qui le rassemblerait, le protégerait du morcellement qu'il commence à pressentir. Ce thème va se préciser par la suite.
Le 19 mai, il cherche à obtenir de moi une parole sur une partie de son corps dont nous verrons le lien symbolique avec son père. Devant l'absence de réponse, il m'attribue dès le lendemain des propos le concernant. On peut dater de ce moment l'entrée dans la psychose de transfert (qui inclura bientôt l'infirmière, Madame G. C...). J'incarne alors celui qui désire pour lui, celui qui fixe quel sera son destin, un grand Autre tout-puissant qui veut uniquement sa mort.
Il dit nettement (21 mai) qu'il ne saurait se soustraire à ce désir ("si Pinto y tient, je me laisserai faire"), car le désir de l'Autre, quel qu'il soit, vaut mieux pour lui que pas de désir du tout.
Il nous le confirme les jours suivants en allant activement à la rencontre de ce destin (il attend l'ambulance). Le thème de morcellement se précise : il détaille quelles parties du corps doivent être amputées.
Dans l'entretien du 23 mai, nous sommes désignés comme complices de sa mère dans cette persécution. Elle est une présence invisible qu'il devine autour de lui. Il dit qu'elle ne le veut plus, exprimant bien là cette absence du désir maternel qui l'empêche d'exister comme sujet.
Quant à la phrase « Je suis minable, c'est pour ça que je ne suis pas amoureux », elle confirme que l'inaccessibilité de l'Idéal du Moi (point d'où le sujet se voit comme aimable) cause l'impossibilité d'être désirant.
D'autre part, l'expression « Je suis mort sur ma chaise » n'est pas ici une métaphore : il vit bel et bien sa mort. (Nous le verrons plus tard employer une expression semblable dans un sens figuré).
Le 24 et le 25 mai la mise en acte de la conviction délirante se précise encore : il monte dans une ambulance qui va chercher un autre pensionnaire à l'hôpital général.
b) Le texte du délire comprend certains événements réellement vécus par le patient, de même que le contenu manifeste d'un rêve est fait de restes des perceptions diurnes de la veille.
C'est ainsi qu'on note dans les antécédents de M. A... de nombreuses interventions chirurgicales portant précisément sur les parties du corps qu'il désigne, et ayant motivé des transferts à l'hôpital général :
26 septembre 1957 : "Douleurs oculaires – Envoyé en consultation à l'hôpital civil".
7 août 1963 : "Extraction dentaire (deuxième molaire et dent de sagesse), et curetage maxillaire sous anesthésie générale à l'hôpital civil".
26 avril 1963 : "Exérèse au galvanocautêre dune verrue plantaire au pied droit".
22 septembre 1969 : "Abcès dentaire au maxillaire supérieur gauche".
16 septembre 1969 : "Abcès au pied droit incisé hier à l'hôpital civil".
29 septembre 1970 : "Consultation à l'hôpital civil pour un panaris au majeur de la main gauche".
7 octobre 1971 : "Genou gauche enflé – Consultation à l'hôpital civil. Le médecin a prescrit une arthrographie".
23 juin 1971 : "Lésion au niveau du genou survenue lors d'un match de basket. Nécessite des examens radiologiques poussés. À ce sujet réveil d'une angoisse très importante. A peur de "passer sous le bistouri", "qu'on lui coupe la jambe", etc... Pleure".
Il semble que ces faits réels resurgissent dans le délire parce qu'ils ont représenté pour le malade la seule expression du désir des soignants à son égard. L'hôpital général est ce lieu où l'on va enfin s'intéresser à lui, mais ce désir ne peut être vécu que comme une menace (déjà manifestée de façon presque délirante à propos de sa blessure au genou).
3) Le remembrement symbolique
Nous pouvons considérer qu'il s'est fait en deux temps :
– identification primaire à son image corporelle, qui lui a permis de se reconstituer un Moi.
– identification secondaire : acquisition de la possibilité de métaphorisation, mise en place du fantasme et de la réalité psychique, accession à une problématique œdipienne.
a) Le premier temps commence avec notre intervention sur l'image de son corps vue dans un miroir.
Le matin du 27 mai, il cherchait à se jeter contre et non sous les voitures qui passaient devant lui. Ceci peut s'interpréter comme une tentative pour rencontrer dans le réel le signifiant "voiture" qu'il reliera plus tard à son père ("voiture de police" revenant dans le délire) et à son beau-père (qui conduit sa mère en voiture). Ce geste n'avait pas le caractère d'une tentative de suicide, et cessa peu après. Quand nous avons nommé les parties de son corps dans le miroir et sur lui-même, il était plus calme.
D'autre part, questionné à propos d'une bague qui portait l'initiale du nom de son beau-père, il répétait « M c'est M, c'est la lettre M de l'alphabet, c'est tout... ». Aucune association témoignant d'un quelconque désir ne venait s'attacher à cette lettre M qui restait alors dépourvue de sens (ceci se modifia par la suite).
L'idée que j'ai fait mourir toute sa famille peut signifier soit qu'il me fait prendre leur place, que je viens les remplacer dans sa généalogie (transfert psychotique), soit qu'il ne peut constituer son image, à ce stade, qu'en détruisant celle de l'Autre, de ceux qui l'ont fait naître ("leur peau ou la mienne").
Le lendemain apparaît dans son discours une comparaison entre le présent et le passé, qui marque la réintroduction de la dimension temporelle dans son vécu. Il retranspose sur le plan biographique (avant l'entrée à l'hôpital) la possibilité d'être désiré par sa mère (être beau, bien manger, se baigner avec elle). Par ailleurs, il commence à manifester une agressivité croissante, bientôt dirigée vers moi, et que la suite permettra de comprendre dans le cadre de la psychose de transfert.
Le 31 mai il commence à conférer un sens au destin qui l'attend. S'il ne plaît pas à l'Autre, c'est qu'il doit être coupable de quelque chose : l'Autre veut le tuer parce que lui-même pense à tuer les gens. Il commence à prendre à son compte ce qui lui apparaissait comme un désir étranger : "il faut me crever les yeux", c'est le châtiment qu'il réclame lui-même, fournissant une réponse à l'énigme que constitue pour lui le désir de l'Autre.
Le 5 juin, bien qu'il continue à délirer, il a retrouvé le calme de la période antérieure, et peut rester dans sa chambre. Alors que son agressivité envers moi diminue, des signifiants directement liés à son père se constituent en un thème délirant ("J'ai vu une voiture de police avec
des pétards – Ils venaient me tuer"). Remarquons qu'au moment où le père va réapparaître dans son discours, il considère sa mère comme morte. Ceci signifie peut-être que la mère qui ne laissait dans son discours aucune place à la fonction paternelle, cette mère-là est en train de disparaître (elle sera remplacée bientôt par une mère objet d'un désir œdipien).
Dans l'entretien du 15 juin, il reformule comme un simple souhait ce qui avait surgi comme réel dans son délire le 5 juin : "Il vaudrait mieux que j'aie un pétard ou que la police me loge deux balles dans la tête. Après, je n'entendrais plus rien". Ceci peut se lire comme le vœu que quelque chose venant du père s'inscrive en lui et lui permette de commencer à oublier (processus de refoulement) pour constituer son désir. Cette inscription semble déjà en cours puisqu'il demande de l'argent pour s'acheter des cigarettes et des vêtements (l'argent est un moyen de réaliser les désirs). Notons qu'il associe directement ce qu'il désire (des vêtements) à quelque chose qu'il aime en sa mère (sa veste) : il la perd comme mère toute-puissante et comme objet de désir, pour la retrouver indirectement dans certains des traits signifiants qui lui sont attachés.
Ce même jour il commence à utiliser le futur dans ses phrases, et fait un emploi métaphorique d'un terme évoquant la mort quand il dit : "Je suis crevé, je vais dormir".
Le lendemain, il confirme, par la reprise des soins corporels, l'intérêt porté à son image spéculaire. Cette image est également, nous l'avons vu, celle de la mère. Et de fait, il m'attribue à la fois les caractéristiques de l'image maternelle ("Pinto devrait se raser et se mettre du rouge aux lèvres") et les siennes, me posant comme un double interchangeable avec lui. ("Qu'il aille manger chez ma mère").
À mesure que je reprends pour lui une dimension plus humaine, il réinvestit sa propre image en la valorisant : si de plus laids que lui (des nains bossus) peuvent vivre dehors, avoir de l'argent et bien manger, pourquoi pas lui ?
b) L'identification secondaire, avec la réapparition d'un Idéal du Moi, commence au moment où le père est évoqué dans le discours de M. A...
Le 8 juin il en parle abondamment : "Tout a commencé en 1945", date de la mort du père. Il relie directement sa mort aux coups de pieds qu'il lui donnait dans les jambes. Ainsi se trouvent expliqués et la première partie du corps désignée dans le délire (il voulait me montrer son pied) et la valeur de châtiment qu'il attribue à sa mort prochaine.
Les premières phrases de l'entretien contiennent des signifiants-clé : Il parle de gras-double, or la syllabe GRA est une des syllabes de son nom, ainsi que la syllabe PAR, et il les utilisera désormais très fréquemment chaque fois qu'il aborde des sujets anodins sans rapport apparent avec les autres associations. Dès que ce fait a attiré notre attention nous avons systématiquement rattaché ces syllabes à son nom complet chaque fois qu'il les employait, ce qui entraînait chez lui des réactions émotionnelles importantes et modifiait son discours. On peut voir dans ce type d'intervention une reconstruction symbolique du nom du père réel, qui a favorisé analogiquement le remembrement de l'image corporelle et la disparition du délire.
D'autre part le père est évoqué "mangeant les bons morceaux de blanc de poulet" et nous verrons que le signifiant blanc est rattaché à la mère. Il s'agit donc probablement d'une vision "orale" de la scène primitive.
À la fin de l'entretien nous le voyons illustrer en actes l'expression "vider son sac", ce qui ne doit pas masquer qu'il est en fait en train de se "remplir" de fantasmes.
Le 17 juin, les raisons qu'il donne à un possible emprisonnement tiennent du fantasme et non plus du délire. Elles ont d'ailleurs une connotation sexuelle (perdre son pantalon). Mais cet entretien vaut surtout par le fait que M. A... commence à rattacher les éléments de son délire (qu'il critique partiellement) à des souvenirs d'interventions subies par d'autres ou par lui-même. Après avoir relié l'extraction dentaire au second mari de sa mère, il se met à raconter la mort de son père, précédée des paroles "la vérité me soulage". Notons que le père est mort des suites d'une opération chirurgicale (ce que M. A... craignait pour lui-même). il est présenté comme un double du malade : la mère lui envoyait des colis en captivité, comme elle envoie des colis à son fils à l'hôpital.
La phrase "Ils ont ouvert le poste à bloc, à bloc" contient deux signifiants (poste et bloc) synonymes en langage courant de la prison et du cachot déjà reliés au père.
Enfin notre intervention "Vous voulez parler du Rhin en Allemagne" en réponse à "Mon père a été opéré d'un rein" montre le terrain sur lequel nous continuions à nous situer même alors que la fantasmatisation avait déjà commencé.
Dans l'entretien du 26 juin, il reparle de la mort du père, d'une façon qui laisse supposer qu'il pourrait lui aussi mourir à 42 ans. À mesure que s'ébauche cette identification aux signifiants paternels, il construit une
sorte de roman familial d'allure très névrotique sur sa naissance (bien que le terme "fabriqué" rappelle qu'il est apparu comme une machine biologique non investie du désir maternel). Il prend sur lui la culpabilité d'exister, comme s'il était le signe vivant de la "faute" qu'ont commise ses parents en le faisant naître.
Plus loin, il rejette de nouveau le signifiant "gras" (syllabe de son nom) mais sollicite de façon étonnante une interprétation sur ce point : "Vous marquerez, mais ça ne changera rien au menu, alors je parle dans le vide". Il associe alors sa mort à celle de son père : "La mort me donnera mieux à manger" – "Mon père est mort en bien mangeant", semblant reconnaître là le lien entre jouissance et mort. La connotation sexuelle présente dans ce dont jouissait le père ("cuisses de poulet") se confirmera plus tard quand il se décrira regardant avec envie "les belles cuisses des infirmières". Enfin l'inscription "Mort pour la France" amorce le retour, à une distance encore lointaine, de l'Idéal du Moi dont nous avons vu qu'il est inaccessible pour le psychotique.
Dans l'entretien suivant (30 juin) cet Idéal du Moi apparaît encore persécuteur tant il est distant : il s'incarne dans l'enfant blond aux yeux bleus (traits empruntés au portrait du père) qui le nargue et le traite de fou. Mais déjà quelque chose de son père passe de son côté pour prendre sa défense : "Si vous me tuez la police viendra avec un pétard". Sa mère peut d'autre part lui apporter un "chapelet incassable" qui le mettrait donc définitivement sous la protection divine. (Il décrira plus tard ce chapelet comme béni, porteur d'une parole sainte et protectrice).
Le 2 juillet, la voiture, attribut paternel, est présentée comme un danger juste avant qu'il n'évoque les rapports sexuels de ses parents. Le signifiant métaphorique de la jouissance sexuelle parentale ne peut encore être approché qu'avec précaution. Après des évocations très œdipiennes de sa mise à l'écart de la scène primitive, il nous donne trois modèles d'identification, trois versions de l'Idéal du Moi, dont le trait commun est qu'ils étaient au départ semblables à lui, que leur nom figure dans les journaux, et que sa mère s'y intéresse. "Un petit maçon arlésien peut devenir un grand chanteur" résume nettement que la voie de l'identification lui est désormais ouverte, sous des formes encore naïves et enfantines (il se comparera plus tard lui-même à un "petit de 5 ans").
Dans l'entretien du 5 juillet le fantasme fonctionne de façon typique : formule grammaticale dont le sujet n'est pas le pronom "Je". Le désir de tuer le mari de sa mère est attribué à un autre malade, et il s'innocente en disant qu'on doit le tuer aussi. Sa mort lui permettra par ailleurs d'atteindre l'Idéal du Moi en ayant son nom dans le journal.
Le 19 juillet débute une évocation qui se maintiendra longtemps : celle d'une doctoresse contenant dans son image des traits du père (yeux bleus, cheveux blonds) et qui semble désigner une mère dont le discours contient la fonction du Nom-du-Père. Sa vraie mère est évoquée à présent comme source de satisfactions orales (ce qui rend compte de la confusion qu'il faisait entre satisfaction orale et satisfaction sexuelle). Après avoir évoqué sa propre mort comme une simple possibilité qui n'a plus rien de délirant, il évoque le châtiment d'un assassin qui ne le représente plus que par des associations inconscientes (le même chiffre désigne le poids de la guillotine et son âge). Deux personnages féminins apparaissent comme objets de désir, dans lesquels la mère, interdite par la loi de l'inceste, est retrouvée par certains des signifiants qui la caractérisent. Ainsi le prénom Arlette contient Arles, ville où habite sa mère, Monique a les yeux marrons comme le manteau de sa mère, et elle lui offre du café comme fait sa mère lors de ses permissions.
Il associe ensuite son prénom à celui de personnes célèbres et à celui du fils d'une de ses sœurs, renouant ainsi avec sa généalogie où il peut maintenant se retrouver. Vient ensuite une nouvelle figure de son Idéal du Moi : Jacques Anquetil, blond aux yeux bleus comme il le dit plus loin de son père.
L'évocation finale de sa mère priant sur une tombe célèbre, au Père Lachaise, alors qu'il accède au désir, nous semble à rapprocher de cette phrase de Lacan : "la réflexion de Freud l'a mené à lier l'apparition du signifiant du Père, en tant qu'auteur de la Loi, à la mort, voire au meurtre du Père, montrant ainsi que si ce meurtre est le moment fécond de la dette par où le sujet se lie à vie à la Loi, le Père symbolique en tant qu'il signifie cette Loi est bien le Père mort".
Un entretien postérieur au relais de la prise en charge (14 octobre 1975) nous paraît digne d'être cité à la fin de ce chapitre tant il illustre et résume l'évolution qui s'est produite :
"Mes parents m'avaient promis de me sortir d'ici. Ils ne l'ont pas fait. Je suis orphelin d'un père policier. J'ai deux pères policiers: le second mari de ma mère est dans la police... Je suis toujours là. Je vous dis la vérité pure... Ma mère m'avait dit : quand tu seras guéri, tu laveras des voitures dans le garage d'un ami (un ami de mon vrai père)... Je ris, j'ai envie de rire, je vous dis la vérité, ça me soulage donc ça me fait rire ...".
À l'infirmière qui lui demande qui il est, il répond : "Moi je suis Paul A. je suis content, ça me donne envie de vous aimer".
4 RÉFLEXIONS ET CRITIQUES
La prise en charge que nous venons de décrire et de commenter en détail soulève certaines questions sur des points particuliers et sur un plan plus général.
A – DISCUSSION DU DIAGNOSTIC
B – QUELQUES PROBLÈMES POSÉS PAR LA DÉMARCHE THÉRAPEUTIQUE
C – LE PROBLÈME DE L'ORIENTATION THÉORIQUE
A – DISCUSSION DU DIAGNOSTIC
1) En ce qui concerne le diagnostic même de schizophrénie, avec ses connotations habituelles de gravité, d'incurabilité, de déficit irréversible, il pourrait se trouver remis en question par le résultat favorable qui a été obtenu chez ce malade.
Ceci pourrait trouver à s'argumenter dans la pauvreté de la symptomatologie avant la prise en charge, et le fait qu'un délire n'ait jamais été clairement mis en évidence chez M. A... On expliquerait alors la phase délirante que nous avons décrite comme une décompensation transitoire survenant sur un terrain fragile d'allure psychopathique.
Mais certains signes de la période de début (discordance motrice, "rapidité dispersée de la pensée", "aspect indifférent"), joints à la réapparition périodique de tendances interprétatives, et surtout à l'évolution inexorablement déficitaire avec les signes observés par nous-même (apragmatisme, clinophilie, mutisme, refus de contact) nous laissent peu de doute sur le fait qu'il s'agit bien là d'un psychotique. L'absence de délire franc, qui n'est caractéristique que de certaines formes de schizophrénie, ne suffit pas à écarter ce diagnostic. Le cas de ce malade pourrait évoquer par certains aspects une forme à début héboïdophrénique (la maladie a commencé chez un sujet très jeune, avec des troubles du caractère et des réactions d'opposition à la famille et à la société).
2) Ne s'agirait-il pas alors, dans le cadre d'une schizophrénie confirmée, d'une poussée processuelle à rémission spontanée ?
Ce qui nous empêche de retenir cette hypothèse vient d'une part de ce que l'éclosion du délire survient en continuité avec des modifications du comportement verbal induites par la prise en charge, et non comme une rupture avec ce qui l'a immédiatement précédé. D'autre part, outre que nous avons pu observer pas à pas le lien entre notre intervention et la disparition du délire, il est à remarquer que le patient n'est pas revenu à l'état antérieur : il a changé radicalement dans son comportement et peut-être dans sa structure (névrotisation), ce qui serait inexplicable dans le cas d'une simple péripétie émaillant une évolution chronique.
B – QUELQUES PROBLÈMES POSÉS PAR LA DÉMARCHE THÉRAPEUTIQUE
1) La question des psychothérapies à l'hôpital psychiatrique
Il y a lieu de discuter, dans le cas de sujets névrotiques, s'il vaut mieux amorcer à l'hôpital une relation psychothérapique qui se poursuivrait à l'extérieur, ou les adresser d'emblée à des thérapeutes extérieurs de peur de créer chez eux une dépendance vis-à-vis de l'institution. Les psychotiques relativement compensés ou correctement équilibrés du point de vue médicamenteux peuvent occasionner une discussion semblable. En revanche l'hôpital devient le seul lieu de prise en charge possible dans deux cas :
– l'entrée dans la psychose ou les poussées aiguës chez des psychotiques chroniques, en raison de l'agitation, des risques courus par d'eux-mêmes et par l'entourage. (Ils se placent d'eux mêmes dans une dépendance momentanée mais profonde).
– les psychoses déjà anciennes ayant évolué vers la chronicité. La désadaptation sociale, l'impossibilité de vie autonome obligent à commencer quelque chose dans le lieu d'hospitalisation, quitte à continuer à l'extérieur si l'évolution le permet.
2) La question du nombre des thérapeutes
Elle est liée à l'état du malade et à ses conséquences sur le contre-transfert des thérapeutes. Un psychotique chronique que l'on aborde progressivement soulève chez nous moins d'angoisse qu'un psychotique
en phase aiguë. Dans ce dernier cas, le fait d'être deux thérapeutes offre une réassurance non négligeable qui permet de mieux supporter le transfert psychotique.
Dans le cas que nous avons relaté, notre nombre (deux) dépendait plutôt du mode de fonctionnement du pavillon à cette époque. En effet nous n'avons jamais ressenti en face de M. A... la même angoisse qu'ont pu parfois susciter en nous des malades jeunes plus profondément destructurés.
3) Le contrôle
Outre le fait qu'une formation psychanalytique personnelle peut faciliter l'abord de toute psychothérapie, on peut envisager diverses modalités de contrôle.
a) Nous avons vu que les réunions d'équipe quotidiennes pouvaient tendre à jouer ce rôle, mais certaines critiques apparaissent rapidement :
– Les soignants ont un pouvoir de décision direct sur les patients. Cet inconvénient peut être surmonté si les personnes qui écoutent un patient évitent de participer à toute décision thérapeutique ou institutionnelle le concernant (à tout geste thérapeutique pour un membre du personnel infirmier)
– Le patient parvient en général à différencier ses thérapeutes du reste de l'équipe, à qui il adresse alors ses demandes de médicaments, de soins somatiques et de sorties.
– Cependant les soignants qui n'ont pas le malade en charge peuvent être influencés, dans leur attitude quotidienne envers lui, par ce qu'ils ont appris de lui au cours des réunions. Certains patients supportent mal ce genre de situation, ce qui n'est pas suffisant pour renoncer à faire des prises en charge dans le contexte décrit. On ne peut que souhaiter que la prise de conscience des soignants au cours des discussions de cas en équipe rende à la longue leur attitude plus neutre.
b) Le recours à un psychothérapeute ou analyste extérieur à l'institution supprime ces interférences et parait donc souhaitable. Il peut être rencontré dans l'hôpital ou à l'extérieur par les thérapeutes du patient. (Une tentative semblable faite dans notre service échoua malheureusement, la personne qui s'était proposée voulant en fait faire elle-même des prises en charge, et non contrôler les soignants).
C – LE PROBLÈME DE L'ORIENTATION THÉORIQUE
Nous avons indiqué, au début de ce travail, qu'à l'époque de la prise en charge de M. A..., nous nous étions principalement inspirés de la théorie lacanienne de la psychose ; ceci en dépit du fait qu'on n'y trouve aucune indication d'ordre pratique, à la différence d'autres modèles théoriques dont découlent directement des techniques à peu près codifiées. Certaines méthodes (Rosen) paraissent même surtout liées à l'expérience pratique de la relation au schizophrène, avec une théorisation relativement peu développée.
Comment rendre compte de l'efficacité comparable de pratiques d'inspiration parfois très différentes ? Nous ne pouvons, pour ce faire, approfondir l'une après l'autre ces orientations : chacune mériterait une longue et minutieuse étude. Nous nous bornerons donc à en évoquer quelques unes, en tentant d'en dégager les caractéristiques que nous comparerons ensuite.
1) L'Analyse Directe de ROSEN
"Pour autant qu'elle s'appuie sur une solide connaissance de la psychanalyse, l'Analyse Directe s'écarte radicalement de la technique psychanalytique : elle en est presque l'envers" (Racamier).
En effet :
– Cette méthode utilise un type d'interprétation qui va directement aux significations inconscientes sans passer par les couches successives de défenses. Le fait d'utiliser un langage concret et simple, voire trivial, évitant les périphrases, permet à l'interprétation d'être incisive et dynamisante. Elle vise à produire un effet de choc. On peut se servir des propres expressions du patient pour engager un dialogue dans le registre où il se situe. L'interprétation est alors faite dans les mêmes termes qu'utilise le langage délirant. L'emploi d'un langage trop abstrait ou trop différent des expressions propres au patient risque de raviver inutilement le processus morbide. En revanche les expressions populaires (proverbes, locutions jouant sur le sens figuré) peu-vent être acceptées et produire l'effet souhaité.
– L'intonation de la voix joue un rôle essentiel. Le ton ne doit surtout pas être monocorde : "ce que vous apportez au patient n'est pas seulement le sens de ses actes mais l'effet émotionnel que son comportement vous a produit... Il doit savoir que ses actes affectent les autres et que les autres
s'intéressent assez à lui pour réagir personnellement et fortement à ce qu'il fait" (Rosen).L'interprétation réussie fait cesser l'acting-out ainsi que l'angoisse qui l'accompagne. Elle amène une sécurisation temporaire et une possibilité de rationalisation. Pour cela elle doit établir un lien entre quelque chose de la réalité extérieure et un aspect important des difficultés actuelles du patient, se reporter généralement à l'avenir, contenir un élément de réassurance pour lui et l'éloigner du point le plus brûlant.
Elle n'agit pas forcément par son exactitude, mais peut-être par la haute chaleur émotionnelle qu'elle véhicule ou par un effet de choc produit par le contenu.
– Enfin il convient d'insister sur la qualité de la relation,qui rend efficientes les interprétations. La "présence" du thérapeute, ce qu'il est, y joue un rôle essentiel.
2) La Réalisation Symbolique de M. A. SECHEHAYE
Cette méthode repose sur une conception dynamique des processus de désagrégation dans la schizophrénie. L'auteur insiste sur l'absence d'amour de la mère (dont l'introjection permet l'amour de soi). La frustration affective précoce joue un rôle important dans la désagrégation du Moi psychotique : elle est responsable de l'état de faiblesse initial du Moi, à la faveur duquel la psychose pourra éclater. Cette désagrégation du Moi est la cause principale de l'irruption des pulsions inconscientes dans le champ de la conscience. Les pulsions primaires orales et agressives dominent. On peut parler de régression à des fixations orales.
Au lieu de laisser les mécanismes de projection, participation, condensation et imitation se mettre au service des pulsions destructrices et des constructions délirantes, il s'agit de les dériver et de les utiliser pour tenter une reconstruction du Moi psychotique. Mais tout d'abord il faut réparer la frustration initiale en autori-sant le malade à assouvir son désir de retour à la mère. À travers la mère-analyste, source de la satisfaction du besoin, le patient peut accepter la réalité bienfaisante, neutraliser ses pulsions autodestructrices par les tendances libidinales puisées dans l'amour de la mère. Les gratifications passent par des objets "pré-symboliques" (telle la pomme chargée de représenter le sein dans le cas de la malade Renée). Les mécanismes formateurs du Moi entrent alors en activité. Le Moi n'opère sa synthèse que lorsque le malade a conscience de son corps : la conscience d'être corps semble indispensable à la différenciation du Moi d'avec le non-Moi. On voit alors le malade repasser
par tous les stades de l'évolution infantile. La projection symbolique et l'imitation jouent leur rôle constructeur dans la réédification du Moi en tant qu'ils achèvent de combler les frustrations initiales, sources premières de l'éclosion de la psychose. L'énergie investie dans les éléments formant la psychose se déplace alors pour se mettre au service du Moi. Celui-ci ordonne les pulsions dans une hiérarchie normale, et investit la réalité avec la libido dont il dispose. Libre et autonome, il s'adapte de mieux en mieux au monde extérieur. Dans ce processus.s'opère une dissolution du "réalisme affectif" par le travail d'introjection et d'identification à la mère aimante. La différenciation entre soi et les autres peut être à présent établie.
D'un point de vue plus synthétique on peut dire qu'il y a passage du symbole (substitut de l'objet, encore adhérent à celui-ci) à l'image puis au concept opératoire.
En résumé "la Réalisation Symbolique est une psychothérapie qui s'adresse directement aux besoins, aux frustrations que le malade a subies dans sa petite enfance, pour les combler et les satisfaire sur le plan présymbolique, magique et concret" (M. A. SECHEHAYE).
3) Les psychothérapies de psychotiques d'inspiration kleinienne
Mélanie KLEIN a surtout pris en charge des enfants psychotiques. Parmi ses disciples, ROSENFELD et BION ont considérablement enrichi, chacun à leur manière, la technique et la théorisation de la relation au psychotique.
Nous avons trouvé particulièrement intéressante la place qu'accorde Bion au langage du psychotique dans le maniement de la cure. Son article "le langage et le schizophrène" détaille cette démarche.
Il rappelle tout d'abord l'hypothèse de Freud "la névrose serait le résultat d'un conflit entre le Moi et son Ça la psychose, l'issue analogue d'un trouble équivalent dans les relations entre le Moi et le monde extérieur". C'est le concept de conflit intrapsychique qui retient l'attention de Bion. Il existe chez le psychotique un conflit avec la réalité : "des attaques destructrices en provenance du patient, ou du Ça du patient, ont été dirigés contre les organes sensoriels nouvellement investis et la conscience qui s'y rattache". Le schizophrène s'attaque à tous les éléments de son Moi qui ont pour fonction d'établir le contact avec la réalité externe et interne, et qui sont :
– la conscience attachée aux organes sensoriels,
– l'attention, fonction d'exploration du monde extérieur,
– le système de notation faisant partie de la mémoire,
– la fonction de jugement,
– la pensée comme moyen de supporter l'accroissement de tension dû à l'arrêt de la décharge motrice.
Or "la pensée verbale est la caractéristique essentielle de ces cinq fonctions du Moi".
Le clivage est une des méthodes d'attaque les plus employées contre la pensée verbale. Ces attaques surviennent chez le psychotique au moment du passage de la position paranoïde-schizoïde à la position dépressive. Au début de celle-ci la pensée verbale augmente en intensité et en profondeur, exacerbant les souffrances de la réalité psychique. C'est donc à elle que le psychotique s'en prend "comme à un des éléments qui l'ont conduit à la souffrance".
Le langage est employé par le schizophrène comme mode d'action, comme moyen de communication, comme mode de pensée. Comme mode d'action il est utilisé :
– au service de l'identification projective : "il se sert des mots comme des parties clivées de lui-même, qu'il enfonce violemment dans l'analyste".
– au service du clivage des objets persécuteurs, par exemple de l'analyste ou de la parole de l'analyste. Ce clivage lui rend difficile l'usage des symboles. Il y a inhibition de la capacité de fantasmer. Au stade où le patient se met à haïr l'analyste du fait qu'il use de la pensée verbale dans le traitement, il a tendance à délaisser sa propre pensée verbale naissante et à la confier à l'analyste (à la placer en lui). Par la suite il se met à croire que c'est l'analyste qui lui a enlevé sa capacité de pensée verbale, et se sent devenir fou, avec une angoisse caractéristique. Paradoxalement c'est dans cette phrase que le clivage diminue et que le Moi tend vers l'intégration. Lorsque la position dépressive fait son apparition survient une "crise contrôlée de schizophrénie" avec une haine très vive de l'analyste. La réaction de panique terminée, il convient d'analyser en détail les "changements apportés aux relations d'objet du patient par la prise de conscience de sa folie". Par cette voie, le schizophrène pourra atteindre "une certaine forme d'ajustement à la réalité".
Tout au long du traitement l'analyste s'appuie sur la "partie non psychotique" de la personnalité du schizophrène. Il fait en sorte de montrer qu'il parle à une personne saine d'esprit, sous peine de voir le patient se servir de l'identification projective pour essayer de se débarrasser de sa "santé mentale", et régresser massivement. D'autre part, l'analyste utilise son propre contre-transfert pour y trouver des indices sur lesquels fonder ses interprétations.
4) La méthode de structuration dynamique de GISELA PANKOW
L'article "Image du corps et symbiose", paru dans les actes du colloque de Milan de 1976, expose les conclusions les plus récentes de cet auteur. Elle se propose de "développer et conceptualiser une psychothérapie analytique des psychoses au moyen de l'image du corps". Pour cela, elle cherche à comparer la fonction de l'image du corps et le rôle de l'objet transitionnel dans la fonction de symbolisation.
Selon WINNICOTT, l'enfant se sert, à partir du quatrième mois, d'objets qui ne font pas partie du soi. Il trouve l'objet qu'il intègre à son schéma personnel, il ne le crée pas. (Il en sera de même pour le langage plus tard). L'objet transitionnel va lui permettre de supporter l'angoisse de séparation d'avec sa mère : "l'utilisation d'un objet symbolise l'union de deux choses désormais séparées, le bébé et la mère, en ce point, dans le temps et l'espace, où s'inaugure leur état de séparation (souligné par Pankow,) qui va s'intéresser à cette "charnière dans la dynamique et la dialectique de l'espace").
L'objet transitionnel n'est ni un objet internalisé, ni un objet externe, c'est un objet que l'enfant possède. En tant que "non-représenté", il ne peut être mis en évidence par l'interprétation du refoulé, mais on peut l'aborder par une dialectique de la structure de l'espace afin de le rendre représentable.
L'image du corps est, quant à elle, définie par deux fonctions symboliques.
La première consiste en un lien dynamique entre la partie et la totalité du corps, la seconde "permet de saisir, au-delà de la forme, le contenu et le sens même d'un tel lien dynamique". Cette notion de l'image du corps sert de repère pour le diagnostic et la thérapie.
Il y a convergence, selon Pankow, entre l'image du corps, définie par ces deux fonctions symbolisantes, et les processus de symbolisation dont l'objet transitionnel est la base.
L'abord des psychoses se doit d'être radicalement différent de celui des névroses – "les troubles proviennent de la manière d'être-dans-le-corps". Si nous arrivons à saisir une dynamique dans l'espace du corps vécu, l'accès à l'autre pourra être mis en route à partir des conflits du champ spatial". Ces conflits consistent en une "dissociation de l'image du corps entre un contenant hétérogène devenu limite du corps pour le sécuriser symbiotiquement, et son contenu authentique".
Pour aborder ces conflits et leur permettre de se symboliser, Pankow introduit les malades dans un "espace de jeu" grâce aux techniques de modelage. Elle cherche par là à créer chez eux des "greffes de désir" afin de déclencher le processus de symbolisation : "l'objet modelé aide à créer un espace qui devrait être structuré". Il se situe dans un "espace potentiel" qui est le même que celui où se situe l'objet transitionnel, mais ici l'objet modelé est créé par le malade. Cet espace une fois aménagé, un transfert peut se nouer et inaugurer la cure analytique proprement dite, où interviennent des interprétations au niveau symbolique (retour à une technique plus classique).
Les divergences entre les différentes approches que nous venons d'évoquer se situent, on le voit, à la fois dans la théorisation de ce qui favorise ou déclenche une psychose et dans les modalités techniques particulières à chaque thérapeute.Il nous semble cependant que cette diversité (souhaitable pour stimuler le questionnement sur la psychose) n'empêche pas de reconnaître certains traits convergents :
– Tout le monde semble s'accorder sur le fait que le psychotique est incapable de reconstituer par lui-même quelque chose qui lui manque, ce qui oblige à utiliser une technique différente de l'analyse classique des névroses. Ce qui lui est impossible, c'est la constitution d'une image du corps (ou d'un imaginaire), l'intégration de son Moi, l'élaboration de fantasmes de type œdipien, l'utilisation du langage caractéristique du sujet névrotique ou sain (qu'on parle de clivage du langage par le psychotique ou de carence de l'effet métaphorique).
– En conséquence, l'attitude du thérapeute consistera à apporter ce qu'on estime avoir manqué, et qu'on situe généralement au niveau de l'amour ou du désir maternel : don d'amour, de parole, de présence au sens propre ou au sens de chaleur affective, de réassurance, don de
compréhension au sens large ou reformulation, par l'interprétation,d'une pensée à la dérive, don de sens (greffe symbolique ou greffe de symbolique). Toutes les techniques s'appuient sur ce don, qui seul pourra permettre ensuite le retour à une attitude psychothérapique plus classique.
– Du point de vue de la technique proprement dite, notons l'impor-tance accordée généralement à l'utilisation par le thérapeute de son contre-transfert pour se guider dans l'élaboration des interprétations qu'il donne. Par ailleurs, plusieurs auteurs semblent tenir la notion de régression contrôlée, voire même de crise aigue, comme nécessaire à une reconstruction efficace du Moi du psychotique (ce qui concorderait avec ce que nous avons décrit dans le cas de M. A...).
CONCLUSION
Nous avons cherché à rendre compte, dans ce travail, de l'évolution favorable d'un psychotique chronique au cours d'une prise en charge psychothérapique en milieu hospitalier.
L'étude d'un seul cas ne saurait conduire à aucune conclusion systématique sur le mode d'action et l'efficacité des psychothérapies de psychotiques. Il s'agissait d'un malade chronique, hospitalisé depuis de nombreuses années : nous ne pouvons tirer de cet exemple aucun enseignement applicable à des psychotiques bien compensés vus en pratique extra-hospitalière.
On peut en revanche insister sur l'importance de la représentation du malade chronique dans l'esprit des soignants. Le terme "chronique", employé à juste titre dans la description de l'évolution spontanée des psychoses déficitaires, a tôt fait de devenir une "étiquette" définitive, qui conduit à renoncer à des tentatives parfois fructueuses. Cette représentation, déjà modifiée par l'apport des médicaments antipsychotiques, pourra vraisemblablement évoluer si elle est abordée et analysée en commun par l'équipe thérapeutique.
D'autre part, si les éléments théoriques qui nous ont inspiré au départ permettent une interprétation à peu prés cohérente des modifications observées, la question reste ouverte de savoir ce qui a réellement agi. On a vu en effet que des modèles théoriques très différents peuvent rendre compte de façon aussi plausible des résultats obtenus. La plus grande prudence est donc de mise quant à l'interprétation de ceux-ci.
On peut penser qu'une approche combinant les différentes techniques, soit de façon synthétique, soit en les utilisant à tour de rôle selon les phases de la thérapie, pourrait conduire à des résultats plus rapides, plus profonds ou plus durables. [Note de 2009 : Cette phrase n'avait été placée en conclusion que pour souscrire à la demande de mon directeur de mémoire, très éclectique, mais ne reflète pas mon opinion intime ! ...]
Sur le plan de notre expérience personnelle, nous pensons avoir appris au contact de ce patient qu'il n'est jamais vain de tenter l'abord de malades graves ou apparemment incurables : une modification inattendue mais décisive de leur était peut parfois récompenser cet effort.
BIBLIOGRAPHIE
BERGERET J. "Abrégé de psychologie pathologique" Masson et Cie – 1974
BION W.-R. "Le langage et le schizophrène" dans "Psychanalyse et langage" n° 9 – Dunod – 1977
BOUIN – DELAUGE J. "Questions soulevées par un cas de psychothérapie dans un hôpital psychiatrique" Mémoire de Psychiatrie – Marseille 1976
DE WAELHENS A. "La psychose – Essai d'interprétation analytique et existentiale" – Nauwelaerts – 1975
FREUD S. "Cinq psychanalyses" – P.U.F.
HIEGEL J.-P. "À propos de trois psychothérapies de schizophrènes en phase aiguë en milieu fermé" Thèse de médecine – Marseille 1969
KLEIN M. "Essais de psychanalyse" Payot – Paris 1976
LACAS M.-L. "Œdipe et folie. Une approche de la problématique œdipienne dans la psychose", paru dans "La folie. Actes du colloque de Milan 1976" – Tome 1 – Collection 10/18, 1977
LACAN J. "D'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose" in "Écrits II" Éditions du Seuil 1971
NASIO J.-D. "Métaphore et Phallus" in "Démasquer le Réel" de S. Leclaire Seuil 1971
OURY J. "Le temps et la psychose", paru dans "La folie – Actes du Colloque de Milan 1976" – Tome 1 – Collection 10/18, 1977
PANKOW G. "Image du corps et symbiose:à propos de la structuration de l'espace potentiel", paru dans "La folie – Actes du Colloque de Milan 1976" Tome 1 – Collection 10/18, 1977
"L'homme et sa psychose" Deuxième édition – Aubier-Montaigne 1973
RACAMIER P.-C. "Techniques de psychothérapies dans les psychoses" – Encyclopédie médico-chirurgicale – 37 819 A10 – 1961
ROSEN J.-P. "L'Analyse Directe" Paris P.U.F. 1959
SCILICET N° 2-3 1970 "Le clivage du sujet et son identification"
"Pour une logique du fantasme" (Articles anonymes)
SECHEHAYE M.-A. "Journal d'une schizophrène" (Auto-observation d'une schizophrène pendant le traitement psychothérapique) Bibliothèque de psychanalyse – P.U.F. 1973
SEGAL H. "Introduction à l'œuvre de Mélanie Klein" Bibliothèque de psychanalyse – P.U.F. 1974
SIBONY D. "Le nom et le corps" Éditions du Seuil 1974
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
OBSERVATION AVANT LA PRISE EN CHARGE
COMPTE-RENDU DE LA PRISE EN CHARGE PSYCHOTHÉRAPIQUE
A – LES CONDITIONS INITIALES
1) Le cadre institutionnel 2) Les participants 3) L'indication 4) Durée et fréquence des entretiens 5) Le contrôle 6) Le traitement pharmacologique
B – DÉROULEMENT CHRONOLOGIQUE
1) "De la naissance à la parole" 2) Le réveil du délire a) Récit détaillé des événements b) Considérations cliniques sur le délire 3) Le remembrement symbolique 4) Le relais
INTERPRÉTATION DES MODIFICATIONS OBSERVÉES
A – RAPPEL DES DONNÉES LACANIENNES SUR LA PSYCHOSE
B – HYPOTHÈSES DE DÉPART
1) Carence de la fonction métaphorique chez le psychotique 2) Processus de symbolisation
C – ESSAI D'INTERPRÉTATION TEXTUELLE
1) La première phase 2) Le réveil du délire a) Analyse point par point de l'installation du délire b) Texte du délire
3) Le remembrement symbolique a) Premier temps b) Identification secondaire
RÉFLEXIONS ET CRITIQUES
A – DISCUSSION DU DIAGNOSTIC 1) Le diagnostic même de schizophrénie 2) Poussée processuelle à rémission spontanée 3) Facteurs réactionnels
B – QUELQUES PROBLÈMES POSES PAR LA DÉMARCHE THÉRAPEUTIQUE
1) La question des psychothérapies à l'hôpital psychiatrique 2) La question du nombre des thérapeutes 3) Le contrôle a) Les réunions d'équipe b) Le recours à un psychothérapeute ou analyste extérieur
C – LE PROBLÈME DE L'ORIENTATION THÉORIQUE
1) L'Analyse Directe de ROSEN 2) La Réalisation Symbolique de M. A. SECHEHAYE 3) Les psychothérapies de psychotiques d'inspiration kleinienne 4) La méthode de structuration dynamique de GISELA PANKOW
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIÈRES
* * * * *























































![Lisboa d'outros tempos [por] Pinto de Carvalho (Tinop)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6331ef87ac2998afa709f3fc/lisboa-doutros-tempos-por-pinto-de-carvalho-tinop.jpg)