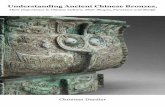Mécanisme d'altération stratifiée des bronzes archéologiques
Transcript of Mécanisme d'altération stratifiée des bronzes archéologiques
ETUDE DE LA CORROSION DE BRONZES ARCHEOLOGIQUES DUFORT-HARROUARD: ALTERATION EXTERNEET MECANISMED'ALTERATION STRATIFIEE
Luc Robbiola, Inocencia Queixalos, LOIc-Pierre Hurtel, Michel Pernot etClaude ·Volfovsky
Resume-Les alterations d'objets en bronze de l'Agedu Bronze provenant du site archeologique du Fort-Harrouard (France) ont ete etudiees dans un premiertemps en fonction de leur aspect externe et de la com-position e1ementaire du metal sain. Une relation entrela composition de la surface apparente des couchespassives et la composition du metal sain a ete mise enevidence. Dans un deuxi<~metemps, l'observationd'une coupe metallographique d'un des bronzes apermis de distinguer des facies de corrosion lies a lageometrie de l'objet: la stratification des produits decorrosion et l'alteration inter- et transgranulaire ray-onnante. L'existence d'une microstructure fantomeinduit l'hypothese d'un mecanisme d'alteration parstratification, qui peut s'expliquer par la croissance deproduits de corrosion dans des fissures orientees,et dans lequel n'intervient pas de precipitationperiodique.
1 Introduction
Ce travail s'inscrit/ dans Ie cadre de la carac-terisation des corrosions d' objets archeologiquesen alliage cuivreux. Le large domaine que repre-sente I'etude de ces alterations a pour butd'ameliorer les connaissances dans les domainesde la restauration et la conservation de ces objetsainsi que, de decouvrir d'eventuels criteresd'authentification.
L'infiuence du milieu d'enfouissement,d'importance reconnue par de nombreuxauteurs ayant etudie la corrosion des metauxarcheologiques [1-4], est un facteur souventdelicat a considerer. Les travaux de Tylecote[5] et plus recemment ceux de MacLeod [6]en soulignent l'interet mais egalement lacomplexite.
Aussi, afin de minimiser Ie role du milieu envi-ronnant, une etude comparative a ete realisee apartir d'un corpus d'objets en bronze. Ces objetsont en commun: leur condition d'enfouissement
Refu Ie 10 aout 1987
Studies in Conservation 33 (1988) 205-215
pendant environ 30 siecles, leur alliage de base etleur forme generale.
Cette demarche a permis de caracteriserl'aspect et la composition des surfaces a1terees,plus particulierement des couches passives, enrelation avec la geometrie et la composition ele-mentaire pro pre a chaque objet.
Au dela de la caracterisation des couches pas-sives, ilest important de tenter de comprendreles mecanismes qui conduisent a une corrosiondegrad ante de l'objet, ce qui est tres souvent Iecas.
Ainsi, la seconde partie de cet article presenteune etude detaillee de la' coupe longitudinaled'une tete d'epingle enroulee appartenant a cecorpus. Elle a permis de relier les differen ts faciesd'a1teration a la geometrie et a la microstructurede l'objet. Elle a permis egalement de proposerun mecanisme de formation pour des corrosionsstratifiees contenant un petit nombre de couches.
2 .Presentation du corpus et du sitearcheologique
Un choix de 29 objets en bronze provenant dusite archeologique du Fort-Harrouard (France)a ete effectue au Musee des Antiquites Natio-nales a Saint-Germain-en-Laye (France). Cesobjets ont ete selectionnes en fonction de l'etatapparent de leur surface (bronzes totalementcorrodes a peu corrodes), et de leur forme (prin-cipalement de forme longiligne). Datant de l'Agedu Bronze Moyen et Final, ce sont essen-tiellement des objets de petites tailles (inferieuresa 20cm): epingles, barres, poinc;ons, morceaux delame, ciseaux, tetes d'epingle, fragments dehache, pointes de lance et rasoirs.
Le site du Fort-Harrouard se situe a environIOOkma I'ouest de Paris, dans la commune deSorel-Moussel (Eure-et-Loir). IIa ete occupe duNeolithique Moyen au second Age du Fer, avecune interruption entre la fin de l'Age du Bronze
205
Final et Ie debut du second Age du Fer. Durantl'Age du Bronze, un important artisanat detransformation metallurgique est atteste par lapresence de creusets, de moules et de quelqueslingots [7].
Le sol est legerement alcalin. La profondeurd'enfouissement des objets ne depassait pas150cm. Mis au jour lors des fouilles de I'abbePhilippe entre les deux guerres, its ont ete con-serves depuis dans les reserves duM usee desAntiquites Nationales. Mis a part une exception,ils n'ont subi aucun traitement de restauration.Une croute terreuse adherente a la surfacerecouvrait encore par endroit un certain nombred'entre eux.
3 Methodes experiment ales
Dejamentionnee dans l'introduction, la me-thode experimentale a consiste a selectionner uncorpus coherent d'objets en fixant comme 'vari-able' les differents aspects de la corrosion desbronzes et comme 'constante' Ie milieu· et laduree d'enfouissement ainsi que la forme gener-ale· des objets. Dans un premier temps nousavons cherche a caracteriser les alterations desurface et les couches passives· afin de les relier,dans un deuxieme temps, a la microgeometriedes objets (de l'ordre du millimetre) et a la com-position· elementaire du metal saine Enfin, dansun troisieme temps, une tete d'epingle appar-tenant a ce corpus aete decoupee, enrobee puispolie afin de mieux comprendre les mecanismesqui conduisent a une alteration degradante.
Les techniquesutilisees pour -J'etude desaspects externes de la corrosion ont ete l'examenvisuel, la· loupe binoculaire, et la microscopieelectronique a balayage. Les microstructures dela tete d'epingle enroulee ont ete etudiees parmicroscopie optique et par microscopieelectro-nique a balayage (appareil type Jeol JSM 840couple avec un microanalyseur Xa detecteurSijLi).
L'identification des produits d'alteration a eterealisee par diffraction X et micro analyse X surMEB. Un spectrometre de masse d'ions secon-daires ou SIMS (Cameca IMS 3F, sourced' oxygene) a egalement ete utilise pour la coupelongitudinale de la tete d'epingle enroulee.
Les analyses de composition du metal sain ontete obtenues par spectrometrie d'emission dansl'ultraviolet avec source d'excitation a plasma
206
Luc Robbiola et ale
d'argon. Un rasoir trop corrode n'a pu etre ana-lyse. Les resultats. sont presentes au Tableau ·1.
L'analyse chimique elementaire des couchesprotectrices de 16 objets a ete realisee sur la sur-face des objets entiers .par micro analyse X surMEB. Au moins deux analyses par echantillonont ete effectuees. Elles portent sur des surfacesnon nettoyees, distantes de quelques centi-metres, exemptes de concretions, et d'unesuperficie de I'ordre du dixieme de mm2 (a desgrossissements compris entre 300 et 450). Laprofondeur d'interaction entre les electrons inci-dents et la surface analysee est de l'ordre dumicrometre. Les resultats sont donnes dans IeTableau 2.
4 Etude des alterations de surface
4.1 Influence de la geometrie de l'objetLes 29 objets ont une forme generale similaire.lIs sont globalement de type longiligne. lIspresentent cependant des differences (presenceou absence de decors, d'aretes, d'extremites afaible section, ... ) qui se traduisent sur les alter-ations de surface par:-une corrosion accrue au niveau des pointes
d'epingles ou d'aretes de decors (c'es( Ietraditionnel 'effet de pointe');
-des formes de corrosion particulieres pour desobjets dont Ie rapport largeurjepaisseur esttres grand (douille, bord de lame, ... ); lacorrosion est alors souvent lamellaire ou enfeuillets;
-une densitede points d'attaque localiseeplusgrande au niveau des parties du metal torduesou deformees.Ces observations revelent les effets electro-
chimiques mis en jeu dans ce type de milieu cor-rosif. Elles illustrent egalement l'importance desfilms passifs dont les ruptures seront favoriseespar la presence d'heterogeneites en surface occa-sionnees par un gradient de nature micro-structurale (deformation, microsegregations,defautsautres), ou par une microgeometriedefavorable a la formation ou a la stabilite decouches passives adherentes et continues.
4.2 Les couches passivesPour ces bronzes, la similitude des alterationsexternes sous forme de piqures oud'excroissances ovoides sont a rapprocher decelles du cuivre [9, 10]. Cependant, il existe
Studies in Conservation 33 (1988) 205-215
Etude de la corrosion de bronzes archeologiques du Fort-Harrouard
Tableau 1 Composition e!ementaire du metal sain, exprimee en pourcentage massique. Le cuivre est Ieconstituant principal de ces objets
No. Labo. Objet Cu Sn Pb Zn As Sb Fe Ag Ni
4326 Rasoir X 9·9 0·09 0·003 0·29 0·14 0·03 0·12 0·704331 Epingle X 11·3 0·11 0·090 0·32 0·13 0·06 0·10 0·854332 Epingle X 10·1 0·10 0·006 0·23 0·11 0·23 0·09 0·684334 Epingle X 9·0 5·80 0·002 0·24 0·24 0·03 0·22 0·194339 Epingle a beliere X 12·1 0·01 0-006 0·09 0·01 0·06 0·06 0·434342 Tete d' epingle X 9·7 0·03 0·009 0·34 0·10 0·07 0·07 0·884355 Ciseau X 19·3 1·90 0·104 0·76 0·52 0·50 0·24 0·564364 Ciseau X 11·3 0·10 0·012 0·23 0·11 0·27 0·09 0·764373 Fragment d' epee X 12·4 0·02 0·002 0·15 0·02 0·06 0·04 0·384382 Tete d'epingle X 11·2 0·19 70·040 0·23 0·02 0·12 0·12 0·564413 Epingle X 10·5 0·07 0·020 0·33 0·08 0·17 0·01 0·664421 Epingle X 13·8 0·03 0·005 0·48 0·16 0·11 0·03 0·604423 Pointe de lance X 12;9 0·21 0·017 0·20 0·08 0·11 0·07 0·224424 Epingle X 7·3 0·04 0·001 0·22 0·06 0·91 0·02 0·554425 Lame de poignard X 7·7 0·06 0·009 0·13 0·06 0·13 0·03 0·234426 Hache a talon X 22·3 1·30 <0·001 0·43 0·14 0·17 0·03 0·234427 Marteau X 12·8 0·24 0·007 0·34 0·02 0·09 0·04 0·564431 Epingle X 13·1 0·28 0·067 0·31 0·14 0·03 0·02 1·004434 Poin~on X 8·1 15·70 0·001 0·12 0·19 0·01 0·08 0·139604 Barre X 4·8 0·09 0·043 0·13 0·07 0·01 0·02 0·349608 Anneau X 6·2 1·67 0·016 <0·01 0·72 0·03 0·10 0·049613 Epingle a tete
conique X 9·4 0·15 0·001 0·12 0·01 0·04 0·01 0·059616 Barre X 18·2 0·18 0·008 0·19 0·11 0·16 0·06 0·339620 Epinglea tete
enroulee X 12·9 <0·01 0·017 0·20 0·04 0·51 0·01 0·6212034a Epingle X 12·8 0·04 0·002 0·22 0·06 0·12 0·03 0·4412034b Poin~on X 7·8 0·18 0·047 0·05 0·18 0·52 0·10 0·0712034c Alene X 6·5 0·08 0·012 0·25 0·07 0·36 0·49 0·4912036 Epingle X 12·3 0·08 0·002 0·22 0·10 0·05 0·03 0·54
Tableau 2 Composition elementaire des surfaces passives apparentes, exprimee enpourcentage massique. Chaqueanalyse porte sur une surface de l'ordre du 1/10 de mm2.
No. Labo. Si P S Cl Fe Ni Cu As Sn Pb
4331 4·5 4·2 0·4 1·9 1·5 1·7 26 1·1 584331 5·4 4·5 0·5 2·3 1·9 1·5 22 1·4 614331 4·0 5·2 0·7 1·3 2·0 1·5 31 1·0 534331 5·5 3·2 0·5 1·8 1·6 1·3 50 0·7 364331 11·2 6·8 0·7 1·9 3·7 1·1 25 0·9 494331 5·2 5·9 0·4 1·3 2·4 1·4 23 1·2 594332 9·7 4·9 1·9 1·6 1·5 20 1·2 594332 16·9 7·4 4·1 3·6 0·9 18 0·5 494332 7·4 3·2 2·4 1·3 0·1 26 1·0 594332 6·4 4·6 2·1 1·9 0·7 21 1·0 624339 6·7 3·6 1·5 0·2 31 50 1·84339 4·9 2·9 3·0 0·5 36 52 0·24339 14·4 1·5 1·8 18 33 25·04355 2·9 1·9 2·2 1·9 1·2 1~5 42 3·2 434355 3·8 0·8 1·2 1·5 1·6 1·5 47 2·2 40
Studies in Conservation 33 (1988) 205-215 207
Luc Robbiola et al.
Tableau 2
No. Labo. Si P S Cl Fe Ni Cu As Sn Pb
4364 6·9 6·7 0·7 1·7 1·6 0·9 22 1·0 584364 6·2 6·3 0·8 1·6 1·2 1·1 21 0·7 614364 5·0 7·6 0·5 1·2 1·8 0·7 23 0·6 604373 4·6 3·2 0·8 1·2 0·8 0·5 23 0·3 664373 7·2 2·3 0·5 0·3 1·1 0·6 32 0·4 554373 5·6 3·4 0·6 0·7 0·6 0·4 29 0·3 594373 8·0 1·9 0·5 1·2 1·4 0·7 32 0·9 544424 10·3 6·5 1·1 6·1 3·6 0·7 39 0·8 324424 10·1 6·2 2·5 3·1 0·9 37 1·5 394431 3·0 2·7 0·6 1·6 1·0 1·6 26 1·6 624431 2·3 3·3 0·5 1·2 0·9 1·6 40 0·9 494426 1·4 0·5 0·4 0·8 0·3 0·4 58 0·3 374426 1·9 0·1 0·7 1·1 0·5 0·4 34 1·4 604426 1·0 0·4 0·4 t7l 0·4 0·7 64 0·5 314426 1·0 0·3 0·4 0·5 0·2 0·3 58 1·0 394426 1·8 0·5 0·2 0·6 0·9 0·4 49 1·1 454426 1·1 0·2 0·3 0·9 0·2 0·5 57 1·1 394434 7·5 5·4 4·2 1·0 20 56 6·44434 - 6·7 5·6 5·1 1·0 19 50 12·24434 10·2 5·4 0·6 3·4 1·6 0·1 21 54 3·54434 6·7 6·1 0·3 3·2 1·1 0·2 25 1·1 569604 5·6 14·5 0·6 5·5 0·8 0·7 38 0·7 349604 4·2 14·9 0·2 5: 1 0·8 0·9 38 0·6 359608 2·9 1·4 1·3 1·1 0·2 0·2 46 1·6 459608 3·0 1·1 1·2 1·2 0·2 0·3 48 1·4 449608 2·9 1·4 49 479608 3·3 1·3 46 509608 3·5 1·2 51 459608 3·7 1·7 43 529613 9·5 4·7 0·8 4·7 1·6 22 0·9 569613 7·8 5·2 0·8 4·4 1·2 21 0·6 599613 6·3 4·4 1·1 4·4 1·3 0·1 23 1·3 589613 9·2 7·6 1·1 2·6 1·1 0·2 28 0·4 509616 1·4 0·4 0·5 1·2 0·7 53 -0·5 439616 1·6 0·8 0·1 0·8 1·2 0·8 51 0·6 439616 2·0 1·7 0·3 1·9 1·4 0·6 45 0·3 479616 2·4 1·0 0·3 1·2 1·2 0·6 46 0·6 479616 2·2 0·7 0·1 0·6 2·5 0·6 47 0·5 46
12034 9·4 7·4 0·6 3·4 3·3 1·2 32 1·2 4112034 10·2 6·7 1·5 3·2 2·3 1·2 32 1·4 4212034 10·8 6·4 0·7 3·1 3·0 1·3 35 1·7 3912034 4·7 9·0 0·7 3·2 2·4 1·5 31 0·9 4612034 10·4 6·7 1·7 4·1 6·2 1·1 31 0·4 3812036 4·5 2·7 1·4 0·6 1·7 22 1·2 6512036 10·6 3·2 0·3 1·1 0·8 1·0 23 1·0 59
differents types de films passifs, caracterises par tiellement d'oxydes et d'hydroxydes d'etain.des couleurs et eclats differents et par leur Les objets presentant ce type de couches pro-composition elementaire. tectrices sont peu ou tres peu corrodes;
On en definit trois principalement: -les surfaces gris clair a eclat submetallique: ce-les couches bleutees:' analysees par diffraction type de surfaces contient tres peu de P, Si et Cl.
X, ces films apparaissent composes essen- Les alterations externes sont surtout sous
208 Studies in Conservation 33 (1988) 205-215
Etude de la corrosion de bronzes archeologiques du Fort-Harrouard
forme de pIages d'hydroxycarbonates de cui-vre Ol} de crontes. Ces surfaces apparaissent'etamees' mais sont en fait Ie resu1tat d'unecorrosion selective des phases rJ. riches encuivre et sont equivalentes a celles decrites parOddy et Meeks dans [11];
-les couches a dominante vert sombre (vert-gris, vert-bleu). Ce sont les plus nombreuses.La corrosion est souvent importante et de type
. localisee. Elle est formee de produitsd'a1teration mineralises a faible teneur encuivre par rapport au metal saineL'importance des teneurs en etain observees a
la surface des films passifs de tous les objetsanalyses est a remarquer. En effet, Ie rapport desteneurs massiques Sn/Cu pour chacune de cessurfaces varie entre 0,6 et 3,0. Ce phenomene esta rattacher a une dissolution importante du cui-vre et a une migration des ions du cuivre liees auprocessus de corrosion. Par ailleurs, les teneursen Si, P et Cl sont vraisemblablement reliees al'influence du sol sur la corrosion.
5 In8uence de la composition du metal sur lescouches passives
5.1 Influence sur l'aspect des couches passivesLes resultats des analyses elementaires du metalsain (Tableau 1) montrent une relative homoge-neite de la composition de ces bronzes.
Ce sont des bronzes dont les teneurs en etainvarient de 4 a 14% (seuls trois objets opt plus de14% d'etain). Les teneurs en plomb sont inferi-eures a 0,3% sauf pour cinq objets quipresentent des valeurs superieures a 10/0.L'arsenic, l'antimoine et Ie fer sont sous formed'impuretes ne depassant pas 1% en masse. Lesautres elements sont presents sous formes detraces.
11n'apparait pas de lien direct entre la com-position de ces bronzes et l'aspect externe deleurs couches passives, en effet:-pour des objets dont les aspects de surface
sont similaires, les compositions elementairesde leur metal sain sont parfois differentes.
+
2.5
2
1.5
Rs an foncUon dulSn dBns 1·Bl11Bg8
:' •••••••••• ':' ••• , ••••• , : •• 0 •• +.. +' ':'~+' : ' , . ':' .. , ::+ + +.· . . +. . , .
:. • • • • • ~ • • • ..:. • • • • . • • • • • ~. • • =1=. • • • ~. .: •• ~ 0 • • • , • • • : • • • • • • • • • • .:. • • • • • • • • • • ~
+:r + +:
:.""'.,., •• : •• '0" 0"" ~ ••••••• , +0 .:.-+. .. ,."' .. : , :" , ." .. :4-
+ :* ~· . . :+- . . .:' •••••••••• ': 0 ••• , • '-to •.• :' , •••..•••• '': ••••.•.... ~ •••••••... ':' ...••....• ':
.~. . + . . .: •••••••••••• : ••• 0 •• ~~ 0t .: 0 • 0 .: ••••••• 0 ••• ; ••••• ¢ or, .: •.•..• , •••.• :· . * =F' . . . + .· , + . . . * + . .
. + :0.5 :..•. 0' •••••• .: ••• , ••• , ••• :••••••• ,., • .: •••••••• " •• ~ ••••••••••• :. ••••• ;- ••••• :
· .
1:1 0 0 1.1 1:1 1:1 1:1 0 " (I Q 0° 0 0 0 0 0 ,) 1:1 0 1:1 0 1:1 °0 1:1 ~ (I 1.1 ':I 1:1 0 0 0 1:1 1:11:1 0 0 1:1 ') ., 0 0 1:1 (\ 0 0 : 0 0 1:1 0 0 U 0) 0 0 0 .'.. 0 0 0 0 (I 0 0 0 1:1 0 0°
B 12
I IIlsB1qua da So dIns 1·a111Bg8
16 20 24
Figure 1 Diagramme Rs enfonction du pourcentage d'etain dans l'alliage. Rs est Ie rapport des teneurs en etainet en cuivre de la surface passive apparente de chacun des objets du Tableau 2.
Studies in Conservation 33 (1988) 205-215 209
Elles peuvent varierd'un facteur 2a 10suivant ,l'element considere;
-pour des objets dont la composition du metalsain est a peu pres identique, la corrosion peutpresenter des aspects de surface ditferents.
5.2 Influence sur la composition (Jescouchespro-tectrices de surfaceSeuls 16 objets, presentant une couche passiveapparente analysable selon les conditions opera-toires decrites en (3), font l'objet de ce para-graphe. Les resultats obtenus pour chaque objetsont relativement homogenes.
On appellera Rs Ie rapport des pourcentagesmassiques des teneurs Sn/Cu des surfaces pro-tectrices apparentes. . .
Pour chaque echantillon, la composition dupremier micrometre de la surface, (Tableau 2)comparee a la composition de I'alliage de base(Tableau 1) montre que:-les variations importantes des teneurs en fer
semblent davantage reliees a I'influence dusolqu'a la composition du metal;
-les concentrations en'Sn, As et'Ni sont pluselevees a la surface que dans Ie metal sain, al'inverse du cuivre;
-les valeurs du rapport Rs sont en relation avecles teneurs en etain dans Ie metal sain.Concernant Ie dernier point, Ie diagramme de
la Figure 1 revele trois domaines distinctssignificatifs d~vant la dispersion des mesures.
Pour les bronzes dont la teneur en etain dansIe metal sain est inferieure a 80/0,Ie rapport Rsest compris entre 0,6 et 1,5. 11 varie entre 1,6 et3,0 pour des teneurs en Sn de 8 a 14%. Enfin, i1est compris entre 0,6 et 1,2 pour des teneurs enetain superieures a 18% (sauf en un point pourun objet assez fortement altere).
11 apparait donc une relation entre la com-position de la surface apparente et la com-position du metal. Ceci est d'autant plusmarquant que certains resultats ont ete obtenussur des bronzes de teneur comparable en etaindont l'aspect de la couche protectriceestditferente.IIse pourrait donc que dans un contexte peu
perturb6 depuis deux mille ans et pour une dureed'enfouissement variant entre 2700 ans et 3300ans, ces surfaces aient atteint un etat d'equilibre.Les resultats obtenus sembleraient signifierqu' en plus des mecanismes de formation descouches protectrices de surface, i1interviendrait
210
Luc Robbiola et al.
un phenomene physique supplementaire quiseraitrelie a I'influence de la teneuren etain del'alliage de base.
Ce phenomene serait a rapprocher des micro-structures et phases presentes dans Ie metal. Eneffet, d'apres Hanson et Pell-Walpole [12], Iedomaine de la phase ex (riche en cuivre) est limiteapproximativement a 70/0d'etain pour les alli-ages coules en sable et' a 16% d'etain pour lesalliages recuits. Ces valeurs delimitent troisdomaines sensiblement les memes que ceux de laFigure I.
Dans l'intervalle compris entre 70/0'et 16%d'etain, la fraction volumique de seconde phasedepend des vitesses de refroidissement pour unetat brut de coulee, et des conditions de recuit Iecas echeant. Cette variabilite pourrait s'accorderavec la forte dispersion du rapport Rs desbronzes du dellxieme domaine de la Figure 1;ellepeut etre renforcee par des heterogeneites derepartition dans l'objet.
Ces, resultats, acquis a partir d'un nombrelimite d'analyses, devraient etre valides par uneextension du corpus et parune interpretationphysique des phenomenes observes.
6 Structure interne de la corrosion
6.1 Exemple de rupture de la couche passiveParmi les objets du corpus, nous avons choisiune epingle a tete enroulee pour I'etude de lamicrostructure de I'alteration. Elle date duBronze Moyen (1500-1250 avant JC). Sa com-position elementaire figure auTableau 1. Elle estdesignee par Ie numero 9620.
La microstructure du metal sain montre quel'objet se trouve dans un etat recristalliseparrecuit apres mise en forme par martelage.
L'etat de la surface de l'objet presente dansson ensemble une corrosion generalisee sousforme de croutes a excroissances ovoides et depoints de chloruration. La forme particuliere dela tete a suggere l'existence d'une correlationentre Ie travail de mise en forme de l'objet etl'alteration qu'il a ·subie.
La coupe longitudinale de la tete enroulee(Figure 2) revele plusieurs zones 'de corrosionstratifiee, les produits de corrosion etant sousforme de couches, ainsique la localisation d'uneforme rayonnante d'alteration a la zone de con-tact entre deux parties de l'enroulement.
Nous avons donc pu identifier deux types
Studies in Conservation 33 (1988) 205-215
Etude de la corrosion de bronzes archeologiques du Fort-Harrouard
Cu = 67,5%, Sn = 30,4%, Fe = 1,3%. Nousconstatons une augmentation de la teneur enetain d'un facteur voisin de 2,5 par rapport acelIe du metal sain adjacent. Par ailleurs,l'hypothese d'une precipitation de composes ducuivre aux joints de grains du metal d'origine estenvisageable. Le cuivre precipiterait alors sousforme de cuprite, laissant des oxydes ethydroxydes d'etain comme composants prin-cipaux des grains fantomes.
Des inclusions de sulfures de cuivre, de formeallongee, temoins du travail de martelage subipar la tige metalIiq ue de depart, observes dans Iereste du metal sain et presents dans cette plage,ne semblent pas avoir ete perturbes par Ie pro-cessus de corrosion.
Nous remarquons que les rayons de corrosionformant une extension de cette alteration de cou-leur jaune-orange ont une teneur en etain dimi-nuant progressivement (de 28% a 13%) al'approche de leur terminaison dans Ie metal.D'ailleurs, ce gradient de concentration est reve-
Figure 2 9620. Coupe longitudinale de la tete enroulee(x 9).
de facies d'alteration: par stratification et parattaque inter- et transgranulaire rayonnante.
6.2 Corrosion inter- et transgranulairerayonnanteCe facies (Figure 3) est lie a la mise en forme eta la geometrie de l'objet. En effet, les degres deliberte mecanique et chimique de l'alterationsont ici reduits par rapport au phenomene destratification:-d'une part, Ie developpement volumique des
produits de corrosion ne pouvant se faire a laperipherie du metal, il s'effectue au detrimentde celui-ci:
-d'autre part, l'apport de composants chimi-ques corrosifs etant plus limite au centre de latete enroulee qu'a sa peripherie, les produitsd'alterations rencontres sont de nature moinsvariee que ceux observes dans la stratification.Nous distinguons une couche de cuprite bien
cristallisee contenant des inclusions de silice adivers stages de cristallisation; puis une structureetendue materialisee par des produits de corro-sion jaunes, meles a de la cuprite sous forme deveines. La composition de cette plage, obtenuepar micro analyse X elementaire, est la suivante:
Studies in Conservation 33 (1988) 205-215
Figure 3 9620. Alteration inter- et transgranulairerayonnante (x 46) .
211
________________ ~ ~~ ' J
Ie par la couleur orange tirant de plus en plus surIe rouge.
Cette geometrie rayonnante dans l'enroule-ment· de la tete est a relier soit au gradient dedeformation impose au formage, ce qui entrainedes heterogeneitesde microstructure lors desrecuits, soit a un champ de contraintes induit parla formation de produits de corrosion.
Figure 4 9620. Stratification des produits de corro-sion.
6.3 Alteration par stratificationTrois zones de corrosion stratifiee ont eteetudiees dans Ie detail. Leur forme est sensi-blement ovoide avec des dimensions allant de 1a3mm pour Ie grand axe et de 1 a 2mm pour Iepetit axe.
Les produits de corrosion sont ici sous formede couches (Figure 4) presentant une certaineconstance dans leur composition et dans leurordre de stratification pour les trois zones analy-sees:-nous retrouvons systematiquement une
couche de couleur orange a marron, a forteteneur en etain (250/0en moyenne) en contactavec Ie metal sain, composee d'oxydes,d'hydroxydes et carbonates de cuivre etd'oxydes et hydroxydes d'etain, comme Ie sug-gerent les resultats d'analyse par SIMS.L'epaisseur de cette strate est comprise entre50pm et 110Jlm;
-puis suit une epaisse couche de cuprited'environ 250Jlm de largeur, contenant unestructure secondaire [13] en bandes fines dememe composition que la premiere strate;
212
Luc Robbiola et al.
-les couches suivantes sont constituees de chlo-rures de cuivre de type atacamite/parata-camite, de produits d'alteration de l'etain defaible epaisseur, de cuprite et de malachite dis-perses sans ordre particulier;
-les dernieres couches de la stratification sontdes carbonates de cuivre et de la cupriterecouverts de silice.Sur les trois zones etudiees il y en a deux com-
portant une frange d'aspect gris cireux consti-tuee de chlorures de cuivre. Ces derniers sontlocalises a la limite de la premiere couche richeen etain et de la cuprite. 11 s'agit de nantokite(CuCl), cause de 'la maladie du bronze' [14].
6.4 Hypothese de mecanisme d'a!terationstratifieeL'etude de la microstructure des strates de corro-sion revele la presence d'inclusions de sulfures decuivre et de grains fantomes au sein de couchesparfois eloignees de l'interface metal/corrosion.La forme globale de la tete enroulee permetd'affirmer que ceselements issus de la structuremetallique se retrouvent en dehors/ de lasurface originelle de l'objet.
Cette observation nous empeche d'assimiler cetype de stratification a un empilement successifdes produits· d'alteration, comme peut Ie faireScott [13] lorsqu'il compare Ie processus de cor-rosion par couches au phenomene des anneauxde Liesegang. 11 a pu observer jusqu'a 20 bandesde cuprite et de malachite alternees sur des objetsiraniens.
Le phenomene de Liesegang repose sur la for-mation periodique de precipites par diffusion etconsommation de deux reactifs tels que l'acetatede CUllen suspension dans un gel et Ie carbonatede sodium. Ces deux reactifs donnent naissancea un produit colloidal qui precipite pour uneconcentration de saturation, d' on la formationde bandes de malachite dans Ie gel. Scott a appli-que les lois mathematiques prevoyant la largeurdes bandes et leur espacement [15, 16] et itobtient une bonne concordance des resultats.
Dans notre cas, ces lois ne s'appliquent pas,cette periodicite n'apparaissant pas.
En revanche nous avons remarque:-la presence d'inclusions non-metalliques et de
grains fantomes, comme l'ont observee Oddyet Meeks [11],dans certaines strates au dela de
Studies in Conservation 33 (1988) 205-215
Etude de la corrosion de bronzes archeologiques du Fort-Harrouard
Figure 5 Carte de repartition de l'etain dans une zoned'alteration stratifiee de l'objet 9620 (voir partie gau-che de la Figure 4).
la surface originelle de l'objet;-une correspondance entre les contours des
fines bandes a forte teneur en etain, bien vis-ibles sur I'image X de cet element (Figure 5),ce qui laisse supposer la fragmentation d'unmeme ensemble initial;
-des fissures paralleles a I'interface metal/corrosion dans la couche en contact avec Iemetal sain, pour des stratifications peu devel-oppees (deux couches).Ces observations nous conduisent a proposer
Ie mecanisme illustre par la Figure 6.Les fissures se formant dans la couche de pre-
cipitation rapide d' oxydes et hydroxydes d' etainpourraient servir de voie d'acces aux elementscorrosifs contenus dans Ie sol d'enfouissementainsi qu'aux gaz necessaires a la formation decertains produits de corrosion. Puis, elles serai-ent comblees par de nouveaux produitsd'alteration du cuivre dont la formation et lacroissance creeraient une perturbation et unemigration de fines couches riches en oxydes et
hydroxydes d'etain vers les niveaux superieursde stratification. '
Le cuivre contenu dans ces bandes a pu par-ticiper a I'elaboration de cuprite, carbonates etchlorures que l'on observe loin de l'interfacemetal/corrosion, ce qui expliquerait les tres for-tes concentrations d'etainGusqu'a 54%) local-isees au centre des stratifications etudiees.
7 Conclusion
On a montre qu'il n'existait pas de relationentre l'aspect externe des alterations et la com-position elementaire des bronzes de cecorpus.Cependant, i1 est apparu une relation entre lacomposition elementaire des couches passivesapparentes et la composition du metal sain pourles elements cuivre et etain. Le rapport des ten-eurs etain sur cuivre en surface est lie a la teneuren etain dans Ie metal, independamment del'aspect externe des surfaces passives. Au stadeactuel de cette recherche, i1n'a pas ete possiblede preciser la nature exacte du phenomeneobserve. Mais i1 serait possible qu'aux meca-nismes de formation des couches passivess'ajoute un phenomene physique en relation avecla proportion des phases presentes dans Ie metalsain.
L'etude de la microstructure interne de lacorrosion sur une coupe metallographique apermis de distinguer deux facies d'alteration,en relation avec la geometrie de I'objet. Surune surface libre la stratification des produits decorrosion est favorisee, alors que dans la zone decontact entre deux parties metalliques apparaitune corrosion inter- et transgranulaire rayon-nante. Nous avons egalement observe quelorsqu'il y a rupture. de la couche passive parfissuration tangentielle i1existe un phenomene destratification des produits de corrosion du cuivrerepoussant de fines bandes riches en oxydes ethydroxydes d'etain, loin de l'interface metal/corrosion.
m~talmetal
nouveaux produits d'alteration ~
--.~fissures
Figure 6 Schema explicatij du mecanisme de stratification propose.
Studies in Conservation 33 (1988) 205-215 213
Deux hypotheses sont possibles pour expli-quer cette forme rayonnante: 1'une repose sur lacreation d'un gradient de microstructure lors duformage de l'objet; 1'autre tient compte des per-turbations mecaniques engendrees par la for-mation des produits de corrosion.
Cette demarche d'etude appliquee a d'autresbronzes archeologiques non restaures, de mememilieu d'enfouissement et de forme globalecomparable, devrait permettre une meilleurecaracterisation de la nature et de la structuredes alterations recontrees sur· de tels objets.Notamment la comprehension des mecanismesde passivation pourrait etre utilement appliqueea la conservation des objets archeologiques.
Remerciements
Nous tenons a remercier Monsieur Mohen, Conser-vateur en Chef du Musee des Antiquites Nationales,sans qui ce travail n'aurait pu voir Ie jour.
References
GETTENS,R. J., 'Tin oxide patina of ancient high-tin bronze', Bulletin of the Fogg Museum of Art11 (1949) 16-26.
2 JEDRZEJEWSKA,H., 'The conservation of ancientbronzes', Studies in Conservation 9 (1964)23-31.
3 STAMBOLOV,T., 'The corrosion and conservationof metallic antiquities and works of art', Cen-tral .Research Laboratory for Objects of Artand Science, Amsterdam (1968).
4 ORGAN,R. M., 'The current status of the treat-ment of corroded metal artifacts' a Corrosionand Metal Artifacts, ed. B. F. BROWNet al.,NBS Special Publication 479 (1977) 107-142.
5 TYLECOTE,R. F., 'The effect of soil conditions onthe long term corrosion of buried tin-bronzesand copper', J. of Archeological Science 6(1979) 345-368.
6 MACLEOD,I. D., 'Corrosion of bronzes on ship-wrecks', Corrosion NACE 41 (1985) 100-104.
7 MOHEN,J. P., BUCSEK,N., MENU,M., HURTEL,L. P. et MALFOY,J. M., 'Metallurgie de l'Agedu Bronze au Fort-Harrouard', a JourneesS.P.F. (Mai 1986), a paraitre dans Bul. Soc.Pre. Fran.
8 SHREIR,L. L., Corrosion, 2eme ed., Butterworths,London (1976) Chap. 1.1.
9 LUCEY,V. F., 'Developments leading to thepresent understanding of the mechanism ofpitting corrosion of copper', ,Br. Corros. J. 7(1972) 37.
214
Luc Robbiola et al.
10 POURBAIX,M., Le90ns en corrosion electro-chimique, Ed. Cebelcor, Bruxelles (1975)328-332.
11 ODDY, W. A., et MEEKS,N. D., 'Unusualphenomena in the corrosion of ancientbronzes' a Science and Technology in theService of Conservation, IIC, London (1982)119-124.
12 HANSON,D., et PELL-WALPOLE,T., Chill Cast TinBronze, Edward Arnold and Co., London(1951) 60-61. -
13 SCOTT,D., 'Periodic corrosion phenomena inbronze antiquities', Studies in Conservation 30(1985) 49-56.
14 ORGAN,R. M., 'The examination and treatmentof bronze antiquities' a Recent Advances inConservation, Butterworths, London (1963)104-110.
15 KELLER,J. B., et RUBINOW,S. I., 'Recurrentprecipitation and Liesegang rings', Journal ofChemical Physics 30 (1981) 5000-5007.
16 MULLER,S. C., KAL, S., et Ross, J., 'Periodicprecipitation patterns in the presence of con-centration gradients, 1 Dependence on ionproduct and concentration difference', Journalof Physical Chemistry 986 (1982) 4078.,-4087.
Luc ROBBIOLA,ne en 1961. Maitrisede Chimie Phy-sique a I'UniversitePierre et Marie Curie (Paris) en1984,puis Maitrise de Sciences et Techniques de 'Con-servation des Oeuvres d'Art' en 1985 a I'UniversitePantheon-Sorbonne (Paris). II poursuit actuellementun doctoraten Sciences a I'Universite Pierre et MarieCurie sur la corrosion de bronzes archeologiques.Adresse de ·l'auteur: URA 34 du CNRS, Paleo-metallurgie et Conservation, Laboratoire de Recherchedes Musees deFrance, 34 quai du Louvre, 75041 ParisCedex 01, France.
INOCENCIAQUEIXALOS,nee en 1960. Maitrise de Sci-ences et Techniques 'Conservation des Oeuvres d'Art'en 1986 a l'Universite Pantheon,-Sorbonne (Paris) etMaitrise de Chimie Physique a I'Universite deParis'-0rsay en· 1986. Elle poursuit actuellement untroisieme cycle universitaire en metallurgie al'Universite Pierre et Marie Curie (Paris VI). Adressede l'auteur: voir Robbiola.
Laic PmRREHURTEL,ne en 1948. Ingenieur ESCP(1972). Charge des etudes et recherches sur Iemetal auLRMF-Ministere de la Culture et de la Commu-nication. Adressede l'auteur: voir Robbiola.
MICHEL PERNOT,ne en 1949. Irtgenieur ENSCP(1971). Docteur essciences (Paris XI, 1977), charge derecherche au CNRS. Adresse de ['auteur: voir Rob-biola.
Studies in Conservation 33 (1988) 205~215
Etude de la corrosion de bronzes archeologiques du Fort-Harrouard
CLAUDEVOLFOVSKY,ne en 1941. Maitre de conferenceUniversites Paris VI et I, Docteur es sciences (ParisVI, 1974), Directeur de I'URA 34 du CNRS. Adressede l'auteur: voir Robbiola.
Abstract-The deterioration of Bronze Age objectsfrom the ,archaeological site at Fort-Harrouard(France) has been studied, firstly, in relation to theirexternal appearance and the elemental composition ofthe sound metal. A relationship between the com-position of the corroded surface and the underlyingsound metal was deduced. In addition, examination ofmetallographic sections of one of the bronzes allowedthe differentiation of corrosion processes which arerelated to the shape of the object: the stratification ofthe corrosion products and the intergranular andtransgranular corrosion processes. Th~ existence of apseudomorphic microstructure suggests that themechanism of deterioration may be stratigraphic,which may be explained by the growth of the corro-sion products in fissures which do not involve periodicprecipitation.
Zusammenfassung-Die Korrosion bronzezeitlicherMetallobjekte aus der Grabung von Fort-Harrouard(Frankreich) wurde untersucht. Als mogliche EinfluB-groBen wurden neben dem auBeren Erscheinungsbildder Objekte die Zusammensetzung des Metalls quan-titativ erfaBt. Die Untersuchungen belegen einenZusammenhang zwischen der Zusammensetzung derkorrodierten Oberflache und der des Metalls seIber.Weiterhin gestattete eine metallographische Unter-suchung an Anschliffen einer der Bronzen eineUnterscheidung von Korrosionsprozessen, dieoffensichtlich etwas mit der Form des Objektes zu tunhaben. Dies betrifft einmal die Schichtung derKorrosionsprodukte als auch die intergranularen wieauch transgranularen Korrosionsvorgange. DieBeobachtung einer pseudomorphen MikrostrukturlaBt erwarten, daB der Korrosionsmechanismusmoglichenfalls schichtenorientiert verlauft. Dieskonnte mit einem Wachsen von Korrosionsproduk-ten in orientierten Rissen, in denen kein regelmaBigwiederkehrendes, sattigungsbedingtes Auskristal-lisieren auftritt, erklart werden.
Bereits viele Restauratoren sehen in diesemTisch die optimale Losung zur Niederdruckkon-trolle, die das sichere Doublieren und Konsoli-dieren von Bildern, Zeichnungen und Textilienerlaubt. Lieferbar in drei Standardgrossen; wobeiauch den Tisch uberragende Objekte behandeltwerden konnen. Solide Konstruktion in Alumi-nium, mobil, mit kraftigem Motor fUr Dauerbela-stung.Verlangen Sie detaillierte Information bei:
Many conservators consider this table to be theultimate solution for achieving the low pressurecontrol required for the safe lining and consolida-tion of paintings, drawings and textiles. Availablein three standard sizes, it has been specialdesigned to accomodate objects much largerthan the t.able)area. Solidly constructed in alumin-ium and complete with powerful motor for conti-nuous operation.Ask for more detailed information from:
Alois K. Diethelm AG, Farbenfabrik, CH-8306 BrOttisellen, SwitzerlandPhone: (CH)-1-833 07 86, Telex: 58755 lase eh
Studies in Conservation 33 (1988) 205-215 215