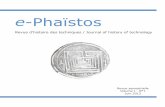L'orientation dans l'enseignement secondaire : une enquête sur les choix d'orientation en Belgique...
Transcript of L'orientation dans l'enseignement secondaire : une enquête sur les choix d'orientation en Belgique...
L’ORIENTATION DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE :UNE ENQUÊTE SUR LES CHOIX D’ORIENTATION
EN BELGIQUE FRANCOPHONE ET EN SUÈDE EN 2015
Une réflexion sur l’orientation comme mécanisme de ségrégation
BRUSSELS SCHOOL
Journalism & Communication
HAUTE ÉCOLE GALILÉEINSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DES COMMUNICATIONS SOCIALES
TRAVAIL PRÉSENTÉ DANS LE CADRE DU MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES
POUR L’OBTENTION DU TITRE DE MASTER EN COMMUNICATION APPLIQUÉE
SPÉCIALISÉE – ANIMATION SOCIOCULTURELLE ET ÉDUCATION PERMANENTE
PAR VICTORIA FORGETPROMOTEUR : JORGE MAGASICH
BRUXELLES – JUILLET 2015
Remerciements Une épreuve individuelle traversée collectivement telle est, sans nul doute, le souvenir que je
conserverai de la préparation et de l’écriture de ce mémoire. Je tiens à remercier
particulièrement mon promoteur, Jorge Magasich, pour sa disponibilité, son perfectionnisme
et ses commentaires qui m’ont épaulée tout au long de ces deux dernières années.
Mes remerciements sincères aux cinq écoles qui ont participé à la réalisation de mon enquête
en Suède et en Belgique francophone. Mention particulière aux élèves pour le temps, la
patience et la confiance qu’ils m’ont accordée. De même, je souhaite témoigner ma gratitude
à ma maitre de stage à Stockholm, Agneta Mogren, qui me permit d’appréhender mon sujet et
de m’imprégner de la culture suédoise. Merci également à Åsa Hallemar et Anna Gustafsson
qui acceptèrent de partager leurs impressions sur le modèle suédois et qui apportèrent un
éclairage précieux à mon travail.
Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à Minh Canny pour ses nombreuses
relectures, son aide pour l’élaboration du sondage et la compréhension des statistiques. Merci
d’avoir cru en moi. Je n’oublie pas ma mère, que je remercie sincèrement pour sa patience et
son soutien durant mon hibernation académique.
Enfin, je tiens à témoigner ma gratitude à l’ensemble du corps professoral de l’Institut des
Hautes Études des Communications Sociales et plus particulièrement à l’équipe de maillage
de la section Ascep. Merci aussi à Elisa, Robin et Thomas de m’avoir permis de découvrir
l’enseignement qualifiant à travers l’œil d’une caméra lors de la réalisation de notre mémoire
médiatique. Merci à Isabelle Canny, Hervé Lenoir, Jérémy Leone, Nikki Demol, Claude Loits
et toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à la réalisation de mon mémoire de
fin d’étude.
1
Introduction « Dans l’imaginaire collectif, dans les politiques publiques ou dans les travaux sociologiques,
la contribution des jeunes dans l’enseignement professionnel à leur trajectoire d’orientation
est désormais décrite comme limitée » (André, 2012, p.1). Dès lors, s’interroger sur
l’orientation des élèves revient non seulement à questionner la place qu’ils seront amenés à
occuper au sein de la société mais aussi à sonder les valeurs démocratiques qui caractérisent
l’institution scolaire. Assurant une double fonction, le système éducatif est reconnu « à la fois,
comme une instance importante de fixation des rapports de classe, de domination et comme
un moyen de retournement, de renversement de ses rapports » (Dandurand cité par Demeuse
et Baye, 2005, p.159). Ainsi, nous sommes en droit de nous demander comment est-il
possible, dans nos sociétés démocratiques, que l’institution scolaire désignée comme
instrument de transformation sociale favorise l’orientation des jeunes des classes populaires
vers le bas de la hiérarchie scolaire ? Notre sujet d’étude ayant fait l’objet de nombreux
ouvrages, nous retrouvons un questionnement similaire dans la littérature belge, française,
anglaise et suédoise. Il semblerait que les questions liées aux classes sociales et au rapport
qu’elles entretiennent à l’école dépassent les conditions nationales. C’est justement dans cette
perspective que nous avons souhaité orienter notre recherche. A travers une enquête sur les
choix d’orientation en Belgique francophone et en Suède, nous proposerons une réflexion
globale sur l’orientation en tant que mécanisme de ségrégation. Ainsi, nous questionnerons
non seulement les mécanismes structurels permettant une orientation négative des élèves mais
aussi les stratégies familiales susceptibles d’accentuer les inégalités. Nous verrons à ce sujet
que celles-ci sont susceptibles de diverger en fonction du groupe social étudié quitte à parfois
s’entrechoquer. De ce fait, il ne s’agit pas tant d’étudier les modèles éducatifs de la Belgique
francophone et de la Suède en vue de les comparer que d’appréhender comment un même
processus de ségrégation peut se traduire différemment selon le système d’orientation étudié.
Afin de limiter le cadre de nos recherches, nous avons émis deux hypothèses. Premièrement,
une orientation équitable serait entravée par une orientation prématurée et par la limitation du
nombre de redoublements dans l’enseignement secondaire. Deuxièmement, les élèves
disposeraient de trop peu d’informations afin de s’orienter correctement. Nos premières
hypothèses établies, nous nous intéresserons principalement aux obstacles structurels et aux
obstacles liés au manque d’information entravant une orientation optimale. Ainsi, nous
tenterons de répondre aux questions suivantes : les élèves disposent-ils d’une information
suffisante sur les options offertes par l’enseignement qualifiant et les métiers en pénurie ?
Quels sont les facteurs influençant la satisfaction d’un choix d’orientation ?
2
Au cours de la préparation de notre enquête, nous nous sommes imprégnée des théories de
nombreux ouvrages. Parmi eux, nous retenons le volume Vers une école juste et
efficace1 rassemblant 26 contributions sur les systèmes d’enseignement et de formation
(Demeuse, Baye, Straeten, Nicaise et Matoul, 2005). Cette étude à l’approche internationale
nous inspira pour notre méthodologie de recherche et nous permit également d’approcher de
nombreux concepts. Les rapports des sociologues Souto Lopez et Paletha nous ont également
été d’un grand secours pour appréhender le phénomène de relégation scolaire tel qu’il est
connu en Belgique francophone. Concernant le chapitre relatif au modèle suédois, nos
lectures ont été guidées par de nombreux rapports publiés par l’OCDE et le Cedefop qui
constituèrent, à ce titre, nos premiers référents.
En ce qui concerne notre méthodologie générale, nous avons procédé à la réalisation de deux
enquêtes distinctes. Principalement quantitative, notre étude se base essentiellement sur la
création d’un sondage en Belgique francophone et en Suède permettant ainsi d’établir un lien
entre les choix d’orientation survenant au sein des deux modèles étudiés. Nous avons
également pris le parti de nous rendre en Suède pendant trois mois afin de nous imprégner de
la culture suédoise, de rencontrer des parents d’élèves et de visiter plusieurs écoles. Compte
tenu de la nature distincte des deux pays pressentis, nous avons pris le parti de détailler la
méthodologie propre aux deux enquêtes au sein de leur chapitre respectif. Nous espérons ainsi
améliorer la compréhension de notre démarche.
A travers une enquête sur les choix d’orientation dans l’enseignement secondaire en Belgique
francophone et en Suède en 2015, nous tenterons de répondre principalement à la question
suivante : dans quelle(s) mesure(s) l’orientation dans l’enseignement secondaire intervient en
tant que mécanisme de ségrégation ? Le premier chapitre propose de s’étendre sur le
phénomène de relégation scolaire en Belgique francophone. L’exposition du cadre théorique
sera suivie de la présentation de notre étude à la fois quantitative et qualitative. Le deuxième
chapitre, conçu en contrepoint, se consacre à l’étude du modèle suédois. Traversé par une
réflexion sur la manière dont l’institution scolaire endigue le phénomène de relégation
scolaire, nous élargirons le cadre de notre réflexion en analysant la réforme du libre choix. A
nouveau, l’exposition des résultats de notre étude quantitative permettra d’articuler nos
différentes hypothèses. Au moment de conclure, nous tenterons de dépasser les clivages
éducatifs afin d’apporter une réflexion constructive sur la manière dont l’orientation est
susceptible d’opérer en tant que mécanisme de ségrégation. 1 L’ouvrage est issu de la collection de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). 2 Un tableau comparatif des modèles éducatifs propres à la Belgique francophone et à la Suède est disponible en
3
Sigles et abréviations
Cedefop Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle
CPMS Centre Psycho-Médico-Social
Eurostat Office Statistique de l’Union Européenne
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques
Siep Service d’Information sur les Études et les Professions
Skolverket Agence Nationale Suédoise pour l’Éducation
Unesco Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture
UNDP Programme des Nations Unies pour le Développement
5
Introduction
Au cours de ce premier chapitre, nous nous intéresserons aux choix d’orientation dans
l’enseignement secondaire en Belgique francophone. Notre réflexion sur l’orientation comme
mécanisme de ségrégation prendra la forme d’une analyse du phénomène de relégation
scolaire. Mais d’abord, intéressons-nous au cadre général et plus particulièrement aux
principales caractéristiques du système éducatif belge2. Celles-ci sont selon nous :
Principales caractéristiques du système éducatif belge
1. L’obligation scolaire
L’obligation scolaire en Belgique est « l’une des plus longues au monde » (Demeuse, 2005,
p.199). Prolongée jusqu’à 18 ans par la loi du 29 juin 1983, elle induit la prolongation de la
fréquentation scolaire tout en « limitant le nombre théorique de redoublements dans
l’enseignement fondamental » (p.197). Par conséquent, elle accélère le rythme scolaire des
élèves et encourage les orientations forcées au début de l’enseignement secondaire.
2. La gratuité de l’enseignement
La gratuité constitue l’un des piliers de l’enseignement en Belgique. Celle-ci est généralisée à
l’enseignement maternel, primaire et secondaire de plein exercice. Elle est le fait de la loi du
29 mai 1959 autrement connue sous l’appellation du « Pacte Scolaire » (p.197). Elle prévoit
qu’aucun droit d’inscription ne puisse être demandé aux élèves même si ceux-ci sont majeurs.
Néanmoins, il s’agit d’une gratuité toute relative puisque les écoles ont le droit d’exiger une
participation aux frais scolaires correspondant à l’accès à des « infrastructures sportives ou
culturelles, le prix de photocopies complémentaires, le journal de classe ou même des frais
d’outillage ou le prêt de livres dans l’enseignement secondaire » (p.197).
3. L’organisation en filières
Le système éducatif en Belgique est organisé en deux filières distinctes. A savoir,
l’enseignement général, de type académique préparant à la poursuite d’études universitaires
ou supérieures et l’enseignement qualifiant. Ce dernier terme désigne l’ensemble des filières
techniques et professionnelles. Selon l’Office Statistique de l’Union Européenne (Eurostat),
72,6% des élèves de l’enseignement secondaire supérieur en Belgique poursuivaient leurs
2 Un tableau comparatif des modèles éducatifs propres à la Belgique francophone et à la Suède est disponible en annexe (1). Celui-ci rassemble un ensemble de données récentes sur les pays étudiés.
6
études au sein de l’enseignement qualifiant en 2012. Soit une écrasante majorité3 des
étudiants inscrits.
Partie I : Les choix d’orientation en Belgique francophone
Le phénomène de relégation scolaire constitue, selon nos recherches, le processus principal
par lequel l’orientation intervient en tant que mécanisme de ségrégation en Belgique
francophone. Avant de continuer, nous vous proposons une définition de la ségrégation :
La ségrégation est la traduction des différences sociales dans l’espace. Elle se manifeste dès
que des individus, classés par la société dans des catégories sociales distinctes, dotées d’une
valorisation sociale différenciée, se trouvent séparés dans l’espace et sont ainsi amenés à peu
se côtoyer. Les formes extrêmes de la ségrégation sont le ghetto et l’apartheid, qui consistent
tous deux, sous des modalités différentes, en une séparation des groupes sociaux systématique
et transversale à tous les champs de l’activité humaine (Delvaux, 2005, p.276).
La compréhension des mécanismes de ségrégation scolaire reste à ce jour relativement
limitée. Nos recherches nous ont cependant permis d’identifier certains facteurs influents.
Ainsi, la ségrégation résidentielle, les stratégies familiales et les possibilités de sélection des
élèves4 au sein des institutions constituent les principaux facteurs d’inégalités (Böhlmark,
Holmlund et Lindahl, 2014, p.2). A ceux-ci, nous nous devons d’ajouter l’asymétrie de
l’information, les coûts liés au transport et la capacité d’accueil des établissements scolaires
(Edmark, Frölich et Wondratschek, 2014, p.4). Dans cette première partie, nous nous
intéresserons plus particulièrement au phénomène de la relégation scolaire et tenterons de
comprendre comment les élèves ont plus ou moins accès à un certain niveau d’éducation en
fonction de leurs origines sociales.
La relégation scolaire : définition et mécanismes structurels
Demeuse, Lafontaine et Straeten définissent la relégation scolaire comme étant « un
mécanisme de sélection qui s’opère sur base de l’origine sociale. Cette sélection, qui n’est
donc pas insensible aux caractéristiques socioéconomiques, se traduit par un passage des
élèves de l’enseignement général vers les sections techniques et professionnelles » (2005,
p.268). Nous émettons l’hypothèse que ce phénomène opérerait principalement à travers une
orientation prématurée et le redoublement des élèves. 3 La Belgique fait partie des pays européens accueillant le plus grand nombre d’élèves au sein des filières de l’enseignement qualifiant (Köditz et Peek, 2009, p.5). En comparaison, la Suède accueille 51,6% de ses élèves dans les filières professionnelles. Il est à noter que la moyenne européenne se situait à 55,7% en 2012 (Eurostat). 4 Ces sélections peuvent s’opérer lors de l’inscription de l’élève ou par la suite, lors des conseils de classe où les enseignants peuvent être amenés à rediriger l’élève vers l’enseignement qualifiant.
7
En effet, l’enseignement secondaire en Belgique francophone se caractérise par une
orientation prématurée. Les élèves ont la possibilité de s’orienter vers l’enseignement
qualifiant dès les deux premières années de l’enseignement secondaire, soit, dès l’âge de
douze ans. Une situation, somme toute, particulière puisque dans la plupart des pays
européens, l’âge de l’orientation est fixé à seize ans (Köditz et Peek, 2009, p.15). Par ailleurs,
les recommandations de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la
Culture sont, à ce sujet, très claires (2001, p.22). Selon l’Unesco, l’âge de quinze ans devrait
être, en principe, la limite minimum pour effectuer un choix de spécialisation. De plus, ce
choix ne devrait s’opérer qu’après que l’élève ait poursuivi avec succès une période d’études
communes se concrétisant sous la forme d’un tronc commun. Cette période de transition
devant permettre à l’élève de choisir de rester dans un enseignement de type académique ou
de s’orienter dans l’enseignement qualifiant.
Outre une orientation précoce, le redoublement apparaît comme le « moyen privilégié, voire
comme unique mesure pour gérer la diversité, les différences de rythmes d’apprentissage et
d’aptitudes » existant entre les élèves (Demeuse et al., 2005, p.260). En obligeant les élèves
ayant doublé deux fois au sein de l’enseignement général à se réorienter vers les filières
techniques et professionnelles, le décret « l’école de la réussite »5 supprime les symptômes de
l’échec sans les soigner (Souto Lopez et Charlier, 2010, p.17). Ainsi, selon le sociologue
Paletha, « l’enseignement professionnel constitue un enseignement de sélection même si il
n’est assurément pas que cela. Il a pour fonction spécifique d’accueillir et d’offrir « une voie
de salut » aux jeunes d’origine populaire les plus rétifs à la socialisation scolaire et/ou les plus
en difficulté, exclus à ce double titre des études longues » (2012, p.42).
La double fonction du redoublement
Dans la mesure où le processus de relégation se traduit par une orientation des élèves à partir
de leurs (trop faibles) performances scolaires, censées exprimer leur inaptitude à poursuivre
dans l’enseignement général et justifiant ainsi leur réorientation vers le qualifiant jugé plus
facile, l’effet d’accumulation des retards dans les apprentissages [redoublements] devient l’un
des principaux moteurs de ce processus (Souto Lopez et Charlier, 2010, p.16).
D’un point de vue à la fois sociologique et économique, le redoublement apparaît
relativement inefficace. Il serait même contre-productif puisqu’il aurait tendance à accroitre
les chances de doubler à nouveau (Meirieu, Guiraud, 1997, p.15). Paletha confirme, à cet
5 L’école de la réussite ou décret du 14 mars 1995 (Fédération Wallonie Bruxelles, 2014a).
8
égard, qu’« à caractéristiques sociodémographiques et scolaires tenues constantes, les
individus ayant redoublé lors du premier degré de l’enseignement secondaire ont ainsi deux
fois plus de chances que les élèves « à l’heure » de connaître une orientation professionnelle :
les redoublants en primaire 3,7 fois plus de chances et les jeunes ayant redoublé à la fois en
primaire et dans le premier degré de l’enseignement secondaire 2,6 fois plus de chances »
(2012, p.56). Il s’agit d’une information d’une importance considérable puisque le
redoublement en Belgique relève davantage de la norme que de l’exception. En effet, selon un
rapport publié par la Fédération Wallonie Bruxelles en 2014(b), seuls 45% des élèves ayant
atteint la quatrième année de l’enseignement secondaire seraient à l’heure dans leur
apprentissage tandis que 32% seraient en retard d’un an. Enfin, 23% d’entre eux accuseraient
un retard de deux ans ou plus.
De plus, le redoublement est susceptible de renforcer les inégalités scolaires en s’adressant
différemment aux élèves selon leurs origines sociales et économiques. Ainsi, il revêt
davantage une fonction de rattrapage scolaire auprès des élèves de la classe moyenne
montante tandis qu’il « prépare à l’élimination scolaire » les enfants des classes populaires
(Paletha, 2012, p.57). Il nous semble important de préciser que ceux-ci ont 7,6 fois plus de
chance de se retrouver dans l’enseignement professionnel (p.64). Face au redoublement, les
élèves sont inégaux et les jeunes ne pouvant compter sur un pilotage familial assidu sont
davantage à même de se convaincre que l’enseignement général ne leur convient pas ou pire
encore, qu’il s’agisse d’une forme d’éducation dépassant leurs capacités cognitives (p.103).
Le pilotage des familles
Dans l’école libérale, il ne s’agit pas d’apprendre à comprendre le monde et à vivre ensemble.
L’important est de tirer son épingle du jeu. Les parents font ici office de soutiens logistiques
auprès de leurs enfants guerriers. Armés d’une pédagogie de comptoir, ils élaborent avec eux
la meilleure stratégie. Ils s’emploient à motiver leurs rejetons pour le combat : utiliser le
professeur, s’en faire un allié ; s’assurer les meilleures bases disponibles, choisir les options
qui feront la différence au moment de l’orientation ; se replier, en cas d’échec, d’un
établissement à un autre en évitant à tout prix ceux qui ont mauvaise réputation
(Meirieu et Guiraud, 1997, p.79).
Orienter ses enfants de manière juste et efficace demande un certain capital culturel. Il s’agit
pour les familles de placer une importance particulière sur l’éducation de leurs enfants. Les
stratégies familiales des parents sont profondément imprégnées par leur milieu socio-
économique. De ce fait, les « vœux d’orientation scolaire » formulés par les parents peuvent
9
varier considérablement d’un groupe social à l’autre (Paletha, 2011, p.103). Ainsi, les familles
des classes moyennes ont tendance à surinvestir le champ éducatif ; elles participent
assidûment aux réunions des parents et questionnent longuement les enseignants sur l’avenir
scolaire de leurs enfants. Pour ces familles, l’école représente un véritable champ de bataille,
une lutte de chaque instant qu’il convient de gagner en équipe. En revanche, les parents des
classes populaires disposant d’une culture scolaire plus effacée et ayant peut-être déjà subis
eux-mêmes les stigmates de la relégation scolaire, ont tendance à adopter une relation plus
distante avec la sphère éducative. De plus, un pilotage harmonieux fait appel à une
connaissance rigoureuse des caractéristiques du système éducatif en Belgique francophone.
Ici encore, les familles sont loin d’être égales. Face aux décisions des agents scolaires, deux
réactions possibles s’offrent aux parents des classes populaires (Souto Lopez et Charlier,
2010, p.67). D’une part, ils ont la possibilité d’obéir sans être certains que la décision prise à
l’égard de leur enfant soit équitable, justifiée ou tout simplement pertinente. D’une autre part,
ils peuvent réinvestir leur espace de liberté en s’opposant à la culture scolaire.
10
Partie II : Une enquête sur les choix d’orientation en Belgique francophone
Au sein de cette deuxième partie, nous présenterons les résultats de notre enquête sur les
choix d’orientation en Belgique francophone. A la fois quantitative et qualitative, notre étude
se compose d’un sondage réalisé auprès de 260 élèves et d’entretiens avec trois élèves
évoluant au sein de l’enseignement qualifiant.
Méthodologie : une approche à la fois quantitative et qualitative
Réalisation d’un sondage Notre échantillon se compose de 260 élèves, âgés de 12 à 20 ans et poursuivant leurs études
dans l’enseignement secondaire au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La récolte des
données s’est opérée principalement auprès de deux établissements scolaires : une école se
situant en Wallonie et organisant une formation de type général et une école localisée à
Bruxelles spécialisée dans la dispense de cours à vocation professionnelle. Par ailleurs, le
sondage a été mis en ligne. En ce qui concerne les informations relatives à l’échantillon
étudié, sur les 260 élèves sondés, 54% sont des hommes et 46% des femmes. Par ailleurs,
70% fréquentent l’enseignement général, 16% l’enseignement technique et 14%
l’enseignement professionnel. Un échantillon6 dont la valeur scientifique demeure, somme
toute, relative. Nous énonçons dès lors les limites des résultats de nos recherches et nous vous
invitons, de ce fait, à considérer nos découvertes comme étant un aperçu des possibles choix
d’orientation en Belgique francophone.
6 Un exemplaire du sondage, les données détaillées de l’échantillon ainsi que l’ensemble de nos résultats sont disponibles en annexe (6 et 7).
26 24
1 1
19
26
4
25
1
9
16
5
13
20
1
6
12
26
6 10
3 3 3
0
5
10
15
20
25
30
Gén
éral
e
Gén
éral
e
Prof
essi
onne
lle
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Gén
éral
e
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Prof
essi
onne
lle
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Prof
essi
onne
lle
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Prof
essi
onne
lle
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Prof
essi
onne
lle
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Prof
essi
onne
lle
féminin masculin féminin masculin féminin masculin féminin masculin féminin masculin
12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans 18-20 ans Plus de 20 ans
Informations relatives à l’échantillon étudié (en unité)
11
Réalisation d’entretiens semi-directifs avec trois élèves Souhaitant éviter le piège d’une enquête qui serait strictement quantitative et qui nierait, dès
lors, le facteur humain, nous avons recueilli les témoignages de trois élèves évoluant au sein
de l’enseignement qualifiant. Ceux-ci partagent leur expérience et racontent comment ils ont
vécu leur orientation. Réalisés sous la forme d’entretiens semi-directifs, ces rencontres nous
permettront d’articuler les concepts présentés dans la première partie du chapitre avec le
quotidien des jeunes interviewés.
Présentation des principaux résultats du sondage
La réalisation d’un sondage sur les choix d’orientation en Belgique francophone nous a
permis de mettre en évidence une série de tendances. L’exposition de ces dernières sera suivie
par une conclusion analytique.
1. Les élèves de l’enseignement général seraient davantage satisfaits de leur choix d’orientation Selon notre sondage, 80% des élèves fréquentant l’enseignement secondaire en Belgique
francophone s’estiment satisfaits de leur choix d’orientation. Un chiffre étonnamment élevé
révélant cependant quelques disparités. En effet, les différentes filières d’étude n’affichent pas
le même degré de satisfaction. Dès lors, si 82% des élèves de l’enseignement général se
déclarent satisfaits de l’orientation suivie, ils ne sont plus que 74% en technique et 73% en
professionnel. De même, parmi les élèves se déclarant insatisfaits nous retrouvons une
majorité d’étudiants ayant dû faire face à un ou plusieurs redoublements. Un mécontentement
pouvant être compris et interprété à la lumière de nos recherches sur le redoublement en tant
que mécanisme central de la relégation scolaire.
2. Seule une minorité des élèves fréquentant l’enseignement technique et professionnel n’aurait jamais redoublé
12
En ce qui concerne le redoublement, nous percevons que seule une minorité des élèves a
déclaré n’avoir, à ce jour, jamais redoublé au sein des filières techniques et professionnelles.
Ils ne seraient, respectivement que 24% et 19%. De même, les élèves ayant déclaré avoir
redoublé 3 à 4 fois se retrouvent majoritairement dans l’enseignement professionnel. Ainsi,
plus les élèves redoublent, plus ils se retrouvent en technique et en professionnel. Un
deuxième signe permettant de nous avertir que lesdites filières ne seraient pas fréquentées
uniquement par des jeunes passionnés par les arts techniques et manuels. Ceci tend à
confirmer la tendance soulignée par la Fédération Wallonie Bruxelles ci-dessus.
3. Des élèves surestimant leurs connaissances des options offertes par l’enseignement qualifiant Parmi les élèves interrogés, 60% se déclarent suffisamment informés sur leurs possibilités de
carrière scolaire et ce, indépendamment de la filière fréquentée. Afin de vérifier leurs
connaissances effectives, nous leur avons soumis une liste de 24 métiers susceptibles d’être
enseignés au sein de l’enseignement qualifiant. Nous leur avons demandé de répondre par
« oui » ou par « non » suivant leurs connaissances7.
Le test réalisé au sein de notre sondage nous permet de déterminer que seulement 18% des
élèves interrogés bénéficient des connaissances suffisantes pour s’orienter de manière
optimale 8 . Plus étonnant encore, le manque d’informations semble s’être généralisé à
l’ensemble des élèves sondés et ce, indépendamment de la filière d’étude suivie. Ainsi, 64%
des élèves de l’enseignement général ont commis entre 6 et 15 fautes. Ils sont également 69%
en technique et 70% en professionnel à être dans le même cas. Un fait étonnant puisque l’on
7 A titre d’exemple, nous avons demandé si il était possible, oui ou non, de suivre un programme en menuiserie dans l’enseignement qualifiant. 8 En émettant l’hypothèse que les élèves ayant commis entre zéro à cinq fautes aient les connaissances suffisantes pour s’orienter de manière optimale.
18%
40% 27%
10% 7%
Nombre de fautes obtenues lors du test les options offertes par l'enseignement qualifiant (en %)
0-5 fautes 6-10 fautes 11-15 fautes 16-20 fautes 21-24 fautes
13
aurait pu s’attendre à ce que les élèves fréquentant l’enseignement qualifiant soient davantage
au courant des options proposées au sein de leurs filières.
De même, en mettant en perspective les données relatives au « sentiment d’être assez bien
informé » sur les options de l’enseignement qualifiant et les fautes obtenues, nous découvrons
un véritable décalage entre ce que les élèves pensent connaître et ce qu’ils connaissent
véritablement. Le tableau ci-dessous nous permet, à cet égard, de constater que sur les 172
élèves ayant commis entre 6 et 15 fautes, 101 élèves se déclaraient correctement informés.
Nous sommes, dès lors, amenés à penser que les élèves surestiment leur degré d’information.
16
44
27
10 6
30
59
42
15 11
0
10
20
30
40
50
60
70
0-5 fautes 6-10 fautes 11-15 fautes 16-20 fautes 21-24 fautes
Réponses vs Sentiment d'information (en unité)
Non Oui
18%
36% 28%
11% 7%
16%
43%
27%
8% 5%
19%
50%
19%
5% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0-5 fautes 6-10 fautes 11-15 fautes 16-20 fautes 21-24 fautes
Nombres de fautes obtenues lors du test sur les options offertes par l'enseignement qualifiant par filière d'étude (en %)
Générale Professionnelle Technique
14
4. Des élèves peu au courant des métiers en pénurie en Belgique Après avoir mesuré le degré de connaissance des élèves des options offertes par
l’enseignement qualifiant, nous leur avons proposé une liste de 22 métiers9 en leur demandant
de signaler si ceux-ci étaient, oui ou non, en pénurie10. Une fois encore, nous sommes surpris
de constater à quel point le manque d’informations touche les différentes filières.
Nous observons que la majorité des élèves interrogés ont commis entre 6 et 15 erreurs. En
observant la répartition des fautes par filières, nous remarquons que ces mêmes élèves
représentent 82% de l’enseignement général, 81% de l’enseignement professionnel et 74% de
l’enseignement technique. A nouveau, la comparaison des données relatives à un sentiment
satisfaisant d’information avec les fautes commises révèle que les élèves surestiment leurs
connaissances en la matière. Ainsi, parmi les 209 élèves ayant commis entre 6 à 15 erreurs,
126 élèves déclaraient se sentir assez bien informés.
9 La liste des métiers proposés a été inspirée par le site internet du Siep sur les métiers en pénurie (2015). 10 A titre d’exemple, nous avons demandé si les métiers suivants étaient, oui ou non, en pénurie : pâtissier, plombier et psychologue.
5%
39% 43%
10% 3%
8%
43% 38%
11%
0%
10%
55%
19% 17%
0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0-5 fautes 6-10 fautes 11-15 fautes 16-20 fautes 21-22 fautes
Nombre de fautes obtenues lors du test sur les métiers en pénurie par filière d'étude (en %)
Générale Professionnelle Technique
4
48
35
15
1
12
61 65
14
5
0
10
20
30
40
50
60
70
0-5 fautes 6-10 fautes 11-15 fautes 16-20 fautes 21-24 fautes
Nombres de fautes vs Sentiment d'information (en unité)
Non Oui
15
5. Peu d’élèves se déclarent satisfaits des moyens mis à leur disposition pour s’orienter Nous avons interrogé les élèves sur les services offerts par les Centres Psycho Médicaux
Sociaux (CPMS) et le salon des études organisé par le Service d’Informations sur les Etudes
et Professions (SIEP). De même, nous les avons questionnés sur les journées d’information
organisées par leurs écoles respectives.
Nous avons été étonnés de découvrir que seulement 32% des élèves interrogés nous ont dit
avoir consulté le CPMS de leur école au sujet de leur orientation. Parmi les rares élèves ayant
franchi le cap, ils ne sont que 35% à se déclarer satisfaits de leur visite. De même, les élèves
ayant déclaré avoir visité le salon des études SIEP ne seraient que 30%. Par ailleurs, ils ne
seraient que 42% à se déclarer satisfaits de leur visite. La majorité des élèves participants
n’auraient pas trouvé l’information qu’ils étaient venus chercher. A savoir, des indications
concernant les filières existantes, leurs débouchés, le salaire et les conditions de travail
auxquelles ils peuvent prétendre. Enfin, les 49% d’élèves ayant eu droit à une journée
d’information concernant leur orientation au sein de leurs écoles respectives, se déclarent
majoritairement insatisfaits ou sans avis (57%). Les élèves seraient donc peu à même de
consulter par eux-mêmes les organismes mis à leur disposition pour les aider à s’orienter et
lorsqu’ils le font, ils seraient majoritairement insatisfaits. Cette dernière information pointe
les faiblesses du système éducatif belge en matière d’orientation.
68% 17%
11%
4%
32%
Consultation PMS et sentiment d'utilité (en %)
Pas de consultation de PMS Consultation PMS mais pas utile
Consultation PMS et utile Consultation PMS et sans avis
16
Analyse des principaux résultats du sondage
L’analyse des résultats du sondage nous a permis de mettre en exergue une série de tendances.
Celles-ci s’illustrent à travers deux catégories d’entraves à une orientation optimale. A savoir,
les obstacles structurels et les obstacles liés au manque d’informations (Souto Lopez et
Charlier, 2010, p.15).
Mise en évidence des obstacles structurels Premièrement, nous avons observé que les élèves de l’enseignement général seraient
davantage satisfaits de leur choix d’orientation. Les données récoltées nous ont également
permis de mettre en évidence que les élèves ayant déclaré avoir redoublé une ou plusieurs fois
seraient davantage susceptibles de se sentir insatisfaits de leur orientation scolaire. Selon
nous, cette première tendance s’expliquerait partiellement par l’application du décret « l’école
de la réussite » qui, vise en effet, à limiter le nombre de redoublements dans l’enseignement
général en contraignant les élèves ayant redoublé deux fois à se réorienter au sein de
l’enseignement qualifiant. La réforme représente un véritable obstacle structurel à une
orientation optimale puisqu’elle contraint les élèves en difficulté à s’orienter de manière
négative, c’est-à-dire, en fonction de leurs faiblesses scolaires. Notre première hypothèse
semble se confirmer par la deuxième tendance observée ; seule une minorité des élèves
évoluant au sein des filières techniques et professionnelles aurait déclaré n’avoir, à ce jour,
jamais redoublé. Ainsi, il semblerait que l’enseignement qualifiant soit davantage considéré
comme un second choix. A nouveau, le phénomène de la relégation scolaire accompagné de
la double fonction du redoublement nous rappelle que tous les élèves ne sont pas égaux en
matière d’orientation. Nous ajouterons, à cet égard, que certains élèves, pouvant sentir qu’ils
ne disposent pas du soutien nécessaire de leurs professeurs au sein de l’enseignement général
et ne pouvant compter sur un pilotage familial pour les aiguiller, pourraient être amenés à se
réorienter d’eux-mêmes et ce, en fonction de leurs propres faiblesses scolaires. Ainsi, de
nombreux élèves interrogés n’hésitèrent pas à marquer sur leur questionnaire qu’ils étaient
satisfaits de leur orientation dans l’enseignement qualifiant car « c’est plus facile ». Cette
dernière affirmation peut sembler étonnante au vu du nombre de redoublements des élèves
fréquentant ces filières. Selon Souto Lopez et Charlier, les nombreux échecs scolaires
observés ne résulteraient pas tant du retard des élèves sur leur formation en terme d’acquis et
de capacités que « d’une mauvaise orientation des élèves, d’une orientation par relégation, qui
parachute le jeune dans une forme d’enseignement qu’il ne connaît pas et où les choix des
options se fait de façon hasardeuse avec, pour conséquence, des changements successifs
d’options » (2010, p.21). Cette dernière affirmation nous amène tout naturellement vers la
17
deuxième catégorie d’obstacle à une orientation optimale. A savoir, le manque d’information
dont disposent les élèves.
Mise en évidence des obstacles liés au manque d’information Notre étude suggère que les élèves surestiment leur degré d’information concernant leurs
possibilités de carrières scolaires. Cette carence informationnelle toucherait de manière
quasiment identique les trois filières concernées. Les élèves ignoreraient globalement les
options disponibles dans les filières techniques et professionnelles et les métiers auxquels
elles amènent. Nous émettons l’hypothèse que l’enseignement qualifiant étant davantage
perçu comme un choix par défaut, les élèves ne s’informeraient qu’à la dernière minute, au
moment de s’inscrire dans un établissement à vocation technique ou professionnelle. Nous
noterons, à cet égard, que de nombreuses écoles secondaires organisent des examens de
rattrapage durant l’été permettant ainsi aux élèves de repasser les examens auxquels ils
auraient échoué durant la session de juin. Les résultats sont très souvent obtenus à l’issue du
mois d’août ou au début du mois de septembre. Ainsi, les étudiants ayant échoué et devant,
par conséquent, se réorienter ne disposeraient que de très peu de temps afin de s’inscrire dans
un établissement à vocation technique ou professionnelle. Cette situation est propice aux
redoublements suite à des réorientations successives par un jeu d’essais-erreurs.
De même, les élèves sont loin d’être aux faits quant à la longue liste des métiers en pénurie en
Belgique. Il nous semble nécessaire de rappeler, à cet égard, que le chômage chez les jeunes
en Belgique est l’un des plus élevés d’Europe. En effet, 24% des jeunes seraient sans emploi
(OCDE, 2013). Une situation à laquelle nous pourrions partiellement remédier en informant
davantage les jeunes sur leurs possibilités de carrière. Nous émettons, à cet égard, l’hypothèse
que les élèves suffisamment informés seraient plus à même à prendre une décision rationnelle
quant à leur orientation leur permettant ainsi de rejoindre des filières porteuses débouchant
sur l’acquisition d’un emploi. Dans le contexte socio-économique actuel, il nous semble
indispensable de préparer les élèves à affronter un marché du travail qui demande de plus en
plus de qualifications.
Enfin, nous soulignons l’échec des services d’orientations scolaires. Ceux-ci seraient
globalement impopulaires. De plus, les élèves ayant déclaré avoir bénéficié de leurs services
se déclareraient majoritairement insatisfaits. Ce dernier point retient toute notre attention.
Nous rappelons, à cet égard, qu’en choisissant l’enseignement qualifiant et plus
particulièrement l’enseignement professionnel, l’élève s’oriente vers un emploi mais aussi
vers tout un style de vie associé à cet emploi (Willis, P., 2011, p.162). Il nous semble donc
impératif d’améliorer les services d’orientation afin de permettre aux élèves de découvrir,
18
d’une part, la panacée d’opportunités scolaires et professionnelles s’offrant à eux et, d’une
autre part, de prendre connaissance des conditions de travail et du salaire auquel ils peuvent
prétendre en optant pour une option technique ou professionnelle particulière.
Portraits et analyse du parcours de trois élèves de l’enseignement qualifiant
L’analyse des résultats du sondage nous ayant permis d’acquérir une vue d’ensemble des
possibles choix d’orientation, nous vous proposons, à présent, de nous concentrer sur les
témoignages11 de trois élèves12 évoluant au sein de l’enseignement qualifiant.
Des élèves à deux hémisphères sociaux - portrait de Youssef
Youssef a 19 ans. Accumulant les difficultés scolaires, il a été réorienté successivement en
technique puis en professionnel. Il est, aujourd’hui, élève en sixième professionnel en
électricité.
Moi la primaire, ça allait déjà pas. Je suis parti en secondaire et j’ai vu que la générale, ça
allait pas avec moi. Je suivais pas, tu vois. J’arrivais pas à étudier. C’est pas comme ici, les
profs en général, ils sont pas toujours derrière toi. Ils sont derrière les gens qui sont toujours là
et tu vois… Ils vont pas t’aider à remonter la pente. D’abord, je suis parti en technique puis je
me suis dit, en vérité, je vais aller dans le professionnel. Et voilà, je suis là maintenant. Faut
aimer, pas le choix hein. Enfin, peut-être après je ferai des études mais ça on sait pas, faut de
l’argent, faut du pain à la maison (Youssef, 12 novembre 2014).
Le témoignage de Youssef ramène le monde extérieur dans l’enceinte de l’école. Adoptant le
rôle d’un père de famille, il accepte son destin scolaire. Il sait que son avenir est, depuis
toujours, lié aux conditions économiques de sa famille. «Enfin, peut-être après, je ferai des
études mais ça on sait pas, faut de l’argent, faut du pain à la maison ». Ce sont des propos
extrêmement forts venant de la part d’un adolescent de 19 ans. Youssef ira jusqu’à ajouter « si
on se donne à fond pour étudier, faire tout ce qu’on nous demande, je crois bien qu’on
pourrait réussir. C’est juste le mode de vie qui est à l’extérieur. Il est différent des autres
quoi ». Youssef ne définira jamais précisément ce qu’il entend par « mode de vie extérieur »
néanmoins il insistera lourdement sur la nécessité de disposer de ressources financières
suffisantes pour suivre la route qu’il aimerait emprunter, c’est-à-dire, les études supérieures.
11 Afin de respecter l’anonymat des élèves, les noms ont été changés. 12 Un quatrième témoignage est disponible en annexe (2).
19
A cet égard, Meirieu et Guiraud écrivaient en 1997 :
Certains enfants vivent avec un cerveau à deux hémisphères sociaux. L’un gère la pauvreté,
les urgences de la survie immédiate, la débrouille au moindre coût, la famille patriarcale ou
matriarcale : l’autre les mathématiques et la physique, …, les connaissances désincarnées de
l’école et le pouvoir du maître supposé tout savoir (p.28).
Lors de notre entretien, Youssef reviendra à plusieurs reprises sur le manque de soutien
ressenti dans l’enseignement général. « Les profs, en général, y a pas de communication avec
eux en fait. Tu vas, tu rentres dans la classe, tu t’assois, tu dois faire ce qu’il dit le prof et
après tu sors. C’est tout, y a pas plus ». La suite du parcours de Youssef est malheureusement
classique, l’élève accumulant les difficultés et ne pouvant bénéficier ni du soutien de ses
enseignants ni d’un pilotage familial, s’est laissé porter d’une section à l’autre jusqu’à
accepter son destin scolaire. Ce faisant, l’élève a baissé les bras. A ce propos, Paul Willis
affirmait déjà dans les années 1970 : « c’est un tropisme académique de séparer ainsi les lieux
et j’espère que plus aucun pédagogue ne pense plus que ce qui se joue à l’école se limite
seulement à ce qui se joue entre ses quatre murs » (Cité par Laurens et Mischi, 2011, p.66).
Hélas, l’histoire de Youssef signe l’échec de l’école à venir en aide aux plus nécessiteux.
Les effets d’une orientation prématurée et du manque d’informations - Portrait de Medhi
Medhi a 18 ans. Il a été réorienté dans l’enseignement qualifiant après sa deuxième année
secondaire. Il poursuit, actuellement, ses études en sixième professionnelle électricité.
Moi j’trouve qu’on est pas assez bien informé. En deuxième secondaire, j’avais été visité deux
écoles mais sans savoir ce qu’il y avait comme option en professionnel. Et on n’a pas trop le
choix quoi, en deuxième année. Soit on continue en général, soit on va en professionnel. On
est trop jeune pour choisir. J’avais que quatorze ans. Enfin voilà, quand je me suis inscris à
l’école, je savais que j’allais venir en professionnel et donc j’ai regardé les options qu’il y
avait dans les écoles et c’est surtout l’électricité qui m’a le plus donné envie. Sinon, avant que
je vienne ici, jamais je me suis dit que je finirai électricien. Mais, ça va, ça me plait
l’électricité (Medhi, 12 novembre 2014).
L’entretien de Medhi met en lumière deux problématiques centrales de l’orientation au sein
du système éducatif en Belgique francophone. A savoir, l’orientation prématurée et le manque
d’informations dont disposent les élèves à l’aube de leurs choix de carrière. Suite aux
obstacles rencontrés lors de ses deux premières années dans l’enseignement général, Medhi a
été réorienté. Celui-ci n’avait alors que quatorze ans. Un âge où l’identité est en pleine
20
construction et où décider de sa trajectoire professionnelle relève pour beaucoup de
l’inimaginable. Medhi a visité deux écoles sans pour autant être certain que ce type
d’enseignement puisse lui convenir. La décision de suivre une formation en électricité s’est
opérée sur base d’un choix par élimination ; l’électricité étant ce qui, finalement, l’inspirait le
plus. Nous sommes en droit de nous demander comment aurait-il pu en être autrement. De
même, nos recherches nous ont menés à nous questionner sur l’utilité d’une orientation
prématurée. Selon Meirieu et Guiraud « à ce que certains aient le droit de devenir citoyens,
d’autres non » (1997, p.161) :
En orientant trop tôt une partie des élèves vers des écoles de seconde zone et un enseignement
au rabais, on accepte de hiérarchiser les citoyens: en haut ceux qui ont réussi à aller jusqu’au
bout du parcours scolaire, en bas ceux qui ont été éjectés: entre les deux, une série de statuts
intermédiaires. C’est la reconstitution de la noblesse, des privilèges et des inégalités (p.161).
Outre le sentiment de ne pas avoir eu le temps de la réflexion, le témoignage de Medhi met en
lumière le manque d’informations auquel font face les élèves en voie de réorientation. Ainsi
Medhi a dû se diriger de manière instinctive vers une formation qui l’attirait plus ou moins. Si
le caractère hasardeux de l’orientation de Medhi connut un dénouement positif puisque celui-
ci poursuit sa formation depuis maintenant quatre ans sans avoir connu de difficultés scolaires
supplémentaires, d’autres élèves doivent faire face à une série de réorientations successives.
S’orientant par un jeu d’essais-erreurs, nombreux sont les élèves à accumuler un retard
considérable dans leur formation. Une situation qui pourrait aisément être évitée en
développant un système d’informations concernant les filières et les options disponibles.
Notre dernière remarque s’adresse ici, à l’ensemble du système éducatif belge. Poser un choix
d’orientation positif ne peut s’opérer qu’en connaissance de cause.
21
Une orientation positive et la fierté du métier - Portrait de François
François a 19 ans. Il a choisi de s’orienter dans l’enseignement qualifiant dès sa troisième
année de secondaire. Il a posé un choix positif. Il ne fait dès lors pas partie des victimes du
phénomène de relégation scolaire.
Moi, de base, j’aime l’enseignement général donc j’ai fait ma première et deuxième
secondaire en général. Mais déjà là, je savais que c’était menuiserie que je voulais faire. Pas le
fait que quelqu’un dans ma famille le fait ou que je connaissais quelqu’un, c’est le fait que
depuis que je suis petit, je trouve que c’est un beau métier. Et c’est une expérience à faire,
donc c’est vraiment ce que je voulais faire de base et je me suis lancé dedans et je me suis
rendu compte que j’aimais vraiment. Donc je continue et j’espère aller vachement loin
(François, 19 novembre 2014).
L’entretien avec François fut étonnant. Principalement pour deux raisons. Premièrement,
François n’est pas issu des classes populaires. Il est le digne fils de la classe moyenne
montante. La famille de François n’éprouve, à cet égard, aucune difficulté socio-économique.
Deuxièmement, François effectua un choix positif. Réussissant dans l’enseignement général,
il a choisi de se réorienter vers l’enseignement qualifiant, de son propre chef, afin de réaliser
son rêve de devenir menuisier. François perçoit la noblesse du métier qu’il apprend. Il partage
un véritable sentiment d’appartenance avec le corps du métier qu’il s’apprête à rejoindre.
Nous avons été étonnés par l’esprit corporatif se dégageant de son discours et ce, au sens
médiéval du terme.
Néanmoins, le parcours de François demeure atypique. Dans un système scolaire idéal, c’est-
à-dire, un système où tous les élèves décideraient individuellement de la trajectoire scolaire
qu’ils veulent entreprendre et mobiliseraient dès lors les ressources nécessaires pour réussir
dans le chemin pressenti, le cas de François ne serait pas isolé (Souto Lopez et al., 2010,
p.68). Hélas, les problèmes structurels et le manque d’informations parasitant les choix
d’orientations, l’histoire de François figure davantage à titre d’exception.
22
Conclusion Les enseignements du langage, des choix d’orientation connotés
Malgré la satisfaction et la fierté de François exprimés lorsqu’il raconte son parcours, nous
avons noté l’utilisation récurrente de l’expression « descendre en professionnel ». Nous
l’avons, dès lors, questionné plus particulièrement sur l’usage de cette formule.
Comme c’est la dernière branche … c’est comme si on s’abaissait aux autres. Par exemple, ce
qu’on fait dans l’enseignement professionnel, ça nous permet pas d’aller aussi haut que ce que
font les cours généraux. En général, une fois qu’on a fini, on peut devenir médecin, avocat, …
Enfin tous les gros métiers, assez importants. Professionnel, y a pas tout ça. On se contente
vraiment aux métiers manuels. Y a pas de trucs à côté. C’est le fait que, pour certaines
personnes, on s’abaisse à eux car ces métiers là sont forcément moins importants que d’autres.
… mais en attendant si c’est vraiment un métier qui nous tient à cœur, on est obligés d’aller
jusque là. Et on y va (François, 19 novembre 2014).
L’explication de François révèle à quel point les choix d’orientation sont, aujourd’hui,
profondément connotés. Une fois encore, le langage nous renseigne sur les faiblesses du
système. Ainsi l’utilisation du terme « descendre en professionnel » révèle la profonde
hiérarchisation des filières. Ainsi, il existerait des « filières nobles » menant aux études
universitaires et des « filières manuelles » qui seraient défavorisées (Demeuse, 2005, p.201).
De plus, celles-ci ne sont exploitées que dans un seul sens. Les élèves se dirigent toujours
depuis l’enseignement général jusqu’aux filières de l’enseignement qualifiant. A cet égard,
Meirieu et Guiraud affirment très justement que :
L’orientation des seuls élèves en difficulté vers les secteurs « manuels » accrédite l’idée qu’il
s’agit là de métiers de simple exécution et que l’on peut effectuer sans véritable culture de
base et sans rien entendre aux enjeux de la société dans laquelle ils s’exercent. Dévalorisés,
ces métiers finissent par ressembler à l’image que l’on a d’eux (1997, p.163).
Dans un rapport publié en 2010, les sociologues Souto Lopez et Charlier relatent comment la
hiérarchisation de l’enseignement influence la perception qu’ont les élèves de leur parcours.
Ainsi, vouloir rester en général serait perçu comme « une décision raisonnable et pertinente
faisant état de la maturité personnelle de l’élève » tandis que s’orienter en professionnel se
rapporterait à « un mauvais choix, à un manque de maturité ou à une faiblesse culturelle ».
(p.68). Medhi est, quant à lui, revenu lors de notre entretien sur la manière dont il se sentait
perçu par les élèves restés en général : « Je pense que les gens qui sont pas avec nous à
23
l’école, ils nous prennent pour des idiots, pour des voyous. Comme on n’est pas venus ici de
notre plein gré, en professionnel j’veux dire, ben j’pense qu’ils ont une mauvaise image de
nous » (12 novembre 2014). Cette dernière intervention ne manque pas de nous rappeler les
effets du redoublement et de la relégation affectant l’image que les élèves ont d’eux-mêmes.
Les choix d’orientation qu’ils soient volontaires ou imposés représentent un moment crucial
dans la construction de l’identité d’un adolescent.
Ainsi Bourdieu soulignait déjà en 1994 que :
L’acte de classement scolaire est toujours, mais tout particulièrement en ce cas, un acte
d’ordination au double sens que ce mot revêt en français. Il institue une différence sociale de
rang, une relation d’ordre définitive : les élus sont marqués, pour la vie, par leur appartenance
(ancien élève de…) ; ils sont membres d’un ordre, au sens médiéval du terme, et d’un ordre
nobiliaire (p.41).
En découle, un système scolaire dont l’orientation s’exerce principalement par choix négatifs
et où les élèves éprouvant des difficultés « passent des filières les plus valorisées, c’est-à-dire
à forte composante intellectuelle, vers celles qui sont moins valorisées, plus pratiques ou
directement en rapport avec l’exercice d’une profession de type manuel » (Demeuse, 2005,
p.204). Une orientation optimale devrait être, à notre sens, retardée. De plus, il nous semble
qu’aucun agent scolaire ne devrait être en droit de forcer un individu à s’engager vers une
filière en vertu de ses résultats scolaires. Le système actuel tend à dévaloriser l’enseignement
qualifiant. A cet effet, un enseignant de menuiserie rencontré lors de notre enquête témoigne
des ravages de la relégation au sein de ses ateliers :
Dans l’enseignement général, le gros souci, c’est que les enseignants ne sont pas au courant de
ce qu’on fait au niveau technique et quelle est la différence entre le technique et le
professionnel. … Et souvent quand on rate dans le général, on a tendance à dire « tu seras bon
dans le technique » mais ça n’est pas toujours le cas. Y a quand même pas mal d’éléments [des
élèves] qui ont dû changer de voie parce qu’au niveau manuel ça n’allait pas ou au niveau
réflexion ça n’allait pas. Enfin, ça demande plein de qualités de travailler dans un atelier
(Erben, 26 novembre 2014).
Ainsi poser un choix actif et positif en décidant de s’orienter vers l’enseignement qualifiant
demande une grande force de caractère aux élèves désireux d’apprendre un métier. De même,
la structure actuelle du système éducatif en Belgique francophone contribue à décourager
certains parents, les amenant ainsi à exercer un pilotage familial plus strict en évitant la piste
professionnelle sans discussion possible. Revaloriser l’enseignement qualifiant demande une
24
restructuration complète du système éducatif. Il est nécessaire de repenser les filières de
l’enseignement et de les considérer, non pas en tant que filtres sociaux et culturels permettant
aux élèves les plus aguerris de survivre à de nombreuses années de sélections et
d’évaluations, mais comme étant complémentaires et permettant la formation de citoyens à
même de contribuer à l’édifice démocratique de notre société.
26
Introduction
Au cours de ce deuxième chapitre, nous nous intéresserons aux choix d’orientation dans
l’enseignement secondaire en Suède. Nous tâcherons de comprendre comment la structure du
système éducatif suédois endigue le phénomène de relégation scolaire tel qu’il est connu en
Belgique francophone. Notre réflexion sur l’orientation en tant que mécanisme de ségrégation
portera, quant à elle, sur l’analyse du « libre choix » permettant la réapparition des inégalités
scolaires.
Mode de fonctionnement et contexte socio-économique de la Suède13
Reconnue comme un Etat maintenant de grands progrès sociaux, la Suède a longtemps été
désignée comme une « troisième voie14 » en tant qu’elle parvint à concilier la satisfaction des
besoins sociaux avec un développement socio-économique conciliant (Francia, Herrera et
Englund, 2005, p.172). Dans un rapport publié en 2012(a), l’OCDE soulignait, la qualité du
modèle suédois permettant à sa population de disposer : « d’un revenu par habitant élevé, de
faibles taux d’inégalité et de pauvreté, d’une population en bon état de santé, d’une qualité
environnementale satisfaisante, d’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
et d’une confiance élevée en les institutions » (p.4). Néanmoins, la Suède et son modèle
éducatif ne sont pas insensibles aux phénomènes internationaux. Ceux-ci influençant
inexorablement la manière d’envisager et d’organiser les structures éducatives. Nous vous
invitons, dès lors, à nous intéresser au contexte socio-économique de la Suède dans lequel
prend place l’institution scolaire :
1. Un Etat décentralisé15
La Suède est une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Le gouvernement représente le
plus haut organe décisionnel. Celui-ci est constitué à l’issue d’élections organisées tous les
quatre ans (Cedefop, 1999, p.15). En ce qui concerne son mode de fonctionnement, la Suède
est divisée en 290 communes et 21 comtés (Cedefop, 2009, p.9). L’Etat étant décentralisé, les
communes en Suède ont un large domaine de compétences couvrant l’éducation, la santé et la
planification sociale (1999, p.16). Afin de les aider à mettre en application les directives de
l’Etat, les communes reçoivent la majorité des revenus perçus par les taxes nationales (2009,
13 Un tableau comparatif de la Belgique et de la Suède est disponible en annexe (1). 14 En comparaison aux deux modèles prépondérants avant 1989 : 1) modèles d’une société totalitaire 2) le modèle de développement capitaliste du libre marché (Francia, Herrera et Englund, 2005, p.172). 15 Pour plus d’informations sur la décentralisation et les prises de décisions éducatives, veuillez vous référer aux annexes (3)
27
p.9). Elles ont également la possibilité de lever des taxes locales leur permettant ainsi de
subvenir à leurs besoins16 (Örebro, 2009). Les communes demeurent, néanmoins, inégales
quant à la perception de l’impôt. Variant énormément en taille et en importance selon leur
localisation géographique, certaines communes n’accueillent que quelques milliers
d’habitants17 et très peu d’écoles tandis que d’autres font face à une population de plusieurs
centaines de milliers d’habitants et par conséquent, de nombreuses écoles18 (Edmark, Frölich,
Wondratschek, 2014, p.60).
2. Un paysage culturel en pleine mutation
Peuplée de 9,7 millions d’habitants, la Suède se caractérise par une faible densité de
population. Le pays connaît une véritable concentration urbaine puisqu’environ 85% des
Suédois vivent en ville. Environ un tiers de la population réside dans les trois plus grandes
villes du pays. A savoir, Stockholm, Göteborg et Malmö (OCDE, 2015, p.15). Semblable à de
nombreux pays européens, la Suède fait face à une population vieillissante. En effet,
seulement 23% de la population est âgée de moins de 20 ans et c’est pourquoi l’Etat s’est vu
contraint de développer une politique d’accueil des immigrants. En 2013, 15% de la
population suédoise était née à l’étranger (p.15). Nous pouvons, dès lors, parler d’une
véritable transformation du paysage culturel suédois. L’intégration des immigrants et de leurs
enfants est devenue un enjeu central pour l’économie du pays.
Ce nouveau contexte multiculturel a, bien entendu, engendré des répercussions sur la manière
de penser et d’organiser le système éducatif puisque la majorité des immigrants non-
Européens sont des réfugiés arrivés au cours des deux dernières décennies (Cedefop, 1999,
p.18). Selon le Conseil National Suédois de la Jeunesse, « sur 4286 écoles élémentaires, 112
accueilleraient, au moins, 50% d’élèves d’origine étrangère » (cité par Bunar, 2009, p.7, trad.
libre). Par ailleurs, les immigrants se concentrent davantage dans les agglomérations urbaines.
Dans certaines communes de Stockholm, 80 à 90% des élèves sont d’origine étrangère
(OCDE 2004, p.49). Les nationalités les plus représentées proviennent d’Iran, d’Irak, de
Somalie, de Bosnie, du Kosovo, de l’Afghanistan, du Chili et de la Pologne (Bunar, 2009,
p.7).
16 Jusqu’à 60% du revenu des communes provient de taxes locales (Örebro, 2009). 17 Stockholm représente la plus grande commune avec 759.311 habitants et Bjurholm est la plus petite avec 2.652 habitants (Örebro, 2009). 18 Ceci explique partiellement pourquoi la réforme du libre choix concerne surtout les communes urbaines les plus importantes. En effet, les communes rurales ayant tendance à accueillir moins d’élèves disposent de moins d’écoles et donc, de moins de choix scolaire.
28
Les idéaux d’équité et d’égalité des chances défendus par la Constitution suédoise se
traduisent dans les faits par une volonté politique d’intégrer les nouveaux arrivants tout en
évitant de les forcer à abandonner leur propre culture. C’est ainsi que la Suède a inscrit dans
sa constitution, l’obligation des communes à organiser des cours de suédois se déroulant
gratuitement au profit des primo arrivants (Cedefop, 2009, p.11). De même, leurs enfants ont
la possibilité de suivre un cours de suédois, enseigné en tant que deuxième langue (OCDE,
2004, p.49). Il est à noter qu’environ 23% des élèves de l’enseignement obligatoire ont la
possibilité de suivre des cours dans leur langue maternelle. Cependant, seulement 54% d’entre
eux profitent réellement de cette opportunité supplémentaire (OCDE 2015, p.34).
3. Un contexte économique stable
La Suède a réussi à créer un contexte favorable permettant la création de nouveaux emplois
depuis 2010. Ce faisant, l’économie suédoise est reconnue comme étant stable. De même, la
Suède se caractérise par un taux de chômage relativement bas. En effet, 8% de la population
active serait actuellement sans-emploi (OCDE, 2014a). En revanche, le chômage chez les
jeunes a considérablement augmenté. 16% des 15-24 ans seraient actuellement sans emploi
(OCDE, 2013b). Il est néanmoins nécessaire de nuancer cette dernière information étant
donné qu’une grande partie des jeunes sans emploi étudient à plein-temps. En conséquence, la
Suède a l’un des taux les plus faibles de jeunes qui soient au chômage et qui ne poursuivent
pas d’étude (Kuczera, 2013, p.14). Si les performances du marché du travail sont meilleures
en Suède que dans de nombreux pays de l’OCDE, certaines inégalités persistent au sein des
différents groupes sociaux (OCDE 2012a, p.4). Un rapport publié par l’OCDE en 2012
confirme que les inégalités et la pauvreté, si modestes soient-elles, n’ont cessé d’augmenter
au cours de ces dernières années. Les premières victimes ne sont autres que les immigrés.
Plus précisément, les demandeurs d’asile et les personnes venues dans le cadre d’un
regroupement familial. Ce groupe social disposant d’un niveau d’éducation potentiellement
plus faible est davantage exposé aux inégalités du marché du travail et au chômage (p.7).
Ainsi la Suède se caractériserait par la décentralisation de son pouvoir, l’émergence d’un
nouveau contexte multiculturel et une économie stable. L’exposition des principales
caractéristiques propres au mode de fonctionnement et au contexte socio-économique de la
Suède nous permet, dès lors, de saisir et de délimiter le cadre dans lequel s’inscrit le modèle
éducatif suédois.
29
Principales caractéristiques du système éducatif suédois
Les principales caractéristiques du système éducatif suédois sont, selon nous :
1. Un héritage luthérien
L’historique du système éducatif en Suède est profondément marqué par le protestantisme. Le
luthérianisme défendant l’idée que chaque individu puisse lire, de ses propres yeux, la parole
de Dieu, l’enseignement des textes religieux permit de légitimer un ordre social alors très
inégalitaire entre les classes sociales et les sexes (Francia, 2005, p.220). L’apprentissage de la
lecture pour l’ensemble de la population suédoise s’est généralisé à partir de l’ordonnance
ecclésiastique de 1689. Celle-ci rendit obligatoire l’apprentissage de la catéchèse de Luther
(p.219). En 1842, la Suède devient l’un des premiers pays au monde à instaurer l’école
obligatoire. Cette mesure fut largement motivée par un désir d’égalité sociale et économique
(Björklund et al., 2005, p.7). Aujourd’hui, si l’influence de l’Eglise s’est amoindrie et qu’elle
est désormais étrangère à l’organisation des programmes scolaires, l’héritage luthérien
persiste au sein de la culture scolaire (Hartman, 2007, p.57).
2. Un enseignement gratuit
La gratuité représente l’un des piliers centraux du système éducatif suédois. En effet, la loi
scolaire19 de 1997 garantie et généralise l’accès à une éducation sans coût et ce « quels que
soient le sexe, le lieu de domicile, les conditions sociales et économiques de l’enfant »
(Francia, 2005, p.225). Contrairement au système éducatif belge, la gratuité est envisagée
dans son sens le plus large. C’est-à-dire que les parents ne prennent en charge « ni les repas
scolaires, les soins médicaux, le transport scolaire ni les aides pédagogiques » (Plumelle,
2011, p.3). Il est important de préciser que ce droit d’accès libre et gratuit s’étend à
l’ensemble du système scolaire, c’est-à-dire, de l’enseignement de base obligatoire, à
l’enseignement secondaire ainsi qu’à la plupart des universités publiques et des écoles
supérieures en Suède (Francia, 2005, p.225). En ce qui concerne le financement de
l’éducation, les dépenses20 annuelles de l’éducation par élève par rapport au PIB par habitant
au titre des établissements d’enseignement publics et privés s’élevaient à 23,7% en 2011
(Eurostat).
19 La loi scolaire (SFS 1997 :22) instaure la gratuité de l’éducation dans tout le système scolaire public : en maternelle, en primaire, en secondaire et à l’université. Et ce, que les élèves fréquentent une école secondaire publique ou privée. Auparavant des frais supplémentaires pouvaient être demandés dans le cas où l’élève serait inscrit dans une école secondaire privée (Francia, 2005, p.225). 20 La Belgique affichait le même pourcentage concernant le financement de l’éducation en 2011 (Eurostat). En comparaison, la moyenne européenne se situait à 26,9% en 2011 (Eurostat).
30
3. Une école élémentaire polyvalente
L’école de base obligatoire (grundskola) est dite polyvalente (Björklund et al., 2005, p.10).
C’est-à-dire que les élèves âgés de sept à seize ans ne sont pas regroupés en fonction de leurs
capacités. Ils ne sont ni sélectionnés, ni relégués. Au contraire, ils suivent un tronc commun
leur permettant d’acquérir des bases similaires. Celles-ci sont définies par le programme
national. En ce qui concerne l’évaluation, ni le redoublement ni la notion d’échec n’existent à
proprement parler. Les tests nationaux21 sont obligatoires à la fin de la 3ème, 6ème et 9ème année.
(OCDE, 2015, p.22). Ces tests sont organisés à titre formatif. Ils permettent de rendre compte
du niveau des élèves et d’améliorer le système éducatif afin de permettre la réussite du plus
grand nombre.
Après l’école obligatoire, la plupart des élèves poursuivent leurs études au sein de
l’enseignement secondaire supérieur. Il est à noter que l’obligation scolaire étant fixée à l’âge
de seize ans, les élèves poursuivent leurs études de leur plein gré. Environ 98% des élèves
choisissent de continuer leur scolarité au sein de l’enseignement secondaire supérieur (Le
Grand, Szulkin, Tåhlin, 2005, p.325). Celui-ci est divisé en dix-huit programmes nationaux22:
douze d’entre eux sont à vocation professionnelle et six sont consacrés à la préparation aux
études supérieures (Skolverket, 2012, p.6). Tous les programmes de l’enseignement
secondaire supérieur comportent un tronc commun 23 de huit cours théoriques. Ceux-ci
occupent environ un tiers de la formation et ce que cela soit au sein des filières académiques
ou professionnelles (Kuczera et al, 2008, p.10).
Les élèves diplômés de l’enseignement secondaire supérieur ont la possibilité de poursuivre
leurs études au sein de l’une des 14 universités publiques et 17 hautes écoles publiques. En
2013, plus de 40% des jeunes âgés de 24 à 34 ans poursuivaient leurs études au sein de
l’enseignement supérieur (OCDE, 2015, p.21). Il est à noter que les étudiants universitaires en
Suède sont relativement âgés par rapport aux standards européens (Björklund et al., 2005,
p.11). En effet, les jeunes suédois ont tendance à attendre quelques années avant d’arrêter leur
choix sur une carrière académique. Cette orientation culturellement tardive est supportée par
les services d’admission des universités qui ont tendance à favoriser les postulants plus âgés.
21 Ceux-ci concernent les cours de Suédois en première ou en deuxième langue, de mathématiques, de sciences et les cours d’anglais (uniquement pour la 6ème année) (OCDE, 2015, p.22). 22 Les 18 programmes nationaux sont détaillés en annexe (4). 23 Les cours dispensés sont le suédois en première ou en deuxième langue, les mathématiques, l’anglais, les sciences naturelles, les sciences sociales. Les élèves suivent également des cours d’art et de religion. Le programme inclut également des cours optionnels, des sujets relatifs au choix spécifique d’un programme ainsi qu’un projet spécial que devra présenter l’élève à la fin de son cycle d’étude (Kuczera et al, 2008, p.10).
31
Partie 1: Les choix d’orientation en Suède
L’orientation comme mécanisme de ségrégation peut recouvrir différentes formes selon la
structure du système étudié. Ainsi, nous avons eu l’occasion de nous intéresser au phénomène
de la relégation scolaire au sein du chapitre consacré à l’éducation en Belgique francophone.
Nous avons constaté que la discrimination scolaire opérait principalement à partir du choix
d’orientation visant à déterminer la poursuite des élèves dans l’enseignement général, de type
académique ou dans l’enseignement qualifiant. Ce troisième chapitre consacré au système
éducatif suédois nous permettra d’élargir le cadre de notre réflexion en considérant
l’orientation sous son expression la plus étendue. De ce fait, les choix d’orientation étudiés,
ci-dessous, porteront non seulement sur le choix d’une filière mais aussi et surtout, sur le
choix d’une école en particulier.
Un modèle éducatif échappant au phénomène de la relégation scolaire
L’enseignement secondaire supérieur en Suède ne participe pas à la relégation des élèves
puisque le choix d’une section académique ou professionnelle est laissé à la seule
appréciation de l’élève. Aucun agent scolaire n’a donc le droit d’orienter un élève contre son
gré. L’OCDE recommande, par ailleurs, de maintenir le système actuel (Kuczera, Field,
Hoffman, Wolter, 2008, p.17). L’organisation met en avant quatre arguments. Premièrement,
les élèves s’orientent souvent en fonction de leurs forces et faiblesses académiques. Le choix
d’orientation impliquerait, dès lors, une forme d’auto-sélection. Les tests nationaux ont
permis de démontrer que les élèves évoluant au sein de l’enseignement professionnel
performaient moins bien que les élèves restés dans l’enseignement dit académique. Cet
indicateur semble confirmer que les élèves éprouvant plus de difficultés avec un
enseignement purement théorique aient déjà choisi de s’orienter en professionnel.
Deuxièmement, instaurer un concours à l’entrée de l’enseignement supérieur à vocation
académique tendrait à stigmatiser l’enseignement professionnel qui serait dès lors perçu
comme un programme pour les élèves « les moins capables ». Cela provoquerait un désastre
au sein d’une société suédoise accordant un statut honorable aux études professionnelles. En
effet, la plupart des élèves suivant le programme se déclareraient fiers et satisfaits de suivre
leur formation (p.18). Il est à noter qu’environ 10% des élèves ayant suivi l’enseignement
professionnel poursuivent ensuite leurs études dans l’enseignement supérieur indiquant que la
filière n’est pas bouchée puisqu’elle permet une marge de manœuvre aux élèves désireux de
rectifier leur choix d’orientation (p.18). Troisièmement, une sélection serait susceptible
d’envoyer un message clair aux employeurs, professeurs, élèves et familles disant que
32
l’enseignement professionnel est pour les plus faibles. Dès lors, un élève éprouvant un certain
attrait à « travailler avec ses mains » pourrait éprouver de la réticence à « rétrograder » en
prenant la direction des études manuelles. Enfin, les employeurs insistent sur le fait qu’ils ne
souhaitent pas voir le tronc commun académique se réduire. Ceux-ci ont le sentiment que
l’utilisation de facultés davantage intellectuelles est de plus en plus demandée dans les
métiers manuels. De plus, l’usage d’un esprit critique, la maitrise des maths, du suédois et de
l’anglais représentent des atouts indispensables (p.18).
Perception de l’enseignement professionnel
Ainsi, le système éducatif suédois se caractérise par une volonté d’inclure l’enseignement
professionnel au sein d’un projet éducatif plus large (Cedefop, 1999, p.2). Si l’enseignement
professionnel (yrkesprogram) est moins courtisé depuis les années 1970, il jouit néanmoins
d’une image relativement positive. Il est généralement perçu comme une alternative
intéressante à une route scolaire dite académique. L’enseignement professionnel dispose d’un
tronc commun théorique important (Cedefop, 2014, p.10). Les stages en entreprise n’occupant
que quinze semaines sur une formation de trois ans, le profil des élèves ayant suivi le cursus
professionnel est davantage celui d’un généraliste que d’un spécialiste. L’acquisition de
compétences supplémentaires est, dès lors laissée, au soin de l’employeur qui tâchera
d’apprendre à son apprenti ce qu’il doit savoir sur le métier (Cedefop, 2009, p.26). Cette
situation, aussi étonnante soit-elle, s’explique par le fait que la majorité des offres d’emploi à
vocation professionnelle ne requièrent pas de diplôme en Suède. Il existe cependant des
professions nécessitant une certification supplémentaire. Nous pensons notamment aux
métiers d’électricien ou de plombier. L’élève désirant exercer ces postes se devra de
compléter sa formation par un apprentissage organisé directement par le conseil de la
formation conjointe (Yrkesbevis). En d’autres termes, l’enseignement professionnel en Suède
est pensé et organisé comme étant non pas, la fin d’un cycle d’étude, mais plutôt le début d’un
apprentissage se poursuivant tout au long de la vie via les filières d’éducation permanente24
(p.26). Par ailleurs, le vieillissement de la population combiné à une large vague de retraites
rend l’enseignement à vocation professionnelle indispensable à la survie de l’économie
suédoise (Skolverket, 2014). Actuellement, 51,6 % des élèves25 choisissent de s’orienter vers
les métiers manuels. Un chiffre qui s’avère insuffisant pour assurer la relève. 24 Celles-ci s’adressent aux adultes âgés de minimum vingt ans et se divisent en quatre filières : l’éducation à vocation professionnelle avancée (kvalificerad yrkesutbildning), l’éducation supplémentaire (kompletterande utbildningar), la formation post-secondaire (Påbyggnadsutbildning) et les programmes de formation professionnelle dispensée par les universités populaires (Skolverket, 2007). Voir annexe (5). 25 En comparaison, 72,6% des élèves en Belgique francophone étudient dans l’enseignement qualifiant dans le secondaire supérieur (Eurostat, 2011).
33
L’Agence National pour l’Education explique cette baisse d’intérêt par l’avènement d’une
société du savoir qui valoriserait davantage les études supérieures de type universitaire
(2014). Pour pallier à une potentielle pénurie, l’OCDE recommande l’amélioration des
conseils d’orientation afin d’informer correctement les élèves sur leurs possibilités de
carrières (Kuczera et al., 2008, p.6).
Ainsi, la structure du modèle éducatif suédois parvient à éviter le piège de la relégation
scolaire. Néanmoins, notre étude des choix d’orientation en Suède nous a permis de constater
la réapparition des inégalités entre les élèves sous le couvert du « libre choix ».
La réforme du « libre choix »
La mutation sociétale engendrée par la réforme de 1992 peut être comprise comme une
volonté de combattre les ségrégations scolaires en donnant la possibilité aux parents de
choisir l’école de leurs enfants et ce qu’elle soit publique ou privée. Auparavant, les élèves
étaient invités à suivre le programme national au sein de l’école publique la plus proche de
chez eux (Böhlmark, Holmlund et Lindahl, 2014, p.3). La possibilité d’influencer le choix
d’école de l’élève était alors très limitée. A vrai dire, la seule manière d’influer sur la scolarité
de son enfant était de choisir un lieu de résidence stratégique. Ce faisant, l’ancien système
encourageait indirectement une ségrégation dite résidentielle (p.7). Créée et mise en place
pour endiguer la ségrégation scolaire, la réforme donna naissance à une nouvelle forme de
discrimination. Nous verrons au cours de cette partie que la compétition entre les écoles
induite par l’introduction du chèque scolaire, l’émergence d’écoles à but lucratif et le pilotage
familial constituent les principaux facteurs favorisant la discrimination scolaire.
Le chèque scolaire, un mode de financement favorisant la compétition entre les écoles L’enseignement étant gratuit pour les élèves en Suède, ce sont les communes qui financent les
écoles fréquentées. Ce mode de financement a été rendu possible grâce à l’introduction du
chèque scolaire. Celui-ci correspond à une somme d’argent relative aux dépenses moyennes
d’un élève. Autrement dit, chaque étudiant, de par son choix d’établissement, emporte avec
lui une certaine somme d’argent qui renflouera les caisses de l’école choisie (Böhlmark et al.,
2014,p.10). L’argent se trouvant là où les élèves étudient, la course à la différentiation est
lancée. Il s’agit de développer un profil particulier permettant d’attirer suffisamment d’élèves
afin d’alimenter financièrement l’école. Parmi les profils scolaires développés, 38% des
écoles privées ont choisi d’adopter un mode de fonctionnement standard, 33% ont opté pour
une pédagogie alternative telle Montessori ou Steiner, 13% sont de type confessionnel, 5%
sont des écoles se concentrant sur une langue particulière telles que l’International English
34
School ou encore le Lycée Français, 5% ont adopté un profil spécial tel que l’enseignement
soutenu de la musique ou des sports et 6% des écoles ont développé un profil de type
« autre » (Cowen, 2008, p.17).
Le libre choix et la marchandisation de l’éducation En choisissant de mettre leurs enfants dans une école privée plutôt que dans une école
publique, les parents suédois obligent les établissements communaux à réajuster leur
programme afin de mieux convenir aux attentes de ces derniers. C’est la loi de l’offre et de la
demande. La marchandisation de l’éducation fut davantage renforcée par l’introduction
d’écoles à but lucratif. En effet, 65% des écoles privées sont détenues par des sociétés
anonymes (Sahlgren, 2010, p.5). Il semblerait que l’appât du gain constitue une motivation
supplémentaire pour investir le champ éducatif. Une situation qui peut sembler douteuse sur
le plan éthique pour deux principales raisons. Premièrement, il est fort à parier que le profit
dont bénéficient les actionnaires ne soit pas réinvesti dans l’éducation des élèves entrainant
ainsi une forme d’exploitation (Cowen, 2008, p.8). Deuxièmement, même si la qualité des
écoles peut être supérieure dans des écoles détenues par des sociétés anonymes, il semble
profondément contraire à la morale que l’argent fourni par l’Etat serve à enrichir les
actionnaires. Les défenseurs d’un tel système soulignent que l’éducation est loin d’être un
marché juteux et que peu d’entreprises sont capables de tirer un réel bénéfice après avoir
réinvesti l’argent nécessaire au maintien de leurs établissements scolaires (p.38). Les sociétés
anonymes rencontrant le plus de succès seraient ainsi comparables à de petites entreprises
sociales26.
Pilotage scolaire des familles Les parents suédois se déclarent majoritairement favorables au « libre choix ». Une étude
menée auprès de 4700 parents d’élèves a révélé qu’ils seraient 90% à soutenir la réforme
(Francia, Herrera et Englund, 2005, p.185). Le pilotage scolaire des familles suédoises
s’effectue essentiellement à travers le choix d’une école (Lie, Linnakylä, Roe, 2003, p.9). En
sélectionnant une école publique ou privée, en privilégiant certains quartiers, et en veillant à
placer leurs enfants dans un climat scolaire jugé propice à leur réussite, les parents exercent
une influence déterminante sur l’avenir de leurs enfants.
26 L’analyse du rapport annuel d’un groupe détenant plus de 15 écoles nous a permis de constater que leur chiffre d’affaire, pour l’année 2014, s’élevait à 37.365.357 euros (2014). Quant aux bénéfices, ceux-ci atteignent la somme de 3.009.086 euros. Peu d’entreprises sociales peuvent se targuer d’un chiffre d’affaires aussi élevé.
35
Il est intéressant de constater que les familles développent des stratégies scolaires propres à
leur condition sociale (Bunar, 2009, pp.8-9). Celles-ci sont amenées à se croiser quitte à
parfois s’entrechoquer. Ainsi, la classe moyenne d’origine suédoise est plus susceptible de
percevoir l’école comme un lieu de reproduction social. L’environnement scolaire ainsi que
les camarades de classe prennent dès lors une importance considérable. Il s’agit d’assurer la
conservation de son statut social à travers l’éducation. La liberté de choix est alors utilisée
comme un moyen de se distinguer des classes populaires en plaçant ses enfants dans un
environnement qui soit culturellement reconnaissable (p.9), créant ainsi des écoles dites à
« drapeau blanc » (Cowen, 2008, p.33, trad. libre). A l’inverse, les familles défavorisées,
largement composées de primo-arrivants et de minorités ethniques envisagent davantage
l’école comme un outil de transformation sociale. L’éducation est alors perçue comme une
clef qui permettra aux enfants d’accéder à un statut social plus élevé :
Si vous prêtez attention aux individus, le libre choix est un moyen de prévenir la ségrégation.
Si vous vivez dans une banlieue, ce système vous permet d’obtenir une clef ouvrant la porte au
reste de la société en vous permettant de fréquenter une école de haut statut. Pour ces
individus, il est possible d’obtenir une meilleure carrière et d’apprendre « les codes » du reste
de la société. Si vous apprenez comment la plupart des personnes pensent, vous pouvez
adopter leur comportement. Cela inclut la langue, les accents, la manière de s’habiller, les
valeurs et les goûts… Beaucoup de jeunes et de parents pensent qu’étudier dans une école
fréquentée par des élèves d’origine suédoise leur permettra d’obtenir ces clefs (Kallstenius cité
par Cowen, 2008, p.31, trad. libre).
La présence d’élèves de tradition suédoise est dès lors perçue comme un gage de qualité.
Nous percevons très clairement la présence de deux stratégies, comparables à deux droites
sécantes. Les effets de telles prises de position peuvent être désastreux pour les enfants issus
de milieux défavorisés. Plongés dans l’univers impitoyable des écoles, ils s’exposent à
« l’exclusion, la marginalisation, à des points plus faibles et peut-être même à l’harcèlement »
(Bunar, 2009, p.12, trad. libre). La seule présence d’élèves issus de la classe populaire aurait
tendance à affecter le statut symbolique des établissements fréquentés. La situation des élèves
restés au sein des écoles de quartiers n’est guère plus enviable. Les écoles localisées dans les
quartiers multiculturels connaissent une véritable fuite des cerveaux (Cowen, 2008, p.32).
Une conséquence désastreuse puisqu’elle creuse davantage les inégalités sociales au sein des
classes scolaires. Les élèves restants dans les écoles défavorisées sont alors livrés à eux-
mêmes. Ceux-ci ne peuvent plus bénéficier de la dynamique des étudiants éprouvant
36
davantage de facilités. De même, ils perdent peu à peu le soutien de parents impliqués et de
professeurs motivés, partis à la conquête de nouvelles écoles privées.
Ainsi le libre choix scolaire n’aurait pas réussi à démontrer sa capacité à instaurer un équilibre
social, ethnique et symbolique au sein des écoles multiculturelles (Bunar, 2009, p.7). Nous
sommes dès lors portée à penser que les stratégies familiales mises en place afin d’assurer les
chances de réussite de leurs enfants entrent en contradiction avec l’ambition politique, propre
à la Suède, de promouvoir un système éducatif permettant de diminuer les inégalités sociales
et d’ouvrir les opportunités éducatives aux enfants provenant des familles défavorisées (Le
Grand et al., 2005, p.322). Il nous semble important de signaler que de nombreuses études27
ont reporté que la ségrégation scolaire serait davantage marquée dans les régions où le libre
choix est prépondérant28. Elle serait en effet moins importante dans les agglomérations
disposant de peu d’écoles et par conséquent, de moins de choix (Böhlmark et al., 2014, p.35).
Notre enquête sur le terrain nous a permis de rencontrer plusieurs parents d’élèves, parmi
ceux-ci, Åsa Hallemar, mère de trois enfants se déclarant favorable au libre choix (1er juin
2015). Si Hallemar apprécie le fait de pouvoir choisir l’école de ses enfants, elle estime
néanmoins que la liberté de choix est, somme toute, relative. En effet, la capacité d’accueil
des écoles privées étant limitée, celles-ci mettent à disposition des listes d’attente29. Selon
Hallemar, les files d’attente des écoles privées sont tellement longues que seuls les parents
s’étant inscrits plusieurs années à l’avance bénéficient véritablement de l’opportunité de
choisir l’école de leurs enfants. De plus, tous les élèves ne paraissent pas attirants. Si la
Constitution ne permet pas la sélection des élèves, les écoles privées peuvent, néanmoins,
encourager les élèves « plus faciles » à venir. Par exemple, en choisissant les foyers auxquels
ils envoient leurs brochures ou en publiant des publicités dans des journaux spécifiques.
Revenant sur la manière dont elle avait été informée sur les différents types d’établissements
scolaires, Hallemar se souvient avoir reçu de la documentation concernant les écoles les plus
proches. De même, certaines écoles privées ont envoyé des brochures à son domicile.
Néanmoins, elle souligne que l’école privée de son quartier, bénéficiant d’une excellente
réputation et d’une longue liste d’attente ne distribua aucun type de brochure dans le quartier.
27 Notamment : (Böhlmark, Holmlund, Lindahl, 2014), (Cowen, 2008), (OCDE, 2004), (OCDE, 2012b) et (OCDE, 2015) 28 La ségrégation scolaire s’est intensifiée en Suède à hauteur de 25% au cours de ces seize dernières années. (Böhlmark et al., 2014, p.5). 29 Il est important de signaler que les écoles privées ne peuvent pas pratiquer de favoritisme et que seul l’ordre d’inscription est tenu en compte pour la sélection des élèves. Une exception est cependant faite pour les frères et sœurs d’un enfant fréquentant déjà l’établissement scolaire (Cowen, 2008, p11). De même, les élèves habitant dans le voisinage sont également favorisés. Cette dernière condition permettant à la ségrégation résidentielle de subsister dans une certaine mesure.
37
Hallemar ajoute : « l’information concernant les écoles circule surtout via le bouche-à-
oreille » (trad.libre). Cette dernière intervention met en lumière l’importance des réseaux
familiaux dans le cadre d’un pilotage optimal. Lors de notre entretien, Hallemar est revenue à
plusieurs reprises sur l’importance de connaître des élèves au sein des différentes écoles afin
de bénéficier d’une information adéquate. Il s’agirait dès lors avant tout de recevoir le bon
type d’information au bon moment. En effet, Hallemar conclut notre interview en soulignant
que « pour inscrire son enfant dans une école privée, vous avez besoin d’obtenir l’information
nécessaire plusieurs années avant l’entrée à l’école de votre enfant » (1er juin 2015, trad.libre).
38
Partie 2 : une enquête sur les choix d’orientation en Suède
Notre enquête sur les choix d’orientation au sein de l’enseignement secondaire en Suède nous
a mené à nous rendre à Stockholm où nous avons eu l’occasion de confronter les concepts
présentés dans la première partie de ce troisième chapitre à la réalité du terrain.
Méthodologie
Dans un souci pratique, nous avons décidé de procéder à une analyse davantage quantitative.
En effet, la barrière de la langue constitua un frein considérable à la réalisation d’entretiens
approfondis avec les élèves. Notre choix s’est dès lors porté sur la création d’un sondage.
Afin de collecter un maximum de données et de diversifier notre échantillon, nous nous
sommes rendus au sein de trois écoles distinctes : une école publique organisant
essentiellement une formation de type académique, une école privée spécialisée dans la
dispense de cours à vocation professionnelle et une école privée accueillant les deux
programmes scolaires. Ainsi, nous eûmes l’occasion de recueillir les données de 107 élèves
âgés de 14 à 20 ans. En ce qui concerne les informations relatives à l’échantillon étudié, sur
les 107 élèves sondés, 65% sont des femmes et 35% des hommes. Par ailleurs, 68 % d’entre
eux fréquentent l’enseignement académique et 32% l’enseignement professionnel. Enfin, 51%
des élèves sondés suivent leur scolarité au sein d’une école publique et 49% des élèves sont
inscrits dans une école privée. Pareillement à notre sondage réalisé en Belgique francophone,
nous soulignons la valeur scientifique, somme toute, relative de notre échantillon30 suédois.
Nous énonçons dès lors les limites des résultats de nos recherches et nous vous invitons, de ce
fait, à considérer nos découvertes comme étant un aperçu des possibles choix d’orientation en
Suède et plus particulièrement à Stockholm.
30 Par ailleurs, un exemplaire du sondage, les données détaillées de l’échantillon ainsi que l’ensemble de nos résultats sont disponibles en annexe (8 et 9).
1
44
4
19 14
6 14
2 2 1 0 5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
Aca
dém
ique
Aca
dém
ique
Prof
essi
onne
lle
Aca
dém
ique
Prof
essi
onne
lle
Aca
dém
ique
Prof
essi
onne
lle
Aca
dém
ique
Prof
essi
onne
lle
Aca
dém
ique
Féminin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin
14-15 ans 16-18 ans 19-20 ans Autre
Informations relatives à l’échantillon étudié (en unité)
39
Présentation et analyse des principaux résultats du sondage
La réalisation d’un sondage sur les choix d’orientation en Suède nous a permis de mettre en
évidence une série de tendances. L’exposition de ces dernières sera suivie par une conclusion
analytique.
1. Les élèves suédois seraient majoritairement satisfaits de leur choix d’orientation Selon notre sondage, 93% des élèves fréquentant l’enseignement secondaire en Suède
s’estiment satisfaits de leur choix d’orientation. Soit 13% d’élèves en plus qu’en Belgique
francophone. De même, les différentes filières d’étude n’affichent pas le même degré de
satisfaction. En effet, 100% des élèves de l’enseignement académique se déclarent satisfaits
de l’orientation suivie contre 79% des élèves de l’enseignement professionnel. Nous
constatons, dès lors, l’apparition de certaines disparités. Néanmoins, celles-ci se révèlent être
plus faibles que celles révélées dans notre sondage en Belgique francophone31. Il nous semble
nécessaire de rappeler, à cet égard, que les choix d’orientation en Suède sont propres à l’élève
et qu’aucun agent scolaire n’est en droit de forcer un élève à s’orienter contre son gré. Dès
lors, un tel résultat nous semble hautement plausible. Parmi les élèves ayant répondu
négativement, nous retrouvons des explications telles que « j’ai cru que ça allait être fun » ou
« je ne me suis pas rendu compte de ce que ça représentait ». De telles informations nous
poussent à penser que si la majorité des élèves opèrent un choix positif, l’orientation au sein
du système éducatif suédois pourrait être optimisée en améliorant l’accès à l’information
entourant les métiers.
2. Les élèves parcourent des distances relativement grandes pour rejoindre leur établissement scolaire
31 Parmi les élèves se déclarant satisfaits de leur orientation en Belgique francophone, 82% étaient en général, 74% en technique et 73% en professionnel.
17%
28%
17%
38%
Distance moyenne parcourue par les élèves (en %)
Moins de 4 km Entre 4 et 10 km
Entre 10 et 15 km Plus de 15 km
82%
18%
Votre école se situe-t-elle dans votre quartier (en %)
Non Oui
40
Il s’agit probablement du résultat le plus marquant de notre sondage. Seulement 18% des
élèves interrogés déclarent fréquenter une école se situant dans leur quartier. En effet, 45%
des élèves déclarent parcourir chaque jour entre quatre et quinze kilomètres afin de rejoindre
leur établissement scolaire. Nous soulignons, à cet égard, la popularité de la réforme du libre
choix qui permet aux élèves de choisir leur école. Pour rappel, avant 1992, les élèves étaient
invités à poursuivre leur scolarité au sein d’un établissement scolaire se situant dans leur
quartier. La mise en relation des résultats obtenus à l’issue des sondages en Suède et en
Belgique francophone, nous permet d’observer une très grande similarité entre les deux pays.
En effet, seuls 17% des élèves belges interrogés ont déclaré fréquenter une école se situant
dans leur quartier. De même, 50% des élèves belges parcourraient tous les jours entre quatre
et quinze kilomètres. Une telle corrélation peut-être expliquée par le contexte de libre choix
propre aux deux pays étudiés.
3. Des élèves disposant d’une connaissance élevée des options offertes par l’enseignement professionnel Parmi les élèves interrogés, 84% se déclarent suffisamment informés sur leurs possibilités de
carrière scolaire et ce, indépendamment de la filière fréquentée. Afin de vérifier leurs
connaissances effectives, nous leur avons soumis une liste de 14 métiers susceptibles d’être
enseignés au sein de l’enseignement professionnel32. Nous leur avons demandé de répondre
par « vrai » ou par « faux » suivant leurs connaissances.
32 A titre d’exemple, nous leur avons demandé si il était possible, oui ou non, de suivre un programme en restauration, en audit (finance) ou en puériculture au sein de l’enseignement professionnel.
0% 1%
17%
28% 24%
30%
Nombre de fautes au test sur les options offertes par l'enseignement professionnel (en %)
Sans faute 1 faute 2 fautes 3 fautes 4 fautes Plus de 4 fautes
41
Nous sommes surpris de constater que 70% des élèves interrogés ont commis entre 0 et 4
fautes. Un résultat remarquable compte tenu des résultats obtenus en Belgique francophone.
En effet, les élèves à ne commettre que 0 à 4 fautes ne représentaient que 11% de
l’échantillon étudié. Cette première observation nous amène à penser que les élèves suédois
seraient globalement mieux informés des options disponibles dans l’enseignement
professionnel. De même, le tableau ci-dessous permet d’observer le nombre de fautes par
filière d’étude. Nous constatons que les résultats sont globalement similaires. Ainsi les élèves
de l’enseignement académique à n’avoir commis que 0 à 4 fautes seraient 70%, tandis qu’ils
seraient 71% dans l’enseignement professionnel.
De même, les élèves suédois tendent à estimer correctement leur niveau d’information. En
effet, sur les 90 élèves déclarant se sentir correctement informés, ils n’étaient que 26 à
commettre plus de quatre fautes.
0% 1%
16%
26% 26%
30%
0% 0%
18%
32%
21%
29%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Sans faute 1 faute 2 fautes 3 fautes 4 fautes Plus de 4 fautes
Nombre de fautes obtenues lors du test sur les options offertes par l'enseignement professionnel (en %)
Académique
Professionnelle
0 0 1
5 5 6
0 1
17
25
21
26
0
5
10
15
20
25
30
Sans faute 1 faute 2 fautes 3 fautes 4 fautes Plus de 4 fautes
Nombre de fautes en relation avec le sentiment d'être assez bien informés (en unité)
Non Oui
42
4. Des élèves peu au courant des métiers en pénurie Après avoir mesuré le degré de connaissance des élèves des options offertes par
l’enseignement professionnel, nous leur avons proposé une liste de 15 métiers33 en leur
demandant de signaler si ceux-ci étaient, oui ou non, en pénurie34. Nous avons été surpris de
constater que les élèves étaient relativement peu au courant des métiers en pénurie en Suède.
Nous observons qu’une minorité des élèves interrogés, soit 36%, n’ont commis qu’entre 0 et 7
erreurs. En observant la répartition des fautes par filières, nous remarquons que ces mêmes
élèves représentent 37% de l’enseignement académique et 32% de l’enseignement
professionnel. Par ailleurs, la comparaison des données relatives à un sentiment satisfaisant
d’information avec les fautes commises révèle que les élèves tendent à sous-estimer leur
niveau de connaissance en la matière. Ainsi, sur les 90 élèves se déclarant assez informés, ils
étaient 56 à commettre plus de 7 fautes.
33 Les métiers en pénurie proposés proviennent du site internet Work in Sweden du Swedish Institute (2015). 34 A titre d’exemple, nous leur avons demandé si les métiers en pénurie suivants étaient, oui ou non, en pénurie : enseignant en primaire et ouvrier en construction.
0 1 0 1 3
9 11 13 13 13 12
31
0 5
10 15 20 25 30 35
Sans faute
1 faute 2 fautes 3 fautes 4 fautes 5 fautes 6 fautes 7 fautes 8 fautes 9 fautes 10 fautes Plus de 10 fautes
Nombre de fautes obtenues lors du test sur les métiers en pénurie (en unité)
0 1 0 0 0 0 1 2 1 3 3
6
0 0 0 1 3
9 10 11 12 10 9
25
0
5
10
15
20
25
30
Sans faute
1 faute 2 fautes 3 fautes 4 fautes 5 fautes 6 fautes 7 fautes 8 fautes 9 fautes 10 fautes
Plus de 10
fautes
Nombres de fautes en rapport avec le sentiment d'être suffisamment informé
(en unité)
Non
Oui
43
5. Des élèves relativement satisfaits de leur service d’information
Notre sondage nous a permis de mettre en lumière que 71% des élèves sondés déclarent avoir
assisté à une séance d’information sur les carrières scolaires et professionnelles. Celles-ci
eurent lieu au sein de leurs écoles de base polyvalente (de sept à seize ans) avant de se diriger
vers l’enseignement secondaire de type supérieur. Le graphique ci-dessus démontre le succès
de ces journées puisque sur 71% d’élèves concernés, 46% se sont déclarés satisfaits. Nous
constatons que les écoles suédoises mettent davantage l’accent sur l’information de leurs
élèves afin de favoriser une orientation positive. En effet, les résultats du sondage réalisés en
Belgique francophone avaient révélé que sur les 49% d’élèves sondés déclarant avoir eu droit
à une séance d’information, seuls 21% l’avaient estimé utile.
Analyse des résultats du sondage
L’analyse des résultats de notre sondage nous a permis de mettre en exergue une série de
tendances. Celles-ci peuvent être regroupées selon trois catégories : la satisfaction exprimée à
l’égard du choix d’orientation, la distance parcourue pour rejoindre l’établissement scolaire et
le degré d’information dont disposent les élèves.
Premièrement, nous constatons que les élèves suédois seraient majoritairement satisfaits de
leur orientation. Nous émettons l’hypothèse que les élèves s’orientant d’eux-mêmes auraient
davantage de chances de poser un choix positif. De même, il nous semble nécessaire de
rappeler que le choix de l’orientation des élèves intervient à l’âge de seize ans. Les élèves
ayant suivi un tronc commun de leur sept à seize ans, sans avoir connu les stigmates de
l’échec - le redoublement n’existe pas en Suède - ont pu construire peu à peu leur identité
scolaire à l’ombre des traumas scolaires. Nous signalons, néanmoins, une distorsion entre les
réponses suivant le programme d’étude pressenti. En effet, les élèves affichant un sentiment
29%
7%
46%
18%
71%
Organisation de séance d'information et sentiment d'utilité (en %)
Pas de séance d'information Séance d'information mais pas utile
Séance d'information et utile Séance d'information et sans avis
44
de regret proviennent majoritairement de l’enseignement professionnel. Nous émettons
l’hypothèse que ces derniers se seraient orientés en fonction de leurs faiblesses scolaires.
Souhaitant échapper aux cours théoriques, ils auraient opté pour le programme professionnel.
C’était sans compter la structure du modèle éducatif suédois. En effet, tous les programmes de
l’enseignement secondaire comportent un tronc commun de huit cours théoriques. Ceux-ci
occupent environ un tiers de la formation et ce que cela soit au sein des filières académiques
ou professionnelles (Kuczera et al., 2008, p.10). En d’autres termes, s’orienter dans
l’enseignement professionnel pour échapper aux cours théoriques est un mauvais calcul. Nos
recherches et notre enquête sur le terrain nous ont permis de déterminer que les élèves
sortants de l’enseignement professionnel auraient davantage le profil de généralistes que de
spécialistes. Une situation expliquée par une orientation tardive et une volonté de garder un
maximum de portes ouvertes aux élèves optant pour la voie manuelle. Il nous semble
nécessaire de rappeler que l’éducation en Suède est envisagée dans son sens le plus large et
que de nombreux réseaux d’éducation permanente se sont développés au fil des années. Ainsi,
opter pour un programme scolaire particulier ne signifierait pas la fin d’une carrière scolaire
mais le début d’un apprentissage se déroulant tout au long de la vie.
Deuxièmement, nous avons observé que les élèves parcourent des distances relativement
grandes pour rejoindre leur établissement scolaire. Cette observation pourrait traduire le
succès de la réforme du libre choix. Par ailleurs, nos recherches nous ont permis de découvrir
que le nombre de kilomètres parcouru est nettement plus élevé parmi les élèves dont les
parents ont moins de revenus et vivent dans des communes avec un taux de criminalité élevé
(Edmark et al., 2014, p.19). C’est le cas d’une majorité de jeunes vivant dans la banlieue de
Stockholm. Ceux-ci ont tendance à couvrir des distances plus grandes afin de bénéficier de la
possibilité de suivre leurs cours en ville (Cowen, 2008, p.30). En d’autres termes, poser un
choix actif représente un enjeu d’autant plus important pour les familles au faible indice
socio-économique. Les élèves issus d’un milieu davantage favorisé ont quant à eux, toujours
bénéficié des moyens financiers nécessaires leur permettant de se déplacer auprès de l’école
souhaitée.
Troisièmement, les élèves suédois disposeraient d’un niveau de connaissances supérieur en ce
qui concerne les options disponibles dans l’enseignement professionnel. Fait surprenant, le
niveau d’information semble relativement homogène entre les différentes filières. Ainsi les
élèves ayant opté pour les filières académiques connaitraient, néanmoins, le contenu du
programme professionnel. De plus, nous avons constaté que les élèves suédois se déclaraient
davantage satisfaits des séances d’informations sur les options et les métiers disponibles.
45
Notre enquête sur le terrain nous a également permis de découvrir que de nombreuses écoles
organisent une journée d’orientation où les enseignants emmènent leurs élèves à la foire des
métiers (gymnasiemässan) à Stockholm.
Par contre, notre étude suggère que les élèves seraient peu au courant des métiers en pénurie.
Malgré une volonté évidente des agents scolaires d’informer correctement les élèves sur leurs
possibilités de carrières scolaires et professionnelles, nous notons une baisse d’intérêt
marquée pour le programme professionnel. Nous suggérons, dès lors, afin d’éviter une
potentielle pénurie, d’informer davantage les élèves sur les métiers porteurs. Hormis un
manque d’information, nous émettons l’hypothèse que cette baisse d’intérêt serait également
le fruit de la valorisation actuelle de la société des savoirs et des métiers liés au secteur
tertiaire.
Outre ce bémol, nous soulignons l’efficacité du modèle suédois en ce qu’il permet aux élèves
de s’épanouir à travers un programme scolaire choisi de leur propre chef. De même, nous
insistons sur l’intelligence du système permettant aux élèves de changer de voie en cas de
fausse route. Il s’agit, selon nous, d’une source d’inspiration en tant que modèle éducatif
reconnaissant le droit à l’erreur de ses élèves et leur accordant le temps nécessaire afin de
s’orienter correctement. Une tendance traversant toutes les couches du système éducatif
suédois. En effet, notre enquête sur le terrain nous a permis à constater que les Suédois se
lançaient tardivement dans des études supérieures. Ceux-ci sont relativement âgés par rapport
aux standards européens (Björklund et al., 2005, p.11). Il est à noter que les services
d’administration des universités privilégient les postulants les plus âgés (p.11). De ce fait, il
n’est pas rare de croiser des étudiants de première année à l’université âgés de 25 ans. Il s’agit
d’une orientation culturellement tardive permettant aux jeunes de découvrir le monde, de
travailler, de s’imprégner du milieu qui les entoure avant de retourner sur les bancs de l’école.
Notre article se limitant aux choix d’orientation dans l’enseignement secondaire, nous ne
poursuivrons pas dans cette voie. Nous souhaitons, néanmoins, mettre en avant un système
permettant aux étudiants de s’engager dans la vie universitaire de manière active et non par
dépit.
46
Conclusion des choix d’orientation en Suède
La réforme du libre choix fut pour le moins radicale. De nombreux observateurs
internationaux la considèrent comme étant une décision politique située aux antipodes des
valeurs défendues par le système social suédois (Böhlmark et al., 2014, p.2). Cette étude
semble confirmer l’acceptation majoritaire de la réforme sous condition que celle-ci soit
limitée. Premièrement, il nous semble honnête que les parents aient le droit de choisir l’école
de leurs enfants. Par ailleurs, nous soulignons l’intérêt de la réforme, en tant qu’elle permit la
diversification du paysage pédagogique avec l’apparition d’écoles à profils spéciaux ou à
pédagogies alternatives. Nous pensons notamment aux écoles dédiées à la musique, au sport,
à l’apprentissage des langues ou encore aux écoles de type Waldorf ou Montessori.
Par contre, l’étude ne confirme pas l’argument selon lequel la compétition entre les écoles
serait gage de qualité en encourageant l’innovation et l’amélioration de ses dernières. Il nous
semble que cette supposition s’appuie sur l’hypothèse que l’enseignement puisse être
envisagé selon un modèle managérial qui assimile « l’offre éducationnelle » à une
marchandise. Nous tenons à rappeler, à cet effet, que le marché de l’éducation est loin d’être
un marché parfait. Un constat supporté par nos différentes lectures. Ainsi Bunar déclarait en
2009 que « les facteurs influençant la compétition ne sont pas tant basés sur la manière
d’enseigner ou d’apprendre mais sont davantage d’ordre social et idéologique » (p.10, trad.
libre). De plus, un rapport de l’OCDE publié en 2015 dévoile, notamment, que les
performances scolaires d’un établissement ne constituent pas le facteur le plus déterminant
dans le choix d’une école (p.95). La présence d’un milieu culturellement reconnaissable
représente, sans nul doute, le facteur exerçant le plus d’influence sur le choix d’une école.
En outre, il semble contraire à l’éthique que des compagnies d’investissement privées soient
autorisées à faire du profit via les écoles privées. Selon Anna Gustafsson, professeur en
linguistique suédoise à l’université de Lund et mère de trois enfants, il serait nécessaire de
durcir la régulation concernant l’obtention de subsides et ce, dans le but d’éviter que des
écoles privées continuent à s’enrichir au profit d’écoles publiques qui se verraient dans
l’obligation de fermer (25 mai 2015). Nous ajoutons, à cet effet, que notre enquête sur le
terrain nous a mené à visiter certaines écoles privées où nous avons été surpris de constater
que les élèves recevaient un ordinateur de type Macbook Pro lors de leur inscription. Une
discussion avec un élève nous a permis de découvrir que celui-ci était offert aux élèves à la
condition de ne jamais être en échec au cours de leur scolarité et de ne pas changer d’école au
cours de leur cursus. Ainsi, les élèves sont attirés à l’aide d’ordinateurs afin de permettre à
47
l’école privée qui les accueille d’obtenir davantage de subsides via le système des chèques
scolaires. De plus, une enquête approfondie des comptes de l’école visitée nous a permis de
découvrir que celle-ci était détenue par un groupe35 gérant près de 15 écoles à travers toute la
Suède et assurant un chiffre d’affaires annuel de 37.365.357 euros (Groupe privé, 2014). Une
somme impressionnante lorsque nous songeons à l’argument des sociétés anonymes en faveur
du libre choix se comparant à des entreprises sociales. Nous soulignons que l’analyse détaillée
des comptes de ladite société nous a permis de constater que le bénéfice pour l’année 2014
remontait à 3.009.086 euros. Nous rejoignons dès lors l’opinion de Gustafsson. En effet, nous
aurions tendance à être en faveur d’une régulation plus stricte des subsides permettant à
l’éducation de rester un lieu d’apprentissage et non une entreprise. Il nous semble que des
établissements scolaires à but lucratif seraient susceptibles d’entrainer de nombreuses dérives
qu’il convient de contrôler via l’instauration de règles plus précises. Le flou juridique
profitant souvent aux entreprises.
Outre l’argument financier, il nous semble que la réforme du libre choix, en laissant libre
cours aux pilotages des parents crée davantage de ségrégation scolaire. Celle-ci permet à
certains parents de profiter entièrement du système en l’utilisant pour se distinguer des
groupes sociaux les moins favorisés (Cowen, 2008, p.33). Un constat partagé par l’OCDE, qui
recommande, dans un rapport publié en 2015, l’amélioration de l’accès à l’information des
familles défavorisées (p.9). Celles-ci doivent pouvoir accéder facilement aux données leur
permettant de poser un choix éclairé. A cet égard, il a été démontré que la probabilité de
choisir une école performante augmente lorsque les familles des classes populaires sont
informées sur les résultats des différents établissements scolaires (Edmark et al., 2014, p.11).
Par ailleurs, certaines expériences locales ont déjà lieu afin de pousser la population a posé un
choix actif. Ainsi, Mats Gerdau, bourgmestre de Naka, a introduit « le libre choix
obligatoire » dans sa commune (Cowen, 2008, p.35). Pour ce faire, il envoie un formulaire
aux parents de la région accompagné d’une brochure décrivant les écoles publiques et privées
de la commune. La brochure redirige les parents vers un site en ligne où ils ont la possibilité
de poser un choix actif :
Je ne place personne dans une école à part mes propres enfants : tous les parents doivent
choisir. A Nacka, nous avons des brochures sur les écoles disponibles en différentes langues et
sur le Web… 90 pourcent des familles font un choix après que la première lettre ait été
envoyée. Après le rappel, environ dix à quinze familles individuelles n’ont toujours pas posé
un choix actif (Gerdau cité par Cowen, 2008, p.35, trad. libre). 35 Au cours de notre visite dans l’école privée, il a été convenu avec le directeur que le nom de son établissement scolaire ne serait pas mentionné dans notre mémoire.
48
Nous l’avons vu lors de notre entretien avec Hallemar, orienter correctement son enfant en
choisissant une école appropriée au développement de ses compétences nécessite un réseau
familial étendu. En encourageant la circulation de l’information, nous pouvons espérer le
développement de sites Internet gérés par les parents permettant de renseigner les familles sur
leurs diverses possibilités.
49
Conclusion générale Partant de l’hypothèse que l’orientation serait susceptible d’intervenir en tant que mécanisme
de ségrégation, nous nous sommes intéressée au phénomène de relégation scolaire en
Belgique francophone. Nous avons émis l’hypothèse que l’orientation des élèves, à partir de
leurs faiblesses scolaires serait conditionnée par une orientation prématurée et la limitation du
nombre de redoublements dans l’enseignement secondaire. Une assomption que notre étude
quantitative semble confirmer. Premièrement, nous avons observé que les élèves de
l’enseignement général seraient davantage satisfaits de leur orientation. Deuxièmement, nous
avons remarqué que les élèves insatisfaits de leur trajectoire scolaire auraient majoritairement
déclaré avoir redoublé une ou plusieurs fois. Enfin, seule une minorité des élèves de
l’enseignement qualifiant aurait déclaré n’avoir, à ce jour, jamais redoublé. Outre la mise en
évidence des obstacles structurels entravant une orientation optimale, notre étude souligne
également les obstacles liés au manque d’information. En effet, notre étude suggère que les
élèves seraient globalement peu au courant des options offertes par l’enseignement qualifiant.
De plus, la majorité des élèves interrogés seraient peu au fait des métiers en pénurie en
Belgique. Ces dernières données semblent confirmer notre assomption de départ et suggèrent
qu’une orientation optimale serait entravée, à la fois, par les obstacles structurels et les
obstacles liés au manque d’information. L’étude du modèle suédois semble également confirmer nos premières hypothèses. Ainsi,
dans un système éducatif où l’orientation est retardée à l’âge de seize ans et où le
redoublement n’existe pas, nous observons une satisfaction plus grande des élèves ayant opté
pour le programme professionnel. En effet, après avoir terminé l’école obligatoire, les élèves
souhaitant poursuivre leur scolarité sont invités à opter pour un programme de nature
académique, visant à la préparation des études supérieures ou une filière professionnelle
permettant l’apprentissage d’un métier. Il est à noter qu’il s’agit d’un processus d’orientation
propre à l’élève et qu’aucun agent scolaire n’est en droit de confisquer ce droit. Selon nos
observations, la configuration du modèle suédois exercerait une influence positive sur l’image
de l’enseignement professionnel. De ce fait, notre étude en Suède suggère que la libre
orientation des élèves bénéficie à la réputation des filières à vocation professionnelle. A cela
nous devons ajouter que les élèves suédois disposeraient d’une meilleure connaissance des
options offertes par l’enseignement professionnel que les élèves belges. Cette dernière
information rappelle l’importance de disposer d’une information adéquate afin de poser un
choix d’orientation positif. Dès lors, notre enquête sur les choix d’orientation en Suède
50
permet d’envisager une porte de sortie aux inégalités scolaires propres au système éducatif en
Belgique francophone.
Néanmoins, notre enquête implique également une mise en garde. Si le modèle suédois
intervient dans notre étude en tant que référent en matière d’équité dans les trajectoires
d’orientation propres à l’affectation d’un programme, l’analyse de la réforme du libre choix
souligne, quant à elle, la réapparition des inégalités scolaires. En effet, en autorisant les élèves
à fréquenter une école se situant en dehors de leur voisinage et en supportant financièrement
la décision de s’inscrire dans une école publique ou privée, l’État suédois espérait endiguer le
phénomène de ségrégation résidentielle. Si notre étude quantitative tend à souligner la
popularité de la réforme en révélant les distances considérables parcourues par les élèves,
notre analyse tend à suggérer que les conditions économiques ne constitueraient pas le seul
frein à une orientation équitable. Nous percevons que la réforme du libre choix, en laissant la
place au développement du pilotage familial, accentue la ségrégation scolaire. Ainsi, les
parents de la classe moyenne en Suède seraient davantage susceptibles de profiter de
l’asymétrie de l’information entre les familles et exploiteraient le système afin de se
différencier des groupes sociaux défavorisés. Ce faisant, la réforme n’aurait non seulement
pas réussi à diminuer les inégalités sociales mais elle aurait, en plus, contribué à la création
d’écoles dites à « drapeau blanc » (Cowen, 2008, p.33, trad. libre). Ainsi l’orientation en tant
que mécanisme de ségrégation se traduirait en Suède par l’affectation d’une école particulière.
Nous percevons l’importance des stratégies familiales permettant d’aller à l’encontre d’un
système qui prévoyait d’améliorer l’égalité des chances de ses élèves.
Ainsi, la compréhension du modèle suédois nous permit de découvrir que les aménagements
structurels ne suffisent pas à éliminer les inégalités scolaires. Nous tirons l’enseignement que
les actions individuelles sont susceptibles de court-circuiter des prises de décisions politiques
en faveur d’un bien-être social collectif. La mixité sociale ne s’imposant pas, nous plaçons
nos espoirs dans l’amélioration de l’accès à l’information des élèves et des familles des
classes populaires. Puisqu’il est plus difficile de modifier la structure d’un système et que la
seule configuration d’un modèle éducatif ne permet pas d’assurer l’équité des élèves, nous
suggérons l’amélioration des services d’informations. Ainsi, les familles des classes
populaires disposeront des données nécessaires afin d’opérer un pilotage optimal permettant
à l’institution scolaire d’assurer, effectivement, une fonction de transformation sociale. Cette
dernière remarque s’adresse à l’ensemble des processus d’orientation étudiés. Il nous semble
que, tant le choix d’un programme scolaire que d’une école, nécessite de disposer des
informations pertinentes au bon moment.
51
Liste des sources Abed. (12 novembre 2014). Interview personnelle, Bruxelles.
André, G. (2012). L’orientation scolaire. Héritages sociaux et jugements professoraux.
Paris : Presses Universitaires de France. Collection « éducation et société ».
Björklund, A., Clark, M., Edin, P.A, Fredriksson et P., Krueger, A. (2005).
The market comes to education in Sweden : an evaluation of Sweden’s surprising
school reforms. New-York : Russell Sage Foundation.
Böhlmark, A., Holmlund, H. et Lindahl, M. (2014). School choice and segregation :
evidence from Sweden. Uppsala : IFAU.
Bourdieu, P. (1994). Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action. Paris: Editions du Seuil.
Bunar, N. (2009). Can multicultural urban schools in Sweden survive the freedom of choice
policy ? The Stockholm University Linnaeus Center for Integration Studies (SULCIS),
Suède.
Cedefop (1999). Vocational education and training in Sweden. Luxembourg : Cedefop.
– (2009). Vocational education and training in Sweden. Short description.
Luxembourg : Cedefop.
– (2014). Initial vocational education and training (IVET) in Europe.
Luxembourg : Cedefop
Cowen, N. (2008). Swedish Lessons : how schools with more freedom can deliver better
education. Londres : Civitas.
Delvaux, B. (2005). Ségrégation scolaire dans un contexte de libre choix et de ségrégation
résidentielle. Dans Demeuse, M., Baye, A., Straeten, M-H., Nicaise, J., Matoul, A.
(Eds), Vers une école juste et efficace : 26 contributions sur les systèmes
d’enseignement et de formation (pp.275-296). Bruxelles : éditions De Boek
Université. Collection «Economie, société, région ».
Demeuse, M et Baye, A. (2005). Equité des systèmes d’enseignement et de formation. Dans
Demeuse, M., Baye, A., Straeten, M-H., Nicaise, J. et Matoul, A. (Eds), Vers une
école juste et efficace : 26 contributions sur les systèmes d’enseignement et de
formation (pp.149-170). Bruxelles : éditions De Boek Université. Collection
«Economie, société, région ».
52
Demeuse, M. (2005). La marche vers l’équité en Belgique francophone. Dans Demeuse, M.,
Baye, A., Straeten, M-H., Nicaise, J. et Matoul, A. (Eds), Vers une école juste et
efficace : 26 contributions sur les systèmes d’enseignement et de formation (pp.191-
216). Bruxelles : éditions De Boek Université. Collection «Economie, société,
région ».
Demeuse, M., Lafontaine, D. et Straeten, M-H. (2005). Parcours scolaire et inégalités de
résultats. Dans Demeuse, M., Baye, A., Straeten, M-H., Nicaise, J. et Matoul, A.
(Eds), Vers une école juste et efficace : 26 contributions sur les systèmes
d’enseignement et de formation (pp. 259-274). Bruxelles : éditions De Boek
Université. Collection «Economie, société, région ».
Edmark, K., Frölich, M. et Wondratschek, V. (2014). Sweden’s school choice reform and
equality of opportunity. Uppsala : IFAU.
Erben. (26 novembre 2014). Interview personnelle, Bruxelles.
Europa (2015a, mise à jour 6 juin). Belgique. Union européenne. Récupéré le 8 juin 2015 de
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/belgium/index_fr.htm
– (2015b, mise à jour 6 juin). Suède. Union européenne. Récupéré le 8 juin 2015 de
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/sweden/index_fr.htm
Eurostat (2011). Dépenses annuelles d’éducation par élève/étudiant par rapport au PIB par
habitant au titre des établissements d’enseignement publics et privés en Europe.
L’Office Statistique de l’Union Européenne. Récupéré le 2 mai 2015 de
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tps0
0069&plugin=1
– (2012). Élèves dans la filière professionnelle de l’enseignement secondaire
supérieur. L’Office Statistique de l’Union Européenne. Récupéré le 1er mai 2015 de
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tps0
0055&plugin=1
Fédération Wallonie Bruxelles (2014a). École de la réussite et organisation en cycles.
Récupéré le 3 mai 2015 de http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=25
– (2014b). Les indicateurs de l’enseignement. Enseignement et recherche scientifique.
Récupéré le 3 mai 2015 de http://www.enseignement.be/index.php?page=27187
– (2014c). L’organisation générale de l’enseignement. Récupéré le 3 mai 2015 de
http://www.enseignement.be/index.php?page=25568
53
Francia, G. (2005). La marche vers l’équité : le modèle suédois. Dans Demeuse, M., Baye, A.,
Straeten, M-H., Nicaise, J., Matoul, A. (Eds), Vers une école juste et efficace : 26
contributions sur les systèmes d’enseignement et de formation (pp.217-232).
Bruxelles : éditions De Boek Université. Collection «Economie, société, région ».
Francia, G., Herrera, L.M et Englund, T. (2005). L’équité dans les pays nordiques : une
réflexion sur la notion d’équivalence dans le système éducatif suédois. Dans Demeuse,
M., Baye, A., Straeten, M-H., Nicaise, J., Matoul, A. (Eds), Vers une école juste et
efficace : 26 contributions sur les systèmes d’enseignement et de formation (pp.171-
190). Bruxelles : éditions De Boek Université. Collection «Economie, société,
région ».
François. (19 novembre 2014). Interview personnelle, Bruxelles.
Groupe privé (2014). Rapport annuel du groupe détenant l’école privée visitée à
Stockholm. Récupéré le 5 mai 2015 de www.infotorg.se
Gustafsson, A. (15 mai 2015). Interview personnelle, Stockholm.
Hallemar, A. (1er juin 2015). Interview personnelle, Stockholm.
Hartman, S. (2007). The development of the Swedish educational system. Dans Carlson, M.,
Rabo, A. et Gök, F., Education in « multicultural » societies : Turkish and Swedish
perspectives. (pp.257-265). Swedish Research Institute in Istanbul vol.18.
Köditz, V. et Peek, R. (2009). How should Europe handle the globalisation ? An educational
perspective : upper secondary education and vocational training. University of
Cologne, Germany.
Kuczera, M., Field, S., Hoffman, N. et Wolter, S. (2008). Learning for jobs. OECD reviews of
vocational education and training. Sweden. Paris : OCDE.
Kuczera, M. (2013). A skills beyond school commentary on Sweden. OECD Reviews of
vocational education and training. Paris : OCDE.
Laurens, S. et Mischi, J. (2011). La division « intellectuel/manuel » ou le recto-verso des
rapports de domination, entretien avec Paul Willis. Dans Apprendre le travail. Revue
Agone. No 46, pp.65-86.
Le Grand, C., Szulkin, R. et Tåhlin, M. (2005). Education and inequality in Sweden : A
literature review. Université de Stockholm, Suède.
Lie, S., Linnakylä, P. et Roe, A. (2003). Northern lights on PISA : unity and diversity in the
nordic countries in PISA 2000. Université d’Oslo, Norvège.
Medhi. (12 novembre 2014). Interview personnelle, Bruxelles.
Meirieu, P. et Guiraud, M. (1997). L’école ou la guerre civile. Saint-Amand-Montrond:Plon.
54
OCDE (2004). What makes school systems perform ? Seeing school systems through the
prism of Pisa. Paris : OCDE.
– (2012a). Études économiques de l’OCDE, Suède. Paris : OCDE.
– (2012b). Equity and quality in education : supporting disadvantaged students and
schools. Spotlight report : Sweden. Paris : OCDE.
– (2013a). Le taux de chômage des jeunes en Belgique. Statistiques de l’Organisation de
Coopération et de Développement Économiques. Récupéré le 1er mai 2015 de
https://data.oecd.org/fr/unemp/taux-de-chomage-des-jeunes.htm#indicator-chart
– (2013b). Le taux de chômage des jeunes en Suède. Statistiques de l’Organisation de
Coopération et de Développement Économiques. Récupéré le 4 mai 2015 de
https://data.oecd.org/fr/unemp/taux-de-chomage-des-jeunes.htm#indicator-chart
– (2014a). Le taux de chômage de la Suède. Statistiques de l’Organisation de
Coopération et de Développement Économiques. Récupéré le 4 mai 2015 de
https://data.oecd.org/fr/unemp/taux-de-chomage.htm
– (2014b). Regards sur l’éducation 2014 : les indicateurs de l’OCDE. Organisation de
Coopération et de Développement Économiques. Récupéré le 8 juin 2015 de
http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
– (2015). Improving schools in Sweden : an OECD perspective. Paris : OCDE.
Örebro (2009). What is a Swedish municipality ? Örebro kommun. Récupéré le 25 juin 2015
de http://www.orebro.se/1383.html
Palheta, U. (2012). La domination scolaire. Sociologie de l’enseignement professionnel et
de son public. Paris : PUF. Collection « Le lien social ».
Plumelle, B. (2011, 17 novembre). L’éducation en Suède. Revue internationale d’éducation
de Sèvres. Récupéré le 26 décembre 2014 de http://ries.revues.org/1316
Sahlgren, G. (2010). Schooling for money : Swedish education reform and the role of the
profit motive. The Institute of Economic affairs (IEA), Londres.
Siep (2015). Les métiers en pénurie. Récupéré le 2 février 2015 de
http://metiers.siep.be/penurie/
Skolverket (2012). Upper secondary school 2011. Agence Nationale Suédoise pour
l’Éducation. Récupéré le 14 mai 2015 de http://www.skolverket.se
– (2014). What types of VET are there in Sweden ? Vocational education and
training in Sweden. Agence Nationale Suédoise pour l’Éducation.
Récupéré le 4 février 2015 de http://www.skolverket.se
55
Souto Lopez, M. et Charlier, J-E. (2010). Quelles sont les représentations des parents,
enseignants, enfants, à l’aube de l’orientation scolaire de niveau secondaire ?
Rapport final d’une recherche commanditée par le CSEF de Charleroi. Université de
Mons, Belgique.
Souto Lopez, M. et Vienne, P. (2011). Comprendre les difficultés des élèves dans le
premier degré de l’enseignement secondaire. Université Catholique de Louvain, UCL
Mons – Groupe de recherche de sociologie, action, sens., Université Libre de
Bruxelles – Centre de Sociologie de l’Education, Belgique.
Swedish Institute (2015). Labour shortage list. Récupéré le 2 février 2015 de
http://work.sweden.se/working-in-sweden/labour-shortage-list/
UNDP (2013). Human development index and its components. Programme des Nations Unies
pour le Développement. Récupéré le 8 juin 2015 de
http://hdr.undp.org/fr/content/table-1-human-development-index-and-its-components
Unesco (2001). Technical and vocational education and training for the twenty-first century.
Unesco Recommendations. Paris : Unesco.
Willis, P. (1978). L’école des ouvriers. Comment les enfants d’ouvriers obtiennent des
boulots d’ouvriers. Marseille : Agone. Collection « L’ordre des choses ».
Youssef. (12 novembre 2014). Interview personnelle, Bruxelles.
57
1. Données publiques les plus récentes pour la Belgique et la Suède
Données publiques les plus récentes Belgique Suède Territoire (km2) (Europa, 2015)
30.528 438.575
Densité habitant/km2 (Europa, 2015)
367,0 22,0
Population (Europa, 2015)
11.203.992 9.644.864
Langues officielles (Europa, 2015)
Néerlandais, Français et Allemand
Suédois
Nature de l'État (Europa, 2015)
Monarchie constitutionnelle parlementaire fédérale
Monarchie constitutionnelle et parlementaire
PIB (2013 - millards d'€) (Europa, 2015)
382,7 420,8
Développement humain (IDH) en 2013 (UNDP, 2013)
0,881 (21e) 0,898 (12e)
Dépenses annuelles d'éducation par élève/étudiant par rapport au PIB par habitant au titre des établissements d'enseignement publics et privés en 2011 (Eurostat, 2011)
27,3% 27,3%
Effectifs scolarisés en pourcentage de la population d’un groupe d’âge donné en 2012 (OCDE, 2014) :
De 5 à 14 ans 99% 99%
De 15 à 19 ans 94% 86% De 20 à 29 ans 33% 36% Espérance de scolarisation de la population âgée de 5 à 39 ans en 2012 (OCDE 2014)
16 ans temps plein 2,6 ans temps partiel
16 ans temps plein 3 ans temps partiel
Jeunes déscolarisés sans emploi (OCDE, 2013)
19% 13%
Taux de chômage chez les jeunes (OCDE, 2013)
24% 16%
Organisation en réseaux (Fédération Wallonie Bruxelles, 2014c)
Enseignement officiel et enseignement libre Ecole publique et école privée
Contexte de « libre choix » scolaire (Francia, 2005, p.228)
Oui Oui
Elèves dans la filière de l’enseignement secondaire supérieur en 2012 (Eurostat, 2012)
72,6% 51,6%
58
2. Portrait supplémentaire – Belgique francophone L’orientation et l’influence de l’environnement social - Portrait de Abed
Abed a 21 ans. Il s’est réorienté dans l’enseignement qualifiant suite à des difficultés
scolaires. Il poursuit actuellement ses études en sixième professionnel en électricité.
J’ai fait ma première et ma deuxième générale et voilà quoi c’était pas pour moi, on va dire. Ils
m’ont conseillé de changer et puis voilà, j’ai été en professionnel de mon plein gré, on va dire.
On m’a proposé électricité. J’ai un oncle à moi qui est électricien et qui m’a conseillé de
continuer. Il m’a dit que c’était un beau métier quand on aimait bien. Enfin, que ça pouvait
être un beau métier, qu’on pouvait bien gagner sa vie. Vu que j’étais encore jeune pour choisir
mon futur métier, on m’a proposé électricité et j’ai dit oui. Au début, j’avais un peu peur, je ne
connaissais pas encore trop le milieu professionnel. Mais voilà, ça fait maintenant quatre ans.
J’ai appris à aimer, j’ai appris à comprendre (Abed, 12 novembre 2014).
Dans un souci de clarté et pour éviter les répétitions, nous ne reviendrons pas sur la
problématique de l’orientation prématurée. Celle-ci a, en effet, déjà été évoquée dans le
portrait de Medhi. La trajectoire scolaire d’Abed a été marquée par de nombreux échecs
scolaires. Ce dernier accuse donc un retard important sur sa formation. Abed déclare avoir
formulé un vœu professionnel différent avant de s’être réorienté, de son plein gré, dans
l’enseignement qualifiant. La formule « Le général, c’était pas pour moi » est familière à de
nombreux élèves ayant redoublé. Selon Paletha, face à un redoublement « nombreux sont
donc les jeunes issus des classes populaires qui auront tendance à se convaincre, peu à peu ou
brutalement que l’enseignement général ne leur conviendrait pas ou qu’ils ne sont tout
simplement pas faits pour les choses scolaires » (2012, p.103). Nous soulignons, une nouvelle
fois, la double fonction du redoublement. Permettant aux jeunes de la classe moyenne
d’approfondir leur année et de rattraper le retard acquis, il signe la fin des espérances scolaires
et le début d’une intériorisation progressive menant à l’auto-éviction de l’enseignement
général des élèves des classes populaires.
Le témoignage d’Abed souligne également la manière dont les jeunes des classes populaires,
parachutés dans un enseignement dont ils ne connaissent rien, ou du moins pas grand chose,
sont davantage susceptibles d’embrasser une filière professionnelle en rapport avec le métier
de l’un ou l’autre des membres de leur famille. Ainsi, les élèves, pris au dépourvu, envisagent
davantage les opportunités de carrière entrant en résonnance avec leur environnement social
direct. L’inspiration peut provenir des parents, des frères, des sœurs, d’un entourage familial
étendu, etc. (2012, p.66). Cette dernière information permet d’expliquer, en partie, pourquoi
59
les choix d’orientation traduisent davantage un mouvement de reproduction plutôt qu’un
véritable changement social.
3. Décentralisation et prise de décisions éducatives en Suède Les prises de décisions éducatives en Suède s’organisent selon trois niveaux : national,
communal, local (école).
Les prises de décisions éducatives suivent un schéma décentralisé permettant aux communes
de participer activement à l’organisation de l’éducation sur leur territoire. Ainsi, le parlement,
le ministère de l’éducation et l’Agence Nationale pour l’Education agissent à un niveau
national en définissant les directives. Ce faisant, ils dressent le cadre dans lequel les activités
éducatives pourront se dérouler. Le programme national fixe les objectifs à atteindre dans
dix-huit sujets obligatoires, il fixe également le nombre minimum d’heures de cours des neuf
années d’école obligatoire (OCDE 2004, p.42).
Les communes décident quant-à-elles de la manière dont elles valoriseront les objectifs
transmis. Elles sont entièrement responsables des tâches administratives et du financement de
l’éducation. Enfin les écoles ont la possibilité d’interpréter et de mettre en application leur
programme afin de satisfaire les exigences nationales (p.22). Ce modèle permet aux autorités
locales de jouir d’une liberté considérable. Ce sont elles qui décident de la manière dont les
directives seront traduites sur le terrain. De même, elles ont la main mise sur les ressources
qu’elles peuvent utiliser et redistribuer à leur gré (Le Grand, Szulkin, Tåhlin, 2005, p.323). Il
est important de préciser que l’autonomie dont dispose les écoles ne leur permet en rien de
modifier le programme national. Elles peuvent, en revanche, organiser et proposer des cours
spécifiques (OCDE 2004, p.22). De même, les écoles peuvent décider de la manière dont les
heures de cours imposées par le programme national seront redistribuées au sein de leur
établissement (p.42).
60
4. Structure des programmes nationaux de l’enseignement secondaire
supérieur en Suède Il existe 18 programmes nationaux : 12 sont à vocation professionnelle et 6 sont des
programmes de préparation aux études supérieures (Skolverket, 2012, p.16, trad.libre).
6 programmes de types académiques préparant aux études supérieures (p.17, trad.libre)
1. Programme des sciences naturelles (NA) – prépare aux études supérieures en
mathématiques, sciences et technologie.
2. Programme des sciences sociales (SA) – prépare aux études supérieures en sciences
sociales, économies et langues.
3. Programme d’économie et de Business Management (EK) – prépare aux études
supérieures en droit, en économie ou dans les sciences sociales.
4. Programme artistique (ES) – prépare aux études supérieures dans les arts ou dans les
sciences sociales.
5. Programme des humanités (HU) – prépare aux études supérieures dans les sciences
sociales et les humanités (études contemporaines, histoire, culture et linguistiques).
6. Programme technologique (TE) – prépare aux études supérieures en technologie et en
sciences naturelles.
12 programmes à vocation professionnelle (p.16, trad.libre)
1. Programme de l’enfance et de récréation (BF) – vise à acquérir des compétences pour
travailler avec des enfants, des jeunes ou des adultes, dans les environnements
pédagogiques et sociaux ou dans les services de la santé, la puériculture et les services
à la personne.
2. Programme en construction et en bâtiment (BA) – vise à acquérir les compétences
nécessaires pour travailler dans le secteur du bâtiment et de la construction, comme
ouvrier, opérateur sur des machines, ouvrier en bâtiment, peintre en bâtiment ou
soudeur
3. Programme en électricité et en énergie (EE) – vise à acquérir des compétences dans
les secteurs des systèmes de production automatisés, des systèmes pour l’énergie et les
technologies liées à l’eau, ou les ordinateurs et les systèmes communicationnels. Les
élèves peuvent également travailler comme électriciens dans la distribution ou
l’installation.
61
4. Programme véhicule et transport (FT) – vise à acquérir des compétences pour
travailler dans la mécanique ou comme conducteur.
5. Programme en business et administration (HA) – vise à acquérir des compétences
dans le commerce comme personnes de vente, acheteurs et gérants de magasin ou dans
le milieu administratif
6. Programme Artisanat (HV) – vise à acquérir des compétences dans les domaines de
fleuristerie, coiffure, menuiserie, textile ou artisanat.
7. Programme hôtel et tourisme (HT) – vise à acquérir des compétences dans le milieu
des hôtels et de l’industrie touristique
8. Programme de technologie industrielle (IN) – vise à acquérir des compétences dans le
secteur de l’automation et l’organisation de production et de maintenance (métal)
9. Programme en utilisation des ressources naturelles (NB) – vise à acquérir des
compétences dans le secteur naturel, avec les plantes, les animaux, la terre, l’eau ou
les forêts comme la production alimentaire, la production de bois ou dans les
environnement horticoles.
10. Programme en gestion hôtelière et en restauration (RL) – vise à acquérir des
compétences dans la restauration et le secteur alimentaire. Par exemple, dans les
restaurants, les pâtisseries ou les boucheries.
11. Programme en maintenance sanitaire (VF) – vise à acquérir des compétences dans les
secteurs de la propreté, la réfrigération, la ventilation, le chauffage et les sanitaires.
12. Programme en soins de santé (VO) – vise à acquérir des compétences pour travailler
dans la santé ou dans les services sociaux.
5. Filières de l’éducation permanente à vocation professionnelle en Suède Les filières d’éducation permanente s’adressent aux adultes âgés d’au moins vingt ans. Elles
se divisent en quatre filières : l’éducation à vocation professionnelle avancée (kvalificerad
yrkesutbildning), l’éducation supplémentaire (kompletterande utbildningar), la formation
post-secondaire (Påbyggnadsutbildning) et les programmes de formation professionnelle
dispensée par les universités populaires (Skolverket, 2007, pp.4-6).
1. L’éducation à vocation professionnelle avancée (kvalificerad yrkesutbildning)
Il s’agit de la plus grande filière d’éducation permanente à vocation professionnelle. En 2005,
elle accueillait près de 27 000 étudiants. Créée en 1996 dans le but de créer une formation qui
rencontrerait les demandes du marché du travail, la filière entraine des spécialistes dans des
62
secteurs variés. Il s’agit d’un programme pouvant durer de une à trois années. Il est à noter
que la plupart des étudiants y consacrent deux années. Au moins, un tiers du programme est
dédié aux stages. Le programme est géré et financé par l’Agence Suédoise pour l’Education
Professionnelle Avancée.
2. L’éducation supplémentaire (kompletterande utbildningar)
Il s’agit d’un programme dispensé en dehors du cadre éducatif dit public. La durée de la
formation varie de 200 heures à deux ou trois ans. Certains programmes sont financés par le
gouvernement, dans d’autres cas, les postulants peuvent demander une assistance financière
propre aux étudiants. Enfin, il existe certains programmes ayant reçu l’aval du gouvernement
mais qui n’offrent pas d’aide financière. Il s’agit d’une filière importante puisqu’elle regroupe
150 formations. Celles-ci sont d’ordre divers. On retrouve par exemple : l’enseignement des
arts, de la musique, du design ou de l’artisanat. Il est à noter que ces programmes d’éducation
supplémentaire ne garantissent pas l’éligibilité des étudiants à poursuivre des études
supérieures. Le programme est davantage présenté comme une formation professionnelle
préparant à des cours en hautes écoles où certaines compétences sont requises.
3. La formation post-secondaire (Påbyggnadsutbildning)
Il s’agit d’un programme dispensant une formation approfondie dans une profession
particulière. Il permet aux postulants de poursuivre leur apprentissage débuté dans
l’enseignement secondaire supérieur et de ce fait, de se spécialiser ou de changer de voie et de
découvrir une nouvelle profession. Ce type de formation dure environ un an et demi. Le
programme est financé par le comité d’éducation permanente des communes.
4. Les programmes de formation professionnelle dispensée par les universités
populaires Il existe 148 universités populaires en Suède. Il s’agit de hautes écoles indépendantes dédiées
à l’éducation des adultes. Chaque école choisit les cours qu’elle désire dispenser. Les
programmes peuvent varier dans la durée. Néanmoins, les formations en un an demeurent
prépondérantes. Celles-ci se focalisent sur un aspect particulier du métier.
Par exemple : spécialisation en artisanat, cours en interprétation du langage des signes, etc.
69
7. Résultats du sondage sur les choix d’orientation en Belgique francophone a. Informations relatives à l’échantillon étudié
53
42
16
23
41
55
30
0
10
20
30
40
50
60
1ère secondaire 2ème secondaire
3ème secondaire
4ème secondaire
5ème secondaire
6ème secondaire
Autre
Année d'étude (en unité)
46% 54%
Sexe (en %)
féminin masculin
70% 14%
16%
Filières d’étude (en %)
Générale Professionnelle Technique
26 24
1 1
19
26
4
25
1
9
16
5
13
20
1
6
12
26
6
10
3 3 3
0
5
10
15
20
25
30
Gén
éral
e
Gén
éral
e
Prof
essi
onne
lle
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Gén
éral
e
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Prof
essi
onne
lle
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Prof
essi
onne
lle
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Prof
essi
onne
lle
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Prof
essi
onne
lle
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Prof
essi
onne
lle
féminin masculin féminin masculin féminin masculin féminin masculin féminin masculin
12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans 18-20 ans Plus de 20 ans
Informations relatives à l’échantillon étudié (en unité)
70
b. Satisfaction du choix d’orientation
18%
82%
27%
73%
26%
74%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Non Oui Non Oui Non Oui
Générale Professionnelle Technique
Satisfaction choix d'orientation par filières d’étude (en %)
20%
80%
Satisfaction choix d'orientation des élèves sondés (en %)
Non Oui
45%
55% 57%
43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Pas doublé Doublé Pas doublé Doublé
Pas satisfait Satisfait
Satisfaction choix d'orientation si doublé (en %)
71
c. Informations relatives à la proximité de l’école fréquentée
d. Informations relatives au nombre de redoublements observés parmi notre échantillon
83%
17%
Votre école se situe-t-elle dans votre quartier (en %)
Non Oui
27%
25% 25%
24%
Distance moyenne parcourue par les élèves (en %)
Moins de 4 km Entre 4 et 10 km
Entre 10 et 15 km Plus de 15 km
50% 50%
91%
9%
97%
3%
98%
2% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui
Moins de 4 km Entre 4 et 10 km Entre 10 et 15 km Plus de 15 km
Distance moyenne parcourue par les élèves (en %)
88%
5% 7%
61%
14% 25% 30% 32% 38% 22%
78% 100%
0% 20% 40% 60% 80%
100% 120%
Gén
éral
e
Prof
essi
onne
lle
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Prof
essi
onne
lle
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Prof
essi
onne
lle
Tech
niqu
e
Gén
éral
e
Prof
essi
onne
lle
Prof
essi
onne
lle
0 1 2 3 4
Non Oui
Avez-vous déjà doublé par filière d'étude? (en %)
72
e. Mesure du sentiment d’information des élèves sondés
f. Mesure du niveau de connaissance des options proposées par l’enseignement qualifiant
18%
36% 28%
11% 7%
16%
43%
27%
8% 5%
19%
50%
19%
5% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0-5 fautes 6-10 fautes 11-15 fautes 16-20 fautes 21-24 fautes
Nombre de fautes obtenues lors du test sur les options offertes par l'enseignement qualifiant par filière d'étude (en %)
Générale Professionnelle Technique
40%
60%
Sentiment d'information (en %)
Non Oui
40%
60%
38%
62%
40%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Non Oui Non Oui Non Oui
Générale Professionnelle Technique
Sentiment d'information par filière d'étude (en %)
73
g. Mesure du niveau de connaissance des métiers en pénurie en Belgique
5%
39% 43%
10% 3%
8%
43% 38%
11%
0%
10%
55%
19% 17%
0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0-5 fautes 6-10 fautes 11-15 fautes 16-20 fautes 21-24 fautes
Nombre de fautes obtenues lors du test sur les métiers en pénurie en Belgique par filière d'étude (en %)
Générale Professionnelle Technique
16
44
27
10 6
30
59
42
15 11
0
10
20
30
40
50
60
70
0-5 fautes 6-10 fautes 11-15 fautes 16-20 fautes 21-24 fautes
Nombre de fautes vs Sentiment d'information (en unité)
Non Oui
4
48
35
15
1
12
61 65
14
5
0
10
20
30
40
50
60
70
0-5 fautes 6-10 fautes 11-15 fautes 16-20 fautes 21-24 fautes
Nombres de fautes vs Sentiment d'information (en unité)
Non Oui
74
h. Consultation PMS et utilité ressentie
I.Visite du Salon SIEP et utilité ressentie
68% 17%
11%
4%
32%
Consultation PMS et sentiment d'utilité (en %)
Pas de consultation de PMS Consultation PMS mais pas utile
Consultation PMS et utile Consultation PMS et sans avis
71%
29%
62%
38%
60%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Non Oui Non Oui Non Oui
Générale Professionnelle Technique
Consulation PMS par filière d'étude (en %)
70% 15%
12%
2%
30%
Visite SIEP et sentiment d'utilité (en %)
Pas de visite du SIEP Visite Siep mais pas utile
Visite Siep et utile Visite Siep et sans avis
75
J. Organisation d’une journée d’information par les écoles des élèves sondés et sentiment d’utilité
k. Principaux critères d’orientation selon les élèves sondés
51% 27%
21%
1%
49%
Organisation de séance d'information et sentiment d'utilité (en %)
Pas de séance d'information Séance d'information mais pas utile
Séance d'information et utile Séance d'information et sans avis
27 19 20 23
74
18
2 6
1 4 3
21
4 4 2 3 5
22
2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
J'ai
cho
isi u
ne fi
lière
ou
une
optio
n qu
i se
trou
vait
dans
J'ai
env
ie d
e po
ursu
ivre
des
ét
udes
uni
vers
itaire
s
Je c
onna
is u
n am
i ou
une
pers
onne
de
ma
fam
ille
qui a
Je n
e sa
is p
as v
raim
ent p
ourq
uoi
j'ai c
hois
i cet
te o
ptio
n
L'op
tion
choi
sie
est e
n lie
n di
rect
av
ec le
mét
ier q
ue je
veu
x fa
ire
Mes
par
ents
ont
cho
isi
J'ai
cho
isi u
ne fi
lière
ou
une
optio
n qu
i se
trou
vait
dans
J'ai
dou
blé
deux
fois
et j
'ai d
u qu
itter
l'en
seig
nem
ent g
énér
al
J'ai
env
ie d
e po
ursu
ivre
des
ét
udes
uni
vers
itaire
s
Je c
onna
is u
n am
i ou
une
pers
onne
de
ma
fam
ille
qui a
Je n
e sa
is p
as v
raim
ent p
ourq
uoi
j'ai c
hois
i cet
te o
ptio
n
L'op
tion
choi
sie
est e
n lie
n di
rect
av
ec le
mét
ier q
ue je
veu
x fa
ire
J'ai
cho
isi u
ne fi
lière
ou
une
optio
n qu
i se
trou
vait
dans
J'ai
dou
blé
deux
fois
et j
'ai d
u qu
itter
l'en
seig
nem
ent g
énér
al
J'ai
env
ie d
e po
ursu
ivre
des
ét
udes
uni
vers
itaire
s
Je c
onna
is u
n am
i ou
une
pers
onne
de
ma
fam
ille
qui a
Je n
e sa
is p
as v
raim
ent p
ourq
uoi
j'ai c
hois
i cet
te o
ptio
n
L'op
tion
choi
sie
est e
n lie
n di
rect
av
ec le
mét
ier q
ue je
veu
x fa
ire
Mes
par
ents
ont
cho
isi
Générale Professionnelle Technique
Choix école secondaire par filière d'étude (en unité)
80
9. Résultats du sondage sur les choix d’orientation en Suède a. Informations relatives à l’échantillon étudié
b. Satisfaction du choix d’orientation des élèves sondés
1
44
4
19 14
6
14
2 2 1 0 5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
Aca
dém
ique
Aca
dém
ique
Prof
essi
onne
lle
Aca
dém
ique
Prof
essi
onne
lle
Aca
dém
ique
Prof
essi
onne
lle
Aca
dém
ique
Prof
essi
onne
lle
Aca
dém
ique
Féminin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin
14-15 ans 16-18 ans 19-20 ans Autre
Informations relatives à l’échantillon étudié (en unité)
7%
93%
Vous sentez-vous satisfaits de votre choix d'orientation ?
(en %)
Non Oui
100% 79%
21%
0%
50%
100%
150%
Oui Oui Non
Académique Professionnelle
Satisfaction du choix d'orientation par filières d’étude (en %)
68,22%
31,78%
Filières d’étude (en %)
Académique Professionnelle
51% 49%
Type d'école (en %)
Ecole publique Ecole privée
81
c. Informations relatives à la proximité de l’école fréquentée
d. Les élèves et le « libre-choix »
82%
18%
Votre école se situe-t-elle dans votre quartier ? (en %)
Non Oui
17%
28%
17%
38%
Distance moyenne parcourue par les élèves (en %)
Moins de 4 km
Entre 4 et 10 km
Entre 10 et 15 km
Plus de 15 km
17%
83% 90%
10%
100% 98%
2% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Non Oui Non Oui Non Non Oui
Moins de 4 km Entre 4 et 10 km Entre 10 et 15 km
Plus de 15 km
Distance moyenne parcourue par les élèves (en %)
45%
20%
35%
54%
38%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Non Sans avis Oui Non Sans avis Oui
Ecole publique Ecole privée
Pensez-vous que le "libre choix" mène à plus de ségrégation? (par type d'école - en %)
82
e. Mesure du sentiment d’information des élèves sondés
f. Mesure du niveau de connaissance des options proposées par l’enseignement professionnel
10%
90%
29%
71%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Non Oui Non Oui
Académique Professionnelle
Sentiment d'information par filière d'étude (en %)
0% 1%
16%
26% 26%
30%
0% 0%
18%
32%
21%
29%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Sans faute 1 faute 2 fautes 3 fautes 4 fautes Plus de 4 fautes
Nombre de fautes obenues lors du test sur les options offertes par l'enseignement professionnel par filière d'étude (en %)
Académique
Professionnelle
0% 2%
18%
29% 29%
22%
0% 0%
15%
27%
19%
38%
0% 5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Sans faute 1 faute 2 fautes 3 fautes 4 fautes Plus de 4 fautes
Nombres de fautes obtenues lors du test sur les options offertes par l'enseignement professionnel par type d'école (en %)
Ecole publique
Ecole privée
83
g. Mesure du niveau de connaissance des métiers en pénurie en Suède
0 0 1 5 5 6
0 1
17
25 21
26
0
5
10
15
20
25
30
Sans faute 1 faute 2 fautes 3 fautes 4 fautes Plus de 4 fautes
Nombre de fautes en relation obtenues lors du test sur les options offertes par l'enseignement professionnel avec le sentiment d'être suffisamment
informé (en unité)
Non Oui
0 1 0 1 3
9 11
13 13 13 12
31
0
5
10
15
20
25
30
35
Sans faute
1 faute 2 fautes 3 fautes 4 fautes 5 fautes 6 fautes 7 fautes 8 fautes 9 fautes 10 fautes Plus de 10 fautes
Nombre de fautes obtenues lors du test sur les métiers en pénurie (en unité)
0% 0% 0% 1% 3% 5%
11%
16% 14%
11% 12%
26%
0% 3%
0% 0% 3%
15%
9%
3%
9%
15%
9%
35%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Sans faute
1 faute 2 fautes
3 fautes
4 fautes
5 fautes
6 fautes
7 fautes
8 fautes
9 fautes
10 fautes
Plus de 10
fautes
Nombre de fautes obtenues lors du test sur les métiers en pénurie par filière d'étude (en %)
Académique
Professionnelle
84
0% 0% 0% 2%
4% 7%
9%
16% 16% 15%
9%
22%
0% 2%
0% 0% 2%
10% 12%
8% 8% 10%
13%
37%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Sans faute
1 faute 2 fautes
3 fautes
4 fautes
5 fautes
6 fautes
7 fautes
8 fautes
9 fautes
10 fautes
Plus de 10
fautes
Nombre de fautes obtenues lors du test sur les métiers en pénurie par type d'école (en %)
Ecole publique
Ecole privée
0 1 0 0 0 0 1 2 1 3 3
6
0 0 0 1 3
9 10 11 12 10 9
25
0
5
10
15
20
25
30
Sans faute
1 faute 2 fautes 3 fautes 4 fautes 5 fautes 6 fautes 7 fautes 8 fautes 9 fautes 10 fautes
Plus de 10
fautes
Nombres de fautes obtenues lors du test sur les métiers en pénurie en rapport avecle sentiment d'être suffisamment informé
(en unité)
Non
Oui
85
h. Mesure des principaux critères invoqués lors du choix d’orientation dans l’enseignement secondaire
2
10
24
2
7
28
10
2 5
17
0
5
10
15
20
25
30
Je c
onna
is q
uelq
u'un
dan
s l'e
cole
, et
c.
Je n
e sa
is p
as v
raim
ent p
ourq
uoi
Je v
eux
étud
ier à
l'un
iver
sité
Mes
par
ents
ont
cho
isi
Ecol
e da
ns la
régi
on
Prog
ram
me
d'ét
ude
Je n
e sa
is p
as v
raim
ent p
ourq
uoi
Mes
par
ents
ont
cho
isi
Ecol
e da
ns la
régi
on
Prog
ram
me
d'ét
ude
Académique Professionnelle
Choix école secondaire par filière d'étude (en unité)
86
Table des matières Introduction 1
Sigles et abréviations 3
Chapitre I Les choix d’orientation dans l’enseignement secondaire en Belgique francophone 4 Introduction 5 Principales caractéristiques du système éducatif belge 5
1. L’obligation scolaire 5 2. La gratuité de l’enseignement 5 3. L’organisation en filières 5
Partie I : Les choix d’orientation en Belgique francophone 6 La relégation scolaire : définition et mécanismes structurels 6
Partie II : Une enquête sur les choix d’orientation en Belgique francophone 10 Méthodologie : une approche à la fois quantitative et qualitative 10 Présentation des principaux résultats du sondage 11 Analyse des principaux résultats du sondage 16 Portraits et analyse du parcours de trois élèves de l’enseignement qualifiant 18
Conclusion Les enseignements du langage, des choix d’orientation connotés 22
Chapitre II Les choix d’orientation dans l’enseignement secondaire en Suède 25 Introduction 26 Mode de fonctionnement et contexte socio-‐économique de la Suède 26
1. Un Etat décentralisé 26 2. Un paysage culturel en pleine mutation 27 3. Un contexte économique stable 28
Principales caractéristiques du système éducatif suédois 29 1. Un héritage luthérien 29 2. Un enseignement gratuit 29 3. Une école élémentaire polyvalente 30
Partie 1: Les choix d’orientation en Suède 31 Un modèle éducatif échappant au phénomène de la relégation scolaire 31 Perception de l’enseignement professionnel 32 La réforme du « libre choix » 33
Partie 2 : une enquête sur les choix d’orientation en Suède 38 Méthodologie 38 Présentation et analyse des principaux résultats du sondage 39 Analyse des résultats du sondage 43
Conclusion des choix d’orientation en Suède 46
Conclusion générale 49
Liste des sources 51
Annexes 56
A travers une enquête sur les choix d’orientation dans l’enseignement secondaire en Belgique
francophone et en Suède en 2015, notre article propose une réflexion sur l’orientation comme
mécanisme de ségrégation. Notre étude se présente sous la forme d’une analyse du
phénomène de relégation scolaire en Belgique francophone et de la réforme du libre choix en
Suède. Ainsi, nous proposons de considérer l’orientation sous son expression la plus étendue.
De ce fait, les choix d’orientation étudiés porteront non seulement sur le choix d’une filière,
qu’elle soit de type académique ou professionnelle, mais aussi sur le choix d’une école en
particulier. De même, nous nous intéresserons aux obstacles structurels et aux obstacles liés
au manque d’information entravant une orientation optimale.
Through a survey on the orientation choices in secondary education in French-speaking
Belgium and Sweden in 2015, our article presents a reflection on the orientation as a
segregation mechanism. Our study presents the analysis of the phenomenon of school
relegation in French-speaking Belgium and the reformation of school choice in Sweden. We
thus suggest to consider the orientation in its widest expression. Therefore, the studied
orientation choices will not only relate to the choice of an educational pathway, irrespective
of the academic or professional type, but also to the choice of a particular school. We will
also be interested in the structural obstacles and the obstacles related to the lack of
information that prevents optimal orientation.
Via een onderzoek van de keuze van studierichting in het secundair onderwijs in Franstalig
België en Zweden in 2015 biedt ons artikel overwegingen over studierichtingen als een een
segregatiemechanisme. Onze studie is een analyse van het schooldegradatie-fenomeen in
Franstalig België en de hervorming van de vrije keuze in Zweden. We onderzoeken
studierichtingen in de breedste zin van het woord. Daarom zullen de onderzochte keuzes van
studierichtingen niet alleen academisch of beroepsgericht zijn, maar we zullen eveneens de
keuze van een bepaalde school onderzoeken. Bovendien zullen we ook de structurele
obstakels en obstakels verbonden aan het gebrek aan informatie bestuderen die een optimale
gerichtheid beletten.