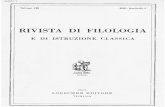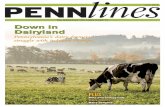N. TRIPPÉ, « Sur une inscription de Cyzique », REA 110 (2008), p. 383-401.
-
Upload
u-bordeaux3 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of N. TRIPPÉ, « Sur une inscription de Cyzique », REA 110 (2008), p. 383-401.
1
SUR UNE INSCRIPTION DE CYZIQUE.
Natacha TRIPPÉ *
Résumé. – Cette étude d’une épigramme de Cyzique, conservée par l’Anthologie Palatine,
s’interroge tout d’abord sur le lieu d’exposition de la pierre, à Cyzique ou à Delphes, avant
d’étudier plus avant les informations qu’elle contient. Il apparaît alors qu’en exposant une
stylis, c’est-à-dire un ornement de trière, la prestigieuse cité de Propontide met en avant sa
puissance maritime, placée sous la tutelle d’Athéna et Apollon.
Abstract. – This study of a Kyzikos epigram, kept by the Anthologia Palatina, first examines
the place where the stone was displayed, in Kyzikos or in Delphi, before going into the
information that lie within. It appears that thanks to the exhibition of a stylis, that is to say a
trireme ornament, the prestigious city of the Propontic coast highlights its maritim strength,
taken under the protection of Athena and Apollo.
Mots-clés. – Epigramme, Cyzique, stylis, culte des Charites, marine.
Une épigramme de l’Anthologie Palatine a très tôt soulevé certaines questions, qui ont été
abordées de manière éparse par différents savants, mais elle n’a jamais fait l’objet d’une étude
particulière qui fît état des riches informations qu’elle contient. Le présent article se propose
de procéder à une mise au point sur les différents problèmes qu’elle soulève, et de mettre en
lumière certains aspects concernant la cité de Cyzique.
Cyzique. Epigramme gravée sur une pierre aujourd’hui perdue. Anonyme. Non datée.
La pierre a été lue dans l’antiquité, mais est aujourd’hui perdue.
Ed. Anthologia Graeca ad fidem codicis olim Palatini nunc Parisini, F. Jacobs, Leipzig, 1813 ; Anthologie
Grecque, VI 342, où elle figure avec la notice suivante : «éανçαθηµα τ)))))ï)η é Aθηνï)α ̟αρàα τ)ων Kυζικην)ων » (édition et
traduction de P. Waltz); Anthologia Graeca, H. Beckby, Munich, 1957-1958 ; G. Roux, « Deux riches offrandes
dans le sanctuaire de Delphes », Journal des Savants, 1990, p. 221-245 ; R. Merkelbach- J. Stauber,
Steinepigramme aus dem griechischen Osten, Tome 2, 2001, « Die Nordküste Kleinasiens (Marmarameer und
Pontos) », 08/01/02.
Cf. L. Robert, BCH 102, 1978, p. 476, repris dans Documents d’Asie Mineure, Athènes-Paris, 1987, p. 172 ; J. et
L. Robert, Bull. 1978, 393.
* Doctorante à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Je tiens à remercier chaleureusement M. Michel Sève pour les conseils archéologiques qu’il m’a généreusement donnés, ainsi que M. Laurent Dubois et M. Pierre Fröhlich pour leurs relectures attentives.
2
( Aθρησον Xαρçιτων &υ̟àο ̟αστçαδι τ)ïαδε τριçηρους
στυλçιδιον, ̟ρçωτας το)υθë &υ̟çοδειγµα τçεχνας.
Tαçυταν γàαρ ̟ρçωταν ̟οτë éεµçησατο Παλλàας é Aθçανα,
4 τçανδε ̟çολει καλàαν éαντιδιδο)υσα χçαριν,
ο"υνεκεν &υψçιστïα Tριτωνçιδι νηàον (ετευξεν
Kçυζικος "αδë &ιρï)α ̟ρ)ωτον éεν é Aσιçαδι.
∆ε)ιγµα δàε καàι ̟λçινθων χρυσçηλατον (ηγαγεν (αχθος
8 ∆ελφçιδα γ)αν, Φοçιβïω τçανδë éενçε̟ουσα χçαριν.
Traduction:
Regarde sous ce portique des Charites cette petite stylis1 de trière, ce modèle d’un savoir-faire originel : ce
savoir-faire originel en effet, c’est Pallas Athéna qui l’imagina autrefois, et qui en fit cadeau à la cité, beau
témoignage de sa reconnaissance, parce que c’est en l’honneur de la toute-puissante Tritonide que cette cité de
Cyzique avait, pour la première fois dans l’Asie sacrée, bâti un temple. Et comme autre preuve visible de ce
qu’elle savait faire, c’est une charge de briques d’or forgé2 qu’elle (Cyzique) convoya en terre delphique, pour
proclamer ainsi sa reconnaissance à Phoibos.
Notes sur la traduction :
v. 1 : l’impératif aoriste montre bien qu’il ne s’agit pas exactement d’une dédicace comme l’indique le lemme du
livre VI de l’Anthologie, mais plutôt d’une épigramme épidictique décrivant un objet et ayant pour but d’attirer
le regard du passant sur ce dernier. L’utilisation du démonstratif τ)ïαδε renforce évidemment cette interprétation.
v. 2 : Pour &υ̟çοδειγµα, les dictionnaires Bailly et Liddell-Scott-Jones donnent comme traduction « modèle,
exemple », en citant notre épigramme et Pollux 3, 17, 8. P. Chantraine, dans son Dictionnaire étymologique,
traduit le terme par « signe, modèle, exemple », en indiquant qu’il se trouve plutôt à l’époque hellénistique, et
qu’il est considéré comme peu attique. A.K. Orlandos et I. N. Travlos3 lui donnent pour synonyme δε)ιγµα
(c’est-à-dire « échantillon, spécimen, prélèvement »), σχçεδιον (« esquisse, croquis, dessin, plan, tracé, ébauche,
projet, modèle »), ou encore ̟ρçοτυ̟ον (« modèle, original, patron »). M.-Chr. Hellmann4 précise que le terme
est rare, qu’il désigne un « schéma » dans un passage de la Septante, mais que dans une inscription de Kymé en
Eolide5 il équivaut à ̟αρçαδειγµα. Ce dernier peut désigner un modèle en grandeur nature, ou bien une maquette
1 Nous choisissons volontairement pour le moment de ne pas traduire ce terme sur lequel nous reviendrons. Ce terme, diminutif de στυλçις, est mis en évidence par son rejet en début de vers, et est explicité ensuite par &υ̟çοδειγµα. 2 Nous avons choisi de traduire littéralement, mais il s’agit bien évidemment de lingots d’or. 3 A. K. ORLANDOS, I. N. TRAVLOS, ΛEΞIKON APXAIWN APXITEKTONIKWN, collection de la Bibliothèque de la
Société archéologique d’Athènes, tome 94, 1986. 4 M.-Chr. HELLMANN , « Termes d’architecture grecque », in D. KNOEPFLER (éd.), Comptes et inventaires dans la cité grecque, Actes du colloque international d’épigraphie tenu à Neuchâtel du 23 au 26 septembre en l’honneur de J. Tréheux, Genève 1988, p. 239-261. 5 H. MALAY , « Three decrees from Kyme », EA 2, 1983, p. 2 (SEG 33, 1040), l. 9-10 ; M.-Chr. HELLMANN , Choix d’inscriptions architecturales grecques, Lyon 1999, n° 26 ; O. PICARD, « Monétarisation et économie des cités grecques à la basse époque hellénistique : la fortune d’Archippè de Kymè », in R. DESCAT (éd.), « Approches de l’économie hellénistique », Saint-Bertrand-de-Comminges 2006 (Entretiens d’Archéologie et d’Histoire, 7) (voir aussi A. BIELMANN , Femmes en public dans le monde hellénistique, Paris 2002, n° 32 ; I. SAVALLI -LESTRADE, in
3
(c’est-à-dire un modèle réduit), ou encore un dessin6. Nous proposons donc de traduire le terme υ̟çοδειγµα par
« modèle » en y voyant un modèle réduit, une maquette de la stylis, interprétation renforcée par le suffixe de
diminutif -ιον. L. Robert, quant à lui, dans les Documents d’Asie Mineure7 traduit ainsi cette expression par
« modèle du début de l’art », en précisant : « Tel est le sens plutôt que primitif. C’est à l’origine de l’art ». Nous
avons, comme nous l’avons dit, proposé de voir dans le terme modèle, le sens concret de modèle réduit, et nous
avons fait le choix de traduire τçεχνα par « savoir-faire », et de mettre ainsi en avant, plus que le caractère
artistique de cette invention, son caractère technique, tout en ne perdant pas l’idée d’origine qui apparaît dans
l’adjectif ̟ρ)ωτος.
v. 4 : le préverbe du participe montre bien qu’il est question ici d’un contre-don. Cyzique a honoré la déesse
Athéna d’un culte, et en échange la déesse fait don de cette technique à la cité.
v.7-8 : ces deux vers ont posé un réel problème aux différents traducteurs car on peut en effet éprouver quelques
difficultés à les rapprocher de ce qui précède. Après l’invention de la stylis, il est fait mention maintenant de
lingots offerts à Delphes. Il est par ailleurs difficile de traduire le καçι 8. L’hypallage, qui fait porter l’adjectif
χρυσçηλατος sur le neutre (αχθος et non sur ̟λçινθων, participe en outre de la préciosité de l’épigramme.
L’utilisation de l’accusatif directif après (ηγαγεν relève d’un usage poétique (cf Eschyle, Perses, v. 8629.)
Notes sur la langue :
Curieusement, il n’y a dans l’ensemble que peu d’ionismes (hormis &ιρ)ïα), alors que Cyzique est une colonie
milésienne ; et l’on constate dans cette épigramme la présence de nombreuses formes doriennes : τ)ïαδε, τçεχνας,
ταçυταν, ̟ρçωταν, é Aθçανα, ταçνδε, &υψçιστïïα, γ)αν. Mais ces dorismes semblent être ici artificiels, car ils n’affectent
que les désinences. Ils sont utilisés surtout pour « colorer » le texte, en conformité avec une mode littéraire mise
à l’honneur à l’époque alexandrine par Théocrite, Callimaque ou Léonidas de Tarente.
Par conséquent, en raison du thème développé dans l’épigramme et des marques dialectales qui la ponctuent,
mais aussi des jeux sur les mots10, il est à penser qu’elle réunit les caractéristiques de la poésie alexandrine, ce
qui suggère une date vers la fin du IIIe, ou le début du IIe siècle av. J.-C.
1. - UN HYMNE À LA PUISSANCE MARITIME DE CYZIQUE
Il apparaît nettement que cette épigramme est composée de deux parties. Alors que le
sens du dernier distique est difficile à saisir, les six premiers vers forment incontestablement
une unité, en célébrant la gloire nautique de Cyzique, cité très présente sur la scène maritime,
du fait de sa configuration exceptionnelle en presqu’île. Cyzique disposait en effet de
La Grèce au féminin, Paris 2003, p. 282-292). Pour restaurer le toit du bouleutèrion financé par Archippè, les architectes sont choisis en fonction du modèle qu’ils présentent, c’est-à-dire d’une maquette (après 133 av. J.-C.) 6 Voir aussi M.-Chr. HELLMANN , Recherches sur le vocabulaire de l’architecture grecque, d’après les inscriptions de Délos, Athènes-Paris 1992, p. 316-321 et L’architecture grecque I, Les principes de construction, Paris 2002, p. 38-39. 7 L. ROBERT, Documents d’Asie Mineure, Athènes-Paris 1987, p. 172. 8 Cf. Infra. 9 « νçοστοι δëéεκ ̟ολçεµων / éα̟çονους éα̟αθε)ις <éανçερας> ε!υ ̟ρçασσοντας !αγον ο"ικους. » « Nos retours de la guerre ramenaient (imparfait dorien) nos hommes, en bonne santé et indemnes, dans des maisons prospères. » (texte établi et traduit par P. MAZON, CUF, 1931). 10 Notamment sur l’adjectif ̟ρ)ωτος , et le terme χçαρις qui désigne tour à tour la reconnaissance et les Grâces.
4
différents ports qui offraient aux navires des mouillages sûrs11. Apollonios de Rhodes
mentionne deux ports à Cyzique : lors de leur escale dans la cité, les Argonautes mouillent
dans un port situé à l’ouest, qui semble se diviser en un avant-port, appelé le Kαλàος Λιµçην
(« le Beau Port »), et le Xυτàος Λιµçην (« le Port entouré de jetées »12). Ces deux ports seraient
donc situés dans le golfe d’Artakè. D’après Apollonios, le port situé à l’est de l’isthme est
appelé le Λιµàην Θρηçικον (le Port Thrace). Un décret de Cyzique en l’honneur d’Apollonis13
mentionne encore un autre port, le Grand Port (Mçεγας Λιµçην) que M. Sève propose
d’identifier avec le port Ouest. De toute évidence ces ports confèrent un statut stratégique
particulier à la ville, ainsi que plusieurs possibilités de mouillage pour les navires, en fonction
de l’orientation des vents. Par la suite, un bassin central a été creusé, à la fin du règne de
Tibère, sous l’entreprise d’Antonia Tryphaina, afin d’éviter le contournement difficile de la
presqu’île14.
Cette stylis de trière est donc un rappel symbolique de la gloire nautique de Cyzique.
La déesse Athéna a inventé cet élément, et en a fait cadeau à la cité de Cyzique, car cette
dernière est la première qui, en Asie, lui ait élevé un temple. Il est donc fait référence au rôle
de patronne des arts de la déesse Athéna dans le domaine nautique, mais aussi et surtout à son
intelligence pratique, sa µ)ητις, grande caractéristique de cette déesse, comme le montre la
présence de l’aoriste du verbe µçηδοµαι qui exprime la conception par l’intelligence15.
2. - LIEU DE CONSERVATION DE LA PIERRE ET DE LA MAQ UETTE : ÉTAT DE
LA QUESTION.
S’il est clair que les six premiers vers de l’épigramme sont un hymne en l’honneur de
la gloire nautique de la cité de Cyzique, le sens du dernier distique apparaît en revanche plus
difficilement. On a longtemps pensé en effet que les deux derniers vers étaient interpolés. 11 Les ports de Cyzique ont fait l’objet de nombreuses études : F. W. HASLUCK, Cyzicus, Cambridge 1910, p. 3-5 ; R. DE RUSTAFJAELL, JHS 22, 1902, p. 174-183 ; K. LEHMANN-HARTLEBEN, Die antiken Hafenanlagen des Mittelsmeeres, Leipzig 1923 ; E. DELAGE, La géographie dans les Argonautiques d’Apollonios de Rhodes, Paris 1930 ; L. ROBERT, Hellenica X, 1955, p. 122-125 ; Hellenica XI-XII, 1960, p. 265 ; voir aussi M. SÈVE, « Un décret de consolation à Cyzique », BCH 103, 1979, p. 327-359, notamment p. 349-351. Discussion approfondie dans P. SCHLOSSER, La Propontide et les détroits dans l’Antiquité : histoire d’un espace maritime, thèse soutenue à Metz le 17 novembre 2006, p. 223-231. 12 E. Delage traduit par « port clos », ce qui se rapproche du sens, mais cette traduction ne rend pas compte de l’étymologie. Littéralement il s’agit d’un port « qui procède de l’amoncellement de terre ou de rochers destinés à former des digues ». Il s’agit donc d’un port artificiel. 13 M. SÈVE, « Un décret de consolation à Cyzique », BCH 103, 1979, p. 327-359. 14 Cf. Syll3 799, II. 15 Athéna se caractérise en effet par son intelligence technique. Cf M. DETIENNE et J. -P. VERNANT, Les ruses de l’intelligence. La mètis des Grecs, Paris 1974, notamment p. 224-227, sur le rôle d’Athéna dans le domaine maritime et la construction navale : « Qu’il s’agisse d’un char, d’un araire ou d’un bateau, la compétence d’Athéna s’étend aux différentes phases du travail du bois : abattage des arbres, polissage des planches, et ajustement des différentes pièces de la charpente, toutes opérations qui exigent une égale mètis » (p. 226).
5
Dans son édition de l’Anthologie grecque, P.Waltz16 précise que, dans le dernier distique, le
texte et le sens sont « extrêmement douteux », notamment pour le sens à accorder au terme
δε)ιγµα. P. Waltz le traduit de la façon suivante : « Et cette cité a encore envoyé à Delphes,
comme spécimen, une charge de briques dorées, pour exprimer hautement sa reconnaissance à
Phébus ». Pour J. et L. Robert, δε)ιγµα est un échantillon de lingots d’électrum, alliage d’or et
d’argent qui constitue le plus ancien monnayage de Cyzique17. Dans la traduction de
R. Merkelbach- J. Stauber, le mot δε)ιγµα est ainsi traduit : « Beweis des Dankes », donnant
ainsi au terme son sens de démonstration de gratitude. Enfin, G. Roux pense que le terme
δε)ιγµα reprend l’&υ̟çοδειγµα du deuxième vers, et désigne le « modèle », à savoir le stylidion,
privé de son préfixe pour des raisons métriques18. Le καçι coordonnerait ainsi δε)ιγµα et ((αχθος :
la cité de Cyzique aurait convoyé à Delphes non seulement la maquette de la stylis, mais aussi
une charge de lingots d’électrum : « Modèle et cargaison de lingots façonnée en or, elle les a
elle-même transportés sur la terre delphique (…) »19. G. Roux voit dans cette charge de
lingots ce qui va servir de socle à la maquette, faisant le rapprochement avec le socle de
briques d’or et d’électrum sur lequel reposait le lion d’or offert par Crésus à l’Apollon de
Delphes20. Dès lors, pour G. Roux, c’est à Delphes qu’était conservée la stylis, offrande
disparue, dont seule l’épigramme atteste l’existence. G. Roux rejoint sur ce point d’autres
commentateurs, comme P. Waltz qui notait dans son édition du texte en 1931 : « Le dernier
distique prouve que l’offrande décrite aux v.1 sq. avait été déposée à Delphes et non à
Cyzique, comme l’ont cru la plupart des commentateurs ; sans quoi la pièce serait tout à fait
incohérente. Le « portique des Grâces » devait faire partie d’un « trésor » de Cyzique,
qu’aucun écrivain ne signale, mais dont l’existence était fort probable, vu l’importance du
culte d’Apollon Delphinien à Cyzique. »21. P. Waltz est suivi par H. Beckby, qui qualifie
l’épigramme de « Inschrift aus Delphi »22. Mais, alors que ses prédécesseurs voyaient
l’offrande exposée dans un portique ou un monument, comme un trésor, construits à Delphes
16 Anthologie grecque, première partie : Anthologie Palatine, texte établi et traduit par P. WALTZ, Belles Lettres, Paris 1931. 17
J. et L. ROBERT, Bull. 1978, 393 : « L’épigramme rappelle à la fin la consécration par l’envoi à Delphes d’une autre invention due à Cyzique, en échantillon, ̟λçινθων χρυσçηλατον ((αχθος, c’est-à-dire une charge de lingots d’électron, le métal dont le monnayage faisait la fortune de Cyzique et dont elle a pu s’attribuer l’invention. » ; L. ROBERT, Documents d’Asie Mineure, p.172, note 109. 18
G. ROUX, « Riches offrandes dans le sanctuaire de Delphes », JS 1990, p. 222-223 : « Il est clair en effet que l’ &υ̟çοδειγµα du vers 2 et le δε)ιγµα du vers 7 (ce dernier privé de son préfixe pour les commodités de la métrique) désignent un seul et même objet, le stylidion de la première trière, « prototype », « modèle » des stylides des futures trières helléniques ». 19 Traduction de G. Roux, ibid. p. 233. 20 Ibid. p. 223. 21
P. WALTZ, Anth. Pal. VI, 342, note 4. 22
H. BECKBY, Anthologica Graeca I, p. 674.
6
par la cité de Cyzique23, G. Roux va plus loin : le terme pastas, où est exposé l’objet, n’est
pas à comprendre au sens habituel de portique, mais est à rapprocher plutôt des rites du
mariage, où pastas peut effectivement désigner un baldaquin dans la chambre nuptiale.
G. Roux affirme ensuite que par une série de glissements sémantiques, le terme pastas a pris
le sens de « chambre nuptiale », puis d’habitation de la femme, puis le sens de temple de la
déesse de l’amour, à savoir Aphrodite24. Les Grâces étant les compagnes d’Aphrodite, il n’est
alors pas étonnant qu’elles logent aussi dans un endroit nommé pastas. Or l’auteur note à
juste titre qu’on ne connaît à Delphes aucun temple des Charites ou d’Aphrodite.
L’expression ̟ αστàας τ)ων Xαρçιτων serait alors à comprendre comme une métaphore désignant
le temple d’Apollon, lieu où étaient conservées les marques de reconnaissance (les χçαριτες)
des cités envers le dieu. Les Charites mentionnées au premier vers seraient donc la
personnification de la reconnaissance des Grecs et des Barbares envers le dieu de Delphes.
L’hypothèse de G. Roux est assurément séduisante, mais elle repose sur des arguments
qui sont difficilement acceptables. Son hypothèse a, comme il l’affirme lui-même25, le mérite
de relier adroitement au reste de l’épigramme le dernier distique dont l’interprétation est
difficile ; il est en effet plus facile de voir dans le καçι tout simplement la conjonction de
coordination, mettant sur le même plan δε)ιγµα et ((αχθος, ce qui signifierait effectivement que
la cité de Cyzique aurait convoyé à Delphes les lingots et le δε)ιγµα. Mais nous ne pensons pas
comme G. Roux que ce terme puisse reprendre l’&υ̟çοδειγµα mentionné plus haut dans le
poème, car l’argument de la métrique qui conduirait le poète à lui ôter son préfixe ne nous
paraît guère convaincant. Il faut au contraire revenir au sens premier de δε)ιγµα, c’est-à-dire
celui de « preuve », « ce qui est donné à voir ». Il est dès lors impossible de voir dans le καçι
la conjonction de coordination, mais bien plutôt l’adverbe, et plus précisément la particule
combinée δàε καçι. Dans cette juxtaposition des deux particules, δçε a ici son rôle habituel de
liaison avec ce qui précède, mais il est renforcé par le καçι adverbial, qui ajoute à la transition
une idée d’addition26, qu’il faut rendre en traduisant les deux particules par « aussi » ou,
23 Il s’agirait alors d’un trésor encore inconnu, ou d’un trésor qui ferait partie des quelques trésors anonymes de Delphes. 24 Ibid. p. 231 : « Par extensions progressives, le mot passe de ce sens précis à ceux de chambre nuptiale, puis de cour à péristyle de la maison, puis d’habitation de la femme aimée, vierge, épouse ou courtisane, enfin de temple de la déesse qui préside aux noces et à l’amour sous toutes ses formes, Aphrodite ». 25 Ibid. p. 223. 26
J. D. DENNISTON, The Greek Particles, Oxford 1934, p. 305-306. C’est cette même particule qui est utilisée par exemple dans l’inscription des Mystères d’Andanie (N. DESHOURS, Les Mystères d’Andanie, Bordeaux 2006) pour relier entre elles les différentes clauses du serment prêté par les hiéroi et les hierai ( § 1, l. 5, l. 8). Dans le paragraphe 2, les hiéroi doivent aussi transmettre à leurs successeurs le coffret et les rouleaux donnés par Mnasistratos, « et qu’ils transmettent aussi tous les autres instruments qui ont été prévus pour le développement des mystères » (̟αραδιδçοντω δàε καàι τàα λοι̟àα "οσα §αν κατασκευασθε)ι χçαριν τ)ων µυστηρçιων).
7
comme nous l’avons proposé, par l’adjectif « autre ». L’utilisation de ces deux particules
combinées insiste sur les deux techniques dont est particulièrement fière la cité de Cyzique :
non seulement elle est la cité qui a la première utilisé la stylis, don d’Athéna, mais elle est
aussi celle qui possède le prestigieux monnayage d’électrum.
Par ailleurs, la démonstration de G. Roux concernant le terme de pastas ne semble pas
très satisfaisante. Ce terme architectural recouvre effectivement des réalités différentes : il
peut désigner à la fois un vestibule, un portique, mais aussi, dans certains textes relatifs à la
cérémonie du mariage, « une structure démontable en bois du type tente ou dais, revêtue d’un
tissu luxueux, voire une sorte de baladaquin à colonnettes »27. Or l’épigramme étudiée étant
éloignée de tout contexte nuptial, il semble que ce soit l’un des deux premiers sens qu’il faille
retenir. Dès lors, si pastas employé dans l’épigramme devait désigner le temple d’Apollon, ce
ne serait pas, comme l’affirme G. Roux, parce que les Grâces, liées à Apollon, séjourneraient,
au même titre qu’Aphrodite, dans une sorte de baldaquin nuptial, mais davantage parce que,
par une sorte de synecdoque, la colonnade péristyle désignerait le temple tout entier. Mais
même si nous pensons, avec G. Roux, qu’il y a bien dans l’épigramme un jeu sur le terme
χçαρις, désigner le temple d’Apollon à Delphes par l’expression ̟ αστàας τ)ων Xαρçιτων nous
paraît trop énigmatique, et pas assez explicite pour le passant qui lit l’épigramme28. Nous
pensons par conséquent, avec L. Robert, que cette épigramme était conservée non pas à
Delphes mais à Cyzique : l’importance maritime de la cité d’une part, et la mention d’un
Charitésion dans une autre inscription de Cyzique d’autre part, rendent très probable
l’exposition de cette stylis dans la prestigieuse cité de Propontide29.
3. - UNE « PIÈCE DE MUSÉE » CONSERVÉE DANS LE PORTIQUE DES
CHARITES À CYZIQUE.
Dans leur notice30, J. et L. Robert rapprochent l’épigramme de Cyzique d’un autre
document provenant de la même cité, publié par E. Schwertheim31, puis par M. Sève32. Il
27
M.-Chr. HELLMANN , Recherches sur le vocabulaire de l’architecture grecque, d’après les inscriptions de Délos, Athènes-Paris 1992, p. 325-327. 28 Même s’il est vrai que dans certaines pièces de l’Anthologie Palatine le terme pastas peut désigner par métaphore la colonnade d’un temple péristyle et le temple lui-même (cf. VI 172, v. 5), il ne demeure pas moins qu’il paraît très difficile de considérer les Charites du v. 1 comme l’ensemble des offrandes se trouvant dans le temple d’Apollon. 29 Un argument de nature grammaticale vient encore renforcer cette hypothèse : l’utilisation du démonstratif τï)αδε au v. 1 indique que l’épigramme et l’objet se trouvent dans le portique où se tient le passant qui lit l’épigramme. Le fait qu’au v. 4 on ait simplement la mention ̟çολει, sans autre précision, montre que le portique des Charites se trouve bien dans cette cité, dont le nom est cité deux vers plus loin : Cyzique. 30 Bull. 1978, 393. 31
E. SCHWERTHEIM, « Ein postumer Ehrenbeschluss für Apollonis in Kyzikos », ZPE 29, 1978, p. 213-228.
8
s’agit d’un décret de consolation, daté par M. Sève du deuxième quart du Ier siècle ap. J.-C.
Ce décret est voté par le peuple et les résidents romains de Cyzique en l’honneur d’Apollonis.
En raison des bienfaits qu’elle a rendus à la cité, un certain nombre d’honneurs sont accordés
à la défunte : ses funérailles sont nationales, elle sera enterrée vêtue d’une tunique pourpre à
l’intérieur de l’enceinte de la cité, elle sera honorée d’une couronne, et une agalmatothèque
sera construite dans le Charitésion (l. 57-59), où sera exposée sa statue :
κατασκευçασαι δàε αéυτ)ης καàι éαγαλµατοθçηκην²éεν τ)ïω Xαριτησçιïω,
εéισερχοµçενων éεκ τ)ης &ιερ)ας éαγορ)ας éεν δεξι)ïα, éεν è ïη καàι éαναστ)ησαι
αéυτ)ης (αγαλµα.
Qu’on lui construise aussi une agalmatothèque au Charitésion, à droite en entrant quand on vient de l’agora
sacrée, où l’on consacrera une statue d’elle33.
L’hapax éαγαλµατοθçηκη fait surgir quelques questions : dans son édition, E. Schwertheim
considérait l’agalmatothèque comme une base ou une exèdre. M. Sève y voit plutôt « une
construction couverte, ouverte en façade où mettre la statue à l’abri et sans doute en
valeur »34, interprétation confirmée par M.-Chr. Hellmann35. Le mot θççηκη se trouve en
composition au second membre dans un grand nombre de composés désignant des
« magasins, des boîtes, des meubles, etc… »36 où l’on dépose une collection d’objets ou un
objet particulier. La définition d’éαγαλµατοθçηκη serait « un endroit où on range une statue »37.
Plus qu’une niche recreusée dans le mur, M. Sève voit plutôt derrière cette appellation une
sorte de présentoir, qui mettrait ainsi la statue d’Apollonis en valeur : « il ne peut s’agir ici
d’une niche installée dans un mur déjà existant, d’exécution difficile, et le verbe implique une
construction complète ; c’est un édicule indépendant »38.
Même s’il paraît peu probable que la stylis, objet en bois, ait été exposée dans une
construction du même type que l’agalmatothèque d’Apollonis, il est tout à fait possible en
revanche que ce petit mât de navire ait été accroché sur le mur de fond du portique des
32
M. SÈVE, « Un décret de consolation à Cyzique », BCH 103, 1979, p. 327-359. 33 Traduction de M. Sève légèrement modifiée. 34
M. SÈVE, loc. cit. p. 345. Par ailleurs, il reste à Philippes, dans la Curie, ce qui semble à M. Sève être l’équivalent exact de l’agalmatothèque de Cyzique : il s’agit d’un baldaquin, comportant deux colonnes corinthiennes sur piédestal mouluré, un entablement et une frise. Cette construction abritait la statue assise de la Fortuna. Cf. M. SÈVE, « L’œuvre de l’Ecole française d’Athènes à Philippes pendant la décennie 1987-1996 », TO APXAIOΛOΓIKO EPΓO ΣTH MAKE∆ONIA KAI ΘPAKH 10 B, 1996, p. 705-715. 35
M.-Chr. HELLMANN , in Comptes et inventaires dans la cité. (cf note 5) Le mot est un hapax qui serait un synonyme de éανδριαντοθçηκη attesté à Aphrodisias comme niche à statues. 36
P. CHANTRAINE, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, article θçηκη. 37 Ce terme n’apparaît pas non plus dans le dictionnaire Grec-Espagnol, mais il apparaît en revanche dans le supplément du LIDDELL -SCOTT de 1996 avec la traduction suivante : « a place for a statue », avec un renvoi au décret de consolation de Cyzique. 38 M. SÈVE, BCH 103, 1979, p. 345. En revanche J.-Ch. MORETTI (« Les inventaires du gymnase de Délos », BCH 121, 1, 1997, p. 125-152) a montré que dans les inventaires du gymnase de Délos il est fait mention de statuettes dans des niches (éεν θυρçιδι), dont on a un exemple dans le mur oriental de la Palestre du lac (fig. 1).
9
Charites à Cyzique. L’exposition de trophées navals est bien attestée en Grèce, comme le
montre la dédicace du Portique des Athéniens à Delphes, indiquant que les Athéniens avaient
offert les ornements de navires (éακρωτçηρια) et les cordages qui y étaient exposés39. Toujours
à Delphes, dans l’Oikos à l’Est sur la Terrasse d’Attale, A. Jacquemin et D. Laroche ont pu, à
la suite d’un nouvel arrangement des blocs conservés, conclure que les encoches apparaissant
dans les blocs pouvaient tout à fait convenir à des traces de fixation pour des stylides de
navires, au nombre de sept40. Ce n’est pas en tant que trophée pris sur un quelconque ennemi
que ce stylidion est exposé dans le Portique des Charites à Cyzique, mais davantage en tant
qu’objet prestigieux, parce qu’ancien. Ce modèle réduit de stylis, qui va devenir un des
éléments majeurs de la trière, est en effet une pièce d’une très haute antiquité, comme se plaît
à le montrer l’auteur de l’épigramme, en insistant sur l’adjectif ̟ρçωτας : offert en contre-don
à la cité par la déesse Athéna elle-même dans un temps fort éloigné, cet objet revêt une
importance toute particulière. Cette épigramme épidictique évoque à la fois la grande valeur
de ce modèle réduit que les Cyzicéniens ont pu ensuite reproduire à grande échelle, et une
autre τçεχνη que possède la cité, celle du monnayage d’électrum. Elle rappelle au passant
l’origine prestigieuse de cette stylis, décrite presque comme une « pièce de musée » : en
réaffirmant le prestige de la cité, l’exposition de cet objet affirme la place de Cyzique dans un
passé mythique (la primauté du lien entre la cité et Athéna), qu’elle contribue à rendre vivant
dans la mémoire collective de ses habitants.
Le portique des Charites serait alors une sorte de musée, tout comme ont pu l’être les
temples des dieux, comme l’illustre la Chronique du temple d’Athéna à Lindos41 : les
colonnes B et C de la chronique, qui recensent les offrandes avec le nom de leurs donateurs
ainsi qu’une courte « bibliographie », mettent l’accent sur la très haute antiquité des objets, le
plus ancien remontant au héros éponyme Lindos, avant la guerre de Troie42. Comme le
39 Cf. G. KUHN, « Untersuchungen zur Funktion der Säulenhalle V », JDAI 100, 1985, p. 269-287. 40 A. JACQUEMIN et D. LAROCHE, « Les piliers attalides et la terrasse pergaménienne à Delphes », RA 1990, p. 219-220 et « La terrasse d’Attale I revisitée », BCH 116, 1992, p. 229-258 : « L’accrochage d’objets verticaux (hampe, mât) rendrait particulièrement bien compte de la forme différenciée de ces encoches : un ancrage profond en partie haute, un simple encastrement oblique en partie basse. L’hypothèse d’un accrochage de stylides de navires, trophée courant pour une victoire navale, nous semble rendre bien compte de ce système de mortaises. », p. 241. 41 Chr. BLINKENBERG, Lindos II n° 2, Copenhague 1941 ; plus récemment, C. HIGBIE, The Lindian Chronicle and the Greek Creation of their Past, Oxford 2003. Notamment p. 249 : « For Lindians, as for other Greeks, the preservation of the past was inescapably linked to objects, because the presence of a significant weapon, votive, or building could be used to justify the vision of the past held by a town or a sanctuary. » 42 L’intitulé même insiste aussi sur l’ancienneté de ces offrandes : « éε̟εàι τàο &ιερàο]ν τ)ας é Aθçανας τ)ας Λινδçιας éαρχαιçοτατον τε καàι éεντιµçο[τα]τον &υ̟çαρχον ̟ολλο)ις κ[αàι καλο)))ις éαναθçεµασι éεκ ̟αλαιοτ]çατων χρçονων κεκçοσµηται διàα τàαν τ)ας θεο)υ éε̟ιφçανειαν… »
10
montre J. Shaya dans un article récent43, le temple de Lindos est, plus que le trésor du dieu, un
musée de la communauté, qui rappelle l’histoire de la cité, depuis les temps les plus anciens.
A Cyzique, c’est le portique des Charites qui pourrait bien jouer ce rôle, en exposant des
objets remontant à un âge mythique, qui contribuent à accroître le prestige de la cité. Il faut
aussi rappeler que la période hellénistique, qui voit la création de la Bibliothèque
d’Alexandrie à l’initiative de Ptolémée Ier Sôter, est celle de l’émergence de la notion d’un
passé qu’il faut conserver, et d’un foisonnement culturel, où, dans le domaine de la littérature,
sont particulièrement en faveur les récits d’aitia, qui inscrivent justement le présent d’une cité
dans la continuité de son passé mythique. Ce stylidion est donc moins une offrande qu’une
sorte de relique, dont l’origine remonte loin dans la conscience des Cyzicéniens, et dont la
présence leur rappelle le glorieux passé de leur cité.
Le décret de consolation publié par M. Sève précise que l’agalmatothèque pour
Apollonis se trouvait dans le Charitésion, sur la droite de l’entrée qui donne sur l’agora
sacrée:
« (…)éεν τ)ïω Xαριτησçιïω, εéισερχοµçενων éεκ τ)ης &ιερ)ας éαγορ)ας éεν δεξι)ïα »
« au Charitésion, à droite en entrant quand on vient de l’agora sacrée » (l. 57-59).
Cette indication permet de comprendre deux choses : tout d’abord que le sanctuaire des
Charites bordait l’agora sacrée, ou du moins n’en était guère éloigné ; et ensuite qu’il y avait
au moins deux accès au Charitésion, car s’il est nécessaire de préciser que l’agalmatothèque
se trouve à droite quand on vient de l’agora sacrée, c’est donc qu’on pouvait entrer dans le
Charitésion par une autre entrée. Notre épigramme mentionnant quant à elle le portique des
Charites, il paraît alors inévitable de placer ce dernier dans le sanctuaire des Charites. Le
Charitésion était donc ouvert aux citoyens de Cyzique qui pouvaient y admirer les statues et
les objets qui y étaient exposés. Aristote insiste en effet sur la dimension de réciprocité et
d’échange du culte des Charites, et précise que c’est pour cette raison que leur sanctuaire est
en accès libre pour les citoyens44. Le Charitésion est par conséquent un lieu de communauté
43
J. SHAYA, « The Greek Temple as Museum : The Case of the Legendary Treasure of Athena from Lindos », AJA 109, 2005, p. 423-442. Voir aussi N. MASSAR, « La "Chronique de Lindos" : un catalogue à la gloire du sanctuaire d’Athéna Lindia », Kernos 19, 2006, p. 229-243. 44 Arist., Ethique à Nicomaque, V 8, 1132b-1133a : « Mais dans les communautés fondées sur l’échange, la cohésion est assurée par cette forme du juste qu’est la réciprocité, selon la proportion, mais non selon l’égalité : l’action de réciprocité proportionnelle maintient l’unité de la cité. (…) Or c’est l’échange de bienfaits qui maintient l’unité. Voilà pourquoi on a donné libre accès au sanctuaire des Grâces : pour favoriser l’échange de bienfaits qui est la fonction de la « grâce ». Il faut en effet rendre service en échange du bienfait qu’on a eu la grâce de vous accorder et, inversement, avoir la grâce de prendre l’initiative d’un bienfait. ». Trad. J. Defradas, Coll. Agora, 1992.
11
entre les citoyens, une sphère du don et de l’échange. En outre le fait que le Charitésion de
Cyzique ne se trouve guère éloigné de l’agora montre la dimension éminemment politique du
culte, en tant que symbole de l’unité entre les citoyens. Ainsi, à Athènes en 229 av. J-C. un
nouveau sanctuaire consacré au Démos et aux Charites est construit au Nord-Ouest de l’agora,
symbole de la cité redevenue indépendante, après la période de sujétion à la Macédoine45.
Pratiquer le culte des Charites est aussi le moyen pour la communauté civique d’exprimer sa
reconnaissance envers les dieux, comme le montre notre épigramme qui met en avant la
reconnaissance des Cyzicéniens envers Athéna et Apollon. Ansi les habitants de Cyzique
pouvaient pénétrer dans le Charitésion, symbole de l’identité de la cité et de son unité, et
admirer sous le portique des « reliques » et des statues consacrées, et être ainsi sensibles au
sentiment d’émulation lorsqu’ils voyaient la statue d’Apollonis et au passé prestigieux de leur
cité lorsqu’ils se tenaient en face de cette stylis.
Le décret publié par M. Sève est donc un argument capital qui permet d’étayer
l’hypothèse selon laquelle cette épigramme épidictique n’était pas conservée à Delphes, mais
bien à Cyzique, sous le portique des Charites, dans le Charitésion.
4. - PRESTIGE ÉCONOMIQUE DE LA CITÉ DE CYZIQUE.
Cette épigramme étant conservée à Cyzique, le dernier distique prend dès lors tout son
sens : tandis que les premiers vers célèbrent la gloire maritime de la cité, les deux derniers
célèbrent une autre invention due à la cité : celle du monnayage d’électrum, comme l’a
supposé L. Robert. L’épigramme rappelle la puissance maritime de la cité mais aussi sa
puissance économique, s’il est vrai que les lingots convoyés à Delphes sont des lingots
d’électrum. Cet alliage d’or et d’argent fort apprécié commença à être frappé à Cyzique au
VIe siècle av. J.-C., et s’épanouit à l’époque classique46. L’emblème de la cité, le thon, dont
les bancs, venant du Pont-Euxin, ne cessaient de passer au large de la presqu’île, et qui
constituait une ressource économique importante, apparaît donc invariablement sur le
monnayage d’électrum de la cité.
En revendiquant l’antiquité du culte d’Athéna et le fait que ce fut à Cyzique que pour
la première fois en Asie la déesse fut honorée, la colonie milésienne s’affirme pleinement en
tant que cité grecque. Elle veut se rapprocher de la Grèce continentale en créant un lien de
45 Chr. HABICHT, Athènes hellénistique, Paris 2006, p. 201-202. Voir aussi Ph. GAUTHIER, Les cités grecques et leurs bienfaiteurs, BCH Suppl. 12, 1985, p. 65-66 ; V. AZOULAY , Xénophon et les grâces du pouvoir. De la charis au charisme, Paris 2004, p. 52 sq. 46 BMC Mysia ; B. V. HEAD, Historia Numorum, 1911, p. 522-526 ; L. MILDENBERG, « The Cyzicenes : a Reappraisal », AJN, ser. 2, 5-6, 1993-1994, p. 1-12.
12
« parenté » cultuelle : Athènes est la cité grecque qui honore Athéna sur le continent grec, et
Cyzique en est le parallèle en Asie Mineure. Mais comme le précise L. Robert, Cyzique « a la
modestie de ne pas contester la primauté du lien d’Athènes avec Athéna. » C’est aussi dans
cette intention qu’il faut voir l’offrande prestigieuse à Delphes, qui entre dans la tradition des
offrandes extraordinaires faites à Delphes: en faisant une telle offrande, Cyzique rappelle que
le culte d’Apollon, transmis par sa métropole Milet, est particulièrement important, comme
l’atteste le monnayage de la cité où le dieu accompagne Korè Soteira, divinité principale47.
Mais il est à noter aussi que le culte d’Artémis Pythiè48, dont l’épiclèse est formée sur le
toponyme ancien de Delphes, culte lui aussi transmis par la métropole milésienne (plus
précisément Didymes), atteste également le lien étroit de Cyzique avec Delphes. La soudaine
allusion à Delphes devient dès lors très claire : cette épigramme affirme le lien privilégié entre
la cité de Cyzique et la déesse Athéna d’une part, et la cité de Delphes, par le truchement
d’Apollon et d’Artémis, d’autre part.
5. - LE CULTE DES CHARITES ET D’ATHÉNA À CYZIQUE.
Notre épigramme et le décret de consolation publié par M. Sève mentionnent un
portique des Charites et le sanctuaire des Charites. Ces deux indications attestent donc la
présence d’un culte rendu à ces divinités à Cyzique, culte assez important pour qu’elles aient
leur propre sanctuaire et, comme le souligne M. Sève, qu’il soit en outre suffisamment grand
pour recevoir l’agalmatothèque d’Apollonis49, et évidemment le portique où est exposée la
stylis. Les Charites sont à l’origine des déesses de la végétation et de la croissance, mais elles
ont aussi été associées à la formation des jeunes gens50 et à la concorde civique51. Leur culte
est assez répandu dans le monde grec52 : les sources littéraires attestent la présence de ce culte
à Orchomène de Béotie tout d’abord, où pour la première fois un culte en l’honneur des
Charites aurait été instauré, à Sparte et Athènes, en Arcadie, à Paros et dans sa colonie
47 Pour exemple, cf. BMC Mysia, monnaie en bronze de Cyzique, n° 132, 330-280 av. J.-C. : au droit Korè Soteira avec le thon, au revers Apollon assis sur l’omphalos, tenant dans sa main droite une patère. 48 Le décret en l’honneur d’Apollonis mentionne aux lignes 60 et 62 des ΠυθαÔιστρçιδες, qui sont, comme l’a bien montré M. Sève, des femmes qui honoraient Artémis Pythiè. Le culte d’Artémis Pythiè n’est par ailleurs attesté qu’à Didymes et dans les colonies milésiennes, comme Apollonia du Pont et Olbia. 49 En outre il est probable que le sanctuaire ait eu au moins deux accès. Cf supra. 50 Cf. Serment des éphèbes à Athènes où elles sont invoquées avec d’autres dieux dont Hestia, Aglauros, Enyô, Enyalios, Arès, Athéna Areia et Zeus. Cf. L. ROBERT, Etudes épigraphiques et philologiques, Paris 1938, p. 296-307. 51 Cf. supra. 52 Pour le culte des Charites, voir E. SCHWARZENBERG, Die Grazien, Bonn 1966 ; M. ROCCHI, « Contributo allo studio delle Charites I », Studii Classice 18, 1979, p. 5-16 et Studii Classice 19, 1980, p. 19-28 ; V. PIRENNE-DELFORGE, « Les Charites à Athènes et dans l’île de Cos », Kernos 9, 1996, p. 195-214.
13
Thasos, et en Asie Mineure53. Il est très rare que ces divinités possèdent un sanctuaire en
propre, excepté à Elis et Hermionè d’après Pausanias, à Paros54. Habituellement, ces divinités
de la nature et de la fécondité sont associées à d’autres divinités, principalement Aphrodite
Pandémos, Hermès et Dionysos, dont elles partagent le téménos. Or ce ne semble pas être le
cas à Cyzique : le décret de consolation mentionne le sanctuaire des Charites, et non des
Charites accompagnant une autre divinité.
La divinité principale de Cyzique est bien connue, par divers types de sources,
notamment les monnaies : Korè y porte l’épiclèse de Soteira55. La ville de Cyzique aurait été
donnée en dot par Zeus à Korè56, et les Cyzicéniens, d’après un oracle rendu par l’Apollon de
Delphes57, auraient été les premiers à offrir des sacrifices à Korè. Mais, d’après notre
épigramme, les Cyzicéniens auraient été aussi les premiers à avoir offert un culte à Athéna. Or
le culte d’Athéna à Cyzique n’est que peu attesté. Notre épigramme mettrait donc en lumière
le culte d’Athéna à Cyzique, qui serait d’une haute antiquité et qui aurait été sous toute
vraisemblance importé à Cyzique par les colons milésiens58.
6. - LA STYLIS.
La stylis a été inventée par Athéna, qui en a fait cadeau à la ville de Cyzique pour
l’avoir honorée la première sur le continent asiatique. Cet aition n’est pas sans rappeler le rôle
important de la déesse dans l’expédition des Argonautes : c’est elle qui planta sur le navire
Argô qui menait les Argonautes en Colchide, plus précisément à la proue, dans l’étrave, une
hampe divine, faite du bois d’un chêne sacré de Dodone, dotée de la parole, qui conseillait et
protégeait l’équipage :
Apollonios de Rhodes, Argonautiques, I, 526-527 :
Σµερδαλçεον δàε² λιµàην Παγασçηιος éηδàε²καàι αéυτàη
Πηλιàας (ιαχεν ëAργàω éε̟ισ̟çερχουσα νçεεσθαι.
é Eν γçαρ ο&ι δçορυ θε)ιον éελçηλατο, τàο &ρéé éανàα²µçεσσην
53 Orchomène : les Charites à Orchomène semblent être des divinités des sources, des nymphes. Paus. IX 37, 3, et 38, 1. Athènes et Sparte : Paus. IX 35, 1 et III, 18, 16. Arcadie : Paus. VIII 34, 3. Paros et Thasos : Apoll. 3, 15, 7 et IG XII 5, suppl. 206, IG XII 8, 358 et Et. Thas. XIV (Stèle du Port). 54 E. SCHWARZENBERG, op. cit. p. 4-7. 55 Les monnaies portent au droit le buste de Korè, couronnée d’épis, accompagnée parfois du thon, et l’inscription ΣWTEIPA. Cf BMC Mysia, n° 125, 132, 175, 176, 178, à partir du début du IV e siècle av. J.-C. 56 Appien, Mithr. 75, 323. 57 L. ROBERT, BCH 102, 1978, p. 466, repris dans Documents d’Asie Mineure, 1987, p. 156-164, l. 1-6 : ²&ο θεàος (εχ[ρησε. Kυζικηνο)ις, ο''ι éε̟ιτετελçεκα[ντι κατçççç éενιαυτàον ?] τàα² Σωτçηρια ̟ρ)ατ[οι τ)αι Kçοραι] τ)αι Σωτεçιραι καλ)ως [καàι εéυσεβε]- ως καàι εéυτυχ)ως. 58 Le culte d’Athéna à Milet est l’un des plus anciennement attestés.
14
στε))ιραν é Aθηναçιη ∆ωδωνçιδος ²&çηρµοσε φηγο)υ. Tout à coup un cri terrible jaillit du port des Pagases et d’Argô elle-même, enfant du Pélion, qui hâtait le
départ. En effet un tronc divin avait en elle été enfoncé, qu’Athéna avait tiré d’un chêne de Dodone pour
l’adapter au milieu de l’étrave.
L’épigramme reprend donc le motif de la déesse Athéna protectrice du navire et des marins.
Elle a offert à la cité de Cyzique sous forme de modèle réduit ce qui va devenir la stylis une
fois que les habitants de Cyzique l’auront reproduite en grandeur réelle. Mais, comme l’a
souligné L. Robert59, cette épigramme n’est jamais mentionnée dans les études sur la marine
grecque ou la stylis en particulier. J. Svoronos60 a consacré un important article aux termes
servant à désigner les différentes parties d’un navire grec et leurs représentations sur les
monnaies. Il rappelle tout d’abord les différents avis des numismates à propos d’une hampe
cruciforme que tient dans la main gauche la Nikè sur les statères d’or d’Alexandre61.
E. Babelon identifia cet instrument avec l’objet présentant la même forme que l’on voit très
souvent planté à la poupe sur les représentations de trières grecques62, et que les Anciens
nomment stylis. Pour Babelon, la Nikè sur ces monnaies tiendrait donc dans sa main gauche
une stylis de trière. Or le terme stylis, dans son sens nautique, n’est guère attesté dans les
sources littéraires, hormis chez les lexicographes :
Hésychius, s. v. στυλçις, µçερος τι τ)ης &ηµιολçιας νεçως.
Stylis : composant d’une hémiolia63.
Pollux, Onomasticon I, 90, dans une description des aplustres qui ornent les poupes des
navires de guerre:
« τàα δàε ((ακρα τ)ης ̟ ρçυµνης éç(αφλαστα καλε)))ιται è ων éεντàος ξ)υλον éορθàον ̟ çε̟ηγεν, 'ο καλο)υσι στυλçιδα, οè υ τàο éεν µçεσω
κρεµçαµενον &ρçακος ταινçια éονοµαζçεται »
« Les extrémités de la poupe s’appellent aplustres, au milieu desquels est enfoncé debout un morceau de bois
qu’on appelle stylis. Le morceau d’étoffe qui pend en son milieu est appelé bandelette. »
59 Bull. 1978, 393. 60 J. N. SVORONOS, « Stylides, ancres hierae, aphlasta, stoloi, ackrostolia, embola, proembola et totems marins », Journal International d’Archéologie numismatique, 16, 1914, p. 81-152. 61 Droit : tête d’Athéna à droite. Casque corinthien à triple aigrette. Revers : Nikè portant dans la main gauche une hampe cruciforme et dans la main droite une courone de feuillage. Voir plus récemment, G. LE RIDER, Alexandre le Grand. Monnaie, finances et politique, Paris 2003, p. 27-28 et p. 182 sq. L’auteur associe la représentation de la stylis à une victoire navale d’Alexandre lors de la prise de Tyr en 332, et non à la victoire de Salamine en 480 ou au franchissement de l’Hellespont en avril 334. 62 E. BABELON, La victoire sur les monnaies d’or d’Alexandre le Grand, 1891. E. Babelon a également repris entièrement cette question dans « La stylis attribut naval sur les monnaies », RN, 11, 1907, p. 1-39 = Mélanges numismatiques, IVe série, p. 149-237. 63 Sur les hemiolia, voir V. GABRIELSEN, The naval aristocracy of Rhodes, Studies in Hellenistic Civilization VI, 1997, p. 87-88 : il s’agit d’un navire à 30 ou 50 rameurs, disposés sur une rangée et demi de chaque côté.
15
Didyme (chez Eusthate, scholie Od. 714) : selon lui on nommait aplustre
« τàο éε̟àι τ)ης ̟ρçυµνης éανατεταµçενον εéις '"υψος éεκ κανονçιων ̟λατçεων éε̟ικεκαµµçενων, διçηκοντος διç αéυτ)ων
κανονçιου [éωνοµασµçενου µàεν θρονçι<τ>ου], éε̟ερεισµçενου [δàε] τοçυτïω στυλçισκου (ο̟ισθεν το)υ κυβερνçητου.
Kρεµçαννυ[ν]ται δàε éεκ τ)ων κανονçιων καàι το)υ θρονçιου ταινçια[ι], εéις ̟αρçασηµον δηλαδàη τ)ης νηçος »
« [L’aplustre est] l’objet qui s’élève haut sur la poupe, fait de règlettes déployées et recourbées, au travers
desquelles passe une règle64 [qu’on appelle le petit trône], à laquelle est fixée solidement une colonnette
derrière le timonier. De ces règles et du petit trône pendent des bandelettes, qui servent assurément d’emblème
au navire. »
S’il est évident que le δçορυ θε))ιον mentionné par Apollonios de Rhodes est enfoncé dans
l’étrave et se trouve donc à la proue, toutes les informations sur la stylis quant à elles
concernent la poupe. Hésychius ne donne aucun renseignement quant à la fonction ou la
forme de la stylis. En revanche la description de Didyme est très claire : l’aplustre termine la
poupe ; il est composé de l’extrémité des ais du bordé du navire formant un éventail,
solidarisés entre eux par une autre pièce de bois qui a la forme d’une règle. A cette règle est
fixée une « petite colonne », c’est-à-dire une stylis qui sert à arborer l’enseigne du navire.
Pollux explique aussi que la stylis est une pièce de bois verticale, à laquelle on suspend une
sorte de pavillon. De ces témoignages littéraires il ressort assurément que la stylis se situe
bien à la poupe du navire (la trière), qu’elle est fixée à l’aplustre et qu’elle a essentiellement
une valeur décorative : elle permet de hisser le pavillon du navire. Un passage de Plutarque
met également en lumière le rôle d’enseigne de la stylis :
Plutarque, Pompée, Chapitre 24, 4 :
!ην δàε καàι ναçυσταθµα ̟ολλαχçοθι ̟ειρατικàα καàι
φρυκτçωρια τετειχισµçενα, καàι στçολοι ̟ροσçε̟ι̟τον
οéυ ̟ληρωµçατων µçονον εéυανδρçιαις οéυδàε τçεχναις
κυβερνητ)ων οéυδàε τçαχεσι νε)ων καàι κουφçοτησιν
éεξησκηµçενοι ̟ρàος τàο οéικε)ιον (εργον, éαλλàα το)υ
φοβερο)υ µ)αλλον αéυτ)ων τàο éε̟çιφθονον éελçυ̟ει καàι
&υ̟ερçηφανον, στυλçισι χρυσα)ις καàι ̟αρα̟ετçασµα-
σιν &αλουργο)ις καàι ̟λçαταις éε̟αργçυροις, "ωσ̟ερ
éεντρυφçωντων τ)ïω κακουργε)ιν καàι καλλω̟ιζοµçενων.
64 Le sens de « petite règle » n’est pas complètement satisfaisant. Il s’agit d’une pièce de bois rectiligne destinée à maintenir entre eux des bordés qui n’avaient à cet endroit plus d’appui dans la membrure du bateau.
16
« Il existait en beaucoup d’endroits des mouillages pour les bateaux des pirates et des postes fortifiés de
signalisation ; ils ne disposaient pas seulement pour attaquer d’escadres, qui, par l’importance des équipages,
l’habileté des pilotes, la rapidité et la légèreté des embarcations, étaient bien adaptées à leur tâche : ce qu’il y
avait là de redoutable était encore moins affligeant que l’appareil odieusement fastueux de ces stylis dorées, de
ces tapis de pourpre, de ces rames plaquées d’argent, comme si les pirates s’enorgueillissaient et étaient fiers de
leur malfaisance65. »
On voit bien dans cette description que la stylis, qui est une sorte de « petit mât d’artimon » à
l’arrière du navire, a pour but ici d’intimider les autres navires en arborant les « flammes » et
les couleurs du bateau.
Certains commentateurs ont pensé que la petite colonnette qu’est la stylis servait à soutenir
l’aplustre, lorsque celui-ci décrivait une ample courbure au-dessus de la poupe66. Cela peut
paraître possible, étant donné que les lexicographes décrivent cet élément comme une pièce
de bois fichée entre les planches de l’aplustre. L’aplustre étant déjà attesté chez Homère67, il
serait néanmoins étonnant que les anciens marins aient fait évoluer la forme de l’aplustre au
point qu’il risquât d’en être moins solide et d’être soutenu par une colonne de bois. A partir
du VIe siècle av. J.-C. la poupe se termine effectivement en un assemblage de planches de
bordés qui se déploient en éventail (c’est-à-dire l’aplustre), mais sur les représentations de
cette époque on ne voit nulle part la présence d’une stylis qui viendrait soutenir cet aplustre.
Nous ne pensons donc pas comme E. Babelon, qui s’est appuyé sur l’étymologie du
terme pour lui donner le sens d’étai, qu’il s’agisse d’une colonnette fonctionnelle soutenant
l’aplustre. Il est en effet assuré que le terme stylis est un diminutif dérivé de στ)υλος, construit
sur la racine du verbe "ιστηµι68.
Si l’on prend en compte le témoignage des lexicographes, l’étymologie du mot ainsi
que les représentations figurées, on se rend compte en effet que la stylis n’est en réalité pas
65 Trad. CUF R. FLACELIÈRE et A. CHAMBRY , hormis pour le terme stylis que nous préférons laisser sous sa forme grecque. 66 E. BABELON, « La stylis attribut naval sur les monnaies », RN, 11, 1907, p. 1-39 : « Quand l’aplustre est très développé, qu’il décrit une ample courbe et que les planches qui le composent sont articulées et ont leurs volutes mobiles, épanouies en éventail, il a besoin d’un étai qui, planté sur le pont, et muni d’une ou même de deux traverses, en soutient les éléments. C’est cet étai que, me conformant à la définition classique, j’ai appelé stylis ; et en effet, d’après son étymologie grammaticale, le mot στυλçις signifie essentiellement un étai, un support, en forme de colonnette (de στυλçοω) ». 67 Hom. Il . XV, 716-717 : " Eκτωρ δàε ̟ρçυµνηθεν éε̟εàι λçαβεν οéυχι µεθçιει,ô ((αφλαστον µετàα χερσàιν (εχων, Tρωσàιν δàε κçελευεν. « Hector a saisi une poupe et ne la lâche pas : il en tient l’aplustre embrassé et lance un appel aux Troyens ». Trad. P. Mazon, CUF. 68 Racine indo-européenne *st-eH2 signifiant « être debout ». στυλçις viendrait donc de cette racine au degré zéro avec élargissement en *u, guère explicable, d’après le Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Dès lors il n’y a pas à chercher dans l’étymologie autre chose que le sens de « être debout » tiré de "ιστηµι, et le nom στυλçις n’est en aucun cas un déverbatif venant de στυλçοω.
17
destinée à soutenir l’aplustre69. Les représentations les plus claires de la stylis sont celles d’un
relief de Lindos datant du IIe siècle av. J.-C. représentant la poupe d’un navire, ayant servi de
base à la statue de bronze d’un marin70, et de graffites retrouvés dans la maison du Dionysos à
Délos71, où l’on s’aperçoit effectivement que la stylis ne semble jouer qu’un rôle décoratif.
Par ailleurs, dans son ouvrage sur la marine antique72, L. Casson considère l’apparition de la
stylis consécutive à la disparition des sortes de « turbans » qui étaient enroulés autour de
l’aplustre des navires du VIe siècle. Avec l’apparition de la trière au VIe siècle, les ornements
du navire sont situés non plus en haut de l’aplustre, mais autour de la stylis elle-même.
Il semblerait cependant étrange que la cité de Cyzique eût exposé sous un portique un
petit mât qui n’aurait pour d’autre fonction que d’arborer les couleurs du navire. Cela est
d’autant plus étonnant que notre épigramme qualifie la stylis de τçεχνη, ce qui implique
indubitablement qu’elle ait un rôle technique dans le gréement du navire, et non pas
seulement décoratif.
Mais la légende du navire Argô autorise une interprétation : la stylis serait le mât où
les marins avaient la possibilité de suspendre l’emblème de la divinité tutélaire du navire, qui
conseille et protège l’équipage. Cela est bien visible dans les Argonautiques : la hampe faite
dans le bois d’un chêne sacré de Dodone est plantée à la proue et protège l’équipage. En
faisant fonction de bout-dehors la stylis jouerait le même rôle, mais elle se situe à la poupe.
Elle serait en quelque sorte l’« âme » du navire, placé ainsi directement sous la protection de
la divinité. Cette interprétation est en outre tout à fait autorisée du fait qu’Athéna elle-même a
offert cet attribut à la cité de Cyzique, comme pour lui donner protection et prospérité sur
mer. Les éléments des navires ont été souvent représentés sur les monnaies, que ce soient
l’aplustre, le gouvernail ou la proue. D’après les numismates, ces éléments symboliseraient la
prospérité de la cité dans le domaine maritime. C’est tout à fait le cas ici : le prototype de la
stylis est exposé à Cyzique73, non seulement en tant que partie de la poupe d’un navire, mais
aussi et surtout parce qu’en reproduisant cet instrument et en l’installant sur leurs bateaux, les
Cyzicéniens ont pu développer leur flotte et acquérir une réelle puissance maritime.
69 En outre le sens de « soutien de l’aplustre » a été alimenté par une mauvaise leçon du manuscrit d’Eustathe qui cite Didyme où il est écrit, à la place de éε̟ερεισµçενου [δàε] τοçυτïω στυλçισκου, «&υ̟ερεισµçενου τοçυτïω στυλçισκου » de &υ̟ερεçιδω : soutenir, étayer par-dessous. 70 Chr. BLINKENBERG, Lindos, 1941. 71 J. CHAMONARD, Le quartier du théâtre, Exploration archéologique de Délos, 1922, fasc. 8. 1, p. 202-205 et BCH 30, 1906, p. 549-552. Première moitié du Ier siècle av. J.-C. 72 L. CASSON, Ships and seamanship in the Ancient world, Princeton 1971. 73 De la même façon qu’aujourd’hui bon nombre de musées conservent les figures de proue de navires des XVIII e et XIXe siècles.
18
Conclusion
Par de judicieuses références à des aitia, cette inscription conservée sous le portique
des Charites à Cyzique apporte donc plusieurs informations. Le culte des Charites, déjà attesté
à Cyzique par la mention d’un Charitésion se trouvant non loin de l’agora, trouve ici une
attestation supplémentaire. Le portique mentionné dans cette épigramme abrite la maquette
d’un élément qui revêt une importance toute particulière pour la cité, une petite stylis,
ornement caractéristique de la poupe des trières. Cette stylis, désignant par synecdoque le
navire lui-même, est en effet traitée dans cette épigramme comme un symbole éminent, celui
de la puissance maritime de Cyzique. Ce poème a pour but de rappeler les éléments qui font la
prospérité de la cité : la gloire nautique et le prestige économique, placés tous deux sous la
tutelle conjointe d’Athéna et d’Apollon. Rendant grâce à ces divinités de sa prospérité, la cité
de Cyzique inscrit son identité présente dans son passé mythique, illustré par la présence de
cet objet, qui s’apparente plus à une relique ou à une « pièce de musée », qu’à une simple
offrande. Cette épigramme s’inscrit donc bien dans ce que l’on sait du monde hellénistique,
où émerge un esprit de collection et de recherche des origines.
19
Planches
Moulage du bas-relief représentant une poupe de trière (v. 190-180) au bas de l’escalier menant à l’acropole de
Lindos. D’après Chr. BLINKENBERG, Triemiolia, 1938, p. 24, fig. 3 (L. BASCH, Le musée imaginaire de la
marine antique, Institut hellénique pour la préservation de la tradition nautique, Athènes 1987, fig. 782)
Graffite trouvé dans la Maison du Dionysos à Délos, 1ère moitié du Ier siècle av. J.-C., L. BASCH, op. cit., fig. 739.