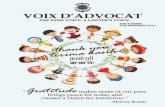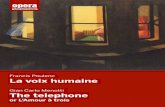Margaret Fuller, ou la voix collective des sages-femmes littéraires par Claude Cohen-Safir
-
Upload
univ-paris8 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Margaret Fuller, ou la voix collective des sages-femmes littéraires par Claude Cohen-Safir
Margaret Fuller, ou la voix collective des sages-femmes
littéraires
par Claude Cohen-Safir
Abstract : The article assesses the many forms influence can be exerted through, with its close perusal of
Margaret Fuller’s Socratic Method and “mother tongue” which enabled her Conversations to reach women
beyond the limited circle of the Boston elite, thereby creating among them a sense of collective
identity in its
snowballing effects.
Cet article a été publié par Cambridge Scholars Publishing en 2010 dans Exchanges and Correspondence: The
Construction of Feminism, Edited by Claudette Fillard and Françoise Orazi Copyright © 2010 by Claudette
Fillard and Françoise Orazi and contributors
Qui étaient ces femmes du passé dont le parcours personnel a consisté
à combiner écriture individuelle et participation à des revues? L'une
d'entre elles, l’écrivaine africaine-américaine de la Harlem Renaissance,
Jessie Fauset, (May 23, 1810 – July 19, 1850) a eu un destin tragique et
quelque peu romanesque dont il ne sera pas question ici. Pour le moment
intéressons-nous à ce que disait d'elle le poète Langston Hughes: « she
was our Literary Midwife »
En effet, Margaret Fuller joua un rôle de premier plan aux Etats Unis au
19ème s. , non seulement parce qu’elle était, à l’ombre du poète
philosophe, Emerson, la rédactrice en chef du Magazine transcendantaliste
The Dial où elle publia virulent son pamphlet The Great Lawsuit (The Great
Lawsuit. Man versus Men. Woman versus Women-The Dial numéro IV en juillet
1843, suivi en 1845 de Women in the Nineteenth Century ) mais parce qu’elle
développa une méthode très spécifique de prise de conscience des femmes à
la cause féministe lors de Conversations qui furent la marque de son
enseignement socratique et de sa maïeutique.
Cet article a pour but d’analyser un aspect des correspondances que
Fuller a engagées avec d’autres femmes de son époque et également de
montrer comment la propagation du féminisme a pu ériger, grâce à ces
correspondances, une forme de « voix collective. » Cette voix n’est
pas née facilement et les obstacles ne manquèrent pas.
Dans un article publié en 1989 Huguette Dagenais1notait :
la riche production des écrivaines féministes ne doit pas nous faire oublier le peu de place que
les femmes occupent dans ce champ (littéraire), non seulement en tant qu’auteures mais aussi
en tant qu’éditrices et diffuseuses. Sur tous les plans, à tous les niveaux (…) le monde littéraire
est dominé par des hommes (Dagenais, 1989,1-13).
La domination décrite par cette critique dans Recherches féministes en 1989,
fut, on le conçoit bien, plus importante encore dans le courant du
XIXème siècle aux Etats Unis. En effet, durant la période très riche qui
devait conduire à la Convention de Seneca Falls et aux divers mouvements
féministes de la fin du siècle, la communication instaurée parmi les
femmes, nationalement comme internationalement, influencera de manière
significative les bouleversements de la fin du siècle. Je prendrai donc le
terme correspondances dans son acception la plus large et je note plusieurs
axes :
L’affirmation de soi et la recherche d’une voix passent par -les
Conversations – la prise de parole en public ,- l’échange par les lettres
journaux publics ou privés, les publications dans les magazines, les
traductions, -les voyages.
1 Dagenais, Huguette. « La recherche féministe des années 1980 : des voix/voies multiples et convergentes ». Recherches féministes vol. 2 (n° 2, 1989) :1-13.
Je souhaite poser ici comme hypothèse qu’une voix collective émane
des essais de Margaret Fuller, dont le plus célèbre est The Great lawsuit.-Man
versus Men; Woman versus Women. Publié dans le Dial in 1843, il devint ensuite
Woman in the Nineteenth Century, ouvrage fondateur du féminisme américain
qui allait à l’encontre du culte de la “vraie féminité” en vigueur à
l’époque prônant la piété, la soumission et l’enfermement domestique. On
peut dire en observant l’œuvre de Fuller que ce livre résulte des
lectures, des Conversations et des correspondances orales et écrites que
l‘auteur entretenait avec d’autres intellectuelles de son époque et qui
fonde la rhétorique mentionnée auparavant.
Afin de définir comment les féministes et en particulier Fuller
élaborent cette rhétorique commune, notons les éléments caractéristiques
que l‘on retrouve, me semble-t-il, chez la plupart de ses contemporaines.
En premier lieu, le féminisme de Fuller doit s’inscrire en tant que parole,
CONTRE un discours dominant, que l’on nommera, pour ce qui la concerne, la
tradition sermonique. La parole, apparemment disséminée et parfois
difficile à analyser, de Fuller, réussit à saper les fondements des
« lectures » à but didactique et moralisateur qui, au final, tendaient à
renforcer un idéal individualiste et élitiste. Ces « lectures » faisaient
si souvent appel à l’abstraction que les interventions étaient bien
davantage prisées pour l’éloquence des orateurs que pour les révélations
qu’ils faisaient sur la réalité américaine.
En second lieu, le ton adopté n’est pas caractéristique de celui
généralement attribué à l’écriture féminine ; c’est celui de l’affirmation
de soi. Par ceci j’entends d’une part, une aptitude à créer un discours
pamphlétaire ou non qui puisse être entendu. Ce discours ne pouvait être
public ou oral au 19è. s. pour des rasions que nous analyserons. D’autre
part, l’affirmation de soi sous entend l’existence d’ un contexte culturel
référentiel qui puisse se substituer au cadre patriarcal. Ce contexte a
constitué ou pour les femmes une référence culturelle à leur luttes, à
leurs écrits et consacre en général leur transmission.
Enfin, si l’on peut parler d’un front anti-patriarcal, avant même de
parler de féminisme, la particularité du discours de Fuller et de celui des
diverses correspondances de femmes au 19è. s. est d’être si diversifié
qu’il provoque, à plusieurs niveaux, dans la langue, une rupture des
habitudes , une sorte d’implosion, qui dérange les conventions et, ce
faisant, aura dans la forme même un certain impact sur ses contemporains.
En effet comme le note Annette Kolodny2 dans Reclaiming Rhetorica, Margaret
Fuller avait lu Mary Wollestonecraft et reconnaissait avoir été inspirée
par Angela Grimké and Abigail Kelley Foster qu’elle mentionne explicitement
dans Woman :
Women who speak in public, if they have moral power, such has been felt from Angelina
Grimke and Abby Kelly [sic], - that is, if they speak for conscience’s sake to serve a cause which
they hold sacred , - invariably subdue the prejudice of their hearers, and excite interest
proportionate to the aversion which it has been the purpose to regard them ( 110-111)
Comme le remarque Kolodny le langage chez Fuller est sans aucun tabou
lorsqu’elle compare le statut de la jeune fille pourvu d’une dot a celui de
la prostituée, Il convient de souligner ici que la correspondance que
Fuller entretient avec le monde entier passe par son usage particulier de
la langue3 . Elle utilise de nombreux mots français : «We are now in a transition
state, and but few steps have yet been taken. From polygamy, Europe passed to the marriage de
convenance» (82). Le jeu langagier atteindra son apogée dans les traductions où
elle excelle et qui sont un autre facteur de dissémination des idées. On
peut y voir émerger une idéologie féministe qui aura ses réseaux son
2 Qted in : Lunsford Andrea A., Reclaiming Rhetorica: Women in the Rhetorical Tradition, Pittsburgh : Univ of Pittsburgh Press, 1995
3 Voir :Traisnel Antoine, « Les placements de la France dans Woman in the Nineteenth Century de Margaret Fuller » in : Revue Francaise d’Etudes Americaines, Paris, Belin. n° 115 2008/1.
rhizome et dont les échos subsistent jusqu'à présent.
Il nous faut donc, d’ores et déjà , nous entendre sur une définition
du sens que nous donnons au terme « féminisme» et revenir sur ce que nous
entendons par voix collective. Margaret Mac Fadden pose la question de
l’existence d’une telle voix dans son ouvrage intitulé Golden Cables of Sympathy
qui évoque ces rhizomes, cette matrice (ou réseau matriciel actif en
technologie) dont elle dit qu’elle n’est pas nécessairement un phénomène
toujours cohérent :
[…] the matrix formed in complex patterns of crossing, overlapping, and repeating. What I
have depicted is not a particularly coherent or always intentional phenomenon; indeed much
about the matrix is contradictory and haphazard 4 (172)."
La métaphore de l’amorphe du magma revient autant que l’expression toile
d’araignée (web) de réseaux ou câbles pour décrire un phénomène difficile
à saisir en tant que mouvement historique défini. Il s’étend dans le temps,
disparaît puis resurgit (on parle de vagues du féminisme on évoque les
éruptions volcaniques) il compte des adeptes un peu partout, de tous bords
politiques. En créant des lieux de rencontres (salons, écoles,
Conversations) en participant à des ligues , organisations politiques en
écrivant dans des journaux, en se traduisant mutuellement et en
correspondant directement ces femmes de plusieurs pays de milieux et
d’origines différentes parvenaient plus ou moins à définir des
développements politiques dans leurs pays respectifs. Ceux-ci faisaient
boule de neige internationalement en fonction d’ objectifs communs et leurs
retombées se firent sentir au 20è.s . La guerre est un bon exemple puisque
selon Leila Rupp, les femmes ont entretenu dans les ligues le principe
d’une identité collective transnationale dont on vit les effets à travers
des correspondances :
[…]the Women’s International League for Peace and Freedom […] was the primary4 Margaret H. McFadden. Golden Cables of Sympathy: The Transatlantic Sources of Nineteenth-Century
Feminism. Lexington: University ot Kentucky Press, 1999.
organization taking a firm stand for international consciousness, and it became
customary for the members of the League in the country committing the wrong to
denounce the actions ..' and appeal for restitution. For example, at the start of World
War I, German women protested the invasion of Belgium, and Allied women voiced
their objections to the blockade of Germany. Again in 1921, when Manchuria was
annexed by Japan, the japanese section sent apologies to their ” Chinese sisters. 5
Pourtant pour définir le féminisme, je souhaite plutôt emprunter à Leila
J. Rupp and Verta Taylor une définition qui me semble appropriée pour
notre colloque :
Feminism is more than gender ideology: it is a collective identity. A collective identity
approach shifts attention to the complex and ever-changing process of drawing the
circles that separate « us » (i.e., feminists) and « them ».
Because the meaning of feminism has changed over time and from place to place and
is often disputed, it requires a framework that allows access not just to what women (or
men) in a specific historical situation believed but to how they constructed, sometimes
through conflict with one another, a sense of togetherness. Although the approach we
propose acknowledges that feminists do not always agree on the definition of feminism
or on feminist strategies or practices, it also recognizes that their disputes take place
within a social movement community that, as it evolves, encompasses those who see
gender as a major category of analysis, who critique female disadvantage, and who
work to improve women’s situations. 6
****************************************************************
*****
5 Martin, Dorothea (review).Worlds of Women: The Making of an International Women's Movement in: NWSAJournal, Volume 13, Number 1, Spring 2001, pp. 168-169
6 Rupp, Leila J. and Taylor, Verta. Forging Feminist Identity in an International Movement: A Collective Identity Approach to Twentieth-Century Feminism Signs, Vol. 24, No. 2 (Winter, 1999), pp.363-386.
Conversations et parole féminine
Dans un premier temps nous nous intéresserons moins aux poèmes et
essais publiés par Margaret Fuller de 1840 à 1844 qu’au talent
spécifique qu’elle a manifesté pendant toute sa carrière pour créer
- dans une Amérique encore peu développée sur ce plan - l’événement
littéraire - Conversations, traduction de Goethe, édition du Dial
sont au cœur de l’expérience intellectuelle du milieu de siècle. -
Avant même la publication en 1843 de The Great Lawsuit.-Man versus Men;
Woman versus Women (The Dial, IV, July 1843), Margaret Fuller connut
une renomme incontestée grâce à son art de la conversation.
En effet alors que florissaient depuis longtemps en Europe les
salons littéraires ceux-ci n’existaient pas vraiment aux Etats-Unis.
Grande admiratrice de Mme de Staël ou de George Sand, Fuller
inventa, bien avant Gertrude Stein, une série de rencontres dans
lesquelles “men and women found, both then and at a later day, the
companionship of cultivated people, and the best of French, German
Italian and English Literature”.
Ces ‘Conversations’, comme elle choisit de les appeler, et lors
desquelles elle rassembla la fine fleur de la Nouvelle Angleterre,
contiennent les germes de codes subversifs que Margaret Fuller
élabora comme moyen d’action. Les Conversations commencèrent en
Novembre 1836 et continuèrent jusqu’en Avril 1844. Elles avaient un
sujet défini, une organisation et comprenait une certaine profession
de foi quant au pouvoir de la parole. Des jeunes filles, souvent des
adolescentes de quatorze ou quinze ans y assistaient parfois seules.
Ce fut le cas d’ Ednah Dow Littlehale (plus tard épouse Cheney 1824-
1904), et de Caroline Wells Healey (plus connue ensuite sous le nom
de Caroline Dall, 1822-1912), qui est souvent mentionnée dans les
biographies de Margaret Fuller. Dès 1840 sous l’influence des
Conversations de Fuller, elles entamèrent une correspondance
concernant les droits des femmes et c’est ce dialogue et cette
influence qui devaient les porter au premier rang du mouvement des
femmes de l’époque, Caroline Wells y contribua en tant que
journaliste et Ednah Dow Cheney surtout en tant que réformatrice et
organisatrice du Mouvement.7 7 Il existe relativement peu de documentation concernant ces deux femmes mais les sources donnentpour Dall, ses Memoires ( ?) Alongside (Boston, 1900) ou Essays and Sketches (1849). On lira aussi des notes biographiques chez Barbara Welter, "The Merchant's Daughter: A Tale from Life," ou encore Dimity Convictions: The American Woman in the Nineteenth Century (Athens: Ohio University Press, 1976);William Leach, True Love and Perfect Union: The Feminist Reform of Sex and Society (New York: Basic, 1980), le chapitre 10; and the sketch by Stephen Nissenbaum in Edward T. James, Janet Wilson James, and Paul S. Boyer, eds., Notable American Women, 1607-1950 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,1971), 428-29.
La correspondance de Dall se trouve a la Bibliotheque Schlesinger a Cambridge, ainsi qu’a la Massachusetts Historical Society de Boston. Quant a Cheney, on se referera a Reminiscences
Les Conversations constituaient une parole féminine particulière,
différente sinon opposée au sermon qui devint la rhétorique subversive
propre à Margaret Fulle qui s’ inspirait de la méthode socratique. Cette
méthode donna lieu à de nouvelles formes d’écriture : le Lawsuit qui
prend donc la forme juridique du plaidoyer, le pamphlet éclectique,
l’oralité du texte écrit. Ce qui s’élabore en filigrane dans ce que
j’essaie de dire est un des maillons d’une chaîne rhétorique propre aux
correspondances de femmes que l’on pourrait qualifier de rhétorique mère
ou matriarcale (par opposition au discours sermonique que je nommerai
rhétorique patriarcale) . Revenons un instant sur ce dernier discours qui
est un art oratoire et littéraire très développé aux Etats- Unis. Pour
résumer , en dehors des sermons religieux dont ils sont issus et qui
comportent une réponse antiphonique de l’auditoire, les sermons ou
conférences (ou « lectures ») du XIXeme s. comportent en premier lieu un
processus narratif qui parle pour , au nom du..... narrateur, de
l’auteur, de Dieu.
Des hommes, des conférences (lectures), sermons et du Lyceum
Le Magazine Monthly Anthology paru pour la première fois en 1803 à
Boston. L’une des premières contributions fut celle du Pasteur William
Emerson, le père de Ralph Waldo Emerson. Willis Wager8 rapporte qu’en
raison de l’influence politique néfaste que la revue aurait pu avoir,
Louis XVIII l’avait interdite en France et qu’elle devint aux Etats-Unis,
(Boston: Lee & Shepard, 1902),8 WAGER Willis American Literature: A World View, New York University Press, N.Y, 1968
la North American Review. Bien que très peu d’exemplaires aient été vendus
je la mentionne parce que c’est le moyen de connaitre la façon dont la
culture était diffusée aux Etats-Unis au moment où Fuller et d’autres
femmes tentaient d’apparaître sur la scène publique. La revue ne comptait
parmi ses rédacteurs que des membres du corps enseignant d’Harvard , qui
était bien entendu exclusivement masculin. En fait Margaret Fuller fut la
toute première lectrice à être admise à la Harvard College Library, où
elle rédigea ses notes pour Summer on the Lakes.9 On peut donc dire qu’à
cette période la culture est modelée par les hommes et qu’elle est centrée
sur deux sujets principaux : la religion et la langue. Comme nous le
constaterons le langage et en particulier quelle langue choisir pour la
Nation est un débat qui agite l’intelligentsia qui se demande si l’anglais
doit bien devenir la langue officielle. 10.
Je ne peux malheureusement pas ici faire l’historique de l’éducation donnée
aux femmes à cette période. Disons seulement que l’héritage puritain prône
l’éducation en vertu du principe selon lequel la lecture des Evangiles
éloigne de Satan et que même si Margaret Fuller fait, sous l’autorité
paternelle, connaissance avec les langues anciennes et modernes et la
culture de manière beaucoup plus extensive que la majorité des jeunes
filles, l’esprit qui sous tend cette éducation n’est pas très différent.
Les leçons paternelles et les règles dominicales sont assimilables à des
sermons:
“We had family prayers our dinners were different and our clothes… My
father put some limitations on my reading . He did not prescribe what
was, but what was not, to be done. And the liberty this left was a
9 WADE, Mason The Selected Writings of Margaret Fuller, The Viking Press, N.Y.194110 There were as many as 20 languages spoken in daily life at the birth of the nation including Dutch
German French and numerous Native American languages. The Articles of the Confederation had beenprinted in German and in English. Then, linguistic diversity grew due to the different waves ofimmigration and there were debates to so to speak “purify or protect English” as Adams had alreadyproposed in his Address to the Continental Congress as early as 1780. This procedure to make Englishofficial had then been rejected as undemocratic and threatening individual freedom.
large one ‘You must not read a novel or a play’. 11
Les sermons qui existaient depuis longtemps en Europe et en particulier en
France n’avaient pas pour autant gagné une telle influence que celle
atteinte aux Etats-Unis où ils faisaient partie d’une culture dominante qui
mélangeait la religion et l’histoire, le prêche et l’ information.
Margaret Fuller qui devait gagner sa vie par ses écrits et ses
Conversations publiques allait à l’encontre de tels codes . De plus, la
culture de cette période influencée par les modèles britanniques et
germaniques reposait sur la tradition du Lyceum institution pour
l’éducation populaire développée à partir de 1826 par Josiah Holbrook.
Elle comprenait des conférences ou “lectures ’ dont liens de fraternité
faisaient une entreprise très masculine. Face à cette culture de l’éloquence et à
l’influence du Lyceum, il fut très difficile pour les femmes de s’exprimer
publiquement . Le seul fait qu’elles le fassent était suspect ou entaché
de manque de féminité. En effet le 19è s. américain, soumis comme on le
sait au culte de la « vraie féminité » imposait, notamment aux femmes
éduquées, une double contrainte.
Celle dont souffraient Caroline Dall ou Margaret Fuller, est d’avoir eu
des pères qui, d’une part reconnaissaient le droit à leur fille d’avoir
une éducation, qui les y poussait même (peut-être pour avoir une
interlocutrice à leur mesure) et , d’autre part, les empêchait, soit
d’assister à trop de leçons soit d’y répondre en exprimant leurs idées
publiquement.
Ce qui révolte la jeune Caroline est moins l’interdiction de sortir pour
suivre des cours que le rôle dans lequel on la confine:
I knew that if I had been to a party, to the theatre or a concert he would not have complained.
It was always thus in the world. Let us impose penalties upon our friends for our own
amusement-and it is all right-but if it be for duty, for improvement-every voice is raised in
11 CHEVIGNY, op. cit., p.43.
tumultuous outcry. It is so with mother-if I were out shopping-flirting-parading and gossiping
all day she would not complain-but so long as I devote my time to books and my pen why there
are a thousand things about the house which I might do that would be more useful.12
Cette double contrainte qui l’invite à réfléchir, puisqu’elle dotée d’une
éducation et qui, dans le même temps la réduit au silence, causa chez elle
de nombreux troubles physiques qu’on retrouvera chez Margaret Fuller qui se
plaignait d’intenses migraines ou chez Louisa May Alcott.
Donc, le seul espace qui permettait finalement aux femmes de s’éduquer
était le Lyceum. La liberté qu’il procurait y était cependant très
limitée :
Not only did antebellum lyceums provide a public space for the airing of intellectual, moral,
and social views, but they also constituted a place where women's presence was considered
appropriate, although typically as spectators rather than as debaters or speakers. 13
Caroline Dall 14 expérimentera cette limitation lorsque la conférence
qu’elle a préparée sera lue par un homme bien plus doué selon elle pour
l’art oratoire dira-t-elle avec modestie. Car paradoxalement, si une femme
12 Boston Feminist in the Victorian Public Sphere: The Social Criticism of Caroline Healey Dall Author(s): Howard M. Wach Source: The New England Quarterly, Vol. 68, No. 3 (Sep., 1995), pp. 429-450.
13 Angela G. Ray, "The Permeable Public: Rituals of Citizenship in Antebellum Men's Debating Clubs," Argumentation and Advocacy 41 (2004): 9–10, 14–15.
14 Il y a de nombreuses sources bibliographiques aujourd’hui sur Dall: William Leach, True Love and Perfect Union: The Feminist Reform of Sex and Society (New York: Basic Books, 1980), chap. 10, et Barbara Welter's "The Merchant's Daughter: A Tale from Life," New England Quarterly 42 (March 1969): 3-22.
Pour des sources littéraires et historiques plus détaillées voir Susan Phinney Conrad, Perish the Thought: Intellectual Women in Romantic America, 1830-1860 (New York: Oxford University Press, 1976), esp. pp. 162-70;
Margaret McFadden, "Boston Teenagers Debate the Woman Question, 1837-1838," Signs: Journal of Women in Culture and Society 15 (1990): 832-46;
Helen R. Deese, "A New England Women's Network: Elizabeth Palmer Peabody, Caroline Healey Dall, and Delia S. Bacon," Legacy 8 (1991): 77-91,
"Alcott Bronson Conversations on the Transcendentalists: The Record of Caroline Dall," American Literature 60 (1988): 17-25; Tom Dublin, "Working Women and the 'Women's Question,"' Radical History Review 22 (Winter 1979): 93-98;
Rose Norman, "'Sorella di Dante': Caroline Dall and the Paternal Discourse," Auto/biography Studies5 (1990): 124-39.
peut apprendre, elle a simplement le droit d’enregistrer ce qui est énoncé
par les autres et éventuellement de rédiger des conférences. Mais on lui
demande en revanche de ne pas les présenter oralement. Pourtant, comme
beaucoup d’autres jeunes femmes de son époque, Caroline voyant l’absurdité
du phénomène continuera de s’affirmer, devenant une féministe très active
qui éditera, avec Paulina Wright, la revue de défense des droits des
femmes, Una. Elle parvint à donner finalement de nombreuses conférences à
Boston entre 1859-62 sur les thèmes de l’éducation mixte, le droit au
travail qui ait un sens.
Often do we hear it said, that no law forbids American women to work. Neither, it has been
responded, is there any law which forbids Chinese women to walk; but the careful ligatures, so
closely pressed by unsuspecting mothers about those tender feet, do not do their work more
surely than the inevitable restrictions of society.15
La place des femmes sur la scène publique est très limitée . On l’estime à
trois pour cent du nombre total d’interventions au Lyceum de Concord étant
entendu que seules cinq femmes eurent le droit de donner des conférences
pendant cette période et que lorsque d’autres femmes intervenaient elles
lisaient simplement des passages d’œuvres par exemple de Shakespeare.
At the Franklin Lyceum in Providence, of about 330 presentations given between 1840 and
1881, 29 (9 percent) involved women as either lecturers, readers, impersonators, or
musicians, but only 10 of these presentations (3 percent of the total) were lectures presented
as the women speakers' own ideas16
En raison de cette difficulté à se faire entendre, les femmes vont avoir
recours à d’autres moyens de communiquer leurs idées . Les conversations
de Margaret Fuller s’inscrivent dans le contexte de cette bataille
15 Caroline H. Dall, Woman's Rights Under the Law: In Three Lectures, Delivered in Boston, January 1861 (Boston: Walker, Wise, and Co., 1861), p. 11., pp. 159-60.
16 Kenneth Walter Cameron, ed., The Massachusetts Lyceum during the American Renaissance: Materials for the Study of the Oral Tradition in American Letters: Emerson, Thoreau, Hawthorne, and Other New-England Lecturers (Hartford, CT: Transcendental Books, 1969), 34. Voir également : Regina C. McCaughey-Silvia, "Lectures and Discussion Questions of the Franklin Lyceum: A Guide to Attitudes and Ideas in Nineteenth Century Providence," Ph.D. diss., University of Rhode Island, 1991.
intellectuelle selon laquelle chaque pas en avant sur le terrain masculin
devient une victoire. Si Dall est considérée comme l’une des premières à
avoir pris la parole en public, Margaret Fullet fut à l’origine d’un
nouveau style. En premier lieu elle s’oppose à la rhétorique dominante qui
fonde la culture de l’éloquence. Cette rhétorique développée par Whately
dans Elements of Rhetoric17 lui parait inappropriée à la communication qu’elle
veut mettre en place car, comme les sermons elle repose sur la persuasion,
qui, elle-même sous tend une didactique opposée à son propre enseignement
socratique. Loin d’être anodin ce constat va jusqu’à énoncer implicitement
déjà une dichotomie entre des types de discours qu’elle perçoit comme
étant inhérent à la différence sexuelle et dont elle dit après avoir lu
George Sand:
These books have made me for the first time think I might write into such shapes what I know
of human nature. I have always thought that I would not, that I would keep all that behind the
curtain, that I would not write, like a woman, of love and hope and disappointment, but like a
man of the world of intellect and action…18
Non seulement elle questionnera son habileté à choisir une langue,
mais elle opposera la sienne à celle de’Emerson aux métaphores
genrées comme on le lit dans son Journal de 1841 “give me
initiative, spermatic, prophesizing, man-making words.”19. Prisonnière
d’une langue et d’une culture qui ne la reconnaissent pas, Fuller
envisage des communications qui engagent un vrai rapport aux autres17 See GOLDEN, James and CORBETT, Edward, The Rhetoric of Blair, Campbell and Whately, Holt, Rinehart
and Winston, New York, 1968.18 Quoted by Chevigny, op.cit., p.57 Letter November 1835.19 For a more complete analysis of this intellectual challenge read: SHOWALTER, Elaine, Sister’s
Choice: Tradition and Change in American Women’s Writing, Clarendon Press, Oxford, 1991.
tout en développant une stratégie propice à la prise de conscience
des femmes:
But my ambition goes much farther. It is to pass in review the departments of thought and
knowledge, and endeavor to place them in due relation to one another in our mind. To
systematize thought and give a precision and clearness in which our sex are so deficient,
chiefly I think because, they have so few inducements to test and classify what they receive. To
ascertain what pursuits are best suited to us, in our time and state of society, and how we
may make the best use of our means for building up the life of thought upon the life of
action…20
On ne peut citer ce passage sans relever l’usage constant du pronom
nous ou notre. Pour Margaret Fuller opinion et pensée ne se forment
qu’après la consultation approfondie des autres. C’est ainsi que les
femmes qui participèrent à ces « groupes » devinrent quelques unes
des féministes ou abolitionnistes les plus actives de leur temps.
Bell Chevigny note que : ‘students of the Conversations especially Caroline Healey
Dall,Elizabeth Peabody and Edna Dow Cheney gave the feminist movement active support…
and that after her death women’s clubs named for Fuller sprang up all over the West”.21
Pour Margaret Fuller l’organe Transcendantaliste The Dial, dont elle
devint l’éditrice en chef devait rendre compte du ‘collective mind
20 Quoted by Katharine ANTHONY, Margaret Fuller, A Psychological Biography, Harcourt Brace and Co, New York, 1921, p.62
21 CHEVIGNY, Bell Gale, The Woman and the Myth, Margaret Fuller’s Life and Writings, Northeastern University press, Boston, 1994, p.222.
of the times”. Elle tentera de répercuter également dans son travail
de traduction une semblable conviction concernant l’échange.
La traduction comme geste politique
Si Margaret Fuller on le verra, est une grande admiratrice de la
nature romanesque de Mme de Stael, on connaît moins le rapport
qu’elle estimait entretenir avec celle qui, en France, définissait
dans De l’esprit des traductions le rôle de la traduction comme mode de
propagation des idées :
Il n’y a pas de plus éminent service à rendre à la littérature, que de transporter d’une
langue à l’autre les chefs-d’oeuvre de l’esprit humain. Il existe si peu de productions du
premier rang ; le génie, dans quelque genre que ce soit, est un phénomène tellement
rare, que si chaque nation moderne en était réduite à ses propres trésors, elle serait
toujours pauvre. D’ailleurs, la circulation des idées est, de tous les genres de commerce,
celui dont les avantages sont les plus certains.22
Wilhelm nous rappelle que :
Fuller, elle-même traductrice, partageait les thèses de Mme de Staël, qui envisageait la
pratique de la traduction comme processus d’acculturation et, simultanément, de
domination culturelle, comme ouverture altruiste et annexion impérialiste. Le
traducteur, pour Mme de Staël, est investi d’un rôle politique : il doit s’élever contre la
22 Mme de Staël De l’esprit des traductions 1838, t. II : 294
conception nationaliste de la littérature prônée à l’époque par Bonaparte23 (17).
Par ailleurs, concrètement nous retrouvons chez Margaret Fuller la
même valeur dialogique attribuée à l’échange dans son activité de
traductrice. Dans la Préface des Conversations with Goethe d’Eckermann,
elle nous renseigne sur sa propre vision de la traduction,
occupation qui lui valut de nombreux éloges et qui diffère de celle
d’Eckermann, : “ What we find here is, to all intents and purposes, not
conversation but monologue.”24 A une époque où les femmes se voyaient
confier surtout la traduction de textes religieux, sa prise de
position et de parole sont des indicateurs de sa capacité
d’affirmation de soi qui, dans le rapport avec d’autres dont
l’opinion doit venir se frotter avec vigueur à la sienne.
The Yankee Corinna et les voyages
Curieusement, le destin de Mme de Staël lorsqu’elle s’oppose à Napoléon,
trouve des résonances dans l’exil voulu de Margaret Fuller qui chercha à
s’accomplir en dehors des frontières de sa nation d’origine. Elevées toutes
deux par des pères éclairés que ne choque pas l’éducation des filles,
entourées des plus beaux esprits de leur époque les deux jeunes filles
souffriront de maux similaires dus à la tension nerveuse que leur éducation23 Traisnel., op.it., p.45.24 ECKERMANN, Johann, Peter Conversations with Goethe, in the Last years of His Life. Trans. Margaret
Fuller, Boston, Hilliard Gray and Co, 1839, Preface viii. For more details about Margaret Fuller’s art as a translator see also: Karen A. English Margaret Fuller and Translation in ATQ 19th century American Literature and Culture, University of Rhode Island, Kingston No 15:2 June 2001.
intellectuelle surchargée leur fait subir. Maitresse des salons
littéraires, Mme de réunit au 19ème s. l’expression politique et
l’expression artistique confirmant ainsi les aspirations féministes. Son
étude, publiée en 1800, De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions
sociales, sera reprise par Margaret Fuller lorsqu’elle aussi examinera la
naissance des nations et précisément de l’Amérique dans ses rapports avec
la religion et le gouvernement. Ce sont les Conversations que les deux
femmes auront le plus en commun même s’il est bon d’ajouter que le Salon
d’une aristocrate, zone d’influence et de bonnes manières, ressemble
finalement peu à ces semblants d’écoles inaugurées par Fuller et Peabody.
Par ailleurs on le sait, Fuller tout en mettant l’art de sa pédagogie au
service des autres les organisait avant tout pour gagner sa vie et celle de
sa famille. Dans Woman in the Nineteenth Century, elle porte un jugement fort
pertinent sur ce qui les différencie :
De Staël’s name was not so clear of offense; she could not forget the Woman in the thought;
while she was instructing you as a mind, she wished to be admired as a Woman ; sentimental
tears often dimmed the eagle glance. Her intellect, too, with all its splendor, trained in a
drawing-room, fed on flattery, was tainted and flawed; yet its beams make the obscurest
schoolhouse in New England warmer and lighter the little rugged girls who are gathered
together on its wooden bench · They may never through life hear her name, but she is not the
less their benefactress.
On retrouve d’autres échos très spécifiques de l’écriture de Staël chez
Fuller. Corinne ou l’Italie, le roman que Mme de Staël publia en 1807 vaudra à
Margaret le surnom de Yankee Corinna. Très romantique cette histoire fut un
best seller en Europe pendant des années. On se souvient qu’elle évoque
Corinne héroïne-femme extraordinairement « possédée » par l’art et la
poésie, presque habitée, qui fait penser à ce qui sera plus tard la Nadja
de Breton. On retrouve un lyrisme similaire dans les pages écrites par
Fuller à Channing à propos de son propre voyage en Italie (Fuller 19 Feb.
1841) : « Once I was all intellect; now am almost all feeling. Nature vindicates her rights, and I
feel. all Italy glowing beneath the Saxon crust. This cannot last long; I shall burn to ashes if this
smoulders here much longer. I must die if I do not burst forth in genius or heroism. »25
Le voyage en Europe suscite des réactions similaires chez Louisa May
Alcott, sa sœur et d’autres.
En effet les femmes américaines voyagent rarement en Europe à cette époque
et lorsqu’elles le font c’est toujours accompagnées. Le voyage
transatlantique entre la grande Bretagne et les Etats Unis s’est pourtant
considérablement raccourci grâce à la vapeur, passant, à partir de 1838,
de cinq semaines à environ 10 jours. Comme le dit en 1878, Fanny Kemble
(Butler), ‘A trip’, as it is now called, to Europe or America, is one of the commonest of
experiences[...]But when I first went to America [in 1832], steam had not shortened the passage[…]Few
men, and hardly any women, undertook it as a mere matter of pleasure or curiosity.26 Harriet25 The Letters of Margaret Fuller by Robert Hudspeth ; New England Quarterly, Vol. 56, No. 4 (Dec.,
1983), pp. 585-581.26 Frances Anne Kemble, Records of a Girlhood, 3 vols (London: Richard Bentley, 1878), 111, 229-30.
Beecher Stowe, Sophia Hawthorne, Elizabeth Cady Stanton, Julia Ward Howe
feront le voyage avec leur mari mais les célibataires comme Louisa May
Alcott and Margaret Fuller devront avoir des ‘compagnons’ de voyage.
Cependant le voyage en Europe qui deviendra ‘rite de passage’ chez
l’écrivain américain de Hawthorne à Henry Miller est censé révéler le
passé de l’Amérique . Pour Margaret Fuller : “our position toward Europe, as to
literature and the arts, is still that of a colony, and one feels the same joy here that is experienced by
the colonist in returning to the parent home”.27Contrairement à l’isolement qui
caractérise plus tard par exemple Gertrude Stein28, Fuller rencontrera à
Paris plusieurs français parmi lesquels George Sand et d’autres personnes
de renom dont elle fait un portrait plein de compassion en dépit des
différences culturelles.
Shirley Foster29 note que Margaret Fuller prend particulièrement conscience
du manque de politisation de la femme américaine lorsqu’elle se rend en
Europe. Lors de ces voyages les femmes, peuvent réfléchir sur la sphère
privée, la domesticité, la culture dont elles sont issues de façon plus
critique. Exposées à des sociétés qu’elles considèrent plus permissives et
à des formes artistiques exprimant davantage de sensualité que.la société
puritaine, elles sont confrontées à leurs propres contradictions :
jugements moralisants sont combinés à l’admiration débridée. Mais une
27 Margaret Fuller Ossoli, At Home and Abroad: or Things and Thoughts in America and Europe (Boston and London: Sampson Low & Son, 1856), p. 250.
28 Pour un panorama de cette époque très florissante pour les expatriées américaines voir Shari Benstock Women of the Left Bank: Paris, 1900-1940.(Austin: Univ. of Texas Press. 1986).
29 Shirley Foster American Women Travellers to Europe in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries BAAS Pamphlet No. 27 (First Published 1994).
cohérence demeure : elles refuseront dorénavant de trouver normal le
« sacrifice » ou l’abnégation auxquels les condamnaient leur condition de
femme.
Louisa May Alcott et sa sœur May voyagèrent ensemble en 1870-71 mais
après quelques allers-retours May décide d’y demeurer à partir de 1878 pour
poursuivre ses études et sa carrière artistique. Elle décrit son bonheur
de pouvoir concilier une vie d’épouse et une vie d’artiste et en avril
1878 annonce son refus de retourner aux Etats Unis :
Nothing, […] wd. ever induce me to live {in Concord again burdened with cares after this
taste of all life can be. If a woman wants a new lease of life let her come here. […]This
foreign life is so satisfactory so fun of the picturesque, so independent & charming that
Concord or Boston would be like a prison to me. 30
Louisa fait elle aussi état de son bonheur à être en Europe « the
happiest ldaysl in [her] life. » et de la frustration qu’elle éprouve à
jouer le rôle de mère nourricière. Dans son journal d’avril 1877 apès avoir
acheté une maison pour Nan sa sœur ainée elle enchaîne : « She has her wish
and is happy. When shall I have mine? Ought to be contented with knowing I can help both sisters
with my brains. But I’m selfish, and want to go away and rest in Europe. Never shall. »31
30 Madeleine Stern, introduction to The Selected Letters of Louisa May Alcott,ed. Joel Myerson and Daniel Shealy (Boston. Little, Brown and Company,1987). Lettre a sa famille datant de 1878.
31 Caroline Ticknor, May Alcott: A Memoir ('Boston : Little, Brown, and Company, 1928), p. 240.
Louisa May a toujours d’une manière ou d’une autre soutenu le désir des
femmes de « rompre des liens . Dans une lettre a une jeune femme
« rebelle » Maggie Lukens32 elle conçoit le changement comme positif et
nécessaire :
Change of scene is sometimes salvation for girls or women who out grow the place they are
born in, & it is thier [sic] duty to go away even if it is to harder work, for hungrey [sic] minds
prey on themselves & ladies suffer escape from a too pale or narrow life. (Letters 277).
Alcott voit le monde “now” as full of opportunities for “girls or women who out grow the place
they are born in.” La liberté est son motto comme elle l’écrit à Lukens “Freedom
was always my longing, but I have never had it” (Letters 277).33
Il semble que les correspondances mettent en lumière non seulement des
aspirations communes mais parfois même des destins communs. Plusieurs
critiques ont par exemple noté que Margaret Fuller avait fourni (comme sa
sœur May), à Louisa May Alcott le modèle de la femme libérée.
Both Fuller and May Alcott defied convention not only in their hairstyles but, by going to
Europe and foreigners much younger than themselves, in their life styles as well. (In Fuller’s
case, we are not even certain she actually married ) And in the end both died at the peak of
32 Eiselein, Gregory Modernity and Louisa May Alcott's Jo's Boys, Children's Literature 34 (2006) 83-108
33 Louisa May Alcott. The Selected Letters of Louisa May Alcott. Ed. Joel Myerson, Daniel Shealy, and Madeleine B. Stern. Boston: Little, Brown, 1987.
their careers-Margaret Fuller at forty, May Alcott at thirty-nine34.
Je n’insisterai pas sur le destin tragique qui unit Margaret Fuller, à May
Alcott la sœur de Louisa May.35 Ce qui nous intéresse ici est que le voyage
et l’expérience européenne, furent les moteurs de correspondances
fructueuses entre les femmes au 19è. s. Il ne fut pas uniquement la source
d’une libération individuelle . Il constitua une reconnaissance de ce que
l’Europe pouvait représenter pour la jeune Amérique à l’affut, notamment
pour les Transcendentalistes, d’une culture en devenir. :
It does not follow because many books are written by persons born in America that there exists
an American literature. Books which imitate or represent the thoughts and life of Europe do
not constitute an American literature. Before such can exist, an original idea must animate this
nation and fresh currents of life must call into life fresh thoughts along the shore. 36
Poe 37à la suite d’une critique élogieuse qu’il fit dans le Broadway
Journal, disait de Margaret Fuller : «Her acts are bookish and her books are less
thoughts than acts» (226). Prises au pied des lettres les correspondances nous
rappellent en effet que ces femmes ont tenté de faire de leurs vies des livres
et de leurs livres des actions qui ont marqué pour longtemps des générations
d’autres femmes.
34 'Natania Rosenfeld. Artists and Daughters in Louisa May Alcott's Diana and Persis. The New England Quarterly, Inc. Vol. 64. No 1 (Mar., 1991), p.20.
35 Fuller avait épousé un aristocrate italien dont elle eut un enfant et tous deux moururent avec elle. Quant à May Alcott son mariage heureux la conduisit en Europe où elle décéda en couches.
36 Margaret Fuller American Literature; Its Position in the Present Time, and Prospects for the Futurefrom her Papers on Literature and Art, 1846 reproduits dans : Literature and art. By S. Margaret Fuller. Two parts in one volume. With an introduction by Horace Greeley. Fuller, Margaret, 1810-1850., Greeley, Horace, 1811-1872. New York: Fowlers and Wells, 1852.
37 Complete Works of E.Alan Poe (NY: G.P Putnam's sons 1902) IX, 13-14 et 17-19