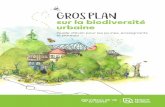Quelle place pour Le Cap dans la mondialisation? Stratégies spatiales des IDE et dynamique urbaine
Mª A. Magallón Botaya y Cristian Rico. La première phase de monumentalisation urbaine : Les...
Transcript of Mª A. Magallón Botaya y Cristian Rico. La première phase de monumentalisation urbaine : Les...
Sommaire
AuteursRemerciementsPréface (M. Martín-Bueno et J.-M. Roddaz) ................................................................................................................ 13Introduction / Introducción (M. A. Magallón Botaya et P. Sillières) ......................................................................... 15Avertissement................................................................................................................................................................ 29
1. LE TERRITOIRE DE LA CITÉ DE LABITOLOSA (L. Chasseigne, M. A. Magallón Botaya et P. Sillières)
Une cité du piémont pyrénéen ......................................................................................................................... 31Les recherches sur le peuplement et la mise en valeur du territoire de Labitolosa .................................... 43Les activités économiques ................................................................................................................................. 61
2. LES PREMIERS TEMPS DE LABITOLOSA (J. A. Asensio Esteban, E. Maestro Zaldívar, M. A. Magallón Botaya, M. Passelac et P. Sillières)
La ville augustéenne .......................................................................................................................................... 69La première agglomération du Cerro del Calvario .......................................................................................... 81
3. LA PREMIÈRE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LES ÉDIFICES DE LA PARTIE NORD DU FORUM (M. A. Magallón Botaya et C. Rico)
Le “Grand Bâtiment” ......................................................................................................................................... 99Le “Bâtiment Est” ............................................................................................................................................... 118
4. LA PREMIÈRE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LES THERMES I (M. Fincker, C. Guiral Pelegrín, M. A. Magallón Botaya et P. Sillières)
Étude architecturale du monument .................................................................................................................. 129Stratigraphies et chronologie ............................................................................................................................ 191L’évolution architecturale du monument et les propositions de restitution ................................................... 205
5. LA SECONDE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LA CURIE (M. Fincker, C. Guiral Pelegrín, M. A. Magallón Botaya, M. Navarro Caballero, C. Rico et P. Sillières)
Les vestiges du monument ............................................................................................................................... 213
Étude architecturale ........................................................................................................................................... 220Une curie en service pendant un peu plus d’un siècle ................................................................................... 237La curie et ses annexes ..................................................................................................................................... 246
6. LA SECONDE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LES THERMES II (M. Fincker, M. A. Magallón Botaya, C. Rico et P. Sillières)
Les vestiges du monument ............................................................................................................................... 253Étude architecturale et proposition de restitution des Thermes II ................................................................. 282Stratigraphies et chronologie du monument .................................................................................................... 287
8 –
7. UNE DOMUS DE LA FIN DU Ier SIÈCLE (M. Fincker, C. Guiral Pelegrín, M. A. Magallón Botaya, C. Rico et P. Sillières)
Les vestiges du monument ............................................................................................................................... 298Une domus de la fin du Ier s. à l’emplacement d’une maison antérieure....................................................... 319
8. EPIGRAFÍA Y SOCIEDAD DE LABITOLOSA (M. Navarro Caballero et M. A. Magallón Botaya)
La epigrafía de Labitolosa ........................................................................................................................... 334La ciudad de Labitolosa, sus habitantes y sus notables .................................................................................. 400
9. LA CERÁMICA ENGOBADA DE IMITACIÓN DE SIGILLATA HISPANICA : ¿UNA PRODUCCIÓN LABITOLOSANA? (C. Sáenz Preciado)
El repertorio tipológico ..................................................................................................................................... 420Caracterización de la producción ..................................................................................................................... 431¿ Una producción local ? ................................................................................................................................... 433
10. RESTES FAUNIQUES DE LABITOLOSA (Y. Lignereux, J. Massendari, H. Obermaier et E. Schwabe)
Composition générale de la faune ................................................................................................................... 438Discussion .......................................................................................................................................................... 441
CONCLUSIONS / CONCLUSIONES (M. A. Magallón Botaya et P. Sillières) ....................................................................................................... 445
Bibliographie ................................................................................................................................................................ 455Table des planches et des figures ............................................................................................................................... 471Index des sources ......................................................................................................................................................... 489Index onomastique....................................................................................................................................................... 493Index géographique ..................................................................................................................................................... 495Index des matières ....................................................................................................................................................... 497
3. La première phase de monumentalisation urbaine : les édifices de la partie nord du forum
María Angeles Magallón Botaya & Christian Rico
– Labitolosa. Une cité romaine de l’Hispanie citérieure, p. 99 à 128
D ans le déroulement des recherches effectuées à Labitolosa, la mise au jour des vestiges d’un grand édifice public en bordure du forum de la cité s’inscrit dans la dernière étape du programme de fouilles démarré en 1991. Le monument est voisin à l’est de la curie municipale, dont les fouilles entre 1993 et 1999
avaient révélé la présence d’un grand mur de direction nord-sud à peu près parallèle à elle (US 07120) 1. Tant son mode de construction (un opus incertum lié à un mortier de chaux assez pauvre) que les données stratigraphiques obtenues dans le sondage C11 pratiqué en 1999 dans le passage à l’est de la curie indiquaient qu’il lui était antérieur. Il paraissait probable d’autre part que certaines des structures découvertes dans le Campo de la Iglesia au tout début des recherches sur le site (campagne de 1992, secteur 6), en l’occurrence les vestiges d’un mur en grand appareil de grès orienté est-ouest (US 06009 et 06022), appartenaient à cet édifice (fig. 1). C’est pour s’en assurer et comprendre dans le même temps l’organisation de ce secteur du centre monumental de l’agglomération romaine que les fouilles se sont étendues en 2001 à l’est de la curie et ont été poursuivies l’année suivante.
Une grande aire ouverte a été réalisée sur un espace de plus de 500 m2, à cheval sur les trois terrasses agricoles qui constituaient cette partie du versant sud du Cerro del Calvario. Le concours d’un tractopelle pendant une dizaine de jours a été nécessaire, lors de chaque campagne, pour, d’une part, évacuer les déblais des fouilles de la curie accumulés les années précédentes, et d’autre part, enlever la plus grande partie des remblais agricoles modernes afin d’accéder aux structures et niveaux archéologiques antiques. Les fouilles qui ont suivi ont permis de mettre au jour l’édifice voisin de la curie dans son entier et ont fait aussi apparaître, au nord-est de l’aire ouverte, les restes d’un deuxième bâtiment accolé au premier (fig. 2). L’un et l’autre ont grandement souffert de la transformation de tout ce secteur à l’époque moderne lors de la construction des terrasses agricoles, qui a détruit leurs parties médianes et basses jusqu’aux marnes rouges et vertes formant la partie supérieure du substrat géologique (désignées pour l’ensemble du secteur US 10006). Seules les extrémités nord des deux édifices, dont les ruines devaient être alors partiellement enfouies sous les terres des ravinements qui n’ont pas manqué de se produire depuis l’abandon de la ville, ont été épargnées par les travaux de terrassement modernes (pl. 1).
LE “GRAND BÂTIMENT” 2
Dans son état originel, le monument se présentait comme un grand podium enchâssé dans le terrain en pente. Il supportait un aménagement intérieur dont ne sont conservés qu’un maigre vestige de mur et une partie de son sol en opus signinum. Celui-ci, situé à l’altitude de 601,04 m, dominait d’un peu moins de trois mètres l’esplanade du forum au sud 3 (fig. 4 et 24). La construction des terrasses agricoles au XVIIIe s. a entraîné la destruction des deux tiers sud de l’édifice et la disparition de la quasi totalité de son aménagement intérieur. L’emprise au sol du monument est donnée par ses quatre
1. De fait, la curie présente une orientation divergente de 3,7° ouest par rapport à l’édifice voisin.2. Appelé “Édifice 1” dans les rapports de fouille et dans les chroniques Labitolosa 2001 et Labitolosa 2002.3. D’après les observations faites au cours des campagnes 1991-92 et 1998 (devant la curie), le niveau originel du niveau de circulation
du forum avait pu être restitué à une altitude comprise entre 598,20 m et 598,60 m. La fouille stratigraphique devant le bâtiment, en 2002, a précisé ces observations. Le seul niveau antique reconnu au sud du monument, US 10029, se trouve à l’altitude de 598,15 m ; au contact de celui-ci-ci se trouve l’US 10027, qui est un niveau de remblai contenant des blocs arrachés à l’élévation de la façade méridionale du grand bâtiment et qui sert d’assise à un mur de terrasse agricole moderne, US 10024. Cette altitude de 598,15 m est aussi, à peu de choses près, celle des deux massifs de fondation (de bases de statues ?) mis au jour devant le monument, d’un côté l’US 10021 (= US 05007), base carrée de 1,40 m de côtés (fouilles 1992) et US 10025 (fouilles 2002), base maçonnée rectangulaire de 2,90 m sur 1,35 m, construite tout contre l’angle sud-ouest du monument, dans le prolongement du mur latéral ouest de celui-ci.
100 – MARíA ANGELES MAGALLóN BOTAYA & CHRISTIAN RICO
| Fig. 1. Blocs de grès appartenant au mur de façade sud du Grand Bâtiment, mis au jour en 1992 (secteur 6, US 06009/06022 = 10022) (cl. M. A. Magallón Botaya).
| Fig. 2. Vue partielle de l’aire ouverte du secteur 10 à la fin de la campagne 2001. La partie méridionale du Grand Bâtiment n’avait pas encore été atteinte (cl. C. Rico).
murs de façade qui, pour l’essentiel, ont été arasés jusqu’au niveau supérieur du substrat dans lequel ils sont fondés (fig. 4). Ils dessinent un grand édifice quadrangulaire, plus proche du carré que du rectangle, orienté nord-sud, dont le grand côté mesure 18,35 m, le petit, d’est en ouest, 15,75 m. Sa surface totale au sol est de 290 m2 (pl. 1).
Description des vestiges
Les fondations et les murs de façadeDes quatre murs, fondations et élévations, qui constituent les limites du monument, trois, les murs nord (US 10003),
ouest (10002 = 07120) et est (10015) (fig. 3), sont appareillés selon la même technique de l’opus incertum. Les moellons de calcaire, grossièrement épannelés et de formes et de dimensions diverses, sont disposés en deux parements, en assises plus ou moins réglées, mais de longueurs et de hauteurs variables. L’agencement reste cependant soigné, les blocs présentant toujours une face plate en façade (fig. 6). Des fragments plus petits de pierre calcaire comblent les interstices ou aident à rétablir l’horizontalité des assises. Les deux parements enserrent un blocage de pierraille lié au mortier de chaux. À l’inverse de ce que l’on observe sur les édifices de la deuxième phase de monumentalisation urbaine (curie, Thermes II et domus), celui-ci n’a pas été utilisé en grandes quantités.
Les fondations présentent une largeur de 0,65 à 0,70 m. Celles des murs ouest et est émergeaient hors du sol, dans la partie nord du bâtiment, jusqu’à la côte d’altitude de 601 m ; elles retenaient les remblais qui, à l’intérieur, supportaient le sol en opus signinum du monument. Ces remblais ont disparu lors de l’aménagement des terrasses agricoles modernes. Sur le mur est (US 10015), dont la base a été atteinte dans le sondage pratiqué dans la tranchée de fondation près de l’angle nord-est, on observe la présence d’une assise de réglage faite de plaquettes de calcaire de 11 cm de long et de 4 cm d’épaisseur en moyenne. Elle marque, à une altitude légèrement inférieure à 601 m, un rétrécissement d’une vingtaine de centimètres de la largeur du mur. C’est à partir de ce niveau que commencent les élévations proprement dites du monument (fig. 6 et 8). Celles-ci, qui ne sont plus larges que de 0,45 m, sont uniquement conservées dans la partie septentrionale du bâtiment. La hauteur maximale observée est de 1,04 m au mur de fermeture nord (US 10003) (fig. 6, 8 et 9). La liaison entre le mur nord et les murs ouest d’un côté et est de l’autre était assurée par des chaînes d’angle en grand appareil de grès à joints vifs, dont deux assises sont encore conservées (fig. 10). Les blocs sont de dimensions à peu près égales, 0,70-0,73 m de longueur 4, 0,49 m de hauteur et 0,49 m de largeur. Leur face externe était traitée en léger bossage. On observe sur trois
4. Le bloc de la deuxième assise du chaînage nord-est est toutefois plus long de 12 à 15 cm que les trois autres.
LA PREMIÈRE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LES ÉDIFICES DE LA PARTIE NORD DU FORUM – 101
| Fig. 4. Vue d’ensemble du Grand Bâtiment, prise depuis le sud-ouest (fin de la campagne 2002) (cl. C. Rico).
| Fig. 5. Le mur 10015, mur est du Grand Bâtiment, fondé dans les marnes naturelles (cl. C. Rico).
| Fig. 3. Numérotation des murs du Grand Bâtiment et du Bâtiment Est et situation des sondages C11 et C14 (M. Fincker, D. Leconte, V. Picard).
102 – MARíA ANGELES MAGALLóN BOTAYA & CHRISTIAN RICO
| Fig. 6. Détail de l’appareil de l’élévation du mur nord du Grand Bâtiment, US 10003 (cl. C. Rico).
| Fig. 8. Vue prise de l’est de la partie nord du Grand Bâtiment, de son sol en opus signinum et de l’élévation du mur de péribole, US 10003 (cl. C. Rico).
| Fig. 9. Vue panoramique du mur US 10003 (cl. M. A. Magallón Botaya).
| Fig. 7. La fondation du mur 10015 et au deuxième plan son élévation, plus étroite, à partir du niveau 601 m (cl. C. Rico).
LA PREMIÈRE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LES ÉDIFICES DE LA PARTIE NORD DU FORUM – 103
d’entre eux des trous de pince 5, à peu près centrés (fig. 11). De forme carrée ou circulaire, leurs dimensions (longueur x largeur x profondeur) varient d’un bloc à l’autre, 3 x 3 x 2,5 cm ; 5 x 5,5 x 4 cm ; 4 x 3,5 x 3 cm.
La façade méridionale du monument avait été reconnue en 1992 6 sur un peu plus de 4 m de longueur (US 06009 et 06022, secteur 6) (fig. 1). Son dégagement complet n’interviendra que dix ans plus tard, en 2002, lors de l’extension au sud de l’aire ouverte en 2001 et qui n’avait pas atteint alors la partie méridionale de l’édifice. La façade (US 10022) se développe sur une longueur de 15,75 m d’ouest en est et, pour l’essentiel, il ne nous en est parvenu que le mur de fondation (fig. 12). Aménagée dans la roche en place sur une largeur de 0,65 à 0,70 m et une profondeur de 0,35-0,40 m, la tranchée de fondation est remplie de blocs de calcaire de taille moyenne liés à l’argile. La partie supérieure du blocage forme un radier parfaitement horizontal (alt. 597,80) qui sert de lit d’attente pour l’élévation (fig. 13), constituée, au moins pour la partie conservée, de grands parpaings rectangulaires de grès (fig. 14). Mais celle-ci a presque entièrement disparu ; seuls quatre blocs sont encore en place à l’extrémité orientale du mur, formant une première assise d’une longueur de 4,43 m (fig. 15). Ailleurs, quelques blocs cassés et incomplètement arrachés subsistent au-dessus de la fondation 7. D’autres sont renversés devant le monument et étaient pris dans les remblais agricoles modernes. Au-dessus de cette assise inférieure d’opus quadratum subsiste un bloc de grès, situé au-dessus des blocs 2 et 3 ; cassé dans le sens de la longueur, il a été abandonné sur place. Les blocs, rectangulaires, sont de dimensions égales, 1,13-1,14 m x 0,65 m pour une hauteur de 0,49 m ; le bloc 1 de la première assise, le plus à l’ouest, est toutefois moins long de 0,10 m que les trois autres 8. Deux d’entre eux présentent sur leur face supérieure et en position centrale des encoches de levier 9 destinées à leur mise en place. Longues de 7 à 8 cm, elles sont larges de 1,5 cm et profondes de 3 cm ± 0,5.
On reviendra plus loin sur la restitution de l’ensemble. Disons d’ores et déjà que l’on peut hésiter entre une façade entièrement en opus quadratum et une construction mixte associant grand appareil pour la base et opus incertum pour l’élévation. Quoiqu’il en soit, la liaison entre la façade sud et les murs latéraux était assurée, de la même manière qu’au nord du monument, par des chaînes d’angle en grand appareil ; un parpaing, cassé, est en place dans l’angle sud-ouest de l’édifice et dans l’axe du mur ouest (US 10002) (fig. 16). Il est, comme les autres blocs conservés, directement posé sur le
5. Ils sont dits aussi “entailles de levage” ; venait s’y ficher la pince permettant de soulever, par autoserrage, les blocs ; cf. Ginouvès & Martin 1985, 122.
6. Labitolosa 1992, 98-116.7. L’un d’eux, mis au jour en 1992 (US 06009) et redécouvert en 2002, et bien que cassé, surprend par sa position verticale. S’il a pu
faire penser un moment à un montant, il apparaît en fait qu’il a été renversé au moment du démantèlement du mur, très vraisemblablement lors de la construction des terrasses agricoles modernes.
8. C’est aussi le cas du parpaing que l’on peut restituer à la deuxième assise, coincé entre le bloc en place et celui qui se situait à l’extrémité du mur, disposé dans le sens de la largeur (0,65 m) et constituant le chaînage avec le mur est du bâtiment.
9. Terminologie préférable, selon Ginouvès et Martin 1985, 124 et n. 270, à celle de “trous de pince”, qui implique l’usage de la pince pour soulever et poser les blocs. L’encoche, dans le cas présent, n’avait pas la même fonction que sur les blocs des chainages d’angle.
| Fig. 10. Angle nord-est du Grand Bâtiment. Chaînage d’angle en grand appareil de grès et jonction avec le mur 10101 (cl. M. A. Magallón Botaya).
104 – MARíA ANGELES MAGALLóN BOTAYA & CHRISTIAN RICO
| Fig. 14. L’extrémité est du mur 10022 en cours de fouille (cl. C. Rico).
| Fig. 15. Blocs de grand appareil de la façade méridionale du Grand Bâtiment, en fin de fouille (cl. C. Rico).
| Fig. 16. Angle sud-ouest du Grand Bâtiment. Vestige du chaînage d’angle en grand appareil de grès.
| Fig. 12. Vue d’ensemble des vestiges de la façade méridionale du Grand Bâtiment.
| Fig. 13. Vue du radier de fondation du mur 10022 (cl. C. Rico).
| Fig. 11. Angle nord-est du Grand Bâtiment. Chaînage d’angle en grand appareil de grès (cl. C. Rico).
LA PREMIÈRE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LES ÉDIFICES DE LA PARTIE NORD DU FORUM – 105
radier de fondation du mur de façade (US 10022). Ses dimensions étaient à l’origine 1,15 m de longueur, 0,49 m de hauteur et 0,65 m de largeur, identiques donc aux autres. À l’angle sud-est, se reconnaît, en négatif, l’emplacement du bloc de grès, qui, sur la deuxième assise du chaînage, pénétrait dans la maçonnerie du mur est du bâtiment (US 10005) ; on peut y restituer un parpaing de 1,10 m de longueur et de 0,65 m de large (fig. 21). Sa hauteur était sans aucun doute de 0,49 m.
L’aménagement intérieurLe sol du monument, à l’altitude de 601,04 m, portait un revêtement en opus signinum (US 10005). Sectionné lors
de la construction des terrasses agricoles, il est uniquement conservé dans la partie nord de l’édifice, sur une largeur de 4,94 m à l’ouest qui se réduit à 2,45 m à l’est (fig. 17). Il est fait de deux couches superposées de petits fragments de calcaire noyés dans un mortier de chaux blanc (fig. 18). La couche supérieure est épaisse de 2 cm, la couche inférieure, d’aspect plus grossier, de 7 cm. Celle-ci repose sur un radier d’une épaisseur de 6 cm fait de galets de tailles moyennes à moitié enfoncés dans le substrat argileux (fig. 19).
À 3,75 m du mur nord et parallèlement à celui-ci, à la rupture de pente, subsistent les restes d’un muret contre lequel le sol d’opus signinum vient s’appuyer (US 10014) ; c’est là tout ce qui reste de l’aménagement intérieur du monument (fig. 20). Il a servi de support au mur de la terrasse agricole supérieure, ce qui explique qu’il ait en partie échappé à la destruction. Conservé sur une longueur de 4,16 m et large de 0,45 m, il présente deux parements de moellons de calcaire non équarris liés au mortier. Il est fondé peu profondément dans le substrat argileux, sur la hauteur d’une seule assise, soit 0,23 m. L’élévation n’a, également, gardé qu’une assise. À l’extrémité ouest du muret, l’opus signinum du sol conserve en négatif l’empreinte du bloc d’angle au-dessus de la fondation. Ses dimensions, 0,42 m de longueur et au moins 0,34 m de largeur, invitent à y restituer un bloc de grès. Il est vraisemblable dès lors que l’élévation de la construction intérieure présentait des chaînes d’angle en opus quadratum, à l’instar des élévations extérieures du monument.
| Fig. 18. Détail du sol en opus signinum US 10005 (cl. C. Rico). | Fig. 19. Détail de la construction du sol US 10005 et de son radier (cl. C. Rico).
| Fig. 17. Vue d’ensemble du sol en opus signinum conservé dans la partie nord du Grand Bâtiment (US 10005) (cl. C. Rico).
106 – MARíA ANGELES MAGALLóN BOTAYA & CHRISTIAN RICO
Les deux murs en grand appareil de part et d’autre du monumentContre les murs ouest et est de l’édifice, viennent s’appuyer deux murs en opus quadratum (fig. 3) : le premier
(US 07124 et 07130) (fig. 16) a été reconnu par la fouille de la façade méridionale de la curie en 1998, à l’est et à l’ouest du massif de l’escalier d’entrée dans le vestibule ; le second (US 10071) est apparu en 2003 (fig. 21) lors de la mise au jour de l’angle sud-est du Grand Bâtiment. L’un et l’autre sont situés dans le même alignement et en retrait de 1,45 m par rapport à la façade méridionale de celui-ci.
Le premier (US 07124 et 07130) se trouve en partie pris dans le puissant massif de fondation de la façade méridionale de la curie. Il mesurait au moins 13,50 m, mais seuls ont été exhumés les deux tronçons qui forment ses extrémités est et ouest, l’un à l’est, contre le Grand Bâtiment (07124), de 2,50 m de longueur, l’autre de 1,35 m, à l’ouest (07130), sous l’angle sud-ouest du massif de fondation du mur sud de la curie. Arasé lors de la construction de celle-ci, à l’altitude de 598,71 m à l’est, et de 598,41 à l’ouest, il conserve deux assises de blocs rectangulaires de grès qui mesurent de 0,65 à 0,80 m de longueur, 0,48 m de largeur et 0,42 à 0,44 m de hauteur.
Le second (US 10071), du côté est du Grand Bâtiment, prend appui sur le mur 10015 et conserve également deux assises de blocs de grès posés à sec. L’appareillage, les dimensions des parpaings 10 et l’usure qu’ils présentent à l’est montrent que le mur nous est parvenu dans toute sa longueur qui est de 1,26 m. Au-delà, à 2,60 m vers l’est et dans le même alignement, un bloc de grès est pris en partie dans la berme est de la fouille (US 10075). Il pourrait appartenir à un mur d’opus quadratum de même direction est-ouest, on y reviendra. Entre les deux, l’espace de 2,60 m est comblé par des remblais modernes d’origine agricole. À la différence du mur de façade sud du grand monument, ce mur 10071, dont l’élévation est conservée sur 0,86 m de hauteur (arase : alt. 598,67 m), repose directement sur les argiles rouges du substrat naturel. L’absence de fondation pourrait indiquer que la construction originelle n’était pas très haute.
10. Dimensions des parpaings (L. x l.) : 0,48 x 0,42 m et 0,82 x 0,42 m (blocs de la première assise) ; 0,21 x 0,44 m et 1,05 x 0,44 (deuxième assise). La largeur des blocs est de 0,48 m.
| Fig. 21. Mur en grand appareil de grès, US 10071, contre le mur 10015 du Grand Bâtiment (photo prise en 2009, cl. C. Rico).
| Fig. 20. Mur 10014, seul vestige conservé de l’aménagement intérieur du Grand Bâtiment (cl. C. Rico).
LA PREMIÈRE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LES ÉDIFICES DE LA PARTIE NORD DU FORUM – 107
Le petit égout dans le passage entre le Grand Bâtiment et la curie La fouille de l’espace qui sépare le Grand Bâtiment de la curie a mis au jour une canalisation conservée sur de
longueur de 5,50 m. Large et profonde de 30 cm, elle est entièrement en pierre avec une série de dalles formant le fond et d’épaisses parois en blocs de 0,70 à 0, 90 m de longueur et 30 cm de largeur. Son extrémité nord (fig. 22a) se trouve à l’arrière du mur est-ouest qui coupe le passage entre la curie et le Grand Bâtiment (mur 07009 sur la fig. 4 du chap. 5, p. 214). Ensuite, au sud de ce même mur, il est comblé de différents débris, en particulier de morceaux de tuiles, et partiellement recouvert par la fondation du mur est du vestibule de la curie (fig. 22b). En revanche sa partie méridionale, qui devait déboucher sur la place du forum, manque car elle a été coupée par le mur sud de la curie (fig. 23a). On a aussi constaté que la maçonnerie de la fondation du mur de la curie n’a pas pénétré dans le petit canal mais qu’elle repose sur le comblement de celui-ci (fig. 24b). Il est donc assuré que ce petit égout fut comblé avant l’édification du mur de la curie et qu’il ne fonctionna plus après la construction de celle-ci.
| Fig. 22a. Extrémité nord du petit égout empruntant la moitié sud du passage entre la curie et le Grand Bâtiment : ce début du canal se trouve au nord du mur est-ouest (US 07009) traversant le passage (cl. P. Sillières).
| Fig. 22b. Petit égout dans le passage entre la curie et le Grand Bâtiment : sa partie sud est partiellement recouverte par la fondation du mur est (US 07259) de la curie (cl. P. Sillières).
| Fig. 23a. Extrémité sud du petit égout recouvert par la fondation du mur est de la curie : à l’avant se dressait le mur sud de la curie, aujourd’hui disparu, qui coupait le canal (cl. P. Sillières).
| Fig. 23b. Vue de détail de l’extrémité sud du petit égout recouvert partiellement par la fondation du mur est de la curie. Elle permet de constater que la maçonnerie de la fondation du mur n’a pas pénétré dans le petit canal mais qu’elle repose sur le comblement de celui-ci ; ce petit égout fut donc comblé avant l’édification du mur de la curie et il ne fonctionna plus après la construction de celle-ci (cl. P. Sillières).
108 – MARíA ANGELES MAGALLóN BOTAYA & CHRISTIAN RICO
Stratigraphie et chronologieLe Grand Bâtiment, aux deux tiers arasé par les paysans de l’époque Moderne, n’a conservé qu’une infime partie de
sa stratigraphie antique. La fouille, menée jusqu’aux marnes vertes et rouges du substrat qui présente un profil en paliers du nord vers le sud, n’a permis d’identifier, pour l’essentiel, que des unités stratigraphiques, architecturales et sédimentaires, liées à la construction des terrasses modernes (fig. 24) . Il s’agit d’un côté des murs en pierres sèches des terrasses elles-mêmes (US 10011 et 10024 = 06002), de l’autre des remblais de terre et de blocs de pierre qu’ils contenaient (US 10007, 10016 à 10019, 10023, 10027, 10028, correspondant aux US 05001, 06005 et 06020 distinguées lors des fouilles 1991-1992). Tout le podium a été ainsi “vidé” jusqu’au substrat, en particulier des remblais qui supportaient le sol en opus signinum et l’aménagement intérieur du monument.
C’est seulement dans la partie nord du monument, là où le sol s’est conservé, qu’est resté en place un niveau d’abandon d’une quinzaine de centimètres d’épaisseur (US 10009) qui le recouvrait. Il renfermait peu de matériel, parmi lequel on relèvera quelques tessons de sigillée hispanique et de céramique africaine de cuisine.
Les éléments qui permettent de dater la construction du monument existent bien, mais il faut les chercher à l’extérieur, dans les sondages stratigraphiques effectués en 1998 et 1999 (sondage C11), 2001 et 2002 (sondage C14 et tranchée de fondation du mur 10015). Les fouilles menées devant la façade sud du monument, en 1992 et en 2002, n’ont pas apporté en effet de données chronologiques pouvant être mises en rapport avec sa construction. Le devant de l’édifice a été en effet profondément perturbé par les travaux d’aménagement des terrasses agricoles modernes. Les seules US antiques mises en évidence sont de fines couches de terre argileuse directement en contact avec la roche en place – US 05006 et 06020 et 06021 (fouilles de 1991-1992) et 10029, 10040 à 10042 (fouilles de 2002) –, dont elles colmatent, par endroits, les irrégularités. Le mobilier archéologique, peu abondant, est en revanche très homogène : céramique grise indigène, quelques fragments de campanienne, de parois fines et, surtout, des tessons de céramique sigillée italique, certains décorés, qui situent la mise en place de ces niveaux à l’époque augustéenne 11. En contact direct avec la roche qui semble avoir été par endroits aménagée, d’après les observations réalisées en 1991 et 1992, cet ensemble de strates pourrait avoir constitué un remblai d’aplanissement préalable à l’aménagement de la première place publique de l’agglomération ; il est, quoiqu’il en soit, antérieur à la construction de notre édifice. À certains endroits en effet, il est coupé par la tranchée de fondation du mur méridional du Grand Bâtiment. Celui-ci est donc postérieur à l’époque augustéenne, ce que confirment les éléments de datation découverts dans les sondages effectués à l’ouest et à l’est du bâtiment.
Sondage C11 (1998/1999) Implanté en travers du passage formé par le mur oriental de la curie (US 07026) et le mur ouest du Grand Bâtiment (US
07120 = 10002), le sondage C11 a coupé cet espace sur toute sa largeur (2,20 m) et sur une longueur de 2 m (fig. 3). Il a eu pour objectif d’étudier la stratigraphie en liaison avec les deux édifices et d’apporter des éléments de datation sur la construction de l’un et de l’autre. Une séquence de 13 unités stratigraphiques y a été mise en évidence (fig. 25a et 25b). Le remblai (US 07257) correspond à la construction de la curie, dont la fosse de fondation (US 07258) a tranché les strates accumulées contre le mur occidental du Grand Bâtiment (US 07255, 07256, 07260, 07291, 07292, 07293 et 07294). Celles-ci, bien que de composition, couleur et consistance variées, présentent une grande homogénéité du point de vue du matériel qu’elles renfermaient puisque celui-ci est attribuable à la première moitié du Ier s. de notre ère. Aux côtés de la céramique ibérique peinte et grise indigène, on trouve de la céramique sigillée italique (dont une forme Consp. 26.1) et de la sigillée gallo-romaine, parmi laquelle on relèvera, dans l’US 07294, un fond de coupelle estampillé OF(ficina) COCI, attribuable au potier de La Graufesenque Cocus, dont l’activité est placée dans la période 15-70 a.C. 12. Seule la couche supérieure (US 07255), qui s’est aussi formée après la construction du Grand Bâtiment et probablement peu de temps avant celle de la curie, renferme quelques vases en céramique sigillée hispanique. Les données recueillies dans le sondage C14 vont dans le même sens.
11. Ce même niveau, avec un mobilier identique, a été retrouvé dans le sondage S.10-3 effectué en 2002 à l’angle formé par le mur ouest du grand bâtiment (US 10002) et le mur de grand appareil de grès qui vient s’appuyer contre lui (US 07130).
12. Genin 2007, 194-195 en particulier.
– 109
|Fi
g. 2
4. C
oupe
strat
igra
phiq
ue tra
nsve
rsal
e no
rd-s
ud d
u G
rand
Bât
imen
t (C
. Ric
o). U
S 10
001
: ter
re e
t ga
lets
: te
rre
arab
le d
es ter
rass
es a
gric
oles
. US
1000
3 : m
ur e
n op
us
ince
rtu
m :
mur
nor
d du
Gra
nd B
âtim
ent.
US
1000
4 : t
erre
, pie
rres
et ga
lets
: re
mbl
ai d
’am
énag
emen
t de
s te
rras
ses
agrico
les.
US
1000
5 : s
ol d
’opu
s si
gnin
um
du
Gra
nd B
âtim
ent,
entre
le m
ur
nord
100
03 e
t le
mur
et 1
0014
. US
1000
6 : m
arne
s ve
rtes
et ro
uges
: su
bstrat
géo
logi
que.
US
1000
7 : t
erre
, pie
rres
et ga
lets
: re
mbl
ai m
oder
ne d
’am
énag
emen
t de
s te
rras
ses
agrico
les.
U
S 10
009
: ter
re e
t te
gula
e : n
ivea
u d’
aban
don
du G
rand
Bât
imen
t. U
S 10
011
: mur
en
pier
re s
èche
de
la ter
rass
e ag
rico
le m
oyen
ne. U
S 10
014
: mur
et d
u G
rand
Bât
imen
t pa
rallè
le
au m
ur n
ord.
US
1001
6 : t
erre
, pie
rres
et ga
lets
: re
mbl
ai d
’am
énag
emen
t de
s te
rras
ses
agrico
les.
US
1001
8 : t
erre
, pie
rres
et ga
lets
: re
mbl
ai d
’am
énag
emen
t de
s te
rras
ses
agrico
les.
U
S 10
019
: ter
re, p
ierr
es e
t ga
lets
: re
mbl
ai d
’am
énag
emen
t de
s te
rras
ses
agrico
les.
US
1002
2 : b
loca
ge d
e pi
erre
s ca
lcai
res
dam
ées
et a
rgile
, ave
c ni
veau
sup
érie
ur p
arfa
item
ent
horizo
ntal
: fo
ndat
ion
du m
ur d
e fa
çade
du
Gra
nd B
âtim
ent.
US
1002
3 : t
erre
, pie
rres
et ga
lets
: re
mbl
ai d
’am
énag
emen
t de
s te
rras
ses
agrico
les.
US
1003
0 : t
erre
s, b
locs
, pie
rres
et
gale
ts :
dém
oliti
on d
u m
ur 1
0022
, lor
s de
d’a
mén
agem
ent de
s te
rras
ses
agrico
les.
US
1004
0 : t
erre
et ch
arbo
ns :
nive
au d
’occ
upat
ion
antiq
ue. U
S 10
041
: ter
re, p
ierr
es e
t ch
arbo
ns :
nive
au d
’occ
upat
ion
antiq
ue. U
S 10
042
: ter
re e
t ch
arbo
ns :
nive
au d
’occ
upat
ion
antiq
ue, r
ecou
vran
t le
sub
stra
t gé
olog
ique
.
110 – MARíA ANGELES MAGALLóN BOTAYA & CHRISTIAN RICO
| Fig. 25a. Le sondage C11 : vue de la paroi nord (cl. P. Sillières).
N° US Mobilier
07253
Céramique campanienne A
Céramique sigillée italique, dont fgt de Goud. 28
Céramique sigillée hispanique :– Coupes et bols Drag. 27, Hisp. 4 et 7
– Bols hémisphériques décorés Drag. 37
07255Céramique sigillée hispanique :– Plats et assiettes Drag. 15/17
– Coupes et bols Drag. 27, Hisp. 4– Bols hémisphériques décorés Drag. 37
07256Céramique ibérique peinte, kalathos et jarres
Céramique sigillée gallo-romaine, Drag. 24/25
Céramique sigillée hispanique (fgt indéterminé)
07260Céramique sigillée italique, dont fgts de Drag. 36/51, Goud. 40
Céramique sigillée gallo-romaine (forme indéterminée)
Céramique à parois fines
07291 Fgts de céramique ibérique peinte
Fgts de céramiques à parois fines
07293Céramique ibérique peinte
Céramique campanienne B
Céramique sigillée italique, dont Goud. 41B
Céramique sigillée gallo-romaine, Drag. 27
07295 Céramique ibérique peinte
Céramique sigillée italique, dont Goud. 71
| Sondage C11. Mobilier remarquable des US liées à l’occupation du Grand Bâtiment.
LA PREMIÈRE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LES ÉDIFICES DE LA PARTIE NORD DU FORUM – 111
Sondage C14 (2002)Pour obtenir des données chronologiques complémentaires à celles fournies par le sondage C11 et en espérant
qu’elles fussent plus précises, un nouveau sondage a été pratiqué à l’extrémité nord du passage entre la curie et le Grand Bâtiment. Ce sondage C14, long de 3 m, n’a été ouvert que sur une largeur de 1,60 m, car il était seulement destiné à examiner la stratigraphie liée au mur 10002 (fig. 3 et 26a). Il n’a pas paru nécessaire de fouiller la partie ouest du passage, correspondant à la tranchée de fondation du mur est de la curie et de son remplissage scellé par un empierrement de galets, dont les sondages C11 de 1999 et S 5 de 1998 avaient fourni les fossiles directeurs nécessaires à l’établissement de la datation du monument 13.
Dans cette partie du passage, les marnes vertes du substrat rocheux (US 10006), ont été assez vite atteintes, contrairement au sondage C11. Le dénivelé entre les deux secteurs est de 1,10 m, ce qui a rendu nécessaire, pour fonder le mur ouest du monument, de décaisser le substrat dans la partie nord et, du même coup, les niveaux qui le recouvraient. Aussi, les différentes phases stratigraphiques et chronologiques apparaissent-elles, dans le sondage C14, plus clairement que dans le sondage C11, même si la séquence stratigraphique y est moins importante (fig. 27b). La phase antérieure à la construction du mur ouest du Grand Bâtiment est représentée par une épaisse couche de terre argileuse marron-rouge (US 07285).
13. Voir ci-dessous, chap. 5, 241-243.
| Fig. 25b. Sondage C11 : coupe stratigraphique est-ouest (P. Sillières et M. C. Sopena). US 07001 : terre et graviers de la terrasse agricole moyenne. US 07026 : élévation du mur est de la curie. US 07120 = 10002 : élévation du mur ouest du Grand Bâtiment, l’édifice voisin de la curie, à l’est de celle-ci. US 07252 : terre marron, mortier, pierres et galets : décombres de bâtiments antiques et remblai de ruissellement formé après l’abandon du site. US 07253 : terre compacte, cailloutis, galets et abondant mobilier céramique : niveau de circulation dans la ruelle après la construction de la curie. US 07254 : pavement de galets et de mortier de chaux ; seulement présent dans la moitié ouest de la ruelle, il correspond au sommet du remblai apporté après la construction de la curie. US 07255 : mortier et graviers : sol de circulation ; dernier niveau coupé par la tranchée de fondation du mur est de la curie c’est-à-dire emprunté jusqu’à la construction de celle-ci. US 07256 : mortier et graviers : sol et niveau de circulation antérieur à la construction de la curie. US 07257 : argile rougeâtre avec pierres et tuiles : remblai apporté après la construction du mur est (07026) de la curie pour combler sa fosse de fondation. US 07258 : paroi est du décaissement ouvert pour la construction de la curie. US 07259 : fondation du mur est de la curie. US 07260 : Terre avec charbons et cendres : niveau antérieur à la construction de la curie. US 07291 : terre et charbons : niveau antérieur à la construction de la curie. US 07292 : argile verdâtre avec tegulae et pierres : niveau antérieur à la construction de la curie. US 07293 : argile verte avec débris de fer, charbons et mortier : niveau postérieur à la construction du mur ouest du Grand Bâtiment. US 07294 : argile rougeâtre, cailloux et charbons : niveau recouvrant la tranchée de fondation du mur ouest du Grand Bâtiment, c’est-à-dire postérieur à la construction de celui-ci. US 07295 : argile rouge avec cailloutis : niveau coupé par la tranchée de fondation du mur ouest du Grand Bâtiment, c’est-à-dire antérieur à la construction de celui-ci. US 07296 : argile rouge, pierres calcaires, galets et mortier : remblai de la tranchée de fondation du mur ouest du Grand Bâtiment.
112 – MARíA ANGELES MAGALLóN BOTAYA & CHRISTIAN RICO
N° US Mobilier
07283
Céramique campanienne B (Lamb. 5)
Fgts de sigillée italique, dont un bord possible de la forme Conspectus 17
Sigillée hispanique : – Plats Drag. 15/17 et 18 ; estampille SEMPRON(ius), potier de Tricio
– Bols et coupes Drag. 8, 24/25, 27, dont un portant l’estampille OF SEM(pronii), Drag. 33, 35 et 46– Bols hémisphériques Drag. 37a (décors de métopes et de frises)
– Bols cylindriques Drag 30 à décor de métopes
Céramiques à parois fines, formes Mayet XXXIII et XXXIV
Fgt de lampe de type Firmalampen
07284
Céramiques grises indigènes et imitations de formes campaniennes
Sigillée hispanique :– Plats et assiettes Drag. 15/17, 18, 36
– Bols et coupes Drag. 8, 16, 24/25, 27 et 35– Couvercle, Drag. 7
– Bols hémisphériques décorés (ou lisses), Drag. 37
Imitations locales de sigillées hispaniques, formes Drag. 15/17, 27 et 37
07285
Céramique ibérique peinte
Fgts de sigillée italique, dont Goud. 37
Sigillée gallo-romaine, Drag. 15/17
Sigillée hispanique, dont fgt de bol Drag. 27
07286
Céramique campanienne B
Céramiques grises indigènes et imitations de formes campaniennes
Céramique ibérique peinte
Fgts de sigillée italique, dont Goud. 30b
Fond de sigillée gallo-romaine, estampille C. SILVI(i)
Sigillée hispanique : – Assiettes Drag. 15/17
– Bols et coupes Drag. 8, 24/25, 27 et 44– Vases Drag. 10 et 33
– Bols hémisphériques décorés Drag. 29b ou 37a
Céramique à parois fines, forme Mayet XXXIV
Fond de cazuela en céramique d’Afrique du nord, forme Lamb. 10a ou 10b
07288
Céramiques grises indigènes
Sigillée italique, dont frgts de Goud. 30 et 32
Sigillée gallo-romaine, dont fgts de Drag. 15/17
Sigillée hispanique : – Assiettes Drag. 18
– Bols et coupes Drag. 24/25, Drag. 27 et 33– Vases Hispanique 10, 20
| Sondage C14. Mobilier remarquable des US liées à l’occupation du Grand Bâtiment.
LA PREMIÈRE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LES ÉDIFICES DE LA PARTIE NORD DU FORUM – 113
| Fig. 26b. Sondage C14 : coupe stratigraphique est-ouest (C. Rico). US 10002 = 07120 : élévation du mur ouest du Grand Bâtiment. US 07283 : terre compacte, cailloutis, galets et abondant mobilier céramique : niveau de circulation après la construction de la curie. US 07284 : mortier et graviers : sol et niveau de circulation coupé par la tranchée de fondation du mur est de la curie. US 07285 : terre argileuse marron-rouge entaillée par la tranchée de fondation du mur ouest du Grand Bâtiment. US 07286 : mortier et graviers : remblai de la fosse de fondation du mur ouest du Grand Bâtiment. US 07287 : paroi de la tranchée de fondation du mur ouest du Grand Bâtiment. US 07288 : argile rougeâtre et cailloux : remblai de la fosse de fondation du mur ouest du Grand Bâtiment. US 07289 : argiles beige-verdâtre : remblai de la fosse de fondation du mur ouest du Grand Bâtiment.
| Fig. 26a. Le sondage C14, vue du sud (cl. C. Rico).
114 – MARíA ANGELES MAGALLóN BOTAYA & CHRISTIAN RICO
Celle-ci est coupée par la tranchée de fondation du mur (US 07287) dont le remplissage est constitué de trois strates (US 07286, 07288 et 07289). La couche 07284, qui scelle les niveaux 07285 et 07286, correspond à la phase d’occupation liée au Grand Bâtiment et est immédiatement antérieure aux travaux de construction de la curie. Et le niveau 07283, qui occupe toute la largeur du passage, s’est, quant à lui, formé après la construction de la curie. Dans le mobilier très abondant qu’il a livré, on relèvera la domination, parmi les céramiques fines, de la sigillée hispanique où les formes décorées ne sont pas peu nombreuses (plusieurs fragments de Drag. 37 et un vase Drag. 30 quasiment complet), ainsi qu’un fragment de lampe à canal type Firmalampen caractéristique du IIe s.
Le mobilier trouvé dans les strates antérieures (US 07285) 14 et contemporaines de la construction du Grand Bâtiment (US 07286 et 07288-07289) est tout à fait intéressant. Dans la première, on notera la forte présence de parois fines, dont plusieurs décorées, mêlées à des fragments de sigillées italiques et gallo-romaines. La céramique sigillée hispanique y est représentée à parts égales avec les deux autres catégories, soit une dizaine de fragments qui appartiennent aux premières formes fabriquées par les ateliers hispaniques, les plats Drag. 15-17 et les petits bols Drag. 24-25. Les remblais qui comblent la tranchée de fondation (US 07286, 07288 et 07289) du mur est du Grand Bâtiment renferment toujours, parmi un abondant mobilier céramique, outre des parois fines, très nombreuses, de la céramique sigillée italique et gallo-romaine, dont un fond de coupelle de type Drag. 27 estampillée C. SILVI de La Graufesenque 15, mais la sigillée hispanique est désormais dominante. Les formes appartiennent au répertoire des premiers temps de l’activité des ateliers de Tritium Magallum, c’est-à-dire du milieu du Ier s., notamment un possible bol caréné Drag. 29 et des fragments de vases Drag. 27, 24-25 et 18, Hispanique 4, 10 et 20. Ces dernières, et l’absence des vases apparus sous les Flaviens, bols hémisphériques Drag. 37 et coupelles barbotinées Drag. 35-36 en particulier, permettent de resserrer la chronologie aux années 50-60, que l’on retiendra pour la mise en place du chantier du Grand Bâtiment sur podium 16.
Un plan très incomplet, une restitution difficileAvec si peu d’éléments architecturaux conservés, la restitution du monument ne va pas sans difficultés et celles-ci
rejaillissent, du même coup, sur son interprétation. Qu’il ait eu une fonction publique découle de sa situation en bordure nord du forum. Le fait, d’autre part, qu’il ait survécu à la deuxième phase de monumentalisation de la cité mise en évidence, dans ce secteur de l’agglomération, par les importants travaux de construction de la curie à l’époque flavienne 17, démontre s’il en est besoin que le monument restait cher aux Labitolosani qui ne jugèrent pas nécessaire de le remplacer par un autre édifice plus en accord avec son temps. Mais il est vrai aussi que la construction n’était pas très ancienne et ce fait a certainement joué dans la décision de la conserver.
Édifice politique, administratif, cultuel ? Il convient d’abord d’examiner, au vu des éléments retrouvés, les différentes possibilités de restitution. Peut-être alors pourra-t-on trancher.
Assurément, le monument devait s’imposer par son aspect plutôt massif dans le paysage urbain de la petite cité pyrénéenne. Il se présentait sous la forme d’un grand podium dont la façade sud, qui se développait sur plus de 15 m d’ouest en est, dominait d’au moins trois mètres, et même sans doute plus, l’esplanade du forum. C’est là notre seule certitude. Pour le reste, et en particulier l’accès à l’intérieur de l’édifice et son organisation interne, les lacunes sont grandes ; aussi les possibilités de restitution, on va le voir, sont-elles d’autant plus limitées.
L’accès de l’édifice En raison de l’état très arasé des maçonneries, l’entrée du monument n’a pas laissé de traces. On peut être sûr qu’elle
n’était pas au nord, seul endroit où l’édifice a conservé sur un tout petit peu plus d’un mètre de hauteur le mur de façade
14. Ce niveau, très riche en mobilier, est en effet coupé par la tranchée de fondation du mur ouest du Grand Bâtiment (US 07287).15. Le potier C. Silvius est daté par Genin 2007, 249, de l’époque flavienne, en raison de la présence de vases estampillés à son nom
dans des contextes de la fin du Ier et du début du IIe s. (fosse Bassus et grand four). Mais il est à remarquer qu’ils le sont en faible nombre d’exemplaires. Celui de Labitolosa permet de placer le début de son activité aux années 60 au plus tard.
16. La fouille d’une partie de la tranchée de fondation du mur est (US 10020) n’a pas fourni, de son côté, d’éléments plus précis. Dans le remplissage, formé d’une série de strates d’épaisseur, consistance et composition diverses mais regroupées sous un même numéro, US 10021, le mobilier se distingue par sa rareté. À côté d’un fragment informe de vase sigillé italique, ont été trouvés deux fragments de sigillée hispanique, dont un appartenant peut-être à une assiette de type Drag. 15-17.
17. Voir la présentation de la curie, infra, chap. 5.
LA PREMIÈRE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LES ÉDIFICES DE LA PARTIE NORD DU FORUM – 115
au-dessus de la fondation ; il n’est en effet percé d’aucune ouverture. Du côté ouest, si une entrée a pu exister à l’origine, elle a forcément été condamnée lors de la construction de la curie et, surtout, du réduit qui a été accolé à l’est de celle-ci. Il occupait en effet toute la largeur du passage ménagé entre la façade est de la curie et le mur ouest du Grand Bâtiment 18. Il est peu vraisemblable par conséquent qu’une entrée ait existé de ce côté avant l’édification de la curie, d’autant plus, d’autre part, qu’un édifice s’y trouvait déjà avant que celle-ci ne fût construite 19. L’espace libre à l’ouest de notre monument devait donc être limité. Or, de par sa taille, il devait être doté, sinon d’une entrée monumentale, en tout cas d’un accès dégagé. Restent alors les solutions d’un accès par le sud d’un côté, et par l’est de l’autre. Chacune a ses arguments, différents toutefois et pas du même poids.
Une première hypothèse consisterait à restituer un grand escalier du côté sud, dans l’axe nord-sud du monument. Elle semblerait la plus logique dans la mesure où un tel escalier ouvrirait l’intérieur de l’édifice sur la place du forum qu’il dominait d’au moins 2,50 m. L’escalier comporterait dès lors une dizaine de degrés d’une hauteur de 0,25 m chacun, dont on pourrait imaginer qu’ils avaient été taillés dans le grès. On peut envisager deux possibilités. Dans la première, l’escalier démarrerait en arrière du mur de façade (US 10022). Pourtant, celui-ci, ou, plus précisément, sa semelle de fondation, ne montre aucune coupure dans son tracé, qui garde rigoureusement d’un bout à l’autre la même largeur. Surtout, le profil du substrat géologique en arrière du mur 10022 ne présente aucun aménagement particulier qui signalerait un escalier. Les marnes sont, sur toute la longueur du mur de façade, entaillées plus ou moins verticalement sur une hauteur moyenne de 0,60 m et on n’y observe aucune rupture. Si donc l’escalier n’était pas pris dans le gros œuvre du podium, pouvait-il avoir été placé devant le monument, à l’instar des grands massifs à degrés que l’on connaît dans les temples romains ? C’est peu probable, en raison de l’absence de traces d’ancrage qu’une telle construction aurait inévitablement laissé dans le substrat rocheux devant le monument. Mais un autre élément conduit à écarter cette solution architecturale, c’est la présence, dans l’axe du monument, à 1,50 m au sud de sa façade, d’une base maçonnée de plan carré de 1,40 m de côtés (fig. 27), mise au jour en 1992 (US 10021 = US 05007). S’il est difficile de lui attribuer une fonction précise (support de piédestal de statue ?), elle n’avait pas de lien avec l’édifice auquel elle semble, d’autre part, chronologiquement antérieure 20. Il est par conséquent très vraisemblable que celui-ci présentait, sur l’esplanade du forum, une façade aveugle, on y reviendra. C’est alors du côté est qu’il faut rechercher l’ouverture permettant de pénétrer à l’intérieur de l’édifice.
Comme son vis-à-vis ouest, le mur est (US10005) est arasé très bas, au niveau supérieur des marnes en place (altitude variant du nord au sud de 600,31 à 598,62 m). Au niveau de la terrasse agricole médiane, la fondation a même été en partie épierrée. C’est lors du nettoyage effectué pour en retrouver la base qu’a été constaté, à 6,90 m de l’angle nord-est du monument, un niveau de gros galets longeant sur 1,80 m le mur et s’appuyant contre lui. Une fouille plus profonde 21 a permis alors de mettre au jour, sous les restes des remblais de la terrasse agricole moderne et à peu près dans l’axe de l’édifice, un empierrement de galets et de blocs de calcaire (US 10050) s’étendant, sans véritable organisation, d’ouest en est sur 3,50 m et du nord au sud sur 2,10 m, soit une surface proche de 7,5 m2 (fig. 28 et 29). Cet empierrement, lié à une terre brune, est directement aménagé dans le substrat argileux. L’altitude supérieure est de 600,06 m. S’il n’a pas été fouillé, il est visible sur une quinzaine de cm de hauteur dans la paroi est de la tranchée de fondation du mur 10005 en partie épierré. Parfaitement circonscrit dans les argiles rouges qui forment le substrat, il ne peut correspondre à un niveau de circulation. On proposera d’y voir les restes d’un radier, détérioré par les travaux agricoles modernes, qui aurait pu supporter un escalier, voire une rampe donnant accès à l’intérieur de l’édifice, puisque celui-ci se trouvait, à l’origine, à moins d’un mètre au-dessus du sol extérieur. De l’entrée elle-même, on ne peut rien dire, mais il y a fort à parier qu’un soin particulier lui avait été porté ; on peut imaginer que, comme pour les chaînages d’angle, le grès avait été utilisé pour les montants et peut-être même le linteau. Aller au-delà serait pure spéculation.
L’intérieur : un espace à ciel ouvert ?À l’intérieur, le monument forme un espace de 14,85 m x 17,45 m, soit à peu près 50 sur 60 pieds. Son sol était revêtu
d’opus signinum, dont on peut penser qu’il était partout présent, en tout cas qu’il courait le long de ses quatre murs. Le seul vestige de l’aménagement intérieur est, on l’a vu, le mur 10014, parallèle au mur de fermeture nord 10003, distant de 3,75 m
18. Voir également infra, chap. 5, 219-220.19. Voir ci-dessus, chap. 2, 71-72.20. Voir ci-dessus, chap. 2, 69 et fig. 2.21. Sondage S.10-2, de 4,50 m de côtés : cf. Labitolosa 2002, 346.
116 – MARíA ANGELES MAGALLóN BOTAYA & CHRISTIAN RICO
| Fig. 27. Base maçonnée US 10021 (= 05007) devant la façade du Grand Bâtiment (cl. C. Rico).
| Fig. 28. Empierrement US 10050 dans l’axe ouest du Grand Bâtiment, vu de celui-ci (cl. C. Rico).
| Fig. 29. Empierrement US 10050, vu de l’est (cl. C. Rico).
LA PREMIÈRE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LES ÉDIFICES DE LA PARTIE NORD DU FORUM – 117
de celui-ci, soit 12,60 pieds, et de 4,45 m du mur ouest 10002, soit 15 pieds ; il est conservé sur 4,16 m de longueur. On peut supposer d’ores et déjà qu’il existait une symétrie entre les extrémités ouest et est du mur US 10014 par rapport aux murs latéraux du monument, soit 15 pieds. Dans cette hypothèse, on peut restituer avec vraisemblance un mur d’une vingtaine de pieds de longueur. Appartenait-il à une construction centrée, dont les quatre côtés auraient été, deux à deux, à même distance, d’un côté, des murs sud et nord, de l’autre des murs latéraux ouest et est, soit, respectivement 12,60 pieds et 15 pieds ? Cela conduirait à imaginer une construction rectangulaire orientée nord-sud de 20 pieds de largeur sur 33,50 pieds de longueur, en opus incertum et chaînages d’angle en grand appareil de grès. Quelle aurait pu être sa fonction ? L’idée qui vient en premier à l’esprit est celle d’un mur stylobate supportant la colonnade d’un quadriportique. Mais elle est à écarter en raison d’une part de la faible profondeur de la fondation du mur 10014, qui est plus posée sur les marnes en place qu’elle n’est ancrée dedans, et d’autre part de la faible largeur des murs extérieurs du monument, 0,45 m. Les maçonneries paraissent ainsi bien trop fragiles pour supporter le poids que représenterait l’assemblage de colonnes, de blocs d’entablement, de poutres et de tuiles formant un tel portique 22. D’un autre côté, la grande surface au sol n’invite pas à restituer un édifice couvert et conduit plutôt à penser à un espace à ciel ouvert, dont les quatre murs de façade formeraient la clôture. Quant à l’aménagement intérieur, on ne peut que se perdre en conjectures. L’hypothèse d’une construction rectangulaire centrée, examinée ci-dessus, est toujours envisageable. Était-elle à l’air libre ou couverte d’une toiture ? Là encore, la faible profondeur de la fondation du seul mur conservé n’est pas un argument en faveur de cette dernière solution. De fait, le mur 10014 pourrait tout aussi bien appartenir à un petit édifice allongé d’ouest en est, ouvert au sud, où ont pu être disposés, par exemple, des autels ; ou faut-il y voir un petit édicule abritant quelque statue de culte ?
L’absence de parallèles dans le monde romain n’aide pas à se faire une représentation de l’intérieur du monument. Les activités qui s’y déroulaient étaient-elles “cachées” à l’extérieur par le mur de péribole, ce qui permettrait de voir dans ce monument un édifice à vocation religieuse ? Il reste pourtant bien difficile d’estimer la hauteur des élévations du monument ; on peut être sûr qu’elles n’étaient pas inférieures à un mètre, qui est la hauteur conservée au mur de fermeture nord.
La façade sud et la bordure nord du forum au milieu du I er s.Assurément, le monument se distinguait par son grand mur de façade aveugle ; il en imposait même. Long de 15,75 m,
il devait avoir une hauteur minimale de 4,20 m, addition du mur du soubassement, 3,20 m, et du péribole qui le couronnait, au moins un mètre. Mais il est probable que la façade que le monument présentait devant l’esplanade du forum était plus haute. L’aspect pose tout autant problème. On est sûr que l’élévation du soubassement comportait au moins deux assises d’opus quadratum de grès et que les chaînages d’angle étaient également en grands blocs rectangulaires de grès. Le reste était-il également appareillé en grès ? On n’a aucun élément pour l’affirmer, même si l’idée d’un appareil isodome ne manque pas d’être séduisante. Partie noble du monument parce qu’elle dominait la place du forum, la façade a pu faire l’objet d’un soin particulier. Il faudrait restituer alors au moins neuf assises faites chacune de quinze parpaings de 1,10 m de longueur et de 0,49 m de hauteur.
Autre solution architecturale, le grand appareil de grès aurait été réservé aux premières assises du soubassement et aux chaînages d’angle, le reste de l’élévation étant réalisé en moellons de calcaire liés au mortier, comme sur les trois autres murs, soubassement et élévations, du monument. On peut se demander toutefois si, étant donné la longueur de la façade, l’opus incertum n’aurait pas été renforcé par des harpes en grand appareil de grès. C’est donc un grand mur en opus africanum qu’il faudrait restituer, technique d’appareillage dont on connaît de beaux exemples de par le monde romain. On ne peut exclure enfin que seul le soubassement ait été en opus quadratum, l’élévation du péribole en moellons, les chaînages d’angle restant en grands blocs de grès. A priori, aucune solution ne peut être préférée à une autre. On notera cependant que l’appareil mixte, qui associe une base de deux ou trois assises de parpaings de grès posés à joints-vifs et une élévation de moellons de calcaire, est attesté dans les façades méridionale et orientale des Thermes I, dont la construction est contemporaine de notre édifice 23.
Ce Grand Bâtiment s’inscrit dans un programme édilitaire d’envergure qui a transformé sans doute radicalement tout au moins la partie nord du centre de la cité et lui a donné un aspect plus monumental qu’elle n’avait à l’origine. On ne doit pas en effet dissocier sa construction de l’aménagement d’un mur de terrasse bordant au nord la place du forum – ou ce qui en tenait lieu jusque là – et dont les seuls vestiges sont les tronçons de murs en grand appareil de grès qui viennent s’appuyer
22. Plus exactement, 4,20 m et 4,90 m, puisqu’il faut ajouter la largeur des murs de la construction centrale.23. Les Thermes I sont présentés plus loin, au chap. 4.
118 – MARíA ANGELES MAGALLóN BOTAYA & CHRISTIAN RICO
contre les murs latéraux ouest et est du monument. Celui-ci, qui avance de 1,45 m sur la place du forum par rapport au mur de terrasse en question, pourrait avoir constitué le centre de ce nouvel aménagement. Mais il est difficile de s’en assurer. Côté ouest, la construction de la curie, puis celle du chemin rural et des terrasses agricoles modernes a complètement bouleversé la physionomie du secteur. À l’est, il faudrait étendre les fouilles pour vérifier que le mur de terrasse existe effectivement sous les parcelles actuelles plantées en oliviers.
Cette terrasse avait, à l’ouest, une longueur d’au moins 13,50 m. Côté est, on peut penser qu’elle était aussi longue que le Bâtiment Est, l’édifice construit au-delà du Grand Bâtiment à la rupture de pente de la colline et dont le mur de fermeture nord, comme on va le voir, a pu être suivi sur 12,60 m. L’ensemble formé par la façade méridionale du Grand Bâtiment et par les deux murs de terrasse à l’ouest et à l’est de celui-ci se développait donc, en bordure nord du forum, sur une longueur d’au moins 42 m. L’altitude de la terrasse est donnée par l’empierrement de galets mis au jour contre le mur est du monument (US 10050), soit autour de 600 m. Elle dominait donc de 1,80 à 2 m la place du forum au sud. Il faut dès lors restituer un mur de terrasse deux fois plus haut que celui qui nous est parvenu, 0,86 m au mur 10071, à l’est du Grand Bâtiment. Quatre assises supplémentaires de parpaings de grès peuvent être restituées, à moins que l’élévation au-dessus du grand appareil n’ait été réalisée en moellons de calcaire. Dès lors, un escalier devait permettre de passer d’une terrasse à l’autre. Nous proposons de situer cet escalier, du côté oriental du monument, au delà de l’extrémité du mur 10071 (fig. 21), là où la fouille n’a révélé que des remblais agricoles modernes. Si on admet que le bloc de grès (US 10075), à moitié mis au jour en limite de fouille et situé dans le prolongement du mur 10071, appartient aussi à un mur de grand appareil, alors on donnera une largeur de 2,60 m à cet escalier, qui pourrait avoir comporté sept ou huit degrés. On peut proposer de restituer un escalier identique dans le mur de terrasse occidental (US 07124 et 07130) afin d’accéder depuis le forum à l’édifice d’époque augustéenne dont les vestiges sont apparus lors de la fouille de la curie 24. Côté est, l’escalier distribuait autant le monument sur podium, dont on a vu que l’accès se faisait par une ouverture pratiquée dans son mur latéral est (US 1005) qu’un deuxième édifice qui fermait au nord la terrasse supérieure. Les vestiges de ce “Bâtiment Est” ont été mis au jour lors de la campagne 2001.
UN DEUXIÈME ÉDIFICE PUBLIC AU NORD DU FORUM : LE “BÂTIMENT EST” 25
Le plan de ce deuxième édifice ne nous est parvenu qu’incomplet et il sera bien difficile d’en proposer une restitution satisfaisante. Sans doute était-il en partie enseveli quand les paysans du XVIIIe s. ont fini de le détruire. Seule la partie arrière de l’édifice a été épargnée parce que son mur de fermeture nord (US 10102) s’appuyait contre la colline (fig. 30). Le mur du fond a pu être suivi sur 12,60 m de longueur ; au-delà, il a été démoli lors de la construction de la terrasse agricole la plus haute de la parcelle. À l’inverse, la partie avant du monument a été entièrement arasée lors de la mise en place de la terrasse agricole intermédiaire ; aussi ne reste-t-il plus rien de sa façade, qui a été entièrement démantelée, fondations comprises. De l’agencement intérieur on conserve deux murs de direction nord-sud (US 10105 et 10106) qui délimitaient trois pièces disposées en enfilade d’ouest en est (pièces P1, P2 et P3 sur la pl. 1 et fig. 3). La plus à l’ouest, la pièce P1, a une largeur de 3,50 m ; sa voisine à l’est, la pièce 2, 6,25 m. De la pièce 3, on ne conserve que l’angle nord-ouest ; le reste a été détruit par les paysans modernes. Les niveaux de circulation des pièces 1 et 2 sont à 10 cm près à la même altitude que le sol en opus signinum du Grand Bâtiment, soit 600,96 m (fig. 31). En revanche, le sol de la pièce 3, disparu, se trouvait un mètre plus bas, à 599,95 m. Le niveau est donné par la base de l’enduit conservé dans l’angle de la pièce sur une hauteur de 0,60 m (fig. 32).
La stratigraphie est peu complexe et, du coup, il nous manque les éléments chronologiques indispensables pour dater avec précision la construction de l’édifice. Dans les pièces 1 et 2, une couche de destruction d’une trentaine de centimètres d’épaisseur et remplie de matériaux de construction, en particulier de tegulae et d’imbrices (US 10107 dans la pièce 1 (fig. 33) ; US 10108 et 10110 dans la pièce voisine), elle-même scellée, sur toute la superficie de l’édifice, par un important niveau d’abandon (US 10104) de 0,80 m à 1 m d’épaisseur, recouvre le substrat dans lequel les murs du bâtiment sont fondés peu profondément, en tranchée pleine. Aucun sol aménagé ou construit en dur n’a été observé. Faute de fossiles directeurs, la date précise de construction de l’édifice nous échappe. Toutefois, quelques observations sur les appareils de murs permettent, d’une part, de situer en chronologie relative sa construction par rapport à celle du Grand Bâtiment, et, d’autre part, d’entrevoir un réaménagement partiel de l’édifice originel.
24. Ce bâtiment a été présenté supra, chap. 2, 71-72.25. Appelé “Édifice 2” dans les rapports de fouille et dans les chroniques Labitolosa 2001 et Labitolosa 2002.
LA PREMIÈRE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LES ÉDIFICES DE LA PARTIE NORD DU FORUM – 119
| Fig. 30. Vestiges en fin de fouille (2001) de l’édifice situé à l’ouest du Grand Bâtiment (cl. C. Rico).
| Fig. 31. Sol de la pièce 1 de l’édifice accolé au Grand Bâtiment (Bâtiment Est) (cl. C. Rico).
| Fig. 32. Restes d’enduit à l’angle des murs nord-ouest de la pièce 3 du Bâtiment Est (cl. C. Rico).
| Fig. 33. Couche de destruction US 10107 de la pièce 1 du Bâtiment Est (cl. C. Rico).
120 – MARíA ANGELES MAGALLóN BOTAYA & CHRISTIAN RICO
Une construction légèrement postérieure à celle du Grand Bâtiment sur podiumL’édifice est accolé perpendiculairement au Grand Bâtiment, dont il est solidaire par son mur ouest. En effet, celui-ci
est constitué en partie du mur oriental du Grand Bâtiment (US 10005), contre lequel vient s’appuyer un nouveau mur (US 10101) qui le prolonge sur une longueur de 2,97 m et qui forme, avec le mur nord (US 10102), l’angle nord-ouest de l’édifice (fig. 10). Le mur est du Grand Bâtiment fait donc, dans sa partie nord, office de mur mitoyen pour les deux monuments. Assurément, la construction de ce deuxième édifice est postérieure à celle du Grand Bâtiment ; mais elle n’en est pas forcément très éloignée dans le temps. Nous en voulons pour preuve l’appareil utilisé pour les élévations, un opus incertum de moellons de calcaire grossièrement taillés et de dimensions moyennes, liés à un mortier de chaux assez pauvre. Il est très proche de celui des élévations du Grand Bâtiment. Toutefois, à la différence de ce que l’on observe dans ce dernier, le grès ne fut pas utilisé comme matériau pour les chaînages d’angle.
Le mur du fond (US 10102), conservé sur 12,60 m et présentant une hauteur maximum de 1,23 m (mesurée dans la pièce 2), est bâti de la même façon, en gros moellons de calcaire liés à la chaux. Sa largeur, visible dans la coupe du terrain à l’extrémité orientale conservée, semble prendre progressivement de l’épaisseur du bas vers le haut, passant de 0,45 m à 0,85 m, ce qui est dû à la nécessité de contenir les terres de la colline qui a été entaillée pour placer le bâtiment et contre laquelle il prend appui (fig. 34 et 35). On retrouvera cette même technique de soutènement dans le mur de fermeture nord de la curie 26. La différence avec celle-ci est que le mortier y est abondamment utilisé, ce qui n’est pas le cas ici ; l’arrière du parement du mur 10102 présente davantage l’aspect d’un chaos de blocs de calcaire sans véritable organisation et qui ne semblent pas avoir été liés au mortier.
On peut donc dire que si la construction de ce Bâtiment Est apparaît postérieure à celle du Grand Bâtiment, elle est aussi antérieure à celle de la curie. On peut supposer de fait que son aménagement intervint assez rapidement après la construction du Grand Bâtiment. Il semble toutefois que l’état dans lequel l’édifice nous est parvenu n’est pas celui qu’il avait à l’origine. En effet, d’autres observations montrent qu’il a connu, dans un second temps, des transformations qui ont sinon changé son organisation intérieure, du moins modifié en partie son aspect.
Un remaniement à la fin du Ier s. ?Comme on l’a vu, deux murs de refend de direction nord-sud, US 10105 (ouest) et US 10106 (est), larges l’un et
l’autre de 0,45 m, subdivisent l’espace intérieur en trois pièces, dont on n’a qu’un plan incomplet puisque tout l’avant de l’édifice a été détruit par les travaux agricoles modernes. On a également constaté que leur appareil ne diffère pas de ceux des murs de fermeture ouest et est ; l’un et l’autre présentent en effet deux parements en moellons de calcaire de tailles moyennes liés à la chaux et enserrant un mince blocage interne de pierraille et de mortier. Les deux murs ne sont cependant pas liés au mur du fond contre lequel ils s’appuient (fig. 36). Ce pourrait être un indice que leur construction n’était pas prévue dans le projet initial et qu’ils ont donc été rajoutés postérieurement.
Pourtant, une particularité dans l’architecture de la pièce 2 contredit cette conclusion. Dans celle-ci, le mur du fond est revêtu d’un parement de moellons à peu près quadrangulaires et calibrés, de plus petites tailles que les moellons des autres murs, 10 à 15 cm de côtés, noyés qui plus est dans un abondant mortier de chaux (fig. 36 et 39). Ce parement forme une saillie de 11 cm à l’ouest et de 17 cm à l’est par rapport au mur du fond 10102 et il n’est pas d’autre part lié aux deux murs intérieurs 10105 et 10106. Ceux-ci existaient donc déjà lorsque le mur du fond de la pièce 2 a reçu un nouveau parement, dont on remarquera d’ores et déjà qu’il s’apparente beaucoup, par l’utilisation de moellons calibrés et de mortier de chaux en abondance, aux maçonneries de la curie, des Thermes II et de la domus située au sud de ce second bâtiment thermal. Or, ces édifices appartiennent à la deuxième grande phase de monumentalisation de la ville mise en lumière par nos fouilles 27.
À la base de ce nouveau parement, se trouve une assise de huit blocs rectangulaires de grès (US 10109) disposés à la file et reposant directement sur le substrat (fig. 37 à 39e). La mise en place de cette structure est assurément contemporaine du parement de moellons contre lequel elle s’appuie. Aucun des blocs n’est strictement identique, même si les dimensions varient peu des uns aux autres (fig. 39a à 39e) : les longueurs sont comprises, pour sept d’entre eux, entre 0,71 m et 0,81 m,
26. Cf. ci-après, chap. 5, 222-226.27. Cf. chap. 5, 6 et 7.
LA PREMIÈRE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LES ÉDIFICES DE LA PARTIE NORD DU FORUM – 121
| Fig. 34. Vue de la pièce 2 du Bâtiment Est. Noter la largeur irrégulière du mur du fond, US 10102 (cl. C. Rico).
| Fig. 35. Vue depuis l’est de l’arase du mur du fond de la pièce 2 du Bâtiment Est (cl. C. Rico).
| Fig. 36. Détail de l’accroche entre les murs 10104 et 10105 du Bâtiment Est. Noter le parement de moellons dont a été revêtu le mur du fond dans la pièce 2 (cl. C. Rico).
| Fig. 37. Vue d’ensemble du parement de moellons noyés dans la chaux de la pièce 2 (cl. C. Rico).
| Fig. 38. Assise de blocs de grès (US 10109) contre le mur du fond de la pièce 2 (cl. C. Rico).
122 – MARíA ANGELES MAGALLóN BOTAYA & CHRISTIAN RICO
| Fig. 39a. US 10109 : blocs 1 et 2 (cl. C. Rico). | Fig. 39b. US 10109 : bloc 3 (cl. C. Rico).
| Fig. 39c. US 10109 : blocs 4 et 5 (cl. C. Rico). | Fig. 39d. US 10109 : bloc 6 (cl. C. Rico).
| Fig. 39e. US 10109 : blocs 7 et 8 (cl. C. Rico).
LA PREMIÈRE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LES ÉDIFICES DE LA PARTIE NORD DU FORUM – 123
les largeurs entre 0,27 et 0,32 m ; seules les hauteurs sont à peu près constantes, de 0,24 à 0,28 m. Un seul bloc, celui situé à l’angle des murs 10105 et 10102, présente une longueur nettement inférieure à la moyenne, puisqu’elle n’est que de 0,54 m. Mais on observe que le bloc a été retaillé aux dimensions de l’espace disponible entre l’angle de la pièce et le bloc voisin (n° 2) 28. C’est là un autre élément qui permet de croire que les deux murs 10105 et 10106, bien que n’étant pas liés au mur du fond, étaient en place quand la salle 2 a été réaménagée.
Tous les blocs, malgré leur usure, montrent un profil unique. Leur face supérieure présente une moulure taillée en forme de talon inversé légèrement arrondi, de 10 cm de large et 4 cm de hauteur. Par ailleurs, cinq des huit blocs, les deux situés aux extrémités de la file et les 3e, 5e et 6e en partant de l’ouest, sont creusés soit en leur centre, soit à une de leur extrémité, d’encoches peu profondes et à peu près carrées (10-12 cm de côté en moyenne). L’espacement, régulier, est de 1,20 m ± 0,02 m. Ces encoches étaient vraisemblablement destinées à recevoir des montants de bois de même section qui se trouvaient dès lors plaqués contre le mur du fond 29. Quel usage avait cet assemblage ? Il est peut-être donné par la découverte, à la base de la couche de destruction US 10108, de plusieurs baguettes de bronze, soigneusement découpées, et de fragments de tôle en bronze également 30 ; ils étaient réunis en un même tas dans l’angle nord-ouest de la pièce, en attente vraisemblablement d’être fondus ou réutilisés. L’origine de ces morceaux de bronze pose évidemment problème. Deux solutions s’offrent à nous. La première est que ces fragments de tôles et de baguettes sont les restes d’objets collectés en différents points de la ville, regroupés dans la pièce de notre bâtiment puis découpés avant d’être emballés dans des sacs et transportés ailleurs. La seconde est de relier ces éléments de bronze à des objets qui étaient conservés dans le bâtiment. Les baguettes nous intéressent plus particulièrement. Il s’agit de moulures d’encadrement, de quatre types différents, qui ne sont pas sans rappeler celles que conservent les grandes inscriptions sur bronze de Malaca et de Salpensa. Nos baguettes ont-elles la même origine ? On ne peut l’exclure. Dans cette hypothèse, nous proposerions volontiers de voir dans la pièce 2 la salle des archives, le tabularium de la cité où étaient conservées mais aussi affichées les lois de la cité. Celles-ci, gravées sur des plaques de bronze dont pourraient provenir les quelques fragments de tôles, hélas anépigraphes, retrouvés aux côtés des baguettes auraient été clouées aux montants de bois dressés contre le mur du fond de la salle, au-dessus de l’alignement de blocs en grès 31.
L’hypothèse prend toute sa signification si on se rappelle que la réfection que connaît la pièce 2 du bâtiment s’inscrit très vraisemblablement dans la seconde phase de monumentalisation de la cité, liée, comme on le verra dans les chapitres qui suivent, à l’obtention du droit latin et l’accession au rang municipal. Celles-ci se concrétisèrent par l’octroi, par l’empereur, d’une charte qui, gravée dans le bronze, devait être affichée dans un lieu public pour être vue de tous. Ce lieu existait et, au même moment où les édiles de Labitolosa entreprirent de gros travaux pour doter la cité d’une curie en accord avec son nouveau statut, il aurait été simplement réaménagé pour accueillir les grandes tables de bronze sur lesquelles étaient inscrites les règles de fonctionnement du nouveau municipe. Si on retient cette idée, on conclura que notre édifice avait dès le début une fonction en rapport avec l’administration de la cité ; sa situation sur la terrasse dominant la place du forum est, du reste, un autre argument pour lui conférer un rôle officiel. Quant à la pièce centrale, qui est aussi la plus large des trois espaces de l’édifice, si elle servit bien de tabularium, cette fonction n’avait peut-être pas été la sienne au moment où le bâtiment fut conçu et construit 32.
L’aspect du plan d’ensemble du Bâtiment Est ne peut faire l’objet que d’hypothèses. Certainement plus long que large, sa partie antérieure comme son extrémité orientale ont été entièrement démolies par les paysans du XVIIIe s. Si l’on restitue à l’est une pièce symétrique à la pièce 1 (ouest), le bâtiment aurait une longueur hors-œuvre d’un peu plus de 15 m. Dans le sens nord-sud, l’édifice avait une largeur supérieure à 5,17 m, qui est la longueur conservée du mur de séparation
28. Cela donne d’ailleurs le sens dans lequel les blocs ont été successivement posés, d’est en ouest. Les sept premiers blocs sont, du reste, entiers.
29. On n’observe pas, dans la maçonnerie du mur du fond “reparementé”, de traces pouvant correspondre à des fixations qui auraient maintenu les montants de bois contre le mur. Ceux-ci ont dû être mis en place par pression, d’où les logements dans les parpaings de grès, et devaient par conséquent être de même hauteur que les murs de la pièce.
30. Voir ci-après, annexe, 125-127.31. Certes, vu l’espacement des montants (1,20 m), on aurait affaire à de grandes inscriptions de bronze, bien plus longues que celles
d’Urso et de Salpensa (0,92-94 m) ou encore d’Irni (0,90 m). Mais la table de Malaca est, de son côté, longue de 1,28 m.32. Bien entendu, on ne peut rien dire de la destination des deux pièces qui l’encadraient.
124 – MARíA ANGELES MAGALLóN BOTAYA & CHRISTIAN RICO
entre les pièces 1 et 2. Assurément, les pièces 1 et 3 étaient plus profondes que larges. Mais il n’est pas nécessaire de donner une très grande profondeur à l’édifice. N’oublions pas en effet qu’il ouvrait sur l’esplanade qui desservait aussi le Grand Bâtiment voisin ; celle-ci devait avoir une superficie de 200-225 m2 33. L’aspect de la façade nous reste inconnu. Était-elle percée de trois portes ou d’une seule située dans l’axe de la pièce 2 ? Il est sûr en tout cas que l’accès à l’intérieur de l’édifice, où qu’il fût situé, se faisait par le biais d’un escalier. Le sol des pièces 1 et 2 l’édifice se trouvait, rappelons-le, à un mètre à peu près au-dessus de celui de l’esplanade extérieure.
Bien que profondément transformée par l’aménagement des terrasses agricoles par les paysans de l’époque Moderne, la partie nord du centre monumental de la cité de Labitolosa apparaît, au terme de plusieurs années de fouilles extensives, assez nettement, du moins pour ce qui concerne son organisation autour du milieu du Ier s. de notre ère. Cette période fut assurément marquée par une activité édilitaire de grande ampleur qui ne concerna pas le seul centre civique, politique, administratif et religieux de l’agglomération. Comme on le verra dans le chapitre suivant, la cité se dota au même moment d’un établissement de bains, édifié sur les terrasses au sud-ouest du forum. Quelques décennies avant son accession au statut de municipe de droit latin, la cité s’était donc engagée dans une transformation sans doute profonde de son apparence, preuve de la volonté de ses élites de se présenter comme une agglomération pleinement intégrée. Le centre civique et religieux fut logiquement le premier secteur de la ville concerné par ces travaux.
Il présentait, du nord vers le sud, un aspect étagé. La place du forum était en effet dominée au nord par une longue terrasse dont on peut estimer la longueur d’est en ouest entre 40 et 50 m ; sa largeur était d’une vingtaine de mètres. Cette terrasse était retenue du côté de l’esplanade du forum par un mur dont au moins la base était en opus quadratum de grès, percé d’un, sinon deux escaliers. Au centre trônait le Grand Bâtiment dont la haute façade, construite peut-être seulement en partie en grand appareil de grès, avançait de 1,45 m sur la place. L’état d’arasement des structures ne nous permet pas, malheureusement, de proposer une restitution plausible du monument dans son entier et, en particulier, de son aménagement intérieur. Il avait peut-être une vocation religieuse, mais sans aucune certitude. Sur la terrasse, ce podium était encadré par d’autres édifices qui eurent très probablement un rôle en rapport avec l’administration et la gestion de la cité. Du côté ouest, les travaux du milieu du Ier s. semblent avoir intégré un bâtiment préexistant, datant de l’époque augustéenne, mais sur lequel les éléments sont insuffisants pour lui attribuer une fonction précise. À l’est au contraire, les travaux ont été de plus grande ampleur puisqu’au Grand Bâtiment a été accolé, sans doute assez vite après sa construction, un édifice rectangulaire d’une quinzaine de mètres de long. Ce Bâtiment Est, construit à la rupture de pente de la colline, fermait au nord la terrasse supérieure. Il a pu avoir, dès le début, une fonction administrative ; à l’époque flavienne, il fut partiellement transformé, peut-être pour accueillir le tabularium de la cité.
On insistera sur le fait que la construction du Grand Bâtiment, celle du Bâtiment Est et l’aménagement de la terrasse supérieure au nord du forum ressortissent d’un même programme architectural, destiné à donner à la cité une parure monumentale digne d’une cité en voie de romanisation alors qu’elle ne jouissait pas encore d’un statut privilégié. Il trahit la présence d’élites actives et dynamiques qui avaient à cœur de créer un cadre de vie en accord avec leurs nouvelles préoccupations qui étaient celles de vivre “à la romaine” ; la construction, au même moment, d’un établissement thermal, peut-être le premier dont la cité se fût dotée, en est une autre illustration.
33. Cette superficie est calculée d’après la longueur supposée de l’édifice, autour de 15 m, et la distance supposée séparant la façade de celui-ci du mur de terrasse situé au sud, entre 13 et 15 m.
LA PREMIÈRE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LES ÉDIFICES DE LA PARTIE NORD DU FORUM – 125
ANNEXE
Los fragmentos de placas de bronce encontrados en la sala 2 del “Edificio Este” del foroMilagros Navarro Caballero
En la campaña de excavaciones del año 2001, en el “Edificio Este” del foro, concretamente en la estancia 2, en la UE 10108, apareció un conjunto de piezas broncíneas fragmentadas 34, aparentemente sin conexión entre ellas (fig. 40). Esta observación permitió suponer que tal vez podría tratarse de la acumulación olvidada de fragmentos arrancados de diferentes lugares del foro, de molduras, de áreas vacías de placas epigráficas o de recubrimientos de pedestales, destinados a ser refundidos, como se halló en Avenches 35. Otra interpretación es, sin embargo, posible: el lugar en el que se hallaron las placas pudiera ser el tabularium, esto es, el archivo del municipio, en el que se conservaban las copias de las normas jurídicas expuestas en público. Esta segunda hipótesis parte de la observación siguiente: en el muro norte, en el zócalo de piedra arenisca adosado al opus caementicium, se detectan huellas de posibles elementos de madera, ubicadas a distancias equivalentes, tal vez pertenecientes a un expositor o a un armario. Sea como fuere, se tratarían de piezas asociadas al conjunto epigráfico del foro.
Pieza n° 1 (fig. 40-41): se trata del fragmento dividido en tres partes de una placa de bronce de 29,8 cm de longitud máxima por 9,8 cm de anchura y 0,2 cm de grosor. Conserva el borde original por un lado del dibujo, en el que se recreó un somero marco moldurado de 1,1 cm de anchura, formado por un simple listel y un ligero movimiento en chaflán hacia el interior. En el centro, aparece una perforación aproximadamente cuadrangular que seguramente estuvo destinada a recibir el clavo que sostenía la placa. Diversas fisuras surgen de dicha perforación por la debilitación del bronce al ser arrancado de su soporte originario. Podría ser parte vacía de caracteres paleográficos de una placa epigráfica o simple recubrimiento lateral de un pedestal 36.
La superficie de su cara posterior está rayada por estrías producidas por el pulimento con un instrumento abrasivo. Tal circunstancia pudiera deberse a la necesidad de lijar una superficie rugosa o al cubrimiento con la placa de una superficie ligeramente irregular, como pudiera ser la cara superior del pedestal del Genio.
Pieza n° 2: fragmento de placa de bronce de forma casi rectangular con un ligero desperfecto en un ángulo. Mide 10,2 cm de longitud máxima, de 3,4 cm de altura y de 0,3 cm de grosor.
Pieza n° 3 (figs. 41a y 41b): fragmento de moldura de 15,7 cm de longitud maxima, de 2,3 de anchura cm y de 0,6 cm de grosor. Su perfil es semejante al borde de la placa n° 2. Sin embargo, no formaban parte de la misma pieza
34. Ver supra, 123. También Labitolosa 2001, 378 y Labitolosa 2002, 348. 35. Kaufmann-Heinimann 1998, 278 y lám. 239. En dicho conjunto aparecen molduras, restos de plaça y fragmentos de pequeñas
estatuas rotas. Agradecemos a Romana Erice sus consejos y ayuda en el análisis de dichas piezas de bronce.36. Álvarez & Nogales 2003, 266-267, consideran que las plaças nos 56 y 57 halladas en el foro de Mérida, semejantes a ésta descubierta
en Labitolosa, podrian formar parte del piédestal del Genius del Senatus.
| Fig. 40. Fragmentos de placas de bronce encontrados en la sala 2 del “Bâtiment Est” (cl. M. A. Magallón Botaya).
| Fig. 41a. Fragmento de moldura (cl. M. A. Magallón Botaya).
126 – MARíA ANGELES MAGALLóN BOTAYA & CHRISTIAN RICO
por varias razones: en primer lugar, la anchura del marco moldurado es mayor que la del precedente; en segundo lugar, en el resto anterior la moldura está fundida en la misma pieza, mientras que ésta se aplicó después, cubriendo los bordes de una placa prealablemente realizada, como se observa en la lex coloniae Genetiuae Iuliae Ursonensis. Una vez que la placa fue inscrita, se le aplicó el marco moldurado, adosándolo a través de pequeñas clavijas de hierro 37, una vez recalentado el metal: en efecto, se observan en él huellas de burbujas que bien pudieron producirse al calentarse la superficie del bronce para su posterior aplicación a la pieza de la que formaba parte. El límite derecho de la placa está perfectamente delimitado y presenta la huella de un pequello orificio de sustentación, lo que permite suponer que la moldura conservada formaba parte de un ángulo de la placa.
Pieza n° 4 (figs. 42a y 42b): fragmento de una placa de bronce de forma aproximadamente cuadrangular cuya longitud máxima es de 24,5 cm y su altura de 12 cm, por un levísimo grosor de 0,3 cm. Conserva el borde original de 1,9 cm de anchura. Aunque muy deteriorado, se puede recrear su perfil complejo, compuesto de abajo a arriba por un cuarto de bocel, seguido de un listel, una cyma inversa, otro cuarto de bocel y un listel final 38. Por su cara principal, se observan dos perforaciones, una, la superior, tal vez realizada al arrancar la pieza, otra, perpendicular que pudiera tener una función sustentante. En la cara posterior quedan restos del clavo de sección ultrasemicircular que sostendría la placa sobre su soporte originario, que tal vez fuera la superficie superior del pedestal del Genius. La moldura es parecida a la que rodea el fragmento conservado de la lex Salpensana 39.
Pieza n° 5 (figs. 43a y 43b): fragmento de placa de bronce de 42 cm de longitud, 7,5 cm de altura y de 0,3 cm de grosor. Conserva el borde original en la parte superior de la lámina: tras un ligero baquetón decorado por leves líneas ligeramente inclinadas a la derecha, aparece una franja exterior de 1,2 cm decorada con incisiones más o menos regulares, que intentan mantener un ritmo (tres verticales por dos en forma de ángulo), imitando someramente una banda decorativa del tipo de dardos y corazones.
Pieza n° 6: en realidad, se trata de dos fragmentos de una placa de bronce de pequeño tamaño que podrían situarse en la parte exterior de una pieza epigráfica o en el recubrimiento de un elemento arquitectónico; 5,5 x 2,5 x 0,2 cm mide el más grande, 1,2 x 1,3 x 0,3 cm el más pequeño.
37. CIL, II, 5439; fotografía en Bronces 1990, 166, n° 7.38. Un perfil parecido tiene la moldura que rodea la placa de la lex Malacitana, CIL, II, 876, fotografía en Bronces 1990, 167, n° 9.39. CIL, II, 876, fotografía en Bronces 1990, 168, n° 10.
| Fig. 41b. Fragmento de moldura: las dos caras (dibujo M. C. Sopena).
LA PREMIÈRE PHASE DE MONUMENTALISATION URBAINE : LES ÉDIFICES DE LA PARTIE NORD DU FORUM – 127
| Fig. 42a. Fragmento de una placa de bronce con su borde (cl. M. A. Magallón Botaya).
| Fig. 43a. Fragmento de una placa de bronce con su borde (cl. M. A. Magallón Botaya).
| Fig. 43b. Fragmento de una placa de bronce con su borde: las dos caras (dibujo M. C. Sopena).
| Fig. 42b. Fragmento de una placa de bronce con su borde: las dos caras (dibujo M. C. Sopena).

































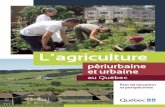
![[2006] L'enceinte urbaine de Niort](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631c01c3d5372c006e0439be/2006-lenceinte-urbaine-de-niort.jpg)