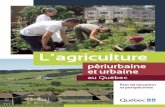Culture, Espace Et Organisation Urbaine Dans La Cite Islamique
Transcript of Culture, Espace Et Organisation Urbaine Dans La Cite Islamique
CULTURE, ESPACE ET OR6ANISAT10N URSBAINE DANS LA CITE ISLAMIQUE
DR. AIDA YOUSSEF HOTEIT
THESE DOCTORALE TRADUITE DE L'ORIGINALE ESPAGNOLE
2000
INDEX
INTRODUCTION.... ... . ... . . . ... . . . . ... .. . . . . .. . . ...... . . . . . .. . .. ... . . . . .... . . .. .... . . .. 2
1. - CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANAL YSEES ... 7
1.1 DaIllas .......................................................... . . .... .... ..... 7 1.2 Tunis ............ .. ............................................ . ............ '" 17 1.3 Cordoue ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 1.4 Le Caire ................................ ..... ... . ... . .... . .. .. . . . .. . ........... 32
2. L'ISLAM ET LES CITES ..... ........ ................. ................. ... ... .... .. 44
2.1 ORIGINE DES CITES ISLAMIQUES ... .. ... .. .. .... . ... .. . . . .... .... . . . ...... 47 2.1.1. Les cites pre-islamiques ........................... . ... ...... . ... ...... . . . .. 48 2.1.2 Cites nouvellement fondees ..................... . ... ... ..... ......... . ...... 52
2.1.2.1. Cites de caractere militaire ........................... . .. . ... ... 53 2.1.2.2. Cites de caractere royal.. ........... .... . .. .. . ... .. .. .. .. .. .. ... 54 2.1.2.3 . Cites de caractere religieux ............ ...... ...... ............. 56 2.1.2.4. Implantations sur des sites historiques .. .. ... .... .... ...... .. 56
2.2. MODES DE FORMATION DES CITES ISLAMIQUES .... .. .. .. ..... .... ... 58 2.2.1. Formation spontanee ............................................. .... . ...... 58 2.2.2. La creation volontaire ..................................... ..... .. ........... 58
2.3. THEORIES DE 'IBN KHALDUN' CONCERNANT LE DEVELOP-PEMENT URBAIN .. ....... . . '" ., . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. ..... . . . . .. . . . . . . . .. .. 60 2.3 .1. Naissance, proces vital et mort des cites............. .... ............... 60 2.3.2. Conditions favorables ala fondation des cites ... .. .. ... ............... 62
2.3.2.1. Installation et construction.......... ......................... 63 2.3.2.2. Observations socio-economiques .... ....... ......... ...... ... 64 2.3.2.3. Le concept du 'Zoning' et la pratique de l'adminis-
tration municipale ... ...... ... ... ............. ... .. ..... . ... .... 65 2.3.2.4. Fonctionnalite dans l'architecture et dans la planifi-
cation urbaine .............. ........... ... . . .... .......... .. ..... 68 2.3.3. Ibn Khaldun, un planificateur urbain precoce ... ... ...... ... . ... .... .. .. 69
2.4. L'ARCHETYPE DE LA CITE ISLAMIQUE ......................... .... ...... 70 2.4.1. Premieres idees: introduction a l'archetype ................. .... ... ... 70 2.4.2. Le developpement de l'archetype ............................... ......... 73 2.4.3. La consolidation de }'archetype ................................ .......... 76
3. L'ESPACE URBAIN..... . . . . . . . . .. .. . . . . . ... . ..................... . ..... . ... . ... 83
3.1 PHILOSOPHIE DE LA VIE DANS L'ISLAM ET ORGANISATION URBAINE ... . ... ..... . .... .. ..... . . .... .. . . . . ... . .. . . ....... . . ... .. ........ . .. . ...... 83 3.1.1. La Religion.. . .. ... ............. . .. ..... .... ...... . ...... . . . . . .. . ..... .. ...... 86 3.1.2. L'intirnite....... .... ........... .. .. . .. ........ .. .... .. . . ...................... 87 3.1.3. L'egalite sociale . .. ... .. ..... ... .. .... ... ....... .. .. . ... . .. ..... ... ... ..... .. . 89
3.2. L'INFLUENCE DE LA LOI ISLAMIQUE 'AL FIKH' SUR L'ORGANISATION SPATIALE DE LA CITE .... ...... . ............. .. ..... 91 3.2.1. Reglementations urbaines dans l'Islam ... ... ... ...... .. ............ . .... 93
3.2.1.1. Le droit a la rue ......... ... ......................... .. ............ 93 3.2.1.2. Le concept dufina ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 97 3.2.1.3. - La question de l'intimite : .. . ... .... .. .. ......... .. .. . ... .. 101
- Hauteur maximale des batiments (nombre d'etages) .. 102 - L 'usage de la terrasse .. . ...... .. ........... .. .. ... . .. . ...... 103 - Placement des portes des maisons . ...... . ...... . ......... 105
3.2.1.4. Garantie de lumiere et d'air frais ....... .. ...................... 107 3.2.1.4. Ruines et murs ou batiments menaces d'ecroulement dans
la cite . .. ....... ... ... .. . . ....... .. . ...... . ................... ..... 109 3.2.2. La Loi de l'Heredite ............. .... ... . ... ..... ....... . .. .. . ......... .. III
3.3 . LES INSTITUTIONS EN RELATION AVEC L'ADMINISTRATION MUNICIPALE DE LA CITE ISLAMIQUE ... . .... ... ... . . . .......... .. . . .. . . . 114
3.3.1. Le Cadi .... .. . . . ...... ...... .. . . . . . .. . ....... .... . ...... . .............. . ....... 115 3.3.2. Le Almotacen (EI Muhtasib) ......................................... . '" ......... 117
3.4. ESPACE URBAIN .... . . . .. . ......... .. ..... . . . .. . . .... .... .. .. . . ..... ....... . .. .... . 120 3.4.1. Organisation de l'espace urbain ............ .. .. ... . ...... . ..... . .. . ....... 120 3.4.2. Concept de l'espace urbain .. . . . ..... . .. ..... ..... ... . ... ... .. . ...... . .... . 121
3.4.2.1. L'espace Ferme ...... .......... . ............. ...... . .... ........ .. 121 3.4.2.2. Espaces Publiques Ouverts: Les Rues . ... . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. 124
3.4.3 . Espaces Urbains et leurs fonctions symboliques dans la cite islamique133 3.4.3 .1. Espaces Religieux et Culturels .. ..... .. .... ..... .............. 133 3.4.3.2. Espaces Economiques et Commerciaux ...................... 140 3.4.3.3 . Espaces Politico-Militaires : Citadelle, Alcazars, Chateau
et Portes . ...... ...... ... .. .. .. .. .. ... .. . . ...... ............... . .. . 147 3.4.3.4. Espaces residentiels ...... . . . . . ...... .. .. .. . . . .... .......... ... . . 153 3.4.3.5. Espaces publics ouve11s: Les Places ..................... .. .. 160
3.5. IMAGE GLOB ALE DE LA CITE ISLAMIQUE TRADITIONNELLE .... 161
4. MUTATIONS ET IDENTITE ...... ..... ... ......... . .......................... 164
4.1. INTRODUCTION: LE DEVELOPPEMENT URBAIN .......... .. ....... .. 164
4.2. FORMES DU DEVELOPPEMENT URBAIN ............ .... . ................ 168 4.2.1. Le deve10ppement concentrique ......... .. ............ ... . . . . .... .... .. 169 4.2.2. Le developpement parallele .................. . . . .... .. ... .. ..... . .. .... ... 169 4.2.3. Le developpement disperse .. ... ................. . .... .. ........... . ....... 172
4.3. TRANSFORMATIONS DU XXe S. ET LA PERTE DE L'IDENTITE DE L'ESPACE URBAIN DANS LA CITE ISLAMIQUE ........................ .174 4.3.1. Changements dans Ie style de vie ............................ ...... . ..... . 174 4.3.2. Changements au niveau de l'espace urbain .. . .... .. ..................... 176
4.3.2.1. L'espace exterieur: La Rue ................................ .... 176 4.3.2.2. L'espace Interieur ........... .. ...... ... .......................... 178
4.3.3. Perte d'autres fonctions symboliques .... .... . . ....... .... ... .......... ... 182
4.4. CONSEQUENCES: DUALITES FORTEMENT MARQUEES ..... ....... 183 4.4.1. Dualite morphologique .............. . ............... . ....... .... . ......... 183 4.4.2. Dualite demographique et sociale . . . ..................................... 183 4.4.3. Dualite fonctionnelle .............. ..... ....... ......... .... . . . ............. 186 4.4.4. Dualite culturelle ............. ... ..... .. ... ...... ................. ... ........ 187 4.4.5. Dualite Legale ............. ..... ... . .. ........ .. . . . . .... ..... ................ 189
4.5. CONSERVATION ET CHANGEMENT DANS LA CITE ISLAMIQUE .. 191 4.5.1. Introduction ............ ........... . ... ....................... .............. .. 191 4.5.2. Motifs et causes de la conservation ......... ..... ....... . ................ . 194 4.5.3. La conservation sterile ... ... . ..... ....... .............. ...... ... .... ... . ... . 195 4.5.4. La conservation dynamique ........... ... ..... .... . ........................ 197 4.5.5. Comment conservons-nous dynamiquement? ................. .... ..... 198 4.5.6. Interventions dans certains espaces impOltants de la Cite Islamique .199
4.5.6.1. L'environnement de la Cite Traditionnelle .................. 199 4.5.6.2. Les rues et Ie probleme du trafic .............................. 201 4.5 .6.3. Les espaces interieurs: Le Domaine Edifie ................. 204
5. CONCLUSIONS ........... ... . ..... ..................... . . ........... . .. .. ... .. . .. 209
6. BIBLIOGRAPHIE ... .. ........... ...................... ...... .... . ...... . . . ... .... 215
INTRODUCTION 2
INTRODUCTION
• La cite islamique a commence it interesser comme theme de recherche
aux alentours du premier quart de ce siecle. Les recherches, qui se faisaient
generalement dans Ie cadre des etudes orientales, etaient influencees par les
concepts et les normes sociaIes, politiques et economiques de Ia cite
occidentale; ceCI a cause des malentendus et une fausse interpretation de Ia
realite.
• Plusieurs articles et etudes ont essaye de :
- Discuter I'existence d'un archetype de "cite islamique".
Expliquer Ie plan des cites islamiques et les facteurs qm
interviennent dans leur organisation .
• Face it ceci, deux courants de recherche ont ete crees:
1. Le premIer s'est occupe de mettre en relief Ie role de I'IsIam dans
Ie proces urbanistique et son influence sur I' organisation de la cite.
William et Georges Marcais(105) (1945), alors qu'ils travaillaient
dans Ie Nord de I' Afrique, ont emis la suggestion que Ia forme de Ia cite
islamique etait determinee d'une part par Ies exigences defensives (la
citadelle, Ies murs, les portes, etc.) et d'autre part par Ie fait que ses habitants
soient musulmans. Car c'est seulement dans une cite islamique qu'un
musulman pent avoir une vie religieuse.
INTRODUCTION 3
Benet(l9) (1963) demontre que l'Islam est une religion urbaine et
qu'il est etroitement lie a la vie urbaine en soi.
Dominique Chevalier(39), (1984) affirme que les cites islamiques
se sont epanouies historiquement dans Ie cadre de la civilisation musulmane.
Son 'habitat', ses plans, ses institutions ont ete con9us en fonction des
exigences de l' environnement physique, mais surtout selon la vie privee de la
societe musulmane qui a determine une projection spatiale des normes, Ie
tout repondant a l'ideal unitaire et transcendantal de l'Islam.
2. D'autre part, d'autres chercheurs et a cause de leur incomprehension
de l'Islam, ont nie son role dans l'organisation de la cite.
Pour Cahen(32) (1958), au Xe S., la cite islamique ne presente aucune
difference essentielle vis-a-vis des cites de l'antiquite classique. En somme,
l'Islam comme religion n'a d'influence que sur la moderation du caractere de
la cite citadine. C' est pour cela, et toujours selon Cahen, que la nomenclature
'cite islamique' n'a pas de base soli de et il serait plus correct de la nommer
'Dar e1 Islam', niant ainsi sa qualite de cite.
Selon Planho)(l25) (1959), l'Islam n'a ni stimule ni ete un facteur
positif dans 1 'urbanisation. Pas plus qu'il n'a eu un role dans l'organisation
de la cite.
Finalement, pour Eugene Wirth(l45) (1977), Ie representant Ie plus a
signaler dans cette tendance dont l' apport au theme peut se resumer par une
'desislamisation' de la cite, toutes les caracteristiques de la cite sont deja
presentes dans l' Ancien Orient, et 1 'unique innovation purement islamique
est Ie souk (el-suq) qui, precisement est la seule chose qui n'a rien a voir
avec l'Islam en tant que religion.
INTRODUCTION 4
• De tout ce dialogue est nee l'idee de la these pour:
1. Demontrer I' originalite de la cite islamique.
2. Detinir et expliquer l' espace urbain dans la cite islamique, en
mettant en relief l'influence de la cite islamique sur son
organisation.
3. Discuter de I' adaptation ou de I' adequation de cet espace aux
besoins de la vie modeme. Est-ce que cet espace repond aux
transformations economiques, techniques, demographiques et
mentales de la periode actuelle?
• Pour illustrer cette etude, nous nous baserons sur trois cites islamiques
choisies dans differentes parties du monde islamique actuel. Les trois cites
en question sont: Tunis, Le Caire et Damas. En plus, nous parlerons d'une
cite hispano-moresque qui est Cordoue. Ces cites ont ete choisies pour trois
motifs:
- Le plan de ces cites, grace it son installation, est tres proche de
l'image de ce qu'est, theoriquement, une cite.
- Pour pouvoir atteindre un certain degre d'uniformite, nous avons
choisi des cites relativement grandes qui ont eu des fonctions plus ou moins
similaires: elles ont ete en meme temps des capitales de leur region et les
sieges du gouvemement des differents empires musulmans.
- Pour montrer la similitude des cites it l'interieur du monde islamique, g
malgre les differences de races, de continents et de civilisations (anterieures it
l'Islam).
INTRODUCTION 5
• En somme, cette these est composee d'une introduction et de quatre
chapitres.
Dans Ie premier chapitre nous essaierons d'analyser Ies caracteristiques
urbaines des cites islamiques choisies.
Dans Ie second nous etablirons une etude genera Ie en ce qui concerne la
cite islamique, son origine et sa fondation, ainsi que Ies theories qui ont ete
crees concernant son apparition.
Dans Ie troisieme no us essmerons d'etudier en profondeur l'espace
urbain de Ia cite islamique: Son concept, ses caracteristiques, ses fonctions
symboliques et Ia relation de tout cela avec la philosophie de Ia vie dans
l'Islam.
Dans Ie quatrieme, nous ferons face aux prob1emes des mutations et des
changements mentaux et economiques de Ia peri ode actuelle, en discutant Ie
degre d'adequation de I'espace traditionnel aux besoins de Ia vie moderne et
en analysant Ie probleme de la conservation des espaces urbains des cites
islamiques traditionnelles.
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 7
1. CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES
ANALYSEES.
1.1. DAMAS (49,50,73,85,148)
REGION: Moyen Orient
TOPOGRAHIE: Situee a une altitude de 690 metres, au pied du Mont de
Qasioun et a la limite du desert. Les difficultes de communication entre la
cite et la mer Mediterranee ont oblige Damas a s'ouvrir vers l'interieur. Ce
fut un centre de commerce et d'echange des nomades ainsi qu'un point
d'arret pour les caravanes qui voyageaient de l'Euphrate au Nil.
ORIGINE PRE-ISLAMIQUE: La premiere installation humaine a Damas
remonte au quatricmc millenaire et se localise sur une colline au Nord-Est de
la vieille cite. Les premiers restes d'urbanisation que nous pouvons detecter
sur Ie plan initial de la cite medievale datent de la peri ode arameenne. Dans
la partie occidentale de la cite, qui etait a ce moment-l a la capitale du pays
d' Aram, il y avait deux poles d'attraction: Ie temple et Ie palais royal. Les
rues, qui s'articulaient a partir de ces deux batiments, avaient un trace
orthogonal dans cette section de la metropole.
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 8
* Durant la peri ode hellenique, la cite a connu un developpement nouveau et
important a I'Est du temple.
• Au IIIe S. Av. 1.-C., Damas est devenue la capitale des Seleucides et sa
planimetrie s' est transformee en une trame incluant des blocs edifies de
100.45 metres. La maison etait Ie module du bloc; chaque bloc avait deux
files de quatre maisons avec un mur posterieur commun.
• Durant la periode de I 'hegemonie nabateenne, de nouveaux blocs
identiques aux premiers mais en direction est - ont ete construits.
• En I'an 64 Av. 1.-C., Pomeyo a proclame la Syrie province romaine. Les
romains ont renove la metropole et ils ont edifie de nouveaux quartiers au
sud de la cite hellenique. La cite etait traversee de l'ouest a l'est par deux
arteres droites et paralleles: Une qui sortait du temple et une autre qui
signalait la limite des nouvelles structures romaines, individualisees par une
nouvelle canaIisation d'eau, el Qanawat. Avec Ies romains est apparue une
certaine preoccupation pour I'esthetique et Ie sens de Ia perspective. Deux
grandes arteres, Ia plus grande mesurant 25 metres de largeur, flanquees de
portiques a colonnades, ont aide a embellir la cite. Afin de se proteger des
attaques exterieures, les romams ont dote Damas d'une muraille urbaine
rectangulaire de 1500.75 metres.
• C'est dans Ia periode romaine que se sont developpes les differents genres
de commerce, certains aux portes de la cite, d'autres tout au long de I'avenue
et d'autres encote dans certaines rues adjacentes.
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 9
• Les romams ont ete suivis par les Byzantins, et Ie christianisme a pris Ie
pas sur Ie paganisme. L' eglise rempla~a Ie temple. Ce fut a cette epoque
que Ie plan orthogonal des romains commen~a a s'effacer jusqu'a sa quasi
disparition avec les musulmans (fig. 1).
',' ~ ';', , ' . • • • • to' : . ':':~.'... 4 . ' . '.'.:.
..... '0 • "0'
.. ..
'.
' ,I •
. :'.
" .
. '. "'t
Fig. 1 Le plan de Damas a I 'epoque byzantine (par N Alsayyad) (13)
1, Temple de Jupiter 2, Rue it co/annes 3, Agora (marche) 4, Rue Decumanos 5, Castrum 6. Pa/ais byzantin 7, Eglise byzantine,
L'EPOQUE ISLAMIQUE: Les musuImans se sont empares de Damas en
l'an 635. Avec l'empire Omeyya, Damas a atteint son apogee et est devenue
Ie centre du pouvoir durant cent cinquante ans.
La domination isIamique n'a eu aucun effet de modification immediate
sur Ie plan urbain. Les musuImans formaient une minorite dans Ia cite. Le
changement n'arriva qu'en I'an 705 avec la construction de deux bfitiments , indispensables: La mosquee, situee dans la parcelle de terrain de l' ancien
CARACTERISTIQUES DEs CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 10
temple et de I' eglise byzantine, et Ie palais du Calife (la citadelle) aI' Ouest
de la cite (fig. 2).
Fig. 2 Le plan de Damas a I 'epoque islamique (par Al Munjid)
1. - Eg/ise St. Jean 2. - Mosquee 3.- Palais Al-Khadra 4. - Marche 5. - Quartiers Residentiels.
• Le centre du pouvoir a ete transfere a Bagdad avec les Abbassides et
Damas a perdu son role de capitale et est devenue une simple province. A
ceUe epoque-Ia beaucoup de modifications vont contribuer a la
transformation urbaine de la cite, lui donnant un caractere et un aspect
islamique:
- Damas a ete divisee en quartiers groupes selon la ligne religieuse ou
ethnique dominante. C'est ainsi que les chretiens ont occupe Ie Nord-Est de
la cite, groupes autour d'ass(")ciat,ions avec saint Paul, les juifs ont occupe Ie
Sud-Est, pres de Bab Kasyoun, et les musulmans se sont installes dans la
moitie occidentale de la metropole, pres de la mosquee et de la citadelle.
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 11
Chaque quartier englobait des maisons qui etaient separees par une artere
axiale et les impasses correspondantes aI' artere en question. Cette artere
pourrait etre fermee, a son tour, par de lourdes portes.
- La transformation de I' ancienne rue romaine a colonnades «La grande rue »
en souks et qaysarias.
- L'apparition de nombreuses ecoles (madaris) au COUTS du Xlr S .. Ces
ecoles etaient regroupees aux alentours de la mosquee-synagogue et des
h6pitaux situes dans la meme zone .
• Sous la domination des Ayyubides, (1154-1260) Ie centre du pouvoir a ete
transfere au Caire, et Damas est devenue la capitale d'un etat independant
(La Syrie). A cette epoque, il y eut une croissance demographique qui
exigea la fondation d'un nouveau quartier en dehors de murs (al Salihiyeh) ,
ainsi que la realisation de beaucoup de batiments publics comme des ecoles,
des mosquees, des h6pitaux, etc. (fig. 3).
• Avec les mamelouks (1260 - 1516) Damas est devenue la seconde cite la
plus importante apres Ie Caire. Tout au long de ces annees il y eu une serie
d'ameliorations et de constructions publiques, parmi lesquelles no us pouvons
mentionner l'extension du l'ancien Souk et la formation d'autres, l'apparition
de "el Maydan Taht el Qala", un grand espace public ouvert destine aux
activites militaires et commerciales, specialement pour Ie marche des
chevaux (Suq el khayl), et la formation d'un nouveau quartier residentiel au
nord de la citadelle (suweqat Saruja) (fig. 4).
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 12
. - .... -.. -.~\_---------"'" ~ ...
Fig. 3 Damas vers la moitie du Xllf S. (par Sauvaget)
• Pendant l'epoque ottomane, Damas s'est epanouie economiquement et ceci
s'est traduit par une croissance demographique exceptionnelle. Une serie de
transformations de differents types vont influencer la forme de la cite:
- Les murailles n'avaient aucune utilite : que ce soit a cause de l'ordre que
maintenaient les Ottomanes dans les camps alentours ou a cause du
developpement de l'artillerie qui rendait ces murailles sans effet pour la
CARACTERISTIQUES DEs CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 13
defense. La cite s'est agrandie en faubourgs residentiels pour la population
croissante.
I, I l~
.. ~ i
,:'\ .!,"! ,~ : ~ ,
I
!-:;., ,..~ '-,..~ .... -..;;;: .. ---=-.
Fig. 4 Damas au debut du xvr s. (par Sauvaget)
_ On commence a bfrtir des bfrtiments en dehors de murailles; des maisons et
des monuments religieux.
_ Le travail des caravanes en direction de la Mecque et de l'Egypte ont
oriente une partie considerable du developpement urbain vel'S Ie sud-est, ce
qui a provo que la construction d'un grand nombre d~ Jans qui ont servi
comme hotels pour les voyageurs.
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 14
- La construction et pour la premiere fois en 1840 d'une residence du
gouverneur en dehors des murs a contribue a la fondation d'un nouveau
quartier residentiel (al Qanawat) avec un souk modeme (fig. 5).
I
~--~=---------~~~~--~------~~----~~~~~--~~-~ I iig.-5 Damas ver~ fa ~oiiie 'd~ XIX S. (par Sauvagetj(J32) .. --..
• En 1920, Damas est devenue la capitale de la Syrie, un pays qui avait ete
confie a la France durant un quart de siecle. Plus tard, ce fut la caJ?itale de la ,
Syrie independante.
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 15
ETAT ACTUEL: Depuis 1926, d' autres nouveaux quartiers residentiels,
dessines selon les idees europeennes predominantes a ceUe epoque-Ia, sont
apparus au Nord, au Nord-Est et au Nord-Ouest de l'ancienne cite. Ces
quartiers ont rempli les trous existants entre les anciens quartiers et la cite a
commence a se fermer petit a petit, prenant une forme semi-circulaire et
solide (fig. 6) .
...... -
Fig. 6 Le Damas Contemporain (Sauvaget J./132)
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 16
Les difficultes de la vie dans l'ancienne cite - difficultes emanant de la
surpopulation, de la deterioration graduelle des anciennes constructions, du
manque d'espaces publics et du manque de travail, de l'inadequation des nles
pour l'usage de la voiture -ont contribue au transfert des populations vers les
nouveaux quartiers.
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 17
1.2. TUNIS(1,99,112,148)
REGION: Afrique du Nord
TOPOGRAHIE: Par opposition a Carthage (l'empire de la mer), la ville de
Tunis est retiree au fond du golf de Tunis, sur une petite colline de 45 metres,
a un croisement de voies de passage, entre trois lagunes et deux grandes
collines (fig.7).
Fig. 7
i-·~IIro" I I ~ ~~~ .w.i.'·~It.
1""1" ;; ...... ;.~rUl
;-r •
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 18
ORIGINE PRE-ISLAMIQUE: Les premiers habitants de Tunis sont
arrives au territoire quelques 600 ans Av. J.-C .. Cependant, la colonisation
en tant que telle n'a commence que quand les Pheniciens ont fonde Utica
(Xne S. Av. J.-C.) et par la suite Carthage (814 Av. J.-C.). Au VIne S. Av.
J.-C., la cite de Rome existait deja et elIe avait soutenu trois luttes (les
guerres Puniques) contre Carthage, et ceci au ne et nIe S. Av. J-C .. Rome a
finalement vaincu et les territoires carthaginois, Tunis inclue, sont devenus la
province romaine de I' Afrique.
• Tunis, sous la dominance romaine, est reste un petit village insignifiant et
ceci durant quelques 600 ans. Ses terres etaient traversees par les deux axes
du reseau routier romain: Decumanos et Cardo .
• En 534, les Byzantins ont conquis Tunis et I' ont dominee pendant un peu
plus d'un siecle, jusqu'aux invasions arabes.
L'EPOQUE ISLAMIQUE: Quand Hassan b. al Numan est entre a Tunis
apres avoir pris Carthage, et ceci en I'an 698, la cite etait totalement
depeuplee et presque totalement detruite. Pour cela, la premiere chose qu'il a
faite fut de placer sa cite a l'interieur pour pouvoir se defendre des attaques
maritimes. La deuxieme chose qu'il a faite fut de construire la grande
mosquee du vendredi, dont I' emplacement fut influence par I' existence d 'un
croisement de deux rues deja existantes du reseau de chemin romain. Ces
deux rues ne sont autres que Cardo et Decumanos (fig. 8).
CARACTERISTIQUES DEs CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 19
r ' ~
. Fig. 8 Tunis.
• Durant l' epoque de la dynastie Khorassanida, la cite fut divisee en trois
parties: Le palais royal et deux grands quartiers (faubourgs) (fig. 9).
• Avec les Almohades, qui ont gouverne Tunis durant 70 ans vers Ie milieu
du Xlr S., la qasaba fut construite. Les Hafsides ont termine sa
constnlction, ce qui a permis d'unir la cite et a cause la disparition du
quartier royal en faveur de l'habitat.
CARACTERISTIQUES DEs CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 20
Fig.9 Tunis. Differentes parties de fa cite. (par Woodford/148)
• Sous la domination des Hafsides (1228-1574), Tunis est devenue la
capitale de toute l' Afrique et par consequent, un centre d'attractions,
specialement pour les emigrants de l' Andalousie. C'est aux Hafsides qu'on
doit la construction des deux ecoles superieures islamiques les plus
fameuses, ainsi que la construction de la majorite des souks qui entourent de
nos jours la grande mosquee.
• Avec la domination ottomane, a partir de 1574, la ville de Tunis
composee par la qasaba, les deux grands faubourgs et la grande mosquee
ont connu une serie de transformations de differents types qui allaient
influencer la forme de la cite.
CARACTERISTIQUES DEs CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 21
- La construction et la restauration de beaucoup de b§timents apres une
longue periode d'abandon, Ie principal b§timent etant peut-etre la mosquee
de YusefBey.
- L'arrivee continue des emigrants musulmans de I' Andalousie a cause un
accroissement de la population, chose qui a provo que une crise
d'hebergement et la substitution de grands espaces libres dans Ie sud de la
medina: les souks des forgerons et des teinturiers ont remplace les jardins.
- La division des faubourgs: Ie faubourg Nord a ete divise en deux et Ie
faubourg Sud en trois; Ceci etait dfi a la croissance demographique et au
besoin de la segregation ethnique et sociale pour les nouveaux habitants de Ia
population -comme les Andalous, les Turcs, les juifs, les Maltais et les
Siciliens- qui sont venus s'ajouter a chaque siecle (fig. 10) .
• Au XVle S., il y eut de graves evenements. En 1535, Tunis tomba entre les
mains des Espagnols de Carlos-Quinto, et ceci a provoque un grand exode de
la population. Durant plusieurs decades, Tunis fut pratiquement abandonnee
par ses habitants.
• Apres l'annee 1770, la cite a commence a grandir hors des murs.
Beaucoup de zones residentielles ont ete construites (la zone Sebkha dans Ie
district Est, une autre zone au Nord-Est et une autre dans Ie faubourg Sud).
De nouveaux cimetieres furent aussi construits, provoquant une extension de
5 hectares de la cite. Un autre changement important a ete Ie transfert de la
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 22
residence gouvemementale de fa qasaba a la region situee en dehors du mur
de separation, loin de la medina.
i'lebal AI MIIff
Fig. 10 Tunis (par Woodford) (148)
34 ORGANISA nON OF PUBUC AND PRIVAT~ SPACES.
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 23
• Les annees comprises entre 1857 et 1881 ont ete des annees fondamentales
pour l'histoire de l'evolution urbaine de Tunis. De nouveaux bfrtiments
apparurent, construits en dehors de la medina et selon Ie modele europeen.
Les plus importants de ces bfrtiments etaient :
- 'Le Quartier Franc' nomme plus tard 'Cite Neuve', fut fonde vers Ie milieu
de 1870. Ce quartier fut Ie quartier des communautes chretiennes de Tunis et
il etait forme d'une avenue principale bordee de deux Iignes de maisons de
chaque cote. Le mode de vie de cette population europeenne a mene a une
organisation autour d'une place 'La bourse' OU on pouvait trouver un grand
nombre de maisons, tous les consulats, les magasins europeens,junduq pour
les artisans pauvres (ils etaient occupes par des maltais, des grecs et des
itaIiens).
- La station de chemin de fer anglaise (La Marsa), construite entre 1874 et
1876. Elle etait entouree d'une eglise et d'un cimetiere, a l'Ouest il yavait
un grand cimetiere pour les juifs et a l'Est ils ont cree leur 'New Town'.
- La station de chemin de fer fran9aise, construite en 1878 au sud de la
station anglaise (fig. 11) .
• En 1881, Tunis fut declaree protectorat fran9ais et elle resta ainsijusqu'en
1956 quand elle obtint son independance. Durant cette periode, Ia cite grandit
lentement, Ie 'New Town' subit quelques restaurations qui donnerent plus
d'espace a la cite.
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 24
Fig. 11 Tunis - La nouvelle cite (par Woodford) (1 48)
ETAT ACTUEL:
Bien que Tunis ait obtenu son independance, la domination etrangere a
laisse de grandes traces sur to us les aspects de la vie. Le resultat fut une
dualite que se manifestait tout d'abord dans Ie systeme legal et specialement
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 25
dans son mecanisme legislatif et regulateur. Ainsi, les lois modernes de
planification urbaine allaient remplacer les lois islamiques traditionnelles.
En plus de la dualite legale nous pouvons observer dans la ville de Tunis une
dualite morphologique fortement marquee dans Ie plan de la cite formee de
deux genres de cites tres differents: la nouvelle, 'cite neuve', et l' ancienne,
'al medina'. La premiere avec ses rues larges et droites, ses grandes places
publiques, etc. et l'autre avec ses rues etroites et tortueuses, ses batiments
traditionnels qui ont subi et continuent a subir une grande deterioration
physique suite a l'introduction du transport automobile et de la croissance
demographique. (fig. 12)
Fig. 12 Tunis. La Medina et fa nouvelle cite (par Brown, C) (28)
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 26
1.3. CORDOUE(12, 31, 52, 63, 64, 78,79,98,138)
REGION: Espagne
LOCALISATION ET EMPLACEMENT: Situee dans la vallee du
Guadalquivir - pres du fleuve meme, elle est situee dans la Sahla - ou plaine
- musulmane qui existe au pied de la 'Sierra Morena', emboltee entre cette
demiere au nord et les 'plateaux' ou zones elevees des ondulations
campagnardes au sud.
Cette voie fluviale a ete Ie facteur principal de sa naIssance et sa
consolidation future, vu qu' elle a servi comme voie de communication et de
transport pour les produits agraires de la Campagne et les mineurs de la
Sierra, surtout quand son installation se trouvait approximativement au
milieu du Guadalquivir.
La metropole s'est petit a petit etendue - en direction du fleuve et en
dehors de I' enceinte en question, occupant aussi Ie bord du fleuve. Pour ceIa,
sa topographie est constituee de deux zones totalement differentes - une
haute et une autre basse, bien que les deux se trouvent au pied du mont de
Sierra Morena.
ORIGINE: La cite primitive de Cordoue etait une ancienne colonie romaine
fondee en l'an 169 Av. 1.-C. par C. Marcelo, en marge des installations pre
romaines deja existantes dans cette zone, et elle etait situee a une vingtaine
de metres au-dessus du fleuve Guadalquivir.
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 27
EPOQUE ISLAMIQUE: La ville de Cordoue etait l'une des cites les plus
importantes de l'Espagne au moment de la conquete musulmane et e1le se
distingue parmi tous les centres urbains de AI-Andalus. Sa position
geographique privilegiee a fait qu' elle soit, des 1717, la capitale de la
nouvelle province du califat de Damas. Mais il a fallu attendre presque deux
siec1es pour que Cordoue - capitale du califat Omeyya - eblouisse les
voyageurs et les chroniqueurs par son extension et sa splendeur en etant aussi
la cite la plus importante et la plus peupIee de I 'Europe Occidentale, ne
pouvant etre comparee qu' a Constantinople, Damas et Bagdad.
Durant les premIers temps de la domination islamique, peu de
changements eurent lieu a Cordoue, la cite typique de l'Europe medievale.
De meme qu'a Damas, les musulmans occuperent les maisons vides alors
que les activites economiques et commerciales continuaient comme avant.
Ce ne fut qu'a l'arrivee au pouvoir de Abd aI-Rahman I que la ville de
Cordoue commen9a a avoir l'aspect d'une cite islamique. Abd aI-Rahman a
converti Ie temple romain, qui etait au temps de la conquete musulmane une
cathedrale Wisigothe (Eglise de St. Stephan), en une grande mosquee
(167/785). Le second acte d'importance fut la construction du fameux palais
(AI-Rusafa) dans les environs de Cordoue. De plus, il ameliora les
infrastructures de la cite (ponts, fortifications, travaux publics, etc.) .
• Vers Ie milieu de Xe S., Cordoue etait une grande agglomeration urbaine.
Sur sa superficie, qui occupait environ 5.000 hectares, il y avait quatre
grands complexes de batiments: at Madina, les quartiers de l'Est ou
Ajarquia, les quartiers occidentaux et les quartiers du Nord, separes entre eux
et subdivises en faubourgs. (Fig. 13).
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 28
MI':l)IEVAL
Fig. 13 Cordoue medil~vale. (Par Escobart C.) (52)
- La Medina avait la forme d'un paralIelogramme presque regulier et elle
constituait la cite muree. Elle avait deux faubourgs: I 'un comprenait la
Mosquee et ses environs et I' autre embrassait Ie reste du secteur urbain situe
a l'interieur de la muraille. Dans ce demier se concentraient 'les batiments
ayant une relation avec les trois fonctions de base de la cite islamique: Ie
centre politique, Ie centre religieux et intellectuel et Ie centre economique'.
- Le secteur oriental de Cordoue ou Ajarquia, qui etait separe de Ia Medina
par une extension inhabitee, ne possedait pas de murailles et il etait constitue
de six faubourgs. II a vu Ie jour grace a la confluence de deux faits:
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 29
l' expansion economique de I' epoque du califat - dont les batiments, souks et
ateliers artisanaux, n'ayant pas assez d'espace autour de la mosquee,
s' etendirent en dehors de I' enceinte muree et Ie long de la rive du
Guadalquivir - et l'etablissement de fermes et de residences entourees de
jardins qui ont fait surgir des maisons dans les environs.
- La ville de Cordoue etait completee par les nouveaux faubourgs de l'Ouest,
qui constituaient Ie plus grand des complexes de Ia metropole de Cordoue,
ainsi que par les trois faubourgs du Nord. En marge de ces zones edifiees il
y avait des enceintes reservees aux services publiques et aux residences de
recreation avec leurs jardins et potagers correspondants. Le resultat de tout
cela etait 'une cite polynucleaire tres en accord avec Ie concept urbanistique
qui donne tellement d'importance aux cellules urbaines (medina, faubourg,
quartiers, etc.) et ayant une surface suburbaine tres etendue reservee
essentiellement aux distractions' .
• Cette grande extension de la Cordoue du Xe S. n'a pas beaucoup dure,
puisque la Cordoue du califat a cesse d' exister durant les annees de la fitna
ou guerre civile (1009-1031). Les deux seuls secteurs de la cite qui ont
echappe a la destruction furent la zone muree nommee at Madina et une
petite partie de at Chanib at Sharqi, situee a I' orient de la zone muree (fig.
14).
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 30
...... -..... , ~~. - ...... _ .... - ..... "to __ , - oIro,. , , ;i
:1 '- .. ,. ": ... ', " .. ~. ,' ... . '. . ....
A.oo,,.,..,~ .. ~ WtttH _w,.., "" .• (';1I..w.u. Srcvnoi., ... ... ,·· .. ~'"~1"'. l~. ~.",.J~ • ., ~I .
Q ,."'Of H NtMru ~ it • .. '''''/tMO ...,.",... ., .. , #.,.m ","",d ... o
Fig. 14 Le plan de Cordoue au X S. (Par Escobart, C.) (52)
Le reseau routier a l'interieur de ces deux zones urbaines comprenait
deux series de rues : les rues principales qui unissaient les portes opposees
de la muraille etaient rectilignes et Iarges et elles etaient la prolongation
urbaine des chemins principaux les plus frequents qui conduisaient vers la
cite. D'autres rues de caractere secondaire n'etaient pas tellement rectilignes
et elles etaient plus etroites ; ces demieres formaient, avec les impasses, les
culs-de-sac .
• Dans la premiere moitie du xne S. (1123) et sous l'egide du Sultan
almoravide Ali b. Yusef, ce secteur oriental fut mure et i1 a ete nomme al
Sharquiyya, vu sa situation au nord de al Medina.
CARACTERISTIQUES DEs CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 31
Les residences etaient distribuees tout au long de ce reseau de chemin
on il y avait quelques places publiques et un grand espace depourvu de
constructions, pour des raisons d' ordre militaire, entre aI-medina et al
Sharquiyya, cette demiere etant beaucoup plus peupIee que la premiere.
Tout ce trace urbanistique qui faisait communiquer les differents quartiers de
la cite avait un centre vital situe dans la zone de al Medina, pas precisement
au centre de la metropole, la on se trouvait la mosquee -synagogue et
l' Alcazar du Calife. Aux alentours de ce centre vital il y a avait un important
commerce qui permettait 'une convergence politico-commercio-religieuse
favorisee par la proximite du fleuve, ce demier etant Ie pont principal dudit
commerce, mais qui convertit la Medina en une cite totalement excentrique'.
• En l'an 1236 du XIIIe S., Fernand III conquit Cordoue, cite qui avait perdu
son hegemonie depuis la chute du Califat Omeyya et qui se trouvait
completement ruinee comme metropole.
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 32
1.4. LE CAIRE (4,13,34,69,84,85,116)
REGION: Egypte
TOPOGRAPHIE: La cite du Caire est situee au bord du Nil, a 23 Km au
Sud du Delta, au pied des montagnes d'al-Muqattam (240 m.). L'importance
de son emplacement a attire I' attention des gouverneurs de tous les temps et
cela par sa situation d'une part au centre de l'Egypte et d'autre part entre la
mer rouge et la mer Mediterranee. Elle fut un centre de rencontre
geographique entre les arables de l'Ouest de I' Asie et ceux du Nord de
I' Afrique et ceci depuis les epoques arabes.
ORIGINE PRE-ISLAMIQUE: Durant les periodes pre-islamiques il y eut
plusieurs installations dans la region du Caire (al-Qahira). Les plus
importantes furent :
- Memphis: fondee en l'an 3315 Av. l-C. au bord occidental du Nil, cette
cite a ete pendant longtemps la capitale de l'Egypte et e1le a existe jusqu'a
l' arrivee des musulmans.
- Babylone: Vne fortification fondee par les romains en l'an 98 au sommet
du fleuve du Delta pour fortifier leur domination dans la vallee du Nil.
De plus, et dans Ie meme contexte qu'al-Qahira, il y eut d'autres cites ,
paralleIes au Nil fondees par des musulmans. La plus ancienne remonte au
VIle S. (640) quand l'emir Ibn AI-As a construit Ie Fustat, un camp militaire,
pres des restes d'une ancienne forteresse.
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 33
Plus tard, les Abbassides ont construit la cite d'al-'Askar au Nord de Fustat
pour loger leurs troupes, et ceci en l'an 750. Quand Ahmed Ibn Touloum a
declare l'Egypte comme etant un Etat independant du Califat Abbasside, il a
fonde aI-Qata'i, une cite royale qui elle aussi fut fondee au Nord de aI
'Askar.
EPOQUE ISLAMIQUE: En l'an 969, lawhar al-Siqilli, Ie commandant du
quatrieme calife ratimide (al-Muizz) s'empara de l'Egypte qui est restee sous
Ia domination ratimide durant deux siecles.
En arrivant en Egypte, lawhar a commence par fonder une nouvelle cite
royale pour eviter les mauvaises conditions de vie de e1-Fustat.
L'emplacement de la cite, nommee al-Qahira, fut choisi de fa90n ace qu'il
s'adapte a l'axe urbain Nord-Sud, parallele au Nil, pour l'unir avec ses
antecedents qui sont al-Fustat, al-'Askar et al-Qata'i. (Fig. 15).
Apres aVOlr pose les murs de la cite et apres avoir determine
l'emplacement des portes, lawhar a commence la construction de deux
grands b§timents: Ie palais du Calife et la grande mosquee d'al Azhar.
Le plan de la ville de Al-Qahira, c'est-a-dire Ie Caire, avait la forme
d'un carre mure ayant deux porte de chaque cote. Dne rue principale
nommee Kasabat al-Qahira traversait l'axe Nord-Sud en passant par la place
principale et par les palais au Nord de la cite. Cette rue traversait aussi les
chemins en direction du Suez ~t de la Damiette au Nord et les chelI1ins en
direction de el Fustat et I 'Egypte superieur au Sud. Les rues secondaires ou
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 34
laterales traversaient les rues principales en angles droits divisant la cite en
plusieurs quartiers residentiels (fig. 16).
Fig. 15 Le site du Caire et sa relation avec les au Ires cites preexistantes. (13)
• Durant les 120 annees du gouvernement ratimide, Ie Caire (al-Qahira) a
grandit considerablement mais· elle est restee une cite royale. La principale
cite commerciale etait al-Fustat et Ie Caire n'en etait qu'un faubourg royal.
• Aux environs de I'annee 1050, correspondant a l'annee 442 de I'Hegire, et
a cause de la famine, al-Fustat a perdu la majorite de sa population et ses
maisons etaient en mine. Les autorites du Caire ont permis aux residents de
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 35
el-Fustat d'y resider et d'y constmire de nouvelles maisons. Ceci a cause
une croissance considerable.
Fig. 16 Le plan original du Caire. (Reconstruction basee sur la description
d 'al-Magrisi).
1. Palais 2. Jardin
6. Mosquee 7. Partes
3. Maidan
8. Rahba
4. Palais 5. Maison des hOtes
9. Quartiers residentiels.
• SOUS Ia domination Ayyubide et specialement avec Ie gouvemement de
Salah-Addin, Ie Caire a subi beaucoup de modifications:
- L'elaboration d'un nouveau plan de Ia cite qui unissait Ies deux districts
habites, Ies mines de el-Fustat inclues. Le projet de Salah-Addin etait base
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 36
sur les besoins defensifs de la cite. En premier lieu il s' est fait construire un
mur enorme qui a entoure toute la cite. Ensuite, il a fonde la citadelle qu'il a
fait situer sur une protuberance des montagnes d'al-Muqattam (fig. 17).
• .. 16.
Fig. 17 Plan du Caire (par Alsayyad N) (13)
1. Le Grand Palais 2.Le petit Palais 3.Place du Palais 4. Mosquee AI-Azhar
5. Maison des hOtes 8. Jardin 9. Mosquee Al-Hakim 10. Mosquee 11. Portes 12. Quartiers residentiels.
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 37
- La construction de nouvelles institutions educatives et religieuses comme
les ecoles, les hopitaux, les mausolees, etc.
- Le remplacement d'une grande partie des palais Fatimides demolis par des
maisons populaires. Ceci a augmente Ia superficie des espaces residentiels et
a contribue a changer Ie caractere de Ia cite royale des Fatimides qui s' est
transformee en une cite populaire.
Depuis l'epoque Ayyiibide la cite du Caire a suivi des lois precises dans
son developpement. Du cote sud, Ie Caire a prefere s'unir avec el-Fustat
parce qu'elle avait besoin d'un port dans Ie Nil pour sa nouvelle cite. Vers
l'Ouest, la capitale grandissait en direction du Nil et elle a traverse Ie canal;
c'est ainsi que l'ile de Bulaq a commence a etre un nouveau port commercial
oppose et rival a celui d'al-Fustat.
• La domination des Mamelouks (1250-1517) a ete consideree comme un des
temps glorieux dans 1 'histoire du Caire qui s' est converti en un centre
commercial international de par sa situation dans un croisement de
commerce universel : les pelerins musulmans africains qui se dirigeaient vers
la Mecque utilisaient Ie chemin est-ouest pour Ie commerce entre l' Afrique et
l' Asie. L'autre chemin etait utilise par les commer,(ants dans leurs voyages
vers I' Alexandrie et pat la suite vers l'Europe.
Dans les premIers temps des Mamelouks, la metropole etait composee
de 4 centres urbains differents: al-Qahira, al-Fustat, el-Bulaq et les •
cimetieres Qarafa au Nord et au Sud de la citadelle.
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 38
Le deve10ppement economique vers la fin de l'epoque des Mamelouks a
aide a la parution de nouveaux biitiments publics dans la cite comme par
exemple : les jans, les palais, les magnifiques complexes des mosquees, les
mausolees qui parfois incluaient des hopitaux, des madaris, des Hammams et
de nouveaux quartiers residentiels avec de grands jardins et des etangs qui
ont envahit les cimetieres existants au pied de la citadelle .
• Avec Ies Ottomanes (1517-1798), Ie Caire a perdu son caractere de capitale
des Mamelouks et e1le est devenue une capitale regionale. Les Turcs ont
fomente les differences sociales, religieuses et raciales ce qui a eu comme
consequence une forte separation physique des differents quartiers a l'interieur du complexe urbain .
• L'occupation franyaise, bien que courte, s'est caracterisee par la violence
militaire et les besoins militaires ont provoque de grands changements dans
Ie modele physique de la cite. Nous mentionnerons, parmi lesdits
changements: L'ouverture de larges rues, Ia fondation de places ou
maydans, la demolition des portes des quartiers-harat. Ces changements
etaient necessaires pour faciliter Ie controle de toute la cite. D'autre part, la
coupure de la ligne de transport mediterraneen entre I' armee franyaise
en Egypte - et la France a force Bonaparte a fonder divers etablissements
industriels dans la cite pour soutenir les besoins de son armee. (Fig. 18).
L'EPOQUE MODERNE: Apres la sortie des troupes franyaises en 1801,
I 'Egypte est de nouveau tombee sous Ia domination turque. Muhamed Ali,
qui fut nomme gouverneur de I'Egypte (1805-1848) a essaye de moderniser
Ie pays et c' est pour cela que son ere est consideree comme Ie debut de
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 39
l'histoire modeme de l'Egypte. A cette epoque-Ia Ie Caire a recupere sa
position reduite sous la domination ottomane.
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 40
I · ... ·.r ~' •• 'I.'
t".
. i' i
.~ . ,
Fig. 18 Le Caire en 1838 (par Abdel Fattah l.S) (85)
..
"
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 41
Durant Ie gouvemement de Ismail, il y a eu beaucoup de changements
dans Ie plan du Caire, changements dus a la visite de Ismail a Paris; en effet,
Ismail a ete tres impressionne par Ie plan de Hausman et a decide d'en
adopter un pareil pour Ie Caire. L'effet dudit plan a eu pour resultat la
creation de nouveaux districts, de nouvelles rues de nouvelles places et
jardins publics de style occidental.
• Durant la premiere guerre mondiale, Ia Grande Bretagne a declare I 'Egypte
un protectorat anglais. Mais en 1936, un traite entre Ies deux pays a resulte
dans Ie retrait des troupes anglaise de toute l'Egypte, Ie Caire inclus mais Ia
zone du canal de Suez exclue. Cependant, l'augmentation de la violence
contre les Anglais a continue et a provo que l'incendie du Caire en janvier
1952. La meme annee Farouk, Ie dernier membre de la dynastie de
Muhamed Ali, fut expulse. Peu apres, la republique fut proelamee et Ie Caire
est devenu la capitale de l'Egypte.
EPOQUE ACTUELLE: Durant la periode de l'occupation britannique Ie
Caire s'est transforme et de nouveaux quartiers ont vu Ie jour au Nord de la
cite. La croissance de la population s'est refletee sur Ie plan urbain
verticalement et horizontalement. Les vieux quartiers ont vu leurs
populations riches nnmlgrer, et les commerces importants ont ete transferes
aux quartiers modernes.
Les projets d'amelioration a cette epoque-Ia furent de petite echelle et
ils se sont limites aux nouveaux quartiers. L'introduction de Ia voiture et du
transport public a aide a I' acceleration de la croissance horizontale. II en est
CARACTERISTIQUES DES CITES ISLAMIQUES ANALYSEES 42
resulte l'apparition de nouveaux quartiers et la fondation d'un nouveau
systeme de portes sur Ie Nil.
La crOIssance horizontale s' est caracterisee par la parution de deux
Caire de caracteres differents bien que physiquement ils n' etaient pas
clairement divises. Alors que les vieux quartiers du Caire voyaient leurs
principaux aspects urbains islamiques se deteriorer, les nouveaux quartiers
vivaient une periode de grand developpement urbain (fig. 19).
LS CAIRB ~ ...
~tp"'l'-"f
. . ~ .. ~ ". . , "
', .' . ; - LiGC~O£ ' . f " -; : 11111 lUlMul1mn
.-::.-. '<t," . ~ .. ~ ~ · 'I....,'~ .. -· • , __ "/I~,f
-:!.' • ',t o !
-
Fig. 19 Le plan du Caire en 1872 (par Abdel Fattah J.) (85)
, ~~,:,:,,:.,: .~~....,.. .. ~. ~
;.·:t;~:, : ,~..;.:,.~.,.. .
.. :. :t~~%;··;··I; '. l =:.~.~.~;..
I '"'-W ~' · ·· . · J.
• " ""'I~ , ....... .,.. ,- ... . I ......... ~ ..... ..... . ..... &---
f' ,~tt:!..~ ., '. , . .,..;.. .. .
L'IsLAM ET LES CITES 44
2. L'ISLAM ET LES CITES
Au debut du VIle S. un mouvement est apparu en marge des deux
grands empires - byzantin et sassanide - qui dominaient la moitie occidentale
du monde. A la Mecque, ville de I' Arabie occidentale, Mahomet fit un appel
dirige aussi bien aux hommes qu' aux femmes, dans lequel illes exhortait a la
reforme morale et a la soumission a la volonte de Dieu. Ces deux messages
divins lui avaient ete reveIes et ils formerent plus tard un livre, Ie Coran. Au
nom de la nouvelle religion, l'Islam, les armees recrutees parmi Ie peuple de
I' Arabie, ont conquis Ies pays environnants et elles ont fonde un nouvel
empire, Ie Califat, qui incluait une grande partie de I' empire byzantin, ainsi
que tout Ie sassanide et il s'etendait depuis I' Asie centrale jusqu'en Espagne.
Des ses premIers Jours, l'Islam s'est affirme comme religion urbaine,
aussi bien dans la petite capitale caravaniere de la Mecque que dans la
Medina, premiere capitaIe, dans une oasis, du premier etat de l'Islam
Durant I 'expansion, les musulmans n'ont pas cesse de creer de
nouvelles cites. II suffit de mentionner Kl1fa, Bassora, Wasit, Mosul,
Bagdad, Fustat, Le Caire et Chiraz en Orient; ou Qairawan, Mahdiya, Alger,
Oran, Fez, Marraquesh, La Qal'a des Banl1 Hammad, Bujia et Rabat en
Occident(l38).
L'IsLAM ET LES CITES 45
Entre toutes ces cites, il y en a qui ont ete completement perdues, alors
que d'autres, au moins quinze, ont continue a survivre comme grandes cites
de l'Islam.
L'importance des cites dans Ie monde musulman est due au fait que les
musulmans ne peuvent ac.complir pleinement et confortablement leurs
obligations rituelles que dans une cite(105).
11 est indispensable d' avoir une mosquee-cathedrale, avec un
minaret et un minbar et de pouvoir compter sur l'assistance d'un
khatib ou predicateur, pour la priere du vendredi, moment de
reunion et d'affirmation de la communaute musulmane.
- Le devoir de la femme musulmane de se couvrir d'un Hijab,
comme I' exige la loi musulmane, ne peut etre accompli que
dans une cite; dans un village, on ne peut que laisser une
certaine liberte a la femme.
- La gestion des biens de maIllS mortes, les waqf (qui ne
s'occupent pas uniquement d'assurer Ie bon fonctionnement du
culte, mais aussi de maintenir de nombreux organismes de la vie
urbaine) se fait dans la cite OU, precisement, il y a une bonne
partie desdits biens.
- La cite a toujours ete Ie foyer et Ie centre de I' islamisation: Ie
point de depart de Ia catechese du peuple disperse a travers les
L'IsLAM ET LES CITES 46
champs. De tous temps, seule la cite a maintenu reellement
I'hegemonie de la vie religieuse. Les magistratures canoniques
ou legales ont toujours eu leur siege dans Ia cite, qui a
forcement-et a tout moment-ete Ie recours de la population
rurale.
- Les principales lois du droit civil dictees par Ie livre saint (Ie
Coran) ne sont valables, en principe, que pour les commer~ants
citadins. De plus, Ies restrictions concernant la speculation et
l'usage du riba (usure) impliquent l'existence d'institutions
urbaines(105).
L'IsLAM ET LES CITES 47
2.1. ORIGINE DES CITES ISLAMIQUES
Les termes proposes par la langue arabe pour designer les
agglomerations urbaines ne sont pas tres nombreux.
Les mots balad ou balda sont des mots imprecis qui correspondent
sensiblement au mot franyais «population. » Le nom qui s'applique
veritablement a une cite est medina et, de meme que Ie terme 'civilisation', il
est proche du mot 'cite' par l'intermediaire du latin Civitas. Le terme arabe
tamaddun, qui designe la civilisation, provient directement de medina. A
part ce demier mot, il y en a d'autres comme hadira, hadra, et asima qui
s'appliquent plus specialement aux capitales. Vne grande cite sera aussi
nommee en arabe misr, et les traditions musulmanes nous prouvent qu'ils ont
appele ainsi - durant la periode des premieres conquetes - les capitales des
provinces; par exemple, Bassora, Kufa.
En ce qui conceme Ie terme medina, il est d'origine arameenne et il
semble designer l'endroit OU se faitjustice(97). Aux tous debuts de l'Islam, il
fit fortune en substituant Ie nom de Yatrib, pour designer la residence du
prophete apres l'hegire. L'origine de la medina semble donc etre une
agglomeration dotee d'un biitiment pour Ie culte qui reunissait tous les
fideles pour la priere commune et dans lequel Ie juge de la communaute ,
rendait ses sentences.
L'IsLAM ET LES CITES 48
Pour etudier I'origine des cites islamiques il faut distinguer entre les
cites pre-islamiques et celles nouvellement fondees.
2.1.1 Les cites pre-islamiques
Les premieres civilisations de l' ere historique voient Ie jour dans les
vallees fertiles du Nil, dans la Mesopotamie et au Moyen-Orient. Ces
civilisations ont fonde de grandes cites comme Memphis, Tebas, Tall al
Amarnah en Egypte, Uruk, ur et Ashur dans la Mesopotamie, Jericho,
Jerusalem, Sidon, Alep et Damas au Moyen-Orient.
Grace aux conquetes faites par Alexandre a I'Ouest de l' Asie et en
Egypte en I'an 334, et grace ala disparition de la menace perse, la culture
grecque a pu s' etendre partout dans I' orient, chose qui a resulte en une
nouvelle culture connue comme Hellenistique, differente de la culture
hellenique ou du grec classique. L'helIenisme est devenu un aspect
dominant du Moyen-Orient et du Nord de I' Afrique, et il a eu une grande
influence pendant des milliers d' annees et jusqu' a I' arrivee de l'Islam.
Au debut, les musulmans ont a peine cree de grandes cites, vu qu'ils ont
avance dans les territoires les plus organises du bassin mediterraneen et
qu'ils ont trouve que la grande tradition urbaine classique - dans sa modalite G
hellenistique, romaine ou byzantine - formait des cites tres importantes et
offrait une gamme riche de solutions spatiales urbaines.
L'IsLAM ET LES CITES 49
II est indubitable que les musulmans, et depuis les premiers temps de
leur expansion, avaient re9u ces modeles anterieurs sans nier leur origine.
Ainsi, les institutions hellenistiques fondamentales dans la vie urbaine ont
survecu avec la domination islamique et elles ont meme ete utilisees comme
base pour des elements posterieurs de la cite islamique : Ie suq a surgi des
avenues a colonnes, la qaysariyya et Ie Khan de la basilique, Ie hammam des
thermes ou anCIens bains, et la maison avec terrasse du style de maison
grecque.
Mais les musulmans ne se sont pas limites a adopter ces elements. lIs
les ont en meme temps transformes, les assimilant et les adaptant a leurs
propres patrons culturels, et ils les ont utilises a leur maniere, les transformant
en autre chose qui n'avait absolument rien a voir avec ce qu'ils etaient a l' origine. Cependant, tous ses elements se ressemblaient entre eux(42).
Une fois 'arabisee' la cite ayant d'anciennes fondations, et meme si elle
conservait son plan primitif, Ie trace de ses anciennes rues, les memes sorties
vers l'exterieur, elle se voyait munie d'un certain nombre de batiments qui
lui donnaient sa physionomie de cite musulmane, conformement a la
conception sociale selon laquelle la vie mondaine ne peut etre separee de la
vie religieuse(97).
D'autres elements hellenistiques urbains ont disparu de la cite
islamique, comme Ie gymnase et Ole theatre: mais ils furent recompenses
fonctionnellement par les aspects sociaux et educationnels de la mosquee, et
L'IsLAM ET LES CITES 50
a partir du Xle S., par l'existence d'institutions d'enseignement religieux et
legal (al-madaris).
Le plan rectangulaire des cites hellenistiques a eu un certain effet sur
plusieurs cites d'origine islamique dans Ie Maghreb et en Egypte, OU des
plans semi-rectangulaires sont apparus dans certaines cites comme al-Askar,
Al Qata'i, al-Qahira, en Egypte, Rabat, Meknes, Tanger, Fez au Maghreb
(figs. 20,21).
Le plan urbain circulaire d'usage assynen a pu etre effectif dans les
regions de l'Orient comme a Kufa, Bagdad, et dans certaines cites iraniennes
islamiques (figs. 22, 23).
L'IsLAM ET LES CITES
Fig. 20 Le plan du Caire au X S. (par Alsayyad N) (13)
1. Pa/ais du Califat
4. Maison des hOtes
2.Mosquee al - Azhar 3. Jardin
5. Quartiers residentiels
51
L'ISLAM ET LES CITES 52
Fig. 21 Le plan de Bassora (par Alsayyad N) (13)
1. Mosquee 2.Palais 3. Place publique 4. Marche
5. Quartiers residentiels 6. Rahba
2.1.2 Cites nouvellement fondees
Le developpement de I'urbanisation a I'epoque islamique s'explique,
selon Wagstaff (l47), a travers trois arguments: L'importance indeniable des
cites dans Ie monde musulman, Ies besoins militaires, et Ies desirs des
Califats et gouverneurs d'etablir de capitales et des centres administratifs
pour eux-memes.
Dfi a differents motifs de fondation, nous pouvons voir:
L'IsLAM ET LES CITES 53
Fig. 22 Organisation schematique du plan de Kula (Reconstruite par Massignon)
1. Mosquee 2. Palais 3. 'Maydan et Musala '
2.1.2.1. Cites de caractere militaire
Beaucoup de cites fondees par les musulmans ont ete, a leurs debuts,
des cites de caractere militaire: face aux territoires qu'il faut conquerir, des
campements, des points d'appui strategiques, des enceintes solides destinees
a abriter - a l'interieur de leurs murs -les colonnes d'invasion obligeesoa se
replier (42). Ce fut Ie cas de Bassora et Kl1fa en Iraq. En Egypte, en Afrique,
L'IsLAM ET LES CITES 54
al-Fustat et al-Qairawan. Des cites qui sont par la suite devenues des centres
d'islamisation des nouvelles provinces.
:l~O· ~I trI '1(XiO: I rt
Fig. 23 Le plan de fa ville circulaire de Bagdad.
Construite par Ie Calife ai-Mansour en 762-67.
1. Mosquee 2. Palais 3. Partes.
2.1.2.2. Cites de caractere royal
Un bon nombre de cites islamique ont ete fondees par des souverains
ou des princes plus ou moins independants. La fondation d'une cite etait un
acte courageux, pouvant etre accompli uniquement par les souverains ayant
assez de ressources, et qui montraient ainsi leur grandeur. Ibn Khaldun a dit
que la fondation et la construction de cites est la fonction des souverains ou
des empires. Le monarque abbas side al-Mutawakkil, quand il a termine de
construire la cite d'al-Ja-Fariyya, l'actuelle Mutawakkiliyya, au Nord de
L'IsLAM ET LES CITES 55 ---------------------
Samara, s' est exclame en disant» : c' est maintenant que je sais que je suis
roi, ayant pu me construire moi-meme une cite pour y vivre. » (138) .
La cite royale correspond a la creation, B~ ?~W.,~ du prince, d'un
ensemble architectural prevu pour lui et pour son patio. Cette fondation
surpasse, de par ses dimensions, Ie palais ou I' ensemble du palais et e1le
acquiert la forme d'une cite entouree de murailles et qui regroupe beaucoup
de bfrtiments reserves a l'usage du prince.
Les habitants de la cite royale ne forment jamais un corps hom 0 gene ;
au contraire, ils correspondent plus a une vraie mosai'que sociale,
professionnelle et ethnique OU tout depend de la volonte souveraine.
Selon w. Marcais (l05), la cite royale s'etend avec les successeurs de
l'Emir et elle devient populaire quand Ie prince n'y vit plus et quand les
pauvres s'installent dans ses bfrtiments.
Comme exemple de cites royales, nous pouvons citer Bagdad, fondee
par les Abbassides en 762, Raqqada, fondee par les Aghlabides en 876 un
peu au sud de Qairawan. En Espagne, avant Ie Xle S., deux de ces cites
situees aux portes meme de Cordoue - ont connu une fortune passagere: la
residence Omeyya de al-Madinat az-Zahra et la residence de amiri de al
Madinat az-Zahira. La premiere, un peu a l'Ouest de la capitale ; l'autre, a
l'Ouest, dans un des meandres du Guadalquivir.
L'IsLAM ET LES CITES 56
2.1.2.3. Cites de caractere religieux
Les endroits sacn:~s situes dans Ie monde rural ont parfois ete I' origine
d'une concentration urbaine qui se developpait spontanement autour du
sanctuaire ou de la tombe d'un saint, et OU plusieurs activites - comme Ie
commerce et I'hebergement - s'epanouissaient pour repondre aux besoins
des pelerins. (La Mecque, medina, Karbaia en Iraq, Quezzane au Maroc.)
(fig. 24).
Fig. 24 Quezzane: Une cite d'origine religieuse
2.1.2.4. Implantations sur des sites historiques
Pour profiter des avantages d'un site historique, et done des vestiges
d' organisations anterieures (rues, ponts, murailles, etc.), beaucoup de cites
isiamiques ont ete fondees sur ces vestiges-Ia ou a proximite d'anciennes
cites detruites ou abandonnees. (AIep, Anjar pres de l'ancien Baalbek au
Liban, el-Fustat pres de }'ancienne cite greco-romaine.) (Fig. 25)
L'IsLAM ET LES CITES 57
o
Afejandrfa
Tripoli
Fig. 25 Cites islamiques implantees sur un site urbanise(J14)
L'IsLAM ET LES CITES 58
2.2. MODES DE FORMATION DES CITES ISLAMIQUES
2.2.1. Formation spontanee
Le noyau original de la cite s' est souvent developpe de maniere
spontanee a partir de differentes implantations originales (Rib at, residence
royale, etc.); ce developpement a eu lieu soit par une progression lineaire
continue de 'parcelles', progression constituee de generation en generation
au sein d'une meme famille, soit par une progression lineaire continue de
'parcelles', progression constituee tout au long des rues rurales, soit encore
par un regroupement autour d'un point d'eau ou tout au long d'un fleuve
comme Samara (Iraq), fleuve de 25 km de IongCl ]4).
Cette formation spontanee est due aux liens familiaux forts qUI
caracterisent la civilisation islamique. Ces liens ont contribue a former des
regroupements tres concentres et un reseau de chemins irregulier et ramifie
qui sert Ia majorite des noyaux originaux(l14).
2.2.2. La creation volontaire
Certaines cites islamiques ont ete fondees par I' initiative ou
l'impuision d'une autorite politique ou religieuse voulant, de cette maniere,
laisser sa trace dans l'histoire et Ie territoire.
L'IsLAM ET LES CITES 59
La creation urbaine comme reunion des croyants et de la pratique
commune des rites religieux a toujours ete une action recommandee et
positive pour la collectivite, et ceci depuis la cite circulaire de EI Mansour a Bagdad, en passant par Cordoue au IXe S., etjusqu'aux cites indiennes ou
perses du XVle et XVIIle S., telles Fathipour Sikri, Jaipur, Ispahan.
Le dessin du plan commence par Ie choix du site et par Ie trace de
l'enceinte pour delimiter les territoires qui doivent etre urbanises, pour
contr6ler les entrees et les sorties, pour definir une surface de securite
interieure, et bien entendu pour des raisons de besoins militaires. Apres
avoir fait Ie trace de l'enceinte, il faut localiser l'emplacement de la
mosquee, de la residence du pouvoir, du commerce ou suq et des rues
principales. La configuration et I' orientation etaient imposees par: la forme
de l'enceinte, la position des portes et par la qibla(l24), qui recommandait une
direction particuliere pour la construction de la mosquee.
L'IsLAM ET LES CITES 60
2.3. THEORIES DE 'IBN KHALDUN' CONCERNANT LE
DEVELOPPEMENT URBAIN
Abd al Rahman Ibn Khaldoun (1332-1406) est ne a Tunis, au sein
d'une famille hispano-arabe. Le fondateur de la famille avait emigre du
Yemen de l'Arabie meridionale vers l'Espagne, et ceci au IXe S. II a occupe
des postes importants a Fez et a Grenade. II fut nomme plusieurs fois juge
d'un des grands tribunaux du Caire. II ajoue un role dans la politi que du
Nord de l' Afrique et de l'Espagne, et ceci l'a aide a ecrire l'histoire des
dynasties du Maghreb en ayant un modele reellement ample(74). La premiere
partie de ladite histoire, la muqaddima (Prologues) (83\ est objet d'attention
jusqu' a nos jours. Dans cette partie, Ibn Khaldoun parle de fa90n detailIee de
la naissance, du proces vital et de Ia mort des cites, ainsi que des conditions
favorables a leur fondation.
2.3.1. Naissance, proces vital et mort des cites
La theorie de Ibn Khaldoun nous explique parfaitement Ie proces de
developpement des cites musulmanes, de meme que son opposition a
l' environnement champetre, c' est -a-dire, Ia vie specifiquement urbaine de
ces cites.
Pour Ie philosophe, Ie vacarme apparent concernant les evenements
africains se reduit a un seul: la coexistence de deux modes de vie, la vie
nomade et Ia vie sedentaire. Ces deux modes sont irreductibles entre eux et
,
L'IsLAM ET LES CITES 61
ils vivent en une lutte perpetuelle. Le nomade est un paysan, c'est l'homme
du desert; Ie sedentaire est Ie citadin (42).
Nous allons smyre la pensee de Ibn Khaldoun a travers l'explication
que nous donnent Ortega et Gasset (121) dans leur reuvre intitulee: 'Ibn
Khaldoun revele Ie secret' , et OU ils nous expliquent ce qui suit:
'La societe humaine commence dans Ie champ libre, comme
nomadisme, et il y a en elle un minimum de cooperation et un maximum de
lutte. La societe humaine tennine par la fondation de cites et elle tend
forcement a cela. Par contre, l'inverse n'a pas lieu: les citadins ne
reviennent pas a la vie nomade, au champ libre. '
" ... La civilisation, consequence inexorable de la cooperation, constitue
un mal en soi, et elle est la veritable base destructrice dans Ie proces de toute
evolution sociale. La civilisation est la cite et la cite est la richesse,
l' abondance, la vie superflue, Ie luxe et la luxure. La famille qui arrive au
pouvoir souffre de I' influx du temps, elle perd sa vigueur et tombe dans la
corruption. Les attentions que les gouverneurs se voient obliges a leur
donner brisent leurs forces et ils deviennent les jouets du hasard, parce qu'ils
ont faibli devant les plaisirs et qu'ils ont epuise leurs forces dans la
JOUlssance et Ie luxe. C' est ainsi que se termine sa domination politique et
son progres dans la civilisation ou l'urbanite de la vie sedentaire; ce mode
est celui de I' existence naturelle de I' espece humaine, comme il est naturel
pour Ie ver de filer son cocon afin d'y mourir a l'interieur,,(l21).
L'IsLAM ET LES CITES 62
"Le cycle de la cite s' est consomme; ne dans Ie champ, il fructifie en
conquerant d'autres groupes qu'il reunit sous une seule souverainete, pour
mourir finalement dans Ia cite qui a ete fondee comme residence dudit
pouvoir politique.
"Le secret de l'histoire humaine reside dans cette tension entre champ
et cite. Le nomade, vaillant, lutteur, temp ere par une vie pauvre et dure, est
Ie conquerant. II arrive a des cites qu'il fait siennes mais, en se les
appropriant, il contracte leur vinls fatal et tombe dans la mollesse, permettant
amSl a d' autres nomades de venir lui usurper son poste quelques annees plus
tard. C'est ainsi que toute l'histoire se convertit en un proces qui se repete
continuellement: des periodes d'invasion et de creation d'etats, des periodes
de civilisation, et de nouvelles periodes d'invasion. Ibn Khaldun est arrive a
fixer Ie chiffre temporel de ce rythme a trois generati ons (cent -vingt ans).
C' est la duree d'un etat. La decrepitude survient un peu plus tOt ou un peu
plus tard. Les etats, tout comme les individus, ont une vie : ils grandissent,
ils arrivent ala maturite, et ensuite ils commencent a decliner. ,,(121)
2.3.2. Conditions favorables it la fondation des cites
Les commentaires suivants, donnes par Ibn Khaldun(83) ne sont pas
accompagnes d'explications suppIementaires parce qu'ils s'expliquent eux
memes.
"
L'ISLAM ET LES CITES 63
2.3.2.1. Installation et construction
Le grand philosophe dit que pour que la vie dans une cite soit
agreable, il faut faire attention, en la construisant, a plusieurs conditions:
- En premier lieu a l'existence d'un fleuve ou de sources d'eau
pure et abondante dans son manoir.
- II faut aussi faire attention a l'air, et choisir un endroit OU l'air
soit pur. Si la cite se trouve dans les environs d' eaux polluees,
ses habitants souffriront de maladies frequentes.
- Dans les environs il devra y avoir de bons paturages, des terres
de labour propres pour la culture des cereales qui sont la base de
I' alimentation des personnes habitant dans Ie voisinage, ainsi
que de leur betail. II devra aussi y avoir des montagnes ou des
forets qui leur foumissent Ie bois pour la construction et les
buches pour Ie foyer.
- Pour sa defense, la cite devra etre construite au sommet d'une
montagne abrupte; dans une peninsule, presque entierement
entouree par la mer ou en bordure d'un fleuve ne pouvant etre
franchi que par un pont de barques ou de pierres.
L'IsLAM ET LES CITES 64
II serait donc convenable que la cite en question soit situee sur une
colline elevee d'acces difficile, et que dans ses alentours il y ait des tribus ou
des gens ayant un esprit combatif, capables de la secourir rapidement en cas
d'aUaque nocturne imprevue. Pour qU'elle soit a l'abri de toute surprise,
to utes les maisons de la cite devraient etre protegees par un siege mure, a
l'interieur duquel les paysans des alentours puissent aussi trouver refuge en
cas de besoin. Ainsi la cite pourra se defendre sans l'aide d'une armee.
Entre les cites exposees aux aUaques et qui etaient situees au bord de
la mer, nous pouvons citer Alexandrie dans l'Orient, Tripoli, Bona et Sale
dans l'Occident. Par contre, Ceuta et Bujia satisfaisaient les conditions
mentionnees ci-dessus relatives aux cites maritimes.
2.3.2.2. Observations socio-economiques
Ibn Khaldoun a fait d'importantes observations pour definir ce qui
peut etre, de nos jours, appeIe les 'dynamiques regionales', Ie 'paysage
economique', la diffusion politique' ou rurale (disseminee) des centres
urbains. Parmi ses observations, nous citons les suivantes :
'L' organisation sociale de l'homme est une necessite. Les
phjlosophes a nous ont indique cela quand ils disaient: "L'homme est par
nature un etre politique", c'est-a-dire qu'il ne peut faire abstraction d'une
organisation sociale que les philosophes nomment techniquement "la cite".
L'IsLAM ET LES CITES 65
Les cites dans les parties lointaines du royaume, meme si elles avaient
une civilisation avancee, se trouvaient dans Ie nomadisme et loin de la
culture sedentaire dans toutes ses formes, contrairement a celles qui se
trouvaient au centre et etaient Ie siege de la dynastie. L'unique raison a cela
est que Ie gouvemement etait pres d'elles, comme l'eau d'un fleuve qui
transforme en vert tout ce qui l'entoure, rend ant les terres environnantes
fertiles, alors que tout ce qui est loin de lui reste aride et tres sec.
Au moment OU Ie luxe s'installe dans une culture urbaine, la
presomption, la paresse et la corruption morale s'y installeront aussi. Ibn
Khaldoun affirme :
"Le but de la civilisation est la sedentarisation. Elle indique la fin de
1a vie d'une cite et amene avec elle la corruption."
2.3.2.3. Le concept du 'Zoning' et la pratique de I'administration
municipale
Les raisonnements suivants impliquent - et peut -etre pour 1a
premiere fois dans 1a 1itterature concernant la planification urbaine - Ie
concept moderne de 'Zoning' .
" ... La construction et la planification urbaine sont des caracteristiques
d'une culture sedentaire. C'est Ie fruit du luxe et de 1a tranquillite... Des
L'IsLAM ET LES CITES 66
cites, des prOVlllces avec leurs monuments (hayakil) , d'impressionnantes
constructions et de grands batiments ont ete etablis pour les masses et non
pas pour une minorite. Par consequent, il faut un effort unifie et beaucoup de
cooperation. "
"Le but des cites est de pourvoir assez de refuges et de foyers. Par
consequent, il faut que tout ce qui pourrait nuire reste hors des cites pour les
prot6ger des invasions et que toutes les choses utiles ainsi que tout Ie confort
soient disponibles a l'interieur des cites."
Ibn Khaldoun eclaircit des aspects de ce qui s'assume de nos jours par
ce que nous appelons 'administration municipale.'
"La fonction de la hisba est un poste religieux ... dont Ie role est de
faire des investigations concernant les delits, de prononcer des arrets
arbitraires et correctionnels vis-a.-vis des auteurs desdits del its et
proportionnellement a leur faute. II do it pousser les gens a. respecter l'interet
general de la cite. C'est ainsi qu'il empeche l'obstruction du passage dans
les voies publiques; il interdit aux porteurs de porter des choses trap
lourdes; il oblige les proprietaires des maisons en danger de ruine de demolir
ces demieres, eliminant ainsi Ie danger qu' elles pourraient representer pour
les passants .
... ce poste n'a pas de competence generale pour tous les faits qui lui
sont presentes, mais seulement pour tout ce qui concenw la fraude, les
L'IsLAM ET LES CITES 67
tromperies dans la vente des aliments et autres marchandises, ainsi que pour
tout ce qui conceme les mesures et les poids."
"Tres souvent les autorites ont eu recours a l'opinion d'architectes et
de planificateurs pour des questions de construction. Pour cela, dans les cites
ayant une grande population, les gens vivent dans des conditions de reelle
congestion. Pour cela aussi ils rivalisent avec les autres afin d'avoir plus
d' espace et d' air - que ce soit par en haut ou par en bas - et ils rivalisent
meme pour l'usage de la partie exterieure du bfrtiment. Le proprietaire a
souvent peur que des abus endommagent les murs et interdit donc cet usage
au voisin, a moins que ce demier n'ait un droit legal pour I'usage en
question. Les gens different en ce qui concerne les droits qu'ont leur magasin
a I' eau courante et ils refusent aussi les dispositions relatives aux conduits
souterrains. Occasionnellement, quelqu'un conteste Ie droit de I'autre a I'usage du mur ou d'une torsade. Ceci est du au fait que les maisons sont
trop proches I 'une de I' autre. Un autre pourrait contester que Ie mur du
voisin est en mauvaises conditions et qu'il a peur qu'il ne s'ecroule. On
aurait besoin ici d'un juge a l'encontre de l'Altera pars, et il faudrait faire
appel a un expert, pour obliger cette Altera pars a casser Ie mur et eviter
d'endommager la maison voisine. Parfois une maison ou terrasse do it etre
divisee en deux parties, de fa~on a ne pas produire de dommages a la maison
et sans nuire a ses utilites ou autres choses de ce genre... toutes ces questions
ne sont claires que pour ceux qui s'y connaissent profondement en
architecture.' ,
I .
L'IsLAM ET LES CITES 68
2.3.2.4. Fonctionnalite dans l'architecture et dans la planification
urbaine
En ce qui conceme I' architecture, Ia planification urbaine et Ia
fonctionnalite dans I'architecture, Ibn Khaldoun a ecrit ce qui suit:
"Les arts ne sont parfaits que s'il y a une civilisation grande et
sedentaire. L'art de I'architecture ... est Ie premier et Ie plus ancien art des
civilisations sedentaires. C'est Ia science de comment realiser des maisons
pour qu'elles servent d'abri et de couverture. Ceci est dfi au fait que l'homme
a une predisposition naturelle it retlechir aux effets des choses. Pour cela, il
est inevitable que nous retlechissions au probleme de comment empecher les
dommages causes par Ie froid et la chaleur. En utilisant des maisons qui
aient des murs et des toits qui s'interposeront, des quatre cotes, entre no us et
tels facteurs ... En plus, les conditions de construction sont differentes selon la
cite. Chaque centre urbain suit une procedure connue par la competence
technique de ses habitants et qui correspond au c1imat et aux differentes
conditions relatives it la richesse ou pauvresse de sa population."
"L'architecture est aUSSI necessaire quand les gouvemeurs d'une
dynastie decident de construire de grandes cites et des monuments eleves. Ils
mettent tous leurs efforts afin de faire de bons plans et de batir des
constructions elevees avec des techniques parfaites, de fayon que G
l'architecture atteigne sa perfection maximale. L'architecture est l'art qui
satisfait tous ces besoins.
L'IsLAM ET LES CITES 69
Les architectes qui exercent leur profession ne sont pas pareils. II y en
a qui sont habiles et intelligents et il y en a qui sont inferieurs et mediocres.' ,
2.3.3. Ibn Khaldun, un planificateur urbain precoce
Ce que Ibn Khaldoun a signale plus haut montre son point de vue
concernant la cite comme devant etre un melange de gens et culture,
d'architecture et genie, de gouvernement et d'administration, de finances et
d'economie. Pour Ibn Khaldoun, la cite n'etait pas un organisme statique de
deux ou meme trois dimensions, c' etait plutot un orgamsme
multidimensionnel auquel il fallait ajouter les elements de temps et de
philosophie(I36). L'ensemble de tout cela a incite Shiber(I36) a decrire les
observations de Ibn Khaldoun concernant les cites comme etant "un presage
universel a la planification urbaine dans tout son sens global et
contemporain." II a en plus dit que les idees de Ibn Khaldoun contenaient
meme "une connaissance respectable concernant les questions urbaines et de
planification. "
L'IsLAM ET LES CITES 70
2.4. L' ARCHETYPE DE LA CITE ISLAMIQUE
2.4.1. Premieres idees: introduction it I'archetype
La premiere tentative pour analyser Ie concept de la "cite islamique"
remonte aux premieres decades de ce siec1e et e1le est representee dans les
travaux des freres Marcais, Sauvaget, Le Toumeau et Van Grunebaum.
Dans un article de 1928, William Marcais(102) a introduit pour la
premiere fois differents concepts qui fiuent adoptes plus tard par beaucoup
d'erudits. Dans I 'article en question, on signale que }'Islam est
principalement une religion urbaine qui porte en e1le une civilisation dont ses
cites furent l'essence. II nous rappeUe que Mahomet, Ie prophete de l'Islam,
ainsi que les premiers califes etaient des membres de la bourgeoisie urbaine
de l' Arabie. II a aussi note que la priere du vendredi dans la grande mosquee
reflete Ie besoin d'une union urbaine pour la survivance de la religion. Dans
une tentative pour identifier les elements physiques de la cite musulmane
typique, William Marcais decrit la cite islamique comme une cite formee par
la grande mosquee du vendredi pourvue d'un souk ou marc he proche, et
entouree d'une serie de hammams ou bains publics (Fig. 26).
L'IsLAM ET LES CITES 71
.. :.: .. : .... 0 . I ~ ... -- V 2. . 1 . . .. '. 0 ':::::::;;:::::::"
.... ; ....................... -... -." \' ., .... • .•.... ~, ......... , .. . __ l __ L
Fig. 26 L 'archetype de la cite islamique au Nord de I 'Afrique, basee sur Ie
texte de W Marcais (1945), R. Le Touraneau (1957) et J. Berque.
(Reconstruite par N Alsayyad) (13)
1. Mosquee du vendredi 2. Marche 3. Bain public 4. Quartiers residentiels
Dans deux articles qu'il a ecrits en 1940 et 1957, Georges
Marcais(103\ de meme que son frere, a adopte la position disant que l'IsIam
est principalement une religion urbaine, et il a ajoute trois autres qualites
physiques propres a Ia cite islamique :
La differentiation entre Ies quartiers residentiels et Ie§ quartiers'
commerciaux; Ia segregation des quartiers residentiels selon Ie facteur
ethnique ou selon la specialisation; Ia hierarchie des commerces dans Ie
L'IsLAM ET LES CITES 72
marche, de fa~on que les plus nobles et les plus propres soient situes autour
de la mosquee.
Comme l'a si bien note Abu-Logod(13), il est important de signaler que
tous les exemples utilises par les freres Marcais proviennent uniquement des
cites du Maghreb. Malgre cela, et bien que la forme physique de la cite
islamique typique etablie par les freres Marcais soit tres elementaire, elle a
ete adoptee par la majorite des chercheurs tout au long des temps. Ce fut Ie
premier pas dans la construction d'une image mentale ou stereotypee de la
cite musulmane.
Le travail de Roger Le Tourneau et Jacques Berque(13) represente
une suite a la tradition etablie par les freres Marcais. Le travail de Le
Tourneau concernant Fez, et qui plus tard a culmine dans son livre pour
inc1ure les cites musulmanes du Nord de l' Afrique, a constitue une autre
tentative pour identifier une morphologie generale de la cite musulmane
basee sur un concept de recherche progressive. Berque a mentionne trois
genres d' elements: La mosquee du vendredi, Ie marche et les bains publics,
et il les a mentionnes dans Ie me me ordre que l'avait fait William Marcais.
Berque a cependant parle des fonctions de la cite qui etait pour lui un endroit
pour s'installer ainsi qu'un terrain pour l'echange. Et les elements ci-dessus
mentionnes ant principalement contribue it ces deux fonctions.
L'IsLAM ET LES CITES 73
2.4.2. Le developpement de I' archetype
Nous avons jusqu'a present discute de l'evolution de l'archetype base
sur les exemples du Maghreb, ou la majorite des cites ont grandit comme
resultat d'un proces spontane.
Au creur meme du Moyen-Orient, les cites les plus importantes etaient
fortement enracinees dans les traditions urbaines pre-islamiques. C' est pour
cela que I' archetype maghrebin ne pourra pas etre facilement applique dans
les cites de la Syrie et de la Palestine. Ceci faisait deja partie des idees de
Jean Sauvaget (132). Quand il a commence son travail concernant Damas et
Alep - deux cites ayant un trace fondamentalement geometrique provenant
des temps greco-romains - Sauvaget a decouvert que la structure
geometrique du bloc greco-romain avait commence a se decomposer avec Ie
declin de I' empire byzantin; Cependant, il insistait sur Ie fait que la
modification radicale du plan s'etait consumee sous la domination islamique.
Sauvaget a identifie Ie premier element de la cite islamique typique, Ie
souk, qui etait surgit des avenues a colonnes de la cite byzantine, et ceci afin
de savoir comment avait eu lieu Ie proces de changement dans la cite. II a
aussi identifie d' autres elements a Alep et Damas, comme la mosquee qui
occupait l'ancienne place de l'eglise ou du temple, la place centrale des
temps pre-islamiques qui, elle, s'est desintegree en un reseau de ruelles ayant
plusieurs fonctions commerciales et residentielles, et la citadelle qui
normalement occupait Ie meme cote de Ia coUine que celui qu' occupait
l'ancien poste de defense. Bien que Sauvaget n'ait dessine aucun schema de
L'IsLAM ET LES CITES 74
la cite typique musulmane, sa conclusion pourrait se resumer de forme
schematique (fig. 27): Ie suq adopte une forme lineaire, la mosquee
n' occupe pas une place centrale et la citadelle est situee dans la partie Est.
Cette structure a represente les bases de I' archetype au Moyen-Orient, et elle
fut l'un des piliers sur lesquels I' orientaliste Gustave Von Grunebaum a base
beaucoup de ses ecrits concernant la structure de la cite islamique (67).
Fig. 27 L 'archetype de la cite islamique au Moyen-Orient, base sur Ie texte de
Sauvaget. (Cons tru ite par N. AIsayyad) (13).
1. Mosquee du vendredi 2. Citadelle 3. Marche 4. Quartiers residentiels.
L'IsLAM ET LES CITES 75
Von Grunebaum est venu de l' Allemagne aux Etats Unis fuyant la
seconde guerre mondiale. Son article 'la structure de la cite musulmane' a eu
plus d'influence sur les chercheurs de la cite musulmane que n'importe quel
autre travail realise par ses contemporains. Dans cet article Grunebaum (67)
etablit une comparaison entre les cites islamiques et les cites grecques
classiques ou les cites europeennes de l'epoque medievale. Face it ces
dernieres, il manque it la cite islamique un statut propre ou quelques
privileges inherents au fait urbain; ce n' est pas une association autonome de
citadins et il n'est donc pas necessaire de remplir une serie de conditions
pour etre consideree comme telle .
L'image de la cite musulmane typique projetee par Von Grunebaum a
ete conyue progressivement. En premier lieu il a accepte les elements de la
cite musulmane telle que definie anterieurement par les chercheurs franyais
qui ont etudie Ie Maghreb it fond (la mosquee, Ie marche et les bains), et
ensuite il a modifie la structure desdits elements ainsi que la relation entre
eux en utilisant Ie travail de Sauvaget concernant les cites syriennes avec
leurs mosquees converties, leurs bazars lineaires et la citadelle. Finalement il
a ajoute deux elements conyus par lui-meme : Les deux nles principales qui
se croisaient dans une place centrale, la mosquee du vendredi situee tout au
long de la rue principale et Ie palais du gouverneur situe it cote de la mosquee
(fig. 28).
L'IsLAM ET LES CITES 76
Q
:ilf."IIIiJ·i"'"If~ Ittl~I'II'I~:i.II~~ .............. ~ .............................. , ...... ~ ®. -Qk ......... ~.;. .. ' .............................. &m
81
Fig. 28 L 'archetype de la cite islamique au Moyen-Orient. Base sur Ie
travail de Von Grunebaum. (Texte de 1995). (Reconstruite par N Alsayyad)(13).
1. Mosquee du vendredi 2. Palais 3. Place pub/ique (Maydan) 4. Marche 5. Citadelle
6. Bain public 7. Quartiers residentiels 8. Murs et portes
2.4.3. La consolidation de l'archetype
Aucun autre chercheur n' a autant contribue a la consolidation de
l'archetype comme l'a fait Albert Hourani qui a organise, vers la fin de 1960,
un des premiers symposiums sur la cite islamique. Quelques annees plus
tard, Ie resume fut publie dans Ie fameux livre 'La cite islamique'. Dans
L'IsLAM ET LES CITES 77
l'artic1e introducteur, Hourani (75) a aborde Ie comment de la formation de la
cite musulmane. Pour donner des reponses il a eu recours ace qu'avait
mentionne Max Weber concernant les composantes ou caracteristiques
essentielles d'une cite. 11 a mis en relief Ie fait que certaines caracteristiques
signalees par Max Weber manquaient a la cite islamique; Cependant, et
malgre cela e1les ont pu s'epanouir et maintenir un niveau eleve de creativite
urbaine. Apres nous avoir avertit des nombreuses variations dans la forme
de la cite islamique, Hourani s'est construit une image de sa conception de la
cite musulmane typique. Nous citons certains de ses mots:
'Premierement il y aurait une citadelle situee, Ie plus souvent, dans un
lieu de defense naturelle... Deuxiemement, il pourrait y avoir une cite ou un
village royal... Troisiemement, il y aurait un complexe urbain central qui
inc1urait les mosquees, les madaris, et les marches centraux avec leurs Khans
et leurs qaysarias ... Quatriemement, il y aurait les quartiers residentiels qui
avaient au moms deux caracteristiques: la combinaison selon la
differentiation ethnique ou religieuse, et l'autonomie de chaque quartier ou
groupe de quartiers... Finalement et en cinquieme lieu il y aurait les
faubourgs et les quartiers exterieurs OU pourraient s'installer les nouveaux
immigres et ou certains genres d'activites pourraient avoir lieu.'
Cette structure urbaine decrite par Hourani, en plus des elements ci
dessus mentionnes par Von Grunebaum, completent l'image d'un archetype
que beaucoup ont utilise pour faire des debats et dogmatiser sur la cite
musulmane a l' epoque preindustrielle. Cet archetype a continue a etre
adopte par des chercheurs de differentes disciplines dans Ie monde entier.
L'IsLAM ET LES CITES 78
Par exemple, Nader Ardlan et Laila Bakbtiar (15), deux architectes
iraniens, ont construit un schema de la cite islamique en considerant que la
forme de la cite musulmane est similaire a la structure cosmique.
'A l'interieur de la cite, l'ideal musulman - represente par Ie calife -
choisissait de s' installer dans un point singulier de I' espace, pres de la
mosquee, creant ainsi Ie centre des echanges spirituels. C'est ainsi que quand
un musulman bouge dans I' espace et dans Ie temps, tout ce qui I' entoure
bouge aussi. Et c'est ainsi qu'on etablit la ligne du bazar qui contient tous
les autres bfrtiments publics de fayon a constituer Ie centre des echanges
materiels. Les murs exterieurs delimitent la cite lui donnant une forme qui
symbolise Ie cosmos. Finalement, l'emplacement des portes rappelle
I' orientation cardinale.' L'interpretation de Ardlan et Bakhtiar concernant la
forme physique n'etait basee sur aucune recherche historique structuree.
Leurs points de vue semblent plutot provenir d'une comprehension
experimentale d'Ispahan, l'une des cites les plus grandioses de l'Islam -
selon une branche de la philosophie islamique, Ie mysticisme soufi.
Cependant, et malgre la tentative des auteurs de creer un modele base
sur les ideaux purement islamiques, si on compare leur schema (fig. 29) aux
schemas discutes plus haut, il parait avoir ete influence par l' archetype de
Van Grunebaum. Ardlan et Bakhtiar ont limite leur argument aux seules
cites de la Perse islamique.
L'IsLAM ET LES CITES 79
Fig. 29 L 'ordre general de la cite islamique, selon Ardlan et Bakhtiar. (15)
1. Mosquee 2. Suq
Heinz Glaube (65), qui s'est aussi occupe d'etudier les cites iraniennes, a
suivi une ligne differente de celle de Ardlan et Bakhtiar. La cite islamique
de Glaube avait quatre fonctions principales qui se manifestaient de favon
physique: (a) l'autorite gouvernementale etait representee par Ie palais ou
Ia citadelle, (b) la vie religieuse et intellectuelle etaient incamees dans les
mosquees et les madaris (ecoles), (c) I' echange economique avait lieu dans
les magasins ou dans Ie marche, dans les qaysarias et dans les caravanes du
bazar, (d) Ia population llrbaine occupait les qllartiers residentiels (fig. 30).
L'IsLAM ET LES CITES 80
Fig. 30 Structure et elements principaux de ia Cite lsiamique. Specialement en
Iran. Seion Giaube (1979). (65)
1. Murailles 2. Portes 3. Citadelle 4. Rues terrestres 5. Faubourgs 6. Rues urbaines 7. La grande Mosquee 8. Institutions administratives 9. Madaris 10. Bazar 11. Caravanserai! 12. Quartiers residentiels.
Les demieres caracteristiques de la cite islamique typique peuvent se
trouver dans l'reuvre de Besim Hakim (69)intitulee 'Arabic-Islamic Cities'
qui est basee sur l'etude d'un seu! cas, la ville de Tunis.
L'IsLAM ET LES CITES 81
Dans l'reuvre en question, Hakim argumente avec conviction que la loi
musulmane a ete particulierement responsable de la forme physique de la cite
musulmane. Bien que ses conclusions soient uniques, sa methode nous
permet de situer son travail dans Ie cadre de la chaine progressive de
recherches qui soutiennent Ie modele de l'archetype.
Comme nous l' avons VU, l' archetype de la cite islamique a ete
construit et developpe par une serie de recherches occidentales qui ont etudie
quelques cites dans differentes parties du monde islamique. Nous avons
aussi vu que ce modele a ete adopte par les chercheurs arabes et islamiques.
L' ESPACE URBAIN 85
Cette absence d'organisation est evidente quand l'analyse de la cite se
base sur la comparaison avec la cite romaine OU l'intention esthetique est une
condition indispensable a la bonne organisation spatiale. En realite, cette
methode comparative ne pouvait etre que reductrice. Par consequent, on ne
peut pas s'etonner du manque de principes d'organisation dans les cites
islamiques si on les envisage d'un point de vue occidental, et ces principes-Ia
n'ont aucun sens si on applique les notions occidentales a une realite qui part
de suppositions totalement differentes. Par contre, si nous essayons de
comprendre ces suppositions qui sont la base de ce genre de cite, tout serait
plus clair et nous decouvririons Ie sens que nous n'arrivions pas a
approfondir.
Dans cette partie de la these nous essayons d' etudier la relation entre
la philosophie ou la forme de vie dans l'Islam et I' organisation urbaine. En
d' autres termes, nous essayons de voir comment la conception de vie a
influence la configuration physique de la cite. Pour atteindre cet objectif,
nous allons traiter deux aspects importants dans la vie de I' etre musulman :
I' aspect religieux et I' aspect prive, mettant en meme temps en relief Ie rOle
de chacun d'eux dans l'organisation de l'espace urbain. D'autre part, nous
essaierons de rechercher comment la loi islamique a contribue a donner a la
cite islamique cet aspect commun, et cela a travers ses regles dans
l'environnement physique urbain.
L' ESPACE URBAIN 86
3.1.1. La Religion
L'Islam est ala fois une religion et un mode de vie. II proclame la foi
et fixe les rites. C' est une civilisation complete et complexe ou les individus,
les societes et les gouvemements devraient, idealement, refleter la volonte de
Dieu. C'est essentiellement un systeme de regles ou lois qui doivent
s'accomplir et qui tendent a s'introduire dans tous les aspects de la vie
citadine.
La cite islamique n'est autre que la grande communaute de personnes
qUI obeissent sa loi. Ainsi elle englobe tous les musulmans, tous ceux qui
professent l'Islam, et elle cOIncide avec la Umma, la «nation» ou chaque
musulman se reconnait et se sent citoyen - qu'il vive seul ou en groupe, qu'il
soit nomade ou sedentaire, qu'il soit citadin ou paysan. La religion et la
politique se confondent dans l'Islam et ceci termine dans la pluralite de
pouvoirs qui separe Ie temporel du transcendant.
Quand Idris II se preparait a fonder Fez, il dit a un vieil ermite qu'il
voulait construire une cite ou I' on pourrait adorer Ie Dieu Supreme, une cite
ou I' on lirait son livre et ou ses lois seraient accomplies. Le programme de la
cite islamique, cite eminemment de croyants (42), est aussi simple que cela.
L'accomplissement des devoirs religieux connus sous Ie nom de
'piliers de la religion' et qui sont: Ie double temoignage de foi, la priere, Ie
jefme, I' aumone et Ie pelerinage, ont cons~derablement influence Ie dessin et
Ie fonctionnement des cites de l'Islam. C'est ainsi par exemple que la
pratique de la priere - qui est la clef de l'Islam, Ie rite dont Ie pouvoir
L' ESPACE URBAIN 87
sanctificateur contribue avec plus de richesse a chaque pierre du batiment de
Ia commune et a sa cohesion - exige des conditions determinees: l'etat de
purete rituelle qu' on atteint grace aux ablutions majeures et mineures ; Ie
respect du moment specifique de la priere; I' orientation vers la Mecque ;
l'existence d'un endroit suffisamment ample pouvant recevoir tous les
fideles pour la priere communautaire du vendredi a midi. La premiere
exigence a oblige a doter la cite de toilettes, d'ablutions, de reservoirs, de
sources et de bains publics (hammams). La seconde a resulte dans la creation
des fonctions du muwaqqit, un fonctionnaire qui est charge de mettre au
point Ies horaires, et du muezzin, qui convoque ala priere. Ceci a resulte, a
son tour, dans la construction de minarets, et dans certaines cites determinees
d'observatoires astronomiques. Les deux demieres exigences ont determine
comment devaient etre construites les mosquees et comment devaient
s' accomplir les exigences Iiturgiques: U ne salle de prieres etendue en
longueur avec une niche ou (mihrab) pour indiquer la qibla, en plus d'une
chaire (minbar) a partir de laquelle Ie imam prononce son exhortation
(khutba) avant Ia priere du vendredi (111).
3.1.2. L'intimite
La cite musulmane se base sur la vie privee et sur Ie sens religieux de
l' existence, et c' est ainsi que nalt sa physionomie (41).
Q Q
La clef de la cite musulmane nous est donnee par les versets 4 et 5 du
chapitre XLIX du Coran, chapitre intitule Ie Sanctuaire: 'L'interieur de ta
L' ESPACE URBAIN 88
mmson - dit Mahomet - est un sanctuaire: ceux qui Ie violent en t'y
appelant manquent Ie respect a l'interprete du ciel. Ils doivent attendre que
tu sortes de ta maison: la decence I'exige.'
Ce caractere profondement religieux de la cite islamique depasse tout,
et il impregne tout depuis la maison meme. Si la cite classique, aristote1ique,
est 1a somme d'un nombre determine de citoyens, la cite islamique est 1a
somme d'un nombre determine de croyants (42).
Chez Ie musulman, la defense de tout ce qui est prive, de tout ce qui
est inti me va jusqu'a l'extreme et sa vie se divise en vie privee et vie de
relation. On ne peut done pas parler d'une vie domestique complete, vu
qu'elle est divisee en parties ; on ne peut pas dire non plus que 1a vie
publique est celle qui domine, comme c'est Ie cas dans 1a cite classique, vu
que 1a vie strictement privee existe.
La VIe privee conditionne l'organisation spatiale de 1a maison
musulmane plus qu'aucune autre regIe de dessin preetabli, et ceci resulte
dans un espace ferme a l' exterieur que 1a vue ne peut en aucun cas penetrer.
En nous promenant dans les ruelles is1amiques tortueuses p1eines de
toumants et de passages, nous ne pouvons jamais savoir si nous longeons 1es
murs d'un grand palais ou la maison d'un miserable. La vie completement
recluse, secrete, sans aucune apparence externe a donne comme resultat une
cite diffici1e et sans fa9ades.
Si ce principe d'intimite a ete reconnu comme instaurateur de l'espace
urbain dans la cite islamique, nous pouvons comprendre pourquoi la maison
L' ESPACE URBAIN 89
n'ouvre pas ses fenetres a la rue mais plutOt a un espace interne, Ie patio.
Nous pouvons aussi comprendre pourquoi les rues et les ruelles de la cite
sont considerees comme espaces residuels, secondaires et non pas comme
espaces primordiaux directeurs du reseau routier.
N ous pouvons comprendre pourquoi la cite islamique etait forrnee de
differents quartiers residentiels re groupe s selon Ie facteur religieux ou
ethnique, ou les chretiens et les juifs vivaient dans des quartiers determines et
non pas avec les musulmans, et cela parce que les differences dans leurs
habitudes rendaient difficiles la vie commune avec ces derniers.
3.1.3. L'egalite sociale
L'islam est une 'theocratie egalitaire'. Pour Ie chretien, tout Ie pouvoir
vient de Dieu, mais Ie musulman va plus loin. Ce n'est pas uniquement Ie
pouvoir qui vient de Dieu, mais c'est aussi Dieu qui l'exerce. Devant lui,
tous les croyants, tous les soumis, tous les islamiques sont fondamentalement
egaux par Ie fait meme d'etre croyants.
L'egalite radicale du musulman, esclave de Dieu, en fait un etre
terriblement cauteleux et prudent quand il s'agit d'exprimer sa hierarchie ou
sa fortune par l'intennediaire de signes externes. II n'y eut peut-etre jamais
de princes aussi depensiers et fastueux que les princes musulmans dans leurs
alcazars de reve, mais nous oublions qu'ils ont cache ces palais d'intimite
derriere des murailles opaques et inexpressives et qu'ils ne les ont pas
exposes a la vue de tout Ie monde parce que v' aurait ete un defi a I' egalite
fondamentale ci-dessus mentionnee (41). Le musulman ne peut concevoir Ie
L' ESPACE URBAIN 90
fait d'elever une fa~ade significative et somptueuse dans une rue ou une
place publique pour exhiber sa condition de richesse. Sa modestie est un
signe de respect a ses freres, a ses egaux. II fera construire la precieuse
fa~ade de sa maison dans un de ses patios et cela non seulement pour pouvoir
la contempler dans son intimite, mais aussi pour respecter ceux qui ne
peuvent pas en avoir de semblable (42). C'est pour cela que nous avons dit
que la cite musulmane est une cite secrete, indifferenciee, sans visage,
mysterieuse et cachee, profondement religieuse, symbole de l' egalite des
croyants devant Ie Dieu Supreme.
L' ESPACE URBAIN 91
3.2. L'INFLUENCE DE LA LOI ISLAMIQUE • AL FIKH'
SUR L'ORGANISATION SPATIALE DE LA CITE.
Le juriste allemand Georges Spies(60) a ete Ie premier a avoir attire
I' attention sur les lois islamiques - al-jikh - en relation avec I' organisation
urbaine. Son travail a ete developpe par Robert Brunshvig (1974i30), et
dernierement Besim Selim Hakim(69) a demontre - dans son livre 'Arabic
Islamic Cities' -la grand importance qu'a eu al-jikh dans l'organisation de la
cite islamique traditionnelle.
Al-Fikh est Ia jurisprudence ou les enseignements oraux qui ont ete
mlS sur papier par les juristes pour resoudre les questions n'ayant pas ete
traitees explicitement par les deux grandes sources traditionnelles: Le Coran
et la Sunna (Tradition du prophete qui fut assembIee durant Ie troisieme
siec1e de l'hegire dans les grandes collections de hadits et qui contient Ies
directives spirituelles et morales applicables aux differentes circonstances de
Ia vie individuelle et sociale).
Le desir de codifier Ia jurisprudence (fiqh) a resulte dans I' apparition
de quatre 'methodes' ou 'ecoles' (Hanafi, Malikite, Shaffi, HanbaIi) des
Sunnites ainsi que de I'ecole laafari des Chiites. Ces methodes ou ecoles
sont apparues aux debuts du Califat Abbasside, durant Ie HIe S., elles ont
survecu jusqu'a nos jours et elles n'ont jamais cesse d'alimenter Ies
argumentations des docteurs de Ia loi (111).
L' ESPACE URBAIN 92
Les differences entre les ecoles sont, en premIer lieu, de caractere
methodologique, et elles se basent sur la methode particuliere qu'a utilise
chaque fondateur pour elaborer - de maniere differente -les normes legales.
Le livre de Selim Hakim qui est, Quant a lui, une etude du cas de la
medina de Tunis et une recherche des anciens manuscrits islamiques dans la
planification des cites, s'est base sur les regles de I'ecole Maliki.
Recemment Hriayuki Yanagihachi (149) a fait un travail sur la lecture des
ordonnances de l'empire ottomane, et il a base son travail sur l'ecole Hanafi.
Dne comparaison entre les differentes interpretations permet d' etablir un
grand consensus dans l'usage meme de la terre et dans les normes de
conduite dans l' environnement physique (60).
Dans cette partie de la these nous essaierons d' etudier, a travers des
opinions legales aussi bien qu'a travers des cas actuels, comment la loi
islamique - seule loi qui se revele dans la vie materielle de la cite ~ va
beaucoup influencer Ie proces de changement et de transformation dans
l' environnement physique de la cite islamique traditionnelle. Pour cela, nous
allons regarder d'une part certains concepts pertinents dans ce sens, comme
par exemple Ie concept de la rue, de la fino, de 1 'intimite, de la garantie de
lumiere et d'air frais, de la securite ; et d'autre part nous allons regarder la loi
hereditaire islamique. Nous allons essayer de demontrer comment ces
concepts ont ete con~us et traites du point de vue legal, et comment ils vont
influencer par la suite la forme urbaine de la cite.
L' ESPACE URBAIN 93
3.2.1. Reglementations urbaines dans l'Islam
3.2.1.1. Le droit it la rue
Dans la cite, la loi islamique differencie entre la rue, Ie chemin public
que tout Ie monde a Ie droit de traverser, et la ruelle ou cul-de-sac que la
plupart des juristes ont considere comme etant un chemin semi-prive
appartenant aux proprietes environnantes. Une notion compIementaire a tout
cela est celle de fina, un espace ouvert autour et tout au long d'un batiment et
qui, selon la plupart des juristes musulmans, est considere comme partie de la
propriete (131).
L'usurpation de la propriete publique ou privee non-edifiee est
interdite par la tradition du prophete qui dit» : Celui que s'approprie d'un
tout petit bout de terre sans en avoir Ie droit sera puni».
On demanda au juriste Ashhab (m. 819) son aVIS concernant un
individu qui avait construit une maison qui envahissait 1 ou 2 cubitus de la
rue . Apres qu' il a termine de construire la maison, Ie voisin d' en face de
l'autre cote de la rue a reclame les terrains, vu que la rue constituait lefina
de sa maison; il a en outre demande que soit demoli tout ce qui avait e16
construit la-bas. Ashhab repondit que ce serait demoli .
Plus tard, Ie juriste Ibn al -Rami(82) (m. 1334) indiqua que pareille
pratique etait tres commune a Tunis. II affirma que plusieurs fois Ie grand
L' ESPACE URBAIN 94
Juge Abd al - Rafi avait ordonne la demolition d'un grand nombre de
bfttiments qui envahissaient une partie de la rue pub Ii que. II semble que ceci
ait aussi eu lieu au Caire ou, en 1478, Ie prince Yacoub entreprit d'elargir les
rues et les ruelles du Caire et il demanda au juge Shafi' i la demolition de tout
ce qui avait envahit les rues et ruelles, que ce soient des bfttiments ou des
structures en bois.
En fait, il semble que l'usurpation graduelle des rues et la fermeture
des ruelles etait chose commune dans les cites Islamiques durant toute son
existence. C'est pour cela que no us ne pouvons pas comprendre les
differentes caracteristiques physiques dans les cites islamiques si nous ('ll(
faisons fi de cette pratique graduelle et continue.
Pour illustrer comment cette pratique a pris forme a niveau physique
dans la cite islamique, nous pouvons citer Ie cas des rues de Damas qui ont
souvent ete transformees en impasses (fig.31). La rue et Ie plan de
subdivision de terrains de l'ancienne Medina est un autre exemple (fig. 32)
ou nous pouvons signaler beaucoup d'instances qui sont Ie resultat d'une
telle pratique (fig. 33). Entre les habitants des cites islamiques, la limite de
la largeur des rues que Ie prophete avait mise etait de 7 cubitus. II a en effet
dit: "quand les gens se disputent en ce qui concerne la largeur de la rue, sa
limite est de 7 cubitus" (82) (fig. 33)
Ibn al Rami (82) raconte que, dans un cas actuel et alors qu'il
subdivisait un terrain a Tunis, il fixa la largeur minimale de la rue a 8
empans, largeur suffisante pour que passe un chameau. Dans un autre cas
plus recent, en 1845 au Caire, M. Clerget (34) raconte que Ia largeur de la rue
N .i- " ,
L' ESPACE URBAIN 95
principale a ete determinee en mesurant la largeur combinee de deux
chameaux charges.
, . . .... \
J I I I I I
-~ ,
8 ~ I ... . ~ , I
. ~
.. .
- ~ 11 •
yl I ; ~ .) ! i I . .
I ~ : . ~. \
~
1 I I 1 I I I I a
. ._, _''' ___ ''''====,_.:r
Fig. 31 Le plan de Damas transforme durant I 'epoque islamique (par 1.
Sauvaget/132)
L' ESPACE URBAIN
~'. -----:--f -~ : '- ' ----- '-~~ ~.
\
, . . • . <,
i'~ ~ !
i
Fig. 32 Medina. Plan de subdivision des terrains de l'ancienne cite.
(par S. Hatloul/l 3l)
96
L' E S PACE URBAIN
~pu6fu:
~ r /1 •
£aroeur minimafe entre 3.23 - 3.JOm (7 cu6itus)
La liauteur minimafe appro:(jmative est de 3.Jm dl!1lant n'impone que{ saiffant ou structure pennise
\ CuCs-de-sac
< ~ \ r- ~ .
£arOlure minimale entre 1.B4-2.0Om (4 cu6itus)
.un
CJ>imensions IWrizontale et verticale nuu,jmafes pour faisser passer un
cliameau c/Utroe
Fig. 33 Rues principales et culs-de-sac.
3.2.1.2. Le concept dujinti
97
Le find est, selon Ies juristes et Ies habitants des cites islamiques, un
espace Olivert qui entoure ou qui Ionge un bfrtiment. Dans Ies rues
principaIes, Ie find correspond a I' espace de Ia rue situe autour de Ia porte de
la maison et qui ne doit pas s'etendre a plus de la moitie de la Iargeur de la
rue. Dans les ruelles, par contre, Ie find couvre Ia presque totalite de
..
L' ESPACE URBAIN 98
l'espace qui est devant la maison, pouvant s'etendre jusqu'a couvrir toute la
largeur de la rue (131) (fig. 34).
On a une fois demande a Malek (78) si ces espaces (afniyah, pluriel
de find) pouvaient etre utilises par les proprietaires. Sa reponse fut la
suivante: 'En ce qui concerne les espaces ayant une petite largeur OU la
moindre chose pourrait empecher la circulation, je crois que personne n'a Ie
droit de s'en reserver l'usage. Par contre, en ce qui concerne les espaces OU
la largeur est tellement grande que la circulation n'en serait pas derangee,je
ne vois pas en quoi cela pourrait nuire si les proprietaires du quartier les £):
utili sent pour leurs propres be SO!Ils rsi les auto rites n' interviennent pas. ' ..... ~ .'. . ., . '" .......... .
Les ruelles et les culs-de-sac semblent avoir ete utilises de maniere
identique au find. Cependant, les proprietaires vivant dans les environs des
ruelles jouissaient de plus de liberte que ceux vivant dans les environs d'un
find donnant sur une rue. Les juristes n'interviennent pas dans les decisions
prises concernant les ruelles en question a condition que tous les
proprietaires des environs soient d'accord pour ce qui est de l'usage qui en
sera fait et a condition que personne ne porte plainte .
L' ESPACE URBAIN
Fig. 34 Le Fina.
. . . . . "
L;').,surjaces considerees comme jina.
... .... . '" ... ... ,: I ,
,~--. CaUe principal
'n " .. .... ,.i ... ..... ~
99
Ibn aI-Rami (182) nous a parle d'un groupe de personnes qui avait
fait construire une porte pour sa ruelle. La porte s'ouvrait vers Ie mur d'une
autre personne. La personne en question a porte pIainte parce que
l'ouverture et la fermeture continues de la porte Ia derangeait. Vne fois Ie
derangement prouve, Ie juge a ordonne Ia demolition de Ia porte.
La non-intervention des juristes et des Muhtasibs dans Ia majorite
des cas de rueIles et culs-de-sac a ete une cause importante dans Ie
developpement d'un grand nombre de portes a I'interieur des quartiers des
L' ESPACE URBAIN 100
cites islamiques traditionnelles. De plus, I'existence d'un grand nombre de
ces portes a I'interieur de chaque quartier revele clairement Ie fait que ces
ruelles et culs-de-sac etaient consideres comme des espaces semi-prives,
collectivement propres.
Le theme des saillantes avancees dans les rues surgit dans I' etude
de I' espace du find.
Les constructions saillantes sur la rue au second etage sont des traits
dominants dans les cites islamiques. Les juristes musulmans ne les ont pas
interdites a condition qu'elles ne nuisent pas et qu'elles ne perturbent pas la
circulation (fig. 35). Ibn al-Rami(82) dit que 'Ies a;jina (pluriel de janna,
balcon s aill ant) , parties du biitiment qui sont emboitees dans les murs et se
projettent dans les rues, ne sont pas interdites.' Malik et Ibn al-Qasim
partagent cette opinion. Ibn al-Qasim(82) dit que 'la limite de la distance
entre Ie janah et Ie sol de la rue est l'espace suffisant pour qu'un cavalier
monte sur Ie plus grand chameau puisse passer confortablement' .
On a interroge Sahnun(lOl) sur Ie droit qu'aurait un individu
possedant deux maisons situees des deux cotes de la rue de construire une
chambre couvrant toute la rue. II a repondu a cette question par
l'affirmative, en metiant cependant comme condition Ie fait que Ia
construction de ladite chambre ne nuise pas au public et qu' elle ne perturbe
pas la circulation.
L' ESPACE URBAIN
(]!rojections permises Ii Nnterieur
<Dewcrves ~---
au fina et qui ne nuissent pas Ii fa circufation
Vewcrues
~ Pina ~erieur
Le concept au 'sa6at' est en
(JJJio ou fina intef'ieur
refation avec Mee ae f'waoe ae ['espace au
Jina aes aewc c6th ae fa rue
Le concept au fina itenau 'f)ertica~ment
L 'eau ae p[uie aoit aecliarger a Nnterieur au Jiria au 6atiment
£e Jina est norma~ment aifini ae 1 41.5 ttl.
...,~---~ .. 1Illl -
Cofonnes et murs 2 Cofonnes CVifferents systemes ae support pour ~ 'Sa6at'
Fig. 35 Elements relatifs aux rues dans la cite islamique. (Par B. Selim Hakim/69).
3.2.1.3. La question de I'intimite :
101
Vu Ia vie famiIiaIe extremement fermee et Ie strict code de conduite
des musulmans, il n'est pas etrange que Ie theme de l'intimite ait attire
L' ESPACE URBAIN 102
l'attention des juristes musulmans. Le fait de pouvoir voir dans une maison
plus que ce que verrait un passant dans la rue est considere comme une
intrusion dans la vie privee de la famille. Ceci ne pourrait etre tolere ni par
les voisins ni par les juristes. Un tel acte nuirait enormement et causerait
beaucoup de prejudices.
Le theme de l'intimite se ref1etait de plusieurs fa90ns sur Ia forme
physique de la cite. Par exemple, la hauteur maximale des batiments dans
toute Ia cite, l'interdiction d' ouvrir des fenetres donnant a Ia rue, Ia
construction des portes des maisons.
- Hauteur maximale des batiments (nombre d'Hages)
L'intrusion dans la VIe privee des voisins etait consideree comme
chose interdite et elle n' etait absolument pas toleree.
Avant tout, Ie point Ie plus eleve de la cite est Ie minaret. Bien que
la fonction de ce dernier fut principalement religieuse, on n'excluait pas Ie
fait de Ie considerer comme un endroit a partir duquelle muezzin, homme
considere pieux, pourrait regarder les maisons environnantes. A ce propos
on a interroge Sahnun(lOI) sur Ie muezzin d'une mosquee qui pouvait, depuis
Ie minaret, regarder a l'interieur des maisons du quartier, et on lui a demande
si les habitants de la region situee a proximite de la mosquee et separes de
cette derniere par un large find ou par une rue pouvaient empecher Ie ,
muezzin de monter au minaret. Sahnun a repondu: 'ils Ie peuvent, si cela
leur est nuisible car Ie prophete a interdit faire du mal a quelqu'un'.
L' ESPACE URBAIN 103
Si ce soup~on n'excluait pas les batiments pieux et religieux, il etait
alors bien clair que les autres seculaires etaient beaucoup plus contr6Ies. Nos
sources incluent de nombreux cas concernant ce sujet, OU la construction de
bMiments eleves est consideree comme une menace d'intrusion dans
l'intimite des voisins. Cette intrusion se manifestait de deux fa~ons: la
hauteur des batiments, l'ouverture de fenetres et l'usage de la terrasse.
On a demande a Ibn al-Qasim(lOl) si on pouvait empecher un
individu d'ouvrir, dans son propre mur, une fenetre a partir de laquelle il
pouvait voir son voisin et donc lui nuire d'une certaine fa~on. II a repondu
en se basant sur un recit de Malik et a dit ce qui suit: 'On n'a pas Ie droit de
creer quelque chose qui puisse nuire au voisin, meme si ce qu'il va faire est a
l'interieur de sa propriete.' Mutarrif et Asbagh vont encore plus loin en ce
qui conceme l'intolerance vis-a-vis du mal qu'on peut faire au voisin, meme
si la source provoquant la nuisance est anterieure a l' objet endommage. On a
en fait interroge Mutarrif (78) sur Ie cas d'un individu ayant ouvert, dans un
Mage superieur de sa maison, une fenetre donnant sur une propriete voisine
OU il n'y avait pas de construction. Le proprietaire de la propriete en
question a porte plainte contre lui en invoquant que ceci lui serait nuisible
quand il construira sa maison. Mutarrif a affirme que' : Le voisin a Ie droit
de s'opposer a ceci, aussi bien avant qu'apres avoir construit sa maison'.
- L'usage de la terrasse
Dne autre chose qUI menace l'intimite des maisons est l'usage de la
terrasse qui donn era a celui qui l'utilisera une vue sur plusieurs maisons. Vu
L' ESPACE URBAIN 104
que la majorite des cites islamiques se trouvent dans une zone climatique
aride, les toits ont des fonctions importantes en ete. lIs sont utilises
generalement pour passer la nuit ou pour dormir, specialement dans les zones
urbaines ou il y a peu d'espaces ouverts. En ce qui conceme cela, deux
elements sont en cause: I' escalier pour monter au toit et Ie toit meme.
Ibn Wahab(82) a dit: 'On perd Ie droit a l'usage de la terrasse si cela
nuit de fa~on quelconque au voisin, comme par exemple Ie fait que l'usage
de ladite terrasse permette de regarder a I'interieur de Ia maison voisine
quand on bouge, on monte ou on descend I' escalier. '
Done, pour pouvoir utiliser Ia terrasse il faut qu' elle soit entouree de
murs qui permettent de proteger les maisons VOlsmes. La meme chose
s'applique a l'usage de I'escalier (fig. 36). La hauteur de ce mur de
protection a ete determinee par les juristes musulmans. Pour Ashab, Ie mur
devrait s'elever jusqu'a une hauteur au-dela de laquelle Ie passant ne puisse
VOIr. Ibn aI-Rami disait que 7 empans etaient un obstacle suffisant a la vue
du passant qui n'avait pas l'intention de regarder (82).
L' ESPACE URBAIN 105
Fig. 36 Tunis: Les toits avec les murs de protection.
Ibn aI-Rami (82) raconte un cas qui a eu lieu a Tunis: Un individu
avait un escalier qui menait a son to it. Aussi bien Ie toit que I' escalier ont ete
proteges par un mur. Le mur est tombe et ceci permettait a n'importe queUe
personne utilisant soit Ie toit soit I' escalier de regarder dans Ia maison du
voisin. Le voisin en question lui a demande qu'il reconstruise Ie mur
protecteur mais l'individu a refuse et Ie voisin a porte plainte contre lui. Le
juge, bien qu'il ne l'ait pas oblige a reconstruire Ie mur, lui a interdit - ams!
qu'a to ute autre personne - de monter au toit sous peine de penalite.
- Placement des portes des maisons
Les malikites ont interdit de placer la porte de la maison face a la porte
du voisin et ceci pour garantir l'intimite. S.ahopn (78) pense 'qu'on do it
placer sa porte a une distance de 1 ou 2 cubitus de la porte d'en face' (fig.
37).
L' ESPACE URBAIN 106
. ....• ,. ' ':J ...... ., ........ -- .. ..
~:~[-... ~~~~ • • • t I .. .. .
. ! • .. • • II .. • .. . . . ! .. .. .. .. •• l1li • .. .. ..
.".: ........ ~: .. . .. .. .. . ~ ................ ..
:! ~ ~ ~ .~ ~ ~. ~ =. :. ~ ~ ~ ~ D .... II ................... .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. ... .. . .. . .. .. .. ...... .. .. .. ..
.. • .. .. • II ...... I 110 ..... _ •
., 10 so =1 s=::.:==:::i. ""' .
Fig. 37 Medina. Plan du quartier al-aghawat mantrant I 'emplacement des partes
des maisans. (131)
Nous pouvons dire que tout ce qui concerne l'intimite semble avoir
affecte substantiellement la variete de la forme urbaine partout dans la cite,
sans cependant se limiter a cela. A travers l' obser.vatipn des quartiers
traditionnels de la Medina, on trouve que les hauteurs des bfitiments sont
toujours similaires (fig. 38), Tous ont deux, trois ou quatre etages, et il est
L' ESPACE URBAIN 107
tres rare de trouver des hauteurs differentes dans Ie meme quartier. Dans les
rares cas OU cela a lieu, on essaie generalement d'eviter les ouvertures qui
pourraient causer un prejudice ou une nuisance quelconque aux voisins.
Les solutions concernant Ie placement des portes dans la rue,
l' ouverture de fenetres, la construction de b§timents et Ie traitement des
terrasses sont differentes pour chacun des cas mentionnes mais les memes
regles et convictions sont prises en consideration.
Fig. 38 Vue du quartier al-aghawat de la Medina montrant la ressemblance dans
la hauteur des bdtiments.
3.2.1.4. Garantie de lumiere et d'air frais
En ce qm concerne Ie fait d' ouvrir des fenetres pour obtenir de la
lumiere et de l'air, les juristes semblent avoir ete tres comprehensifs a condition que les fenetres ne facilitent pas l'intrusion dans les maisons du
vOlsmage. Ibn Wahb et Ashhab(78) ont pennis a un individu cl'ouvrir des
fenetres dans sa maison pour pouvoir profiter de la lumiere solaire et de l'air
frais, et cela meme si les voisins s'y opposaient en alleguant que ces
L' ESPACE URBAIN 108
fenetres pourraient faciliter I'intrusion dans leurs foyers. Les deuxjuristes
ont juge que Ia fenetre serait permise it condition qu'e11e soit suffisamment
haute de fayon qu'un passant ne puisse voir it travers e1Ie. (80) (fig. 39).
. I
£a aetennination ae fa "auteur ae fa femtre d partir ae f'int~rieur
2.50m )f.pro~ J{auteur ttccepta6k a partir tU f'em6rassure - ae fa fenetre
1.6Om Muteur moyenne If'une personne
1. 25m Muteur If'un Cit ou tf'un 06jet
CJJetennination ae la liauteur tIe fa femtre Ii partir tIe f'eJ(#rieur
1.75
calle
p- P.a:e peut etre tIe moins tIe 1.75m si fa (fone ae 'flUe passe au tIessus au niveau ae fa tete a'une petsonne qui se trouw Ii ('interieur
Q]lana fe niveau tIe fa rue et ee{ui tIe f'interieur sont approx:imativerTlmt egaU)(,
7 cu5itus ou plus
(]Jeaucoup tU trafic
fPorte exjstance
-+--.L-t-- (['orte proposee aoit UTe placee p(us en drriire
calle
quantf fe niveilu tIl fa roe' est plus eUroe que eemi ae {'intirieur
moms tfe 7 cu6itus
porte proposee pennise
I Porte exjstance
Fig. 39 Ouverture de fenetres et de portes
L' ESPACE URBAIN 109
3.2.1.5. Ruines et murs ou biitiments menaces d'ecrouIement dans Ia
cite
Concernant la menace d'ecroulement de murs et batiments, ceci
semble etre profondement enracine dans Ie theme de dommages et prejudices
que les juristes musulmans ont traite. Les juristes ne se sont pas centres sur
la securite de la propriete meme, mais plutOt sur la securite de ceux qui y
vivent et des gens qui pourraient passer pres d'elle. lIs se sont aussi attardes
sur les dommages qui pourraient etre causes a la propriete voisine. Ces cas
ont ete etudies par les juristes a deux niveaux: les murs demolis qui ne
peuvent pas etre repares de fa~on appropriee ; et les batiments deteriores qui
causent des dommages nuisibles a la communaute.
Dans Ie premIer cas, Ia preoccupation des juristes ne s' est pas
limitee a la demolition du mur, mais aussi a rechercher si tel
acte pourrait causer une nuisance quelconque a la propriete
voisine et si Ie proprietaire ne serait donc pas force de Ie
reconstnlire.
En ce qui concerne ceIa, MaIik(78) a commente ce qui suit: ' Quand
Ie mur a ete demoli par Ie proprietaire et que celui-ci a assez de ressources
pour Ie reconstruire, il faut alors I' obliger a Ie reconstruire pour ne pas nuire
a son voisin; meme dans Ie cas Oll Ie mur tomberait tout seul. Mais dans Ie
cas 011 Ie proprietaire serait pauvre et n' aurait pas Ies ressources necessaires,
on Ie dispenserait alors de reconstruire Ie mur et Ie voisin devrait
L' Es PACE URBAIN 110
reconstruire un mur dans sa propriete, devant Ie mur demoli, s'il veut se
proteger.'
Sahnun et Ibn al-Majishun(82) pensent, eux, que Ie proprietaire
doit etre oblige de reconstruire son mur dans les deux cas. Ils expliquent cela
en disant que, selon eux, la protection 'est un droit qu'a un voisin sur son
autre voisin au moment de constmire sa maison'.
- En ce qui conceme Ie sujet des btitiments en decadence dont la
demolition sera nuisible a la communaute, les juristes ont oblige
les proprietaires ales reconstruire. Deux cas de la Medina
illustrent ceci. Le premier en 1826 et l' autre en 1829. Dans les
deux cas il etait question de maisons en mine possedees par plus
d'un individu. Les voisins ou les personnes utilisant la propri¢te
voisine ont porte plainte contre les proprietaires. Dans les deux
cas, l'absence de l'un des proprietaires semble avoir ete prise
comme excuse pour empecher d' arriver a un compromis dans la
restauration de la maison. Cependant Ie juge, et apres s' etre
assure du dommage et de la nuisance que pourrait provoquer la
demolition du btitiment en question, a ordonne dans les deux cas
que Ie proprietaire present prenne la responsabilite de
reconstmire Ie btitiment et qu'il fasse par la suite payer a son
associe sa part de depenses(l28).
L' ESPACE URBAIN 111
3.2.2. La Loi de I'Heredite
Dans l'IsIam, Ie proprietaire peut, selon Ia loi et s'ille veut, disposer
d'un tiers de sa propriete pour Ie Ieguer it qui il veut apres sa mort. Pour Ie
reste, il doit suivre les stricts reglements Iegaux en faisant sa distribution.
Le cours de Ia propriete n' est pas lineaire, il est plutot diffus et extensif.
A ce propos et dans Ie cas du monde islamique, la propriete ne s'herite
pas automatiquement d'un individu it un autre. Comme Ie vase sanguin qui
se divise en une infinite de tubes capillaires de formes irregulieres qui
fournissent des aliments it toutes les cellules, Ia propriete se divise aussi
entre tous les successeurs, en une proportion exactement en accord avec sa
position de parente dans I'arbre de famille.
C'est ainsi que la Ioi hereditaire islamique fut l'une des causes de
l'apparition des rues tortueuses et des impasses, sous-produits de la
repartition de la propriete individuelle. Ces sous-produits se developpaient
de fac;on desordonnee, refusant tout genre de systematisation, et cela nous
donne la sensation d'Stre en presence de fils de tubes capillaires minuscules
qui envoient des aliments it chaque cellule(91) (fig. 40).
L' ESPACE URBAIN 112
Fig. 40 Exempfe de fa subdivision irreguliere des terrains dans fa ville de
Tunis. (Par Lezine/99).
Finalement, nous pouvons dire que la loi islamique a constitue une
base commune qui reglait l'environnement physique et l'organisation
spatiale dans toutes les cites islamiques et dans differents endroits. CeUe loi
a joue Ie role principal dans l'apparition des res semblances impressionnantes
dont parle F. Chueca Goitia(41), et cela malgre les differences climatiques et
geographiques.
D'apres l'environnement traditionnel existant, l'application de ces
regles ne semble pas avoir ete pareille pour ce qui est de l'interet prive et
public. Dans les cas 011 l'interet des individus etait en jeu, comme par
exemple l'intrusion dans l'intimite du foyer- que ce soit depuis un bfttiment
eleve ou par l'ouverture d'une porte - les regles etaient toujours obeies.
Dans d'autres cas par contre, Olll'interet public entrait enjeu, il semble que
la 10i ait ete tres flexible. Ceci avait une grande influence sur la forme des
L' ESPACE URBAIN 113
rues, surtout que certaines d'entre elles ont ete envahies ou partiellement
appropriees. De meme, la fermeture complete de certaines ruelles etait chose
courante dans les cites islamiques et ceci aussi a influence la forme de la cite.
Les raisons de cette pratique peuvent etre expliquees a travers Ie
concept meme de Ia Ioi et sa mise a execution. En ce qui conceme son
concept, la loi islamique considere la partie de la rue ou ruelle se trouvant
devant la maison comme etant Ie find de Iadite maison; Ia loi etait assez
flexible concernant l'usage du find, et les opinions divergeaient sur Ia
question de I'invasion des espaces publiques, specialement quand il n'y avait
pas de dommage ou nuisance impliques. En ce qui conceme I'execution de
la Ioi, on peut distinguer deux niveaux: D'une part, les rues et Ies espaces
publiques, et d'autre part, Ies rue lIes et les espaces semi-prives. Pour ce qui
est des nles, l'executeur publique (el Muhtasib) pouvait ne rien faire, vu que
l' execution n' ehtrait pas dans ses pouvoirs. Pour ce qui est des ruelles, les
juges et les muhtasibs ne sont jamais intervenus sans plainte preaIable(I3I).
L' ESPACE URBAIN 114
3.3. LES INSTITUTIONS EN RELATION AVEC
L'ADMINISTRATION MUNICIPALE DE LA CITE
ISLAMIQUE
Les cites islamiques traditionnelles se sont caracterisees,
indubitablement et entre autres choses, par l' existence d'un sens tres fort et
tres developpe d'unite et de cohesion sociale parmi ses habitants.
Mais Ie fait que ce sens de l'unite n'ait pas ete exprime, du point de
vue juridique, en tant qU'autonomie municipale et auto-gouvernement local,
comme ce fut Ie cas dans les cites europeennes de l'antiquite et de l'Europe
medievale, a provo que certains debats echauffes et une bonne dose de
confusionnisme non negligeable dans des cercles determines. C'est ainsi que
certains ecrivains - induits en erreur, soit par leur propre eurocentrisme
aveugle, soit par l'acception sans reserves des modeles et generalisations,
supposes sociologues et libres de valeurs, donnes par Max Weber - ont
affirme que les centres urbains des pays musulmans etaient loin d' etre des
cites dans Ie vrai sens du terme, mais qu'ils etaient a peine des
agglomerations de groupes de personnes et d' individus inconnexes.115).
Et ceCI est Ie plus surprenant, vu que les cites islamiques ont ete des
communautes integrees. C'etait la consequence directe du fait que les
habitants des cites en question etaient, bien sur, pour la plupart des
musulmans qui - guides par leur oulema - ont procede consciemment a edifier leur societe sur la base des valeurs socio-religieuses islamiques. Et
c'est pour cette raison, c'est a dire l'integration sur les bases de l'Islam, que
L' ESPACE URBAIN 115
d'autres formes alternatives d'associations politiques, raciales, territoriales
ou municipales ont ete refusees.
Vu que les cites islamiques s' organisaient sur differentes bases de
l'autonomie municipale et de I'auto gouvernement local, qui etaient des
caracteristiques de leurs correspondants en Europe, il en resultait que les
institutions juri diques et administratives des cites islamiques etaient
egalement soumises - et sans exceptions - au meme ensemble de lois de la
Shari'a, et elles etaient, par consequent, considerees comme des institutions
religieuses.
Dans cette partie de la these, no us allons nous concentrer sur I' etude,
bien que breve, de deux institutions en rapport avec l'administration et Ie
fonctionnement urbain de la cite; Ie cadi et Ie almotacen.
3.3.1. Le Cadi
Le Cadi est un juge nomme par les autorites et qui, avec Ie pouvoir de
la jurispnldence, agissait entre les plaideurs en examinant attentivement et
avec une impartialite absolue l' objet du litige, et en evaluant les preuves
presentees pour rendre finalement sa sentence(115). Ses responsabilites
incluaient :
resoudre les questions personnelles (comme par exemple les disputes
matrimoniales ou les discussions concernant les heritages) et les questions
d' ordre civil qui impliquaient, par exemple, l'inaccomplissement d'un
L' ESPACE URBAIN 116
contrat, I' administration des biens des personnes mentalement incapacites,
des orphelins, de ceux qui declaraient faillite et des insoIvabIes qui etaient
sous sa garde ; son role impliquait aussi la supervision de l' accomplissement
des demieres volontes et des dons; II s' occupait aussi de gerer Ie mariage
des jeunes qui n'avaient pas de tuteurs pour en prendre la charge,(83).
'Le Cadi doit controler tout ce qui se passe dans Ie quartier, arreter
toute usurpation des rues et des endroits publics, eli miner les projections
nuisibles et les elements eleves qui menacent I'intimite du quartier ... ,(ll).
Le Cadi pouvait aussi se responsabiliser du controle des fondations
pieuses (awqaf, singulier: waq{) considerees comme une institution typique
de la cite islamique et en meme temps tres importante dans son organisation.
Le waqf se plie a trois normes de base : a) il est determine par Ie
souhait du donneur, selon exprime dans I'acte de constitution,
etablissant I 'usage perpetuel de la propriete immobiliere ; b) il n' est soumis a
aucune formalite et peut etre constitue a travers une simple declaration
verbale a condition que Ie donneur soit un croyant responsable ; c) une fois
constituee la propriete est inalienable et invioIable(11).
De cette fa90n Ie waqf produit I' effet de ceder une possession a la
propriete divine, alors qu'il en laisse la jouissance a ses creatures. La
propriete assignee au waqf peut etre de plusieurs genres et aussi bien
mobiliere qu'immobiliere. D'apres une statistique faite au Maroc, Ie
L' ESPACE URBAIN 117
patrimoine du waqf- qui atteint les 40.000 proprietes - est fonne de maisons,
magasins, moulins, fours, bains, champs de culture, jardins, etc.clll).
L'institution du waqf urbain a rendu d'inestimables services a la cite
islamique. L'administration des biens-fonds (awqaf) a proportionne, durant
des siec1es, un capital circulant ou d'exploitation et il n'est pas rare que la
construction de mosquees, d'universites, de sanctuaires, d'h6pitaux et de
cimetieres aient ete finances par eux. Ils ont aussi servi a financer la
construction des defenses des cites, de leurs conduits d' eau, de leurs reseaux
d' egouts, de l'illumination des rues, etc. (127).
C'est grace a l'institution du waqfque la cite d'Alep et la zone sud-est
du Caire ont connu un grand developpement au XVle S,027).
3.3.2. Le Almotacen (EI Muhtasib)
On admet generalement que la base theorique et ideologique de cette
institution est Ie devoir qui incombe a tous les musulmans de promouvoir Ie
bien et de combattre Ie mal, c'est-a-dire, la pratique de 'al amr bi-l- rna 'ruf
wa-l-nahu 'ani-l-munkar' (,Faire ce qui convient et refuser l'indesirable').
Generalement parlant, la fonction du muhtasib, qui dependait du juge
ou cadi, consistait a promouvoir l'application des valeurs ethiques islamiques
dans la vie quotidienne des societes musulmanes, specialement en ce qui
concernait les transactions commerciales et sociales qui se faisaient dans Ie
I .
L' ESPACE URBAIN 118
marche. C'est pour cela que dans beaucoup de cas cette institution fut
connue sous Ie nom de sahib al-suq (litteralement, 'seigneur du souk'i115).
Dans sa forme c1assique et pleinement developpee l'institution du
muhtasib etait un poste municipal important incluant un ensemble delimite et
communement accepte de fonctions diversifiees. Ces fonctions incluaient,
entre autres, l'inspection des poids et mesures - pour essayer d'empecher les
transactions frauduleuses et les pratiques deloyales dans Ie souk; Ie
muhtasib agissait comme un arbitre dans les disputes qui pouvaient avoir
lieu, par exemple entre patrons et employes; une autre fonction etait
d' ordonner la demolition et la reconstruction des btitiments qui mena9aient
ruine ainsi que de ceux qui permettaient a leurs habitants de s'immiscer dans
l'intimite de leurs voisins, de fa90n it ce que les btitiments en question ne
soient plus source de danger ou de derangement pour Ies voisins. Le
muhtasib se devait aussi de verifier la prop rete des bains publics et du
comportement des baigneurs qui devait etre en accord avec les canons de la
decence; il devait s' assurer que les mosquees etaient nettoyees, pourvues de
Ia quantite d'eau adequate et illuminees de fa90n appropriee durant Ia nuit,
etc.(83).
A cause de Ia variete et la multiplicite de ses fonctions Ie muhtasib
avait besoin, logiquement, de I'aide d'un groupe d'assistants et
collaborateurs entre lesque1s il y avait Ies 'arift ou amins (chefs ou
dirigeants) appartenant aux differentes corporations et confreries de Ia
Gmetropole. II etait en plus aide par Ies 'arifs des quartiers (harat) de la cite,
et bien Sllr par Ia shurta (la police) et par Ie cadi avec lequel il planifiait Ie
travaiI(l15) .
L' Es PACE URBAIN 119
Vu la nature de ses responsabilites on attendait evidemment du
muhtasib qu'il soit une personne de caractere affable mais pourvu d'autorite
et qu'il ait, au moins, une connaissance pratique des lois de la Shari 'a. (115).
L' ESPACE URBAIN 120
3.4. ESP ACE URBAIN
Nous avons vu auparavant comment les regles ou les normes qm
formaient l'organisation de l'espace urbain dans la cite isiamique etaient
systematiquement reliees a la culture, a l'ensemble de valeurs et de lois, aux
croyances et aux points de vue concernant Ie monde en general, ainsi qu'au
style de vie que partagent les musulmans qui habitent ces cites-lao
En nous basant sur cela, nous allons analyser I' espace urbain, son
organisation, son concept, ses caracteristiques et ses fonctions symboliques.
2.4.1. Organisation de I'espace urbain
L'une des caracteristiques qui attirent Ie plus l'attention dans la cite
islamique est la grande differentiation et separation entre les deux domaines :
prive et publique. Le centre des activites et la vie familiale sont clairement
differencies en termes spatiaux. Le premier est la sphere de l'homme et Ie
second celui de la femme(88).
Cette conception d'un espace clairement divise, cite publique vis-a vis
de cite privee, se reflete facilement dans les plans de la cite a travers Ie genre
du reseau deso rues existant dans Ie noyau de la cite - al medina - et dans les
quartiers residentiels.
/'
L' ESPACE URBAIN 121
Dne autre caracteristique importante dans l' organisation de Ia cite
islamique est son organisation qui va de l'interieur vers I'exterieur (de Ia
maison vers Ia rue, en d'autres termes), alors que dans Ia cite occidentale
c'est Ie contraire: de la rue, prealablement tracee - avec ou sans plan -les
maisons ont commence a occuper leurs espaces respectifs et a se plier a la loi
distributive de la rue. Dans la cite musulmane, c'est la maison qui a eu la
priorite et qui a oblige la rue as' accommoder entre les trous que laissaient
les maisons. C'est pour cela que les rues sont tortueuses, labyrinthiques et
invraisemblables(41).
2.4.2. Concept de l'espace urbain
Bien que Ie style puisse changer d'une cite a une autre et d'une epoque
a une autre, chaque cite musulmane est formee par les memes genres
d'espaces internes fermes et d'espaces publiques ouverts; ces espaces se
repetent et s'organisent selon des principes analogues. La cite, quant a elle,
forme en soi un espace ferme qui se reproduit grace a d'autres espaces
semblables, separes les uns des autres mais entre lesquels s'est etabli tout un
systeme de relations.
2.4.2.1. L' espace Ferme
Selon Ernest Egli (48), les elements structuraux qui forment la cite
sont: la maison, la rue, la place, les batiments publiques et les limites qui
definissent la cite en question a I' interieur de son emplacement spatial. Dans
L' ESPACE URBAIN 122
une cite, tous ces elements obeissent a de profonds besoins de la
communaute, a des circonstances dues a l' environnement physique, au climat
et au paysage. Tous ces elements (maison, rue, place, monuments, limites)
obeissent a une conception unitaire, et c'est pour cela qu'on ne peut pas
trouver une rue musulmane abritant des maisons gothiques, ni une cathedrale
pres d'une agora classique, ni aucune autre combinaison d' elements
heterogenes. Chaque structure urbaine est essentiellement unitaire.
Ernest Egli dit que l'idee fondamentale d'une cite est impliquee
dans l'idee de la maison individuelle de la cite en question.
observation assez pertinente qui se manifeste, bien sur,
clairvoyante dans la cite musulmane.
C'est une
de fa~on
Le patio de la maison represente l'espace reel et veritable de la
culture de 1 'Islam. Cet espace est a la fois interne, intime et ferme sur soi et
en meme temps ouvert verticalement en plein air. eet espace se repete dans
les autres batiments, dans la mosquee, dans Ie souk, dans Ie funduq, etc.
Le patio n'est pas une idee originale des arabes, elle a ete prise du
monde hellenistique pour etre par la suite transformee et adaptee a leurs
exigences vitales. Beaucoup de facteurs ont contribue a ce que les
musulmans adoptent ceUe idee comme element d'organisation dans tous les
espaces fermes.
L' ESPACE URBAIN 123
- Facteurs socio-religieux
- L'intimite: Le style de la maison avec patio correspond au
souhait traditionne1 qu'a Ie musulman de proteger l'intimite de
sa vie familiale. Le patio est Ie seul espace ouvert OU la femme
peut bouger librement sans etre vue; et Ie musulman peut
decorer ou exhiber sa fortune a travers les belles fa9ades de Ia
maison donnant sur Ie patio.
- Calme et independance: Comme nous Ie savons, les cites
islamiques se sont caracterisees par la grande densite de
logements et de population qui etaient Ia consequence directe
des besoins defensifs et des conditions climatologiques : la cite
devait avoir la plus petite circonference possible pour ameIiorer
les capacites de defense(88); et les batiments etaient relies par
les memes murs pour se proteger des rayons de solei!. C'est
pourquoi I' adoption du style du patio etait tres effectif et a
permis au musulman de fuir Ie bruit et de jouir du calme.
Facteur spirituel: Vne autre explication plus profonde est
la suivante: l'espace ferme sur soi et ouvert au ciel repond dans
ses articulations aux symboles unificateurs de l'Islam. Dominee
par les minarets qui renvoient en echo l'invocation d'un seul
Dieu, la maison fermee sur el1e-meme constitue une unite qui ne
cesse de se reproduire dans chaque maison juxtaposee a une
autre(39).
L' ESPACE URBAIN 124
- Facteurs c1imatologiques
En plus de l' effet spirituel, Ie facteur climatologique a contribue de
fa~on decisive a l' apparition du patio, et cela meme dans les espaces
publiques de la cite.
Presque tous les pays arabes se trouvent dans une region qUI
s'etend depuis Ie Golf perse jusqu'a l'ocean Atlantique, qui est - pour la
plupart - une region desertique a c1imat sec et chaud. La grande chaleur du
desert, les rayons du soleil et les tourmentes de sable ont eu une grande
influence sur Ie fait que la maison musulmane n'ait pas d'ouverture vers
l' exterieur au niveau de la terre mais plutOt que cette ouverture - la soit en
direction du ciel, seul facteur naturel du desert qui promet clemence et repos.
C'est ainsi que la maison s'ouvre vers Ie ciel par l'intermediaire d'un patio
interne dont Ie role sera thermoregulateur: I'air froid qui circule la nuit
s'introduit dans les differentes salles, a travers Ie patio interne, pour
rafraichir I'air et I 'atmosphere jusqu'a des heures avancees de lajournee(55).
3.4.2.2. Espaces Publiques Ouverts: Les Rues
Dans la cite islamique Ie reseau des rues montrait Ie concept
qu'avaient les habitants de la cite concernant la vie urbaine, concept qui est
completement different de celui qu' ont les occidentaux.
."
L' ESPACE URBAIN 125
Dans la cite islamique il y avait deux genres principaux de rues qui
etaient en relation avec la fonction qu'elles avaient et avec Ia zone concrete
du noyau urbaine OU elles se trouvaient: Ia medina ou Ies quartiers
residentiels.
Le premIer genre de rue, constitue par la grande mosquee qui se
trouvait au centre de Ia cite, - qui n' etait pas necessairement Ie centre
geographique - par Ie marche situe autour de la mosquee et par Ies autres
bfttiments publics. La rue est dans ce cas con<;ue et disposee comme un
espace de communication agite, bruyant et a plusieurs facettes: I' action et la
devotion devaient etre convenablement combinees. De meme, Ies rues sont
relativement regulieres, Iarges, ouvertes, s'etendant, mais sans cependant
enfreindre les limites de la cite. Dans Ie second genre, Ia rue est formee des
quartiers residentiels et les rues etaient dans ce cas-Ia con<;ues strictement
pour la circulation et non pas pour s'y arreter; I, elles constitmiient des
~ ~spaces d'attente et non pas d'installation (1,27) ; c'est pour cela que Ie reseau
des rues a change pour se transformer en une structure complexe
Iabyrinthique irreguliere et tortueuse dont Ie but est de donner aux etrangers
I'impression qu'ils ne peuvent pas passer librement a travers elles (15) (Fig.
41).
- Concept de la Rue
La cite islamique se caracterise par I'enorme quantite d'impasses ou • •
culs-de-sac qui existent en elle. (Fig. 42). Bien que toutes Ies cites des
atItres civilisations aient eu ce genre de rues, Ie pourcentage de ces impasses
vis-a-vis des autres rues etait tres bas compare a celui de la cite islamique ;
L' ESPACE URBAIN 126
c' est pour cela que ce genre de rues ( culs-de-sac) est devenu une
caracteristique distinctive de la cite islamique(89).
"\ ',;' ';..J .\
__ , ..... ..w ... """ __ ,_._ .... toIII.,.. ........ ItIIo4".atofto<Hk
Fig. 41 Les genres de rues dans la ville de Tuni/69).
Les impasses ou 'culs-de-sac' semblent etre la negation de la rue, de sa
valeur structurale dans la formation de la cite. La rue formatrice est celle qui
conduit d'un cote a un autre tout en etant une piece essentielle dans cet
espaee public qu'elle conditionne. Le 'cul-de-sac' n'a pas de sortie, n'a pas
de suite, il ne presente aucun interet public general mais uniquement un
interet prive, eelui de l'ensemble des maisons qu'il penetre pour leur donner
une entree. C' est done une rue privee qui se fermait durant la nuit pour isoler
et proteger une petite communaute de voisins(42).
L' ESPACE URBAIN 128
. Y:~t(:... • I r~ .. .. _.- .-~~/. ~ . ,- . ~- ~. r_ i'l'~ -. ;.,.,- . ',- -. -. ,
.-: I -' • ".
'- .'
Fig. 42 Cordone: l'impasse(l38).
L' ESPACE URBAIN 129
Bien qu'il existe aussi dans les cites musulmanes une rue de transit qui
mene d'un endroit a un autre et qui est inevitable pour Ie fonctionnement de
Ia cite, ces rues sont conditionnees de manieres differentes selon leur fa~on
particuliere de comprendre la cite. Dne rue occidentale est toujours continue
et peut etre comparee a une ligne droite. Dans une rue musulmane, par
contre, et bien que cette rue soit une artere de trafic, cette continuite est
continuellement brisee par un coude ou un ecart qui brise la perspective.
Beaucoup de theories ont ete elaborees pour essayer d' expliquer et de
comprendre les facteurs qui ont donne naissance a ce genre de cite et a ce
genre de rues.
Quand Torres Balbas(138) parle du concept islamique de Ia cite, il
justifie I' etrange et tortueux trace en evoquant des raisons defensives; en
fait, a part Ies murailles qui enfermaient les arables et qui parfois divisaient
Ies quartiers pour obtenir une meilleure securite, les impasses elles-memes
etaient un autre element defensif du fait qu' elles pouvaient etre fermees en
cas de revolution interne. De plus, ces rues tellement etroites etaient faites
pour circuler et non pas pour bavarder ou pour s'asseoir.
Chueca Goitia(41) pense que Ie concept islamique de la rue reside dans
Ie fait que cette derniere n'est pas l'element ou Ie principe qui preside Ia
constitution organique de la cite, comme c'est Ie cas dans la cite occidentale.
Au debut il y eut Ia rue, et avant Ia rue il y eut Ie chemin et c'est a partir de Ia
rue que se forme Ia cite. Les maisons s'alignent tout au long de la rue
chemin et ainsi la cite se forme petit a petit. C' est pour cela que Ia cite
musulmane n'a pas de rues dans Ie sens occidental du mot, des rues qui sont
L' ESPACE URBAIN 130
les pnnClpes directeurs du trace urbain. Dans la cite musulmane, ce qui
preside est la propriete privee, l'intangible et inviolable propriete privee. En
regardant Ie plan d'une cite musulmane, on per~oit directement qu'il s'agit
d'une repartition emmelee de proprietes individuelles dont Ie contour
irregulier ne peut avoir comme origine que des titres de propriet6 acquis sans
penser a aucune ordonnance urbaine.
La rue n'est donc pas primordiale mais secondaire, c'est Ie sous
produit de la repartition de la propriete, c'est la limite qui separe une
propriete d'une autre.
L'existence de ce genre de rues s'explique a travers deux autres
facteurs: Ie facteur climatoIogique et Ie facteur psychoIogique.
Le climat atmospherique a influence non seulement la constnlction
de la maison, mais aussi Ie dessin des rues. C'est ainsi qu'est nee l'idee de
la rue etroite et fermee ayant la meme fonction thermoregulatrice que Ie
patio de la maison. Dans la rue longue et ouverte, il n'y a pas d'ombre et Ie
phenomene d'emmagasinage de l'air froid de la nuit - qui se chauffe de
fa~on directe et croissante durant Ie jour - manque aussi(55).
Le facteur psychoIogique est aussi important. Le musulman n' aime
pas l'alignement indefini d'une perspective continue, parce qu'il considere
qU'elle detruit toute intimite. C'est donc a travers ces rues brisees, OU il n'y
a aucun alignement droit et aucun parcours continu, que Ie musulman peut ,
atteindre ce sentiment d'intimite meme dans l'espace Ie moins privatise, Ie
plus public(41). De plus, dans la rue longue, droite et ouverte, il n'y a pas de
L' ESPACE URBAIN 131
bomes et d'attractions comme celles qu'on trouve abondamment dans la rue
etroite, tortueuse et fermee. Ceci facilite la fatigue et l'epuisement du
passant qui s'imagine, des qu'il commence a marcher, que Ie but ne peut
etre atteint(55) (figs. 43,44)
Fig. 43 Le minaret de la mosqw?e 'Zaitouna' a la fin d 'une rue principa/e
de la medina de Tunis (photo: Carl Broun/28).
~.
L' ESPACE URBAIN
, t(.
"io \ _
r"""" r·
,: ~ .... ' .. ";:;,.--lh
, . r . .. . I ; ... . 1
'. ;1; . l! ,:':~ , ..... . , .. .
~ ~ 7
'. i ': t r
I
, .
Fig. 44 Le Caire : deux rues principales
Photo J : Rue principale dans Ie Caire (par D. Roberts).
Photo 2: Rue commerciale dans Ie Caire (par David Roberts).
132
L' ESPACE URBAIN 133
3.4.3. Espaces U rbains et leurs fonctions sym boliques dans la cite
islamique
3.4.3.1. Espaces Religieux et Culturels
Depuis les ongmes de l'Islam la mosquee occupait deja une place
centrale dans l'urbanisme musulman. C'est elle qui a genere, a cause de la
specialisation de ses fonctions, beaucoup d'autres biitiments et endroits
religieux aussi bien a l'interieur qu'a l'exterieur de la cite.
La mosquee majeure etait Ie veritable cceur de la cite, l'eIement de
base dans I' organisation spatiale et son centre authentique OU battait
veritablement Ie pouls de la cite. II ne serait jamais assez d'insister sur
l'importance qu'a Ia mosquee majeure dans une cite musulmane ayant une
certaine extension. Ce n' etait pas uniquement Ie lieu de reunion des fideles
pour la priere du vendredi, mais aussi Ie lieu OU gravitait toute la vie
religieuse, intellectuelle et meme politi que de la cite. Affirmer que la
mosquee dans la cite musulmane a un role tres similaire a celui de I' agora ou
du forum dans une cite grecque ou romaine(97) n'est nul1ement une
exageration. Le souveram musulman etant a la fois Ie chef religieux et
politique, Ia mosquee devait remplir ce double role. Dans les premieres cites
musulmanes, a Medina, a Damas, a Bassora, a Kiifa, a Fustat, la mosquee
occupait un endroit dominant et central dans la cite; Generalement, et quand
Ie plan de la cite Ie permettait, el1e se trouvait au croisement de deux rues
principales (ce fut Ie cas de Tunis) alors que la demeure du gouverneur se
L' ESPACE URBAIN 134
trouve dans ses environs immediats (Ie Caire, Damas). D'autre part, Ie
souverain etait - du moins idealement - Ie directeur de Ia priere commune et
Ie predicateur des fideIes. Pour cela, c'est en principe a partir de Ia chaire (el
minbar) qu'il parlait a ses sujets.
La mosquee qm inclut un patio avec fontaine pour les ablutions et
une salle de nefs avec colonnes et arcades est Ie genre de mosquee
predominant dans Ie monde islamique. C'est aussi Ie genre de mosquee qui
se prop age Ie plus, specialement dans Ie Nord de I' Afrique et dans Ia zone de
la Mediterranee europeenne - surtout la region de al Andalus - regions qui
ont ete dominees par l'Islam, (figs. 45,46). D'autres elements aussi
fondamentaux sont: Ie minaret, a partir duquelle muezzin convoquera a Ia
priere, Ie mur de la qibla qui indique Ia direction de Ia priere et OU se trouve
Ie mihrab, qui est - peut etre - Ie point Ie plus symbolique dans tout
I'ensemble.
L' ESPACE URBAIN 135
,
~ e>«J I ~
0 "<. C><l , " I
D D. • I ... • ~ " "" /~
. ~ .. " '- .
~" " " S 1
0 10 WI
I. J("r. 1. Dlimhcui ~ l , Mltd"". I . /l1.!>PO 5, Hm>o 6 ,tMlulcm , "'""dol.>
Fig. 45 DifJerents exemples de grandes mosquees montrent Ie meme style dans Ie
dessin et dans f 'orientation de fa qibfa (par Bianca et Sauvaget).
L' ESPACE URBAIN 137
La mosquee n'a pas de fac;ade particuliere qui la differencie, sauf la
porte d'entree. Pour cela, elle ne peut etre reconnue it l'interieur du marche.
Les signes qui permettent de l'identifier sont: Ie minaret et Ie dome. Le
minaret etait I' element Ie plus eleve de la cite qui marque Ie profil de la scene
urbaine de la cite islamique traditionnelle(85).
En plus de la mosquee majeure, il y avait d'autres mosquees
differentes de par leur grandeur et leur emplacement: Mosquees du quartier,
de confreries, de palaces et de fermes, de maisons particuliereS(51).
Depuis Ie haut de cette mosquee on pne, mais aussi on lit les
communications officielles it la population, on fait part des resultats des
expeditions militaires, on notifie les investitures, on communique les avis
relatifs aux questions fiscales, on resout les litiges politiques et juridiques. II
est a noter cependant que les fonctions juridiques peuvent etre releguees a d' autres dependances urbaines voisines (palais royal, maison du juge,
etc.i96).
La mosquee est aussi I' endroit OU I' on enseigne, soit dans la meme
salle it colonne destinee it la priere, soit dans les porches du patio adjoint.
Mais la mosquee n'est pas Ie seul endroit OU l'on enseigne, vu qu'iI y a aussi
dans des bfttiments speciaux OU a lieu I' enseignement primaire des enfants.
eet enseignement peut aussi avoir lieu dans leurs propres quartiers,
.quoiqu'en general, c'est presque toujours pres d'une mosquee. Dans les
premieres annees du Moyen Age des centres speciaux d' enseignement, avec
residences pour etudiants, ont ete crees (les madarisi51).
L' ESPACE URBAIN 138
Le Hammam: Bain Public
Le bain public (hammam) a une relation religieuse avec la
mosquee. C'est en effet l'endroit OU se fait la purification majeure de
l'ablution ou proprete de tout Ie corps. Generalement il est physiquement
separe de la mosquee et se trouve plus proche des quartiers residentiels (fig.
47).
Fig. 47 Bain Public a Damas. Xli! S. Hammam de 'Os ama ' (par SauvagetjJ33).
1. Salle destinee a se devetir (apodyterium) 2. Latrines 3-4. Salles tiMes (tepidariums)
5-6. Salles chaudes (caldarium) 7. Etuve (sudatorium) 8. Depot de Vapeur 9. Chaudiere.
L' ESPACE URBAIN 139
En plus de cela, Ie hammam a ete I 'un des importants b§timents
sociaux de la cite. Les contacts sociaux entre les voisins d'un meme quartier
se faisaient autour du hammam. Pour les hommes c'etait l'endroit informel
des discussions de travail, et pour les femmes c'etait une occasion de
bavarder et d'echanger leurs idees sur les travaux menagers (87). C'etait un
endroit pour la recreation et Ie repos.
La Musalla
Depuis les premiers temps de l'Islam, c'etait coutume de destiner un
endroit comme oratoire en plein air; cet oratoire devait etre situe sur une
plaine libre et degagee, dans un champ ras et en dehors mais immediatement
a cote de I'enceinte muree des citeS(138). A certaines dates precises,
specialement les deux fetes canoniques annuelles, Ie peuple se regroupait
dans cet oratoire - appeIe musalla - avant Ie lever du solei! pour la priere
(salat) commune. Aussi grande que fut la mosquee majeure, elle ne l'etait
pas assez pour contenir les grandes foules et ceci explique la creation de la
musalla. Pour ces prieres en plein air on avait besoin, en plus des conditions
topographiques et de la largeur mentionnees, un mihrab ou niche provisoire
ou permanente, qui etait parfois ouvert dans un mur, pour fixer la direction
vers laquelle devaient se diriger les prieres.
L' ESPACE URBAIN 140
Les Cimetieres
La premiere chose que pouvait voir un voyageur en arrivant aux
environs d'un regroupement urbain islamique etait la cite des morts. En fait,
les cimetieres musulmans s' etendaient, en dehors des mUTS et sans aucun
type de cloture, sur les cotes des chemins qui conduisaient aux portes
principales de la cl6ture(138). Le cimetiere est un espace ouvert vers l'au-del<l
et ou les tombes, tout comme les mosquees et la musalla, agissent
liturgiquement et expriment - en termes architecturaux - I' axe horizontal.
Les corps sont enterres en position horizontale formant un angle droit avec la
qibla, de fa~on qu'ils puissent avoir la face a la Mecque s'ils se mettaient de
cote. Ainsi, Ie croyant jouit de la meme relation materielle avec la qibla
aut ant durant sa vie qu' apres sa mort.
Le jardin funeraire est l'un des symboles les plus profonds et
satisfaisants de l'Islam. C'est en fait Ie jardin paradisiaque qui n'est autre
chose que ce jardin primordial que I'Homme a perdu par Ie peche. Le gazon,
les £leurs et les arbres sont inseparables dans Ie culte que les musulmans
portent aux morts(138).
3.4.3.2. Espaces Economiques et Commerciaux
Chaque cite islamique traditionnelle avait son propre marche et la
plus grande cite etait celle qui avait Ie marche Ie plus grand. Les grandes f a tOO
cites comme Le Caire, Damas, Cordoue, Tunis approvisionnaientiseulement ".----.--.--
leurs propres populations mais aussi tout leur entourage. Leurs marches
fonctionnaient comme des centres commerciaux regionaux. Le
L' ESPACE URBAIN 141
developpement du commerce a provo que l'apparition - dans la meme cite
d'autres marches de differentes grandeurs et dans des emplacements
differents(85) .
Du point de vue spatial, il y a de tres grands noyaux commerciaux
dans la cite: la zone centrale pres de Ia mosquee et du palais ; la zone des
acces ou portes de la population; et la zone des gran des voies de
communication entre Ie centre et les aCCeS(51).
Dans la zone centrale nous pouvons trouver :
Les souks specialises
Les souks de produits imperissables sont situes dans les zones
centrales, et ils sont specialises selon leur production. Le so uk etait toujours
situe a cote ou tres proche de la mosquee majeure et il obeit a sa loi
d'organisation; d'abord il y ales librairies (a cause de l'importance de 'la
recherche du savoir' dans Ie Coran), puis vient Ie suq al atarin ou marche du
parfum (les paroles du prophete concernant I'importance du parfum), ensuite
vient Ie marche des tissus, des aliments, etc.(17). Le marche etait
generalement forme d'un dedale de ruelles qui se developpaient autour de la
mosquee majeure et dans lesquelles les artisans ou commeryants se
regroupaient par offices.
L'union des souks avec la mosquee exerce une attraction
extraordinaire et tres puissante, de fayon que la plus grande partie de la
L' ESPACE URBAIN 142
circulation passe par les rues qui, it partir de ce noyau urbain, conduisent aux
portes de la cite.
Dans les cites d' origine pre-islamique, les activites commerciales
occupaient les memes places commerciales qu'elles avaient it l'epoque
romaine, et ceci durant les premieres epoques de I'Islam. Graduellement,
cependant, la grande rue commerciale it colonnades s' est spontanement
transformee en souks tortueux OU les magasins ont occupe les arcades et OU
les postes commerciaux ont envahi la chaussee (Ie cas de Damas i 132) (fig.
48).
Fig. 48 DAMAS. Transformation de la Rue Romaine commerciale en un so uk
islamique (par Sauvaget/132).
Au fur et it mesure que les cites islamiques se developpaient, de
nouveaux elements architecturaux commerciaux sont apparUS pres ou it
l'interieur des souks existants; ces nouveaux elements sont les quartiers OU
l' on vendait la soie et les halles de differents genres (junduqs, khans au
wekalas)
L' ESPACE URBAIN 143
Les quartiers de vente de la soie ou Alcaicerias
Ce sont les ensembles urbanistiques, commerCIaUX et artisanaux
formes par Ie pouvoir politique qui les louait tres cher et sous un regime de
monopole de la production et des ventes. Ils formaient des quartiers propres
a }'interieur du quartier commercial OU l'usage reticulaire de l'espace est a
son maximum dans Ie centre de la cite. Ces monopoles peuvent etre formes
de bijoux et d'objets precieux, de vetements de luxe, de soie, etc. lIs se
trouvent generalement a proximite de l'a1cazar ou centre du pouvoir(51).
Les Alhondigas
Ce sont des batiments speciaux ayant une specialisation dans un
commerce que nous pournons qualifier de 'commerce en gros'. II y avait
deux genres de batiments: ceux qui servaient comme auberges aux
voyageurs qui venaient de loin, et ces batiments-Ia se trouvaient pres des
portes de la cite et etaient frequentes par les ruraux et les commer9ants
agricoles; on les appelaitfunduqs. Dans cesfunduqs les voyageurs et leurs
betes de somme trouvaient hebergement et ils pouvaient y deposer leurs
marchandises. L'autre genre de batiments etait ceux qui existaient dans la
Medina et qu'on appelait Khans ou wekalas; ceux-Ia sont plus soignes et
destines aux commer9ants des produits de haute qualite (parfumerie, tissus, ...
etc.Y87) (figs. 49,50,51).
Les khans de la cite etaient normalemeDnt regroupes dans les
environs du marche de graines (suq al qamih) qui recevait sa marchandise de
regions plus ou mains eIoignees(97).
L' ESPACE URBAIN 144
Morphologiquement ils ont normalement un ample patio central
avec des piliers et un etage superieur avec balustrade.
Fig.49 Wekala de DiJJiigiIr Kathude dans Le Caire (par P. Costef]27). o
L' ESPACE URBAIN 145
Jim eJ - [fark en Damasco (por J. Sauvaget).
Fig. 50 Deux exemples de khans a Damas:
- Photo J : Khan Asad Pacha a Damas (par A. Rih 8Wl/27) .
- Photo 2 : Khan el-Harir a Damas (par J Sauvaget/133).
L' ESPACE URBAIN 146
Fig. 51 Le grand khan Qiins ilh a1 Gilri au Caire (Siecle)
Les deux etages inferieurs etaient utilises comme depot. Les superieurs etaient des
appartements disposes en unites verticales et avec des escaliers interieurs individuels(J10).
L' ESPACE URBAIN 147
- Dans la zone des acces ou portes de la cite:
Le petit marche (suwaiqa)
Nous avons deja parle de l'espace ouvert (maydan), de la porte des
cites et des ports OU se trouvait Ie petit marche qui se caracterisait par la
predominance de l'echange entre la cite et Ie village et dont les fonctions se
repetent de nos jours dans beaucoup de cites et villages. Ce petit marche
peut avoir des jours fixes par semaine ou bien il peut etre monte et demonte
quotidiennement(Sl). Ces espaces peuvent aussi avoir d'autres fonctions
(comme par exemple des activites ludiques dans des defiles, des fetes et des
divertissements), mais ils restent completement vides durant les nuits.
Le marche du quartier
On a aussi parle du marche du quartier, qui se trouve generalement
dans un coin des acces aux maisons. S'il y a confluence de quartiers il peut y
avoir plusieurs marches(Sl).
3.4.3.3. Espaces Politico-Militaires: Citadelle, Alacazars, Chateau et
Portes
La fonction militaire ou de contr61e politico-fiscale inc1ut - de
fa~on directe ou indirecte - tous les espaces urbains, periurbains et
interurbains, mais elle se concentre particulierement dans Ie contr6le des
L' ESPACE URBAIN 148
enceintes urbaines et ses acces ainsi que dans les sieges des principaux
agents du pOUVOlr: les citadelles ou forteresses des gouverneurs
provmClaux, les palais ou alcazars des souverains, les murailles et les portes,
les tours de vigilance, etc.
La citadelle a, dans ses diverses formes, une structure fortement
individuelle, une sorte d'organe bizarre greffe dans Ie corps urbain. Elle a
une enceinte pro pre avec une cUlture particulierement renforcee - a cause de
sa position et des ses constructions - et elle a aussi des acces propres a elle,
que ce soit vers la cite civile ou vers l'entourage. Cet espace doit pouvoir
contenir une garde militaire plus ou moins nombreuse. II doit avoir
pratiquement tous les services qu'a un quartier ou un faubourg civil
(mosquee, fours, bains, marches ... ), surtout s'il se trouve dans les grandes
cites. La citadelle est formee de nombreuses chambres adossees articulees
avec des salles de reception et de 'travail administratif (51).
L'alcazar du pouvoir politique peut etre situe dans Ie centre de la
medina civile (Le Caire, Damas). Cependant, s'il est situe a I'interieur d'une
enceinte muree qui Ie separe de la medina, sa valeur strategique en sera
renforcee. II peut aussi etre partiellement entoure d'un fleuve (Cordoue). II
peut se trouver sur un point eleve, et donc physiquement separe de la medina,
quand il possede assez d'eau (Grenade) ou alors il peut avoir un doublet
politico-militaire ou Ie pouvoir politi que reside pres de Ia medina et Ia
forteresse militaire en altitude (Tunis). II se peut aussi qu'il y ait un transfert
permavent du siege du pouvoir politique des alcazars urbain~ vers une ferme
externe qui sera transfonnee en citadelle autonome; de meme, Ie pouvoir
politique peut etre renforce militairement de fas:on progressive(51). (C'est Ie
L' ESPACE URBAIN 149
cas 'de Tunis quand, en 1770, la residence du gouvemement a ete transferee
de la qasaba a la region situee en dehors du mur de separation, loin de la
Medina).
Les murailIes, en plus de leur condition defensive eminente et de
leur role de configuration, ont eu une grande importance dans la vie de la
cite, surtout a travers les portes qui ont un effet extraordinaire. La porte est
comme une chamiere entre I' espace exterieur et I' espace interieur de la
Le nombre de portes de la cite etait relie a son importance et a la
structure de sa parcelle de terrain ou de son relief. Tolede, par exemple, et
malgre son importance, en avait quatre. Les petites cites avaient parfois a peine une porte, ce qui etait tres favorable a leur defense, vu que les entrees
sont les endroits faibles de la cloture OU se concentraient normalement les
attaques des assaillants. Plus la cite etait importante et plus elle avait de
portes(138). La cloture de Cordoue en comptait sept, celIe du Caire des
Fatimides en avait huit.
Les portes se fermaient la nuit et la cite n'avait plus de
communication avec l'exterieur. On essayait, dans Ia me sure du possible, de
situer les portes loin des points eleves de Ia cloture, dans un angle entrant, et
proches de tours, afin de faciliter l'affaiblissement des assaillants' (138) (figs.
52,53).
En plus du caractere d'entree fortifiee qu'avaient les portes, elles
avaient aussi une fonction fiscaIe, vu que c'etait aux portes qu'on touchait les e G
impots sur presque toutes les marchandises qui entraient dans la cite, et
parfois meme pour celles qui en sortaient(l38). Tres souvent les souks et
marches etaient etablis dans les environs immediats des portes pour former
L' ESPACE URBAIN 150
les petits marches ou suwaiqas. II y a donc autour des portes des agoras ou
places ayant, generalement, des formes tres irregulieres mais avec - bien
entendu - une fonction citadine. Vu que la structure de la cite musulmane est
tres amorphe, il n'y avait presque pas de places publiques et ces espaces qui
s' organisaient autour des portes ont acquis une tres grande importance (fig.
54). Nous pouvons toujours voir ce phenomene de nos jours dans la Bab
Segma de Fez, ou la foule s'entasse dans Ie patio pour contempler les
enchanteurs de serpents, pour ecouter les diseurs de contes et d'histoires ou
pour ecouter les musiciens et les chanteurs(41).
L' ESPACE URBAIN 151
,-
'('.1rfL:.~ DP ~ " III 7 to! r.~ • ........ ---
Fig. 52 Le Caire au Xr s. : Porte de el-Zoueyleh (Source: Prisse D 'Avennes/J26),
L' ESPACE URBAIN 152
' ..... " ,
'"
Fig. 53 Le Caire: Partes construites au Xf S. : Porte de el-Zoueyleh (Source: , c
Prisse D 'Avennes/126),
Photo} : La porte de /'aide de Dieu (Bab al-Nasr)
Photo 2 : Porte des conquetes
L' ESPACE URBAIN 153
Fig. 54 Le Caire: Place maydan Rumeyla (Micara L./109) .
3.4.3.4. Espaces residentiels
Les Quartiers
La plus grande partie de la population residait hors du centre, dans
d'autres quartiers (harat, au singulier hara) ayant des extensions tres inegales.
Chacun de ces quartiers etait une masse de ruel1es et d'impasses situees
aut~ur de la rue principale. Dans certaines epoques bien specifiques, les
quartiers avaient des portes qui se fermaient et qui etaient gardees durant la
nuit. Chaque quartier abritait quelques centaines ou milliers d'habitants(l38);
il avait sa mosquee, son marc he filial qui suffisait a approvisionner les
besoins locaux, et parfois meme ses bains publics (hammams)(figs. 55,56).
L' ESPACE URBAIN 154
o 10 X>
Fig. 55 Quartier residentiel it Damas (Sauvaget, J./132).
Fig. 56 Quartier residentiel a Tunis (F. Lezine/99),
L' ESPACE URBAIN 155
Comme nous l'avons deja dit, la structure des quartiers residentiels
obeit ala tendance de maintenir Ie secret de la vie familiale et elle obeit aussi
au respect du concept du hijab des femmes.
Le quartier appartient a ses habitants et, d'une certaine fa~on, il etait
considere comme une extension des maisons. En cas de besoin, son intimite
etait protegee par les hommes jeunes possedant un certain ideal moral et qui
parfois s' organisaient en groupes permanents(118).
Les habitants d'un quartier s'unissaient normalement soit par une
origine religieuse, ethnique ou regionale commune, soit par affinite ou
mariage. Ces liens creaient une solidarite tres forte. Les juifs et les chretiens
vivaient normalement dans des quartiers determines et non pas avec d'autres
personnes; cela etait du a des raisons d'affinite ou d'origine parce qu'ils
souhaitaient se trouver pres de leurs lieux de culte ou alors parce que les
differentes coutumes qu'ils avaient rendaient difficile la vie commune avec
les musulmans(85).
Les quartiers les plus pauvres, dans lesquels vivaient les immigres
ruraux, se trouvaient loin du centre et pres des murs ou loin d'eux. Dans ces
quartiers on trouvait aussi les ateliers OU se faisaient les travaux bruyants ou
produisant de mauvaises odeurs, comme les tanneries et les boucheries.
j.
L' ESPACE URBAIN 156
La Maison
Le mot qui correspond au mot matson dans la langue arabe est:
maskan, et c'est un mot qui provient de la racine sakina qui veut dire paix et
tranquillite. L'interieur de la maison est ouvert au ciel, ala serenite. C'est Ie
seul endroit OU la famille musulmane peut trouver sa serenite et OU la femme
peut se deplacer sans porter Ie hijab et sans etre exposee aux regards des
etrangers.
Bien entendu, la matson musulmane s'organise autour d'un patio
interieur, elle presente au monde exterieur des murs eleves qui sont
depourvus de fenetres. Ces murs ne sont interrompus que par une porte
unique pas tres elevee, et parfois par des fenetres a meneaux (ce sont des
fenetres ou des balcons en bois, fermes par d' epaisses jalousies OU les
femmes pouvaient - dans une agreable penombre - etre en plein air et
contempler la rue sans etre vues).
La porte exterieure donnait sur un vestibule plus ou moins grand, selon
l'importance de la maison; ce vestibule menait vers une autre porte,
decentralisee par rapport a Ia premiere, et qui permettait de penetrer
directement ou a travers un passage accoude - dans Ie patio. De cette fa~on
on evitait que n'importe queUe personne passant dans la rue puisse voir Ie
patio, si la porte donn ant a Ia rue etait ouverte(l38).
La stricte VIe privee et inti me de la .famille islamique, ains~ que Ie
respect au devoir reIigieux du hijab des femmes ont incite Ie developpement
d'un systeme de 'double circulation' ou de la division de la maison en deux
L' ESPACE URBAIN 157
zones: L'une reservee a Ia reception des invites du sexe masculin (selamlik)
et I'autre reservee aux femmes et aux membres de Ia famille (haremlik/88).
Cette division etait clairement definie dans Ies grandes maisons OU l' on
trouve deux patios, un pour Ie haremlik et un autre pour Ie selamlik (fig. 57).
Cependant, Ia majorite des maisons avait un seul patio. L' espace etait
organise de fa90n verticale ou Ie premier etage etait destine aux hommes et Ie
second a Ia femme et a Ia famille. Dans d'autres cas, Ies chambres proches
de I' entree etaient destinees a recevoir Ies invites du sexe masculin et Ies
chambres internes etaient reservees aux femmes et aux membres de Ia
famille (fig. 58).
HA R[NL IX
Fig. 57 Damas: Maison de Asdd-Bacha-el 'Ash.
1. Porte d'entree 2. Porterie 3. Mastaba 4. Logement des domestiques 5. Escalier 6. W. C. 7. Chambre 8. Etang 9. Cuisine pour fa preparation du cafe 10. iwan 11.Entree du haremlik 12. Grande salle de reception 13. Bain 14. Salle de reception 15. Portique a cofonnes.
L' ESPACE URBAIN
l' Casa de clase media,Dar Balma
Casa ,; ... modesta. Oar Temane.
Gran residenc:i~. Dar e\ Hedri
~. Fig. 58 Quatre genres de maisons dans la medina de Tunis.
(Classifiees par Revault/129).
Maison modeste. Dar Temane
Maison de classe moyenne. Dar Balma
Grande Residence. Dar el Hedri
Palais. Dar el Murabet
158
L' ESPACE URBAIN 159
Bien que les enVIrons immediats du patio central soient fermes, Ie
patio est ouvert au ciel et il donne a ses habitants une vision claire de l'infini.
Dans ce cas Ie patio est comme une connexion symbolique entre Ie
macrocosme de la famille et Ie microcosme de l' exterieur. Le fait d'utiliser
activement Ie toit protege par un mur contribue aussi a l'augmentation de la
sensation de vitalite a l'interieur et procure -surtout aux femmes - un espace
ouvert ou elles ont toute liberte pour bouger.
Avec la chaleur et la cmelle secheresse il a fallu un effort humain
enorme pour pouvoir donner un souffle de vie aux maisons des cites
islamiques. C'est pourquoi on trouve des fontaines d'eau coulante dans les
centres des patios couverts de marbres. Ces fontaines creent une sensation
de tranquillite et elles ont aussi Ia fonction de rafraichir l'air. Les plantes
typiques dans Ie patio sont les arbres citriques et Ies jasmins a causse de
leurs belles fleurs et des parfums agreables qu' elles emettent. La presence de
I' eau et des arbres donne un sens symbolique, creant une sensation de paradis
sur terre.
D'autres caracteristiques de Ia maison islamique, specialement dans Ie
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, sont: En premier lieu, la fa~on qu'ont
Ies membres de la famille de se deplacer dans la maison vers des zones plus
confortables et cela selon Ia station de l'annee et Ie moment de Iajoumee.
Ce savoir traditionnel est particulierement utile avec la chaleur intense de
1, 't' e e. En deuxieme lieu, I 'usage intelligent des grilles, des paravents et des
tentes pour aider dans Ie contr6Ie atmospherique. Le plaisir de la vie en plein
L' ESPACE URBAIN 160
air est une vieille habitude et souvent on trouve une chambre enorme
appeIee 'iwan ' -a l' exterieur de la maison et qui donne sur Ie patio(88).
La hauteur des fayades variait de cite en cite. BIles etaient
nonnalement formees de deux etages, Ie rez-de-chaussee et un autre etage
au-dessus. La 'nudite' des fayades exterieures des maisons ne permettait pas
de reveler la position sociale et economique de leurs habitants(138).
3.4.3.5. Espaces publics ouverts: Les Places
II est a noter que dans une cite musulmane du Moyen-Age il n'y
avait pas, en general, un endroit pour les reunions publiques comme la place
de l'eglise ou l'espace sihle face a la mairie qu'il y avait dans les cites
europeennes de la meme epoque. L'enceinte des concentrations religieuses
etait la mosquee, qui comptait toujours avec un ample patio limite par un
portique. Les reunions pouvaient aussi se tenir hors de la cite, dans des
surfaces degagees comme Ie maydan, hippodrome ou camp destine a la
pratique de I' equitation, qui existait dans chaque cite. BIles pouvaient aussi
avoir lieu dans la musalla (oratoire en plein air)(l38). Dans la cite musulmane
il y avait plusieurs petites places (rahbas ou bat 'ha) entourees de maisons, et
iI y avait aussi et surtout des places ouvertes dans les carrefours.
L' ESPACE URBAIN 161
3.5. IMAGE GLOBALE DE LA CITE ISLAMIQUE
TRADITIONNELLE
La cite islamique traditionnelle apparait comme une entite urbaine
unitaire, coherente, complete, bien delimitee et protegee.
Quand on analyse Ies principaux elements qui Ia constituaient, on peut
noter un centralisme et une convergence vers un element principal qui n'est
autre que Ia grande mosquee, en droit privilegie de retrouvailles, de pratiques
religieuses communes. C'est a partir de cet element que s'organise un
squelette urbain multifonctionnel forme de chemins pietons principaux OU
differents genres d'activites se melangeaient: Souks,junduqs, ecoles, bains,
etc., et qui atteignaient les portes meme de la cite OU se trouvent les surfaces
de production. II s'agit donc d'une organisation qui a tendance a aller de
I' enceinte spirituelle et de ses activites collectives, situees dans Ie centre de
Ia cite, vers les secteurs peripheriques dedies a I' approvisionnement et aux
industries bruyantes. Un tissu constant d'habitat alveolaire et dense s'etend
des deux cotes de ce squelette urbain de Ia cite islamique; ce tissus d'habitat
est servi par un reseau routier ramifie plus ou moins irn!gulier et par des
ruelles de plus en plus etroites(114) (fig. 59).
L' ESPACE URBAIN 162
.... !Muraiffe.s et portes .... Q.artiers resilfentieu L = Citadelk
CIHJ Surfaces socio-economiques
~ (j(Jles pn"ncipa[es
• !Mosqu~e
~ pofs de production f:;.,.~"1 ' ....... , -- jardins
r.;~ L._ cimetien
Fig. 59 Organisation schematique de fa Cite lsfamique traditionnelle
MUTATIONS ET IDENTITE 164
4. MUTATIONS ET IDENTITE
4.1. INTRODUCTION: LE DEVELOPPEMENT URBAIN
Vers Ia fin du XIXe S. et Ie debut du XXe, de grands changements ont
eu lieu dans Ie monde musulman; ces changements ont provoque, par
consequent, sa fragmentation, sa desintegration, sa destabilisation et la
nlpture avec ses traditions spirituelles et culturelles(l24). La chute de l'empire
ottomane apres sept siecles de domination, a permis aux nations europeennes
une expansion coioniale qui a entraine de nouveaux systemes politiques,
economiques et culturels. La civilisation islamique a ete affectee de fa~on
directe par Ies modes de production et d'industrialisation occidentales qui
sont, peu a peu, devenus 'synonymes de progres' provoquant en meme temps
une confrontation entre tradition et lllodernisme.
Beaucoup de facteurs ont contribue a Ia crOIssance des cites
islamiques. Nous citons, parmi ces facteurs :
Facteurs historiques et politiques
En regIe generale, l'administration coioniale et les champs militaires
se sont installes en dehors des murs de Ia cite traditionnelle et ceci pour des
MUTATIONS ET IDENTITE 165
raIsons de securite (isolement et segregation) d'une part, et pour des raisons
strategiques (avantages que peut offrir Ie site choisi) d'autre part (fig. 60).
C'est ainsi que ce nouveau noyau, de nature differente, a commence a
s'etendre rapidement jusqu'a devenir une cite coloniale destinee
a l'hebergement de la population europeenne(l14).
Ce premIer dedoublement de la cite, qui constitue un phenomEme
quasI general dans toutes les cites islamiques, represente Ie debut d'une
devitalisation de la cite traditionnelle ; c'est un phenomime qui a toujours ete
dicte par un souhait de separation de la population locale, de meme qu'il a
ete marque par un aspect segregatif plus ou moins volontaire et affirme.
Facteurs economiques
L'exploitation du petrole ainsi que l'entree de quelques pays
islamiques dans un nouveau systeme de production et de changement dirige
vers les pays occidentaux et destine a repondre a leurs besoins, sont deux
facteurs qui ont contribue a la creation de nouvelles stnlctures economiques
et donc a l'apparition de nouveaux elements urbains dans la cite modeme,
elements qui n'avaient aucun lien avec la cite traditionnelle(l14). Parmi ces
elements, nous pouvons mentionner: les nouveaux axes de communication
commerciale qui ont cause de grands changements dans la vocation
dominante de la cite et dans les infrastructures du transport ayant une relation
quelconque avec les nouvelles productions (chemin de fer, voies de
circulation des voitures, installations portuaires).
...
MUTATI ONS ET IDENTITE
I~' '''''INI''''' .,. .... . 111 ... ... ~ .. t-!" .... _.,. " • .,1 .... 1 ..... ' ..... ,"' ... 1" t.o"l,t., ;e.,.··4"",_ • ........... c..-.t,&, " ...... ; ~('a. _.:.., ...
10 ..... _ .. _
, ... ' ..... ,.,_ ·\0 ... _10.
lPlioto 1: CDjerftfa en 1938. <Premieres impfantatwns europ!ennes (source: c.JI .. 9{aUi1l4 et)f. Preset.)
.,
fPlioto 2: C4Sa6fanca en 1912, res cliamps miEitaires et fa mitRna (par f£cocliard)
Fig. 60 Les champs militaires europeeni1J4) .
166
MUTATIONS ET IDENTITE 167
Facteurs demographiques
L'installation de la population etrangere (fonctionnaires coloniaux,
familles des immigrants, etc.) en plus d'une partie de la bourgeoisie
traditionnelle a beaucoup contribue a I' extension et au developpement de la
nouvelle cite.
ParalleIement, la crOIssance demographique et l'exode rural ont
provo que une massification de la cite traditionnelle et une creation -
volontaire ou spontanee - de quartiers populaires dans la peripherie de
l'endroit urbanise ou au sein des zones interstitielles 'inoccupees(27).
MUTATIONS ET IDENTITE 168
4.2. FORMES DU DEVELOPPEMENT URBAIN
La crOlssance des cites variait avec I'endroit, Ie contexte economique,
la forme et la structure de l'ancien noyau. Le developpement, rarement
planifie, se faisait de fa'ion desordonnee et Ia plupart du temps sans realiser
les infrastructures indispensables. Ce deve10ppement avait des formes
differentes que nous pouvons classifier d'une maniere tres rudimentaire (Fig.
61).
(})fveCoFPement concentrique
r[)i1Jeloppement para{(Jfe
o !Noyau traaitionneffe ~ "-~ !NoUf/ew: cite r "t .. _.. eJ(tension recentes
Fig. 61 Formes du developpement urbain dans Ie monde islamique
1 .
,. !
MUTATIONS ET IDENTITE 169
4.2.1.Le deveioppement concentrique
Ce developpement se faisait de maniere progressive autour de la cite
traditionnelle, soit par ordre continu, soit par des sauts successifs - avec ou
sans la conservation de zones intermediaires pas encore urbanisees
(cimetieres, jardins, surfaces commerciales occasionnelles, murs
additionnelsi1l4). Les villes de Teheran, Djedda, etjusqu'a un certain point
Beyrouth, ont vecu ce genre d'extension (fig. 62).
4.2.2. Le deveioppement paralIeie
Ce developpement se faisait par la creation pure et simple d'une
nouvelle cite completement independante de la cite ancienne. Ce genre de
" developpement qu' ont connu Ispahan, Maqakes, Fez et Ankara, impose de r-"" ~ ......
nouveaux problemes parce que n'importe quel genre de coherence semble
impossible. Les differences de type demographique et economique aident a
augmenter les causes de dysfonctionnement de la cite.
Cette forme de developpement peut avoir des origines differentes :
spontanee (qualite du site) ou volontaire (expression de la volonte politique).
Beaucoup de cites ont adopte cette forme dans leur expansion coloniale, et
ceci a souvent contribue a la naissance d'un antagonisme entre les deux
cites(l14) (fig. 63).
MUTATIONS ET IDENTITE
~it_I~.""'.'.'~ ~ ... ;,.",,.. t:J ,;: •. ~~l Dl .... J.'.~1 CJ r..1H.~-6"'I' .A(1~"11i.
Photo 1 : Damas
m 1:QJ1-HHi!:r
o 'ti~a'!)1D o E'Cuns)Ont. 1u: . ..... It4r'.
Photo 2: Teheran
Fig. 62 Developpement concentrique(114).
., . . ,,~ . . '
170
MUTATIONS ET IDENTITE 172
4.2.3. Le developpement disperse
Ce genre de developpement a souvent ete la consequence d'un relief
accidentel ou d'une complication extreme du reseau de communication ou
alors d'une croissance demographique tres rapide qui n'a pas permis a la cite
de se developper selon les formes ci-dessus mentionnees(124).
Selon les cites et Ie role politique ou economique de chacune, ce genre
de developpement avait parfois l'aspect d'une vraie fragmentation qui a
complique les relations entre les differentes parties de la cite surtout la OU il
est tres difficile de comprendre Ie fonctionnement (ce fut Ie cas de Djedda
aux debuts des annees 50, ce fut aussi Ie cas de Casablanca et de Delhi qui
laisse c.ertains secteurs interstitiels libres - soit parce qu'ils ne sont pas
urbanises, soit parce qu'ils ne peuvent pas etre urbanises). (Fig. 64).
\
I
r
I
l:
MUTATIONS ET IDENTITE 173
Fig. 64 Le developpement disperse: Djedda en 1948 (I 'ancienne cite et les
premieres extensions).
MUTATIONS ET IDENTITE 174
4.3. TRANSFORMATIONS DU XXe S. ET LA PERTE DE
L'IDENTITE DE L'ESPACE URBAIN DANS LA CITE
ISLAMIQUE.
Le developpement et la crOIssance des cites islamiques, amSI que
I' organisation urbaine selon les modeles etrangers ont cause de grandes
ruptures et de grands changements dans la vie .de la cite. Ces ruptures ont
laisse Ie champ libre aux forces de transformation qui agissaient et agissent
toujours au niveau de la vie des habitants d'une part, et au niveau de
l'urbanisme d'autre part.
4.3.1. Changements dans Ie style de vie.
Bien que les changements aient affecte plusieurs aspects de la vie
citadine, nous ne parlerons ici que de trois aspects qui ont fortement affecte
I' espace urbain traditionnel :
Le rOle de la femme:
La demande rapide de production et de servIces a cree un
stimulant pour que les femmes abandonnent Ie refuge de la maison et se
dirigent au monde du travail. L'acces aux telecommunications (T.V., radio, , '
films) a ete un facteur seculaire additionnel dans la diminution du respect des
lois islamiques concernant l'intimite et la segregation ou separation entre les
sexes dans les espaces physiques(60).
I .
MUTATIONS ET IDENTITE 175
La familIe :
La surpopulation ou la crOIssance demographique a cause,
indirectement, la transformation de 'Ia famine extensive' en 'une famine
nuc1eaire'; ceci a beaucoup influence les relations d'autorite dans la famine,
surtout en ce qui concerne la selection, Ie choix de la carriere et la
cohabitation(60). L'organisation de la maison en noyaux prives n'a pas pu
etre maintenue. Au Caire, par exemple, 260/0 de toutes les maisons sont
formees d'une seule chambre et cependant, la famine moyenne est une
famille de 5 personnes. Ceci veut dire que I'intimite de la maison n'etait pas
respectee(84) .
Le quartier :
Un autre facteur de 'modernisation' est I' augmentation de
I'heterogeneite de la population; Ie resultat de ceci est une perte de la
cohesion et de la solidarite sociales qui existaient avant dans Ie quartier
habite par des familles extensives ou par des gens ayant une me me origine
h . I " (116) et mque ou re 19leuse . Actuellement, un constructeur construit des
milliers de maisons en unites de demeures publiques que Ie gouvernement
remplit en y assignant des locataires choisis au hasard.
MUTATIONS ET IDENTITE 176
4.3.2. Changements au niveau de I'espace urbain
Nous allons etudier ici quelques nouveaux elements urbains qui ont
une influence negative sur l'organisation urbaine de la cite traditionnelle, ou
- pour Ie dire d'une autre fac;on - qui ont contribue ala perte de l'identite de
I' espace urbain.
4.3.2.1. L'espace exterieur: La Rue
De grandes et amples avenues ont eM ouvertes pour heberger la
voiture, symbole du progreso Ces avenues traversaient Ie dense tissu de
souks et bazars, interrompant Ie flux de pietons et causant une confusion
dans la relation preetablie entre les differentes activites. En Iran, Shah
Rezah a introduit la modernisation en faisant croiser orthogonalement de
grandes avenues a travers les villes de Teheran, Ispahan, Mashad et
Yash(61)(fig. 65). L'amelioration ou Ie progres du trafic a ete accompagne
d'un isolement des monuments religieux, comme les mosquees et les
sanctuaires, du reseau urbain.
MUTATIONS ET IDENTITE 177
-.
ISFAHAN
Fig. 65 Grandes avenues qui traversent Ie n?seau routier traditionnel(JJ4)
!
l
MUTATIONS ET IDENTITE 178
4.3.2.2. L'espace Interieur
L'un des changements les plus importants de l'urbanisme islamique
a eu lieu dans l'espace interieur et specialement dans l'espace de Ia maison
qui s'est transforme d'un espace introverti, ferme sur soi-meme et ouvert
vers Ie patio qui lui procure de Ia Iumiere et de I'air, a un espace extraverti,
ouvert a l'exterieur et a la rue pour l'ensoleillement et Ia ventilation. C'est
ainsi que cet espace a perdu tous les avantages que lui donnait Ie patio (la
tranquillite, l'air humide, I'intimite, etc.) ; par consequent, son caractere et sa
fonction symbolique ont ete completement detruits(54). D'autre part, pour
payer Ie coilt de l'expropriation et de la demolition pour la creation de
grandes avenues, on a encourage la construction de b§timents tres eIeves.
Ces b§timents ont ete construits dans toutes les parties du monde islamique
par les architectes etrangers qui ont contribue, a leur tour, a decider du
modele et de la forme des cites islamiques sans penser aux coutumes et aux
traditions de leurs habitants(60).
La ville Nasr au Caire a ete dessinee en 1956 par des specialistes
sovietiques ; la nouvelle ville industrielle Ariashahr (dont Ie nom a change en
1979 pour devenir Foulade-Chahr) - situee pres de Ispahan - a ete, Quant a elle, planifiee par Giprogor a Moscou et cet architecte a applique
rigoureusement dans les deux villes Ie style des maisons russes typiques(62).
Le projet de demeure RUSH a Djedda ; la ville King Khaled ; la cite militaire
Suqaihah a Abu Dhabi, sont autant d'autres exemples realises par des
specialistes americains. Le projet Djedda inclut '1000 personnes' dans des
tours de' 15' etages, et il y aurait une plate-forme destinee aux garages, pour
chaque trois etages.
MUTATIONS ET IDENTITE 179
Ce geme de constructions ne respectait ni l'intimite ni Ie climat et
elies ont genere beaucoup de problemes. L'intimite de la vie privee a I'interieur de Ia maison etait violee par Ia presence de nouveaux batiments
plus eleves(45) (fig. 66). Les conditions micro-climatiques qui sont tres
importantes dans l'habitat traditionnel ont ete perturbees. L'usage de cristal,
d'acier, de beton, etc. provient principalement de l'occident OU Ie climat n'est
pas tellement chaud et dur. Dans Ie Golfe perse les eMs sont extremement
chauds et humides, la temperature oscille - souvent - entre 40° - 45°C (115 -
120°F) et I'humidite atteint 85% ou plus.
~ .. f..-_ _ -t DO
• •
+--, h\-~ ,,-
;' ,,-~ '" "1 ,/ ., +-,,-
" "" '" 7 I:J ,/ ,/ , ,/ " ~ '" 11 .s- ~ ¥:-
••• .1.. 01- , . • •• ~ooooo a h DO
~~o~nn (loon n • 0 .0
Fig. 66 La construction en altitude perturbe les conditions micro-climatiques et
sociales de I 'habitat traditionnel.
- Le raJrafchissant vent de I 'ouest est detenu
- L 'inti mite de vie dans Ie patio est violee par la vue dominante du bCitiment.
I I , I
MUTATIONS ET IDENTITE 180
Les nouvelles villes de la peninsule sont devenues dependantes de l'air
conditionne et d'autres equipements et technologies sophistiquees qui,
souvent, n'etaient pas dessinees pour une telle chaleur et une telle humidite,
surtout 3 long terme(26). Hassan Fathy(55) a explique Ie probleme de la fa~on
suivante:
, Avec les nouveaux dessins de la cite islamique, les fenetres 3
mucharabiyyas ont ete remplacees par les grandes fenetres et fa~ades de
crista!. Ceci a ete justifie par Ie fait d'introduire Ia vue exterieure 3
l'interieur de la maison. Mais si cela fut une bonne idee dans les pays froids
(3 cause de l'existence d'une bonne vue comme ceolle de la mer, du fleuve, de
la foret), ce ne Ie fut pas dans les pays chauds. Comme nous Ie savons si
bien, une fa~ade de cristal transmet dix fois plus de chaleur qu'un mur solide
de dix 3 quinze centimetres; de meme, un mur de cristal directement expose
aux rayons solaires permet d'introduire 2000 klcal par heure et ceci requiert
un indice eleve de refrigeration. Avec l'usage du 'brise soleiI' nous pouvons
diminuer cette temperature jusQU'3 600 kg/cal par heure. Cependant, Ie
resultat est toujours 3000/0 plus de chaleur que dans Ie cas d'un mur solide de
dix centimetres.'
En plus de ce qui precede, d'autres facteurs ont contribue 3 la
degradation de I' espace interieur et la perte de son identite. Parmi ces
facteurs nous pouvons mentionner :
MUTATIONS ET IDENTITE 181
- Le demenagement vers les nouveaux quartiers
Dne grande partie des habitants des maIsons traditionnelles ont
emigre vers les zones residentielles modernes. Leurs maisons se sont
transformees en ecoles ou residences communautaires occupees par des
populations rurales qui trouvaient dans la maison traditionnelle certaines
caracteristiques de leur habitat. Certaines de ces maisons bourgeoises ont ete
divisees en unites de petites dimensions. D'autres ont ete transformees par la
construction d'un etage suppIementaire, par l' ouverture de grandes fenetres
ou de balcons et d'extensions dans Ie patio meme(45).
- La faiblesse du systeme du 'Waqr :
Le plan original de beaucoup de cites a ete conserve grace au
systeme du Waqf qui ne permet pas la transaction ou la vente de ses
proprietes(54). Dernierement ce systeme a ete aboli dans certaines regions, et
actuellement la possession de ces grandes proprietes est partagee par de
nombreux beneficiaires qui construisent des blocs de batiments selon Ie
nouveau modele, ouverts vers I' exterieur; de cette fayon ils defigurent les
quartiers traditionnels.
Finalement, aussi bien les maisons anciennes que les quartiers ont
perdu leurs qualites. La construction en hauteur, la suppression des patios,
I' ouverture de grandes avenues pour la circulation ainsi que la rupture de la
cohesion sociale existante ont cause la perte du caractere propre et de la
fonction symbolique du quartier traditionnel.
MUTATIONS ET IDENTITE 182
4.3.3.Perte d'autres fonctions symboliques
Le placement des nouveaux centres d'affaires hors de la cite
traditionnelle a aide a la conservation des batiments historiques. Cependant,
en faisant sortir de la cite traditionnelle les activites economiques, Ie resultat
fut la decadence de certains espaces comme Ie suq QU Ie bazar, de meme que
d' autres batiments comme Ie khan qui a perdu sa fonction traditionnelle pour
se convertir dans certains cas en magasin(45).
En plus de cela, la posseSSIOn speculative - due a la demande
croissante de demeures - a contribue a faire disparaltre certains genres de
batiments comme les funduqs et les wekalas qui ont ete reutilises comme
demeures(60) .
Une autre consequence du deplacement des centres d'affaires a ete la
mIse en marge de la cite traditionnelle, sa transformation en un quartier
pauvre qui regroupe des gens d'origine rurale et la desintegration des grands
batiments en unites residentielles abandonnees et ayant une structure
physique decadente(l14).
MUTATIONS ET IDENTITE 183
4.4. CONSEQUENCES: DUALITES FORTEMENT MARQUEES
4.4.1. Dualite morphologique
La dualite qui caracterise Ie plus les cites islamiques est sans doute la
dualite morphologique(28)(fig. 67).
D'une part, no us trouvons dans la cite traditionnelle une construction
homogene, agglomeree, dense, fermee sur soi-meme et bien delimitee,
dominee par ses minarets et servie par des rues etroites et tortueuses qui
souvent sont des impasses.
D'autre part, dans la cite moderne, Ie tissu urbain est plus lache, plus
entrelace, moins defini dans Ies peripheries, servi par un reseau routier de
voitures; ses batiments ont plutot un aspect occidental et ils sont moins
adaptes aux coutumes et au climat.
4.4.2.Dualite demographique et sociale
Ce phenomene s'est traduit, dans la cite islamique, par une segregation
spatiale tres claire :
r
MUTATIONS ET IDENTITE 184
La cite traditionnelle avec ses quartiers sous-integres a forme une base
pour les populations plus pauvres, a cause des liens qu' elle conserve avec Ie
monde rural et avec les emplois locaux tres specialises, dans Ie cadre de la
production typiquement traditionnelle<1l4).
Par contre, les nouveaux quartiers sont generalement occupes par les
familles aisees qui sont en relation avec les activites modemes.
Cette dualite socio-demographique s'est aussi traduite para une densite
de population qui est plus elevee dans l'ancienne cite que dans la modeme.
MUTATIONS ET IDENTITE
Islah"" : an'<''' til! 1600. Calles , <lror,uosils. aquilcclllra
_ tradlc/onal. uri)i1lltSfilO
~.~ao.") . . "- '--~on!;ineo. ~,~~ . ",,,,,,,,,_,, ••• ,, .. " •.• 1.,.
I~fah;{n : despuefi ctP. 160{1:Urbanismo flguroso y
Fig. 67 Dualite morpholo~ique Photo 1: Tunis (par C. Brown)(18) Photo 2: Ispahan
185
Ispa/7an avant 1800: Rues tortueuses, architecture traditionnelle. urbanisme spontone. Ispohon apres 1800: Urbanisme rigoureux et autoritaire. Perspectives droites (par Ardlan et Bakhtiarf5
).
MUTATIONS ET IDENTITE 186
4.4.3. Dualite fonctionnelle
Depuis ses origines, Ia cite ancienne s'est basee sur certaines fonctions
urbaines traditionnelles qui constituaient la base de sa vie economique et
sociaIe et qui se sont difficiIement adaptees aux nouvelles orientations de la
societe.
Avec Ie developpement de la cite moderne, de nouveaux elements
fonctionnels sont apparus, elements qui etaient en relation avec un mode de
vie occidental et avec un systeme plus ou moins industriaIise.
Cette bivalence a provo que une confrontation qui s'est manifestee par
ce qui suit (114) :
Dne dualite au mveau du commerce et du changement (souks,
grands magasins).
- Dne dualite au niveau de la fabrication et de la production
(artisanat, industrie).
Dne dualite au niveau des activites d' equipements qUI sont
situees, pour la pIupart, en dehors de la cite traditionnelle.
- Dne dualite au niveau des activites tertiaires, administratives et
privees.
- Dne dualite au niveau des acces et de la communication (reseau
pieton, reseau automobile) .
MUTATIONS ET IDENTITE 187
4.4.4.Dualite culturelle
II est evident que la cite traditionnelle a eM comme un gardien vis-a
VIS des traditions culturelles et religieuses et qu'a travers elle la civilisation
islamique s'est transmise et maintenue.
La permanence du patrimoine urbain a contribue a la continuite de ses
valeurs spirituelles et morales, a la realisation de manifestations importantes
dans les memes cadres et la perpetuation des activites artisanales et
artistiques originales.
Sur Ie plan religieux, la cite anclenne est Ie site de la majorite des
locaux de culte (mosquees, mausolees, cimetieres, sanctuaires, etc . ... ) ; par
consequent, elle est Ie point de rencontre de beaucoup de fideles.
Par contre, la cite modeme - presque toujours inspiree par Ies formes
urbaines etrangeres - ne presente presque aucun lien avec Ia civilisation
islamique. Les modes de rencontres, de contact et d'activite sont differents, o
les cadres culturels sont plus proches de I' occident Cil_ ils fie Jes 'Semt de
I'IsIam(l24)(fig. 68).
MUTATIONS ET IDENTITE 188
--.-========--~-- .. ,,--
Fig. 68 Varietes de juxtapositions entre ancien et nouveau, entre indigene et I 0
importe, dans la cite moderne du Moyen-Orient. (Dessine par Kathe Tanous dans:
Aramco world Magazine).
\
MUTATIONS ET IDENTITE 189
4.4.5.Dualite Legale
Comme resultat de l'adoption de conventions physiques prises d'autres
contextes et leur application a la cite musulmane, une dualite s' est
developpee dans Ie systeme legal; plus specifiquement dans son mecanisme
regulateur. Pour illustrer comment tout cela se manifeste dans
l'environnement urbain, nous touchons de nouveau Ie point de l'intimite dans
la cite contemporaine. Dans Ie cas de Bada'a qui a eu lieu en Safar 1400,
janvier 1980, l'autorite municipale a permis au proprietaire d'ouvrir des
fenetres au second etage a deux metres du mur de son voisin. Les plans ont
ete approuves et Ie proprietaire a commence la construction de la maison.
Cependant, quand Ie voisin s'est rendu compte que son intimite etait en
danger a cause des fenetres, il a porte plainte. Apres avoir etudie Ie cas, Ie
juge dit au proprietaire qu'il etait pret a ordonner la fermeture des fenetres ;
mais, vu que les decisions legales coi'ncidaient avec les normes approuvees,
il etait oblige d'accepter ce que l'autorite municipale avait autorise(l31).
Cette contradiction revele la nature des normes appliquees dans Ie
contexte traditionnel et contemporain. Les reglements urbains modernes mis
en place par un groupe de technocrates etrangers ont pu, a un certain
moment, changer (comme ce fut Ie cas de la ville de Riyad, OU 'Les
Associes Doxiadis d' Athenes' ont introduit un groupe de reglements en o 0
193011970 et ou SCEr international SEDES de Paris a propose un autre
groupe de reglements differents en 140011980P31). Cette possibilite de
changement est due au fait que ces reglements n' ont aucune connotation
I I
( ,;
MUTATIONS ET IDENTITE 190
culturelle et sont donc consideres comme 'artificiels' et 'techniques.' De
sorte que les nouveaux reglements representent non seulement un
changement dans les normes, mais aussi un changement dans Ie systeme et
dans la methode desquels derive la loi.
MUTATIONS ET IDENTITE 191
4.5. CONSERVATION ET CHANGEMENT DANS LA CITE
ISIJAMIQUE
4.5.1. Introduction
Avant d'entrer dans Ie theme de Ia conservation, nous allons faire une
description breve de l' atmosphere ideoIogique actuelle dans Ie monde
isiamique. On a signale qu'il y a deux perspectives, Ia traditionaliste et Ia
liberale. Les traditionalistes reaffirment I' autorite du passe comme guide
unique pour Ie present. Ils attribuent Ie retard technoIogique des villes
isiamiques a la deviation des buts spirituels. Pour sauver Ia societe, on a
besoin, selon eux, de reforme morale(9S). Les partisans de ce point de vue ne
refusent pas Ia technologie 'etrangere' modeme ; au contraire, 1'adoption de
certains aspects de cette technologie est jugee necessaire. Le point de vue
liberal ne nie pas seulement I' autorite de la tradition, mais il ne reconna1't
meme pas son authenticite comme source pour Ie present. Les partisans de
ce courant voient Ia tradition comme un obstacle au progreso Selon eux,
I' unique chemin pour faire sortir la societe de son retard est de tout effacer et
de recommencer tout depuis Ie debut(9S). Le resultat de ce point de vue est
que la societe s'embarque dans un proces etendu d'emprunt d'idees et de
technologies d'autres cultures.
MUTATIONS ET IDENTITE 192
Les deux points de vue cOIncident en un point: Ie desir d'introduire la
technologie moderne dans leur societe. Les traditionalistes Ie justifient par Ie
besoin tres clair qu'a la societe d'une telle technologie. Les liberaux, par
contre, pensent de maniere differente. lIs ont l'illusion que la technologie
modeme peut resoudre tous les problemes de la societe; c' est pour cela que,
pour eux, la modernisation est equivalente aI' occidentalisation. Et quelque
chose d'occidental veut dire quelque chose de moderne.
Ci-dessous nous allons analyser Ie point de vue theorique de cette
etude en ce qui conceme Ie probleme de la conservation et sa relation avec la
dualite existante.
Notre position implique que nous regardions Ie present comme il est,
avec une grande comprehension de ce qu'il est; il faut aussi que nous
voyions comment Ie passe etait different du present. II est aussi important
que nous definissions, dans Ie contexte du present, comment sont les
problemes, comment ils sont apparus, et que nous essayions alors de
presenter des solutions qui seront utiles aces problemes. Cependant, il faut
toujours que nous fassions attention aux implications qu'auraient ces
solutions sur Ie futuro Ceci permettrait d'eliminer les deux points de vue qui
sont utilises simultanement soit en imitant Ie passe soit en imitant une autre
culture. Ceci permettrait aussi de favoriser ou d'encourager l'idee du iytihad
(effort en faveur de l'initiative personnelle et du jugement independant)
comme etant notre point de depart.
Cette position, en vertu de sa reconnaissance de la valeur traditionnelle
et de ses proces contemporains, pourrait developper des solutions coherentes
et minimiser autant que possible les contradictions et la dualite dans la
I ..
MUTATIONS ET IDENTITE 193
societe. Cette dualite existante pourrait etre eliminee par une tentative
serieuse et par une comprehension totale de sa nature. Par exemple, on peut
etablir des programmes d' education actuels et futurs et les utiliser dans les
autorites de construction que ce soit dans la loi islamique et sa relation avec
les problemes de la ville ou dans l'etude des reglements de la zone moderne
et des codes de construction. La disposition de ces programmes serait plus
de la responsabilite des habitants de la ville que celIe des technocrates qui
ignorent ce contexte.
En ce qui conceme Ie theme de comment regarder Ie passe, la fa~on de
Ie comprendre et de Ie detinir ainsi que la fayon de choisir de ce passe, nous
retournons a la position de l'etude basee sur la tradition. Cette position voit
la tradition · en soi sans autorite mais avec une valeur definitive. Sa valeur
vient du fait que la tradition constitue la reference la plus importante que
nous connaissions et consiste donc en une plate-forme sur laquelle nous
travaillons. Pour illustrer comment cette position peut etre appliquee,
regardons de pres un cas, par exemple la tentative de definir la fonne urbaine
dans la cite islamique. Les etudes de la cite islamique ont toujours considere
leurs formes urbaines comme des elements ou caracteres physique , comme l \ l eM ') . tA t:\JAi
la mash rab iah , les arcades, les cupules, etc. sans cependant abandonner ]es \
recherches quant aux raisons pour lesquelles elies sont utilisees.
La conclusion inevitable de cette approche est Ie fait de croire qu'il
n'est pas permis de changer ces formes et que si nous voulons preserver la
continuite du passe, nous devons continuer a utiliser ces elements dans leurs o
formes plus ou moins originales. Cependant, si nous suivons la position
anterieure et que nous regardons ces formes traditionnelles comme une plate
forme sur laquelle nous travaillons et si nous essayons de comprendre ces
MUTATIONS ET IDENTITE 194
fOImes dans leur contexte socioculturel, Ie resultat serait completement
different.
La definition de la forme urbaine dans la cite musulmane ne peut done
se faire avec ses elements physiques mais avec son systeme d' ordonnances
(normes de conduite) ; c'est pour cela que ces elements peuvent s'adapter ou
me me changer tant que leurs systemes d'ordonnance ou tant que leurs
relations restent constantes. Ceci nous menerait a l'idee qu'il n'y a pas une
fOIme urbaine fixe dans la cite en soi, mais qu'il y a une certaine attitude
concernant la question de comment vivrait et queUe relation aurait un
individu vis-a-vis de son voisin et vis-a-vis de toute la communaute libre.
4.5.2. Motifs et causes de la conservation
II est important de rappeler que Ie noyau historique dans Ie monde
islamique n'occupe qu'une petite fraction de la surface metropolitaine, Ie
grand Caire s'etend tout au long de 2200 kilometres carres parmi lesquels
261 kilometres carres sont occupes par la zone urbanisee alors que 3.7
kilometres carres sont occupes par la zone de la medina flitimide(60). Dans Ie
Caire, comme partout, la strategie adequate serait la conservation complete
de la medina comme refuge traditionnel protege par une legislation
specifique.
Malgre les tendances actuelles de marginalisation des noyaux c
historiques des agglomerations islamiques actuelles ainsi que les tendances
de desarticulation structurelle et fonctionnelle, il semblerait que les cites
traditionnelles ont encore un caractere polariseur du point de vue culturel,
MUTATIONS ET IDENTITE 195
social et religieux. De plus, elles participent toujours, moins toutefois, a un
apport economique(l14).
D'autre part, la presence de b§timents et de complexes urbains tres
interessants du point de vue architectural, ainsi que Ie role culturel et
religieux de la cite traditionnelle lui donnent une valeur indeniable qu'il
convient a la communaute ne jamais laisser entrer dans Ie declin. II serait
aussi necessaire de prendre les mesures de protection et de conservation
necessaires a la cite, que ce soit a cause du temoignage culturel qu' elle
presente ou a cause du modele d' organisation spatiale qu' elle represente, par
ailleurs, dans Ie proces urbanistique.
La conservation peut etre de deux fayons :
Conservation de certains monuments importants (conservation
sterile)
Conservation dynamique.
Nous allons ci-dessous analyser ces deux genres de conservation,
mettant en relief les avantages et les defauts de chacun.
4.S.3.La conservation sterile
Elle consiste en la sauvegarde et l'ameIioration de quelques b§timents
tres significatifs du point de vue historique ou artistique (mosquees, madaris, G
fontaines, etc.). Elle repond aussi a des objectifs d'ordre touristique. Elle se
resume toujours par un arrangement quelque peu fictif de monuments
importants et de certains chemins (traitement du sol, actions sur les fayades,
I
l
MUTATIONS ET IDENTITE 196
etc.) donnant ainsi a Ia cite une nouvelle vocation de 'cite musee', et ceci a travers Ia reconstitution de sa decoration urbaine.
Ce geme de conservation ou conservation 'du cosmetique' se fait en
appliquant Ia decoration traditionnelle a l' exterieur des b§timents de type
occidental. Ceci peut convertir Ia medina en une caricature de 'Disney,C60).
Un des exemples qui attirent Ie plus l'attention sur ce qui precede est Ie
noyau renove de la Falfa: air conditionne et une installation modeme de
tuyauteries. Selon Abdullah Schleifer, ceci a ete applique a un 'quartier
musulman bohemien et district de lumiere rouge,(134).
Ce geme de conservation n'est iriteresse que par des 'objets'
architecturaux isoles de leur contexte urbain. Pour cela, il cause de grands
prejudices sur les ceuvres meme d'art qui, meme ayant ete bien conservees,
perdent leur dimension pour ne pas avoir ete englobees dans leur contexte:
Beaucoup d'ceuvres d'art ont ete detruites par la politique de deblocage
etablie par les experts occidentaux. CeUe politi que meme a isoIe Ies
mosquees, faites en principe pour etre integrees a l'ensemble urbain(lo7).
De plus, ce geme d'interventions limite Ie role de I'ancien noyau et Ie
transforme en un temoin du passe, contribuant ainsi a exagerer la
devitalisation fonctionnelle et sociale de la cite.
MUTATIONS ET IDENTITE 197
4.5.4. La conservation dynamique
La sauvegarde 'active' consiste dans Ie fait de reutiliser Ie patrimoine
urbain a des fins socioculturelles et touristiques, tout en respectant toujours Ia
typologie et la morphologie de Ia trame urbaine.
Une sauvegarde 'active' qui encourage les structures existantes dans
les domaines de l'education, de la religion, de l'art et de la recherche est
plus justifiable quand Ie noyau historique continue a presenter un
patrimoine urbain de valeur et qui garde une certaine realite et un certain
impact religieux, social et culturel, ainsi que quand elle a encore des racines
profondes dans la civilisation islamique.
Un tel choix, quand il est possible, ne veut pas dire la conservation des
quartiers anciens dans leur aspect solide mais leur renovation intelligente
qui consiste a rehabiliter Ie tissus, a conserver et a developper les activites
locales, la maintenance de la population dans des conditions de vie
meilleure et l' apport de nouveaux composes sociaux.
Mais rien n'est valable si on n'y ajoute pas quelque chose qui ne soit
pas inscrit sur la pierre. Parce que ni l'histoire, ni la beaute, ni Ie signe ont
un sens s'ils ne sont pas vivants et vivants aussi bien par les visiteurs que
par les habitants eux-memes(107). C'est a dire que paralleIement a la
renovation il faut faire tout un effort d'education. Le programme qui va de
pair avec ce genre de conservation est celui de rentrer continuellement dans
l'intimite du souvenir, de I'reuvre et du signe: l' ecole, l' explication, la
lecture des choses, en bref la culture par tout un peuple. Ceci est important
j
t
MUTATIONS ET IDENTITE 198
t)v\'L~ ..... ., Jl.---1t\1
pour ne pas, que Ie respect de la richesse passee soit considere comme un
sacrifice des hommes envers les choses ; il est de meme important pour que
les habitants de ces quartiers ne souffrent d'aucun esprit de conservation,
chose qui serait intolerable(107).
4.S.S.Comment conservons-nous dynamiquement ?
Comme la coherence initiale socio-spatiale de la cite traditionnelle a
ete progressivement deterioree, nous devons donc en premier lieu chercher
les moyens qui permettent de redefinir la nature et la structure de ses
relations internes dans Ie cadre d'une organisation globale de l'ensemble
urbain. En deuxieme lieu il faut arreter la degradation des quartiers
traditionnels et les integrer a la vie urbaine tout en conservant leur identite.
Dans ce contexte-la, to ute intervention ayant pour objectif de
remodeler - me me Iegerement - n'importe queUe partie du tissu, ou de
reorganiser n'importe quelle stnlcture fonctionnelle a beaucoup de
repercussions a tous les niveaux de la ville et rend toute action
d'amenagement extremement delicate, nous pouvons meme dire dangereuse,
pour l'organisme coherent qui constitue l'ancien noyau urbain. Ceci fait ainsi
ecarter toutes les methodes de 'renovation' qu'une telle intervention risque,
par sa bmtalite, face a un milieu tres fragile et ceci en adoptant une methode
de conservation qui assure a la cite islamique son caractere spatial, tout en
offrant les besoins du present et du futuf.
MUTATIONS ET IDENTITE 199
4.5.6. Interventions dans certains espaces importants de la Cite
Islamique
Si l'on prend en consideration les dangers de la generalisation des
solutions, et si l'on admet que chacune des cites islamiques a evidemment sa
personnalite differente, dft aux differences des conditions climatologiques et
historiques, on essaiera, ci-dessous, de donner quelques propositions
generales d'intervention qui peuvent etre convenables dans la sauvegarde des
cites islamiques traditionnelles.
4.5.6.1. L'environnement de la Cite Traditionnelle
La disposition de I' environnement de la cite traditionnelle do it
obligatoirement obeir aux objectifs suivants(114, 47) :
- Assurer Ie debouche convenable des VOles automobiles
exterieures qui menent a la cite
Permettre l'amelioration de ses acces par un reseau de voirie
approprie
- Creer un potentie1 de stationnement et de depots peripheriques
adaptes aux besoins internes de la cite.
- Construire, dans la mesure du possible, une zone de protection
et de revalorisation de la cite traditionnelle, zone qui devra
border la cite et souligner physiquement son unite et sa
coherence. La constitution de cette zone peripherique - partielle
ou totale - d'approximation ou d'acces, de communication et de
protection peut paraitre comme une solution interessante pour
MUTATIONS ET IDENTITE 200
eviter l'asphyxie, la marginalisation de la cite, ainsi que pour
permettre la revalorisation et la rehabilitation du patrimoine
urbain (fig. 69).
EI centro de Meshed. Proyedo de revalorizaciOn. (pOl' Chevalier y Eco(;hal'd,
Abrir t:I circtJlo exterior para liberal' las vistas y dar 1<1 longitud sUficieote a las tiendas.
1
(;;~ ~~ '-~~~
Indicar el heotro, no por las tiendas, sino por un cinturon de agua dejandose todo el valor al rnonumento.
Fig. 69 Le traitement de I 'environnement du centre de Meshed47J.
Photo 1 : Le centre de Meshed. Projet de revalorisation (par Chevalier et Ecochard).
Photo 2: - lndiquer Ie centre, non pas a travers les magasins sinon a travers une ceinture d'eau, tout en laissanl au monument toule sa valeur.
Ouvrir Ie cercle exterieur pour liberer les vues et donner la longitude sufJisante aux magasins.
Separer fa circulation mecanique de fa pie/onne.
MUTATIONS ET IDENTITE 201
4.5.6.2. Les rues ef Ie probleme du frafic
Le probleme est difficile quand il s'agit de villes marquees par Ie
progres technique et par l'urbanisme du siecle demier, parce qu'il s'agit alors
de passer entre les canons rigides.
Pour introduire au creur des cites islamiques Ie courant de la
circulation utilitaire a rythme rapide et modeme, il y a deux solutions:
- La premiere solution est chirurgicale et elle consiste a ouvrir de
gran des avenues a I' interieur des noyaux historiques, en effa~ant
les limites peripheriques et en atteignant une integration totale et
une suppression des differences fonctionnelles qui - evidemment -
ont tendance a se prolonger en segregations a caracteres ethniques
ou SOClaux. Cette solution, qui a ete utili see dans certaines cites
islamiques, a detmit et mine Ie caractere de la rue islamique(I07)
(fig. 70). Les resultats semblent actuellement negatifs ; l'ouverture
de I' ancien noyau a la circulation des voitures (par reconversion du
reseau ou par des ouvertures) ne peut etre que fatale parce que Ie
tissu traditionnel ne Ie permet pas, pas plus qu'il ne supporte des
interventions tellement brutales(l14). Le probleme ne se resout pas
non plus avec la realisation de certaines installations specifiques
dans Ie tissu (elargissement des voies, perforations, ouvertures,
creation de parcs de stationnements, etc.).
MUTATIONS ET IDENTITE 202
,,,,.---:.-...
Ciudad de Meshed en Iran. (114)
La ciudad de Herat en Afganistan. (por C. Brown)
Fig. 70 L 'ancien noyau traverse par Ie reseau routier contemporain. Photo 1: Ville de Meshed en Iran (114) Photo 2: La ville de Herat en Afghanistan (par C. Brown)
MUTATIONS ET IDENTITE 203
- L'autre solution est d'entourer l'ancien noyau par une avenue
peripherique de circonvallation et OU les culs-de-sac peuvent se
connecter a elle, chose qui faciliterait I' acces des ambulances, des
voitures des pompiers et d'autres voitures d'urgence(56). En plus de
cela, l'amelioration et la modernisation peuvent avoir differents
aspects en partant de la restructuration et de I' arrangement des
voies existantes qui seraient accompagnes d'un developpement
potentiel du stationnement automobile peripherique et de la
reorganisation du transport animal sur les trajets rationnels bien
determines.
De par Ie fait que les proprietaires des voitures preferent controler
leurs voitures en les stationnant pres de leurs maisons ou de leurs bureaux ou
magasins, il serait souhaitable d'attirer vers la medina les gens qui n'ont pas
besoin ou ne peuvent pas avoir de voiture ; par exemple: les etudiants, les
professeurs retraites, les fonctionnaires, les officiers et employes
d'institutions telles que: les residences, les orphelinats, les maisons et les
hopitaux de maternite. La fonction de la medina serait d'heberger les
activites artisanales et commerciales traditionnelles, les institutions, ainsi
qu'une population residentielle dont Ie niveau d'education serait assure par
I' heritage architectural. La medina ponrrait ainsi joner un role
compIementaire: il serait aUSSI possible d'avoir des hotels, des auberges et
certains genres de spectacles que propose Ie melange commercial
institutionnel, sans cependant que ces spectacles soient du style international
des cabarets destines aux touristes(60).
MUTATIONS ET IDENTITE 204
Finalement, les projets modemes a grande echelle sont bases sur les
reseaux de rues orthogonales, d'avenues droites et larges. Tout cela serait
evite. Hassan Fathy(57) signalait que dans la medina traditionnelle, la plus
longue extension de rue etait de 300 metres et la largeur des rues les plus
grandes etait de lOa 20 metres. Comme contraste a ce1a, les rues les plus
modernes construites en Libye ont une largeur de 70 a 100 metres.
4.5.6.3. Les espaces interieurs: Le Domaine Edifie
En ce qui conceme Ie domaine edifie, nous pouvons differencier
entre les espaces residentiels et les autres espaces interieurs.
- La revalorisation des espaces residentiels traditionnels peut se
materialiser en premier lieu par un developpement systematique
du confort interieur des logements et par l'eIimination des
constructions parasites, liberant de cette maniere les patios et les
jardins qui existent encore.
- Reutiliser les palais ou les gran des residences abandonnees ou
subdivisees de nos jours en leur trouvant de nouveaux usages
dans Ie cadre d'une revivification de la ville a des fins
d' equipements de vOlsmage ( administratif, social,
enseignement) ou a des fins exceptionnelles d' ordre artistique et
culture I (musees, ecoles, centres d'art, etc.).
I I
I
[ i
I'i
MUTATIONS ET IDENTITE 205
En plus, l'amelioration de l'habitat peut avoir besoin de peu de
moyens, relativement, si eIle est accompagnee de la participation des
habitants et de l'usage de materiaux locaux et de techniques simples. Selon
les experiences faites par Hassan Fathy(57), 20 a 25 maisons seraient
construites en groupes et assignees a des groupes d'habitants compatibles,
elus selon les antecedents regionaux communs et seIon d'autres formes de
relation sociale. On viserait une certaine homogeneite dans Ie profil de la
population de chaque quartier pour proportionner l'identite et la cohesion
sociale. L'institution du waqf pourrait etre retablie pour entreprendre
l' administration des biens communs et pour entretenir les terrains et les
batiments publics.
En ce qui concerne les autres espaces :
Rendre a certains batiments leur vocation originale en les
adaptant a I' evolution des nouveaux besoins (rehabilitation des
souks,junduqs, madaris, etc.).
Reanimer, equiper, restructurer certains poles fonctionnels
d'interet general (bazars, junduqs, structures de production
artisanale, etc.).
Ces mesures globales peuvent etre accompagnees par des interventions
ponctuelles ou specialisees qui visent specialement certains espaces comme :
I '
MUTATIONS ET IDENTITE 206
La mosquee
Dans sa conservation dynamique il faut prendre en consideration
beaucoup d' elements comme :
La revivification de l'usage traditionnel de la mosquee non
seulement comme lieu de culte, mais aussi comme centre des
activites educatives et sociales.
- Sa localisation et son integration dans l'ensemble urbain. II faut
respecter la position centrale qu' elle a toujours occupee a l'interieur de l'ensemble urbain, en eliminant ce qui pourrait la
cacher de la vue.
Lehammam
Bien que les equipements necessaires au bain et a J'hygiene
personnelle aient ete incorpores dans les maisons modestes, Ie hammam
(bain public) reste toujours un equipement important. Le Sauna et d'autres
equipements sanitaires peuvent etre incorpores au hammam pour offrir un
equipement sanitaire complet a l'echelle du voisinage. Le sens social de ce
genre de facilite ne peut pas etre sous-estime.
D'autres espaces publics comme Ie maydan, les musallas, les petites Q
places et les fontaines d'eau sont encore des elements utilisables a l'interieur
de la cite islamique contemporaine.
I. \
l '
MUTATIONS ET IDENTITE 207
De toute fafi:0n, ces differents genres d'interventions doivent etre
accompagnes d'une politique de sauvegarde et d'arrangement des elements
caracteristiques du patrimoine architectural (fontaines, mosquees, portes
urbaines, etc.).
On avait en plus besoin de plus d' effors pour Ie controle de la
speculation. Les mesures non-physiques peuvent etre utiles pour unir la
valeur declaree de I' etat reel a la quantite des tributs de la propriete, ainsi que
pour faire remarquer que la valeur tributaire de la propriete peut etre
expropriee a n'importe quel moment. Ceci donnerait des revenus plus eleves
aux mairies, tout en rendant anxieux les proprietaires interesses par la juste
contribution de leur propriete. Les mesures d'attraction positives, comme les
escomptes tributaires, pourraient etre utilisees pour assurer l'usage optimal
de la terre, selon Ie concept islamique de la propriete.
Finalement, nous pouvons de cette maniere conserver Ie caractere
original des noyaux traditionnels, en maintenant les concepts du dessin
urbain traditionnel hautement representes dans I' articulation de leurs espaces
fonctionnels differents et dans leurs configurations optimales concernant les
aspects climatiques et sociocultureis. Bien que Ia cite islamique
traditionnelle ne soit pas Ie paradis perdu(2S), une grande tradition urbaine est
un recours qui merite d'etre promu. Avec un peu plus de sensibilite dans
I' etablissement et Ie dessin urbain, Ies projets modernes pourraient etre plus
en harmonie avec I'heritage islamique. ,
I ,
CONCLUSIONS 209
CONCLUSIONS
1. L' etude a reflete que la loi islamique, a travers ses regles - al fikh -
constitue la base commune qui regulait tout l' entourage physique et
l'organisation spatiale dans toutes les cites islamiques, et qu'elle a ete Ie
facteur principal dans I' apparition des ces similarites impressionnantes
malgre les differences climatiques et geographiques.
II a ete demontre que les reglements urbains islamiques en relation avec Ie
principe de l'intimite, la loi hereditaire islamique et l'usage du fin a ,
constituent les veritables elements organisateurs de l'espace urbain dans
la cite islamique :
- Le pnnCIpe de l'intimite conditionne l'organisation spatiale de
la maison et affecte substantiellement la variete de la forme
urbaine pour toutes les parties de la cite.
- La loi hereditaire islamique est une des causes de l' apparition
des rues tortueuses et labyrinthiques de la cite islamique
traditionnelle.
- Le concept du fina ' qui considere I' espace exterieur ouvert situe
autour ou tout au long d 'un batiment comme un espace semi-
( .
CONCLUS IONS 210
prive, collectivement propre, donne une raison importante au
developpement d'un grand nombre de portes a I'interieur de
tous les quartiers des cites islamiques traditionnelles.
D'autre part, la flexibilite dans I'application des regles islamiques dans
l'environnement urbain quand il s'agissait de l'interet public a affecte de
fa~on importante la forme des rues, dfi au fait que dans presque toutes les
cites islamiques certaines rues ont ete partiellement appropriees et des ruelles
ont ete completement fermees.
2. En ce qui conceme Ie theme de I' organisation urbaine, on a remarque
I' existence de trois caracteristiques determinantes qui sont :
- La forte differentiation et separation entre les deux domaines :
public et prive.
- L' organisation de I' espace de I' interieur vers I' exterieur (depuis
la maison vers la rue).
- La centralisation et la convergence vers un element principal qui
est la grande mosquee. A partir de cet element, un squelette
urbain multifonctionnel s' organise, constitue par des voies
pietonnes principales OU s' entremelent differentes activites:
souks, funduqs, ecoles, bains, etc., jusqu'a arriver aux portes des
cites ou se trouvent les surfaces de production. Des deux cotes
CONCLUSIONS 211
de ce squelette s'etend un tissu constant d'habitat dense et servi
par un reseau routier tortueux et irregulier.
3. Dans I' etude de l' espace urbain, de ses elements et des ses fonctions
symboliques, on a vu que meme si Ie style peut changer d'une cite a une
autre et d'une epoque a une autre, chaque cite musulmane est formee des
memes genres d'espaces fermes interieurs et d'espaces publics ouverts
qui se repetent en elle et qui s'organisent selon des principes analogues.
- Le patio de la maison represente I' espace veritable et reel de la
culture de 1 'Islam. Son adoption par Ies musulmans comme
element d' organisation de tous les espaces fermes a ete la
consequence de beaucoup de facteurs, specialement les facteurs
climatologiques et socioculturels.
4. Les grands changements qui se sont produits vers Ia fin du XIXe s. et Ie
debut du xxe, ainsi que la croissance des villes islamiques selon Ies
modeles etrangers ont contribue a la perte de I' identite de I' espace urbain
et a la nlpture du style de vie de ses habitants, provoquant des dualites
fortement marquees dans tous Ies aspects de la vie de la ville.
La proposition de sauvegarde de la cite islamique traditionnelle a
dans cette these consiste a reutiliser Ie patrimoine urbain a des
fins socioculturelles et touristiques. C' est -a-dire, la
rehabilitation du tissu, la conservation, Ie developpement des
r
CONCLUSIONS 212
activites locales et Ie maintien de la population dans de
meilleures conditions de vie, tout en respectant toujours la
typologie, la morphologie de la trame urbaine et Ie caractere
original des noyaux traditionnels.
5. Enfin, on peut poser une question importante: Comment pouvons-nous
appliquer ce grand heritage et ces concepts urbanistiques islamiques dans
la cite islamique contemporaine? Comment agissons-nous pour eliminer
cette nostalgie que l'on sent en marchant dans les nouvelles cites
islamiques? En d'autres termes, comment pouvons-nous planifier de
nouvelles cites islamiques qui repondent en meme temps aux be so ins de
la vie modeme et aux modes et styles de vie de ses habitants?
Bien que pour repondre a cela il faille faire de nouvelles recherches, nous
pouvons dire que la clef reside dans l'introduction de valeurs
socioculturelles dans Ie mecanisme legal actuel et dans les institutions
urbaines en relation avec l'administration municipale.
I ~
r .
SYNTHESE BmLIOGRAPmQUE DES JURISTES MUSULMANS CITES
- IBN' ABD AL-RAF', ABU ISHAQ, IBRAHIM: Le grand juge de Tunis. I1 vecut et mournt a Tunis en 1333.
- IBN AL-IMAM, 'ISA B. MUSA B. AHMAD B. YUSUF B. MUSA B. KHASHAB: Connu aussi comme ABU AL-ASBAGH: I1 naquit a Tolede, il etudia a Cordoue et Qairawan on il mournt en septembre 996.
- IBN AL-MA1ISHUN, 'ABD AL-MALIK B. ABD AL-'AZIZ: Un etudiant de Malik, il vecut a la Medina et mournt en l'an 828.
- IBN AL-QASIM, ABD AL-RAHMAN: Un etudiant de Malik, il mournt au Caire en l' an 807.
- IBN AL-RAMI, MUHAMMAD B. IBRAHIM AL-LAKHMI, ALBANNA' : Un etudiant du grand juge, Ibn 'abd al-Rafi, de Tunis, expert en matiere de construction. I1 vecut et mournt Ii Tunis en 1334.
- IBN NAFI' : I1 mournt en I'an 827.
- MALIK, MALIK B. ANAS B. MALIK B, ABI 'AMIR AL 'ASBAHI AL-Y AMANI: Chef de I'ecole Malikite, il naquit a la Medina en 712, vecut la-bas et mournt en l'an 795.
- MUTARRIF: Etudiant de Malik, il mournt a la Medina en l'an 835.
- SAHNUN, ABU SA'ID, ABD AL-SALAM B. SA'ID AL-TANUn : Un etudiant de Ibn al-Qasim, il vecut en Afrique du Nord et y mournt en l'an 854.
( I
\
'.
I3mLlOGRAFIA 215
BIBLIOGRAFIA
ABDELKAFI JELLAL: La Medina de Tunis. Presses du CNRS. 1985
2 ABDELWAMAB BOUMDI5A, CMEVALIER DOMINIQUE: La Ville Arabe dans
I'Islam. Mistoire et Mutacions. Actes du 2 eme colloque de I'A.T.P. Carthage
Amilcar-I 2-18 Marzo 1979 .
.3 ABDULAM SAMIR, PINON PIERRE: Maisons en pays Islamiques. En:
ArchitectLire d 'Aujourd 'hui. 197 3;sep/oct( 169): 6-15.
4 ABU-LUG MOD JANET: C<1iro: Perspective and Prospectus. En: From Madina
to Metropolis. Meritage and Change in the Near Eastern city. Brown L.
C.(ed.) The Darwin press. Princeton. 1973: 95-113.
5 ACMOUR SAID: AI- Mayat AI-Ijtimaiah fi al Madina AI-Islamiah (La vida social
en la ciudad islamica). EN: Revista Alam al -Fil,r. 1980; I (II ):88-100.
6 ALAM MANZOOR: Ibn I,halddun 's concept of the origen, grouth and decay
of cities. En: Islamic Cultures. 1960; 34:90-106.
7 AL- ASM' AB KMALlS: Asalat al-madina al-arabiyah wa al -Maayer al muasira
Ii tajtitiha (tile arab -city: traditional and contemporary criteria for its
planning). En: Afaq Arabia. Bagdad. 1977: 1 (3):34-43.
8 AL-AZZAWI SOUBMI: A comparative study of traditional courtyard houses
and modern non courtyard houses in Bagdad" Phd dissertation school of
environmental studies. University college London. 1984.
9 AL-JARSIFI 'UMAR B. 'UTMMAN B. AL-' ABBAS: Risalat al- Jarsifi fi al-Misba.
10
En: Thalath Rasa'il Andalusiah fi Adab ai-Mis bah wa-al-Muhtasib. Levi
ProvencClI E.(ed.). Cairo. 1955.
ALLIATA V.: Le Case del Parcldiso. Milano. 1983.
II AL-MAWARDI: AI-Ahl<;ClIll al-SutClniah. Cairo. 1909.
12 AL-YA'QUBI A.: KitClb al-Buldan. Leidell. 1860_
13 ALSAYYAD N[ZAR: Cities cllld Ccllirhs. Greenwood press. Estados Unidos.
[
(
l
E)IBLIOGRAFIA 216
1991.
14 ALUCH ABDELKRIM: Org;'lI1isClcion de las Ciud<ldes en ellslal11 Espanol. En:
Miscelanea de Estudios Arabes y HebrC'licos. Universidad de Granada.
196 I; I (X): 40-55.
15 ARDLAN NADER. BAKI1TIAR LAlLA: The Sense of Unity. University of
Chicago Press. 1973.
16 AZMEHT AI·AZIZ: What is the islamic islamic city? En: Review of Middle
E<lst Studies. 1976; 2: 1-12.
17 BAMMATE N.: La ville dClns L'lsl<1l11. En: La Ville Arabe d<1ns l'lslam. Histoire
et Mutacions. Bouhdib;-l A., ChevC'llier D. (eds:) Actes du 2 el11e colloque de
I'A.T.P. Carthage AllliIGlr-12-18 MC'lrzo 1979: 27·37 .
18 BARRUCAND MARIANNE: lJrbanjsme princier en el Islam. Librairie
orientaliste. Paris.
19 BENET F.: Tile Ideology of Islam Urbcmizatioll. Ell: International Journal of
ComparC'ltive Sociology. 1963; IV: 2 I 1-226.
20 BERARDI ROBERTO: Lecture d'une ville:la Medina de Tunis. En:
Architecture d' Aujourd'iwi. I 970(Dec./Jan.); 153: 38-43 . , 21 BERARDI ROBERTO: Significacion du Plan Ancien de la Ville Arabe. En: La
22
23
24
25
Ville ArC'lbe d<lns l'lslam. t'listoire et Mutacions. Bouhdiba A., Chevalier D.
(eds.) Actes du 2 ellle colloque de I'A.T.P. Carthage Amilcar-12-18 Marzo
1979: 165-191.
BERARDI ROBERTO: Espace et Ville en Pays D'isiam. En: L'Espace Social
de la Ville Ar<lbe. ChevCllier Dominique (ed.). Paris. Maison neuve et Larose.
1979: 99-120.
BERGER MORROE (ee1.): The New Metro;::,oli c in the Arab World_ London .
1960.
BERGER r-10RROE (eeL): Tal<.htit al-Mudun fi <11-Alam aI-Arabi (City Planning
in the Ar<1b World). International Association por CulturC'l1 Freedom alid the
Egyption Society of Engineers. Cairo. 1964.
BN-TALAL PRINCIPE HASSAN "JORDANIA": Message to the Internatipnal
Cultural Founc1cltion's Symposium ~m the Middle-[astern City. EJi: The
Middle'[;-lslern City. Saqqaf a. (ed.). New Yorl,,: ParC'lgon House. 1987.
26 BONIN[ M IC~IAEL [.: Cities of Oil and MigrClnts: Urbanization and Economic
" -
r
I
l
. -
t .
l
BIBLIOGRAFIA 217
Ch<lnge ill the Arabi<-lll Peninsula. En: The Proceedings of International
Conferen ce on Urbcll1isll1 in Islc-1111. Tol\yo. 1989; Vo1.2: 340-354.
27 BOUHDIBA A.: Duree et Changell1ent dans la Ville arabe. En: La Ville Arabe
dans I'Islal11. Histoire et Mutacions. Bouhdiba A., Chevalier D. (eds.) Actes
du 2 eme colloque de I' A. T. P. Carthage Amilcar-12-18 Marzo 1979: 17-26.
28 BROWN l. CARL (ed.): Froln Madina to Metropolis. Heritage and Change in
the Near Eastern city. The Darwin press. Princeton. 1973.
29 BROWN KENNETH: The Uses of a Concept: The Muslim City. En: Middle
Eastern Cities in Comparative perspective. Franco-British Symposium.
1984. Brown Kenneth. Jole M., sluglett p., Zubaida S. (eds.). Ithaca Press.
London. 1986: 73·8 I .
30 BRUf:iSCHVIG ROBERT: Urbanisme medieval et droit musulman. En: Revue
des Etud es Isl<1llliques. 1947; XV: 127-155.
31 CASTEJON R.: Cordoba Calif<ll. En: Boletin de la Real Academia de
Cordoba. Cordob<'l. 1929: VIII
32 CAHEN c.: Y a-t-il· eLi des corporations profesionnelles dans Ie monde musulll1an classique ? Ell : The Islamic City. Hourani A. H., Stern S. M.
(eds). Bruno Cassier. Oxford. 1970: 51- 64.
33 CANTACUZINO SHORBAN. BROWNE KENNETH: Isfahan. En: The
Architectur<ll Review. 1976; May(special issue).
34 CLERGET MARCEL: Le C<lire: Etude de Geographie et d'Histoire
Economique. Paris. Paul Geutllllcr. 1934.
35' COUSINS ANDREA. DETHIER JEAN ETAL: L 'Esprit d 'un Habitat:
Architecture et urb<'lI1isllle tradicionals d 'Algerie et de Tunisie. la Galerie
de la Madeleine. Brussels . i 966.
36 CHALMETA PEDRO: Orgc-lIlizacion Artesano-Comercial de la Ciudad
Musullll<lna . En: Silllposio Internacional sobre la Ciudad Islamica.
Institucion Fernando el Catolico. Zaragoza. 1991: 93-1 I \.
37 CHALMETA PEDRO: Los Mercados. En: La ciudad Islamica. SERJEANT
R.B.(ed.). Serbal/Unesco. 1982: 13\-143 .
38 CHEVALIER DOMINIQUE (cd .): L'Espace Soci<ll de la Ville Arabe. Paris.
Maison neuve et Larose. 1979.
'.
. 1 ,
r 39
BmLIOGRAFIA 218
CHEVALIER DOMINIQUE: S(-1119 des Villes, Sang des Peuples. En: La Ville
Ar(-1be dans 1'lsl<lIn. liistoire cI [,'lut<lCiolls. Bouhdiba A., Cllevalier D. (eds.)
Actes' elu 2 crne colloquc dc I' A,T.P. Carthage All1ilcar-12-18 Marzo 1979:
541-554.
40 CHEVALIER DOMINIQUE: Un titre Cllnbigu pour des Ilormes reelles. En:
Middle EClstern Cities in ComparCltive perspectivc, Franco-British
Symposium. 1981L f3rown /\enl1etil, Jole M., sluglett p., Zubaida S. (eds.).
Ithaca Press. London. 1986: 83-89.
41 CHUECA GOITIA F.: EI UrbClnislllo Islamico. En: Vivienda y Urbanismo en
Espalia. Banco HipotecClrio de Espalia (ed.). 1982. 83-103.
42 CHUECA GOITIA F.: La Ciudad Islillllica: En: Breve Historia del Urbanismo. Alianza editorial. Madrid. 1981 ;
43 CHUECA GOITIA F.: Sp('Ul ish-lsl;llllic Arch itecture.lnstituto C,:,lturallslillllico.
44 CHUECA GOITIA F.: Inv<lri<1IlIes C<'lstizos de la Arq-uitectura Espanola,
Editorial Doss<lt S.<1. i"1<ldrid. 1981.
45 DAVID JEAN-CLAUDE: Les QlI<Tdicrs Anciens dans la' Croissance Moderne
de ' Ia ville D' Alep. En: L'Esp<lCc Social de 13 Ville Arabe. Chevalier
Dominique (ed.). PClris. 1'1C1ison neuvc et Larose. 1979: 135-144.
46 DICKINSON r,OBERT E.: The Western EuropeCln City. London. 1951: p.273.
47 ECOCHARD MICHEL: Des \lilies Anciennes ei de L'Urbanisme
Contemporain. En: L'Espace Social de ICI Ville Arabe. Chevalier Dominique
(ed.). Paris. 1'1aison neuvc et LMose. 1979: 309- 318.
48 EGLI ERNEST: Climate and Town Districts. Consequences arid Demands.
ZUlich. 195 I: p. 18.
49 ELlS5EEfF NIKITIA: EI TrClz<lclo Fisico. En: La ciuclacl IslEunica. SERJEANT
KB.(ed.). SerbClljUnesco. 1982: I 13-129.
50 ELlSSEEfF N,: Damas Clla LUlllierc dcs Theories cleJean Sauvaget. En: The
Islamic City. HourClni A. Ii., Stern S. 1"1. (eels). Bruno Cassier. Oxford. 1970:
157-178,
51 EPALZA M II\EL: Espacios y sus !-'unciones en 1<1 Ciuclacl A,rabe. En: Simposio
InternacioJ)<ll sobre la Ciucl"'ld Isli'lillica, Institucion FernClndo el Cat6lico.
ZaragozCI. 1991: 9<30.
'-
.'
'.
BIBLIOORAFIA 219
52 ESCOBART CAMACHO J.: Cordoba en la Baja Edad Media: Evolucion
Urbana de la Ciudc-ld. Cordoba. Caja Provincial. 1989.
53 ETTINGHAUSEN It: Muslim Cities: Old and New. En: From Madina to
Metropolis. HeritClge and Change in the Near Eastern city. Brown L. Carl
(ed.). The Darwin press. Princeton. 1973: 290-318.
54 FATliY HASSAN: Constancy, Transposition and Change in the Arab City. En:
From Madin<l to Metropolis. 11erit<'lge and Change in the Near Eastern city.
Brown L. Carl (ed.). The Darwin press. Princeton. 1973: 319-333.
55 FATHY HASSAN: The Arab house in the urban setting: Past, Present and
Future. Fourth Carreras Arab lecture at the University of Essex. Longman.
London. 1972; 1970 (3 November).
" 56 . FATHY HASSAN: Ta'syl al·Qie-lm al-Islamiah fi Atjtit wa ai-Amara al-Muasira.
En: Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islillnicos en Madrid. Madrid .
1983-84; XXII: 29-35.
57 fATHY 11ASSAN: ell ulla entrevista COil Yoricl<; Blumenfeld. En: Architectural
Association Quartly. 1972; 6: 302-31 I.
58 FRANKFORT H. : Town plc-llllling in ancient Mesopotamia. En: The Town
Planning Review. 1950Uulio); 2(XXI): 98-115.
59 FUSARO F,: La Cittc'l Islamica. Bari. 198LL
60 GALANTAY ERVIN Y.: Islamic Identity and the Metropolis, the search for
continuity. En: The Proceedings of International Conference on Urbanism
in Islam. Tol<;yo. 1989. (I): 2-23.
61 GALANTAY E.Y. (ED.): The Metropolis in Transition. New Yorl<;: Paragon
House. 1988; 389-404.
62 GALANTAY E. Y.: New Towns. New YOlk g.Braziller. 1975.
63 GARCIA GOMEZ E.: Notas sobre la Topografia Cordobesa en los Anales
Pale-ltinos por Isa Razi. En: AI-Andalus. 1965; XXX.
64 GARCIA GOMEZ E.: Algun3s Precisiones sobre la Ruina de la Cordoba
Ollleya. En: AI-Andc-llus. 1947; XII.
65 GAUBE 11EINZ: Iranian cities. New Yorl<; university press. 1979.
66 G RUNBEAUM GUSTAVE VON: Tile Muslim Tmvn and the ~lellenistic Town .
r
t·
l
67
BmLlOGRf,FIA 220
En: Scient<'l. 1955; p.36 /-f-370 .
GRUNEBAUM GUSTAVE VON : Th e stucture of the Muslim Town. En: Islam:
Essays in the Nature (-1t)d Growth of a Cultural tradition . Memoiris of the
American Anthopologicnl Association. 1955; 81: 141-158.
68 GRABER OLEG: Cities and Citizen. En: Islam and Arab world. Lewis(ed.) .
1976; p.89 .
69 HAKIM BESIM 5.: Arab-Islcllllic Cities. KPI. London. 1986.
70 HAKIM BESIM 5., ROWE PETER G.: The Represntation of Values in traditional and contclllpOr<lIY Islamic Cities. En: Journal of Architectural Education . 1983; Lj ( 136):22-28.
71 HAMDAN GAMAL: The pattrell Illedieval urbanism iq the arab world. En:
Geography. 1962 ; 47:121-131-f .
72 HAMMOND j\1ASON: The City ill the Ancient World. Harvard. 1972: 342-
358.
73 HERZFELF ERNEST: D"lInasclls : Stl'/dies ill Architecture. En: Ars Islarnica. 19L~2; VoI.IX: I-53, 1943; VoI.X : 13-70 Y 1946; Vol. XII : 1-71.
74 HORANI ALBERT: Historia de los Pueblos Arabes. Editorial Ariel. Barcelona. 1991
75 HOURANI A. H., STERN S. M. (eds): The Islamic City. Bruno Cassier.
Oxford. 1970.
76 HOURANI A. H. : The Islamic City ill the Light of Recent Research. En: The
Islamic City. Hourani A. H., Stern S. M. ·(eds). Bruno Cassier. Oxford. 1970:9-24 .
77
78
79
1131511' YUSUF: Las Instiluciolles Economicas. En: La ciudad Islamica.
SERJEANT R.B. (ed.). Serb<-li/Ullesco. 1982: 145-159.
IBN AL-IMAN: Manuscrito de Algeri<l. AI-mal~taba al-watalliyah. No: 1292.
Traduccion fr<-1tlcesa: BARBIER: Des droits el obligations entre propietaire
d'herit<lge voisin . En: Revue Alqerienne et Tunisienllc de Legislation et de
Jurisprudence. 1900- I 90 I .
IBN rIAWQAL: ConfigUl(ltioll de 1<'1 tene (I\ilab Sural nl-Ard). Trad. por J. H.
Kraillcrs y G. INiet. ['>eyrouth- P<-lris. 1964 (2 vals.)
r. 80
BIBLIOGRAFIA 221
IBN 11AYYAN:(NuqtalJas) EI Califato de Cordoba. En: Anales Palatinos del
Califato de Cordoba al-Hal~clll1 II, pOl' Isl'l 5. Ahmad al-Razi . Trad. por E.
Garcia Gomez. Sociedcld de Esturlios y rublicaciones. MCldrid. 1967.
81 IBN IYAS: 5ada'i' al-Zuhur. Cairo. 189'f; Vo.lIl: 171-177 . Citado por 'ABO
AL-WAHHAB. En: T<'I\<.htit al Q<-li1ir(lh W<J Tanzirnuha Mundllu Nash'atiha.
Cairo. 1957: p.12-13.
82 IBN AL-RAMI: Kitab <'I1-l'Ian bi-<'Ihl~all1 al-5unian. Manuscrito de Rabat. Dar
al-Khizanzh al-' Amll1ah. N. A8 '.!2834 .
83 IBN KHALDUN A.: Los Prolegoll1enos. Traducido por SLANE. Paris. 1858.
84 IBRAHIM S. E.: Cairo: a SociologiG~1 Profile. En:Coping with urban Growh
in C<liro. The Aga Kh<'ln award. 1984. Ref. 20: 373-402 .
85 ISMAIL ABDEL-FATTAH: Origen,ldeology and Physical Patterns of Arab
Urbanization. Dr-ing-dissertation. faculty of Architecture. University of Karlsruche_ 1969.
86 ISSAWI CHARLES: Economic Chr1l1ge and Urbanization in the Middle East. En: Middle Eastern Cities. Lapidus Ira M.(ed). University of California
Press. Berheley. calif. 1969: 102- I 2 I .
87 JIM ANTONIOU: Islamic cities and conservation. The Unesco Press. 1981.
88 JINNAI HIDENOBU: Microcosm of the family life <lround the court yard_ En:
The Proceedings of InternationC11 Conference on Urbanism in Islam. To),yo.
1989; supl: 392-425.
89 KIJIMA YASUFUMI: Street Networ\<.s and Open Space in Islamis Cities. En:
The Proceedings of Intern<'ltional Conference on Urbanism in Islam. Tokyo.
1989; sup: 315-355.
90 KOJ) YAGI, TALA) HAMID: Integrated Spatial Systems of Urb<ln Dwellings in
Islamic Old Cities. En: The Proceedings of International Conference on
Urbanism in 151<'1111. Tol~yo. 1989; vol.2: 532-543.
91 KURODA TOSHIO: Priv<'lcy in Isl<'lll1ic World. En: The Proceedings of
International Conference on Urb(,lI1isll1 in IsIClm. To\<'yo. 1989; vol.sup: 299-
311.
92 LAPIDUS IRA M.(ed).: Middle [;'lslern Cilies. Universily of CCllifornia Press.
Berl~eley . calif. 1969.
t·
93
94
l'SmI.lOGRAFIA 222
LAPIDUS II\A M. (ed).: Muslim cities in the l(lter Middle Ages. Harvard -LJlliversily Press. C1111hridgc. 1967.
LAFIDUS II\A P. : Tr<1diciollrll ~111Slilll Cities: Slructure Clnd Change. En: From
Madin<1 to Metropolis. 11eril<lge r1l1d Change in the NeClr E(lstern city_ Brown
L. Carl (ed.). The O,1nvill press. Princeton. 1973; 51-69.
95 LAROUI A.: The Crisis of the Arc1]) Intellectual, Tradition<1lism or Historicism
? Berheley: Univ. of Californic1 Press. 1976.
96 LEVY Pf{OVENCAL [ . (cd.): "1'11,11<-1111 Rasa'il Andalusiah fi Adab al-Hisbah wa
al-Muhl<lsib. Cairo. 1955.
97 LEVY PI,OVENCAL [.: 1.,15 ciud<1des y las in5tiluciolles urbanas del
occidellte musullll;-ll) ell 1<1 eeL-lei media. Edit. Mal roqui. Tctu<ln. 1950.
98 LEVY PROVENCAL [_: f:~p(~11a ~lusull1lana . Instituciones y Alte. Vots. IV y
V de 1<1 Historia de [SprlI1cl. Dirigid<l por R. Menendez Pida\. Espasa-Catpe.
Madrid. 1965.
99 LEZINE ALEXANDRe: Deux Villes D'ifriqiya: Sousse. Tunis. Librarie
OrientCllisle Paul Gcuthllel. F'lris.
100 llEWELLYN O . 5.: The ObJeclives of Islamic law. En: Ekistics.
Ene./Feb. I 989;n'2 280.
101 MALlI\ Sal1nun's cOl11pilCllion: AI-Mudmvwanah. Cairo. 1905; 16 votumnes.
102 MARCAIS GEORGES: L' Urb<lllisll1e ll1usulman . Cinquiell1e congres de la
federation des sociclcs savtliltes de I' Afrique du Nord. Alger. 1970: 13-34.
103 MARCAIS GEORGES: la concqKion des villes dC1ns I'Islam". En: la Revue
d'Alger. 1945; vol II : 517-5.3.) .
104 MARCAIS GEORGES: L'Arl ~lL1sullll;-1))e. Presses Llniversit<lires de France.
Paris. 1962.
105 MARCAIS WILLlA~1: L'lsl<llllisllle el 13 vie urbaine. Comptes rendues des
seances dc I' Academic des inscriptions et Belles-l.ettres. 1928: 86-100.
106 MARIN MANUEL.A: CiCI1(iCl. [1l5CI-1;-1))Z<1 y Cuitur<l ell l<l Ciudad Islal1lica. En:
Silllposio Intern<lcion·,,1 sohle 1,1 Ciucl<lO Isl<'lmic;-l. Illstituci6n Fernando el
C<lt6Iico. 2al"<-190z;-1. 199 I; I 1,)- I 3,).
107 MARHI[LOT FIEI{f\[: l~ccIH : r(l1c [)'ldclllitc ct Mul<llioll Urbaine: L'Exelllple
'.
( I _
\ I
[~mI.lOCif\AFlA 223
du CClirc. Ell: Rcvue <lc L'Occiclcnl MusullllC1n et de la Mediterrance.
MClrseille. 2'.! sCll)cstrc 197'1: 18: I I 1·1 18.
108 MASSIGON S.: ExplicC1lioll du PICln de J<'L1fa (IrClI~). Ed. POI''' MelClnges
Maspcro III",Mellloires de L'lnstitut Francais d'Archeologie Orientalc du
Caire. Cairo. 1935
109 MICARA L.: Architctturc c SpilZi deW Islam. ROl11a. 1985.
110 MICHELL G.: La Arquitcctura del Mundo Isli'lmico. Alianza Editolial. Madrid.
1985.
II I MICHON JEAN LOUIS: Instiluciones religiosas. En "Ia ciudad islamica".
SERJEANT I\.B. (ed). Serb <l ljUnesco. 1982: 17-47.
112 MIEI\O 1'1IYAJI : Modcrn Muslilll City and Family Change: A Tunisian Case.
En: The Procecdings of Interncltional Conference on Urbanism in Islam.
Tol~yo. 1989; Vo1.2: 296·327.
113 MOUSAOUI 1"10USTAFA: AI·Aoucllllel al·Tarijiah li·NClChClt wa Tatawer al
nludun ClI·Arabiah <'I1·lslc1l11i,)h (los factores historicos del desarollo de las
ciudades islalllicCls). D<lr al·r<lchid li·N<lcher(cd.). 1982.
I 14 MSEFER JAOUAD: Villes Islallliqucs: cites d'hier ct d'aujourd' hui. Conseil
IntertlClCional dc l<l LanguC'l Fral1C<lise(ed.). Paris. 1984.
115 MUDDATillR ARDEL-RAI-IIM: Institucioncs Juridicas. En: l<l Ciudad Islamica.
SERJEANT R. B. (cd). ScrhaljUncsco. 1982: 49·61..
116 NADIN NAWAL EL-MESSII\I: Chc1l1ging Life Styles in Cairo. En: The
Proceedings of International Conference on Urbanism in Islam. Tokyo.
1989; supl: 112·127.
I 17 NAJI ABDEL-JABBAR: AI'llledina <ll·Ar~bia fi .li·Dir<ls<'lt al Ajnabiah" (La
Ciud<ld Islalllic<l en los Estudios Extranjcros). En: AI·Mawrid. 1981; 4: 136-
170.
118 NAJI ABD[L·JABI,)AR: MarhoUlll al· 1'1<ldin<l al·lslallli'lh (Concepto de la
ciudad islamica). En: Revue AI·Madin<'l <'l1·Ar<'lbi<lll. 1984; 15: 58-62.
119 NAJI ABDEL-JABBAR: 1'1<'lrholllll cll·M'ldina al·lslallli'lh (concepto dc la
ciud,ld isl,1Illica). En: l,cvuc AI-Mc1clinc) ;-ll·Ar;-lbiah_ 1984; 16:' 64·66.
120 OUM LlL ALI: Ibn I\haldun cl 1;-1 Societe Urb;-line. En: L<l Villc Arabe dClns
1'151 ;-1111. I-lisloirc ct 1'1utaciolls. [)ouhdiba A., Chevi'llici D. (cds. ) Actes du 2
l
51 nl_IOOI\ .. ,\fli\ 224
eme colloque de I' A.T. f. C<'lI\ll;-l~IC PIlllilcar-12-18 Marzo 1979: 39A4.
121 ORTEGA Y GASS[T: Ibn JaldLII1 nos revel?! el secreto. Ell: EI Espectador.
1934; VIII Obras complelas. 1.11: 661679.
122 OSMAN MOUHAMED A[~D-[L SATIAI\: AI-Madina AI-lsl(lllli<1h. Ell: Alalll al
Maarifa. 1988; N. 128
123 PAUTY EDMOND: Villes spontannecs e\ villcs crees en IsIClIll. En: Annales
de I'lnstitut d'etudes orientales. 1951; vol.XI: 52-57.
124 PELLETIER J .. DELFANTE CH.: Les Villes IslClll1iques. En: Villes el
UrbClnisllle dans Ie 1\10nde. M<'lsson. Paris. 1989_
125 PLANHOL XAVIER: Tile World of 151(1111. New Yorl,. 1959: 8-29 .
126 PRISSE D'AVE.NNES: L' Art Ar<lbe D' Apres les Monuments du Kaire. Paris.
127 RAYMOND ANDRE : The Ore;'lt Arah Cities. Ncw Yorl, University Press. New
Yorl, and London. 1984_
128 Registros de los trihllllalcs cle [\1edillC1: R. I LIO. p. 42 . Caso N~.252. Fechada
10/4/1242/1826. Y R. 140. p.~)2. Caso N!!. 543. Fechada
18/11/124LI/1829.
129 REVAULT J.: fal(lis el DellleLllcs de TUllis (16-17 siecles). Paris. 1980.
130 REVAULT J., MAURY 5.: Palais et l11;-lisons du C<lire. Cairo. 1975.
131 SALEH All liATHLAUL: Tradition. Contilluity and Change in the Physical
Environl11ent: the Arab Muslim City. Phd. D.Submitted to the Department
opf Arhitecture Cl't M.I.T. 1981.
132 SAUVAGET JEAN: Esquisse d'ullc hisloire de 1<1 ville de Dalll<ls. En: Revue
des Etudes Islclilliques. 1934: 421-480
133 SAUVAGET JEAN: Les I'-'lonumellts I'listoriques de D<l111 <1S. Il1lprimerie
Catholique. Beyroulil. 1932.
134 5CHLEIFFER A.: Islcllllic Jerlls(llclll . [11: The [\liddle-Easlern City. Saqqaf A.
(ed.). New Yorl, : P;-lra~IOn t1ollsc. 1987: 163-176.
135 SERJEANT 1\,IS,(ccl.): 1.;-1 Ciudac1ls1c-ll11icc-1. SCl'bClI/Ullcsco. 1982.
136 SH1BER SAI)/\ (I.: Ibll-/\hc-llclull: All 1':c-11Iv Towll PI(-lllllcr. Tile Middle East
'.
r
t .
225
Forum (cd.). [kilut. 1962 .
1.37 SHrBER SABA G : Flc11llling Needs <mel Obst<lCles. En: Tile New Metropolis
in tile Arab \"lorlc1. [kl~Jcr f\1orroc led . ). London. 1960: 166- 188.
138 TORRES BALBAS L.: Ciuelrldes I·jispano-Muslillalles. Ministerio de Asuntes
Exteriores ,Dil eccioll gener<ll etc relaciones culturilles, Instituto Hispano
Arabe de cultura.
139 TORRES BALI3AS L.: Les villes Il1USUllllnnes d'Espilgne et leur urbilnization.
En: AllIl<lles de I'lnstitut des Etudes Orientales. 1947; Vol 6: 5-30.
140 TORRES BALBAS L. : D;lI11nSCO y Grilnndn. En: Revistil AI-Andillus. 1941; VI:
461-469 .
141 WAHBA RAFt1AIL: CliiO. En: The New Melro[)olis in the Alrlb Wortd. Berger
Morroe (ed.). Loncton. 1960: 23-27.
142 WAGSTAFF J.f\1 .: The Origin <lnd Evolution of Towns. En: The Changing
Middle Easterll City. G.rl. BALKE, R.J.LAWLESS (cds.). London: Crown
Helm. 1983.
143 WARREN J ., fETt11 I. : TICldiciollal I-Iollses in Bagd<ld. Horsham. 1982 .
144 WHEATLEY PAUL: Levels of space Cl\Vareness En: tile Trilditional Islamic
City. EKISTICS. Die. 1970: 354-366.
145 WIRTli EUGEN: Villcs Islaillique, Villcs o.rientales? Une Probleillatique Face
au Changement. [n: L<I Ville Arabe d<lns I'lslClIll. Histoire et f'1utacions.
Bouhdiba A" Cllev;-1licr D. (eds.) Actes du 2 eme colloque de I'A.T.P.
Carthage Arnilccw-12-18 Marzo 1979: 193-225.
146 WIRTH EUGEN: ConservCltioll or RevitCllize-ltion of the Old City of DCllllascus.
En: Elements sur les Ccnlres-Villes dClns Ie Monde Arabe. Actes du
Symposium illterll<llioll;-ll tenu Cl Tours. Dic.1987. Universile de Tours.
Tours. 1988: 179-1813.
147 WITM ER JOHN: Etuck sur 1'<llllenilgl1lent de lil ville ancienne de Dnrnas par
I'assainisselllent de I'exist<lllt. En: Annales Archeologiques de Syrie, Revue
d'Archeolo~ie el cj'llistoire Syriellncs. 1961-62: Vois 11·12: 19.1J4.
148 WOODFORD J . S.: The City or Tunis. Middle EClSt·y North African Studies
Press Limited. Enqlclild.
149 YANAGI11ACI-IIII.: I.e 1)loit f\lusull11;-lll el i"lilieu LJrbClin. Universily of Tol<.yo.
Bmu OG I,/\fl /\ 226 ----------.-.. - ._------ - - -
Resc(lrch Projcct 011 Islinn. MOl1ogr;'-lpll series. 1"1Clyo 1989; 11" 280
150 ZAI,I ABD EL-R.AI1f'1AN: AIM<ldiIlCl AI·lsl;lllliclll. [11: RcvistCl al-FCllsel!' N.77 :
p.9 l f.
151 ZIYADAH NIQULA: f'1uclull Ar(lbia (ciudCldcs <ll<lbcs). Dar al Taliah. Beirut.
1965.
'.
















































































































































































































































![Les socialistes français vers la société du Care CITE 043 0067[1]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6314f36cc32ab5e46f0d1ba5/les-socialistes-francais-vers-la-societe-du-care-cite-043-00671.jpg)




![Something Darkly This Way Comes: The Horror of Plasticity in an Age of Control [Do Not Cite Without Permission]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631374bc5cba183dbf071b7e/something-darkly-this-way-comes-the-horror-of-plasticity-in-an-age-of-control-do.jpg)