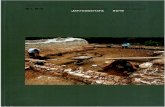L'origine de la métallurgie en Chine
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of L'origine de la métallurgie en Chine
Dialogues d'histoire ancienne
L'origine de la métallurgie en ChineMadame Sophia-Karin Psarras
Citer ce document / Cite this document :
Psarras Sophia-Karin. L'origine de la métallurgie en Chine. In: Dialogues d'histoire ancienne, vol. 20, n°2, 1994. pp. 43-50;
doi : 10.3406/dha.1994.2175
http://www.persee.fr/doc/dha_0755-7256_1994_num_20_2_2175
Document généré le 25/01/2017
RésuméDu 18 au 23 avril 1994, la ville de Sanmenxia (He' nan) a accueilli le troisième congrès internationalsur les débuts de l'emploi des métaux et des alliages (Beginning of the Use of Metals and Alloys,BUMA-3). Comme BUMA-1 et -2, en 1978 et 1986 respectivement, ce colloque a attiré des participantsvenus d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord pour discuter de tous les aspects de la métallurgie :techniques d'extraction, de fonte, de production ; problèmes liés à la préservation d'objets en métal ;analyses métallurgiques, telles que les techniques au radiocarbone et à l'isotope de plomb ; et le rôledu métal et de sa production dans les sociétés de l'Asie à l'Europe ainsi qu'aux Amériques. Le BUMA-3a particulièrement traité de la production du fer.
AbstractFrom April 18-23, 1994, the city of Sanmenxia, He'nan, hosted the Third International Conference onthe Beginning of the Use of Metals and Alloys (BUMA-3). As was the case with BUMA-1 and -2, held in1978 and 1986 respectively, BUMA-3 attracted participants from Asia, Europe, and North America todiscuss all aspects of metallurgy : techniques of mining, smelting, casting ; problems in thepreservation of metal objects ; metallurgical analyses, including radiocarbon and lead isotopetechniques ; and the role of metal and its production in societies ranging from Asia to Europe to theAmericas. The focus of BUMA-3 was on iron production.
Dialogues d'Histoire Ancienne 20.2, 1994, 43-50
L'ORIGINE DE LA METALLURGIE EN CHINE
Sophia-Karin PSARRAS Sinologue non-affilié
Du 18 au 23 avril 1994, la ville de Sanmenxia, aux bords du fleuve Jaune dans la province de He'nan (Chine), a accueilli les participants du colloque international sur les débuts de l'emploi des métaux et alliages (Beginning of the Use of Metals and Alloys, BUMA), convoqué pour la troisième fois. Comme BUMA-1 et -2, en 1978 et 1986 respectivement, ce colloque, bien que situé géographiquement en Chine, a traité de la métallurgie dans toutes les régions, permettant ainsi d'instituer des comparaisons informelles aussi bien que formelles sur le développement, les techniques, l'usage de la métallurgie de société à société. En tant que sinologue, j'ai particulièrement retenu les informations concernant la Chine, mais celle-ci était loin de dominer le colloque.
Parmi les participants, on comptait 40 spécialistes chinois, dont plusieurs associés à l'Institut de l'histoire de la métallurgie à Beijing (Université de la science et de la technologie), mais aussi aux musées, instituts d'archéologie et universités à Nanyang (He'nan), Luoyang (He'nan), Zhengzhou (He'nan), Nanling (Anhui), Xi'an (Shaanxi), Guyuan (Ningxia), Taiyuan (Shanxi), Nanjing, Shanghai, Hefei et Beijing. On comptait également un spécialiste du
44 Sophia-Karin Psarras
Musée du palais à Taibei, Taiwan ; neuf Japonais dont les affiliations comprennent l'Institut de la technologie à Tokyo, le Musée National de l'histoire japonaise (Sakura), l'Université de Tohoku (Kanagawa) et l'Université de Tokushoku (Yokohama) ; et 26 participants occidentaux venant des Etats-Unis, du Royaume Uni, de Hong Kong, de Norvège, de Suède, d'Allemagne, de Belgique, de Suisse et d'Israël. Des participants prévus venant de l'Inde ne sont pas arrivés, pas plus qu'une délégation russe, dont l'absence fut sans doute occasionnée par la fermeture, en automne 1993, de certaines divisions de l'Académie des Sciences, telle l'Institut de l'histoire de la culture matérielle à Saint-Pétersbourg. Le colloque fut entièrement organisé par les Chinois, notamment par Mme Han Rubin, de l'Institut de l'histoire de la métallurgie à Beijing. Bien conçu, le colloque comprenait quatorze sessions de communications, deux sessions ouvertes de discussion le soir, et deux excursions pendant lesquelles on visitait des sites et des musées. Spécifiquement, ces excursions comprenaient une visite extrêmement brève à l'Institut d'archéologie (institut national) et au bureau des objets de la culture matérielle (organisation locale)1, tous deux situés dans la ville de Luoyang, et une visite plus aisée au cimetière de l'Etat ancien de Guo (disparu en l'an 655 avant notre ère) au village de Shangcunling, qui fait partie de la ville de Sanmenxia. Ce site est donc connu sous les deux noms de Shangcunling et de Sanmenxia. Les participants ont également bénéficié d'une exposition organisée à leur intention des objets fouillés récemment à Shangcunling, sur lesquels je reviendrai. Bien qu'aucun échange de monnaie étrangère n'existe actuellement à Sanmenxia, la ville présentait l'avantage de prix plus modestes qu'ailleurs en Chine. Peut-être pour cette raison, le colloque fut marqué par un manque, bienvenu, de ségrégation entre Chinois et étrangers, en contraste avec la situation caractérisant d'autres colloques non-BUMA récents. Des interprètes étaient disponibles pour la discussion privée aussi bien que formelle, et j'ai trouvé le dialogue animé et ouvert. La plupart des Ocidentaux travaillant sur le matériel chinois étaient scientifiques, et non sinologues- archéologues ou historiens. Leurs conclusions, tout comme celles des spécialistes se consacrant à d'autres régions que la Chine, sont d'une importance immédiate pour l'étude de la Chine. Je note ici quelques conclusions présentées.
1. C'est-à-dire le Bureau du wenivu, terme dont la traduction officielle, en anglais, est "cultural relies".
DHA 20.2, 1994
L'origine de la métallurgie en Chine 45
À présent, l'emploi le plus ancien du fer dans les confins de la Chine actuelle daterait du 14e s. av. n.è. sous la forme de sept armes en fer météorique (communication de Han Rubin). Des 9e-8e s. av. n.è. nous parviennent plus de données, et les exemples les plus anciens connus à présent de fer produit par l'homme. Des tombes royales de l'Etat de Guo à Sanmenxia (Shangcunling) furent exhumées cinq armes en fer météorique et en fer fabriqué. La variété de fer utilisée pour la fabrication de chaque arme n'est pas spécifiée. Les cinq armes comprennent un couteau incrusté de turquoise, un ge (hallebarde) en bronze avec tranchants en fer, et une épée avec une lame en fer et une soie en bronze autour de laquelle a été attachée une poignée de jade. Dans chaque cas, l'arme en fer faisait partie d'un assemblage comprenant trois armes de la même forme : une en fer, ou partiellement en fer, une en bronze, et une en jade. Le fer figurait donc comme matériau rituel. Le fer produit à cette époque la plus ancienne se catégorise comme fer forgé ; 130 exemples sont connus de la fin du 9e au 6e s. av. n.è. provenant de tout le territoire de la Chine actuelle sauf le Xinjiang, où plusieurs exemplaires ont été déterrés. Vers la fin de cette période, des fouilles dans le He'nan révèlent la coexistence sur un même site de fonderies pour le fer et le bronze, dans lesquelles on se servait des mêmes moules (communication de Ko Tsun). Le point de fusion du fer est presque celui du bronze. Jusqu'au 10e s. de notre ère et l'éradication des forêts, on utilisait du charbon de bois pour la fonte du fer, remplacé alors par le charbon de terre. Lorsque ce dernier se trouve sur des sites datant d'avant le 10e siècle, il s'agit de charbon utilisé dans la production sur le site de céramiques.
L'analyse du développement de la production du fer en Chine se complique par l'inclusion, non justifiée, d'exemples provenant de cultures non-chinoises situées dans les confins de la Chine actuelle (cf. Han Rubin, Luo Feng). Dans ce cas, la datation des sites est problématique et, en général, est en relation avec le chauvinisme chinois. En outre, puisque ces sites remontent à des cultures non- chinoises, ils ne servent pas forcément à démontrer la production de fer chinoise, bien que des interactions culturelles touchant à ce domaine puissent éventuellement se dégager. Il est important de souligner que même si l'on accepte une date du 14e s. av. n.è. pour l'emploi le plus ancien en Chine du fer (météorique), la production (par l'homme) du fer s'est développée au début du 2e millénaire avant notre ère dans la steppe eurasienne, et vers 1500 av. n. è. en Thaïlande (Robert Maddin).
DHA 20.2, 1994
4 6 Sophia-Karin Psarras
Selon Ko Tsun, en Chine le fer remplace le bronze, à partir du 6e s. av. n.è. environ. Cette hypothèse semble discutable, étant donné que l'âge du Bronze ne prend fin que vers la fin de l'époque des Royaumes combattants (475-221 av. n.è.) ; pendant toute cette période, la production d'armes en bronze se poursuit. Il est clair, cependant, que sans remplacer le bronze, le fer devient plus important à partir du 6e-5e s. av. n.è. On ne sait si ce développement s'est produit à cause de l'existence de technologies (puisque la technologie du fer existait déjà bien avant), à cause du déclin de l'importance rituelle du bronze, à cause de la supériorité supposée du fer en tant que matériau, ou à cause de choix culturels, dont l'importance du bronze donne un bon exemple. Puisque, dans le cas des armes ou des outils, le bronze retravaillé peut offrir un tranchant dur et adapté, il n'est pas certain que le fer soit nécessairement supérieur, quoique l'acier le soit. Comme en Chine, dans certaines cultures non-chinoises, certaines formes d'armements, telle que l'épée courte des Xiongnu ou des Saka, étaient produites en bronze, bien que le fer soit utilisé également. Dans ce cas, l'épée courte de bronze a tendance à porter un décor plus élaboré que l'épée courte de fer. Etant donné que l'épée courte joue un rôle rituel important dans la culture scythe, où elle représente un dieu considéré par les Grecs comme l'équivalent d'Ares, et étant donné la parenté culturelle des divers peuples de la steppe, il est bien possible qu'un tel rôle doit être rattaché à celui de l'épée courte des cultures steppiques de l'extrême Orient. Cette importance peut se voir dans l'attention accordée au décor de l'épée courte, ainsi qu'au choix du bronze comme métal de production, si le bronze était associé particulièrement et primairement à l'épée courte et si le bronze en soi comportait une signification culturelle dans ces sociétés. Vu la production répandue d'objets de bronze dans les cultures Xiongnu et Saka, qui possédaient également la technologie du fer, il est raisonnable de penser que le bronze avait une valeur culturelle intrinsèque. Supposant que plus d'une technologie métallurgique existe dans une culture donnée, et sachant que les mêmes objets, ornement ou outil, peuvent être produits en bronze ou en fer, il est donc possible que l'adoption par une culture d'un métal particulier remonte plus aux choix culturels qu'aux décisions pratiques. En Chine, nous pouvons considérer que l'emploi croissant du fer remonte à des questions d'ordre culturel plutôt que technologique : la valeur à la fois du bronze et du fer, aux plans économique, social et rituel.
DHA 20.2, 1994
L'origine de la métallurgie en Chine 47
La faucille en fonte de fer remplace celle en fer forgé depuis le 3e s. av. n.è. en Chine. Dès le 2e s. av. n.è. , la loupe de fer était utilisée et l'acier produit à partir de lingots de fer. Les Han (206 av. n.è.-220 de n.è.) fabriquaient de l'acier par décarbonisation à l'état solide (Ko Tsun).Des fragments étaient recyclés (forgés) sous les Han orientaux (25-220 de n.è.), ce qui suppose une accumulation importante d'acier dans la société. Des découvertes récentes dans ce domaine ont mené à la reévaluation du rapport de fouilles publié en 1962 par Zhao Qinyun sur le site Han de Tieshenggou. Ce site a récemment été rouvert et un rapport révisé sera publié. Selon le nouveau rapport, des hauts fourneaux de deux types étaient utilisés : l'un de forme circulaire, l'autre de forme elliptique. Ce qu'on avait d'abord identifié comme un produit de "haute pureté" est maintenant reconnu comme la charge du fourneau, mélangée de charbon de bois (sponge iron burden). On trouve que le fer produit dans les différents coins du fourneau a une composition chimique différente selon son emplacement dans le fourneau. Des fosses identifiées comme destinées au magasinage du produit sont maintenant reconnues comme des foyers.
On avance une date de 3800 ans avant le présent (i. e. avant 1950), ou 1850 av. n.è. , pour l'horizon le plus bas dans les débuts de la production du cuivre en Chine (communication de Ko Tsun). Malgré cette datation, obtenue à partir d'expériences au radiocarbone, cette production est attribuée à la culture néolithique de Hongshan (ca. 3500-3000 av. n.è.) (communication de Li Yanxiang). Cela parce que le site se trouve dans l'aire Hongshan à Niuheliang, dans le comté de Lingyuan, province de Liaoning. Le site a rendu les fragments de mille creusets qui retenaient des scories, trouvés en place dans un fourneau de forme pyramidale. Les creusets seraient en forme de sceau, avec six conduits d'aération dans la partie supérieure. Il paraît que le produit était un cuivre arsenical, fondu à partir de minerai de cuivre sulfureux. Cependant, une telle production massive ne s'accorde pas avec l'évidence actuelle venant du matériel Hongshan. En effet, la date 14C replace la fonderie dans les limites de la culture de la couche inférieure de Xiajiadian, qui recouvre les mêmes régions géographiques. Une telle attribution est acceptable, étant donné l'existence d'objets en métal parmi le matériel de la couche inférieure de Xiajiadian, bien que la datation de cette culture reste discutable. Un rapport, indirect et incomplet, de la production du laiton dans la culture néolithique de Yangshao (ca. 4000-3000 av. n.è) (communication de Ko Tsun) suscite d'autres questions encore.
DHA 20.2, 1994
48 Sophia-Karin Psarras
Ce laiton serait un bronze (cuivre plus étain) dans lequel le zinc figure dans une quantité plus grande que celle d'un élément de trace.
A cause de progrès récents dans le domaine des techniques radiocarbones, il est actuellement possible d'extraire du carbone des scories ou d'objets en fer ou en acier à haute teneur de carbone, et d'en obtenir une date carbone-14 (communication de Kenzo Igaki). Du carbone peut également s'extraire de protéines spécifiques tirées du collagène obtenu à partir des ossements ou des dents. Bien que cette technique soit répandue en Angleterre et en Scandinavie, par exemple, il n'est pas certain qu'elle soit adoptée en Chine2. De tels développements ne changent pas la nature inhérente de la datation radiocarbone comme présentant une possibilité exprimée en pourcentage, plus ou moins l'erreur du laboratoire, mais ils permettent la datation (dans ces confins de potentialité) d'une quantité de matériel beaucoup plus large qu'auparavant. C'est-à- dire que l'absence d'objets en bois (ou des restes en cendres) ne constitue plus un empêchement à la datation radiocarbone. Pour cette raison au moins, des problèmes d'attribution de sites tels que la fonderie de cuivre dite Hongshan ne devraient pas exister.
Un rapport plus substantiel a été présenté sous forme vidéo sur les fouilles des fonderies de cuivre dans les montagnes du comté de Nanling, dans la province de Anhui. Ce site recouvre quelque 50 km, et était exploité dès le début des Zhou occidentaux (ca. Ile s. av. n.è). Un fourneau, par exemple, fonctionna du 9e jusqu'au 6e s. av. n.è., comme l'on voit à partir des bronzes et des céramiques associés aux différentes couches du fourneau. La fondation de ce fourneau était faite de scorie de cuivre contenant du fer ; le foyer, elliptique, mesurait environ 30 cm d'épaisseur ; la hauteur du fourneau était d'environ 1 m, et le volume total environ 1. 35 mètres carrés. Même sous les Tang (618-907 de n.è.), on exploitait les mines de cuivre et les fourneaux de Nanling. Les métallurgistes chinois notent la présence sur tout le site de l'herbe dite "à cuivre" (tongcao), aux fleurs violettes, qui se nourrit de cuivre et dont la présence signale ainsi des dépôts.
On doit présumer, donc, que les dates obtenues en Chine à partir d'os sont soumises aux vieux problèmes de la porosité de l'os (produisant une date généralement trop haute). Cela dit, les dates les plus raisonnables venant des laboratoires radiocarbones chinois sont souvent fondées sur l'os, plutôt que sur le bois ou la cendre.
DHA 20.2, 1994
L'origine de la métallurgie en Chine 49
Les participants au colloque ont également eu l'occasion d'examiner les fouilles continues du cimetière de l'Etat de Guo au village de Shangcunling. Comme ce fut le cas avec les fouilles de 1956 à Shangcunling, les 146 tombes fouillées depuis 1990 datent de la fin du 9e/8e s. av. n.è. (ou, au moins, d'avant la disparition de Guo en l'an 665 av. n.è.). Parmi ces tombes, celle, numéro 2001, d'un roi de Guo, et le numéro 2009, celle d'une princesse, ont livré des données importantes. Le numéro 2001 se distingue par les jades, taillés en forme d'yeux, sourcils, nez, bouche, oreilles, boucles, pommettes et front, qui furent placés au dessus du visage du défunt. À en juger d'après les petits trous perçant chaque pièce, les jades étaient probablement cousus à un tissu. Le corps était recouvert d'un tissu en soie, dont la teinture de cinnabre est restée sur le corps après la décomposition du tissu. La tombe 2009 a également livré des textiles (de chanvre), à présent supposés être les exemples les plus anciens en Chine. Cette tombe est remarquable pour les jades (petits animaux) datant de la dynastie des Shang (peut-être ca. 18-12/11 s. av. n.è.), dont certains paraissaient essentiellement identiques à des jades provenant de la tombe de la reine Fu Hao (ca. 14-12 s. av. n.è.). Ces pièces suscitent des questions sur les rapports entre Guo et les Shang, bien antérieurs, ainsi que sur la transmission d'objets. Du matériel exhumé de ces tombes était exposé dans une exhibition spéciale au musée de Sanmenxia, organisée en vue du colloque du BUMA-3. Parmi le matériel, on voyait non seulement les objets en fer cités dessus, mais des ensembles de gui (marmite), de ding (trépieds), de cloches inscrites (bianzhong) et de pierres (clochettes) suspendues.
Sur le site du cimetière de Guo, on trouve également un grand nombre, encore non déterminé, de fosses à chevaux et à chars, dont certaines contiennent seulement un char et des chevaux. Une de ces fosses, cependant, où l'on fouille encore, contient plusieurs chars et 38 chevaux. À en juger d'après la position de ces derniers, les sabots des plus lointains restant sur les côtes des plus proches, les animaux ont été abattus avant d'être mis dans la fosse. La plupart faisaient face à la fosse, contiguë, aux chars. La plupart des objets en métal ayant été enlevée du site, il y restait cependant les impressions ou les restes pétrifiés des paniers, poteaux, et de l'attelage des chars, ainsi que des roues et du fond de la voiture. Plus d'un type de char était identifiable.
Le colloque du BUMA-3 était dédié au souvenir de Cyril S. Smith. Un comité permanent fut créé pour organiser des BUMA dans l'avenir. Le quatrième est projeté pour 1998, peut-être au Japon.
DHA 20.2, 1994