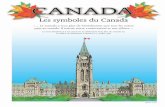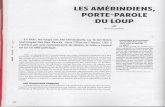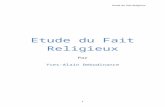Lettres d’étudiants de la fin du XIIIe siècle : les saisons du dictamen à Orléans en 1289...
Transcript of Lettres d’étudiants de la fin du XIIIe siècle : les saisons du dictamen à Orléans en 1289...
Anne-Marie Turcan-Verkerk
Lettres d'étudiants de la fin du XIIIe siècle : les saisons dudictamen à Orléans en 1289, d'après les manuscrits Vaticano,Borgh. 200 et Paris, Bibl. de l'Arsenal 854In: Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes T. 105, N°2. 1993. pp. 651-714.
RésuméAnne-Marie Turcan-Verkerk, Lettres d'étudiants de la fin du XIIIe siècle : les saisons du dictamen à Orléans en 1289, d'après lesmanuscrits Vaticano, Borgh. 200 et Paris, Bibl de l'Arsenal 854, p. 651-714.
Le ms. Borgh. 200 de la Bibliothèque Vaticane contient un recueil de modèles de lettres d'étudiants recoupant pour 8 pièces unrecueil contenu dans le ms. 854 de la Bibl. de l'Arsenal de Paris. Les deux séries correspondent sans doute à deux annéesscolaires successives. Les cours ont été dispensés à Orléans, la première série au printemps 1289, la seconde sans doute àl'automne de la même année. Le ms. Borghèse doit remonter à la copie du «livre du maître»; en revanche, le copiste du ms. del'Arsenal, à la suite de sa copie du corpus des œuvres de Guido Faba, a transcrit directement un cours de dictamen, dont onpeut reconstituer le déroulement. Il a ensuite annoté Guido Faba en se référant aux cours qu'il avait reçus. Une analyseessentiellement statistique du cursus, réalisée à l'aide d'un programme informatique entièrement original (cf. annexe 1), a permisde préciser le niveau de l'enseignant, son évolution, mais aussi le degré de sensibilité au cursus de l'étudiant.
Citer ce document / Cite this document :
Turcan-Verkerk Anne-Marie. Lettres d'étudiants de la fin du XIIIe siècle : les saisons du dictamen à Orléans en 1289, d'aprèsles manuscrits Vaticano, Borgh. 200 et Paris, Bibl. de l'Arsenal 854. In: Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age,Temps modernes T. 105, N°2. 1993. pp. 651-714.
doi : 10.3406/mefr.1993.3320
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_1123-9883_1993_num_105_2_3320
ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE :
LES SAISONS DU DICTAMEN À ORLÉANS EN 1289
D'APRÈS LES MANUSCRITS VATICANO, BORGH. 200 ET PARIS, BIBL. DE L'ARSENAL 854*
Parmi les recueils de lettres à l'usage des étudiants médiévaux, les plus savoureux sont sans doute ces pêle-mêle de lettres d'amour, de plaintes affamées déguisées sous le souci d'acheter des livres de grammaire, de correspondances amicales ou ambitieuses. Authentiques ou fabriqués, ces modèles dont le contenu, en vertu d'un vieux principe pédagogique, est destiné à toucher ou amuser l'étudiant donnent de la vie scolaire une image dont les stéréotypes eux-mêmes sont riches d'enseignements. Si la thématique amoureuse a eu récemment quelque succès1, les problèmes plus strictement scolaires et pédagogiques que permet d'entrevoir Yars dictaminis médiévale n'ont guère été approfondis depuis l'étude, brève mais fondamentale, de Ch. H. Haskins en 18982.
Dans cet article historique, Haskins signalait, en en citant quelques
* Je tiens à remercier ici M. Ch. Vulliez pour les nombreuses indications qu'il m'a données au cours de mes recherches. Les lettres scolaires du manuscrit Arsenal 854 seront éditées pour la plupart dans sa thèse d'État intitulée «Des écoles de l'Orléanais à l'université d'Orléans (Xe-début du XIVe siècle)». Ce texte doit beaucoup aux suggestions stimulantes d'I. Heullant-Donat, qui a bien voulu le relire. Il devrait être signé d'un second nom, car l'analyse du cursus n'aurait jamais pu être réalisée sans l'inventivité et la patience de Philippe Verkerk.
1 Cf. D. Schaller, Erotische und sexuelle Thematik in Musterbriefsammlungen des Mittelalters, dans Fälschungen im Mittelalter, V, Hannover, 1988, p. 63-77 (MGH Schriften, 33/5). Voir aussi dans le même volume, p. 79-94, H. M. Schaller, Scherz und Ernst in erfundenen Briefen des Mittelalters.
2 Ch. H. Haskins, The Life of mediaeval Students as illustrated by their Letters, repr. dans Studies in Mediaeval Culture, New York, 19652, p. 1-35, version revue et augmentée de l'article paru dans American Historical Review, 3, 1898, p. 203-229. On attend avec impatience la thèse de Ch. Vulliez sur les écoles d'Orléans du Xe au début du XIVe siècle
MEFRM - 105 1993 - 2, p. 651-714. 46
652 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
passages, un petit recueil de modèles de lettres d'origine orléanaise concernant particulièrement la vie estudiantine (Paris, Bibl. de l'Arsenal 854 f. 214-216 = A)3. Ce document, datable de la fin du XIIIe siècle, était jusqu'à ce jour unique et isolé, témoin conservé par le hasard d'un enseignement sans retentissement. Au cours de nos recherches sur l'apprentissage de la rédaction au moyen âge, dont la première étape était la délimitation d'un corpus des arts d'écrire en prose comme en vers, nous avons rencontré un second exemplaire de ce recueil Orléanais, contenu aux f . 4v-8v du manuscrit Borghese 200 de la Bibliothèque Vaticane (= Β)4. Le terme n'est d'ailleurs pas exact : le recueil du Vatican, qui se compose de 54 modèles de lettres, pour la plupart adressées à des étudiants ou écrites par eux, ne recoupe que pour 8 lettres celui de l'Arsenal, qui transmet quant à lui 26 formules5. Ce témoin, qui semblait jusqu'à présent anecdotique dans son isolement, et de ce fait inclassable, peut apparaître désormais comme une suite d'extraits d'une plus vaste compilation, dont le Borghese 200 révélerait un autre pan : il resterait donc à chercher le «troisième homme», hypothétique témoin du formulaire complet. Mais il est également possible que chacun des manuscrits transmette un état différent de l'enseignement d'un maître en dictamen dont l'activité, faute de documents, a été jusqu'à ce jour méconnue.
Le formulaire est précédé dans le manuscrit du Vatican par un petit traité du dictamen en 58 hexamètres léonins copié par la même main (f. 1), dont on retrouve quelques extraits dans le manuscrit de l'Arsenal (f. 214 et 21 5v). Certains vers sont également présents dans le manuscrit du Formulaire de Tréguier (Paris, BN nouv. acq. lat. 426 f. 19v et 20 = T), recueil constitué en Bretagne au tout début du XIVe siècle, sans doute par un ancien élève des écoles d'Orléans. Deux groupes de quatre et trois vers, dont les incipit sont «Si bene dictabis... »6 et «Qui dictareputas...»7 se retrouvent fréquemment -surtout le second- dans les manuscrits d'ars dictaminis des XIVe et XVe siècles8 : ils sont extraits de notre poème scolaire. Enfin, j'ai retrouvé dans au moins deux manuscrits, de la première moitié du XIVe et
3 Studies..., p. 8 en note. 4 J'ai pu effectuer cette recherche au cours d'un séjour comme boursière à l'É
cole française de Rome, que je remercie de son accueil. 5 Ces modèles de lettres sont suivis d'une formule de testament, et de quelques
salutationes et notes diverses copiées d'une main plus tardive. 6 H. Walther, Initia n° 17620. 7 H. Walther, Initia n° 15470 et Prov. n° 24036c. 8 E. J. Polak {Medieval and Renaissance Letter Treatises and Form Letters. A Cen
sus of Manuscripts Found in Eastern Europe and the Former U.S.S.R., Leiden, 1993)
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 653
du XVe siècles (Praha, Archiv Prazského Hradu M 115 f. 16v-189 = P, et München, UB 4° 810 f. 174-179v10 = M), une ars dictaminis en prose (inc. «Saptentis est opus...») qui utilise, pour résumer de façon mnémotechnique les règles qu'elle énonce, des groupes de vers empruntés à notre ars en hexamètres, dans un ordre qui ne reproduit pas systématiquement celui du manuscrit Borghése. L'ensemble de ces vers forme au total, d'après les manuscrits de Prague et Munich, un poème didactique en 123 hexamètres, qui complète le texte conservé à la Bibliothèque Vaticane (on y retrouve certains vers présents dans le formulaire de Tréguier mais absents du Borgh. 200) et parfois le rend intelligible. La forme métrique, la rime et la concision semblent avoir assuré le succès de cette ars, dont les plus anciens témoins sont, à ma connaissance, Orléanais et liés à notre recueil de lettres. En l'absence d'étude sur ce texte qui, dès les manuscrits les plus anciens (1289-1300 environ), présente de nombreuses variantes, on ne peut proposer la moindre conclusion, sinon qu'il est vraisemblablement antérieur à notre recueil et d'origine orléanaise11. Je compte poursuivre mes recherches sur ce poème, manifestement aussi important qu'ignoré, sans doute à
cite 7 témoins du «Qui dictare putas (ou putat)» : Brno, Stâtni Archiv G II 964 (XV) f. 48v - Olomouc, Stâtni Vëdeckâ Knihovna M I 271 f. 250v (d'après Yexplicit, j'ai l'impression que le manuscrit contient les deux séries de vers) - Praha, Archiv Prai- ského Hradu M 76 (XIV2) f. 31 (en fait, ces trois vers forment un ensemble avec le v. 46 du manuscrit Borghése = ν. 51 du manuscrit de München; Yexplicit donné par Po- lak est inventé de toutes pièces, le manuscrit portant Yexpl. habituel) - Praha, Archiv Praiského Hradu Ο 59 (XIV2) f. 86 - Tïebon, Stâtni oblastni Archiv A 6 (XV) f. 183, au cœur de la Rhetorica en latin et tchèque de Procope (cf. E. J. Polak, p. 42-3) - Tfebon, Stâtni oblastni Archiv C2 (XIV) f. 1, où il sert de prologue à une ars en prose qui semble différente de la nôtre. H. Walther cite encore les manuscrits Eichstätt, Staat. Bibl. 535 (XV) f. 185v - Erfurt, Amplon. Q. 375 (XV1) f. 42v - Sankt Gallen, SB 304 (XV) p. 210 - London, BL Royal 11 A XI (XV) f. 89 (manuscrit par ailleurs juridique) - Würzburg, UB M Ch. Q 112 (1426) f. 208 - Hamburg, Staatsbibl. Philol. Auct. Class, lat. Fol. 126 (XV) p. 305. J'ajoute le ms. Paris, BN lat. 8317 (XIV) f. 60 in marg. inf. On trouve les deux séries de vers dans le manuscrit Innsbruck, Tiroler Landesarchiv 120 (XV) f. lv (cf. F. Schillmann, Das Notizbuch eines Tiroler Notars aus dem 14. Jahrhundert, dans Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 31, 1910, p. 392-420 [416-417]).
9 Pour la partie concernant Yars dictaminis, le manuscrit est décrit par E. J. Polak, Medieval and Renaissance Letter Treatises. . ., p. 48-49. Se fiant à la seule formule ^explicit, cet auteur croit avoir affaire à une ars uniquement en vers.
10 Descr. P. O. Kristeller, Iter Italicum, III, Londres-Leyde, 1983, p. 645-646. Manuscrit cité par H. Walther, Initia n° 17620.
11 Outre la géographie de la diffusion du texte, le vocabulaire employé dans le manuscrit de München à propos du cursus semble indiquer une origine orléanaise.
654 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
cause de la diversité de ses incipit et d'une transmission «sauvage», marginale à tous les sens du terme12.
Il reste qu'avec cette ars dictaminis nos deux manuscrits forment un ensemble pédagogique dont on ne soupçonnait pas l'existence : ils révèlent un enseignement du dictamen plus développé qu'on ne l'aurait cru à la fin du XIIIe siècle dans la région d'Orléans-Tours13, dû peut-être à un véritable dictator, médiocre émule cependant de ceux qu'avait connus Orléans au XIIe siècle et dans la première moitié du XIIIe siècle. Une méthode nouvelle d'analyse statistique du cursus nous a permis de prendre la mesure de sa compétence et de son évolution personnelle. Mais surtout, l'édition complète des deux séries14 offre désormais un témoignage direct sur les cours de dictamen tels qu'ils étaient donnés en 1289 dans l'un des centres les plus réputés de l'Occident médiéval.
A + Β n'est pas égal à χ
Les manuscrits
Le manuscrit Borgh. 200 de la Bibliothèque Vaticane est un recueil de textes grammaticaux et médicaux qu'A. Maier, dans son catalogue du fonds Borghése15, date de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle16. Le manuscrit est formé de quatre cahiers ainsi composés : 3-3 (f. 1-6), 4-4 (f. 7-14), 6-6 (f. 15-26), 3-3 (f. 27-32). Il s'agit d'un petit manuscrit de papier épais, sans marges, dont A. Maier n'a pas signalé les deux filigranes. Le premier type (lettre M) est repérable dans les deux premiers cahiers (f. 2 et 5, f. 3 et 4, f. 10 et 11); introuvable dans Briquet, il s'apparente, mais assez lointaine- ment, à la variante 5346 de V. A. Mo§in et S. M. Traljic : Forez, 1320. Le second type (lettre A) apparaît dans les cahiers 2 et 3 : le type dont il se rapproche le plus est Briquet 7937 (= V. Α. Μοδΐη et S. M. Traljic 5110) : Gre-
12 Celle-ci, on l'a vu, rend le répertoire de E. J. Polak trompeur; vraisemblablement, beaucoup de notices de manuscrits ne signalent même pas ces vers aux allures de probationes pennae.
13 On trouve dans le formulaire du manuscrit Paris, BN lat. 8653A (le cosidetto «Formulaire d'Arbois») une lettre d'étudiant sur le déclin du trivium à Orléans : éd. Ch. H. Haskins, Studies..., p. 26 n. 5.
14 On peut se reporter à notre transcription, dans laquelle chaque lettre est désignée par le sigle du manuscrit suivi du numéro d'ordre du modèle.
15 A. Maier, Codices Burghesiani Bibliothecae Vaticanae, Cité du Vatican, 1952, p. 252-255 (Studi e testi, 170).
16 Après l'avoir daté du début du XIVe siècle, A. Maier s'est repentie et l'a daté de la fin du XIIIe siècle : cf. Addenda et emendando., p. 494.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU ΧΙΠΕ SIÈCLE 655
noble, 1344.17 Si les filigranes semblent dater le manuscrit du premier quart du XIVe siècle, l'écriture, qui n'utilise pas les abréviations drastiques du XIVe siècle, semble plutôt de la fin du XIIIe siècle. Le manuscrit, aux f. 10- 12 (Dictionarìus de Jean de Garlande copié par une autre main que nos lettres, mais sur le même papier filigrane), est annoté en flamand : la main de l'annotateur pourrait bien être celle du copiste de Yars et du recueil de modèles, dans lesquels la nasalisation systématique des voyelles devant g {dingnus par ex.) fait songer à un copiste de langue germanique. C'est sans doute au même homme qu'est due la copie des Flores Thesaun pauperum (f. 25v-38v). Dans le premier modèle, la glose [ajurelianis a été ajoutée à l'encre rouge, comme une «revendication». Il s'agit donc vraisemblablement d'un manuscrit copié en France, mais peut-être par ou pour un étudiant flamand : ils étaient nombreux à fréquenter les écoles d'Orléans. Par ailleurs, on sait que l'essentiel de la collection Borghése provient de l'ancienne bibliothèque pontificale en Avignon; d'après A. Maier18, notre manuscrit pourrait correspondre au n° 316, 40 du catalogue de 1594 de la bibliothèque avignonnaise : «Grammatica versibus explicata». Si telle est bien la provenance du manuscrit Borgh. 200, c'est sans doute par le droit de dépouille qu'il est parvenu dans cette bibliothèque. Rien dans le manuscrit ne permet de préciser l'identité du ou des propriétaire(s) au moyen âge.
Le manuscrit de l'Arsenal, d'un format plus petit, est un manuscrit composite en parchemin19. Le recueil de lettres a été copié sur des feuillets restés blancs, à la suite de la Summa de Guido Faba (f. 164-214). L'écriture, d'un module très petit, d'une encre très pâlie, est souvent malaisée à déchiffrer : certaines lettres n'ont pu être lues qu'aux rayons ultra-violets (ce qui explique pourquoi on n'en connaissait jusqu'à présent que des extraits20). Le recueil n'occupe pas le même élément codicologique que les dictamina d'origine toulousaine qui commencent au f. 217, mais il forme avec la Summa de Guido Faba un élément autonome portant au bas du f. 164 une cote ancienne, «.Q..IIL», qui correspond peut-être à un ancien sys-
17 On ne retrouve ces filigranes dans aucun des manuscrits en papier du XIVe siècle conservés dans le fonds Borghése. Le ms. Borgh. 219 est en partie copié d'une écriture, au moins au début, extrêmement proche de celle de notre copiste; nous n'avons pas su trouver de filigranes dans ce manuscrit.
18 A. Maier, Der letzte Katalog der päpstlichen Bibliothek von Avignon (1594), dans Ausgehendes Mittelalter, 3, Roma, 1977, p. 187-248 (p. 247) (Storia e letteratura, 138).
19 Descr. par H. Martin, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de l'Arsenal, 2, Paris, 1886, p. 134-137.
20 II se trouve que les lettres permettant la datation précise du formulaire étaient parmi les moins lisibles.
656 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
tènie de cotes de Saint-Victor (le volume hétérogène conservé aujourd'hui à l'Arsenal est décrit sous la cote SS 9 dans le catalogue de Claude de Gran- drue21); on distingue, f. 216v, la trace des remplis d'une ancienne couverture et de deux clous (sans doute les deux tenons). La copie est très légèrement postérieure à celle de la Summa, mais due à la même main, alors peut-être un peu plus libre et légère. Or, comme l'indique un colophon rubrique, la Summa de Guido Faba a été copiée à Orléans au printemps 1289 par Philipus Pelliparii de Puteolis : «Hanc summulam scripsit phïlipus /pel- liparìi de puteolis clerìcus proprìa manu I sua aurelianis post pasca anno / domini M°.C°C° octuagesimo nono quicumque eam /furatus fuerìt anathema sit». Les Pâques ont été fêtées cette année-là le 10 avril22. On ne sait comment le manuscrit est arrivé dans la bibliothèque de Saint- Victor de Paris, fort riche en artes dictaminis. On peut tout de même remarquer dans l'obi- tuaire du XIVe siècle de l'abbaye de Saint- Victor cette addition postérieure à 1462 (16 juin) : «ofo. frater Iohannes Le Pelletier, sacerdos, quondam prìor Beate Marie de Puteolis» (Puiseaux dans le Loiret)23. A moins qu'il ne s'agisse d'une pure coïncidence, il se peut que le manuscrit ayant appartenu à Philippus Pelliparii de Puteolis ait été légué à Saint- Victor par un de ses héritiers.
Les lettres communes au manuscrit Borgh. 200 (= B) et au manuscrit Ars. 854 (= A) forment dans les deux recueils une séquence presque ininterrompue : Β 8 = A 9, Β 10 = A 10, Β 11 = A 11, Β 12 = A 13, Β 13 = A 16, Β 14 = A14,B15=A15,B18 = A17. On constate un léger désordre dans le manuscrit A, où la lettre 16, par laquelle un étudiant demande à son oncle le Doctrinale et le Grecismus, suit la réponse de l'oncle (lettre 14) au lieu de la précéder. Dans cette réponse, où le manuscrit A ne donne qu'une initiale, le manuscrit Β livre le nom en clair : Reinoldus. Vraisemblablement, A et B, très proches, ne remontent pas au même exemplar. En ce qui concerne Yars dictaminis en vers léonins, B donne un texte consistant qui ouvre le manuscrit, A quelques extraits seulement, qu'il place également en tête du recueil. D'une façon générale, la copie du manuscrit B est d'une très grande qualité; on ne trouve en effet presque aucune trace de mélecture, aucune erreur
21 Cf. éd. par V. von Buren et al., Le catalogue delà bibliothèque de l'abbaye de Saint-Victor de Paris de Claude de Granarne 1514, Paris, 1983, p. 264.
22 D'après la table chronologique d'A. Giry, Manuel de diplomatique, Paris, 1894, p. 198.
23 A. Molinier, Obituaires de la province de Sens, 1, Paris, 1902, p. 565. Pour un autre Le Pelletier (Iohannes, chanoine de la Sainte-Chapelle), on trouve également la forme Pelliparìi.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 657
due à l'inattention; le modèle de Β était excellent. En revanche, le copiste du manuscrit A semble avoir été plus négligent; ainsi, il emploie, pour abréger quatenus, un double q signifiant quoque : Philipus Pelliparii a sans doute mal compris l'une des abréviations de quatenus, q9. D'autres erreurs semblent dues à la mauvaise compréhension d'un texte dicté (cf. infra). On peut donc accorder autant d'importance à chacun des deux manuscrits, A pour son ancienneté, Β pour sa qualité.
Origine géographique du formulaire
Dans le manuscrit B, sur un ensemble de 54 lettres, 38 mentionnent Orléans (dont 6 à la fois Orléans et Tours24), 2 Saint-Mesmin de Micy, 1 Tours; 36 sont adressées à des étudiants ou écrites par eux, 32 concernent des étudiants Orléanais; 13 lettres ne comportent aucun nom de lieu. Chartres ou Paris sont mentionnés de temps à autre : les lettres n'en sont jamais originaires, les parisiens étant souvent des membres de la famille ou des camarades y faisant leurs études. Dans le manuscrit A, 15 modèles concernent explicitement des étudiants Orléanais, dont 4 mentionnent à la fois Orléans et Tours : l'un d'eux (A 12) n'est pas transmis par le manuscrit B. Cette écrasante majorité pourrait faire pencher pour une origine purement orléanaise de la summula. Si l'on tente cependant d'identifier les personnages cités - bien souvent par une simple initiale, on constate l'importance particulière des tourangeaux : seuls leurs noms, excepté celui du cardinal-légat Jean Cholet, sont cités intégralement, ou sinon accompagnés d'une mention pouvant permettre une identification :
- Le Reinoldus rector talis ecclesie de la lettre B14 peut sans doute être identifié avec le Reinoldus canonicus ecclesie beati martini turonensis de la lettre B 53 : si la Gaïlia Christiana (t. 14, col. 180-1) ne mentionne aucun chanoine de Saint-Martin du nom de Reinoldus, on peut remarquer la présence, parmi les signataires d'un acte dont les noms ont été relevés par dom Housseau dans ses extraits de la pancarte blanche de Saint-Martin, d'un Raginaldus cellerarius25; le même acte avait été signé par un certain Io- hannes scholasticus : cela se passait au mois de décembre 1289; or, un Io- hannes scolasticus ecclesie beati martini turonensis est l'auteur de la lettre B 8 - A 9 (réponse : lettre B 10 - A 10).
24 B 8, 10, 14?, 17, 18, 53. 25 Paris, BN Coll. de Touraine 13, 1 f. 103 n° 8712 S. (f. 298v du document origi
nal). L'acte est également signé par Simon de Nigella, thesaurarius au moins depuis depuis 1279-1280 (on voit un trésorier Simon en 1267) et au plus jusqu'en 1309 (apparition du trésorier Philippus), le doyen Egidius, qui apparaît dans les actes des années 1289-91, le cellérier Raginaldus, Dominus Opizo cantor etc.
658 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
- Les lettres concernant à la fois Orléans et Tours sont généralement envoyées par un tourangeau (B 8 - A 9 : initiative de Iohannes Scolasticus et réponse des Orléanais) - Β 14 : lettre d'un Reinoldus sans doute tourangeau (cf. supra) à un étudiant Orléanais - Β 17 : R., clerc étudiant à Orléans, implore le secours de son dominas, M. chanoine de Tours - Β 18 : l'abbé de Marmoutier et son frère ont confié leur neveu à un étudiant Orléanais - Β 53 : Reinoldus, chanoine de Tours, écrit d'Orléans à un clerc demeurant à Tours pour qu'il lui envoie du poisson - la lettre Β 54 est adressée on ne sait d'où à un citoyen de Tours - A 12 : D. Boterei, en dernière année de droit à Orléans, demande des subsides à trois de ses parents, civibus Turonis.
Le noyau commun à Β et A comprend essentiellement des lettres de Tourangeaux résidant à Orléans; cela nous renseigne sur l'origine géographique du formulaire (Orléans) mais aussi sur celle du public auquel il était plus particulièrement destiné : des Tourangeaux travaillant à Orléans.
Certaines mentions cependant ne peuvent être prises en compte : - Β 18 : on ne connaît pas d'abbé B. ou V. à Marmoutier dans la période,
sauf si l'on admet la candidature de Guarinus (1229-1233 ca : cf. Gallia Christiana 14, col. 225 CD). Dans la période qui nous intéresse, l'abbé est Robert III (1283-1296).
- B 27 : le seul abbé de Saint-Mesmin dont le nom commence par un B est Bertherus (1242-1263 : cf. Gallia Christiana 8, col. 1535). Il est devenu ensuite franciscain (cf. B44 ?). Le quarantième abbé pourrait être aussi un bon candidat : Guillelmus II de Alneto ex subpriore electus abbas, a Ferrico aure- lianensi episcopo confirmatus est, cuius quoque electioni ut assensum praebe- ret, regent orarunt monachi sancii Maximini anno 1297 etc. Il règne jusqu'en 1320 {Gallia Christiana 8, col. 1535 DE). On connaît très mal l'histoire de Saint-Mesmin à cette époque. Notre lettre, pour fictive qu'elle soit, fait peut- être écho à de réelles tensions.
- On ne trouve pas trace des deux rectores scolarum de Sainte-Croix d'Orléans dans la Gallia christiana.
Datation de la composition des modèles
Le recueil contenu dans le manuscrit A n'avait jamais été daté précisément, les lettres «politiques» étant peu lisibles et n'ayant pas attiré l'attention des chercheurs. La datation des modèles peut maintenant être déduite des mentions de personnages officiels :
- B 39 : .p. dei gratia carnotensi episcopo : il s'agit sans doute de Pierre II de Mincy, évêque de Chartres de 1260 à 1275 {Gallia Christiana 8, col. 1164-67)
- B 45 : .p. dei gratia aurelianensi episcopo : il ne peut s'agir que de Pierre de Mornay, évêque d'Orléans de 1288 à 1296 {Gallia Christiana 8, col. 1469-70).
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU ΧΠΡ SIÈCLE 659
- Β 27 : Iohanni tituli sancte cecilie presbitero cardinali sedis apostolice legato : le cardinal-légat Jean Cholet, envoyé en France en 1283, «intervient vers 1287 dans de nombreuses négociations particulières»26. C'est en 1289 qu'il se trouve particulièrement sur le devant de la scène, quand il scelle à Lyon le traité de paix entre Philippe le Bel et Sanche de Castille (13 juillet 1289). C'est aussi cet été-là qu'il est «d'actualité» dans le milieu estudiantin : ses gens ayant mis à mal des étudiants de l'université de Paris, le cardinal calme les esprits en fondant, par un acte du 30 août 1289 confirmé par Philippe le Bel au mois de novembre suivant, une chapellenie de 20 livres parisis à la collation de l'université27. Il meurt le 1er août 129228.
- A 4 : lettre adressée par Edouard Ier, roi d'Angleterre (1272-1307), à Philippe le Bel, roi de France (1285-1314) : nous sommes donc entre 1285 et 1307, et de préférence avant 1293-94, où la menace de confiscation de la Guyenne aux Anglais rendit sans doute les rapports épistolaires entre Philippe et Edouard peu amènes. Il s'agit d'arracher la Terre Sainte aux Sarrasins. La datation exacte de cette lettre est délicate, car elle pourrait faire allusion à la prise de Tripoli (26 avril 1289) comme à la perte de Saint- Jean d'Acre (assiégée du 5 avril au 18 mai 1291). C'est incontestablement en 1288-1289 que la question de la croisade est le plus à l'ordre du jour dans la correspondance entre Edouard et le Saint-Siège29, mais Edouard, qui est aux prises avec les affaires d'Ecosse, semble peu pressé d'investir dans une
26 M. Prévost, 5. v. Cholet (Jean), dans DHGE, 12, 1953, p. 759. 27 Chartularium Universitatis Parisiensis..., 2/1, éd. H. Denifle - E. Châtelain,
Paris, 1891, n° 560, p. 34-35 et n° 563, p. 37-38. Alors que Jean Cholet reste diplomatiquement dans le vague (des «malfaiteurs» ont «frappé» des étudiants), Philippe le Bel dit clairement que des étudiants ont été blessés et tués par des gens du cardinal-légat («ut dicebatur»).
28 D'après le calendrier de Notre-Dame de Paris éd. dans A. Molinier, Obi- tuaires de la province de Sens, 1, Paris, 1902, p. 163; cf. A. Paravicini Bagliani, / testamenti dei cardinali del Duecento, Rome, 1980, p. 50 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 25).
29 Th. Rymer, Foedera, conuentiones, literae, et cujuscunque generis acta publica inter reges Angliae..., 1/3, La Haye, 17393, p. 43-44 : lettre adressée par Edouard au pape pour demander un délai, à cause des affaires d'Ecosse : Dat. apud Westm. 3. die Februarii anno Domini 1288 - p. 49 : Bulla de lugubri statu Terrae Sanctae adressée par le pape Nicolas au roi d'Angleterre : 1289 (ides d'août de la deuxième année de son règne) - p. 50 (le 2 des kalendes d'oct. de la même année) : le pape exhorte Edouard à aider la Terre Sainte - p. 76-7 : deux lettres de Nicolas à Edouard du 2 des ides de février 1291 etc. : il faut se dépêcher d'aller en Terre Sainte. Un échange en 1286, puis de nombreux échanges en 1288-1289 : la question est pendante; négociations pour l'Ecosse. Après 1291, plus rien jusqu'au 5 mars 1293 : Petrus de Luna lui propose cent hommes pour aller en Terre sainte (p. 117). Il n'en est plus question jusqu'en 1296 inclus, où j'ai arrêté les dépouillements.
660 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
expédition en Terre-Sainte. En juillet 1290, Otton de Grandson, au service de l'Angleterre, part cependant pour Acre. En 1289, les relations épisto- laires entre Edouard et Philippe le Bel ont été extrêmement courtoises30.
Les échanges avec le souverain pontife redeviennent intenses en 1291- 1292 : à la mi-mars 1291, Nicolas s'est fait de plus en plus pressant - en vain. Après la chute de Saint- Jean d'Acre, le pape prévoyait le départ pour la Saint- Jean de 1293. Edouard, qui est qualifié par Jean Richard de «véritable chef de la future croisade»31, proposait en effet le départ pour juin 1293.
Il semble cependant que la question ait été «dans l'air» particulièrement en 1289, sous le choc violent de la prise de Tripoli; l'amabilité de la formule prêtée à Edouard convient d'ailleurs mieux à cette période qu'à l'année 1293. Enfin, si vraiment Philippus Pelliparii de Puteolis a copié ce modèle de lettre peu après la Summa de Guido Faba, seule la première période est possible. Cette lettre sonne comme un appel, une espérance et une critique, à une époque où les initiatives les plus sérieuses pour lancer une nouvelle croisade sont le fait des Mongols32.
- Dans les années 1288-1289, alors qu'Edouard est ligoté par des problèmes de politique intérieure, Philippe le Bel est également trop engagé dans le guêpier sicilien pour pouvoir consacrer toute son énergie à une croisade. A 7 : lettre adressée par Robert, comte d'Artois, au roi de France, lui demandant de l'aide contre les Siciliens révoltés : Robert II (1250-1302) a été régent de Sicile de 1285 à 1289. C'est le 29 mai 1289 que Charles II est sacré roi des Deux-Siciles par le pape. La lettre est donc nécessairement antérieure à cette date.
La fourchette chronologique est donc 1260-1296, mais, si l'on écarte Pierre de Minci qui seul est antérieur aux années 1280, on peut situer la majorité des lettres dans les années 1283 à 1291 ou 1296, la période commune à tous ces personnages étant 1288-1289. Deux des personnages cités dans les lettres étant mentionnés dans un acte authentique de décembre 1289, en particulier un maître de grammaire, Iohannes scolasticus, on est fortement tenté de dater le recueil de cette année-là, qui se situe au
30 En 1289, une lettre à Philippe (Th. Rymer, 1/3, p. 46) : «Excettentissimo domino suo, domino Philippo, Dei gratia Franciae Regi (...) E. eadem gratia salutem et promptum optatum ad eorum beneplacita et mandata». Edouard est nommé consan- guineus par Philippe dans un sauf-conduit de la veille de la Pentecôte 1288 (p. 25). Le samedi avant les Rameaux 1288 : «Philippus dei gratia francorum rex egregio prìncipi karìssimo consanguineo Edwardo, eadem gratia illustri Regi Angliae Domino hi- berniae et Duci Aquitaniae fideli suo salutem et dilectionem» (p. 22).
31 J. Richard, Le Royaume latin de Jérusalem, Paris, 1953, p. 333. 32 Cf. R. Grousset, Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jérusalem 3.
La monarchie musulmane et l'anarchie franque, Paris, 1936, p. 722-727 en particulier.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIP SIÈCLE 661
cœur de notre fourchette la plus large. Le fait que la copie du manuscrit A soit de peu postérieure au 10 avril 1289 confirme cette datation. La composition du recueil date sûrement du printemps 1289, entre le 26 avril (chute de Tripoli) et le 29 mai (fin de la régence de Robert d'Artois) - ou un peu après, le temps qu'arrivent les nouvelles - et au moins avant la Saint- Jean mentionnée par Edouard dans A4 (24 juin 1289).
Datation des deux séries
Les deux séries forment à l'évidence un ensemble dû au même professeur de dictamen. L'unicité et l'unité du recueil sont sensibles jusque dans les lettres qui ne sont pas communes aux deux manuscrits. Il suffit pour se convaincre de cette unité stylistique de lire continûment l'index des saluta- tiones (cf. infra) : outre le retour des mêmes formules introductives, on peut constater l'homogénéité de l'emploi du cursus, presque systématiquement velox (pp4p). Cependant, les lettres permettant la datation la plus précise ne se trouvent que dans le manuscrit A, à l'exception de l'échange entre Iohannes scolasticus et ses collègues qui, avec quelques autres modèles, semble former une séquence assez solide et importante aux yeux de l'auteur de chacune des séries. Partant de cette constatation, on s'aperçoit très vite que les deux recueils n'ont pas la même physionomie, sans doute parce qu'ils ne répondent pas aux mêmes besoins.
A apparaît d'emblée comme étant plus politique et plus professionnel. Il fait plus largement écho à l'actualité dans ce qu'elle a de plus brûlant : Tripoli, la croisade, les suites des Vêpres Siciliennes. Le recueil, qui semble s'adresser essentiellement à des juristes, révèle aussi davantage les préoccupations du dictator auteur des lettres, puisque, outre la séquence dont nous avons parlé, il livre des échanges de lettres entre étudiants désireux de s'adonner à Xars dictaminis et des enseignants bienveillants. Enfin et surtout, il contient une lettre-programme imitant celle de Pons le Provençal, où le dictator décrit sa rencontre avec la vierge Rhétorique sur les bords de la Loire.
En revanche, Β ne manifeste pas un grand intérêt pour l'actualité internationale : Jean Cholet n'apparaît que pour régler un différend - sans doute fictif33 - né à Saint-Mesmin de Micy. Moins programmatique, le recueil concerne un public plus mêlé, étudiants en droit et en lettres, dont
33 Le testament de Jean Cholet n'indique aucun lien particulier avec le diocèse d'Orléans, encore moins avec Saint-Mesmin de Micy, qui ne fait pas partie, par exemple, des établissements auxquels Jean Cholet avait emprunté des livres (art. 133-144) : cf. éd. par A. Paravicini Bagliani, / testamenti dei cardinali del Duecento, Roma, 1980, p. 50 {Miscellanea della Società romana di storia patria, 25). Cela dit, d'avoir arbitré un différend ne crée pas de liens privilégiés.
662 ANNE-MARIE TURCAN VERKERK
beaucoup poursuivront des études de théologie à Paris. Il illustre davantage les tracasseries de la vie quotidienne et ses besoins, dépenses, dettes, problèmes matériels de fils de marchands ou de chevaliers envoyés à Orléans et qui, loin de leur famille, dépensent peut-être dans les tavernes ce qu'on leur a donné pour acheter des livres - et au moment de retourner chez eux, ne se trouvent pas assez bien vêtus pour faire leur entrée au pays... Ce sont aussi les rapines et rivalités entre hobereaux, ou la publication des bans que l'écrivain public rédigera pour un curé de paroisse. Les frères mineurs sont particulièrement présents dans ce recueil et contribuent à l'impression de vie active et diverse dans le siècle, à un échelon local, c'est-à-dire proche des hommes dans leurs préoccupations quotidiennes.
Que déduire de cette diversité? Deux interprétations sont possibles. D'un vaste recueil, deux étudiants ou professeurs ont pu réaliser des séries d'extraits en suivant l'ordre originel : en effet, les lettres communes aux deux manuscrits forment une séquence sensiblement identique. Ils avaient des centres d'intérêt ou des publics différents. Dans ce cas, il resterait à chercher un exemplaire du formulaire complet, contenant au minimum 70 modèles de lettres. Philipus Pelliparii de Puteolis aurait réalisé la plus ancienne des séries, quelques semaines après la composition du grand formulaire. Nous n'avons pas pu retrouver ce formulaire hypothétique. Le délai entre sa composition et la copie de A me paraît trop court pour que, déjà, l'on soit en présence d'extraits. En outre, la permanence d'une série à l'autre de la séquence commune, qui touche de près les problèmes d'enseignement, pourrait refléter les soucis d'un même homme. Cela dit, les annotations de la Summa de Guido Faba (cf. infra) donnent l'impression que Philipus Pelliparii connaissait aussi les modèles de B, ou au moins des modèles présentant les mêmes particularités.
À cette première solution, qui me semble difficile à envisager, je préférerais un roman que les faits confirmeront par la suite. Au printemps 1289, X scolasticus, qui débute dans l'enseignement du dictamen34, est encore plein de bonnes intentions. Il a gardé en tête les manuels de Guido Faba, mais aussi le récit de la rencontre entre Pons le Provençal et Rethorica, qui lui donne les clés de la Cité de la Pratica dictatoria. Pourquoi pas moi, se dit-il? Manifestement moins doué que son illustre prédécesseur, il se met en scène à sa place, abrégeant et défigurant le célèbre récit. Il rédige les lettres d'élèves avides de recevoir son enseignement... et se souvient en-
34 Cf. lettre A20 : on peut ainsi interpréter le verbe inceptsse. De même, la rencontre de Rhétorique ouvre la voie de l'enseignement, symbolise l'entrée du professeur dans la carrière.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 663
core des lupanars d'Orléans (A3). Les temps sont troublés, on ne parle que des affaires de Sicile et de la prise de Tripoli : le dictator, tant pour partager son émoi que pour tenir en éveil l'attention de ses étudiants - Philipus Pel- liparii est au premier rang et prend des notes - invente les lettres que les grands de ce monde ne s'enverront jamais. Le temps a passé. X scolasticus a acquis de l'expérience, et il a compris que ses élèves deviendraient, au mieux, officiai de Tréguier ou recteur des écoles d'Arbois, que jamais ils n'auraient à écrire pour le compte du roi d'Angleterre. Ce qui les intéresse, ce sont ces histoires de procès qui n'en finissent pas, les livres de grammaire et de droit, l'argent, toujours l'argent35, des préoccupations de drapiers; quelques uns ont la vocation, mais, pour la plupart, ne font que méditer leurs futurs bénéfices, prêts pour cela à toutes les bassesses (B3) - quand ils ne sont pas la proie de la paresse.
Les deux recueils reflètent, de la part du professeur, un état d'esprit différent : cernant mieux les besoins de son auditoire, il déplace ses centres d'intérêt. Il est donc peut-être hasardeux de dater l'ensemble du recueil du printemps 1289. Je crois plutôt que l'on peut distinguer deux strates dans l'enseignement d'un même dictator : un état rédigé entre le 26 avril et le 24 juin (au mieux le 29 mai) 1289, quelques semaines avant la fin de l'année scolaire (fin juin), et un état rédigé au plus tôt au cours de l'année scolaire suivante, après le 13 juillet 1289; la présence d'un Jean Cholet responsable d'un mauvais choix et réparant son erreur, comme dans l'affaire des étudiants de Paris, invite en effet à dater cette deuxième série de cours de l'automne 1289, c'est-à-dire du début de la nouvelle année scolaire.
Professeurs et étudiants au travail
L'apport du cursus : constance et évolution d'une séné à Vautre
L'étude du cursus permet de confirmer cette interprétation. Nous avons analysé l'emploi des clausules rythmées à l'aide d'un programme informatique. Nous précisons le vocabulaire et les modes de notation employés ci-dessous dans l'annexe n° 1. On y trouvera les indications nécessaires sur l'analyse statistique du cursus et, sous forme de tableaux, ses principaux résultats chiffrés.
Dans le cas présent, nous voulions voir si les deux séries étaient bien
35 Cf. Boncompagno da Signa : «Primum carmen scolarium est petitio expensa- rum, nec umquam erit epistola que non requirit argentum», cité par Ch. H. Haskins, Studies..., p. 8 en note.
664 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
d'un même auteur, et si, éventuellement, elles représentaient deux strates distinctes. Pour ce faire, nous avons soumis à l'ordinateur des textes préparés différemment.
1) Nous lui avons fait analyser d'abord les clausules marquées dans les deux manuscrits par une ponctuation (version minimale). En toute rigueur, cette étude doit nous renseigner sur la perception que le copiste ou l'étudiant avait du cursus, plus que sur les efforts réels de l'auteur des modèles. Dans un cas comme celui-là, la ponctuation est un véritable enregistrement du texte tel qu'on l'entendait.
2) Ayant observé la place des cursus soulignés par une ponctuation, nous avons soumis à l'ordinateur une «version maximale» de chacun des recueils : nous avons marqué des alinéas entre deux indépendantes formant un couple, après les participiales, entre les principales et les subordonnées, et dans les cas où le sens exigerait aujourd'hui une ponctuation.
1) Version minimale
La ponctuation ne manifeste aucune sensibilité à l'isocolie de la part des copistes : la variation de longueur des membres de phrase est en effet importante, 27.58 syllabes dans A, 26.54 dans B. Les membres de phrase sont en moyenne plus longs dans Β : 46.1 syllabes contre 35.7 dans A. En revanche, l'analyse des deux versions maximales montre que l'auteur des modèles se souciait davantage d'isocolie, la variation de longueur étant de 8.68 syllabes dans A (pour une longueur moyenne de 18.9 syllabes) et de 7.92 syllabes dans Β (pour une longueur moyenne de 19.4 syllabes).
Dans les deux cas, les copistes ont ponctué le texte quand ils entendaient une clausule rythmée : en effet, 94.6% des fins de membres de phrases marquées par une ponctuation sont rythmées dans A, 94.4% dans B; la proportion est légèrement inférieure dans les versions maximales : 93.1% dans A, 92.5% dans B.
Hommes de leur temps, les deux copistes repéraient essentiellement le cursus velox : 83.9% dans A, 82.5% dans B (pour tous les pourcentages, cf. tableaux 1 et 2). Les trois principales variantes de ce cursus se retrouvent en proportions égales ou presque dans les deux recueils : dans A, 61.3 - 17.3 - 5.4%, dans B, 59 - 17.9 - 5.2%. Les deux copistes manifestent la même indifférence à l'égard du cursus tordus dans sa forme fondamentale (1.8% dans A, 0.4% dans B); l'auteur, s'il l'employait très peu, en usait quand même plus que cela : 6.6% dans B, 5.2% dans A. Quant au cursus trispon- daicus dans sa forme fondamentale, la proportion en est la même dans les deux manuscrits : 2.4%; en fait, la confrontation avec la version maximale montre une disproportion au niveau des textes eux-mêmes : le copiste de A en a repéré 4 sur 5, le copiste de B 6 sur 22. Nous avons donc affaire à deux
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIP SIÈCLE 665
copistes dont l'oreille a été éduquée de la même façon. La prédominance du cursus velox s'explique par le fait que seul ce cursus pouvait être employé devant n'importe quelle ponctuation, étant obligatoire à la fin des périodes36 : l'ayant entendu plus souvent, les copistes l'ont reconnu plus facilement.
Les deux copistes ont cependant des goûts différents : alors que le copiste de A fuit particulièrement l'alliance l+4p (monosyllabe suivi d'un qua- drisyllabe paroxyton), fidèle en cela aux intentions de l'auteur telles que les révèle l'analyse des versions maximales de A et B, le copiste de Β évite surtout l'alliance pp3p (mot proparoxyton suivi d'un trisyllabe paroxyton, variante de type «Meyer» - cf. infra - du cursus trispondaicus).
2) Version maximale
On perçoit déjà, au niveau de cette version minimale, les phénomènes que révèle l'étude de la version maximale, une extrême unité des deux recueils de lettres, mais aussi de légères différences qui vont toutes dans le même sens : une diversification des cursus dans B. Au lieu d'employer systématiquement le cursus velox, ce qui est une solution de facilité, l'auteur des modèles respecte de mieux en mieux la hiérarchie des ponctuations, inséparable de celle des cursus31.
La prédominance du cursus velox s'affirme très largement dans les deux recueils. Ce n'est pas le fruit du hasard : la différence entre la fréquence attendue de sa forme fondamentale (pp4p), calculée sur l'ensemble du lexique des recueils, et la fréquence observée est éloquente. Dans A, où l'on peut s'attendre à 11 occurrences, on en a 187, dans B, 322 contre 19 occurrences attendues38 (cf. tableaux 6 et 9). On retrouve les mêmes tendances dans l'ensemble du texte, indépendamment des clausules, l'auteur
36 Cf. Guido Faba, Summa LXXXVIII (éd. A. Gaudenzi, Guidonis Fabe Summa dictaminis, dans // Propugnatore, Ν. S. 3/18, p. 348) : «In periodo vero datur régula singularis, quia semper débet esse dictio quatuor sillabarum cuius penultima sit acuta. Exemplum : Privilegium meretur amittere, qui concessa sibi abutitur potestate».
37 Ces habitudes sont très clairement exprimées par Robert de Basevorn en 1322 (je cite cet extrait de la Forma praedicandi d'après F. Di Capua, Fonti ed esempi per lo studio dello «stilus curiœ Romance» medioevale, Roma, 1941, p. 76-77) : «Et istae sunt très cadentiae, et non plures nunc communiter a Romana Curia frequentantur, sic quod prima cadentia [cursus tardus] nunquam vel rarissime in fine versus ponitur. Congruissimum autem locum habet in puncto flexo, id est in simplici pausa. Secunda cadentia [cursus planus] in omnibus tribus locis ponitur, sed consone magis in media distinctione quae vocatur punctus médius vel medietas versus. Tertia cadentia [cursus velox] similiter ubique ponitur, sed convenientissime infine versus».
38 Nous expliquons en annexe les modalités du calcul de cette fréquence attendue, et leur signification. Notre méthode diffère de celle de T. Janson : selon cette
666 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
employant par exemple 113 fois dans A et 190 fois dans Β l'alliance 3pp4p alors qu'on pouvait en attendre respectivement 37 et 59 occurrences (cf. tableaux 7 et 10). On voit dans quelle mesure le style des clausules rythmiques peut «déteindre» sur l'ensemble du texte. Cette déduction doit cependant être tempérée par une autre observation. Alors que, dans l'ensemble du texte, l'auteur emploie dans des proportions très voisines les mots 3p (A : 268 Β : 509), 3pp (A : 330 Β : 555), 4p (A : 293 Β : 533), 4pp (A : 204 Β : 381), on remarque que ne se retrouvent fréquemment en fin de membre de phrase que les quadrisyllabes paroxytons, c'est-à-dire les fins de cursus velox : dans A, 51 3p, 19 3pp, 194 4p, 24 4pp, dans B, 125 3p, 20 3pp, 347 4p, 39 4pp (cf. tableaux 5 et 8). Ces tableaux montrent aussi la fréquence de l'alliance l+3p en fin de membre de phrase (une cinquantaine dans A, une centaine dans B) : il s'agit également d'une fin de cursus velox (var. 2). On peut affiner en effet l'étude du cursus velox, dont existaient, en vertu de la consillabicatio, deux autres versions logiques : pp+l+3p (= var. 2) et pp+2+2 (= var. 3), présentées très clairement par Guido Faba39. Guido Faba ne parle pas de deux autres variantes possibles selon les méthodes de W. Meyer : p+l+4p (= var. 4) et p5p (= var. 5). Notre professeur emploie la var. 5 une fois sur 317 dans A et deux fois sur 598 dans B (seul le copiste de B s'en est aperçu, une fois). En revanche, il connaît et emploie les var. 2 et 3, qui représentent respectivement 13.9 % des clausules dans A et B (var. 2), et 4.4% dans A, 5.7% dans B (var. 3) (cf. tableaux 3 et 4). En cette fin du XIIIe siècle, on semble loin des arguties de l'école orléanaise du cursus, dont le vocabulaire est encore expliqué par Pons le Provençal40; en revanche, l'auteur des lettres paraît se conformer à l'exposé lumineux de Gui- do Faba.
Si l'auteur est resté très constant dans son usage du cursus velox, il a élargi son éventail de clausules d'un recueil à l'autre. Certes, cet effort reste très limité. Alors que l'on attendrait 19 occurrences de cursus planus (var. 1) dans A, on n'en trouve que 4 (1.3%), et 22 dans B (3.7%) alors qu'on peut en attendre 36 (cf. tableaux 6 et 9 pour les fréquences, 3 et 4 pour les pourcentages). Néanmoins, on constate que l'auteur a recherché davantage le
dernière, la fréquence attendue serait de 122 occurrences dans A, 198 dans B (cf. infra, Annexe 1).
39 Guido Faba, Summa LXXXDC (éd. A. Gaudenzi, p. 348) : «Item consillabican- tur due bisillabe, et fit dictio quatuor sillabarum; item una monosillaba et trisillaba, et effìcitur tetrasiUaba isto modo : Pro salute gentium animam suam débet pónere bonus pastor, et : Pro tuenda iustitia sapiens se oppónere non formideU.
40 Texte cité par F. Di Capua, Fonti..., p. 63 : cf. manuscrit Paris, BN lat. 8653 f. 6v.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 667
cursus pfanus dans le second recueil. On peut faire la même observation à propos du cursus trispondaicus (p4p) : on en trouve 5 dans A (1.6%) alors qu'on aurait pu, statistiquement, en trouver 21, et 22 dans Β (3.7%) au lieu de 38; l'évolution est exactement la même que pour le cursus planus. Elle a eu lieu aux dépens du cursus tardus. Alors que l'auteur utilise la succession p4pp plus qu'on ne pourrait s'y attendre dans le texte (137 fois au lieu de 76 : cf. tableau 10), il ne la recherche pas dans les clausules. Dans A, quand la fréquence attendue de sa forme fondamentale est de 15 occurrences, l'auteur emploie 21 fois cette clausule (6.6% : cf. tableaux 3 et 6); dans B, la fréquence attendue étant de 27 occurrences, il l'emploie 31 fois (5.2% : cf. tableaux 4 et 9). La variante 2 a régressé davantage : 0.8% dans Β contre 1.6 % dans A (cf. tableaux 4 et 3). Cette évolution transparaissait également dans les versions minimales (cf. tableaux 1 et 2). Il est clair que l'auteur des modèles, sans doute à cause de la mode du cursus velox, apprécie de plus en plus les paroxytons en dernière position. On en trouve 272 en fin de membre de phrase dans A pour 44 proparoxytons dans la même situation, dans Β 528 pour 66 proparoxytons (cf. tableaux 5 et 8). Mais, dans cette unité des mots «lents», qui terminent plus solennellement les propositions, le dictator recherche de plus en plus une certaine variété.
Cette analyse un peu longue nous montre un dictator parfaitement rompu à l'usage du cursus et constant jusque dans l'emploi des variantes du cursus le plus important, le cursus velox. Elle nous apprend un fait essentiel : le cursus velox, qui est de tous le plus courant, est le seul que les copistes - c'est-à-dire les étudiants, les débutants - repèrent facilement. C'est aussi sans doute le seul qu'ils sachent former avec une régularité proche de l'automatisme. C'est celui que notre professeur, dans le premier recueil, emploie le plus massivement. Le second recueil manifeste la solidité de cette formation fondamentale, le cursus velox étant parfaitement maîtrisé et dosé, mais il marque aussi une évolution, une maîtrise plus grande des autres cursus, ainsi que des choix esthétiques. Cela conforte notre analyse : A reflète l'enseignement d'un dictator habile mais encore à ses débuts, qui, à l'époque de la rédaction de B, a mûri et s'est perfectionné à l'épreuve de l'enseignement.
En amont et en aval : traditions italienne et orléanaise
L'étudiant n'a copié Guido Faba que parce que son professeur, qui, pour le cursus, suivait docilement les règles italiennes, le lui avait recommandé. La source principale de l'auteur des lettres est en effet le célèbre Magister Guido, chanoine de Saint-Michel de Bologne, actif dans les années 1220. Comme le montrent nos notes, l'essentiel des formules a été
MEFRM 1993, 2 47
668 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
puisé dans les Dictamina rethorìca, écrits dans les années 1226-122741, et dans la Summa, publiée en 122942. Ces recueils, extrêmement commodes, connurent un succès considérable dû à la qualité de leur style, mais surtout à la variété des cas de figure envisagés, qui, limitant les initiatives des notaires, réduisaient d'autant les risques d'impairs.
Copié à Orléans, le texte de Philipus semble provenir directement d'Italie, puisqu'il a conservé dans tous les modèles les noms italiens, sans même les abréger; cela ne semble pas avoir troublé notre copiste. Or on sait que, la plupart du temps, les textes sont adaptés à leur public, au moins en partie, ce qui permet souvent de localiser avec une certaine précision les diverses versions d'un même formulaire. Ainsi, la Bibliothèque municipale d'Avignon possède-t-elle un Guido Faba de la fin du XIIIe siècle (Avignon, BM 831) dont certains modèles ont été adaptés au public Orléanais43. Le pluriel Puteoli désignant normalement Pouzzoles, on peut se demander si un exemplar italien n'a pas été apporté à Orléans par Philipus lui-même, ou par son professeur, venu peut-être lui aussi d'Italie du sud. C'est à cette époque que Laurent d'Aquilée, notanus régis Sicilie, après avoir émerveillé les étudiants napolitains de sa faconde, vient enseigner à Paris; il s'est peut- être arrêté quelque temps à Orléans44. Il ne serait pas étonnant que ce maître célèbre eût entraîné à sa suite des étudiants et des émules. Ainsi s'expliquerait bien la lettre sicilienne du manuscrit A. Cependant, comme on l'a vu plus haut, Puteoli ne désigne peut-être que Puiseaux dans le Loiret45. D'ailleurs, le professeur de Philipus ne s'inspire pas du style brillant et contourné de Laurent d'Aquilée. C'est que l'influence italienne s'affirme alors à Orléans de deux façons diverses et convergentes. On peut distinguer une influence directe, liée aux déplacements des hommes, et une influence «en différé» s'exerçant par le biais de manuels vieux de cinquante ans et plus, mais toujours considérés comme utiles; c'est avec ce matériau clas-
41 Ed. A. Gaudenzi, Guidonis Fabe Dictamina rhetorica, dans // Propugnatore, N. S. 5/1, p. 86-129 et 5/2 p. 58-109.
42 Ed. A. Gaudenzi, Guidonis Fabe Summa dictaminis, dans // Propugnatore, N. S. 3/15, p. 287-338 et 3/18, p. 345-393.
43 Cf. Catalogue général des manuscrits... 8°, XXVII, p. 419-421 (en particulier p. 420). Ce manuscrit de 78 ff., que nous n'avons pas vu, est également un volume de petit format : il mesure 152 χ 99 mm., celui de l'Arsenal 174 χ 120.
44 Cf. K. Jensen, The WorL· of Laurence of Aquileia with a list of Manuscripts, dans Manuscripta, 17, 1973, p. 149.
45 Dans un calendrier du XIIIe siècle de Sainte-Croix d'Orléans est mentionné un Thomas de Puteolis (au 23 avril, après 1207) : cf. A. Vidier-L. Mirot, Obituaires de la province de Sens, 3, Paris, 1909, p. 9 et 49.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 669
sique que l'on compose les formulaires modernes. Cela illustre dans le détail l'une des phases marquantes de l'histoire de Yars dictaminis, cette fin du XIIIe siècle où s'exportent et s'interpénétrent les traditions «nationales», époque-charnière où, à la faveur des déplacements des hommes avec leurs manuscrits, Yars dictaminis s'européanise.
En effet, l'auteur des lettres anonymes (!) ne s'inspire pas uniquement de Guido Faba. Il reprend également des formules de Pons le Provençal, qui enseignait à Orléans vers le milieu du XIIIe siècle. L'emprunt le plus manifeste est constitué par A24; l'auteur de notre recueil s'est directement inspiré de la lettre fameuse dans laquelle Pons relate sa rencontre avec la Rhétorique : Universis doctorìbus et scolaribus Aurelianis studio commo- rantibus, P. magister in dictamine, salutem et audire mirabilia que se- cuntur...46. Il ne dépend ni de Buoncompagno, qui ouvrait par un récit de ce type sa Rota Veneris41, ni de son contemporain Laurent d'Aquilée, dont le recueil d'Epistulae destiné aux étudiants napolitains commence par ces mots : Attendue mirabilem, ο vos qui studetis Neapoli, Laurentii visionem. Pridie, dum in urbe romana dormitarem in quodam rosarum ortulo, florum et frondium vernali suavitate rìdente, velamine arboris in umbroso; ubi dulces avium cantus iugiter resonabant, et suaviter murmurabant rìvuli a fontibus descendentes, flores similiter apparebant ventantes, et lilia venusta- tis, rose quoque spetiose surgebant, et circa cinamomum et balsamum viole parìter redolebant; supra me venit subito, quasi de alto celi polo descenderet, pulcra ut luna et electa ut sol, quedam angelica creatura, que beatis spintibus in limpida speculatione celestium digne poterat adequarì4*. Le texte de l'Arsenal, s'il n'a aucun rapport, ni pour le fond, ni pour la forme, avec celui de Laurent d'Aquilée, s'inscrit pourtant dans un même mouvement d'imitation de Pons le Provençal. Moins travaillé que celui de Laurent, il est une récriture très simplifiée du «programme» (l'expression est de L. Delisle) de Pons le Provençal, qu'il suit pas à pas en y taillant des coupes sombres : il fait l'économie de la descrìptio pulchritudinis, retient les éléments essentiels de la narration en en simplifiant l'expression; la Rhétorique emmène le narrateur vers la cité aux sept portes, mais la description des portes est
46 Ed. L. Delisle, Les Écoles d'Orléans, au douzième et au treizième siècle, dans Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France, 1869, p. 150-152.
47 Ed. F. Baethgen, Magister Boncompagno. Rota Veneris. Ein Liebesbriefsteller des 13. Jahrhunderts, Roma, 1927 (Texte zur Kulturgeschichte des Mittelalters, 2).
48 Ed. d'après le manuscrit Roma, Bibl. Casanatense 9 f. 13v par G. De Luca, Un formulario della cancelleria francescana e altri formulari tra il XIII e XIV secolo, dans Archivio italiano per la storia della pietà, 1, 1951, p. 230-231.
670 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
supprimée : l'auteur va à l'essentiel, l'évocation de l'ordre laïc, avec à sa tête l'empereur, et du clergé, avec le pape à sa tête, ordre social simple et clair, dont la hiérarchie se traduit par l'étagement des individus sur les degrés de deux escaliers; c'est la dernière partie qui est reprise le plus largement, dialogue entre la vierge Rhétorique et le dictator auquel elle confie les clés de la cité nommée «Pratica dictature», pour qu'il ouvre les portes à qui voudra entrer. La reprise de Pons le Provençal permettait à notre médiocre professeur d'enrichir ses recettes pour l'apprentissage du dictamen en associant ingrédients Orléanais et procédés italiens.
Quelle que fût l'importance de Yars dictaminis italienne aux yeux de l'auteur des modèles, il s'adressait à un public pour l'essentiel originaire de Tours et d'Orléans, et devait traiter certains thèmes traditionnels liés aux habitudes scolaires orléanaises : je songe en particulier aux lettres concernant le Grecismus d'Evrard de Béthune et le Doctrinale d'Alexandre de Vil- ledieu. A en croire Jean de Garlande, ces manuels étaient les livres de chevet Orléanais vers 1240 : il n'a pas de jeux de mots assez cinglants - et intraduisibles - pour dire le mépris qu'ils lui inspirent49. Ch. H. Haskins passe rapidement en revue les modèles contenant la demande d'un Grecismus et/ ou d'un Doctrinale50. On remarque que, pendant tout le XIIIe siècle, la demande de ces deux manuels forme une constante des lettres d'étudiants issues du milieu Orléanais, alors qu'on ne la rencontre pas chez les italiens. On la trouve en particulier sous la plume de Pons le Provençal : (...) precor igitur dilectionem vestram quatenus mihi denarios transmittatis quïbus ex-
49 Morale scolarìum X : persuasio ad libros philosophicos propter quedam moderna scripta inutilia et ad laudem cancellarli (...)Florent auctores et ab Ulis florìdiores
fiunt döctores et lectris utiliores. Doctrinale viam claudens ad philosophiam
non gerii egregiam linguam set tautologiam, tardât preproperos, nec ducit ad ardua cleros.
Fallu garciferos omnis probus, hoc probat Heros. Multotiens fantur bona qui furiis agitantur,
Set non laudantur ideo nec magnificantur. Mendax Grecismus est Grecis philosophis mus;
quando latintsmus est turget tnons velut ismus. Ed. L. J. Paetow, Morale scolarium of John of Garland (Johannes de Garìandia)..., Berkeley, 1927 (Memoirs of the University of California 4, 2).
50 Studies..., p. 24 n. 1. Il faut supprimer le renvoi à la Zweitschrift für die Geschichte des Oberrheins, NF 11, 1896, n° 50 : c'est le «novum Grecismum... a magistro condom C. editum » que demande l'étudiant Petrus à un ami : il s'agit naturellement de l'œuvre de Conrad de Mures.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIF SIÈCLE 671
pensas meas faciam et grecismum et doctrinale valeam comparare51. On trouve dans le ms de l'Arsenal, f. 214v (lettre A8), une formule correspondant presque littéralement à celle de la lettre 115 du formulaire de Tréguier, contenu dans le manuscrit Paris, BN nouv. acq. lat. 426 (début du XIVe siècle)52, compilé vers 1320 : doctrinale cum magnis glosulis de litera veraci et legibili tam in nota quant in textu (A853), studeatis michi emere doctrinale cum magnis glosulis et veraci littera, tam in interlinearibus quant in textu (Tréguier)54 : le maître des écoles de Prat demande à un ami resté à Orléans de lui envoyer un Doctrinale. Dans la lettre 125 du formulaire de Tréguier, un copiste annonce à un armiger qu'il est en train de copier avec le plus grand soin le Doctrinale qu'il lui a commandé. Les lettres B13-A16 et B14- A14 montrent les tractations entre un étudiant désireux de posséder les deux précieux manuels, et son oncle, qui les lui a promis. La permanence du thème montre quelle a été la stabilité des instruments d'apprentissage de la grammaire latine à Orléans jusqu'au début du XIVe siècle, malgré les critiques d'un esprit aussi éclairé que Jean de Garlande.
Ces rapprochements permettent d'entrevoir les liens unissant l'enseignement de notre maître anonyme et le Formulaire de Tréguier, proches en outre par le vocabulaire et le choix des proverbia. Ce recueil de 157 pièces a sans doute été compilé vers 1320; le seul évêque de Tréguier qu'il cite est Geoffroi Tournemine, en fonctions de 1297 à 1316 ou 131755 : si la compilation est postérieure de 30 ans à la nôtre, les documents eux-mêmes peuvent
51 Je n'ai pas pu consulter la thèse de l'École des chartes de H. G. Le Saulnier de Saint-Jouan, Pons le Provençal, maître en «dictamen» (XIIIe siècle), Paris, 1957, 2 vol. dactyl. Je cite d'après le manuscrit Paris, BN lat. 8653 f. 11 : Revemndis [sic] pa- rentibus post deum super omnia reverendis .p. et.b. de tali loco .G. eorum devotissimus filius salutem et filialem subiectionem. Sicut bonus ortolanus plantationem suant di- ligenter excolit sic bonus pater débet facere suo studenti fìlio sumptus et libros necessa- rios ministrando. Insinuatione presentium dominationi vestre clareat venerande quod ego sum aurelianis sanus et hilaris per dei gratiam et ibidem proficio in arte gramatica competenter. Verumtamen meam pecuniam totam quam mecum detuli cum a vestra dicessi facie granosa penitus in sumptibus mets neccessariis consummavi. precor igi- tur dilectionem vestram quatenus mihi denarios transmittatis quibus expensas meas faciam et grecismum er doctrinale valeam comparare.
52 Éd. R. Prigent, Le formulaire de Tréguier, dans Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, All, 1923, p. 275-413 (éd. p. 321-401).
53 Signalé par Ch. H. Haskins, Studies..., p. 24 n. 1. 54 Cette lettre avait déjà été éditée par L. Delisle {Le Formulaire de Tréguier et
les écoliers bretons des écoles d'Orléans au commencement du XIVe siècle, dans Mémoires de fo Société archéologique et historique de l'Orléanais, 23, 1892, p. 41-64, appendice X).
55 R. Prigent, p. 282-5.
672 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
ne l'être, en comptant au plus juste, que de 8 années. Le manuscrit du Formulaire de Tréguier transmettant en outre quelques vers de notre ars dicta- minis, on perçoit l'unité historique des deux recueils, qui doivent remonter, directement ou plus lointainement, à un même enseignement : la sphère d'influence de notre maître Orléanais en apparaît élargie. La lettre B8 fait d'ailleurs allusion à la prospérité des écoles de grammaire de Sainte-Croix d'Orléans, où les maîtres ont beaucoup d'élèves et gagnent bien leur vie; ces écoles étaient sans doute la pépinière où s'initiaient au latin les futurs étudiants en dictamen et en droit. Peut-être est-ce son propre établissement et ses propres collègues que le nutrìcius curìosus de la grammaire (A24) met ainsi au premier plan : remarquons qu'un Thomas de Puteolis a été chanoine dé Sainte-Croix au cours du XIIIe siècle56.
Un cours médiéval en direct
Comment se passaient les cours de dictamen auxquels assistaient, dans les années 1289 in poi, l'auteur du Formulaire de Tréguier et Philippe Le Pelletier? L'observation de ce clerc au travail nous permet de comprendre les grandes lignes de la pédagogie du dictamen mise en œuvre ici. Philipus semble bien avoir réalisé, en ce petit volume, un instrument de travail personnel, sous l'impulsion d'un professeur. A la suite du manuel fondamental qu'est le corpus de Guido Faba, il a noté notre petit recueil, qui représente sans doute l'enseignement dispensé à Orléans au printemps 1289 : en effet, à partir du produit fini que nous avons sous les yeux, nous pouvons reconstituer partiellement la réalité du cours médiéval.
Le maître commence par énoncer les règles fondamentales de Yars dic- taminis. Dans A, on ne trouve que quelques vers, au f. 214 :
Cum dictare putat quisquam. pars prìma salutai altera bfanditur. sed trìna res aperìtur quinta [sic] petit votum. claudit conclusio totum (= B, v. 8-10, avec variantes) litera grosetur prìor. et sic clausula detur nomine pro proprìo sic fiat et aproprìato (= M, v. 111-2, avec variantes)
et un vers à la dernière ligne du f. 215v : dant hostes tuti contraria verba saluti. (= B, v. 53 et M, v. 56). En revanche, Β donne un texte plus important -même s'il est incomplet, la copie du poème semblant inachevée. On peut y voir un progrès dans l'enseignement de l'anonyme, qui étoffe davantage les préliminaires théoriques. B, dont le modèle devait contenir le texte
56 Cf. note 45.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 673
complet, remonte peut-être à l'exemplaire de l'enseignant plutôt qu'à celui d'un élève : cela expliquerait également sa qualité. Ces règles simples, que l'on retrouvera souvent dans les décennies suivantes, étaient sans doute mémorisées par les débutants avant le passage à la pratique.
L'étudiant a parsemé le recueil anonyme de petites gloses : on remarque le même phénomène dans Β ; or, les gloses me semblent très rares dans les manuscrits d'artes dictaminis, et en particulier dans les formulaires. Sans doute peut-on y voir la trace non pas de la relecture de l'élève, mais du cours dispensé oralement, le dictator expliquant brièvement les termes peu usités. On pourrait croire en effet que ces gloses proposent des termes interchangeables, comme ceux qu'énumèrent les pratice dictaminis de la fin du XIIIe siècle. En fait, il s'agit bien d'explications souvent introduites par id est. Le terme noté dans l'interligne, s'il devait se substituer au mot employé dans le texte, supprimerait parfois une clausule rythmée; ainsi, dans Al 3, recurrere non formi- do forme un cursus velox, recurrere non timeo ne donne aucun cursus : il est clair que timeo est une explication et non pas une solution de rechange. Certaines gloses, qui laissent transparaître la langue vernaculaire, sont manifestement «parlées» : comme, dans la lettre Al 8, ce id estfìdelium gencium, «les gens de foi», expliquant fidedinorum. Β n'est sans doute que la copie d'un recueil copié posément et sans fautes : nous l'avons vu, il pourrait s'agir du livre du maître plutôt que de l'élève; en revanche, il semble bien que les gloses de A soient la transcription directe des commentaires de l'enseignant.
A, beaucoup plus que B, transcrit d'ailleurs les mots tels qu'ils ont été entendus plutôt que lus. Dans la lettre Al 5, la leçon copuletur pour populetur révèle essentiellement l'inattention de l'étudiant; mais bien des graphies retranscrivent certains modes de prononciation : ainsi dans la lettre Al 8 nan pour nom, où, comme on sait, le m marque simplement la nasalisation de la voyelle; on trouve de même souvent la finale iem pour iam : les deux graphies correspondent à la même prononciation, ion; fidedinorum, oiectis, dans A24 pedi pour petit, sondo poursentio dans la dernière lettre, dans Al 5 militali sin- gulo (un r roulé, ci prononcé si) etc. Le recueil a manifestement été copié sous la dictée : cela seul peut expliquer dans la lettre A7 la leçon erronée cum quis pour cunctis, dans Al 6 hoc librorum carenciam pour ob librorum carenciam.
L'écriture de Philipus varie beaucoup, elle est plus ou moins cursive selon les phases de la copie, très sensibles grâce aux variations de la couleur de l'encre; on peut les distinguer comme suit : règles théoriques + Al-2; A3-4; A5-9; A10-13; A14-17; A18 et A19 semblent isolées; A20-22 + peut-être A23; A24, étant donné son importance, a fait l'objet d'un cours à elle seule; A2 5-26; la formule de testament a également été traitée séparément du reste. Ces phases, qui forment toutes en moyenne une colonne de texte, correspondent sans doute au temps consacré à la dictée des modèles
674 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
étudiés lors du cours : un à quatre par séance, selon leur intérêt et leur longueur; la première séance ayant commencé par un commentaire des règles théoriques, seules deux lettres ont été dictées aux élèves. Selon les jours, selon la rapidité de la dictée, Philipus copie plus ou moins vite et comprend plus ou moins bien : les principales erreurs d'audition apparaissent dans les lettres copiées di corsa. C'est là une raison supplémentaire pour voir en ce recueil la transcription directe d'un cours médiéval sur la rédaction des lettres. Le professeur dictait deux à trois modèles par cours, et sans doute les commentait. En revanche, le manuel fondamental de Guido Faba a été copié d'après un exemplar : son statut est tout différent. On s'y réfère comme à une auctoritas. Le maître en dictamen, ayant utilisé Guido Faba, invite ses étudiants à s'y reporter à leur tour.
Après le cours, le travail personnel
Dans le manuscrit A, le recueil de lettres suit immédiatement la copie de la Summa de Guido Faba, entendue en son sens le plus large : il s'agit en fait du corpus de ses œuvres principales57, tel qu'on le rencontre dans de nombreux manuscrits (dont le décompte exact n'a pas encore été fait). La Summa est assortie de quelques annotations marginales, corrections, ma- nicules ou nota. Ces annotations sont dues à la main la plus cursive du recueil de lettres, c'est-à-dire à Philipus Pelliparii qui, ayant quitté en quelque sorte la phase de copie, se livre ici à un travail plus personnel58. Les notes ont été motivées par la transcription et l'étude du recueil de lettres anonyme. Au f . 167v, en marge de la formule et quicquid boni ioseph iacob pre- buit patri suo, Philipus note pro contulit : c'est le verbe employé, dans la même formule, par l'auteur de notre recueil (lettre A2). Quelques lignes plus bas, la formule et benedictionem quant dédit filio patriarcha est glosée par [IJsaac; Philipus a présente à l'esprit la même expression de A2, qui nomme Ysaac. Au même folio, Philipus propose de remplacer devotus par devotissimus, superlatif, curieusement, particulièrement présent dans Β (Β 26, 41, 42; devotus : Bl, All= Bll, A18). Toujours au même f., dans la formule et Salomonis sapientia luminari, Philipus préférerait illustrari, terme qui apparaît dans Β 31, alors que luminari semble absent du vocabulaire de l'anonyme. Au f. 191v, on trouve cette note : scutifer À. armiger : si le pre-
57 f. 164 : Summa; f. 183 : Dictamina rethorica; f. 200 : exordia; f. 201v : Continuata exordia; f. 209v : De privilegiis ecclesiasticis; f. 210v : Arengae.
58 L'écriture est bien identique. Une note nous en donne d'ailleurs la certitude, car voici ce qu'écrit ce fils de pelletier dans la marge inférieure du f . 200v : Scire pa- ter vellem si mutât corta pettem / Pellis adhuc durât de nullo coria curât.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 675
mier mot n'apparaît jamais dans nos recueils, en revanche le second est employé dans la salutatio de la lettre A 5, où il a été ajouté après coup.
Les passages marqués par un signe attirant l'attention se retrouvent pour la plupart dans nos recueils (5/7). Ce sont, au f. 169, la formule et Ma in terris discere que hominibus placeant et angelis in excelsis (A9 = B8 et B35), au f. 171 et reverenciam tam débitant quant devotam (B45), au f. 174 l'expression nullatenus dubitarì (cf. B9), au f. 180v les mots veraciter co- gnoscentes en particulier (cf. A2), au f. 202 le proverbe in malts promissis melius est ftdem recindere quant promissum scelerìbus ftdeliter adimplere (B50). Consciencieusement, l'élève a repéré des parentés avec Guido Faba et les a notées pour son compte. Il semble que Philipus Pelliparii de Puteo- lis se soit livré au même exercice que nous, recherchant dans Guido Faba les sources, ou plutôt les parallèles des modèles qu'il avait copiés, et la confirmation écrite du cours dispensé oralement.
* *
L'ensemble des deux recueils donne à un formulaire comme celui de Tréguier l'arrière-plan purement Orléanais et pédagogique qui lui manquait, car l'étudiant qui a composé ce recueil à son retour d'Orléans en pays Tré- gorrois avait vraisemblablement suivi un enseignement de ce type. Fait rare, on peut presque assister, en lisant A et B, aux leçons qu'il a reçues : cet ensemble de modèles datable et localisable avec précision est resté très proche de la réalité orale du cours de dictamen, qu'il nous retransmet comme un enregistrement. Fait encore plus rare, nous tenons peut-être là, pour un même enseignement, le livre de l'élève et la copie du livre du maître, proches chronologiquement, mais correspondant à deux séries de cours différentes. Dans le laps de temps qui a séparé les deux années scolaires, les préoccupations du dictator et de son auditoire ont évolué. Car dans leur contenu aussi, ces lettres fictives ont la saveur du vrai, par la fraîcheur de l'instantané - même si c'est la fraîcheur illusoire que le miroir renvoie à la femme maquillée -, la diversité des personnes et l'unité des lieux. Elles constituent une véritable tranche de vie orléanaise, où l'on voit les préoccupations, les inquiétudes et les joies de tout un petit monde de clercs, de frères mineurs, de propriétaires terriens et de marchands. Les étudiants, toujours soupçonnés de paresser ou de mener joyeuse vie, réclament des livres et des vêtements, s'inquiètent de leur logement, cherchent même un local tranquille pour s'exercer à Yars dic- taminis. Les femmes semblent absentes de ce monde, sinon dans rarrière- plan fantasmatique de la lettre A3 et dans la réalité terre-à-terre de la lettre B34 (bien que cette missive soit pleine de respect), comme si elles n'étaient bonnes qu'à habiller et déshabiller les intellectuels fatigués.
Anne-Marie Turcan-Verkerk
676 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
ÉDITION DES DEUX RECUEILS
Étant donné l'importance de ce témoignage sur l'enseignement oral, nous n'avons corrigé le texte qu'en cas d'absolue nécessité. Pour les mêmes raisons, et pour respecter la perception que les copistes avaient du cursus, nous avons reproduit la ponctuation des manuscrits. On a indiqué par un accent la place de l'accent tonique dans les clausules rythmiques marquées par cette ponctuation. Les résumés en français permettront de débrouiller l'écheveau de la syntaxe. On a imprimé en italique les passages les moins lisibles (et donc les plus douteux), entre crochets droits les restitutions. L'apparat des sources n'est pas exhaustif, en particulier en ce qui concerne Pons le Provençal, dont nous n'avons pu que consulter l'œuvre dans le manuscrit lat. 8653 de la BN de Paris; lui-même devait beaucoup à Guido Faba. La plupart des textes cités (textes bibliques, proverbes etc.) ne le sont pas directement, mais sont sans doute puisés dans des traités antérieurs ou des listes comme on en trouve souvent dans les manuscrits à'artes dictaminis.
Paris, Bibl. de l'Arsenal f. 214-216
[f. 214 col. 2] A 1 - Un étudiant Orléanais demande de l'argent à son père pour acheter des livres de droit.
patri ac domino metuendo .b. civi parisiensi .c. humilis eius natus scolari [sic] ari- liensis salutem cum reveréncia filiali, cum scientia sit nobilis possessio illa est maxime appetenda que nobilissima reputatur hinc est quod in legum honorabili fa- cultate propono ultérius desudâre. quia sui possessores multum honoris consecun- tur. quare dominationi vestre suplicat devótio filiâlis. quatenus causa emendi codi- cem et digestum cum institutionibus quadraguinta1 libras parisiensium michi mi- tere procurétis. Scientes pro certo quod iste labor vobis et amicis nostris honorem et glóriam reportâbit
kl -Le père accepte.
.b. genitor civis parisiensis benedicto. filio .e. aurelianis scolasticis dedito disciplinis salutem et quicquid ysaac iacob cóntulit cum salute2. Si lingue [sic] loqueremur an- gelicis et afflueremus doctissimi sapientie [sic] salomonis quod inter mentis archa- nem concepimus ingens tripudium3 exprimere nequiremus quod tune vere suscepi- mus qui (?) nostris auribus tuarum patefecit series litterarum quod legali pericia
1 Ou quadraginta surmonté d'un tilde par erreur? 2 = Guido Faba (désormais GF), Summa XIII, p. 301. 3 tribpudium ante coir.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU ΧΙΠΕ SIÈCLE 677
proponis ultérius desudâre. tegitur4 nostram plantam volentes imbre saluberrimo inrorare5 tuamque petitionem cupientes amplecti6 nostre dextera largitatis tibi causa emendi codicem et digestum cum institutionibus quadraginta libras parisiensium gratanti ànimo destinâmus. veraciter cognoscentes quod semen nostrum fructifica- bit et non córruet in arénam. Si bene studueris ut cepisti benediximus7 expensas fac- tas8 et gratas reputâbimus faciéndas9.
A3 - Le père refuse.
b. genitor suo filio maledicto pro salute merórem10. et oprobrium sempiternum11 ge- nitoris amaricavit animam rumor nostrarum aurium Illsimis (?) et doloris nostra viscera multipliciter perturbâvit. quia relacionem [sic] intelléximus aliquórum. quod te inebrias turpiter in tabernis et die noctuque lupanaris sordibus suofocaris12 et Sic in gramatica que omnium liberalium artium dicitur fundamentum13 non posita firmo basi proponis ad legalem periciam te transferre propter quod patemum auxilium tibi exiberi humiliter postulasti quod [f. 214v] scias penitus te priuadum14 Si premissis ve- ritas sufragem (?) donec vitam tuam et habitum duxeris in mélius commutândum.
A 4 - Edouard Ier d'Angleterre engage Philippe le Bel à aller combattre en Terre Sainte.
Philipo dei gratia regi francorum suo consanguineo peramando .Ο. eadem gratia rex anglorum cum sincera dilectióne salutem. cordi nobis est diligentibus oculos pieta- tis in sanctam terram ierosolimitanam eripiendam de manibus paganorum que iacet ancilata15 canibus contributaria16 sarracenis quam saluator noster proprio sanguine consecravit17 vt humanum genus deperditum redimeret de sevicia inimici quo pro-
4 Sans doute pour te igitur (coir. Ch. Vulliez). 5 Les métaphores horticoles de ce type s'inspirent de Pons le Provençal : cf. Paris,
BN lat. 8653 f. 11 (cf. supra, n. 51). 6 approbari éd. Ch. Vulliez. 7 Pour benedixerimus? 8 Ce dernier mot est peu lisible, en particulier au début. 9 GF, Dictamina rethorica II, p. 86-87 : benedicimus expensas quas in te fecimus et
gratas gerìmus faciéndas. 10 II s'agit de l'une des formules de salutatio les plus banales : cf. GF, Summa VIII
(Generalis doctrina omnium salutationum), p. 299. 11 Formulaire de Baumgartenberg [quinta tabula salutationum] (éd. L. Rockinger,
Briefsteller und Formelbücher des 11. bis 14. Jahrhunderts, Munich, 1863-4 [Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte, 9], repr. Aalen 1969, p. 725-838) p. 742 [Salutacio parentum ad malum filium] «(...) vel pro salute obprobnum sempiternum et similia» : on suit toujours l'ordre du formulaire de Baumgartenberg = GF, Summa XIV, p. 302.
12 Ou suffocaris : il est impossible de décider. 13 Cf. GF, Dictamina rethorica LXII, p. 109 : «(...) Quare tibi mandamus ut in hoc an-
no debeas adhuc dicte scientie inherere [grammatice] que liberalium artium dicitur fundamentum » : la comparaison entre les traces d'écriture de A et ce texte de GF permet de restituer le passage illisible. Cf. aussi B31 : «Quesiui aurelianis scientiam et inueni que omnium artium liberalium primarium dicitur fundamentum·» .
14 Una tache à cet endroit empêche de lire. Il se peut que l'on ait corrigé le fautif pri- vadum en privaturum, encore plus fautif. En tous cas, on ne lit pas privandum.
15 ancüatam ante coir. 16 II est possible que le mot commence par un 9 tironien. 17 GF, Dictamina rethorica CLXXXXIII, p. 97 : ad eripiendam terram sanctam de ma
nibus paganorum, quam salvator noster proprio sanguine consecravit.
678 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
posito salubri crédimus vos teneri, quapropter vestram celsitudinem exorâmus. qua- tenus gentem regni vestii quantam poteritis congregetis ut in proximo festo nativita- tis beati johannis taliter transferetis ita quod domino opitulante debellantes barbari- cas nationes18 vitoriam célitus reportémus19.
A 5 - Les parents d'un clerc n'ont pas les moyens de financer ses études; il demande à un parent d'« obtenir pour lui un bénéfice» : sinon, il devra les interrompre.
Dilecto ac peramabili consanguineo armigero de tali loco20 .b. de tali loco clericus aur[elianis] insistans scolasticis disciplinis salutem cum sincere dilectiónis constân- cia21. cum parentibus meis proprie non subpetant facultates sicut vestra discreptio non ignorât quibus in scolis me vâleant subfulcire. interciso studio me remeare ad propria opportebit nisi aliunde mihi subsidium largiâtur. idcirco vestram multi- plicem bonitatem de qua gero fiduciam specialem precibus rogito subiectivis quate- nus mihi per vos vel per alios aliquod beneficium impetretis quo mediante ad lau- dem dei et gloriam vestii nominis et honore [sic] Studium prosequar incoactum et ipsum possim felici éxitu terminare.
A 6 - Réponse : son parent, un franciscain, a décidé les parents de l'étudiant à lui envoyer l'argent nécessaire pour financer ses études.
Vir religiosus et socius suus condam .fr. g. de ordine fratrum minorum .h. scolari aur[elianensi] salutem et ad premium celestis magnificiéncie pervenire, tuarum in- trospeeta serie literarum et plénius intellécta. considérantes quod ea que contine- bantur in illis ab equitatis tramite procedebant tuorum parentum corda sic propul- savimus admonendo quod infra proximum festum natalis domini se promiserunt ti- bi tantam summam pecunie22 transmissuros quod libros neccesarios [sic] ex ea emere poteris et in scolis commode sustentâri.
A 7 - Robert comte d'Artois, régent de Sicile, demande au roi de France son aide contre les rebelles siciliens.
Viro magnifico et excelso dignis et magnis laudibus decorato illustri dei gratia regi francorum .r. comes arteicensis23 salutem cunctis24 felicitâtibus afluéntem. aduersus sanctam romanam ecclesiam que in orbe terrarum disponente domino est cuncto- rum fidelium domina et magistra siculorum rebellium rabie seviente ipsis resistere non valeo cum paucorum numero bellatorum quia ubi existit vix absentia ibi necesse est
18 Cf. GF, Dictamina rethorica CLXXXXIV, p. 98. 19 GF, Dictamina rethorica CLXXXXIII, p. 97 : palmam victoriae celitus reportemus. 20 Armigero... loco : add. supra lin. 21 = GF, Summa XXIV, p. 307. 22 Pecuniam ante corr. 23 Peut-être un c écrit au-dessus du premier t. 24 Cod. 9 tironien suivi de l'abréviation de quis.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 679
quod ibe [sic]25 civitas opprimâtur. quocirca duxi vestram celsitudinem imploran- dam quatenus sic26 in vestrum (?) auxilium desinetis27 quod aversariis ita28 obsistere valeat et ecedat29 aduérsitas preliórum.
A 8 - Un clerc Orléanais envoie à un «socius» un Doctrinale glosé.
peramabili socio .P. de tali loco clerico .η. Scolaris aur[elianensis] salutem et dei et hominum grâtiam invenire30. Attendens quod socius in mundi machina nil carius re- putat quam si sibi alter faciat quod postulat et affectât31, doctrinale cum magnis glo- sulis de litera veraci et legibili tarn in nota quam in textu vobis emere fidéliter procuravi, quod per talem nuncium vobis mirto, paratus in hoc et in aliis societati vestre senper [sic] fâcere que sint grata.
A 9 - (Β 8 - Après la mort du recteur des écoles de grammaire de Saint-Martin de Tours, l'écolâtre Jean demande à M. et V., recteurs des écoles de grammaire de Sainte- Croix d'Orléans, de trouver un remplaçant. Celui-ci aura un bon salaire et beaucoup d'élèves.)
Iohannes scolasticus ecclesie beati martini turonensis. viris sapientibus et discretis .n. et v. rectoribus scolarum gramaticalium32 ecclesie sancte crucis aurer[ianensis] salutem et ea docere in terris que angelis placeant in excelsis33 cum rector scolarum nostrarum gramaticalium vocante domino de valle huius miserie migraverit ad superna nos volentes ipsis scolis viduatis providere de regimine magistrali, prudentiam vestram in quantum possumus deprecamur quod si rectorem apud vos possitis ydó- neum invenire. ipsum ad scolas nostras regendas fiduciâliter transmittâtis. scientes pro certo quod bona salaria34 ibidem recipiat [sic] et habebit multitudinem pueró- rum35.
A 10 - (B 10 - Les recteurs des écoles de grammaire de Sainte-Croix ont trouvé un bon grammairien qu'ils envoient à l'écolâtre de Saint-Martin de Tours.)
viro venerabili et discreto scolastico ecclesie beati martini turonensis rector scolarum gramaticalium sancte crucis aur[elianensis] salutem et paratam ad beneplâcita volumtâtem. Rogamina vestra que loco suscépimus mandatórum. effectui tradere
25 Pour ibidem ? 26 On lit un S avec un apex qui ressemble beaucoup à l'abréviation de «sigillum», mais
également à l'abréviation de sic dans la lettre A3. 27 Pour destinetis. 28 Ce dernier mot est souligné : supprimé? 29 Pour recédât ? Sans doute une haplographie, le 7 tironien et le r d'attaque étant très
proches dans cette écriture. 30 = GF, Summa XXVII, p. 308. 31 Guido Faba, cité par O. Redlich, Eine Wiener Briefsammlung zur Geschichte der
deutschen Reiches und der österreichischen Länder in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts, dans Mittheilungen aus dem Vaticanischen Archive, 2, Vienne, 1894, p. 317-31 (éd. d'après le manuscrit Vaticano, Ottob. 2115 : section des Exordia magistri Gwidonis), n° 67 : Amicus nil carius reputai quam si amico faciat quod affectât.
32 Gramaticalium add. supra lin. 33 = GF, Summa XXVIII, p. 309. 34 solacia ante coir. 35 Cf. GF, Dictamina rethorica CLXIII, p. 83 : multitudinem habebitis auditorum.
680 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
gestientes in scolis nostris inquisivimus diligenter si possemus vobis magistrum ydo- neum invenire et ibidem inquisitione habita diligenti36 rectorem invenimus in arte gramatica bene doctum quem ad vos duximus transmitendum existantes promti pâ- riter et parati, omni tempore vestre bonitatis beneplâcitum adimplére.
11 - (B 11 - Un étudiant Orléanais recommande à son père demeurant à Paris un marchand d'Orléans se rendant à Paris pour investir dans des tissus. )
Patri et domino metuendo .b. civi parisiensi .c. devotus eius natus Scolaris auri- lianensis filialem reverénciam cum salute, petrus civis aurilianensis mercator provi- dus et discretus qui mihi contulit multa servicia graciosa parisius nunc dirigit gres- sus suos. ut ibidem pecuniam suam in pannis débeat investire, quocirca paternita- tem vestram duxi attentius deprecandam quatenus eidem quidquid honoris et servicii potéritis faciâtis. considérantes quod qui honorem exibuit et servivit honorem et servicium iure méruit invenire.
[f. 215] A 12 - D. Boterei, qui est sur le point d'obtenir sa licence en droit et souhaite devenir professeur, demande à des parents, citoyens de Tours, de l'aider à subvenir aux frais d'examen.
Vins providis et discretis consanguineis peramatis .a. et b [et] .c. cognomine poterel- lis civibus turonis [sic] .d. boterei aurelianis in ultimo .V. legum volumine lectioni- bus elaborans cum salute vite cursum prósperum et longévum. dilectionis a fédère non recédunt. qui iustis amicis37 précibus condescéndunt. Vestra noverit dilectio mihi cara quod infra mensem favente deo finiem38 librum méum. quo finito licentiam in legibus adipisci poterò qua obtenpta conscribi desidero venerabili collègio profes- sórum. Sane cum tune oporteat me fâcere sumptus graves, vobis supplico quatenus in .C. libras parisiensium vos hâbeam provisóres. talìter quod meo principio sub- ventione vestra laudabiliter celebrato vestre dilectionis affectum recoligens per ef- fectum impensius39 ténear obligâtus.
A13-(B12-Le clerc M., étudiant à Orléans, demande à un parent d'intercéder auprès d'une abbesse pour lui obtenir un bénéfice.)
Domino et consanguineo proprie bonitatis mentis honorando40 rectori talis ecclesie .m. clericus aur[elianis] studio deditus literali salutem et quidquit potest servicii et honoris41. Cum vos sitis mihi post deum refugium singulare non est aliquâtenus ad- mirândum. si ad vos velud ad portum tutissimum necessitatis articulo recurrere non formido42. hinc est quod prudenciam vestram deprecor et requiro affectu43 quo vâleo amplióri. quatenus apud talem abbatissam vestris interiectionibus sic instare velitis
36 = GF, Dictamina rethorica CXVI, p. 62. 37 amicorum em. Ch. Vulliez. 38 On trouve la même graphie dans le Formulaire de Tréguier. Elle trahit l'identité de
prononciation (an) entre am et em. 39 Glose : magis. 40 = GF, Summa XVIII, p. 304. 41 = GF, Summa XII, p. 301. 42 Glose : timeo. 43 Glose : desiderio.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 681
et earn tâliter deprecali, quod sicut promisistis. ab ea mihi aliquod beneficium impe- tretis quo mediante sustentari valeam et aput deum me semper habeatis pro vobis assiduum rogatórem.
A 14 - (B 14 - Reinoldus envoie à son neveu V., étudiant le dictamen à Orléans, le Doctrinale et le Grecismus promis.)
x. rector talis ecclesie dilecto nepoti suo .b. aurelianis dedicato stùdio literâli. salu- tem et scientie incrementum promissionem nostram ad effectum dùcere cupiéntes. ne illis esse similes videamur qui quod verbis promittunt òpere non adimplent. per latorem presentium tibi doctrinale mittimus cum grecismo precipientes quod taliter scolasticis invigiles disciplinis quod de tuo studio fama percepta laudabili non so- lum in libris sed in aliis tibi succurrere teneâmur.
A 15 - (B 15 - Le chevalier G. demande de l'aide au seigneur F. contre tel chevalier qui le menace et ravage ses terres.)
Viro inclito et potenti domino .f. de tali loco militali singulo decorato44 amicorum precipuo .e. de tali loco miles salutem et amiciciam semper adquirere et adquisitam omni tèmpore conservare. Nobilitati vestre presenti pagina innotescat quod talis miles nobis minas intonai45 et insidias46 machinatur ut terram nostram ingrediatur hostiliter et ut earn incèndio copulétur [sic]*7. Quoniam igitur amicicia fallax de facili lâbitur ad promissa. sed verax semper invenitur pronta in obséquiis amicorum. amiciciam vestram caram quam in negociis nostris invénimus liberalem, omni af- fectione qua póssumus exorâmus. quatenus tali die in nostrum veniatis subsidium tam magnifice quam potenter48, ut vestra et aliorum amicorum nostrorum potentia et virtute prefati hostis nostri cornua retundere valeâmus.
A 16 - (Β 13 - R., étudiant Orléanais, «citation» de Sénèque à l'appui, rappelle à son oncle qu'il lui avait promis, au début de ses études de dictamen, un Doctrinale et un Grecismus.)
Domino et avonculo suo pre mundi ceteris honorando. presbitero talis loci .r. Scolaris aur[elianensis]. salutem et reverencie débite famulâtum. Sicut moralis philo- sophus seneca protestatur cum cetera recuperabilia sint solum tempus inrecuperâ- bile potest dici49, iusxta [sic] quod dicitur. dampna fleo rerum sed plus fleo dâmpna diérum50. quod quidem tempus perditur hoc51 librorum caréneiam vel deféetum.
44 Dans sa Summa dietaminis, Laurent d'Aquilée conseille de saluer ainsi les chevaliers : «egregio viro et strenuo militi vel nobilissimo viro, domino .P. milicie cingalo decorato vel militari gloria refulgenti» (texte consulté dans le ms. Vaticano, Ottob. lat. 877 f. 142- 153).
45 Glose : inferi. 46 insidiai ante corr. 47 Glose : destruatur. 48 = GF, Summa LXXVII, p. 334, Dictamina rethorica XXXVII, p. 100 et CLXXXXIX,
p. 99. 49 C'est le thème développé dans Sénèque, Ad Luc. I, 1, 3. 50 H. Walther, Prov. n° 4893. 51 Pour ob.
682 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
cum itaque mihi ad literale Studium recessuro doctrinale promiseritis et grecismum et ceteros libros gramatice oportunos quibus indigeo inpresenti discreptionem ves- tram propensius rògito et expósco. quatenus mihi eosdem libros per latorem presen- cium destinetis in quibus mihi studenti tempus inutiliter non labâtur.
A 17 - (Β 18 - Un clerc étudiant le dictamen à Orléans écrit à B., abbé de Marmoutiers, et à son frère N., prévôt de telle église, qui lui ont confié leur neveu : il faut envoyer à celui-ci une lettre de menace qui le remette dans le droit chemin et l'encourage à étudier. )
Reverendo in christo patii et domino metuendo .b. abbati maioris monastérii turo- nénsis. et .n. eius fratri rectori talis ecclesie bonitate omnimoda commendando, talis clericus Scolaris aur[elianensis] seipsum cum omni protitudine [sic] serviéndi. dum ad literale Studium dirigerem gressus méos. nepotem vestrum mee custodie deputasti [51c] districius iniungéntes. quod si deviaret in aliquo vel erraret vobis meis literis intimârem. licet autem predictus nepos vester bene proficiat tam in móribus quam in doctrina. quia tarnen non nocet amisso subdere calcar equo supplico ut ipsi verba minatoria destinetis quibus a maio proposito retrahatur et inanimetur fórcius adis- céndum52.
A 18 - Un étudiant en appelle à l'évêque de Chartres contre ses détracteurs.
Reverendo patii ac domino, domino episcopo carnotensi. eius talis Scolaris humilis et devotus salutem et fidem cum detractóribus non ferire, exitus aquarum deduxe- runt oculi mei. et adhuc torrentes effluerunt lacrimârum. nan fallaces quidam invidi detractores contra me non per viam sed per invium53 procedentes contra me graviter sunt locuti. suscipiatis causam meam pater reverende cum mansuetùdine et favóre, nam favente deo fidedinorum54 testimonio me super oiectis cognoscere potéritis in- nocéntem. et contra iustum mendacia proponentes subdolos55 et mendâces.
A 19 - [lettre copiée d'une écriture encore plus cursive, d'une encre pâle déchiffrable seulement aux UV] Des étudiants demandent à un maître de leur enseigner /'ars dictaminis.
Viro discretionis titulis insinito. tali magistro scolares eius humiles et devoti salutem et ad sedem (?) conscéndere celsiórem. Ut ebriantes hauriant latices Ad fontem vé- niunt siciéntes. Rex munificus et eternus pectus vestrum fonte dictavit uberrimo scilicet arte dictaminis preciósa Nos autem cupientes fieri dictatóres. ad vos tamquam ad fontem recurrimus suplicantes quatenus56 nobis artem dictaminis velitis per régulas aperire Taliter quod per vos in arte dictaminis informati vobis condigna stipendia referentes dictare possemus de materia quâlibet occurénti57.
52 Pour ad discendum. 53 Cf. GF, Dictamina rethorica XI, p. 90 : et cum sis nunc in invio et non in via. 54 Glose : .1. fidelium gencium. 55 Glose : fraudulentes. 56 Ici, le double q est surmonté du signe -us. 57 Cette lettre s'inspire manifestement de la première lettre du recueil de Pons le Pro
vençal (je cite d'après le manuscrit BN lat. 8653 f. 9) : Viro discretionis et morum titulo pre- pollenti magistro pondo ildefonsus eius scohris et amicus fidelissimus salutem et dilectionis omnimode firmitatem. Ad fontem veniunt cum desiderio sicientes ut inde potum hauriant
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU ΧΠΡ SIÈCLE 683
[f. 215v] A 20 - Un chevalier envoie son fils à un dictator réputé.
Viro venerabili et discreto tali magistro talis miles salutem et adquisitam sciencie margaritam58 karitative suis scolâribus dispensare, decet hominem bone fame per effectum nomini respondere vos spéculum dictatórum. fama prédicat incepisse sco- laribus legere flores et régulas dictature Si quidem filium nostrum cupientes fieri dictatórem59. ipsum ad vos mittimus exorantes quatenus cum reliquis in talibus vos habeat instructorem taliter quod in ipso reniteat doctrine solercia cònsona vestre fame, scientes quod sub maiorum numero (?) vobis pro labore respondébimus larga fauce60.
A 21 - Réponse favorable du dictator. Viro nobili ac potenti tali militi laudibus armorum militibus excellendo talis magis- ter salutem et armorum laudibus assidue gloriâri. peticioni vestre [r]ationi consone me noveritis inclinâtum. filium autem vestrum quem vultis fieri dictatórem. favente deo tâliter informâbo. quod erit aliis dictatoribus spéculum et exemplar.
A 22 - Réponse d'un lector à ses étudiants : il leur promet de leur trouver un local tranquille pour s'exercer à l ars dictaminis.
Suis scolâribus mèrito diligéndis. talis lector cum salute sciencie compleméntum. Vos artem dictaminis totis viscéribus affectantes, locum pacificum quéritis ad dic- tândum. hinc est quod vestre cupimus satifâcere [sic] voluntâti. ad exercicium dictature post festa vobis repromito locum ydoneum et quietum necnon diligénciam et la- bórem. tâliter quod minores, médiocres proficere póterunt et maióres.
A 23 - Un étudiant se défend contre les médisances : contrairement à ce qu'on dit de lui, loin de courir les tavernes, il passe son temps à travailler.
pirito*1. Theseus amoris constanciam et mendaciis non crédere detractórum. sagita firmum lâpidem non dirimit. sed resilians62 sepe vulnerat dirigéntem. vobis subies- sit63 detractio malignorum quod studio pretermisso potationibus illicitis exponé-
preoptatum. Deus creator omnium in vestro pectore fontem uberrimum epistularis dulcis dictaminis procreavit; unde salientes rivuli per canales vestre facundie corda multorum sco- larium habundantissime rigaverunt. Et quoniam multi desiderant et ego pre cunctis aliis ut tamquam virgultum variis herbis et floribus. arboribusque et frondibus decoratum epistula- rium componatis secundum ordinem et modum summe dictaminis de competenti dogmate quam vestra veneranda discretio compilavit. in quo quidem epistulario de omni materia consueta possit subiectis rubricis epistularum copia inventri, discretionem vestram de qua magnam gero fìduciam precor instantissime quantum possum ut predictum opus ad honorem dei et utilitatem multorum facere procuretis. Estis enim vera uittis dictaminis et multi scolares erunt per hoc opus si feceritis vestri palmites procreati ve/ propagati quod erit vobis decus et gloria per omnia secula seculorum amen.
58 Cf. GF, Dictamina rethorica XLI, p. 101. 59 dictatures ante corr. 60 favore coni. Ch. Vulliez. Le mot fauce, que je crois lire, donne un cursus velox. 61 Pirithoos. 62 Restliens et resiltans transcrivent une même prononciation. 63 = subiecit.
MEFRM 1993, 2 48
684 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
bam. sed quia per dentés et labia64 menciuntur de me talia promulgentes noveritis quod in studio laudabiliter persevero, iuxta tenorem mandati vestii solicite preca- vens ne tempus éxeat occiósum. Ceterum quia dominus destruet vanilogos et men- daces favente deo fructum sciéncie reportâbo65. taliter quod detractio premissorum in capita mendacium potent redundâre.
A 24 - Un maître en dictamen raconte sa rencontre avec Rhétorique sur les bords de la Loire : elle lui confie les clés de la cité sur laquelle elle règne, Pratica dictature : il s'agit d'une simplification de la célèbre lettre de Pons le Provençal.
Universis scolaribus sedulis et devotis. talis magister in arte dictâminis salutem. ac firmiter retinere mirabilia que secutur. Omne bonum exuberans duci débet in publi- cum ut proficiat singulis et pateat universis dum supra ripam ligeris pridie spaciarer vidi virginem generósam. cuius elegantiam vix describerit eloquéntia tulliana, cuius visa pulcritudine stupefactus ad pedes eius me réddidi provolutum66. virgo quidem me respiciens ac subridens. manu benivola sublevâvit. aduxit intra menia civitatis propinque septem portis plândidis [51c] circumcinte. in medio siquidem civitatis erat palatium cuius structura preciosis lapidibus refulgebat in ingressu vero palata due scale nobiles ponebantur in quarum prima summum gradum romanus tenevat pon- tifex ac sub eo per ordinem totus clerus in alia strenuus imperator sub se regens or- dinatum populum laicalem ceterum veloces noncii veniebant singula referentes que geruntur sub anbitu firmamenti quibus visis admirans pecii que nam virgo esset et quo nomine civitas vocarétur. ad hec virgo respondens famine gracióso67 dixit. fili vócor retòrica68, et hec civitas pràtica dictature, cuius optineo principâtum. sane, quia pauci sunt istius incole civitatis. cuius gramâtica. sibi vendicat prefecturam tibi gramatice nutricio curioso trado claves ut portas apperias volentibus ingredi civitâ- tem. accédant igitur qui cupiunt fieri dictatures, nam paratus sum scolaribus appetire portas per quas doctrina dictâminum figurâtur. taliter quod clarescere poterit omnibus summum bonum dictatórie facultatif .
A 25 -Un tel, victime des rapines de son voisin, le menace de représailles.
Talis tali oprobrium sempiternum et per laqueos incidere quos teténdit. Nostrorum novimus subditorum queremonia lacrimosa quod tu qui semper queris quem dévores aut quid rodas simplices nostros agricolas et colonos depredaris tam graviter quod merito dicerie lupus râpax. hinc est quod tibi precipimus et mandamus quate- nus ablata restituas et amodo talia non audeas perpetrare quod si feceris nostri po-
64 Cf. Sap. 1, ó. 65 Cf. GF, Summa XX, p. 306. 66 Ce n'est pas biblique, mais on trouve presque l'expression dans une vie de saint :
Passio sanctorum Hermagorae episcopi et Fortunati diaconi (manuscrit Namur, BC 53, 61e texte), éd. dans AB, 2, 1883, p. 311-316 (311) : ad pedes eius provolutus. La source, nécessairement commune, serait-elle une hymne?
67 graciosa ante corr. 68 rectorica ante coir.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU ΧΠΡ SIÈCLE 685
puli defensores tibi laqueo69 parabimus quos ///res et sancies70 impeditam (?) salutem quem (?) dant hostes tuti contraria vérba saluti71.
[f. 216] A 26 — Un étudiant qui, en quittant son pays, a confié ses affaires à son frère, se plaint de sa gestion et exige des comptes.
Tali vilico fratri meritis nominando talis Scolaris sic fratris négocia dirigere ne quid offici perdi <distinctio>72 nomen totâliter adsequâtur. amor fratrum non est in solido qui locorum vel tenporum pervértitur intervallo73, cum de nostris exirem partibus ut ad Studium me transférrem. vos rebus meis ut decwii confitenter constitui provi- sórem. sane quia sancio quod res meas tepide geritis et remisse recurrens ad illud quod sapientis dicit auctoritas non in omni fratre tuo74 fiduciam habeas, nam plures sunt fratres vocabulo quorum noscitur opere raritudo per présentes literas. vobis mando, quatenus tali fideli meo quem procuratorem meum constituo generalem ta- lem compotum de meis reddatis negociis quod inter nos post modum quod absit nec oriatur materia questionis scientes quod maio profectum per alium quam per fra- trem recipere detriméntum.
Vaticano, Borghese 200 f. 4v-8v
[f. 4v] Β 1 - H., clerc faisant des études de droit canonique et/ou de grammaire à Orléans, se porte bien et demande à ses parents des subsides pour acheter des livres de droit.
Dilectissimis ac precordialissimis parentibus suis nicolao filio W. et margarete in officio de tali loco commorantibus eorum devotus filius .h. clericus aur[elianis]75 commorans et iuris canonici studio deputatus uel gramaticali scientie inuigilans condingnam reverentiam et filialem subiectiónem cum salute. Vestram reverendam dilectionem volo non latere me per dei gratiam fore salvum et incolumem et optimis scolaribus et bene studentibus fóre confederâtum. sed quia iuris canonici scientia requirit ut auditores sui sint libris competéntibus premuniti, alioquin eorum Studium parum valet, et labor et sumptus sunt inanes et quia pro libris iuris mihi necessâriis. fere totam pecuniam quam mecum aur[elianis] attuli iam expendi et non habeo unde possum diutius sustentari in studio nisi velitis mihi lârgi- ter suffragâri. dilectionem vestram atténtius déprecor. quatenus per latorem presen- tium .X. libras parisiensium mihi sine excusatione âliqua transmittâtis. omnes ami- cos nostros amicabiliter et salutétis val[éte].
69 Pour laqueos. 70 Pour senties. 71 Citation du v. 53 de Yars dictaminis contenue dans Β (= ν. 56 du manuscrit de Münc
hen) : la règle versifiée suit sa mise en pratique. 72 On lit ici un mot beaucoup plus pâle, d™ : un distinctionem mal entendu est-il deve
nu distinctio nomen? Doit-on penser à per distinctionem? Cette phrase n'est pas limpide. 73 Cf. Pons le Provençal, manuscrit Paris, BN lat. 8653 f. 3v : [Proverbia amicorum ad
amicos] Amicorum vera dïlectio nec locorum nec temporum dissolvitur intervallo. 74 nec exponctué. 75 //urelianis rubrique au-dessus de l'abréviation aur'.
686 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
Β 2 - P. demeurant à Orléans félicite son ancien professeur de s'être fait franciscain76 et lui souhaite de persévérer, le mettant en garde contre le découragement possible11.
Precordiali socio suo quondam .magistro .p. viro religioso de ordine fratrum mino- rum .p. genabi . moram trahens78 salutem et inceptum opus melius persequi sed79 óptime terminare. Sicut aspectus in speculo dilucidai intuéntem. sic epistula vestra mihi missa meam faciem reseravit quando per earn lucide intellexi quod ad frugem melioris uite domino inspirante venerabilem fratrum minorum hâbitum assumpsis- tis. quocirca humiliter supplico deo celi ut vobis concédât perseverantiam in bonis opéribus inchoâtis. attendentes quod multum melius est ab incepto desistere quam ab eodem turpiter póstmodum resilire80. prestolantem beatam spem et adventum glorie mangni dei quern mereamini facie ad fâciem contemplali81.
Β 3 - Pierre, habitant de tette ville, veut que son fils arrête ses études; qui lui procurera des bénéfices «qu'on n'obtient de nos jours que moyennant prière ou prix» ? Qu'il apprenne un métier manuel pour nourrir femme et enfants.
Petrus opidanus talis ville filio suo caro petro salutem subiectam (?) gratis et honóri- bus opuléntam82. Usquequaque83 non tolerabo te scolas in futurum frequentare, qui- nimmo84 tedet me nimis quod solum elémentum didicisti. quis etenim ecclesiastica beneficia tibi procurabit que85 uix hodie conferuntur nisi prece uel précio mediante. que86 duo mergunt animas ad interitum et conscientias labefâciunt patronórum. placet igitur ut artem addiscas mechanicam de qua liberos et uxorem vâleas educare rescriptio.
Β 4 - Réponse du fus, qui a L· vocation depuis l'enfance et a confiance en Dieu. Obediendum est paternis iussionibus licitis et honestis sed in hiis que vergunt87 ad salutis dispendium88 est patribus intrépide referèndum, hinc est quod ab evo puerili miliciam desideraverim clericalem vitam in hac professione constanter decrevi
76 Les mendiants recrutaient volontiers parmi les maîtres et étudiants, «chassant» essentiellement dans les grands centres universitaires : cf. J. Verger, «Studia» et Universités, dans Le scuole degli ordini mendicanti (secoli XIII-XIV), Todi, 1978, p. 182-4 (Convegni del Centro di studi sulla spiritualità medievale, 17). Orléans possédait un Studium franciscain à la fin du XIIIe siècle : cf. C. Ribaucourt, Panorama degli studia degli ordini mendicanti. Francia Centro-settentrionale, dans Le scuole..., p. 81.
77 Cf. thème de la lettre 28 de Tréguier. 78 Tréguier lettre 145 (f. 3) : Andegavis in studio moram trahens. 79 Ou scilicet? Sed est abrégé de la même façon dans la lettre B4. 80 Guido Faba dans l'éd. d'O. Redlich, n° 122 : Non est ab incepto aliquatenus opere
desistendum donec fructus respondeat faboranti. n° 127 = Baumgartenberg 106 : Laudabi- lius creditur opus non inceptum relinquere (B : opus non incipere) quam a cepto turpiter póstmodum resilire.
81 Cf. GF, Dictamina rethorica CLI, p. 78 : quatenus perseverantiam, auctore domino, in bonis operibus habeatis, expectantes beatam spem et adventum glorie magni Dei quem vi- dere facie ad faciem mereamur.
82 Glose : plenam. 83 Glose : aliqua rottone. 84 Glose : pro certe. 85 Abréviation de quia. 86 q surmonté d'un tilde. 87 Glose : uadunt. 88 Glose : dampnum.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 687
consummare neque sum de beneficio curiósus. non enim famelicum me relinquet qui dat escam omni carni et pullis coruorum qui ad éum clamant89
Β 5 - [f. 5] Pierre, prévôt de telle église, invite son neveu, étudiant à Orléans, à ne pas faire L· grasse matinée.
Petrus talis ecclesie rector suo nepoti precaro studenti aurelianis proficere tam in móribus quam in doctrina. Quemadmodum in ewangelio fatuis virginibus dor- m[i]entibus ianua nuptiârum est preclùsa, pari modo scolaribus sompnolentibu[s] et in lecto pigritie tardântibus90. precludetur assensus id est cumulatio (?) ad laudem et honorem preterea non sit tibi vanum manne surgere ante lucem quia promisit scientia corónam uigilânti.
Β 6 - L'étudiant H. se tient à la disposition de son collègue P.
Precaro suo socio quern gratia commendai multiformis .p. clerico moranti in tali loco .h. merens laboribus studiorum salutem quam sibi. Epistolam salutariam [sic] vestre dilectioni laudabili decrevi destinandam in qua vos flagito sociâliter et amice, quatenus in omnibus in quibus vestrum sedet beneplacitum ad meam parvitatem fi- delem habeatis ingressum scientes curissime91 quod vestris voluntatibus paratus sum obtémperans92 nunc et semper.
Β 7 - Un prêtre salue son neveu et se tient à sa disposition.
Talis presbiter suo nepotulo proficere in omnibus et salutem constanter et societati vestre semper fâc[ere] que sunt grâta93.
Β 8 - (A 9 - Après la mort du recteur des écoles de grammaire de Saint-Martin de Tours, l'écolâtre Jean demande à M. et V., recteurs des écoles de grammaire de Sainte- Croix d'Orléans, de trouver un remplaçant. Celui-ci aura un bon salaire et beaucoup d'élèves.)
Iohannes scolasticus ecclesie beati martini turonensis viris sapientibus et discretis m. et .b(v). rectoribus scolarum gramaticalium ecclesie sancte crucis aurelianensis salutem et ea docere in terris que angelis plâceant in excélsis94. Cum rector scolarum nostrarum gramaticalium vocante domino de valle huius miserie migraverit ad superna nos volen[tes] ipsis scolis viduatis providere de regimine95 magistrali, pruden- tiam vestram inquantum póssumus deprecâmur. quatenus si rectorem ydoneum possitis apud vos inveni[re] ipsum ad scolas nostras regendas fiduciâliter transmittâ-
89 Ps. iuxta LXX 135, 25 : qui dat escam omni carni, et Ps. iuxta LXX 146, 9 : et dat iu- mentis escam ipsorum et pullis corvorum invocantibus eum : le texte selon l'hébreu est encore plus lointain : il faut peut-être supposer un intermédiaire.
90 Tréguier lettre 145 (f. 3) : in lecto jacens egritudinis. 91 Pour certissime? 92 Glose : À. obediens. 93 Tréguier lettre 4 (f. f. 12v) et 157 (f. 20) : facere que sint grata, = GF, Dictamina re-
thorica CLVIII, p. 81 etc. Cf. lettre A8. L'indicatif est inhabituel dans cette formule. 94 = GF, Summa XXVIII, p. 309. 95 Sur ce terme, cf. O. Weuers, Terminologie des universités au XIIIe siècle, Roma,
1987, p. 295-6.
688 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
tis. scientes pro certo quod bona psallaria ibidem recipiet et habebit multitudinem puerórum96.
Β 9 - L'expéditeur remerete son collègue V., étudiant à Orléans, de lui avoir procuré un manuscrit glosé (le Doctrinale) et se tient à sa dùposition.
Precordiali socio suo clerico .b. scolari aurelianis intendenti scolasticis disciplinis .e (?) [salutem] et philosophie palâtium introire97. societati vestre que sicut aurum pu- rissimum renitescit et exhibitione operum comprobatur actione relata multimoda gratiârum. ex eo quod mihi doctrina[le] cum mangnis glosis emere curavistis et per talem nuncium destinare, vestram sinceram d[ilectio]nem rògito multa préce. quate- nus si qua penes me vobis utilia sint et grata sic a me ut a// petere nullâtenus dubité- tis. in vero scientes quod petitio vestra repulsam minime pa[tiétur]
Β 10 - (A 10 - Les recteurs des écoles de grammaire de Sainte-Croix ont trouvé un bon grammairien qu'ils envoient à l'écolâtre de Saint-Martin de Tours.)
Viro venerabili et discreto scolastico ecclesie beati martini turonensis rectores sco- [larum] gramaticalium sancte crucis aurelianensis salutem et paratam ad beneplâci- ta volumtâtem. Rogamina vestita] que loco suscepimus mandatorum effectui tra- dere gestientes in scolis nostris inquisivimus [dili]genter si possemus vobis magis- trum idoneum invenire et ibidem inquisitione habita diligen[ti]98 rectorem invenimus in arte gramatica bene doctum quem ad vos duximus transmi[ttendum] existentes prompti pariter et parati omni tempore vestre volumtatis beneplâcitum" adimplére
B11-(A11- Un étudiant Orléanais recommande à son père demeurant à Paris un marchand d'Orléans se rendant à Paris pour investir dans des tissus.)
Patii et domino metuendo vel100 civi parisiensi .c. devotus eius natus Scolaris aurelianensis filial[em] reveréntiam cum salute, petrus civis aur[elianensis] mercator providus et discretus qui mihi con[tulit]101 multa servicia gratiosa parisius nunc diri- git gressus suos ut ibidem pecuni[am] suam in pannis debeat investire quocirca pa- ternitatem vestram duxi attentius deprecan[dam] quatenus eidem quicquid honoris et servicii potéritis faciâtis. Considérantes quod qui honorem [exi]buit102 et servivit honorem et servicium iure méruit invenire.
96 Cf. GF, Dictamina rethorica CLXIII, p. 83 : multitudinem habebitis auditorum. 97 = GF, Summa XXVII, p. 308. 98 = GF, Dictamina rethorica CXVI, p. 62 : inquisitione habita diligenti. 99 Cod. : benepacitum.
100 All : .b. Le manuscrit Β porte nettement uel, mais il est possible que le copiste n'ait pas compris, et pris un b pour une abréviation de uel : les deux sont très proches dans ce type d'écriture.
101 Cf. Β 40 : «seruiciorum... cottatorum» : on ne distingue ici que le 9 tironien. 102 D'après A 11.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU ΧΠΙΕ SIÈCLE 689
Β 12 - (A 13 - le clerc M., étudiant à Orléans, demande à un parent d'intercéder auprès d'une abbesse pour lui obtenir un bénéfice.)
Domino et consanguineo proprie bonitatis meritis honorando103 rectori talis ecclesie .m. clericus aur[elianis] studio deditus literali salutem et quidquit potest servicii et honoris104 [f. 5v] Cum sitis mihi post deum refugium singulare non est aliquatenus ammiran- dum si ad vos velud ad ad [sic] portum tutissimum necessitatis articulo recurrere non formido. hinc est quod prudentiam vestram deprecor et requiro affectu quo vâ- leo amplióri. quatenus apud talem abbatissam vestris intercessionibus sic instare ve- litis et earn taliter deprecâri. quod sicut promisistis ab ea mihi aliquod beneficium impetretis quo mediante sustentari valeam et apud deum me semper habeatis pro vobis assiduum rogatórem
Β 13 - (A 16 - R., étudiant Orléanais, «citation» de Sénègue à l'appui, rappelle à son oncle qu'il lui avait promis, au début de ses études de dictamen, un Doctrinale et un Grecismus.)
Domino et avonculo suo pre mundi ceteris honorando presbitero talis loci .r. Scolaris aur[elianensis] salutem et reverentie débite famulâtum. Sicut moralis philo- sophus seneca protestatur cum cetera recuperabilia sint solum tempus irrecuperàbile potest dici, iuxta quod dicitur dampna fleo rerum sed plus fleo dâmpna dié- rum105. quod106 quidem tempus perditur ob librorum caréntiam vel deféctum. Itaque107 mihi ad literale Studium accessuro doctrinale promiseritis et grecismum et ceteros libros gramatice oportunos quibus indigeo inpresénti. discretionem vestram propensius rògito et expósco. quatenus mihi eosdem libros per latorem presentium destinétis. in quibus mihi studenti tempus inutiliter non labâtur.
Β 14 - (A 14 - Reinoldus envoie à son neveu V., étudiant le dictamen à Orléans, le Doctrinale et le Grecismus promis.)
Reinoldus rector talis ecclesie dilecto nepoti suo .b. aurelianis dedicato108 studio literali salutem et sciéntie increméntum Promissionem vestram ad effectum ducere cupientes ne illis esse similes videamur qui quod uérbis promittunt. òpere non adimplent. per latorem presentium tibi doctrinale transmittimus cum grecismo, pre- cipientes quod taliter scolasticis invigiles disciplinis quod de tuo studio fama precep- ta laudabili non solum in libris sed in aliis tibi succurrere teneâmur.
103 = GF, Summa XVIII, p. 304. 104 = GF, Summa XII, p. 301. 105 H. Walther, Prov. n° 4893. On trouve dans le manuscrit München, lat. 641 (XV) f.
28v cette suscription : «Quidam studens». 106 Ici : abrévation du quod relatif. 107 A : Cum itaque. 108 Glose : coniuncto uel dedito.
690 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
B15-(A15-Le chevalier G. demande de l'aide au seigneur F. contre tel chevalier qui le menace et ravage ses terres.)
Viro inclito et potenti domino .f. de tali loco militari cingulo decorato amicorum precipuo .g. de tali loco miles salutem et amiciciam semper acquirere et acquisitam omni tèmpore conservare. Nobilitati vestre presenti pagina innotescat quod talis miles nobis minas intonat et insidias machinatur ut terram nostram ingrediatur hos- tiliter et ut eam incèndio populétur109. Quoniam igitur amicicia fallax de facili labi- tur ad promissa. set verax semper invenitur prompta in obséquiis amicórum110. ami- citiam vestram caram quam in negotiis nostris invénimus liberalem, omni affectione qua póssumus exorâmus. quatenus tali die in nostrum veniatis subsidium tam man- gnifice quam potenter111 et vestra et aliorum amicorum nostrorum potentia et virtute prefati hostis nostri cornua retóndere valeâmus - rescriptio
Β 16 - Réponse : rendez-vous tel jour pour vaincre les ennemis.
Quoniam amicos vestros diligimus cordis et ànimi puritâte. ac habemus odio inimi- cos qui vos in persona vel in rebus112 ledere moliuntur persequémur ad mortem, bene noveritis quod tali die in vestrum veniemus auxilium sic strenue sic potenter quod de vestris hostibus suffragante divina potentia uictóriam consequémur.
Β 17 - JR., clerc étudiant à Orléans, se met au service de M., chanoine de Tours, et lui demande son aide.
Suo domino plurimum reverendo .m. canonico turonensi .r. clericus seipsum cum omnimoda promptitudine famulândi. quamvis non corpore sed animo sum in vestro servicio constitutus cogitane qualiter vobis possim grata servicia impartiri. quia ubique sum et ero vester famulus volo esse cunctis temporibus vite mee sane quia in studio aur[elianensi] iuxta mee modulum parvitatis laboro haurire aquam de fónti- bus prime mâtris. vos de gratia tantum rogo ut in aliquo mihi vestra dominatio auxilium largiâtur.
Β 18 - (A 17 - Un clerc étudiant le dictamen à Orléans écrit à B., abbé de Marmoutier, et à son frère N., prévôt de telle église, qui lui ont confié leur neveu : il faut envoyer à celui-ci une lettre de menace qui le remette dans le droit chemin et l'encourage à étudier.)
Reverendo in christo patii et domino metuendo .b. abbati maioris monasterii tu- ron[ensis] et .n. eius fratri rectori talis ecclesie bonitate multimoda commendando, talis clericus Scolaris aur[elianensis] seipsum cum omni promptitudine serviéndi. Cum ad literale Studium dirigerem gressus meos nepotem vestrum mee custodie de- putastis discretius iniungentes quod si deviaret in aliquo vel erraret vobis meis literis intimârem. licet autem predictus nepos véster. bene proficiat tam in moribus quam
109 Cod. populeter ou populetis : l'abréviation du modèle a été mal interprétée. 110 Guido Faba dans l'éd. d'O. Redlich, n° 89 : Amicicia fallax prompta est ad promiss
a, sed verax semper reperitur ad exhibicionem operis preparata : cf. Baumgartenberg 106. 111 = GF, Summa LXXVII, p. 334, Dictamina rethorica XXXVII, p. 100. 112 Cf. GF, Dictamina rethorica XLJV, p. 102 : in personis vel rebus vobis vel alicui ves-
trumS offensam (...).
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 691
in doctrina quia tarnen nocet admisso subdere calcar èquo, supplico ut ipsi uerba minatoria destinetis quibus a maio proposito retrahatur et inanimetur fórcius ad discéndum
Β 19 - [f. 6] Un chevalier informe le seigneur Flo. qu'un de ses serfs (vassaux ?) a pénétré dans ses terres, dont il a dépouillé et emprisonné le régisseur; il demande la restitution de ses biens et la libération du régisseur : sinon, il se vengera lui-même.
Viro strennuo et potenti mangnifico domino .fio. de tali loco quem doctrina exor- n[at] et militaris glòria recomméndat113. talis miles salutem et tocius altitudinis in- creméntum. Rem non modicum enormem114 que débet singulis sapientibus displi- cere ad vestram sapientiam duximus deducen[dam] qualiter talis servus vester violenter nostrum territorium115 intravit et custodem ipsius ibidem inveniens spolia[vit] eumdem et spoliatum carcerali custòdie mancipâvit116. quocirca vestram pruden- ciam exoramus quatenus tantum ma[le]ficium sic animadversione117 debita puniatis quod ceteris presumptionibus vestra non pateat dile[ctio] facientes nilominus spolia restituì spoliato et ipsum reddi pristine libertati ne nos ad quod veniremus inuiti118 de prefato malefactore uindictam sumere compellâmur. R. rescriptio.
Β 20 - Réponse : les biens seront restitués, le régisseur libéré, le coupable puni. Nobis vestre nobilitatis litera patefecit quod talis servus noster ingressus est vestrum territorium v[io]lenter et ipsius custodem nequiter spoliavit et spoliatum tradidit custodie carcerali de quo tristamur non m[o]dicum et dolemus cum vos et vestros et vestra puritate cordis et ànimi diligâmus. Cuius rei ell vobis facimus manifestum119 quod spoliato spolia integre restituì faciemus et ipsum redd[i] pristine libertati malefactore [sic] taliter puniendo quod impunitum facinus non transibit âliis in//120
Β 21 - H., étudiant Orléanais, remercie le clerc G. de ses bienfaits et lui demande de défendre les intérêts de son père en cas de besoin.
Benefactori precipuo et domino dingnis meritis multipliciter honorando .g. de tali loco clerico .h. s[cola]ris aur[elianensis] salutem et si quid simile potest salubrius in- veniri. Ne ingratitudinis vicio videar laborare pro e[o] quod sum a vobis corporaliter separatus super multis beneficiis que vestre largitatis munificentia mihi f[ecit] vobis refero gratiarum multimodas actiones121 supplicane ut si patri meo aliquis iniurie- tu[r] in rébus uel in persóna122, et ipsum et bona eius velitis defendere contra quem- libet offensorem ad hoc si no[n] fuerit taliter vos habentes quod vobis tenear ad grata servicia et honores
113 Cf. GF, Summa XXXVIII, p. 314. 114 GF, Dictamina rethorica CXVII, p. 62 : Rem gravem non modicum et enormem. 115 Glose : .i. manerium. 116 Glose : .t. dédit. 117 Glose : pena. 118 II manque sans doute une conjonction de coordination. 119 est vobis facinus manifestum? 120 II faudrait 3 syllabes paroxytones pour le cursus, mais il y a de la place, statistique
ment, pour environ 2 ou 3 lettres. 121 Tréguier lettre 76 : cum gratiarum multimoda actione. On trouve la même expres
sion dans les lettres 96, 109, 131. Cf. lettre 107. 122 Cf. GF, Dictamina rethorica XLIV, p. 102.
692 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
Β 22 - Un étudiant Orléanais a eu recours au Saint-Siège pour obtenir un bénéfice dépendant de tel abbé. Il demande au prévôt de telle église, ami de cet abbé, d'intercéder pour lui : il évitera ainsi de devoir une seconde fois s'adresser au Saint-Siège.
Suo domino plurimum honorando rectori123 talis Scolaris aurelianensis salutem cum omnimoda probitâte124 Vestra prudencia bene novit quod contra talem abbatem lite- ras a sede apostòlica impetravi, quod mihi prom[iserat] de primo beneficio vacaturo quod ad suam collationem principâliter pertinéret. Quoniam igitur [et] dicitur et est verum eidem abbati estis amicicie vinculo copulati vestram multiplicem boni[tatem] de qua teneo indubitatam fiduciam duxi suppliciter deprecandam125 quatenus erga prefatum abb[atem] pro me intercedere vos velitis ut cum dictum beneficium vacare contigerit me non debeat [molestare sed tradere potius efféctui quod promisit. Ita quod me non oporteat iterum propter hoc ad sed[em] apostolicam proficisci.
Β 23 - Β., prévôt de telle église, informe C, étudiant à Orléans, qu'il a fait la démarche auprès de l'abbé pour qu'il lui donne le bénéfice dès sa vacance.
Β rector talis ecclesie solo verbo et non opere dilecto scolari .e. aurelianis literali studio commendato [salutem] et metam scientie àssequi peroptâtam. Ut non tantum nomine sed re possimus amicus veraciter app[ellari] tuis profectibus et commodis promovendis intendere cupimus debita sollicitudine diligénter. Itaque noveris quod illieo cum ad nos tue litere pervenerunt ad talem abbatem dirigere curav[imus] gres- sus nostros et eumdem per nos et per amicos nostros fuimus taliter deprecati quod ipse sicut [in] scripto domini pape plenius continetur te investiet absque difficultate ut tenetur (?) de pri[mo] beneficio vacaturo quod ad suam dominationem dinóscitur pertinére.
Β 24 - R., étudiant Orléanais, a remplacé son maître P., maintenant maître de philosophie à Paris, à la tête des écoles de grammaire; il réclame le reliquat de son sa- hire, 100 sous.
Viro literato militie cingulo decorato magistro .p. parisius commoranti .r. Scolaris aurfelianensis] salutem [et in] scolis philosophie militiam exercére. Opinor quod a vestra memoria non recessit qualiter in regi[mine] scolarum talium gramaticalium vester [sic] éxtiti vice doctor, et de meo psallario mihi non integre respondistifs] quoeirca vestram rogo prudentiam circonspectam quatenus mihi .c. solidos qui re- manserunt de meo psalla[rio] persolvendi mihi per latorem presentium mittere non tardétis. Attendentes quod indingnum est et da[mp]num equitanti ut merces mercenarii commoretur apud dóminum usque mane126.
123 Peut-être manque-t-il ici un tali. 124 Cod. : prouitate. 125 Cf. GF, Dictamina rethorica CXLI, p. 73. 126 Glose : .i. usque ad mane.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 693
Β 25 -Le clerc M. réclame à R., marchand Orléanais, les 100 sous parisis qu'il lui a prêtés.
.R. mercatori aurelianensi provido et discreto .m. de tali loco clericus salutem et de mercibus [sic] multiplica[tum] colligere capitale127. Sicut in libro de gestis militum continetur quisque débet persolvere sibi liberaliter mutuatum cum igitur .c. solidos parisiensium vobis mutuaverim sicut scitis d[ilec]tionem vestram rògito incessânter. ut latori presentis nepoti meo illos sine diffic[ul] [f. 6v] [t]ate âliqua persolvâtis. tan- tum exemplum facientes quod vobis de rebus meis tenear facere grâtiam et amórem.
Β 26 - M., étudiant à Orléans, a fini ses études de grammaire et veut faire du droit. Il rappelle à son père L., de Paris, qu'il lui a demandé de quels livres il avait besoin : il lui faut de quoi acheter des livres de droit.
L civi parisiensi suo peramabili genitori .m. devotissimus filius Scolaris aurelianen- sis filialem reveréntiam cum salute. Pater karissime vobis scripsi quod cum in gra- matica stabilire proposuerim fundamentum ad honorabilem legum facultatem de- siderabam dirigere gressus méos. Idcirco vobis memini me scripsisse ut pro libris necessariis emendis mihi pecuniam mitteretis et vos mihi postmodum mandavistis quibus libris indigerem et ego dominationi vestre notifico quod libris128 legalibus in- digeo sine quibus nec valeo proficere nec studére.
Β 27 - Le prieur et les moines de Saint-Mesmin de Micy, après la mort de leur abbé V. (B. ?), reprochent à Jean Cholet, cardinal-légat, de leur avoir donné un mauvais abbé et demandent son remplacement.
Reverendo in christo patri et domino metuendo. Iohanni tituli sancte129 cecilie presbitero cardinali sedis apostolice legato humilis prior et conventus monachorum mo- nasterii sancii maximini aurelianensis dyocesis promptum et devotum in òmnibus famulâtum130. Postquam felicis recordationis .b(v?). abbatis nostri spiritus transiit ad superna firmiter credebamus habere nostrarum fidelem medicum animarum qui monasterium nostrum sublimaret et eius bona in statu conservarci débito et augé- ret. sed ecce131 inimicus homo quem nobis dedistis132 vestra prudentia in abbatem in accipitrem est conversus qui columbas sibi commissas dispergit pariter et conturbat bona etiam nostri cenobii dilapidât et consumit. Quare vestre clementie humiliter
127 Cf. GF, Summa LX, p. 326 : salutem et de mercimoniis multiplicatum colligere capitale.
'■ Cod. : libris libris. 1 Cod. : ancte.
130 Cf. GF, Summa XL, p. 315 et GF, Dictamina rethorìca LXI, p. 108. 131 Cod. : ecce sans tilde. 132 Cod. : -stis exponctué d'une encre différente, sans doute postérieure. Avec «dedi»,
on ne comprendrait pas le «vestra prudentia» , ni l'ensemble de l'échange épistolaire.
694 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
supplicamus quatenus a nobis removeatis dictum pessimum inimicum nostro mo- nasterio de nomine providéntes. qui animas nostras regat et nostri monasterii bona non dirimat sed augméntet. rescriptio.
Β 28 - Réponse de Jean Cholet, cardinal-légat, au prieur et au couvent de Saint- Mesmin de Micy : il s'est laissé tromper par la bonne tête de ce moine de Saint- Mesmin, nouveau Judas; qu'il aille se pendre, il sera remplacé sous peu.
I divina miseratione tituli sancte cecilie presbiter cardinalis apostolice sédis legâtus. religiosis vins priori et conventui monasterii sancti maximini aurelianensis dyocesis salutem in domino. In angelum lucis aliquando se transformat angelus tenebrarum ut simplices et incautos subtilius fallere valeat sua uersutia multifórmi, prodiit igitur de vestrorum fratrum numero novus iudas quern cum pro viro mangno et ydoneo ecclesie vestre fiducialiter elegerimus in rectorem mentitus habitum bonitatis quem representabat in vultum nostre fefellit conscientie puritatem et post dingnam pro- missionem regiminis per osculum confirmatam accedere non timuit ad vestii dilapi- dationem cenobii dissimulata nequicia proditòrie [Rjemovéatur ergo celeriter iniquitatis filius ab opere nefandi et recedens a vobis index ille nefarius lâqueo se suspéndat133. Nam in proximo recipietis abbatem qui procurator erit ydoneus tam rerum ecclesie quam monasterii vestii et vestrarum fidelis erit médicus animârum.
Β 29 - C, étudiant le dictamen à Orléans, demande à son père G. dele venger, s'il en a l'occasion, d'un clerc qui lui a fait du tort.
Reverendo genitori .g. de tali loco .c. humilimus eius natus aurelianis deditus studio literali cum filiali subiectióne salutem. Paternitatem vestram non latere opinor grâ- vem iniuriam. et non modicum detrimentum intulisse vobis et mihi talem cléricum sine causa. Cum itaque qui alteri facit iniuriam et dâmpnum procurât, et dampnum et iniuriam mèrito paeiätur. Dominationi vestre supplico reverenter quatenus si par- tibus in vestris dictus clericus potuerit inveniri eidem reddatis pro mentis taliónem
Β 30 - Pour ne plus être à sa charge, R., étudiant Orléanais, demande à son père P. de solliciter un bénéfice d'un évëque dont il a été sénéchal.
Honorando patii post deum super omnia huius mundi et domino .p. de tali loco militari cingulo decorato .r. humilimus filius Scolaris aurelianensis salutem et quicquid boni ioseph iacob prébuit suo patii134. Quamvis necessârium non existât, quia cum equs stimulatus currere velócius consuévit. paternitatem vestram rogito supplicando135 ut talem episcopum pro me rogare velitis. cuius fuistis longo tempore senescal-
133 Mt. 27, 5. 134 Formulaire de Baumgartenberg (quinta tabula salutationum), p. 742 : [Salutacio
filiorum ad parentes] (...) vel salutem et quidquid boni Ioseph Iacob prebuit patri suo et multa similia = GF, Summa XII, p. 301.
135 supplicandam ante corr.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 695
lus quod ipse mihi provideat in beneficio competenti ut vobis non sim honeri ad ex- pensas et Studium prosequi vâleam inchoâtum
Β 31 - Ν. est venu à Orléans étudier «le premier de tous les arts libéraux» (la grammaire), mais voudrait se rendre à Pans pour étudier la philosophie. Il demande à M., demeurant à Paris pour la même raison, de lui trouver un logement et des socii pour étudier.
Sociorum karissimo .m. de tali loco parisius causa logicalis studii commoranti .n. Scolaris aurelianensis salutem et philosophic palâtium introire136. Quesivi aurelianis scientiam et inveni que omnium artium liberalium primarium dicitur fundamen- tum137 sed modum sciendi de cetero querere me oportet quem dyaletica veritatis in- quisitam ad omnium methodorum principia viam habens proculdubio subministrat. Cum itaque in proximo paschate parisius ad studendum in loica firmum habeam propósitum accedéndi. societatem vestram duxi affectuosius exorandam quatenus mihi hospitium et honestam societatem querere studeatis per quam possim splendore scientie illustrali considerane et atténdens. quod cum sancto sanctus ero et cum innocente innocens et peruertar per contrârium cum peruérso138
Β 32 - Ni., étudiant Orléanais, prie son parent Lam. de demander à ses frères de lui envoyer de l'argent pour acheter des livres, et de lui en prêter lui-même.
Suo peramabili consanguineo .lam. de tali loco .ni. Scolaris aurelianensis salutem et dierum longitudinem cum honore. Ad vestram gratiam liberalem recurro in necessi- tatis articulo confitenter penes quam precamina mea effectum sentient quem requi- runt. hinc est quod [f. 7]139 cum libros non habeam oportunos sine quibus margari- tam scientie140 non vâleo ad[i]pisci. prudentiam. vestram instanter postulo quatenus fratres meos pro me velitis taliter exorare quod ipsi mihi pro libris emendis trans- mittant tantam pecunie quamtitâtem. alioquin vos mihi de vestra pecunia succurra- tis quam vobis restituere integre procurâbo. Attendentes quod ubi nécessitas imminet ibi subvenire consanguineus consanguineo promptus esse débet et ipsum non relinquere in a//141
Β 33 - Réponse : M. avise M., étudiant Orléanais, qu'il a demandé à ses frères de lui envoyer de quoi acheter des livres et faire les dépenses opportunes.
Dilecto consanguineo .m. scolari aurelianensi .m. de tali loco salutem et pervenire ei ad metam scientie peroptatam. Tua négocia sicut propria promovere cupiens di- ligenter quarum142 introspecta et intellecta plenius serie literarum ad fratres tuos accedere illico properavi monens eosdem taliter et inducens quod infra principium instantis quadragesime tibi tantam summ[a]m pecunie mittere procurabunt quod libros necessarios poteris comparare et de residuo stipendia fâcere oportuna
13é = GF, Summa XXVII, p. 308. 137 Cf. GF, Dictamina rethorica LXII, p. 109. 138 Ps. iuxta LXX 17, 26-7 : cum sancto sanctus eris et cum uiro innocente innocens eris
et cum electo électus eris et cum peruerso peruerteris. 139 Marge supérieure : qui sua dat minus. 140 Cf. A 20; 141 On lit ai 142 Pour tuarum?
696 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
Β 34 - V. n'a plus de vêtements corrects pour revenir dans ses foyers; il demande à sa tante paternelle (cousine ?) de lui envoyer du tissu.
Reverende matertere sue .b.i. salutem cum promptitudine serviéndi. sicut equs sine phâl[eris] deridétur. Sic vir scolasticus contempnitur nisi vestibus decéntibus deco- rétur. Iuxta quod versifiée solet dici, vir bene vestitus pro vestibus esse peritus credi- tur a mille quamvis ydio[ta] sit file143. Vnde cum in proximo paschate proponam ad propria remeare ut inter homine[s] honorabiliter vâleam apparére. vestram dilectio- nem precibus rogito subiectivis144 quatenus mi[hi] pannum ad camicam et ad super- cimicale mittere procurétis. scientes me sanum [et] incolumem permanere quod de vobis audire desidero péctore scitibundo.
Β 35 - P., étudiant Orléanais, demande à son parent P., professeur de grammaire, d'intercéder auprès de son père, sourd comme le serpent «qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre L· voix du charmeur», pour qu'il lui envoie de l'argent.
Peramabili congnato suo magistro .p. floribus eloquentie purpurato145 gramaticalis sci[entie] laudabili professori .p. Scolaris aurelianensis salutem et ad ea docere in terris que deo placea[nt] et ângelis in exélsis146. Propulsavi viscera genitoris ut in sco- lis penuriam paci[e]nti mihi aperiret et porrigeret suam déxteram largitâtis. sed eius aures sic sunt forftiter] opturate quod non valent ad clamorem nimium excitari ad instar surde aspidis aures suas opturantis ne uocem audiat incantântis. Quia ig[itur] vestris consiliis pater meus sepius acquiescere consuevit. vestre prudentie bonita- te[m] que sufficiens creditur in hac parte rogito reverenter ut sic eidem vestris inter- cessionib[us] instare velitis quod ab eo per vos meis necessitâtibus consulâtur
Β 36 — F., étudiant Orléanais, demande à V., étudiant à Paris (en philosophie), de le représenter lors d'un procès.
Suo socio precordiali .b. scolari parisius147 commoranti .f. Scolaris aurelianensis salutem et ad pedes philosophie crebris vigiliis accubâre148. Cum parisius die tali co- ram officiali auctoritate /// //ca149 quosdam adversarios meos fecerim convenni et ad
143 H. Walther, Prov. n° 33505. 144 «preces... subiectiuas» est une formule fréquente chez Laurent d'Aquilée. Cf. aussi
A5 : precibus rogito subiecttuis. 145 Cf. Laurent d'Aquilée, Summa dictaminis «Qualiter scribitur magistris et aliis li-
teratis» : . «... fîoribus eloquencie purpurato» (texte consulté dans le ms. Vaticano, Ottob. lat. 877 f. 142-153).
146 Cf. GF, Summa XXVIII, p. 309. 147 Cod. : par' : parisien ante corr. : le scribe lui aussi a un modèle comportant des
abréviations. 148 = GF, Summa XXVII, p. 308. 149 Ou //ta? On pourrait déchiffrer à la fin de la ligne précédente un 9 tironien; le co
piste a-t-il mal lu le mot contra?
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU ΧΙΠΕ SIÈCLE 697
diem interesse non possim aliis negótiis impeditus. dilectionem vestram duxi fidu- cialiter exorandam quatenus pro me et v[ice] mei ad diem coram eodem iudice in- tersitis. attendentes quod fidelitas socialis in necessitatife[us] socium relinquere minime consuévit.
Β 37 - /., étudiant Orléanais, informe son père G. qu'il arrête ses études et a des dettes à payer; si son père veut qu'il revienne bien vêtu et à cheval dans ses foyers, qu'il lui envoie de l'argent.
Reverendo patii et domino metuendo .g. de tali loco militari cingulo decorato .1. de- votiss[imus] eius natus aurelianensis Scolaris filialem subiectionem omnimodam cum salute. Tractus150 prolixi temporis iam ela[p]so in agone scolastice milicie pro viribus detribavi a quo cessare géstio151. quia quod caret al// requie diutius non sub- sistit. Cum itaque revidere proponam lares pâtrios circa pâscha. supplico quatenus152 mihi pro meis debitis solvendis et pro eméndis véstibus. ut inter homines honorabi- lius app[arere]153 valeam pecuniam destinetis et si vobis placeat quod eques redeam mihi equm ad dictum locum nilóminus154 transmittâtis.
Β 38 - /. a compris d'après h lettre de son fus G. qu'il avait beaucoup de dettes; il lui envoie de quoi acheter un cheval et 10 livres pour payer ses dettes et faire les achats nécessaires.
Iohannes genitor de tali loco miles .g. suo filio benedicto salutem et dei et hominum grâtiam inveni[re]155 Requiem quam petis cessandi a tuo studio laudabiliter terminato156 tue filiationi annuimus [et] necessariam tribuimus ad propria revertendi et quia per tuas literas intelleximus multis debi[tis] te teneri et vestes cóngruas non habére. tibi per nostrum famulum et latorem presentis causa [re]meandi equm mittimus et parisientium .X. libras de quibus debita tua persolvere poteris et [res] emere oportu- nas et de residuo ad lares pâtrios repedâre.
Β 39 - [f. 7v] Le chevalier C. demande à P., évêque de Chartres, un bénéfice pour son fiL·, étudiant le droit à Orléans (cf. lettre 30).
Suo domino metuendo .p. dei gratia .carnotensi episcopo .e. de tali loco miles seip- sum cum omni promptitudine serviéndi. Aliqua servicia que paternitati vestre ohm fecerim me aliquatenus non inducunt nec propria mérita me invitant, quibus su- mam audâtiam vos rogândi. sed sola vestra dementia que preces sibi porrectas reci- pit et receptas mandat débito compleménto, hinc est quod cum filium hâbeam. aure- lianis in scolis legali peritie insudantem quem oportet expensas157 mangnas facere in eodem et libros acquirere sumptuósos. vestre domination! duxi devotissime suppli-
150 Pour tractu. 151 Glose : cupio. 152 On devine ce mot dans un pli du papier. 153 Cf. lettre B34. 154 Glose : tarnen. 155 = GF, Summa XXVII, p. 308. 156 Cf. GF, Dictamina rethorica II, p. 86. 157 expensa ante coir.
698 ANNE-MARIE TURCAN -VERKERK
candam quatenus eidem in competenti dingnemini beneficio providere ut158 ad lau- dem dei et vestii nominis gloriam et honorem ad fructum scientie véniat peroptâ- tum159. rescriptio
Β 40 - P. évêque de Chartres, en reconnaissance des services qu'il lui a rendus, demande au chevalier C. de lui envoyer son fils (cf. lettre 30).
.P. divina miseratione carnotensis episcopus dilecto in christo filio .e. de tali loco militi saluterà in dòmino sempitémam. Quamvis vestris literis nóbis expresséritis. sicut ex earum significationibus intelleximus evidenter quod pretextu serviciorum vestro- rum nobis fideliter collatorum non inténditis nos rogare, cum nos eorum non imme- mores existentes vobis et vestris volumus160 subvenire et facere gratiam quam póssu- mus speciâlém. quia indingnum esset et dissonum equitati si bonis bonitas non pro- desset et obsequium prestitum fideliter et devote non sequeretur condingna remunerâtio de labóre, hinc est quod tale beneficium quod nunc vacat ad nostram collationem spectans tali vestro filio duximus conferéndum. mandantes ut eumdem ad nos sine more dispendio destinetis illud de nostris mânibus recepturum.
Β 41 - M., étudiant le dictamen à Orléans, réclame à son oncle, prieur demeurant à Paris, le complément de son bénéfice (?).
Viro religioso et honestate multimoda renitenti avunculo .n. priori talis loci parisius commoranti .m. devotissimus eius nepos aurelianis literali studio dedicatus seipsum cum promptitudine famulândi. Promissionem quam mihi fecistis de provisione vos decet dùcere ad efféctum. ne vestra verba nuda remaneant sed complementum debi- tum sortiantur proinde vestram prudentiam cum affectione rogito et instantia quanta possum quatenus sicut promisistis in competenti beneficio mihi dingnémini pro- vidére. vestram manum adiutricem nilóminus porrigéntes161. ita quod inceptum Studium vestra suffragante gratia laudabiliter terminetur considerando quod ignis flagrantia prope positos calefâcere consuévit. pótius quam remótos
Β 42 - R., étudiant Orléanais, demande des subsides et des livres à son oncle, gardien des frères mineurs de tel lieu.
Sanctitate animi et honestate corporis162 prefulgenti suo avunculo gardiano fratrum minorum talis loci .r. devotissimus nepos Scolaris aurelianensis reverentie débite fa- mulâtum. Vestre discretionis prudentiam existimo non latere quod nullus Scolaris studere potest vel proficere in doctrina quacumque sit ingenii prospicacis163 nisi
158 et ante coir. 159 Tréguier lettres 117 : fructum.. scientie peroptatum et 142 (f. 19) : fructus colligere
scientie peroptate; GF, Dictamina rethorica LXI, p. 109. Pons le Provençal dans Paris, BN lat. 8653 f. 11 col. 2 : et ad peroptatum fructum scientie pervenire.
160 Le manuscrit, du fait d'une tache, n'est pas très lisible en cet endroit; vôlumus, contrairement à velimus, permet de retomber sur un cursus velox : vôlumus subvenire.
161 Tréguier lettre 134 (f. llv) : manus dignemini porrigere adiutrices; idem lettre 138 (f. 17v). Cf. GF, Summa CLXXIX, p. 386 et CLXXX, p. 388.
162 corporeis cod. 163 Pour prospicacia, voire perspicacia; prospicacis donne un cursus velox.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 699
sumptibus et libris necessariis fulciatur quorum defectum perpetiens164 vobis duxi humiliter supplicandi ut sicut promisistis velitis mihi succurrere misericorditer in eisdem ut per hec bona et alia que inspirante domino feceritis possitis ad eterna gau- dia pervenire - rescriptio
Β 43 - Réponse : le gardien des frères mineurs ne peut tenir sa promesse pour le moment, son neveu devra attendre.
Humilis gardianus et indingnus fratrum minorum talis conventus dilecto nepoti .r. scolari, aurelianensi salutem et sciéntie increméntum. Promissio quam tibi fecimus de libris et de sumptibus oportunis processit a linea parentele165 que nos inuitat pari- ter et inducit ut in honorem nostri ordinis tuis profectibus et utilitâtibus intendâ- mus. Verum profectibus et utilitâtibus intendâmus. Verum quia dictam promissio- nem non possumus nunc ad effectum ducere bono modo tam diu te condecet expec- tare quousque tibi valeamus sicut desideras providére.
Β 44 - [f. 8] {cette version des faits n'est pas introduite par rescriptio) B., gardien du couvent des frères mineurs de Chartres, envoie à son neveu R., étudiant le dicta- men à Orléans, 100 sous tournois.
.B. insufficiens et indingnus gardianus conventus fratrum minorum carnotencium dilec[to] nepoti suo .r. aurelianis literali studio commendato salutem et ad fructum sciéntie pervenire. Promissionem quam tibi fecimus irritare nolimus sed ducere potius ad effectum ne ill[is] esse similes videamur qui quod promittunt non exsolvunt in tèmpore competenti, mittimus na[m]16é tibi χ. solidos turonensium per presentium delatorem qui- bus libros necessarios emas et sumptus fâcias ο//167
Β 45 - Un prêtre de paroisse demande à P., évêque d'Orléans, de conférer la clérìcature àD.
Reverendo in christo patri et domino metuendo .p. dei gratia aurelianensi episcopo talis plebanus salutem [et] obedientiam tam débitam quam devótam. Dignum est et consonum rationi ut sancta mate[r] ecclesia ille [sic] se prebeat beniuolam et exhi- beat liberalem qui eius obsequiis desiderant se asscribi et clericali caractère in- singniri. cum igitur lator presentium .d. add[i]168 cupiat milicie clericali . pro ipso
164 Glose : .i. valde paciens. 165 Cf. GF, Dictamina rethorica XX, p. 93. 166 Ou na[mque]. 167 Nous sommes en fin de ligne, au bord du feuillet : l'adj. oportunos, usuel dans ce
genre de contexte (cf. lettres 33, 38, 43) donnerait un cursus velox. 168 Glose : .î. admittll.
MEFRM 1993, 2 49
700 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
démentie vestre precibus supplico subiectivis quatenus eid[em] coronarti benedic- tam de beningnitate vestre grâtie conferâtis. scientes quod existit legitimo matrimonio procreatus et bonis moribus et sciéntia redimitus.
Β 46 - M, étudiant Orléanais, demande à Lambert, marchand parisien, de lui rendre l'argent qu'il lui a prêté.
LAmberto civi parisiensi discreto et provido mercatori .η. Scolaris aurelianensis sa- lutem et de mer[cibus]169 multiplicatum recolligere capitale170. Non est dispendium inferendum unde gratia est pot[ius] reportânda. proinde vos exoro ut latori presen- tium et meo nontio speciali [e]am summam pecunie quam vobis liberalster mutuavi qua multum indigeo persolvatis et vobis de rebus meis alia vice tenear facere grâ- tiam et amórem
Β 47 - Le chapelain M. informe le chapelain M. qu'il a célébré les bans de B. et M. et que personne ne s'est opposé au mariage.
Dilecto et precordiali amico .m. talis loci capellano .m. capellanus talis ecclesie cum omnimoda dilectione et devotióne salutem. Amicicie vestre care presènti, pagina pa- [te]fiat quod nos antiquam et probatam consuetudinem imitantes in ecclesia nos- tr[a] tria banna indiximus sollempniter per très dies et nullus apparuit contradictor qui [op]poneret impedimentum vel obstaculum quo171 unus .b. parrochianus noster cum .m. parroch[ia]na vestra fedus valeat perficere coniugale unde inter ipsos in christi nomine matrimónium cele[brâvi]
B 48 - Un prêtre de paroisse informe R., officiai d'Orléans, qu'il a célébré les bans de B. et Ma. et que quelqu'un s'est opposé au mariage; que faire ?
.R. karissimo amico suo et domino dingnis meritis honorando et iuris prudentia et facti ex[perien]tia redimito officiali aurelianensi talis plebanus salutem et quicquid potest servitù et honoris. Prudentie vestre tenore presentis litere innotescat quod cum in ecclesia mea inter .b. meum parroch[ia]num et .ma. parrochianam talem super contractis sponsalibus banna celebrarem solempnit[er] de consuetudine approbâta. quidam apparuit contradictor se asserens eidem mulieri pri[us] quam secundus fidem dedisse cum ea de matrimònio contrahéndi. Quare super hoc articulo [quid] sit agendum vestra dis- cretio mihi débeat respondére.
B 49 - G. réclame à ses parents A. et B. de l'argent pour étudier plus longtemps.
Reverendis parentibus .a. et .b. et post deum super omnia diligendis .g. eorum devo- tissi[mus] et unicus filius salutem cum reveréncia filiali. Per experientiam didici manifeste q[uod] exiguo tempore acquisita sciéntia cito labitur nisi per continuationem susceperit increment[um] quia stultus est ille merito reputandus qui se credit multa
169 Cf. lettre B25. 170 Cf. GF, Summa LX, p. 326 : salutem et de mercimoniis multiplicatum colligere ca
pitale. Cf. B25. 171 Glose : pro ut pro ut.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU ΧΠΙΕ SIÈCLE 701
paruo tèmpore di[di]cisse. Cum ergo usque ad proximum festum nativitatis beati io- hannis baptiste propo[nam] in studio remanere pecuniamque non habeam mihi ad festum huiusmodi suscept// supplico ut mihi pecuniam destinétis. considérantes quod arescit in brevi [ramus]culus qui fomentum non récipit a radice172
Β 50 - Un tel a promis à son collègue d'assassiner son ennemi, mais il aime mieux manquer de parole que tenir sa promesse en commettant un crime.
Talis suo socio salutem et presentia mala fugere et futuris utilitatibus providére. Oc- cidit Heródes iohânnem. ut iusiurandum quod fecerat illicite adimpleret et ideo sup- plicium méruit gehennâle. licet igitur fide vobis promiserim quod talem vestrum in- terficerem inimicum cum ipsam observare aliquâtenus non propóne Considerans quod in malis p[romis]sis melius est fidem rescindere quam fidem sceléribus adim- plére173
Β 51 - [f. 8v] Le moine B. demande au moine C. d'aider son neveu à obtenir un bénéfice et de lui avancer de l'argent; il lui remboursera tout.
Dilecto in christo fratri .b. monacho talis loci .c. eiusdem loci monachus salutem et sinceram in domino caritâtem. Ad dei fiduciarii atque vestram meum nepotem et la- torem presentis ad romanam curiam nunc transmitto. fraternitatem vestram rogans attentius et exposcens quatenus eumdem adiuvare velitis ad aliquod beneficium im- petrandum et si pecunia indiguerit sibi liberalster mutuétis. scientes quod quicquid eidem duxeritis mutuandum integrâliter vobis réddam
B 52 - N., étudiant Orléanais, demande à son bienfaiteur M. de le prévenir s'il récupère ou essaie de récupérer auprès de ses parents l'argent qu'il lui a prêté à Orléans; il lui demande de solliciter pour lui l'aide de son oncle.
Benefactori precipuo amico precellenci et honorando domino meritis proprie boni- tatis174 .m de tali loco .η. Scolaris aurelianensis salutem et tarn promptum quam de- bitum in omnibus famulâtum175. exhibita vobis gratiarum multiplici actione176 super infinitis benefieiis que in scolis vestre bonitatis lârgitas mihi fécit. a vestra gratia postulo incessanter ut mihi rescribere177 vos velitis si a meis parentibus manam ar- genteam quam aurelianis mihi liberaliter mutuastis recepistis vel recipere inténditis ab eisdem. ad hec affectuosissime vos exoro ut meum talem avunculum rogitétis. quatenus mihi manum suam pórrigat adiutricem178.
172 H. Walther, Prov. n° 887d. Cf. Tréguier lettre 134 (f. llv) : sicut ramusculus exa- rescit nisi fomentum reeeperit a radice; même expression dans la lettre 143 (f. 21v). Variante dans Tréguier lettre 138 (f. 17v) : Ut avulsus ramus ab arbore exarescit, sic puer in studio evanescit nisi alimenta habuerit qui ministret. GF, Exordia (de filiis parentibus et consan- guineis tam ascendentibus quam descendentibus et collateralibus) : Arescit in brevi ramusculus qui fomentum non recipit a radice, interversion de ramusculus et in brevi dans le manuscrit Vaticano, Ottob. 2115 = l'éd. d'O. Redlich, n° 123.
173 Guido Faba dans l'éd. d'O. Redlich, n° 105 = Baumgartenberg 105 : In malis pro- missionïbus melius est fidem rescindere quam promissum sceleriter adimplere.
174 Cf. GF, Summa XVIII, p. 304. 175 Cf. GF, Summa XVIII, p. 304 et GF, Dictamina rethorica LXI , p. 108. 176 Cf. GF, Dictamina rethorica CCXIV, p. 105. 177 Cod. : rescribe. 178 Tréguier lettre 134 (f. llv) : manus dignemini porrigere adiutrices; idem lettre 138 (f.
702 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
Β 53 - Reinoldus, chanoine de Tours, demande à P., clerc demeurant à Tours, de lui acheter un saumon pour fêter le début des cours sur les Institutes : à Orléans, le poisson est si cher que même les riches ne peuvent en acheter.
Reinoldus canonicus ecclesie beati martini turonénsis. dilecto clerico suo .p turonis commoranti salutem et dei [et] hominum grâtiam invenire179. Cum aurelianis nunc temporis tanta caristia piscium habeatur quod non solum pauperes sed etiam diuites uix possunt attingere ad eósdem. tibi presenti sedula demandamus quatenus unum psalmonem emere procures et nobis non différas destinare quia sequenti eb- domeda proponimus incipere institutam et nostris sociis et amicis sicut moris est convivium celebrare
Β 54 - H. a décidé d'être moine et demande à son père G, citoyen de Tours, de lui envoyer du tissu pour son habit.
Honorando patii suo et domino metuendo .g. civi turonensi .h. humilimus filius salutem et reverentiam in omnibus filiâlem. Paternitati vestre tenore presentis pagine innotéscat180. quod abbas talis monasterii solo divino intuitu et amore181 me recepii in suum monachum et confrâtrem182. paratus me induere quandoque183 monaste- rium volo ingredi hâbitum monachâlem. Quare dominationi vestre duxi devotissime supplicândum. Quatenus mihi pannum mittere non tardetis ad monasticum hâbitum competéntem
17v) : cf. GF, Dictamina rethorica LXXXVII, p. 119 : manum vestram extendere dignemini adiutricem et GF, Summa CLXXDC, p. 386 et CLXXX, p. 388 est plus proche d'A et B.
179 = GF, Summa XXVII, p. 308. 180 Tréguier lettre 102 : presenti pagina innotéscat. 181 Cf GF, Dictamina rethorica CLV, p. 79, = Dictamina rethorica CLXXXV, p. 94. 182 Tréguier lettre 27 : ... rectpere dignemini in monachum et confrâtrem. De même
dans la réponse (lettre 28); lettre 33... recipere in monachum et confrâtrem. 183 Avant monasterium, une note illisible dans la marge.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 703
Annexe 1
LE CURSUS ET L'INFORMATIQUE
Note préliminaire : selon des habitudes bien établies, ρ désigne un mot paroxyton, pp un mot proparoxyton; le chiffre qui précède ρ ou pp correspond au nombre de syllabes du mot concerné. 1 désigne les monosyllabes, 2 les dissyllabes.
L'analyse statistique du cursus a été mise au point il y a une vingtaine d'années par Tore Janson1. Dans une langue rythmée naturellement comme le latin, on est toujours en droit de se demander si les clausules rythmées sont fortuites ou recherchées par l'auteur. Pour le savoir, plutôt que de comparer des textes sans rapport entre eux, Janson a mis au point une méthode de «comparaison interne»2. Il distingue donc une «fréquence observée», correspondant au nombre de clausules rythmiques effectivement présentes dans le texte, d'une «fréquence attendue». Pour chiffrer cette dernière, Janson isole toutes les fins de membres de phrases (deux mots3) et calcule des probabilités sur le mariage de tous les premiers mots des clausules avec tous les seconds mots. Si la différence entre les deux fréquences est importante, on pourra supposer que le cursus est particulièrement recherché ou évité. On voit d'emblée la limite de cette méthode : la fréquence attendue étant calculée sur un stock de mots déjà «suspect», pris dans l'ordre, surdéterminé, où ils apparaissent dans le texte, la différence réelle entre les deux fréquences ne peut apparaître4. Mais T. Janson faisait ses calculs à la main, ce qui lui interdisait pratiquement de s'attaquer à un corpus plus vaste.
En nous inspirant de cette méthode, dans son principe excellente, Philippe Ver- kerk et moi-même avons mis au point un programme informatique d'analyse du cursus5. Ce programme calcule les fréquences attendues de trois façons différentes :
1 T. Janson, Prose Rhythm in Medieval Latin from the 9th to the 13th Century, Stockholm, 1975 (Studia Latina Stockholmiensia, 20).
2 T. Janson, Prose Rhythm..., p. 19 sqq. 3 D s'agit de deux mots accentuels, ce qui ne signifie pas nécessairement deux mots
graphiques, en vertu de la «consilfabicatio» prise au sens le plus étroit : on considère par exemple comme un mot de 4 syllabes un mot de 3 syllabes accompagné d'une préposition, d'une négation, de l'auxiliaire «être» etc.
4 T. Janson, évoquant le cas d'un texte où une clausule rythmée serait nettement privilégiée, écarte le problème d'un revers de main : «In most cases, fortunately, they are not serious» (p. 27). Il disait à la page précédente : «This is not true for the very extreme case where the whole sample consists entirely of one cadence, say pp4p. Then, of course, the expected and the observed frequency will be the same. This, howewer, will happen only in very small samples from extremely monotonous authors». T. Janson, qui traitait des textes antérieurs au ΧΠΡ siècle, pouvait juger ce phénomène rare, mais la simple lecture des recueils de lettres du XIIIe siècle, en particulier de la fin du siècle, lui donne tort; la prédominance du cursus velox est telle que l'on ne peut plus se contenter de la méthode de Janson. Et c'est effectivement d'une grande monotonie...
5 Philippe Verkerk, que je remercie, s'est occupé brillamment de toute la partie informatique de ce travail.
704 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
1) selon la méthode de T. Janson au sens strict; 2) en calculant toutes les successions de mots possibles sur l'ensemble du lexique du texte, indépendamment de l'ordre réel des mots dans le texte; 3) en observant et décomptant les successions réelles des mots deux par deux dans le texte (ce qui permet par exemple de voir si l'auteur affectionne, indépendamment des clausules, la succession d'un paroxyton et d'un proparoxyton, de deux paroxytons etc.). Généralement, l'écart entre la fréquence attendue et la fréquence observée est ainsi beaucoup plus contrasté si le cursus est évité ou recherché; l'indifférence à son égard est marquée par des fréquences attendue et observée de valeurs voisines. Ce mode d'analyse limite ainsi les erreurs d'appréciation. L'ensemble des tableaux permet en outre des études plus fines des habitudes stylistiques; ainsi, nous essayons de déterminer si l'auteur réserve un certain type de mots aux clausules, s'il apprécie particulièrement tel ou tel rythme en dehors de ces clausules, telle ou telle succession de cursus différents, si l'on voit apparaître des séquences etc. Nous recherchons en outre une éventuelle isocolie.
Pour pouvoir mener à bien ces calculs, l'ordinateur a besoin d'un texte préparé. Il examinera les clausules suivies d'un retour de chariot (return) : en un premier temps, ces returns ne seront marqués que si le ou les manuscrit(s) présente(nt) une ponctuation, ou remplaceront, à défaut d'une étude ou examen direct des témoins, les ponctuations fortes des éditions. L'ordinateur a besoin d'un texte entièrement accentué. On lui a donc enseigné les règles essentielles de l'accentuation du latin : il re
connaît la longueur des pénultièmes brèves ou longues par position et en déduit la place de l'accent. Il accentue ainsi environ la moitié des mots d'un texte. Reste le problème des pénultièmes longues ou brèves par nature. Nous avons choisi de constituer un dictionnaire de mots accentués, que nous alimentons au fur et à mesure. Pour réduire cette partie ingrate du travail, Ph. Verkerk a écrit un programme de déclinaison accentuée des noms et des adjectifs : à partir de l'adjectif simple, l'ordinateur fabrique le superlatif, le comparatif, les adverbes et décline tout ce qui doit l'être en l'accentuant; il décline et accentue de même les noms des trois premières déclinaisons à partir du couple nominatif-génitif, en se référant aux paradigmes. Nous envisageons de lui inculquer l'art de la conjugaison. Il reste une marge d'erreur que j'espère minime : la place de l'accent tonique a changé dans certains mots usités entre l'Antiquité et le moyen âge; pour le moment, nous avons décidé de ne pas en tenir compte6. Le décompte des syllabes exige que soient observées les distinctions u/v et i/j; si le texte de départ ne comporte que des i et des u, l'ordinateur, en se référant à son dictionnaire, effectue les remplacements nécessaires, et signale le problème s'il n'a jamais rencontré le mot concerné. Le programme fait de même la différence entre les hiatus et les diphtongues. Il connaît les équivalences œ-ç-e, au-o etc.
Le cursus avait ses chapelles au moyen âge7, l'étude du cursus a eu ses chapelles à l'époque moderne. T. Janson s'inspire manifestement de l'école bolonaise dans sa description du cursus : cursus planus formé d'un mot paroxyton suivi d'un trisyllabe paroxyton (p3p), cursus tordus formé d'un paroxyton suivi d'un quadrisyllabe proparoxyton (p4pp), cursus velox formé d'un proparoxyton suivi d'un quadrisyllabe pa-
6 T. Janson exclut les mots de ce type de ses échantillons, en particulier les noms propres qui ne sont pas d'origine latine (cf. p. 31).
7 Nous ne revenons pas sur les particularités des écoles orléanaise et bolonaise, qui concernent moins les usages eux-mêmes que leur mode de description.
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 705
roxyton (pp4p), auquel on peut ajouter le cursus trispondaicus^ formé d'un paroxyton suivi d'un quadrisyllabe paroxyton (p4p). En revanche, W. Meyer9 a proposé une hypothèse selon laquelle seul compteraient le nombre de syllabes séparant les deux accents toniques de la clausule, et le nombre de syllabes suivant le dernier accent; ainsi, pour reprendre des exemples classiques, vineam nóstram serait un cursus pla- nus au même titre que ttlum deduxit : deux syllabes entre les deux accents, une syllabe après le dernier accent. Un trisyllabe proparoxyton suivi d'un dissyllabe aurait été l'équivalent d'un paroxyton suivi d'un trisyllabe paroxyton (-' '-). En fait, musicalement, il n'y a pas d'équivalence : l'oreille médiévale était sans doute sensible avant tout à la succession des paroxytons et proparoxytons10. Il faut ajouter qu'un tel système d'équivalences permet de donner le nom de cursus aux cadences les plus variées et les plus fortuites. Néanmoins, pour ne pas commettre d'oubli majeur, nous faisons rechercher à l'ordinateur les variantes les plus courantes des cursus fondamentaux décrits plus haut, qui forment ainsi un éventail de Janson à Meyer.
Le programme analyse également les liens éventuels entre clausules rythmées et rimées. Dans le cas de nos recueils, cette recherche n'est pas pertinente; nous n'en présenterons donc pas les modalités.
TABLEAU DES PRINCIPALES VARIANTES DE CURSUS
Planus Tardus Trispondaicus Velox
var 1
p3p p4pp p4p pp4p
var 2 ρ 1 +2
ρ 1 + 3pp ρ 1 + 3p pp 1 + 3p
var 3
p2 + 2 pp2 + 2
var 4
ρ 1 + 4p
var 5 pp2
pp3pp pp3p Ρ 5ρ
A, version minimale
Tableau 1
FRÉQUENCE MESURÉE (EN %) DES PRINCIPAUX CURSUS
Planus Tardus Trispondaicus Velox
var 1 1.8 1.8 2.4 61.3
var 2 0.0 1.2 0.0 17.3
var 3
1.2 5.4
var 4
0.0
var 5 0.6 1.2 0.6 0.0
total 2.4 4.2 4.2 83.9
8 Toujours appelé par T. Janson trispondiacus . 9 W. Meyer, Die rythmische fateinische Prosa, article paru d'abord dans Göttingische gelehrte Anzeigen (1893), repr. dans Gesammelte Abhandlungen zur mittellateinischen Ryth- mik 2, Berlin, 1905, p. 236-286.
10 Guido Faba vante l'alternance de mots paroxytons itardae dictiones) et proparoxy- tons (celeres dictiones) : «Sed pulcrum est quod celeres dictiones et tarde invicem miscean- tur» (Summa LXXXVI, p. 346).
706
Β, version minimale
ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
Tableau 2
FRÉQUENCE MESURÉE (EN %) DES PRINCIPAUX CURSUS
Planus Tardus Trispondaicus Velox
var 1 4.0 0.4 2.4 59.0
var 2 1.2 0.4 1.2 17.9
var 3
1.2 5.2
var 4
0.0
var 5 0.0 0.8 0.4 0.4
total 5.2 1.6 5.2 82.5
A, version maximale
Tableau 3
FRÉQUENCE MESURÉE (EN %) DES PRINCIPAUX CURSUS
Planus Tardus Trispondaicus Velox
var 1 1.3 6.6 1.6 59.0
var 2 0.3 1.6 0.3 13.9
var 3
1.6 4.4
var 4
0.0
var 5 0.3 1.6 0.3 0.3
total 1.9 9.8 3.8 77.6
B, version minimale
Tableau 4
FRÉQUENCE MESURÉE (EN %) DES PRINCIPAUX CURSUS
Planus Tardus Trispondaicus Velox
var 1 3.7 5.2 3.7 53.8
var 2 1.0 0.8 1.3 13.9
var 3
1.3 5.7
var 4
0.2
var 5 0.0 0.3 1.2 0.3
total 4.7 6.4 7.5 73.9
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 707
Dans les tableaux qui suivent, on a grisé les cases correspondant aux principaux cursus.
A, version maximale
Tableau 5
NOMBRE D'OCCURRENCES DE CHAQUE TYPE DE MOTS, DANS LE TEXTE, ET À LA FIN DES MEMBRES DE PHRASES
(DERNIÈRE ET AVANT-DERNIÈRE POSITIONS)
Texte Fin Av der
1 498 0 57
2 509 23 32
? 3 1 1
3p 268 51 15
3pp 330 19 98
4p 293 194 7
4pp 204 24 69
5p 44 3 5
5pp 58 1
29
>5p 11 1 0
>5pp 17 0 4
Tableau 6
NOMBRE D'OCCURRENCES 1) OBSERVÉES 2) ATTENDUES SELON LA MÉTHODE DE T. JANSON 3) ATTENDUES SELON NOTRE MÉTHODE (cf. supra)
On ne considère que les deux derniers mots de chaque membre de phrase pour les deux premières mesures, tous les mots du texte pour la troisième.
1er mot 2nd mot
1 2
3p 3pp 4p 4pp 5p 5pp >5p >5pp
1 0 2 0
BB 8 1 0 0 0 0 0
0 4 0 9 3 35 4 1 0 0 0
16 16 0 8 10 9 6 1 2 0 1
Ρ 0 20 0
6
1 1 1 0
0 4 0
4 ■■&■'
1 0 0 0
36 36 0
24
m,
3 4 1 1
PP 0 1 1 1 5 W
3 2 0 0 0
0 15 1 32 12
15 2 1 1 0
19 20 0 10 13
";.&.■'
8 2 2 0 1
708 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
Tableau 7
SUCCESSION DES RYTHMES DANS TOUT LE TEXTE (TOUS LES MOTS SONT ASSOCIÉS DEUX PAR DEUX).
Nombre d'occurrences mesurées (ligne supérieure) et attendues (ligne inférieure).
1er mot 2nd mot
1
2
?
3p
3pp
4p
4pp
5p
5pp
>5p
>5pp
1 88 95 141 97 1 1
110 51 92 63 14 56 31 39 5 8 13 11 0 2 3 3
2 77 97 128 100 0 1
58 52 84 65 23 57
■
13 9 19 11 5 2 6 3
? 1 1 0 1 0 0
3p 50 51 51 52 0 0
0 1 î£ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 34 8
3pp 73 63 50 65 1 0 12 34 30 42 m
30 ■§?
IBl 6 5 4 6 6 1 5 2
1^
26 7 6 8 7 0 1 2 2
4p 18 56 23 57 1 0
4M 30 23 37 6 33 ti
mi
2 5 4 7 0 1 1 2
4pp 29 39 21 40 0 0 10 21 25 26
2E 12 16 2 3 4 5 0 1 0 1
5p 9 8 10 9 0 0 7 5 5 6 3
5pp 11 11 5 11 0 0 1 6 6 7
■■ 5 1 "7 5 3 0 1 2 1 0 0 0 0
2 5 0 1 1 1 0 0 0 0
>5p 0 2 1 2 0 0 5 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
>5pp 4 3 3 3 0 0 2 2 0 2 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 709
B, version maximale
Tableau 8
NOMBRE D'OCCURRENCES DE CHAQUE TYPE DE MOTS, DANS LE TEXTE, ET À LA FIN DES MEMBRES DE PHRASES
(DERNIÈRE ET AVANT-DERNIÈRE POSITIONS)
Texte Fin Av der
1 987 2
118
2 997 54 80
? 8 2 1
3p 509 125 33
3pp 555 20 169
4p 533 347 14
4pp 381 39 108
5p 101 2 6
5pp 140 7 53
>5p 43 0 5
>5pp 39 0 10
Tableau 9
NOMBRE D'OCCURRENCES 1) OBSERVÉES 2) ATTENDUES SELON LA MÉTHODE DE T. JANSON 3) ATTENDUES SELON NOTRE MÉTHODE (cf. supra).
On ne considère que les deux derniers mots de chaque membre de phrase pour les deux premières mesures, tous les mots du texte pour la troisième.
1er mot 2nd mot
1 2 ?
3p 3pp 4p 4pp 5p 5pp >5p >5pp
1 1 11 0
IBB 7 2 1 0 0 0 0
0 11 0 25 4 68 8 0 1 0 0
32 32 0 16 18 17 12 3 4 1 1
Ρ 0
ME 1
11 22 31 2 6 0 0
0 12 0
5 80 * ; 0 2 0 0
70 71 1
■■li 39 38
,M * 7 10 3 3
PP 1 0 1 7 2
322 7 0 1 0 0
0 31 1
71 11 198 22 1 4 0 0
36 36 0 18 20 19 14 4 5 2 1
710 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
Tableau 10
SUCCESSION DES RYTHMES DANS TOUT LE TEXTE (TOUS LES MOTS SONT ASSOCIÉS DEUX PAR DEUX).
Nombre d'occurrences mesurées (ligne supérieure) et attendues (ligne inférieure).
1er mot 2nd mot
1
2
ρ
3p
3pp
4p
4pp
5p
5pp
>5p
>5pp
1 177 195 317 198 0 2
195 101 142 110 34 105 64 75 17 20 26 28 4 9 9
, 8
2 141 198 257 200 2 2
■
157 111 55 107
m
wêêêêêê 28 20 51 28 11 9 10 8
? 4 2 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3p 112 101 64 102 2 1
smiii
■
47 57 20 54
■
■ 8 10 10 14 20 4 9 4
3pp 122 110 79 111
1 1
27 57 52 62
USÉE IBHÜI Ijljjl
31 42 7 11 16 16 2 5 8 4
4p 38 105 33 107 2 1
«mu ■■Β ■SB ■■ι
30 59 10 57
Iliill ■PP ■B WmSm
5 11 9 15 3 5 1 4
4pp 77 75 57 76 0 1 17 39 35 42
jjis_ ■t1
27 29 3 8 9 11 0 3 2 3
5p 20 20 27 20 0 0 11 10 15 11 5 11 17
1 2 2 3 1 1 0 1
5pp 22 28 29 28 0 0 7 14 12 16
- 5Éj lm 6 11 0 3 3 4 0 1 0 1
>5p 1 9 6 9 0 0 17 4 8 5 5 5 5 3 0 1 1 1 0 0 0 0
>5pp 8 8 8 8 1 0 2 4 4 4 12 4 2 3 0 1 2 1 0 0 0 0
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 711
Annexe 2
INDEX SALUTATIONUM
3. genitor civis parisiensis benedicto filio .C. Aurelianis scolasticis dedito disciplinis salutem et quicquid Ysaac Jacob cóntulit cum salute A 2
.Β. genitor suo filio maledicto pro salute merorem . et opróbrium sempitérnum A 3
.Β. insufficiens et indingnus gardianus conuentus fratrum minorum carnotensium dilec[to] nepoti suo .r. aurelianis literali studio commendato salutem et ad fruc- tum sciéntie pervenire Β 44
.Β. rector talis ecclesie solo uerbo et non opere dilecto scolari .e. aurelianis literali studio commendato et metam sciéntie âssequi peroptâtam Β 23
Benefactori precipuo amico precellenci et honorando domino mentis proprie boni- tatis .m de tali loco .n. Scolaris aurelianensis salutem et tam promptum quam debitum in òmnibus famulâtum Β 52
Benefactori precipuo et domino dingnis meritis multipliciter honorando .g. de tali loco clerico .h. s[cola]ris aurelianensis salutem et si quid simile potest salubrius inveniri Β 21
Dilectissimis ac precordialissimis parentibus suis nicolao filio W. et margarete in officio de tali loco commorantibus eorum devotus filius .h. clericus aur[elianis] commorans et iuris canonici studio deputatus vel gramaticali sciéntie inuigilans
Bl Dilecto ac peramabili consanguineo armigero .B. de tali loco clericus Aurelianis in-
sistans scolasticis disciplinis salutem cum sincere dilectiónis constâneia... A 5 Dilecto consanguineo .m. scolari aurelianensi .m. de tali loco salutem et pervenire ei
ad metam sciéntie peroptâtam Β 33 Dilecto et precordiali amico .m. talis loci capellano .m. capellanus talis ecclesie cum
omnimoda dilectione et devotióne salutem Β 47 Dilecto in christo fratri .b. monacho talis loci .c. eiusdem loci monachus salutem et
sinceram in dòmino caritâtem Β 51 Domino et auonculo suo pre mundi ceteris honorando presbitero talis loci .r. Scolaris aurelianensis salutem et reverentie débite famulâtum A 16 -Β 13
Domino et consanguineo proprie bonitatis meritis honorando rectori talis ecclesie .m. clericus aurelianis studio deditus literali salutem et quidquit potest servicii et honóris A 13 - Β 12
Honorando patii post deum super omnia huius mundi et domino .p. de tali loco militari cingulo decorato .r. humilimus filius Scolaris aurelianensis salutem et quicquid boni ioseph iacob prébuit suo patii Β 30
Honorando patii suo et domino metuendo .g. civi turonensi .h. humilimus filius salutem et reverentiam in òmnibus filiâlem Β 54
Humilis gardianus et indingnus fratrum minorum talis conuentus dilecto nepoti .r. scolari, aurelianensi salutem et sciéntie incrémentum Β 43
I diuina miseratione tituli sancte cecilie presbiter cardinalis apostolice sédis legâtus.
712 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
religiosis uiris priori et conuentui monasterii sancti maximini aurelianensis dyocesis salutem in dòmino Β 28
Iohannes genitor de tali loco miles .g. suo filio benedicto salutem et dei et hominum grâtiam inveni[re] Β 38
Iohannes scolasticus ecclesie beati martini turonensis viris sapientibus et discretis m. et .b. rectoribus scolarum gramaticalium ecclesie sancte crucis aurelianensis salutem et ea docere in terris que angelis plâceant in excélsis A 9 - Β 8
L civi parisiensi suo peramabili genitori .m. devotissimus filius Scolaris aurelianensis filialem reveréntiam cum salute Β 26
Lamberto civi parisiensi discreto et provido mercatori .n. Scolaris aurelianensis salutem et de mer[cibus ?] multiplicatum recolligere capitale Β 46
Nobis vestre nobilitatis litera patefecit quod talis seruus noster ingressus est vestrum territorium v[io]lenter et ipsius custodem néquiter spoliâvit Β 20
Obediendum est paternis iussionibus licitis et honestis sed in hiis que uergunt ad sa- lutis dispendium est patribus intrépide referèndum Β 4
.P. diuina miseratione carnotensis episcopus dilecto in christo filio .e. de tali loco militi salutem in dòmino sempitérnam Β 40
Patii ac domino metuendo .B. civi parisiensi .C. humilis eius natus Ariliensis salutem cum reveréncia filiali A 1
Patii et domino metuendo .b. (B : vel) civi parisiensi .e. devotus eius natus Scolaris aurelianensis filial[em] reveréntiam curii salute A 11 - Β 11
Peramabili congnato suo magistro .p. floribus eloquentie purpurato gramaticalis sci[entie] laudabili professori .p. Scolaris aurelianensis salutem et ad ea docere in terris que deo placea[nt] et ângelis in exélsis Β 35
Peramabili socio .P. de tali loco clerico .N. Scolaris Aurelianensis salutem et dei et hominum grâtiam invenire A 8
Petrus opidanus talis uille filio suo caro petro salutem subiectam gratis et honóribus opuléntam Β 3
Petrus talis ecclesie rector suo nepoti precaro studenti aurelianis proficere tam in móribus quam in doctrina Β 5
Philipo dei gratia regi francorum suo consanguineo peramando .o. eadem gratia rex anglorum cum sincera dilectióne salutem A 4
Pirito. Theseus amoris constanciam et mendaciis non crédere detraetórum A23 Precaro suo socio quem gratia commendat multiformis .p. clerico moranti in tali lo
co .h. merens laboribus studiorum salutem quam sibi Β 6 Precordiali socio suo clerico .v(b). scolari aurelianis intendenti scolâsticis disciplinis
. [salutem] et philosophie palâtium introire Β 9 Precordiali socio suo quondam .magistro .p. viro religioso de ordine fratrum mino-
rum .p. genabi . moram trahens salutem et inceptum opus melius persequi sed óptime terminare Β 2
Quoniam amicos vestros diligimus cordis et ànimi puritâte. ac habemus odio inimi- cos qui vos in persona vel in rebus lèdere moliuntur Β 16
.R. karissimo amico suo et domino dingnis meritis honorando et iuris prudentia et facti ex[perien]tia redimito officiali aurelianensi talis plebanus salutem et quic- quid potest servitii et honoris... Β 48
.R. mercatori aurelianensi provido et discreto .m. de tali loco clericus salutem et de mercibus [sic] multiplica[tum] colligere capitale Β 25
LETTRES D'ÉTUDIANTS DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE 713
Reinoldus canonicus ecclesie beati martini turonénsis. dilecto clerico suo .p turonis commoranti salutem et dei [et] hominum grâtiam invenire Β 53
Reinoldus (A : R.) rector talis ecclesie dilecto nepoti suo .v(b?). aurelianis dedicato studio literali salutem et sciéntie increméntum A 14 - Β 14
Reverende matritere sue .v(b?).i. salutem cum promptitudine serviéndi Β 34 Reverendis parentibus .a. et .b. et post deum super omnia diligendis .g. eorum devo-
tissi[mus] et unicus filius salutem cum reveréntia filiali Β 49 Reverendo genitori .g. de tali loco .e. humilimus eius natus aurelianis deditus studio
literali cum filiali subiectióne salutem Β 29 Reverendo in christo patii et domino metuendo .b. abbati maioris monasterii tu-
ronensis et .n. eius fratri rectori talis ecclesie bonitate multimoda commendando A 17 - Β 18
Reverendo in christo patri et domino metuendo. Iohanni tituli sancte cecilie presbitero cardinali sedis apostolice legato humilis prior et conuentus monachorum monasterii sancti maximini aurelianensis dyocesis promptum et devotum in òmnibus famulâtum Β 27
Reverendo in christo patri et domino metuendo .p. dei gratia aurelianensi episcopo talis plebanus salutem [et] obedientiam tam débitam quam devótam Β 45
Reverendo patri ac domino, domino episcopo carnotensi eius talis Scolaris humilis et devotus salutem et fidem cum detraetóribus non ferire A 18
Reverendo patri et domino metuendo .g. de tali loco militari cingulo decorato .1. de- votiss[imus] eius natus aurelianensis Scolaris filialem subiectionem omnimo- dam cum salute Β 37
Sanctitate animi et honestate corporis prefulgenti suo avunculo gardiano fratrum minorum talis loci .r. devotissimus nepos Scolaris aurelianensis reverentie débite famulâtum Β 42
Sociorum karissimo .m. de tali loco parisius causa logicalis studii commoranti .n. Scolaris aurelianensis salutem et philosophic palâtium introire Β 31
Suis scolaribus merito diligendis talis lector cum salute sciéncie complemén- tum A 22
Suo domino metuendo .p. dei gratia carnotensi episcopo .c(t?). de tali loco miles seipsum cum omni promptitudine serviéndi Β 39
Suo domino plurimum honorando rectori talis Scolaris aurelianensis salutem cum omnimoda probitâte Β 22
Suo domino plurimum reverendo .m. canonico turonensi .r. clericus seipsum cum omnimoda promptitudine famulândi Β 17
Suo peramabili consanguineo .lam. de tali loco .ni. Scolaris aurelianensis salutem et dierum longitudinem cum honore Β 32
Suo socio precordiali .b(v?). scolari parisius commoranti .f. Scolaris aurelianensis salutem et ad pedes philosophie crebris uigiliis accubâre Β 36
Tali uilico fratri meritis nominando talis Scolaris sic fratris négocia dirigere ne quid offici perdi/// nomen (?) totâliter adsequâtur A 26
Talis presbiter suo nepotulo proficere in omnibus et salutem constanter et societati vestre semper fâc[ere] que sunt grata Β 7
Talis suo socio salutem et presentia mala fugere et futuris utilitâtibus providéreB 50 Talis tali opro[brium] sempiternum et per laqueos incidere quos teténdit A 25 Vir religiosus et socius suus condam frater .G. de ordine fratrum minorum .B. scolari Aurelianensi salutem et ad premium celestis magnificiéncie pervenire ... A 6
714 ANNE-MARIE TURCAN-VERKERK
Viris providis et discretis consanguineis peramatis .A. et .B. et .C. cognomine Pote- rellis civibus Turonis .D. Boterei Aurelianis in ultimo legum volumine lectioni- bus elaborane cum salute uite cursum prósperum et longéuum A 12
Viro discretionis titulis insinito. tali magistro scolares eius humiles et devoti salutem et ad sedem (?) conscéndere celsiórem A 19
Viro inclito et potenti domino .f. de tali loco militari cingulo decorato amicorum precipuo .g. de tali loco miles salutem et amiciciam semper acquirere et acquisi- tam omni tèmpore conseruâre A 15 - Β 15
Viro literato militie cingulo decorato magistro .p. parisius commoranti .r. Scolaris aurelianensis salutem [et in] scolis philosophie militiam exercére Β 24
Viro magnifico et excelso dignis et magnis laudibus decorato illustri dei gratia regi francorum .r. comes Arteicensis salutem cunctis felicitâtibus affluéntem... A 7
Viro nobili ac potenti tali militi laudibus armorum militibus excellendo talis magis- ter salutem et armorum laudibus assidue gloriâri A 21
Viro religioso et honestate multimoda renitenti avunculo >η. priori talis loci parisius commoranti .m. devotissimus eius nepos aurelianis literali studio dedicatus seipsum cum promptitudine famulândi Β 41
Viro strennuo et potenti mangnifico domino .fio. de tali loco quem doctrina exor- n[at] et militaris gloria recommendat. talis miles salutem et tocius altitudinis in- creméntum Β 19
Viro venerabili et discreto scolastico ecclesie beati martini turonensis rectores sco- [larum] gramaticalium sancte crucis aurelianensis salutem et paratam ad bene- plâcita volumtâtem : A 10 - Β 10
Viro venerabili et discreto tali magistro talis miles salutem et adquisitam scientie margaritam karitatiue suis scolâribus dispensare A 20
Uniuersis scolaribus sedulis et devotis talis magister in arte dictaminis salutem ac firmiter retinere mirabilia que secuntur A 24