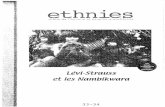"Les technolectes empruntés à une langue étrangère: résultat d'un processus d'acquisition ou...
Transcript of "Les technolectes empruntés à une langue étrangère: résultat d'un processus d'acquisition ou...
The Arab Journal For Arts Vol. 6 No. 1, 2009, pp. 1-16
Les technolectes empruntés à une langueétrangère: résultat d’un processus d’acquisition
ou d’apprentissage?
Mohammad Al – Khatib *
AbstractOn va essayer dans cette recherche de montrer si on
acquiert ou on apprend les technolectes en répondant à cestrois questions : Comment notre cerveau fonctionne dansl’acquisition de la première langue ? Il est évident qu’ily ait une relation entre le cerveau et ce qu’on appelle« langage ». L’étude de cette relation, qui est d’ordrepsycholinguistique, demeure importante pour révéler lesecret de ce don appelé « langage » accordé exclusivement àl’être humain et pour montrer comment l’enfant acquiert salangue maternelle, jusqu’à quel âge l’acquisitioncontenu et à quel âge l’apprentissage commence. La deuxièmequestion: les technolectes : produit linguistique ouculturel ? Les études sociolinguistiques font preuve durapport étroit entre la linguistique et la société.L’interaction entre les cultures d’une part et entre leslangues et les cultures d’autre part donne naissance à destechnolectes étrangers. Ces technolectes occupent une placeimportante dans l’usage quotidien. La troisième question:les technolectes, disparaîtront-ils un jour complètementd’une langue donnée ? Comme tout vocabulaire, lestechnolectes d’origine étrangère passent d’une génération àune autre. Mais certains technolectes résistent et durent
Copyright 2005 by The Society of Arab Universities Faculties ofArts, All rights reserved
* Department of French Language and Literature, Faculty of Arts andHumanities, Al al-Bayt University, Mafraq, Jordan.
1
Al – Khatib
longtemps et d’autres disparaissent. Cela dépend de lafréquence d'usage du technolecte et de l'espérance de viede son référent.
IntroductionPersonne ne contredit le fait que les technolectes
s’imposent dans toutes les langues et toutes lescultures. Ce vocabulaire, qui peut être d’origineétrangère, occupe une place importante dans l’usagequotidien des gens dans toutes les langues. Il estévident qu’il y ait une relation entre le cerveau etce qu’on appelle «langage». L’étude de cette relation,qui est d’ordre psycholinguistique, demeure importantepour révéler le secret de ce don appelé «langage»accordé exclusivement à l’être humain. Quant auxanimaux, il est vrai que l’on a tendance à direaujourd’hui «langage des animaux», mais certainslinguistes utilise le terme «communication animale»pour bien faire la différence entre le systèmecommunicatif humain et celui des animaux.
Afin de donner une idée générale sur lefonctionnement du cerveau dans l’acquisition de lalangue maternelle nous allons traiter dans la premièrepartie de deux aspects: l'aspect neurologique etl'aspect psycholinguistique. Comment l’enfant acquiertsa langue maternelle? Jusqu’à quel âge l’acquisitioncontenue? A quel âge l’apprentissage commence? … etcautant de questions auxquelles on essayera de répondreafin de découvrir la genèse des technolectes dans lalangue.
On s'intéressera dans la deuxième partie "Lestechnolectes: produit linguistique ou culturel?" auprocessus de l’acquisition et de l’apprentissage de lalangue, dont les technolectes. C’est l’interaction
2
Les technolectes empruntés à une langue étrangère: résultat d’un processus
d’acquisition ou d’apprentissage?
entre les cultures, les sociétés et les langues quidonnerait naissance à des technolectes étrangers. Cestechnolectes occupent une place importante dansl’usage quotidien, mais arrivent-ils à être normés etreconnus dans le dictionnaire? Pourquoi les genstendent-ils à utiliser des technolectes étrangersalors qu’ils connaissent souvent l’équivalent dansleur langue maternelle? Quel rôle l’école peut-ellejouer dans la naissance et la disparition destechnolectes?
Le passage des technolectes d’origine étrangère sefait, entre autre, par l’intermédiaire desgénérations. Mais pourquoi certains technolectesdurent-ils longtemps et d’autres disparaissent?l’Homme peut-il intervenir dans la naissance et ladisparition des technolectes? On essayera de répondreà ces questions dans la troisième partie " L’espérancede vie des technolectes"
En effet, le but de notre étude est de mettrel'accent sur l'interaction vitale entre la société etla linguistique et son importance dans l'appropriationd'une langue donnée. Nous prenons l'exemple destechnolectes car c'est un vocabulaire qui a un timbresociolinguistique et qui a une particularité dansl'usage quotidien comme nous allons le voir dans cetteprésente étude. Qu'est-ce que le "technolecte"?
Il convient de noter tout d'abord que depuis lesannées 1980, l’acception du terme technolecte connaîtune certaine extension et a tendance à remplacerl’usage de «langue de spécialité».
3
Al – Khatib
Le technolecte est contenu - comme sous-ensembledans le socio-style (langage et terminologie d'uneactivité, d'une entreprise). Jargon professionnelcaractérisé par des expressions lexicales à caractèrescientifique ou technique.1
Pour Messaoudi (1990, 2000, 2001, 2003)2 letechnolecte fonctionne comme la terminologie. Parcontre, elle note que la terminologie diffère dutechnolecte par ses unités qui ont le statut de«terme» et qui sont normalisées, tandis que les unitésdu technolecte peuvent être normalisés ou non etsurtout, elles intègrent les phrasèmes, constructionsphraséologiques souvent évitées par les terminologues.De même que la terminologie, le technolecte d’undomaine ou d’une sphère d’activités a pour objet dessystèmes conceptuels. Comme en terminologie, le sensspécialisé semble affecter les unités ayant lacapacité d’être décontextualisées.
Il ne faut pas ignorer que dans l'étude dutechnolecte il y a d’autres éléments de la situationde communication qui pourraient être fort utiles pourl'analyse du technolecte, comme les situationssociolinguistiques. Mais il faut noter que lasituation de communication au sein de laquelle sedéroule l’acte d’utiliser un technolecte peut êtretrès diverse (scolaire, didactique, scientifique,professionnel, etc.). C'est pourquoi, dans l'étude dutechnolecte, il faut prendre en compte aussi bien lesaspects situationnels que le référent même.
1 - http://www.eurologos.com/htm/Pages/page24fr.asp2 - http://perso.univ-lyon2.fr/~thoiron/JS%20LTT
%202005/pdf/Messaoudi.pdf
4
Les technolectes empruntés à une langue étrangère: résultat d’un processus
d’acquisition ou d’apprentissage?
Le fonctionnement de notre cerveau dans l’acquisitionde la première langue
Puisque nous parlons de l’acquisition et del’apprentissage d’une langue donnée, il nous sembleimportant de donner une idée générale sur lefonctionnement du cerveau dans l’acquisition de lalangue maternelle. Malgré les différentes études quiont été faites et les différentes théories ethypothèses linguistiques, la façon dont notre cerveaufonctionne dans l’acquisition d’une langue donnéereste un vrai mystère. Toutefois, nous allons essayerde montrer certains aspects neurologiques etpsycholinguistiques concernant l’acquisition etl’apprentissage d’une langue donnée. Aspects neurologiques
Il nous semble important de donner, dans ce propos,un aperçu sur le côté neurologique en didactique deslangues. Il existe certainement des relations entre lecerveau et l’apprentissage. Les anciens travaux deBroca et ceux de Roger Sperry nous laissent comprendreque c’est l’hémisphère gauche de notre cerveau quiprend en charge le fonctionnement du langage chezl’Homme.
«L’hémisphère gauche, logique, abstrait,analytique, gère les quatre fonctions du langage.L’hémisphère droit, intuitif, synthétique, traitel’image, le spatial, le musical.»3
3 - Cuq J.-P., Gruca Is.: Cours de didactique du françaislangue étrangère et seconde, PUG, 2003, p.107.
5
Al – Khatib
Donc la préférence d’un hémisphère à l’autreinfluence chez l’apprenant son profil d’apprentissage.
Selon Mac Lean P.D et Guyont R4. le cerveau del’homme est organisé en trois strates: - Le cerveau primitif (reptilien). C’est la couche la
plus profonde. Il est le siège des réflexes, desréactions instinctives. Selon Alain Ginet lecerveau primitif est responsable de certains«blocage et résistances instinctifs», car il estcapable de réactions «d’autopréservation et derepli défensif vers le connu, les racines,l’identité profonde» 5.
- Le cerveau limbique (mammalien). C’est la coucheintermédiaire où se trouve l’aspect émotionnel. Ilest le siège de l’imagination, «de nos émotions, dela motivation, de la mémoire affective à courtterme, du sentiment d’appartenance au groupe»6.Dans l’apprentissage d’une langue, Alain Ginet ditque le cerveau limbique peut …«être un nouveau frein, puissant et bien connu, qui
sera actionné chez l’apprenant par tout enseignementvécu comme ennuyeux, intéressant, non motivant outraumatisant», mais il peut favoriser l’apprentissage «dès quel’expérience est vécue comme agréable ougratifiante»7.
4 - Mac Lean P.D., Guyot R.: Les Trois Cerveaux de l’homme,Laffont, 1990.
5 - Ginet A. (dir): Du laboratoire de langues à la salle de coursmultimédias, Nathan, 1997, p.36.
6 - Ginet A., ibidem.7 - Ginet A., ibidem.
6
Les technolectes empruntés à une langue étrangère: résultat d’un processus
d’acquisition ou d’apprentissage?
- Le néocortex. C’est la couche de la volonté et del’argumentation. A. Ginet dit que cette couche«traite les données reçues, gère les imagesmentales et nos diverses mémoires, traduit lesréactions cérébrales en langage verbal.»8 Cettecouche ne traite pas les émotions car c’est ellequi analyse, décide et conceptualise. «le néocortex permet la production et la
préservation des idées. Il raisonne froidement et neconnaît pas des émotions.(…) Il est capabled’analyser, d’anticiper, de prendre des décisions, derésoudre des problèmes, de conceptualiser.»9
Nous constatons donc que les deux premières couchesconstituent des passages nécessaires des stimuli versle néocortex, et elles ne sont pas, à proprementparler, capables d’apprentissage. Alors que ces deuxcouches agissent comme des filtres, qui peuventmodifier l’information ou l’arrêter, c’est dans lenéocortex que le traitement de l’information se fait.Cela nous laissera entendre,donc, que les technolectesseraient plutôt mémorisés dans la troisième couche.
Nous avons donc compris que le cerveau primitif etlimbique sont responsables des réflexes et desémotions, alors que le néocortex traduit ces réflexeset émotions en langage verbale. Après avoir eu cetaperçu général sur les trois strates dont notrecerveau est organisé, il nous semble important defaire le lien avec la didactique des langues pour
8 - Ginet A., op. cit., p.39.9 - Trocmé-Fabre H.: J’apprends, donc je suis, Editions
d’Organisation, 1987, p.47.
7
Al – Khatib
montrer comment une langue s’imprime dans notrecerveau.
Aspects psycholinguistiquesAu niveau de la langue française, il est évident
qu’il y ait une différence entre le langage, la langueet la parole. Même si le terme «langage» n’existe pasdans beaucoup de langues, il existe par sa fonction.Autrement dit, tout être humain est doué d’uneaptitude à communiquer au moyen d’un système de signesvocaux qui est le «langage». Etant donné que lelangage est la capacité innée de pouvoir parler lecerveau primitif serait son siège car il estresponsable du côté instinctif. Concernant la languedont le système syntaxique, sémantique ou phonétiquenécessite une capacité d’analyse et de traitementscientifique de l’information, son siège serait lenéocortex. Quant à la parole, qui est l’acte ou laproduction individuelle, son siège serait le cerveaumammalien car cette couche est responsable desémotions qui s’expriment différemment d’une personne àl’autre en fonction des paramètres sociaux, culturels,psychologiques, contextuels, etc.
Toutefois, notre propos ne concerne pas vraiment leclassement du langage, de la langue et de la paroledans les trois strates du cerveau, qui resteévidemment discutable, mais il s’agit plutôtd’imaginer le fonctionnement de notre cerveau dansl’enregistrement10 de la première langue. Pourquoi l’âge
10 - J’utiliserai le mot « enregistrer» dans le sensmétaphorique pour expliquer le processusd’acquisition de la langue maternelle.
8
Les technolectes empruntés à une langue étrangère: résultat d’un processus
d’acquisition ou d’apprentissage?
de six ans est-il l’âge adopté presque par tous lessystèmes éducatifs du monde entier comme l’âge ducommencement de l’apprentissage scolaire? En répondantà cette question, nous allons voir le processusd’enregistrement de la langue maternelle.
Pour simplifier les choses, nous allons assimilernotre cerveau (l’hémisphère gauche) à un appareild’enregistrement avec une cassette (magnétophone). Dèsle premier jour de la naissance, le magnétophone dunouveau né se met en marche et la cassette commence àtourner et à enregistrer tous les phénomèneslinguistiques qui l’entourent. Quelques mois après,l’enfant commence à essayer son appareil phonatoire enprononçant quelques sons. Il pourrait même comprendreles mots qui se répétaient souvent par son entourageet que son magnétophone a captés. Par contre, il nepourra pas prononcer correctement ces mots, toutsimplement parce que le muscle de son appareilphonatoire n’est pas assez fort pour reproduirecorrectement les mots enregistrés. Une fois l’appareilphonatoire est complet et capable de produire, plus oumoins, les sons d’une façon correcte, de reproduire etde comprendre des mots, on peut envoyer l’enfant àl’école pour classer, analyser et compléter lesconnaissances linguistiques enregistrées sur sonmagnétophone pendant six ans. Les connaissanceslinguistiques des premiers six ans ont un timbreinconscient. Autrement dit, le magnétophone tourneautomatiquement et capte toute connaissancelinguistique d’une manière inconsciente. Par contre,après ces six ans, le magnétophone s’arrête etl’enfant devient responsable du processusd’enregistrement, c’est-à-dire il entre dans la phase
9
Al – Khatib
du conscient. Cela explique la difficulté d’oublierdes mots appris avant l’âge de six ans, alors qu’àl’école c’est très fréquent que l’enfant oublie laplupart de ce qu’il apprend dès qu’il rentre chez lui.
Si on suppose qu’un nouveau né passait les premierssix ans de sa vie dans un milieu complètement isolé detoute sorte de communication, pourrait-il apprendreune langue après l’âge de six ans? En fait, deschercheurs dans la linguistique avaient déjà répondu àcette question en proposant l’hypothèse suivante quistipule que cet enfant ne pourrait apprendre ni acquérir aucunelangue après avoir dépassé l’âge d’enregistrement inconscient. Lapremière phase d’enregistrement, de zéro à six ans,constitue la base sur laquelle l’enfant s’appuie pourapprendre d’autres langues. Tout apprenant se réfère àsa langue maternelle pour construire une deuxième ouune troisième langue. Si la cassette sur laquelle lemagnétophone doit enregistrer une langue reste viergeà cause d’un manque de communication, l’enfant perdrale point de repère. Par exemple, quand un arabophoneveut apprendre le français il a toujours sa languematernelle comme référence dans l’apprentissage decette langue étrangère. Mais si l’apprenant ne sedisposait pas d’une langue maternelle car il a dépassél’âge d’enregistrement, l’apprentissage d’une languene serait pas facile. De là surgit la difficultéd’oublier la langue maternelle car c’est la versionoriginale de la cassette, alors que toute autre langueapprise après la phase d’enregistrement (les premierssix ans) restera menacée par l’oubli.
On en conclut que la didactique des langues a toutintérêt à tenir compte de la phase d’enregistrement dela langue maternelle, car c’est sur cette phase quel’enfant se basera aussi bien pour compléter et
10
Les technolectes empruntés à une langue étrangère: résultat d’un processus
d’acquisition ou d’apprentissage?
approfondir ses connaissances dans sa languematernelle, que pour apprendre d’autres langues. Plusil maîtrise sa langue maternelle (c’est-à-dire il sedispose d’une cassette bien claire et bien remplied’informations linguistiques), plus il pourramaîtriser l’apprentissage de cette langue et d’autreslangues à l’école.Les technolectes: produit linguistique ou culturel?
Après avoir donné une idée sur l’aspectneurodidactique et psycholinguistique de l’acquisitiond’une langue, il est important de faire le rapportqu’entretient la langue avec la société d’un côté etde comprendre la différence entre l’acquisition etl’apprentissage. Ceci est dans l’objectif decomprendre l’origine des technolectes. Influence mutuelle entre la société et la linguistique
On a expliqué ci-haut que le magnétophone dunouveau né commence à enregistrer la première langue àtravers un «bain linguistique» constitué dessituations de communications réelles et qui luifournissent les connaissances à capter. Ce bainlinguistique n’est que la société dans laquelle vitl’enfant constitué des parents, des frères, des amis,des voisins et de tout son entourage. Pour mieuxcomprendre l'influence qu’exerce la société sur lalinguistique et vice-versa, il convient de mettre lalumière sur le domaine de la sociolinguistique enexpliquant le terme de la "linguistique externe".
Le nouveau courant sociolinguistique a tendance àdénoncer la priorité accordée à la langue au détrimentde la parole. Il est vrai que Saussure n’est pas
11
Al – Khatib
sociolinguiste, mais il n’ignore pas l’importance dela revalorisation de l'acte de parole et la productionlinguistique concrète. Il souligne à ce sujet:
"Notre définition de la langue suppose que nous enécartons tout ce qui est étranger à son organisme; àson système, en un mot tout ce qu'on désigne parlinguistique externe. Cette linguistique-là s'occupepourtant de choses importantes et c'est surtout àelles que l'on pense quand on aborde l'étude dulangage".11
Saussure pose donc une nouvelle dichotomie quistipule qu'il existe une "linguistique interne" versusune "linguistique externe". Les champs que Saussureclasse sous la "linguistique externe" sont, entreautres,: l'ethnologie, l'histoire, l'histoirepolitique, les rapports aux institutions, les rapportsentre la langue du livre et la langue courante, etenfin la variation géographique. Ces champs trouventleur place dans la sociolinguistique.
On constate ainsi que le linguiste qui envisagel'étude des technolectes est confronté à la tâcheprimordiale de prendre en compte la diversité desfaits sociolinguistiques et leur richesse. Autrementdit, il est important d'étudier la variationlinguistique qui est déterminée par la structure desrelations sociales au sein d'une "communautélinguistique". Or, qu’est-ce qu’une "communautélinguistique"? Ce terme est défini dans le Dictionnairede linguistique (1994) par "un groupe d'êtres humains utilisant lamême langue ou le même dialecte à un moment donné et pouvant
11 - Saussure F.(de): Cours de linguistique générale, Paris,Payot, 1972. p.40.
12
Les technolectes empruntés à une langue étrangère: résultat d’un processus
d’acquisition ou d’apprentissage?
communiquer entre eux". Bloomfield le définit égalementpar "un groupe de gens qui utilise le même système de signeslinguistiques est …".12
La question qui se pose à ce propos: utilise-t-onréellement les mêmes signes? Les technolectes utilisésdans une communauté linguistique donnée sont-ils tousconnus ou utilisés par tous les membres de cettecommunauté? Normalement, dans l'étude destechnolectes, l'accent est mis sur l'homogénéitérequise pour la constitution d'une communautélinguistique et qui consistera à utiliser les mêmessignes, dont les technolectes. Messaoudi dit à cesujet que:
"Du point de vue de la cohésion sociale, latendance aussi bien en linguistique que dans lesautres sciences sociales, a souvent été de privilégierle "même" au détriment du "différent" qui se trouve leplus souvent négligé"13
Cela signifie donc que l'on ne peut pas étudier lestechnolectes et leurs origines en dehors de leurcontexte qui sont les communautés linguistiques. Ceciconstitue une forte preuve qu’il existe uneinteraction entre la linguistique et la société dansle domaine des technolectes, et que les faitslinguistiques dépendent des faites sociaux. De làsurgit l'importance de la prise en compte de la"communauté linguistique" dans la didactique des
12 - Bloomfield L.: Language, New York, Holt, Rinehartand Winston, 1933.
13 - Messaoudi L.: Etudes sociolinguistiques, Editions Okad,2003, p.11
13
Al – Khatib
langues, car c'est elle qui fournit aux didacticiensles éléments nécessaires dans la constitution desméthodes ou des manuels de langues.
Revenons au terme de la "communauté linguistique".Nous remarquons que ce terme met l'accent sur lespratiques linguistiques, alors que Labov s'est levécontre cette conception en disant qu' "il serait faux deconcevoir la communauté linguistique comme un ensemble de locuteursemployant les mêmes formes. On la définit mieux comme un groupe quipartage les mêmes normes quant à la langue"14
Il en découle que certains membres d'une communautélinguistique donnée peuvent reconnaître et comprendrecertains technolectes utilisés dans cette communautélinguistique sans être obligés de les utiliser.Autrement dit, l'emploi des technolectes, comme toutsigne linguistique, varie d'un individu à l'autreselon l'âge, le sexe, la classe sociale et selon biend’autres critères. Gadet va même plus loin ensoulignant qu'il y a des dimensions géographiquescomme en dialectologie et géolinguistique qui serontprésentes dans l'étude sociolinguistique afin dedégager les formes linguistiques socialementsignifiantes. (Gadet, 2003)
Il convient de noter que même au sein d'une mêmecommunauté linguistique les locuteurs développent, aucours des interactions, une série de conduiteslangagières en fonction de but déterminé. SelonMessaoudi, ces conduites sont socio différenciées et
14 - Labov W.: Sociolinguistic patterns. Pennsylvania,University of PEnnsylvania Press (traduit enfrançais (1976) Sociolinguistique, Paris, Minuit,p.288.
14
Les technolectes empruntés à une langue étrangère: résultat d’un processus
d’acquisition ou d’apprentissage?
elles obéissent à une "rationalité". L'hypothèse de larationalité pour Messaoudi stipule le suivant15: leslocuteurs déploient des stratégies qui peuvent être dedeux sortes:a- des stratégies d'adéquation lorsqu'ils manipulent un
code linguistique donné et qu'ils sont enconformité avec les normes des son emploi;
b- des stratégies de compensation lorsque les locuteursusent alternativement de deux ou plusieurs codes etqu'ils choisissent l'un ou l'autre ou un mélangedes deux selon les situations de communication danslesquelles ils se trouvent impliqués. La stratégie de compensation est intéressante, et mérite
une étude à part, dans la mesure où l'interlocuteur setrouve dans une situation de communication où il estobligé d'utiliser des technolectes pour comprendre etse faire comprendre. Quand on va, par exemple, chez legaragiste pour faire réparer sa voiture on est obligéd'utiliser les technolectes de la mécaniqued'automobile pour la fiabilité de la communication. Ilest très rare que le garagiste adapte son discours àson interlocuteur, c'est plutôt l'inverse.
Il faut admettre que l’influence linguistique surla société est moins forte que celle de la société surla connaissance linguistique de l’enfant. Lalinguistique peut influencer la société dans la mesureoù l’utilisation de tel ou tel mot peut indiquer laclasse sociale du sujet parlant. Et cela reste relatifd’une culture à l’autre. Par exemple, l’emploi de
15 - Messaoudi L.: Etudes sociolinguistiques, Editions Okad,2003, p.34
15
Al – Khatib
certains mots en anglais dans un discours entre desjeunes jordaniens (Please, done, hi, bye, ok fine,already) n’est que pour laisser entendrel’interlocuteur que l’on est à la mode, civilisé, chique, etc.Il en est de même pour certains technolectes, si bienqu’en Jordanie, un étudiant d’université dira «mobile,lab top, CD, message», et ne pensera pas à les dire enarabe pour ne pas se mettre dans une situation demoquerie.
Quant à l’influence sociale sur la linguistique,elle est très claire surtout lorsqu’on voit desenfants utilisant des technolectes sans se rendrecompte qu’ils sont en train d’employer des motsd’origine étrangère. Les technolectes enregistrésavant l’âge de six ans sont plus difficiles à effacerde la mémoire linguistique (la cassette) de l’enfantque ceux enregistrés après l’âge de six ans. Parexemple, un enfant jordanien dira «télévision,téléphone, radio, etc» sans savoir qu’il existe enarabe un équivalent de ces mots.
L’usage fréquent des technolectes dans la sociétéfait d’eux des codes linguistiques conventionnels pourcertains groupes de gens, voire obligatoires dans lecadre professionnel. Un informaticien est obligéd’utiliser avec son collègue de travail des motstechniques comme «Hard disk, software, CD driver,floppy, modem, etc». Les technolectes sont à la foisun produit linguistique et culturel: linguistique carils sont empruntés la plupart de temps à une langueétrangère, et culturel car ils deviennent une partiede la culture et de l’usage quotidien de la communautélinguistique. Donc, la genèse des technolectes dansune communauté linguistique donnée n’est pashasardeuse, non plus complètement volontaire. Par
16
Les technolectes empruntés à une langue étrangère: résultat d’un processus
d’acquisition ou d’apprentissage?
exemple le développement et le progrès technologiquesjouent un rôle primordial dans la création destechnolectes. Acquisition / Apprentissage
Pour mieux comprendre la façon dont les sujetsparlant s’approprient les technolectes, il vaut mieuxmontrer la différence entre l’acquisition etl’apprentissage. On sait bien que c’est un sujet usé,mais il est important de montrer que certainstechnolectes peuvent être acquis et d’autres peuventêtre appris.
D’après Krashen16 on insiste généralement sur ladifférence entre deux processus distincts:l’acquisition, qui serait un processus d’appropriationnaturel, implicite, inconscient, qui impliquerait unefocalisation sur le sens, et l’apprentissage, quiserait, à l’inverse, artificiel, explicite, conscient,et qui impliquerait une focalisation sur la forme.Donc l’acquisition serait l’enregistrement dumagnétophone avant l’âge de six ans, alors quel’apprentissage serait l’analyse, la confirmation etle classement de ces enregistrements dans un milieuscolaire.
Bernard Py présente l’acquisition comme le«développement spontané, naturel et autonome des connaissance enL2» et l’apprentissage comme une «construction artificielle,caractérisée par la mise en place de contraintes externes, notammentmétalinguistiques et pédagogique, qui ont pour effet de déréglerl’acquisition sous le fallacieux prétexte de l’améliorer ou de
16 - Krashen S.D: Second Language acuqisition and SecondeLanguage Learning, Oxford, Pergamon Press, 1981.
17
Al – Khatib
l’accélérer.»17 Mais en fait, il n’y aurait pasd’acquisition pure, c’est-à-dire pas d’acquisitionsans apprentissage.
D’un point de vue didactique, si on arrive àfournir à l’apprenant d’une langue étrangère lescirconstances nécessaires qui le mettent dans unesituation d’acquisition artificielle, le résultat del’apprentissage pourrait être mieux. L’idée d’un «bainlinguistique» n’est pas récente, mais elle prouvetoujours que l’immersion de l’apprenant dans un «bainlinguistique» et l’usage de l’approche communicativel’aide beaucoup à mieux s’approprier la langue cible.
«L’hypothèse acquisitionniste est fondée sur l’idéeque, de même qu’un enfant s’est approprié une languepremière de manière «naturelle», c’est-à-dire parsimple exposition à celle-ci, un enfant ou un adultesont capables d’en faire autant pour une langueétrangère, par simple réactivation des processusd’acquisition du langage»18
Revenant aux questions de technolectes. Dans uncours d’une langue étrangère, l’enseignant doit-ilenseigner les technolectes aux apprenants comme desvocables authentiques? En effet, si l’enseignant veutavoir recours à l’immersion dans un «bainlinguistique» pour assimiler une vraie situation de
17 - Py B.: « Linguistique de l’acquisition deslangues étrangères: naissance et développementd’une problématique», dans Coste D., Vingt ans dansl’évolution de la didactique des langues, (1968-1988), Crédif-Haiter, LAL, 1994, p.44.
18 - Gaonac’h D.: Théories d’apprentissage et acquisition d’unelangue étrangère, Crédif-Haiter, LAL, 1987, p.134.
18
Les technolectes empruntés à une langue étrangère: résultat d’un processus
d’acquisition ou d’apprentissage?
communication, on pense qu’il sera confronté auproblème de l’usage des technolectes. Les technolectesétant une partie de l’usage quotidien de la languecible, l’enseignant ne pourra pas les ignorer s’ilveut avoir recours à l’approche communicative commeméthode d’enseignement.
Tout cela veut dire-t-il que l’apprenant peutignorer les technolectes dans l’apprentissage d’unelangue étrangère? Cette ignorance influence-t-elle sacapacité de communication en langue étrangère? Laréponse à ces deux questions dépend de la placesociolinguistique que ces mots occupent dans l’usagede la langue et de la situation de communication danslaquelle l'apprenant sera impliqué. Par exemple, ilconvient d’apprendre à un apprenant de la langue arabele mot «mobile» à côté de son équivalent arabe car cemot est plus fréquent dans la société jordanienne quesa traduction en arabe. L’espérance de vie des technolectes dans une langue
donnéeComme tout vocabulaire, les technolectes d’origine
étrangère passent d’une génération à une autre. Maispourquoi certains technolectes résistent et durentlongtemps alors que d’autres disparaissent? S’agit-ild’une évolution linguistique ordinaire ou bien y a-t-il une volonté socioculturelle de changement etd’utiliser les équivalents en langue maternelle? Aisance d’usage
A notre avis, tout mot capté par notre magnétophoned’enfance demeure préférable et plus facile à l’usage.Le sujet parlant ne pense pas lors de la communication
19
Al – Khatib
réelle à l’origine des mots qu’il est en traind’utiliser. L’essentiel pour lui est d’utiliser uncode linguistique que son interlocuteur partage aveclui pour que le message soit compréhensible.
Avec le développement technologique actuel onremarque qu’il y a beaucoup de technolectes quicirculent sans être acquis dans l’enfance. Les gensont tendance à les utiliser en communicationlinguistique soit parce qu’ils ne connaissent pasl’équivalent en langue maternelle, soit parce qu’ilsils le connaissent mais qu’ils ont peur quel’interlocuteur ne soit pas au courant de cetéquivalent.
L’observation suivante que l’on a fait dans unmagasin d’informatique montrer de quelques sortes àquel point l’usage des technolectes est vraiment lié àun phénomène sociolinguistique et culturel. Nous avonspassé trois heures dans un magasin qui vend desaccessoires d’informatique en Jordanie. Pendant cestrois heures, nous avons noté 65 demandes, dont 53avec des technolectes empruntés à une lange étrangère:(CD, Flash Memory, disquettes, câbles de connexion,microphone) et 12 demandes en arabe (programme de sonou d’affichage). Que ces technolectes soient acquisdepuis l’enfance ou appris plus tard dans lacommunication quotidienne, leur usage reste préférableà leur équivalent en arabe. Il faut noter que quandnous avons demandé à chaque acheteur de direl’équivalent en arabe du technolecte qu’il a utilisé,85% de ces acheteurs n’ont pas pu reconnaîtrerapidement l’équivalent en arabe, 10% ont reconnu vitel’équivalent et 5% n’ont pas voulu répondre. Donc, lefait que la grande majorité des acheteurs utilisentdes technolectes et qu’ils ne puissent pas se rappeler
20
Les technolectes empruntés à une langue étrangère: résultat d’un processus
d’acquisition ou d’apprentissage?
facilement le nom de l’objet en arabe est une preuvesur la dominance des ces termes dans le cerveau dusujet parlant surtout dans le néocortex, comme on l’adéjà montré au début de cette étude. Contraintes sociolinguistiques
La question qui se pose est la suivante: Es-cenous, les utilisateurs, qui décidons de garder ou desupprimer un technolecte de notre dictionnaire d’usageou bien est-ce la société?
Il faut chercher tout d’abord qui donne naissance àce technolecte et comment son usage s’étend? Nousavons déjà dit que la genèse d’un technolecte est liéeà un phénomène sociolinguistique. C'est la "communautélinguistique" qui crée des technolectes et en adoptecertains qui peuvent être le résultats, dans laplupart du temps, du développement technologique.Autrement dit l’homme n’est qu’un récepteur auquel telou tel technolecte peut être imposé. Puisque ce n’estpas le sujet parlant qui décide le choix dutechnolecte, donc il n’aurait pas vraiment le choixdans l’usage. Par exemple, le mot "mobile" est trèscourant en Jordanie, mais ce mot a été imposé dans lasociété jordanienne ce qui rend son emploi quasi-obligatoire même si le locuteur est au courant de sonéquivalent en arabe.
Les technolectes qui disparaissent sont ceux dontle référent est presque disparu. C’est-à-dire, quandl’objet même est rarement utilisé dans la communautélinguistique. Dans ce cas là, et comme tout mot, letechnolecte qui réfère à cet objet disparaîtquasiment. Les outils que l’on utilise dansl’agriculture en sont des exemples. Beaucoup de gens
21
Al – Khatib
ont oublié ou utilisent peu de technolectes signifiantun outil d’agriculture. Par conséquent le mot devientmenacé par la disparition de l’usage quotidien. Comme
le mot �ن رج� ,20[kwara]ك� واره ,[Rasan]19رس� � [xorʒ]21 qui sont خ�d'origine persane mais dont l'utilisation est presquedisparue car l'outil même est moins fréquent, voireinconnu pour certains jeunes.
Ce qui est rassurant c’est que très peu detechnolectes entrent dans le dictionnaire arabe. Celapermet de mieux conserver l'originalité de notrelangue. Sachant que le fait qu’un mot soit dans ledictionnaire lui garantit une espérance de vie pluslongue, par forcément dans l'usage mais en tant quemot existant. Donc c’est le dictionnaire, la"communauté linguistique" et la transmission d’usaged’une génération à l’autre qui donnent auxtechnolectes une puissance d’usage exceptionnelle.
Comme un groupe de linguistes peut décider desupprimer tel ou tel technolecte du dictionnaire oubien de l’interdire dans les textes écrits, l’usageoral dans la "communauté linguistique" a un mot à direégalement quant à la durée de vie d'un technolecte. Conclusion
19 - C'est le nom que l'on donne à la corde utiliséepour attacher un animal domestique comme le cheval,l'âne, la vache, etc.
20 - C'est le nom du réservoir où on conserve le bléou la farine.
21 - C'est un type de sac que l'on met sur le cheval oul'âne pour y mettre des objets à transporter.
22
Les technolectes empruntés à une langue étrangère: résultat d’un processus
d’acquisition ou d’apprentissage?
Le rapport étroit entre les aspects neurologiqueset psycholinguistiques dans l’acquisition et ladidactique d’une langue donnée mérite une étude plusdétaillée pour mieux comprendre la réalité del’acquisition d’une langue donnée. Il est trèsimportant d’insister dans la didactique des langues àla phase d’enregistrement de la langue maternelle, carc’est la phase qui fournira à l’enfant toutes lesconnaissances linguistiques dont il aura besoin pourcompléter et approfondir ses connaissances sur salangue maternelle, et pour apprendre d’autres langues.Si on veille à ce que l’enfant maîtrise bien sa languematernelle dans la phase d’acquisition, cela l’aideraà maîtriser l’apprentissage de cette langue etd’autres langues.
23
Al – Khatib
Comme les technolectes font partie de la langue etsurtout de l’usage courant, à notre sens il n’est pasfacile de les négliger pendant la phase d’acquisitionou d’apprentissage. Dissocier la linguistique de lasociété où elle se développe est vraiment impossible.Les études sociolinguistiques font preuve du rapportétroit entre ces deux disciplines. En effet, c’est lemariage métis entre les cultures mêmes d’une part etentre les langues et les cultures d’autre part quifait surgir des technolectes d’origine étrangère. Doncsi l’apprenant veut apprendre une langue étrangère enn’ignorant pas ses traits sociaux, il lui faut prendreen compte la connaissance de certains technolectes.
24
Les technolectes empruntés à une langue étrangère: résultat d’un processus
d’acquisition ou d’apprentissage?
Avant de clore cette recherche, il faut signalerqu'à propos de l'acquisition d'une langue donnée,Chambers définit trois périodes dans l'évolution descompétences langagières22: - durant l'enfance, le parlé spontané s'acquiert sous
l'influence de la famille et des proches. Lamaîtrise de la phonologie et de la syntaxe dedéveloppe en intégrant les caractéristiquesrégionales et les marqueurs du groupe social.
22 - Chambers J.K: Sociolinguistic Theory, Oxford-Cambridge,Blackwell, 1995, p.158.
Bibliographie utilisée dans la recherche: Bloomfield, L.: Language, New York, Holt, Rinehart and
Winston, 1933.Cuq, J.P., Gruca, Is.: Cours de didactique du français langue
étrangère et seconde, PUG, 2003. Gaonac’h, D.: Théories d’apprentissage et acquisition d’une langue
étrangère, Crédif-Haiter, LAL, 1987. Gadet, F.: La variation sociale en français, Paris, Ophrys,
2003.Ginet, A. (dir): Du laboratoire de langues à la salle de cours
multimédias, Nathan, 1997.Krashen, S.D.: Second Language acuqisition and Seconde
Language Learning, Oxford, Pergamon Press, 1981. Labov, W.: Sociolinguistic patterns. Pennsylvania,
University of PEnnsylvania Press (traduit enfrançais (1976) Sociolinguistique, Paris, Minuit,p.288.
25
Al – Khatib
- l'acquisition du vernaculaire se développerapidement à l'adolescence par le contact avec lesréseaux des pairs comme l'a noté aussi W. Labov(1994).
- les jeunes innovent énormément et semblent reprendreleur revanche sur les aînés en se créant un parlerpropre, comme les "parlers jeunes". Cela est la
Mac Lean, P.D., Guyot, R.: Les Trois Cerveaux de l’homme,Laffont, 1990.
Messaoudi, L.: Etudes sociolinguistiques, Editions Okad,2003.
Py, B.: «Linguistique de l’acquisition des languesétrangères: naissance et développement d’uneproblématique», dans Coste D., Vingt ans dans l’évolutionde la didactique des langues, (1968-1988), Crédif-Haiter,LAL, 1994.
Trocmé-Fabre, H.: J’apprends, donc je suis, Editionsd’Organisation, 1987.
Saussure, F.(de): Cours de linguistique générale, Paris,Payot, 1972.
Site Internet: http://perso.univ-lyon2.fr/~thoiron/JS%20LTT%202005/
pdf/Messaoudi.pdfhttp://www.eurologos.com/htm/Pages/page24fr.asp
Bibliographie liée au sujet de la recherche: Alliaume, J.: Le langage et les deux cerveaux, Carilang, éd.
Du Céralec, 1998.
26
Les technolectes empruntés à une langue étrangère: résultat d’un processus
d’acquisition ou d’apprentissage?
meilleure preuve sur l'influence sociale à lacréation des néologismes, dont les technolectes,qui peuvent être appropriés parfois par les aînés.Quand le jeune atteint l'âge adulte, il commence àchercher à acquérir la norme du standard. Pour finir, même si on ne répond pas complètement
aux questions posées au début de cette étude, cesquestions constitueraient une vraie piste d'un débatsociolinguistique avec d'autres chercheurs. C’est unsujet vaste qui ne peut pas être traité en quelques
Anderson, P.: La didactique des langues étrangères à l’épreuve dusujets, Presses Universitaires Franc-Comtoises,1999.
Calvet, L.J.: Le marché aux langues, Paris, Plon, 2002. Encrève, P.: "Présentation, linguistique et
sociolinguistique", dans Langue française, No.34,pp.3-16.
Messaoudi, L.: "Le technolecte et les ressourceslinguistiques", Revue Langage et société, Paris, Maisondes sciences de l'homme, 2002.
Messaoudi, L.: "Opacité et transparence dans lestechnolectes bilingues (français-arabe)", RevueMeta, Montréal, 2000.
Véronique, D. (éd).: Etudes de Linguistique appliquée, No120, Didactique des langues étrangères et recherches surl’acquisition, 2000.
Vion, R.: La communication verbale, Analyse des interactions,Hachette Supérieur, 1992.
27
Al – Khatib
pages, il faut admettre que l’Homme ne peut rien fairedevant le développement ou la disparition destechnolectes car le seul maître de ces vocables est la"communauté linguistique".
عاره� ال مصطلحات� ة� ال مست� ي) ن� ق+ "ال ت� ات� م ن� " ة� ل ع� ي) ب0 ن� 3 اج� اج ت� 6 علم : ن � سات3 ام ت اك ت�؟
ب3 م حمد� طي) سم ،ال خ� � ة� ق ة� ال لغ� سي) � ها ال ف�رن 3 داب Uغة� ،وا ام 3 ل ج Uب� ا ي) . ،ال مف�رق� ،ال ب0 ردن� الأ_
ص م لخ�dش � اق ت������ ( ا ن د� حبd ه����� ة� ال ب3 ي�����) ف� ول ك ت) � ة� ال مص�����طلحات� دخ����� ي�����) ب0 ن� 3 ج لى الأ_ oة� ا لأم ال لغ������ د� ا_ � ج����� أ_ � الأ ون dت����� كu ع لى م ل����� د�
ة� ال مصطلحات� ي) ن� ق+ عاره� ال ت� ات� م ن� ال مست� طرق� ال لع� ت� ( . ن ة� ي) ب0 ن� 3 ج ا الأ_ حبd ه د� لأتd ال ب3 dت اط ل ق� � ة� ت س اس ي) : ا_ة� ي) ف� ل ع مل - ك ت) سان� ع ق� � ن oى) الأ سات3 ف� ة� اك ت� ول ال لغ� شdىالأ_ � اق ت� + ه . ن طة� ه د� ق� ا ال دم أغ� ع مل ال ت� ت) 3 ول وج س��ي) � ق
ى) ة� ف� ل( ال لغ���� ن� س���ح3 � لأم )ن بd ا_ ن� ج ي) أغ� ا_ س���ان� دم��� � ن oسم الأ ف� ت� ( ن� ن ي) ئ�_ ر� ن� ل ج���3 مي) ( ء ون�)س���ار : ي ر� س���ار وال ج���3 ال ت)ول ة� ع ن� ال مس������ي_ ك������ون� ال لغ������� ت� ( لأتd م ن� ن d ات� ن ق������� ده� ك ل ط ت3 ف� ل ها واج������ _ ائ � ن� وظ������ ي�) ر� ج������� � ة� ت لف������� ن� ع ن� م ح�رى. � خ الأ_
28
Les technolectes empruntés à une langue étrangère: résultat d’un processus
d’acquisition ou d’apprentissage?
ة� - ال مص�����طلحات� ي�����) ن� ق+ اج� هى) ه ل ال ت� ت������ 6 وى) ن م ل غ������ ى) ا_ اف� ق������ d ط�����رق� ؟ ت ت� + ه ن د� ط�����ة� ه����� ق� ة� ال ت� ة� ل لعلأق������ ادل ي�����) ت3 ال ب�ة� كام لي) ي�ن� وال ت� 3 ة� ئ ة� ال لغ� اق� ق� dت ى) وال ال ف� سات3 م ح3 علم اك ت� � . ك ما ال مصطلحات� وت ة� ي) ب0 ن� 3 ج شd الأ_ � اق ت� + رق� ن ي�ن� ال ف��� 3 ئ
ة� سات3 ع ملي) علم الأك ت� عاره� ل لمصطلحات� وال ت� ة� م ن� ال مست� ة� ل غ� ي) ب0 ن� 3 ج ة� ا_ ي) ف� ره ا وك ت) د� ح3 � ى) ت ة� ف� م. ال لغ� الأ_ى) - ال عمر ت�راض����� ة� ل لمص����طلحات� الأق� ي����) ن� ق+ عاره� ال ت� ة� م ن� ال مس����ت� س ل غ����� . ل ت) ة� ي����) ب0 ن� 3 ج اك u ا_ مكن� م ح����دد ع مر ه ت����� ( ي
ع طاءه oى) ا لة� م ف�رده� لأ_ ت) � ة� ع لى دج ت�مع ال لغ� لأم. ال مح3 ى) ه و ا_ ف�رض� ال د� ( عمال ت ه اس ت� ى) وه و ال كلمة� ه د� ال د�ح��دد ( ة� ت ف��� ت�) طر 3 ت)ر ب ره� غ��� dاش�� ى م ت3 ت� مكن� م�� ( دال ها ي ت3 ب� كلم��ة� اس�� 3 م أ ب رى. ا_ � خ�� أ ا_ ( ون ام وس ل غ� ال ق��� � ع ه و ف 3 د ال مرج ال وج ت)
ى) د� ح����دد ال���� ( ول ت ي���3 � و ق ص� ا_ � رف ( ى) م ص����طلج دم ج� ي��� ت3 ن���� 3 ج ى) م أ ا_ ة� ف� كم ال لغ����� 6 لأم. ف ى�) م ص����طلج م ن� ا_ ت� ف���� � ى) ت ت3 ن���� 3 ج ا_دم ح� كل ن )س�����ت� d3ش����� ة دارج� ن ر ل كي� ت) درج� غ������ ى) م����� ام وس ف� و ال ق������ درج� ا_ ( ار ن����� dة ون�)س����� ل ي) oة ا � ن أ_ 3 ى) ن ت3 ن������ 3 ج ود م ع ا_ 3 وخ�����
ى) ال مرادف� ة� ف� لأم. ال لغ� ا_* The paper was received on , and accepted for publication on ,.
Notes:
29