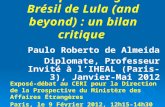Sociologie des experts turcs de la politique étrangère
Transcript of Sociologie des experts turcs de la politique étrangère
1
Papier présenté lors de
La Fabrique des thèses
dans le cadre de
l’Ecole d’Eté de Sciences Po’ Aix
juin 2014
Jean-Baptiste Le Moulec
Doctorant, IEP d’Aix-en-Provence
Contrat doctoral CNRS, affecté à l’IREMAM et à l’IFEA
La fabrique de l'expertise sur le monde arabe en Turquie: une entreprise en sous-
traitance pour l'Etat
Parti du constat de l’accroissement, en Turquie, de la production dite scientifique sur le
« monde arabe », le Moyen-Orient1 –notamment arabe-, les pays arabes et les relations turco-
arabes depuis le milieu des années 2000, s’est progressivement imposé la nécessité de
procéder à une analyse sociologique des modalités et aboutissants de l’expertise turque
contemporaine sur le Proche-Orient arabe dans une perspective synchronique ne pouvant
cependant se passer de mises en perspectives historiques. En effet, depuis le début des années
2000 et plus particulièrement depuis 2003, la production dite scientifique en sciences
humaines et sociales sur ces thématiques a pris diverses formes et son volume a semblé
s’accroître par rapport aux périodes précédentes, invitant à croire à un renouveau des relations
interétatiques et transnationales entre Turquie et pays du Moyen-Orient, notamment arabe,
tant dans ses principes que dans ses modalités et son ampleur. La dynamique académique a
semblé d’autant plus forte que plusieurs de ses acteurs ont accès aux organes médiatiques
mais aussi que de nombreux journalistes ont relayé ou participé à cette entreprise de
production de savoirs étiquetés académiques. Outres les nombreuses publications
scientifiques, les innombrables conférences, colloques et ateliers organisés par universités et
centres de recherche privés, nombres d’ouvrages écrits par des universitaires sont parus en
Turquie au cours des années 2000. Cette dynamique a même semblé s’accélérer avec la
survenue des révoltes arabes : la crise syrienne, les variations des relations turco-irakiennes, la
« donne » kurde dans ces relations, sans oublier les révolutions égyptiennes, libyennes et
1 Ce terme résulte et renvoie, comme on le verra ensuite, à un usage et à des acteurs spécifiques. De plus, n’étant
pas le seul terme utilisé pour désigner ce qui se situe à l’est et au sud-est de la Turquie, il entretient un flou
parfois voulu.
2
tunisiennes. Ce qui semblait donc un phénomène académique a été relayé sous divers formats
dans les médias via des articles, chroniques écrites et talk-shows télévisés.
Au-delà de l’apparente nouveauté du phénomène, le caractère majoritairement stratégique et
géopolitique de la production scientifique turque sur les thématiques afférentes au Moyen-
Orient invitait au questionnement sur l’identité des producteurs de ces savoirs dits
scientifiques. Le champ d’entrée de l’étude était donc celui des universités et notamment de la
recherche turque en sciences humaines et sociales. L’une des premières informations
pertinente à émerger à ce sujet est que, jusqu’aux années 1990, la formation doctorale n’était
pas disponible dans les universités turques. La fonction principale des facultés consistait en la
transmission et la sanction de l’apprentissage de connaissances. La recherche académique
turque se développe à proprement parler à partir de la fin des années 1990, promue par des
universitaires formés à l’étranger et encouragée par des acteurs localisés dans la sphère
politico-administrative.
Ce qui explique l’hyper-visibilité de la production académique en question, que ce soit dans
les médias ou dans les rayons des librairies, est son lien avec les initiatives diplomatiques
déployées par le gouvernement AKP en direction des pays arabes et de l’Iran, politique
présentée comme une remise en cause partielle du tropisme occidental de la politique
extérieure turque. Au demeurant et pour reprendre les termes de G. Dorronsoro : « La
trajectoire globale de la politique extérieure turque est intimement liée aux questions
d’identité. » (Dorronsoro, 2009). En effet, à partir du moment où le gouvernement AKP à la
tête de l’Etat entend « orientaliser », « restaurer » l’identité nationale turque, il est attendu
qu’il cherche à développer ses relations avec le monde arabe, les velléités hégémoniques
venant par la suite. Ce qu’il va chercher dans ces « partenariats orientaux renforcés », sur le
plan de la politique identitaire, c’est une légitimité, une consécration, d’où l’impasse
croissante de cette politique à l’issue de révolutions arabes qui rejettent une Turquie perçue
avant tout comme voulant imposer son leadership et/ou un modèle de société. La formule de
G. Dorronsoro recèle aussi des implications internes : à partir du moment où l’Etat-
gouvernement va chercher une consécration dans une aire géographique voisine, la production
d’un discours d’expertise sur cette région revêt un caractère stratégique.
Au demeurant, s’il relève de l’évidence, cet alignement des agendas politiques, académiques
et médiatiques, m’a semblé devoir être questionné car au moment où émerge une recherche
universitaire purement turque en sciences humaines et sociales, semblent s’établir
3
concomitamment des rapports étroits entre acteurs du savoir académique et décisionnaires
politiques.
Et de fait, des séries d’entretiens effectués à ce jour auprès d’universitaires turcs s’étant
signalé dans les quinze dernière années par une production sinon fréquente tout au moins
significative en lien avec la thématique « Moyen-Orient » -je reviens sur ce flou de définition
plus loin-, se dessinent les contours de diverses coalitions d’acteurs. Entre ces coalitions dont
le qualificatif devra faire l’objet d’un questionnement approprié –doit-on parler de
« populations », de groupes sociaux, de générations… ?-, il apparaît que se nouent des
alliances et que s’échangent des coups. Qui plus est, la distribution des ressources et
notamment celles fournies pas les institutions étatiques, mettent en évidence l’asymétrie des
coalitions d’acteurs, les modalités diverses d’agrégation et des degrés divers de cohésion en
leur sein mais aussi et surtout l’aptitude de certaines à entretenir de fructueuses relations avec
le ministère des Affaires étrangères ou les services du Premier ministre, marginalisant à la fois
dans le processus de décision politique et dans les médias celles qui n’ont pas cet accès
politico-administratif.
Ce qui émerge donc est un questionnement sur l’articulation entre la mobilisation dans le
champ universitaire en vue de produire des savoirs spécifiques et la formation d’un véritable
réseau de politique publique (Massardier, 2003) alliant universitaires et cadres politico-
administratifs. J’étais tenté ici d’ajouter « dans le but de… ». Or, il reviendra précisément à
cette étude de se défier des réflexes intentionnalistes pour restituer la plénitude des enjeux et
stratégies mis en œuvres par des acteurs, individuels et collectifs, dont les intérêts sont à la
fois pluriels, complexes et évolutifs sur la période.
Au plan théorique, le défi consistera à combiner sociologie du champ universitaire et
intellectuel d’une part et sociologie de l’action publique d’autre part.
L’objectif de ce papier étant de refléter l’état d’avancement de la recherche, après une revue
de littérature non-exhaustive, je chercherai à présenter un certains nombre des découvertes
effectuées à ce jour en tenant de les rattacher au questionnement propre à la démarche
sociologique, qu’il s’agisse de la pertinence du champ d’étude, de la dénomination des acteurs
et des stratégies que je crois avoir décelé sans être encore parvenu à bien les décrypter.
I. Revue de littérature
4
Les pistes théoriques suggérées par le matériau collecté à ce jour semblent se consolider
autour de trois entrées principales. La sociologie des mobilisations, combinée à celle des élites
et notamment du champ intellectuel, devrait me permettre de restituer l’émergence socio-
historique d’un groupe d’universitaires assez remarquable dans le champ académique turc et
en lien avec les projets politiques dits islamo-conservateurs. Il existe dans le domaine des
mobilisations et de la formation des groupes sociaux à la fois des ressources théoriques basée
sur des travaux empiriques réalisés en France (Boltanski, 1982 ; Offerlé, 1998 ; Neveu, 1999 ;
Filleule, 2001, 2005) mais aussi de nombreuses références utiles quant à penser mon objet
plus spécifiquement dans le contexte turc (Dorronsoro et alii, 2002), en procédant de manière
comparative avec les mobilisations identitaires (Massicard, 2005), générationnelles
(Monceau, 2002, 2007), intellectuelles (Monceau, 2007) ou politiques (White, 2002). Quand à
penser un champ, le recours à Bourdieu (1979, 1984, 2002) et à certains de ses
exégètes (Lahire, 2001) est indispensable, a fortiori lorsqu’il concerne le champ intellectuel
(Bourdieu, 1984) ou celui de l’Etat (Bourdieu, 1989), mais non exclusif d’autres lectures
(Sapiro, 2009 ; Kepel et Richardson, 1990), notamment celles plus spécifiques à la Turquie
(Atacan, 1993 ; Copeaux, 1997 ; Mardin, 1994 ; Meeker in Tapper 1991 ; Monceau, 2002 ;
Taşkın, 2001 ; Botiveau et alii, 1985 ; Khelfaoui, 2003). Complémentairement, la sociologie
des élites permet d’affiner les définitions et de suivre les mutations du champ (Pareto, 1968 ;
Suleiman, 1979).
Il m’a été souvent fait la remarque que je ne mentionnais pas M. Foucault comme référence
quant à penser la dialectique savoir-pouvoir. Le fait est que sa lecture est d’un hermétisme tel
(Foucault, 1969) que je ne vois comment l’utiliser. Peut-être dois-je passer par certains de ses
commentateurs pour espérer en tirer quelque bénéfice. L’analyse au filtre de la sociologie de
Weber (1919) s’impose elle aussi probablement.
Je recourrai par ailleurs à la sociologie de l’action publique afin de comprendre les modalités
de l’articulation qui s’est établie entre ces intellectuels universitaires « islamo-conservateurs »
spécialistes de divers « Moyen-Orient » et la sphère étatique, principalement incarnée ici par
le ministère des Affaires étrangères, la primature et un certain nombre d’agences et organes
spécialisés. Il me faudra puiser dans les travaux relevant de l’approche néo-pluraliste et du
(néo-)corporatisme (Schmitter, 1974) tout en prenant garde aux défauts de chacune de ces
démarches. En effet, la première, si elle présente l’avantage de s’intéresser aux acteurs
extérieurs à l’Etat, se concentre sur la problématique de l’influence des groupes d’intérêts en
concurrence pour peser sur la politique publique, ce qui est déjà difficile à mesurer, néglige
5
l’analyse de l’organisation interne des groupes d’intérêt. Or la sociologie du groupe en
question devra nous avoir déjà éclairé sur l’asymétrie des ressources entre acteurs. L’approche
corporatiste, qui s’intéresse davantage à la structuration des groupes d’intérêt, présente quant
à elle l’avantage de mettre en évidence le rôle de l’Etat dans la formation même de ces
groupes (Hassenteufel, 1997), ce qui ne manque par de faire écho aux observations
empiriques effectuées. De même, elle fait ressortir les tensions entres logiques internes et
externes, adhésion et participation au sein du groupe d’une part, influence et participation
entre groupe d’intérêt et Etat de l’autre, évoquant les échanges de ressources politiques
générateurs de légitimité. Reste que je ne suis sûr de pouvoir estampiller les groupes observés
sur le terrain comme relevant d’organisations ou de logiques « corporatiste ».
La sociologie de l’action publique permettra en outre une analyse de la composition et des
fonctions des acteurs intermédiaires de la politique publique (Nay et Smith, 2002), acteurs de
l’expertise peuplant ces lieux de rencontre, les think-tanks (Medvetz, 2010), où se nouent les
réseaux d’action publique (Heclo et Wildavsky, 1974 ; Crozier et Friedberg, 1977). En
complément d’une réflexion sur la naissance des « situations d’expertise » (Cresal, 1985 ;
Delmas 2001) et sur le rôle des expert et de « l’expertise Moyen-Orient » en Turquie dans la
période récente (Rioufreyt, 20013 ; Dezalay, 2004 ; Denord, 2002 ; Jobert et Muller, 1987), il
faudra non seulement se pencher sur la configuration d’acteurs mais aussi décrypter les
dynamiques d’échanges entres espaces et/ou univers institutionnels. Ainsi, il faudra
éventuellement déterminer, pour reprendre la catégorisation élaborée par J. Habermas (1973),
sur quel mode s’enchevêtrent –plutôt que ne se supplantent- modèle décisionniste,
technocratique ou pragmatique concernant les relations pouvoir décisionnaire-savoir expert
dans le cas observé. Enfin, je ferai appel à la typologie des réseaux d’action publique pour
tenter de présenter les logiques d’échanges et de liens entres acteurs, optant tantôt pour le
réseau de projet (Gaudin, 1995 ; Rhodes et Marsh, 1992), tantôt pour la communauté de
politique publique (Richardson, Jordan, 1983), tantôt encore de communauté épistémique
(Haas, 1992).
En marge de ces entrées dans la littérature scientifique, il m’arrive aussi de puiser
fréquemment dans la production sur le thème de l’internationalisation du champ scientifique
et de la circulation internationale des modèles d’enseignement supérieur (Gingras, 2002 ;
Musselin, 2008)
6
Au demeurant, j’ai abordé ces axes théoriques au fur et à mesure des questionnements nés de
l’enquête de terrain et des échanges avec des universitaires encadrant. Ayant commencé par la
sociologie du champ universitaire, j’ai peu à peu évolué vers les politiques publiques en
cherchant à approfondir en même temps les lectures empiriques.
En marge de ces lectures théoriques, il me reste à poursuivre le traitement de la collecte
documentaire. Celle-ci se compose essentiellement de publications dites académiques (thèses,
mémoires, revues, compte-rendus de colloque). M’intéressant en l’occurrence davantage aux
modalités de circulation et de mise en valeur des savoirs, je me préoccuperai au moins autant
des choix formels opérés dans ces publications qu’au discours qu’elles véhiculent.
II. Une sociologie de la mobilisation dans le champ universitaire turc
Si je dispose bien d’un champ d’entrée qu’est le champ universitaire et, plus largement, le
champ intellectuel turc, appréhendé dans la synchronie sans oublier les nécessaires remises en
perspectives diachroniques, je m’interroge néanmoins sur l’éventuelle consolidation d’un
champ « à cheval » entre université et institutions politiques. Il faut ensuite questionner ce
qui, dans ce champ, fait groupe. A cet égard, je présente plusieurs coalitions d’acteurs dont
une se distingue par sa plus forte cohésion –générationnelle, idéologique, biographique. Je
présente ensuite les « think-tanks », acteur institutionnel et lieu privilégié de la cristallisation
de l’expertise. Cet élément permet de mettre en évidence la donne réticulaire et permet
d’avancer l’hypothèse de l’existence d’un réseau ou communauté de politique publique
extérieure. Enfin, je procède à une remise en perspective indispensable en rappelant à la fois
l’internationalité à laquelle sont soumises l’ensemble des sciences sociales en Turquie ainsi
que le poids des modes d’organisation universitaires américain sur la jeune recherche turque.
A. Eléments constitutifs du champ
Synthétisant les caractéristiques constitutives d’un champ dans la sociologie de Bourdieu tout
en soulignant que le concept a évolué sous la plume même de son créateur et que celui-ci en a
également autorisé certaines extensions, B. Lahire (2001) énonce :
« Un champ est un microcosme dans le macrocosme que constitue l’espace social (national)
global ; chaque champ possède des règles du jeu et des enjeux spécifiques, irréductibles aux
règles du jeu et enjeux des autres champs ; un champ est un « système » ou un « espace »
structuré de positions ; cet espace est un espace de luttes entre les différents agents occupant
7
les diverses positions ; les luttes ont pour enjeu l’appropriation d’un capital spécifique au
champ (le monopole du capital spécifique légitime) et/ou la redéfinition de ce capital ; le
capital est inégalement distribué au sein du champ ; il existe donc des dominants et des
dominés ; la distribution inégale du capital détermine la structure du champ, qui est donc
définie par l’état d’un rapport de force historique entre les forces (agents, institutions) en
présence dans le champ […] ».
Cet essai de définition engendre deux types d’hésitation en ce qui concerne mon sujet. Tout
d’abord, parler de champ universitaire suppose de me référer aussi aux sciences dites
« dures ». Or tant le sujet que le matériau empirique récolté ne concernent que la recherche en
sciences humaines et sociales sur une zone géographique spécifique, soit un sous-champ
académique. Qui plus est, considérer que mon champ –ou sous-champ- d’étude est
universitaire, suppose une démarche exclusive par laquelle je refuserai de prendre en compte
des acteurs tels que les think-tanks ou les journalistes-essayistes par exemple.
Par ailleurs, mon hypothèse principale portant sur les liens établis entre acteurs de la
production du savoir académique et décisionnaires politiques, je serais plutôt tenté de poser
que « mon champ » est celui qui s’est formé en chevauchant deux espaces, l’espace
académique et l’espace politico-administratif, le point de contact s’établissant entre des
universitaires en sciences humaines et sociales d’une part et des agents du ministères des
Affaires étrangères ou de la Primature d’autre part. C’est là qu’il me semble que dans le cas
retenu le terme de « champ » fasse le plus sens. C’est en effet là, pour reprendre partiellement
la définition de Bourdieu, qu’il me semble pouvoir observer des agents disposant de
ressources asymétriques occuper des positions et lutter pour capter du capital selon une
combinaison de règles spécifique au champ.
B. Eléments constitutifs de groupes sociaux mobilisés
Du traitement d’une cinquantaine d’entretiens biographiques et reconstitutions biographiques
d’acteurs individuels issus en large majorité du champ académique et y opérant à la
production de savoirs labellisés scientifiques sur le thème du Moyen-Orient arabe et/ou des
relations de la Turquie avec cette espace géographique, émergent dans le champ –tout en le
rendant plus lisible- plusieurs agrégats d’acteurs. L’un de ceux-là est particulièrement saillant
en raison des nombreuses similitudes de trajectoire et d’habitus partagées par ses membres.
1. La génération « Stratejik derinlik »
8
Les personnes interrogées ont été « sélectionnées » de plusieurs manières, tantôt à l’issue des
lectures préparatoires –articles scientifiques et de presse, ouvrages-, tantôt en dépouillant le
résultat d’une collecte documentaire, tantôt en recherchant sur internet, par mot-clé renvoyant
à une thématique et par université, tantôt sur la suggestion d’une personne interrogée
auparavant.
Ces acteurs appartiennent tout d’abord à une même génération démographique, celle des
personnes qui âgées entre 25 et 45 ans aujourd’hui, sont nées entre 1965 et 1985. S’ils ont
grandi dans des familles classes sociales différenciées2, ils ont en commun un sentiment
d’avoir été marginalisés dans les instances politiques du fait de leurs convictions islamo-
conservatrices. Il faut néanmoins nuancer. Ces jeunes universitaires ne sont pas tous issus de
familles liées à des confréries -Nakschbandis, guleniste/nurcu, süleymancı…-, et il est
difficile d’obtenir des interrogés des réponses sur ce point tant ces appartenances
confessionnelles, même si elles jouent un rôle dans la construction des identités et des
solidarités sociales et politiques, sont considérée comme relevant de la sphère privée. On est
même tenté de se dire que l’affinité islamo-conservatrice constitue en elle-même un « lien
faible » (Granovetter, 1973) au-delà de l’évidence qu’elle semble désigner à première vue et
en comparaison d’affinités plus concrètes pour des universitaires comme le fait d’avoir été
étudiants d’un même « maître »3.
Cette population s’illustre en outre par son succès dans l’usage des mécanismes scolaires
méritocratiques turcs. En effet, rares sont les acteurs qui n’ont pas effectué leurs études
secondaires dans les « Anadolu Lisesi », lycées sélectifs dont une partie de l’enseignement se
fait en anglais ou allemand, cela avant d’accéder à des universités turques prestigieuses4.
Sinon dès l’entrée à l’université tout au moins après la licence, ces individus se signalent aussi
par l’accumulation de capitaux « scientifiques » au sein d’universités turques et étrangères –
2 Tous ne sont pas des fils de commerçants anatoliens dits Tigres d’Anatolie. On trouve des fils de paysans mais
aussi, en proportion significative, des fils d’instituteur. 3 Ils sont rares à jouir de du statut de « super-mandarin ». L’observation et les occurrences relevées sur le terrain
nous incitent à labelliser en priorité : A. Davutoğlu, M. B. Altunışık (METU), Z. Kursun (Marmara). Ces deux
derniers n’étant d’ailleurs pas, tant au titre générationnel que de l’affinité politique affichée, représentatifs de la
génération étudiée ici. La particularité de cette génération est qu’en marge d’A. Davutoğlu, dit « Hoca » (le
maître), professeur de relations internationales islamo-conservateur sorti du champ académique pour devenir
conseiller du Premier ministre puis ministre des Affaires étrangères, les références tutélaires dont elle dépend ne
relèvent pas de la même « mouvance » politique. Cette génération n’a pas encore produit ses propres
« mandarins ». 4 On pense tout d’abord à : Bogaziçi, METU, Marmara, Ankara, Istanbul et plus récemment quelques privées :
Sabanci, Yeditepe, Koç, Bilkent (Ankara), Hacıtepe (Ankara)
9
notamment aux Etats-Unis5-, de sorte à accumuler titres et publications mais aussi d’élargir
leur réseau et de « cosmopolitiser » leur cursus scientifique, ce qui se double parfois d’un
cursus parallèle dans une dershane6 de sorte à « rester en contact avec [leur] culture
totalement absente des enseignements dispensés à l’université sur le mode des universités
occidentales »7. Lorsque l’on met en parallèle ces parcours individuels, se dessinent un
nombre limité de trajectoire-types. La première phase, celle de la licence, s’effectue
généralement dans une université turque, à Istanbul, Ankara ou dans une ville de moindre
importance8. C’est après la licence que s’amorce une différenciation. La présentation
schématique de ces trajectoires est toutefois plus parlante
5 Près de la moitié des trajectoires de ce groupe, ressortent ainsi l’Utah University ou la Mason University
(Virginie) comme lieu de réalisation du doctorat. 6 Terme générique qui désigne les écoles du soir ou du weekend soit où se préparent les examens, soit encore où
les étudiants peuvent suivre un cursus parallèle (langues étrangères notamment) 7 Entretien avec T. Köse, Şehir üniversitesi, décembre 2012. Il évoquait alors son cursus parallèle au sein du
Bilim ve Sanat Vakfı où il exerce désormais les fonctions de coordinateur pédagogique. 8 Bolu, Sakarya, Eskişehir, Gaziantep sont les villes les plus souvent citées.
10
Sur le plan idéologique, cette population partage le sentiment que la tentative d’oblitération de
l’identité musulmane de l’Etat-nation turc que les élites kémalistes et la junte militaire ont
longtemps cherché à réaliser constitue une tromperie majeure et une injustice qu’il convient
désormais de corriger. A cet égard, le « processus du 28 Février » (1997) par lequel l’Etat-
major des Armées intervenait à nouveau dans la vie politique pour limiter « la réislamisation
et l’arabisation de la société » (Yavuz, 2003) a constitué un événement négatif fondateur.
Pour les plus anciens de la génération, le coup d’état postmoderne a même pu occasionner une
rupture biographique. L’impossibilité de poursuivre le doctorat ou le mastère du fait de
l’inopportunité du sujet, de la fermeture de nombreux cours, ou tout simplement du refus de
11
se dévoiler pour ce qui est des femmes, se sont traduit par une sortie temporaire –parfois
définitive- du milieu universitaire9.
Autre point commun de cette population universitaire, le séjour prolongé dans une ou
plusieurs universités occidentale est non seulement le moment où elle noue des liens entre
elles mais aussi la période de ce que les sujets présentent comme une « prise de conscience »
du caractère occidentalo-centré des représentations dominantes du monde et de son histoire.
Cela entraîne dès lors une réflexion critique et parfois une relativisation des méthodes dites
universelles de production du savoir scientifique conçues en Occident. Dans ces méthodes et
récits qu’ils s’astreignent à appliquer et à reproduire dans le cadre d’une stratégie
d’accumulation de capital scientifique, ces étudiants turcs se sentent en effet éclipsés de
l’histoire en tant que musulmans –et Turcs- héritiers de civilisations qui se percevaient elles
aussi comme le centre du monde. Ce ressenti commun est aussi formulé sous forme de
préoccupation problématique par A. Davutoğlu dans l’ouvrage en forme d’entretien intitulé
Küresel Bunalim (2002)10. Le consensus sur la dimension fondatrice de l’œuvre intellectuelle
et institutionnelle11 d’Ahmet Davutoğlu est d’ailleurs l’un des ciments de cette population.
Nombre des anciens étudiants de l’actuel ministre des Affaires étrangères à l’université de
Marmara où il a enseigné à son retour de Malaisie se charge d’ailleurs d’entretenir le réseau et
de mobiliser autour des diverses thématiques développée par le « Hoca » (Zengin, 2012). La
cohésion de ce groupe d’universitaires est évidemment renforcée par l’interconnaissance née
de leurs trajectoires croisées, en Turquie et à l’étranger.
Enfin, les contours de cette « quasi-communauté » se dessinent aussi par ses caractéristiques
« négatives » et notamment par le fait qu’en dépit d’un intérêt pour la zone arabophone, ses
membres n’investissent guère dans l’apprentissage de l’arabe en dépit de déclarations qui
évoquent une forme de vénération craintive pour cette langue. De même, ces acteurs –hormis
lorsqu’ils sont mandatés par un think-tank, nous le verrons plus bas-, n’ont pas intégré la
collecte de données empirique de première main12 dans leur démarche de production de
9 Entretiens avec T. Z. Kor, Bilim ve Sanat Vakfı, Istanbul, décembre 2012 ; Et avec M. Şenel, Şehir
Üniversitesi, novembre 2012. 10 Davutoğlu, A., Küresel Bunalım, Küre Yayınları, 2002, p. 92 ; cité dans Dorronsoro (2002), opcit., p. 41. 11 L’actuel ministre des affaires étrangères turc a fondé une université privée stambouliote (année) au prestige
croissant et avait ouvert auparavant une fondation culturelle, la Fondation pour la sciences et les arts (Bilim ve
Sanat Vakfı), deux entités dans lesquelles sa pensée fait figure de dogme et ses anciens élèves de missionnaires
coordinateurs de réseau. 12 Cependant nous touchons là à une problématique partagée plus largement par les sciences sociales turques et à
leur dimension largement livresque, au détriment des enquêtes empiriques, le caractère empirique consistant
souvent dans la reprise des résultats d’enquêtes effectués par des chercheurs américains ou européens. La
critique et les changements survenus récemment dans ce domaine sont traité dans la troisième partie du papier.
12
savoirs. Les trajectoires des acteurs n’offrent donc que rarement trace de séjours linguistiques
dans un pays arabe pas plus que de terrains sociographiques. La langue arabe peine à
s’extraire du champ religieux, n’étant maîtrisée pour ce qui est de sa version classique –
aptitude corollaire d’un mépris de l’arabe dialectal- que par les sujets ayant suivi le troisième
parcours-type13.
On constate de surcroît un phénomène de « transhumance » de la spécialité chez les plus
sujets les plus anciens. En effet, la reconstitution biographique permet parfois de constater que
certains professeurs de relations internationales affichant via leurs publications et/ou sujet de
thèse, une spécialisation sur les Balkans, le Caucase ou l’Asie centrale dans les années 1990,
ont déplacé le cœur de leur expertise vers le Moyen-Orient au cours de la décennie 2000,
d’abord en termes généraux puis, éventuellement et à titre d’exemple, au conflit syrien et à
son impact sur la politique turque. C’est là il est vrai un thème anxiogène de part notamment
son impact à l’intérieur de Turquie (émigration, attentats…), ce qui encourage peut-être les
vocations. Au demeurant, la conscience de ce phénomène conjugué à la méconnaissance de la
langue de la zone de spécialité explique en partie que les titres « d’expert Moyen-Orient » ou
« d’Ortadoğucu »14 soient systématiquement rejetés par ces acteurs eux-mêmes,
indépendamment du volume de publications, communications ou consultations revendiquées
ou affichées afférentes aux thèmes du « Moyen-Orient ».
La question qui se pose à nous à l’issue de la présentation de ces éléments de convergence est
celle de la qualification de cette population. Dans quelle mesure peut-on parler de groupe
social ? Si c’est en effet un groupe social, peut-on parler de groupe générationnel ?
disciplinaire ? De communauté de politique publique ? Et il faut alors identifier en
complément les acteurs issus d’autres espaces que celui de l’université, notamment celui de
l’Etat et plus spécialement du ministère des Affaires étrangères et des services du Premier
ministre? De réseaux –auquel cas il faut mettre en avant l’aspect réticulaire et les échanges de
ressources ?
Il faut de surcroît prendre en compte l’effet de la conjoncture, et notamment égyptienne et
syriennes, sur la politique étrangère turque. Celle-ci a des effets directs dans le champ de
13 Il existe pour cela des accords interuniversitaires turco-arabes ayant donné naissance dès les années 1980 à des
filières et à l’envoi de petits contingents d’étudiants turcs, notamment vers la Jordanie et l’Egypte (Entretiens
avec C. Tomar, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, décembre 2012 ; Entretien avec T.
Başoğlu, ISAM, Istanbul, janvier 2013) 14 L’Ortadogu uzmanı dipose d’un fort capital scientifique tandis que la catégorie « Ortadogucu » (Moyen-
Orientaliste) inclut aussi les journalistes spécialisés.
13
l’expertise moyen-orientale turque. D’un réseau thématique (Rhodes et Marsh, 1995) peu
exclusif15 comprenant non seulement la population décrite plus haut mais aussi d’autres
acteurs issus de secteurs d’activité, de mouvances et générations politiques diverses, il semble
que l’on s’achemine vers une communauté épistémique (Haas, 1986) voire de politique
publique (Richardson et Jordan, 1983) au fur et à mesure que les révoltes arabes affectent ce
que certains ont cru devoir nommer la « politique arabe » du gouvernement AKP. Celui-ci est
alors peut-être davantage dans une logique d’échange de légitimité avec un groupe restreint et
soudé d’acteurs académiques.
2.Partenaires et rivaux
A cet égard, il convient à présent de présenter brièvement –et on notera d’emblé l’asymétrie
en termes de cohésion- d’autres populations et/ou individus dont la présence dans le champ
atteste de rapports de concurrence. Plusieurs acteurs jouant un rôle pivot dans les institutions
universitaires mais aussi dans les médias, certains revendiquant l’étiquette de « libéraux », ont
participé activement à la production de savoirs dits scientifiques sur le monde arabe en
Turquie. Il est tentant d’analyser cette contribution comme le mouvement tactique d’acteurs
ayant initialement pris acte de la forte politisation de l’arène dans laquelle ils opèrent et ayant
décidé d’en user en privilégiant la construction de leur carrière16. Sans aller jusque là, on
constate avant tout que ces acteurs ne présentent par le même degré de cohésion que le groupe
présenté en premier lieu car mise à part leur condition de «mandarins » des les sciences
sociales turques s’étant initialement ou progressivement spécialisés, les signes de leur
mobilisation collective font défaut.
La seconde population marginale est celle des universitaires et intellectuels se revendiquant
« de gauche » et se mobilisant pour une approche alternative du Moyen-Orient.
Institutionnalisée dès la fin des années 1990 et la réconciliation turco-syrienne17, cette
15 Les listes des personnes formant les délégations ministérielles turques vers les pays arabes sont difficilement
accessibles. En revanche, les entretiens permettent de savoir jusqu’à quelle date telle ou telle personne a été
conviée à se joindre à ces délégations. Beaucoup ont en effet été peu à peu évincé à compter de 2010. 16 Entretiens avec M. B. Altunışık et Ö. Tür, Ankara, janvier 2013. Entretien avec E.P. Dal, Istanbul, octobre
2012. Entretien avec F. Atacan, Istanbul, octobre 2012. Entretien avec Mete Çubukçu Istanbul, novembre 2012. 17 C’est d’abord l’initiative « Ortadoğu Kadınları » -Femmes du Moyen-Orient- lancé par des intellectuelles
turques –universitaires, écrivaines, journalistes- et consistant à se rendre en délégation dans plusieurs pays de la
zone pour participer à des rencontres et débats sur diverses thématiques –paix, société civile, femmes etc.- avec
des intellectuelles des pays arabes, d’Iran et d’Israël. Le mouvement, qui donne lieu à de nombreuses délégations
et rencontres jusqu’au milieu des années 2000, semble toutefois s’étioler par la suite. Les participantes
rencontrées (N. Mert, Istanbul, décembre 2012 ; F. Atacan, octobre 2012 ; M.B Altunışık), en parlent désormais
au passé.
14
mouvance à la fois politique18 et académique, se voulant également transnationale, converti
ultérieurement en parti politique bénéficie de l’héritage symbolique de la gauche radicale et
de la présence d’ancien militants très investis en faveur de la Palestine dans les années 1970 et
dont certain ont même été combattre l’occupant israélien aux côté de l’OLP19. (HDP). Parmi
ce mouvement cherchant à multiplier les passerelles politiques avec les élites politiques et
intellectuelles des différents pays du Moyen-Orient, certains participants ont soutenu durant
un temps (2003-2008) la politique extérieure de l’AKP et ont ainsi fait parti de certaines
délégations ministérielles20 dans le monde arabe. Toutefois, vers 2008, cette «alliance » s’est
dissoute et ces intellectuels de gauche, dont certains ont un accès régulier aux médias, ont
entrepris la critique des ambitions supposées impérialistes du gouvernement AKP., reprenant
le terme « néo-ottomaniste »21. Pourtant, il semble que ces initiatives de gauche relèvent
davantage de l’activisme partisan que d’une coalition d’acteurs du secteur académique
déterminés à produire des savoirs étiquetés scientifiques à l’usage du personnel politico-
administratif.
Le dernier « type » d’acteurs – les facteurs de cohésion de groupes sont encore difficile à
présenter sauf à placer tous le monde dans une catégorie « islamiste » aussi floue
qu’incorrecte- fera l’objet d’une analyse biographique et d’une enquête de terrain spécifique
prochainement. Il s’agit des universitaires en provenance de pays arabes mais aussi des
activistes ayant participé aux mouvements de révoltes auxquels l’entreprise de production de
savoirs dits scientifique turque sur le monde arabe a fait appel afin, vraisemblablement,
d’injecter dans son capital scientifique une note arabe qui en rehausserait la crédibilité et
effacerait un peu le caractère turco-centré au profit d’une note « internationale » ou
« transnationale ».
C. Institutions et passerelles inter-champs : centre de recherche et think-tanks
Il existe donc dans le champ plusieurs populations distinctes dont un groupe plus clairement
identifiable à raison des nombreuses caractéristiques convergentes de ses membres. Outre ces
18 La seconde et plus pérenne incarnation est plus partisane. Il s’agit du HDP qui était initialement le Halkların
Demokratik Kongresi a organisé à plusieurs reprises une « Ortadoğu Konferansı » annuelle -Conférence Moyen-
Orient- avec cet objectif d’instaurer une approche alternative, par opposition au néo-ottomanisme de l’AKP, des
relations entre Turquie et Moyen-Orient arabe et persan. Il est à noter que parmi ses leaders, qui ont pour
beaucoup un passé dans les partis de gauche radicale sans avoir été « activistes », beaucoup sont kurdes. 19 Entretien avec F. Bulut, Istanbul, décembre 2013. 20 Entretien avec N. Mert, Istanbul, novembre 2012. 21 Idem
15
caractéristiques, ce groupe se démarque des autres du fait des liens entre les acteurs qu’il
rassemble et qui incitent à parler de « réseau ».
Cette logique réticulaires est favorisée par l’existence d’acteurs intermédiaires situés dans les
interstices entre champs (Stampnitzky, 2013) entre organes de l’Etat, université et médias. Cet
espace de médiation a été créé, suivant les cas, avec la bienveillance du ministère des affaires
étrangères, de la primature, voire de la présidence et du ministère de la défense,
administrations qui en régulent l’activité via le financement des « projets de recherche» et les
nominations officieuses22. Il est institutionnalisé au moyen de ces entités appelées « institut
de réflexion stratégique » -stratejik düşünce kuruluşu- ou think-tanks, terme choisi afin de
faire écho au discours sur la croissance de la société civile mais aussi en raison de
l’expérience de certain de leurs cadres dans les think-tanks américains. Ces think-tanks
préexistaient d’ailleurs à l’AKP sinon sous leurs noms actuels -SETA, ORSAM, SDE…- tout
au moins dans leur fonction23. Il faut en effet souligner que les « institutions de pensée
stratégique » turques travaillent moins à formuler des recommandations de politique publique,
vocation principale de leurs homologues américains, qu’à organiser le rapport entre ministères
et universitaires, entre commanditaire et sous-traitants dans l’objectif de produire un discours
labellisé « scientifique ». Outre la mise en relations des secteurs d’activité et des acteurs et la
centralisation des commandes d’Etat en matière de production de discours scientifique, les
think-tanks turcs, procèdent à ce que Bourdieu appellent des opérations de marquage. Ils
imposent le cadrage « stratégique », sélectionnent les thématiques, important et traduisent24
une sélection d’auteurs étrangers.
Il faut préciser à ce point de l’exposé que la recherche en sciences humaines et sociales en
Turquie est le parent pauvre de l’université. Les universitaires réalisent peu d’enquêtes
empiriques car ils disposent de peu de moyens. Il y donc là un carence que ces think-tanks ne
manque pas d’exploiter en faisant miroiter aux universitaires la possibilité de voyager, de
22 Le personnel dirigeant des « düşünce kuruluşları» les plus en vue sont en effet nommés pas le ministère des
Affaires étrangères voire par la primature (entretien avec O. Orhan, ORSAM, janvier 2014, B. G. Puntsmann,
Ankara, décembre 2013). 23 Il semble que ce soit la junte qui ait créé les premiers « stratejik düşunce kurulusları» dans les années 1990.
Déjà traités en des termes stratégiques et géopolitiques, les thématiques de recherche étaient alors davantage
centrées sur le Caucase et l’Asie Centrale. Voir Kanbolat, Hasan, and Hasan A. Karasar. “Türkiye’de Stratejik
Düşünce Kültürü ve Sratejik Araştırma Merkezleri: Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları.” Nobel
Yayın Dağıtım, 2009, p. 305-320. 24 Via leurs appels à contributions pour leurs diverses publications, certaines de vulgarisation, d’autres dites
« académiques ». C’est là en tout cas ce que fait apparaître une première lecture des publications telles qu’Insight
Turkey (SETA), Perceptions (Stratejik Araştırmalar Merkezi, ministère des Affaires étrangères), Ortadogu
Dergisi (ORSAM), Analiz (USAK).
16
publier régulièrement voire d’accéder aux médias grand publics et donc d’acquérir de la
visibilité. La redistribution des prébendes s’opère généralement via l’organisation
d’événements ou la publication d’ouvrages collectifs dans le cadre de partenariats
interinstitutionnels et multisectoriels à géométrie variable25.
Participant à la formation d’un réseau de politique publique, se retrouvent donc dans ces
think-tanks mais aussi dans leurs publications26, les universitaires identifiés en premier lieu,
plusieurs « mandarins » relevant de la mouvance libérale, un nombre limité d’universitaires
arabes et des responsables politico-administratifs –MAE, Primature- turcs. Ce réseau est
consolidé non pas tant par des finalités idéologiques ou partisanes partagées –ce qui est le cas
pour le groupe générationnel universitaire identifié- que par le fait que l’ensemble de ses
participants y trouvent l’opportunité de cultiver leurs intérêts en termes de position dans leur
champ d’activité, de revenu, de prestige et de notoriété.
25 Combinant un think-tank coordonateur, un ministère, un département d’université ou centre de recherche, un
organe médiatique et un mécène pro-société civile (ex. Carnegie Endownment, German Marshall Fund) 26 Parmi les principales : Insight Turkey (SETA), Ortadogu Etütleri (ORSAM), Ro’ya Turkiyya (SEAT, en
arabe), Analiz (USAK), Perceptions (SAM). Il est à noter que près de la moitié des revues les revues turques
dites académiques traitant de questions internationales sont la propriété de think-tanks réputés « proches du
gouvernement AKP ».
17
Source : auteur
Source : auteur
D. L’internationalité des sciences sociales et le poids du modèle américain
Il pouvait sembler jusqu’alors que l’on assistait à un phénomène sinon nouveau, tout au moins
endogène. Il convient toutefois de relativiser cette impression en évoquant l’impact de
tendances lourdes sur les sciences sociales turques mais aussi sur l’enseignement supérieur et
la recherche à l’échelle mondiale.
Le poids des études « moyen-orientales », tant à l’université que dans les centres de
recherches privés appelés « think-tanks », doit cependant être comparé à celui d’autres
régions d’intérêt tant au plan synchronique que diachronique. En effet, en même temps que ce
champ d’étude moyen-orientales prend son essor, les études balkaniques ou caucasiennes
bénéficient également d’un développement. Toutefois, il apparaît que la thématique Moyen-
Orient prend un caractère hégémonique, renforcé par les crises sociopolitiques survenues
depuis 2011, ce qui a des effets symboliques et matériels sur la croissance des thématiques
18
concurrentes. Les bourses attribuées par le TÜBITAK aux projets de recherche individuels et
surtout collectifs semblent ainsi marquer une préférence moyen-orientale. Les donateurs,
souvent de grandes entreprises turques qui, tout en se signalant à l’attention du gouvernement
en finançant l’une de ses « agences détachées », obtiennent des abattements fiscaux, voient
eux aussi le Moyen-Orient comme une cible plus digne d’intérêt car plus vaste et plus
populeuse. Il faut néanmoins souligner que jusque dans les années 1990 et jusqu’au milieu des
années 2000 2003, tandis que la même logique était à l’œuvre, ces mêmes donateurs
distribuaient davantage aux entités et projets travaillant sur des thématiques telles que
l’Eurasie, l’Asie centrale27. Les premiers centres de recherche stratégique appelés « think-
tanks » sont d’ailleurs apparus dans les années 1990. Il s’agissait alors pour les bailleurs de
fonds privés de marquer leur convergence de vue avec la junte militaire, alors considérée
comme gardienne du régime.
Par ailleurs, la nécessité ressentie de voyager pour acquérir des savoirs, accumuler des
diplômes, accroître son capital scientifique, mais aussi de publier dans des revues
scientifiques étrangères –américaines et britanniques surtout-, et ce indépendamment de
visées en termes d’influence politique, ne sont pas propre à ce champ des études moyen-
orientales. L’internationalisation des sciences sociales est un phénomène plus large observé
tant en Turquie d’ailleurs. Certains auteurs parlent même de « l’internationalité » du champ
scientifique comme de l’un de ses caractéristiques fonctionnelles essentielles (Gingras 2002).
J’ai signalé dès l’introduction que la formation doctorale est assez récente en Turquie. Voilà
qui plaçait l’ensemble de la recherche turque dans la dépendance des universités étrangères
jusqu’à sa création et contraint celle-ci à s’inspirer de modèles développés hors du pays.
Dès lors, la voie obligée du « social scientist28» a longtemps consisté à réaliser son doctorat à
l’étranger et à publier autant en langue étrangère –anglais, français- qu’en Turc. Le personnel
académique turc chargé de mettre sur pied des formations doctorales est titulaire de diplômes
étrangers, notamment américains et britannique mais aussi français. Bien que cette formation
à l’étranger soit présentée par la génération ascendante de social scientists islamo-
conservateurs comme ayant occasionné un traumatisme identitaire, ce sont ces même acteurs
qui par les postes qu’ils occupent et les ressources auxquelles ils ont accès qui jouent le rôle
27 Entretien avec O. Orhan, ORSAM (Ankara), janvier 2014. Voir aussi Kanbolat Hasan, and Hasan A. Karasar.
“Türkiye’de Stratejik Düşünce Kültürü ve Sratejik Araştırma Merkezleri: Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce
Kuruluşları.” Nobel Yayın Dağıtım, 2009, p. 218-219. 28 Comme le note Vincent Romani (2010), il ne semble pas existe d’équivalent de cette expression en français
pour désigner l’ensemble des sociologues, politologues et autres anthropologues.
19
de passeurs du modèle international –américain surtout- de recherche vers le système turc. La
donne internationale est donc consubstantielle à la recherche universitaire turque dans cette
phase initiale de son développement. En effet, la majeure partie des personnes interrogées ont
effectué une partie de leur cursus aux Etats-Unis, en tant que boursiers turcs au début au
moins, devenant éventuellement boursier américain (avec contrepartie enseignement et/ou
recherche dans l’université) par la suite. Certains y sont restés plusieurs années29, occupant
des fonctions d’enseignement et de recherche tandis qu’ils accomplissaient leur doctorat. Il est
rare pour autant que le cursus ait été effectué dans le gotha des universités américaines
(Princeton, Harvard, Columbia, UCLA etc.). Par ailleurs, d’autres sujets, tandis qu’ils
effectuaient leur thèse, ont rapidement opté pour l’expertise et ont ainsi opéré comme
chercheurs dans les think-tanks américains. Ces parcours ont donné lieu à l’accumulation de
savoirs et surtout de savoir-faire valorisables dans le champ académique et dans celui de
l’expertise. Une fois de retour en Turquie, on ne s’étonne pas que ceux qui avaient acquis ces
compétences les « mettent en application » en cofondant des institutions qu’ils nommeront
« think-tanks », et cela même si les relations établies dès leur fondation avec telle ou telle
administration d’Etat –plutôt qu’avec un parti30- atteste d’une fonction différenciée d’avec
celles de leurs homologues américains.
L’influence américaine ne se limite pas à ce transfert de savoir-faire et au rôle de passeur joué
par ces universitaires turcs formé aux Etats-Unis. Ce sous-champ universitaire versé dans les
études moyen-orientales naît comme on l’a dit sous la mandature AKP. La doctrine de
politique étrangère de l’AKP est pour sa part formulée au début des années 2000, alors même
que G. W. Bush met en avant son projet pour un Grand Moyen-Orient. Aussi proche puisse-t-
elle paraître, aussi intime devrait-elle sembler, la relation de la Turquie avec le Moyen-Orient
telle que définie par le personnel politico-administratif turc et nombre d’universitaires
travaillant en collusion avec lui apparaît sous influence américaine. Le caractère essentialiste
et messianique du projet américain semble avoir été largement repris à leur compte par la
diplomatie turque et ses partenaires académiques dans leur volonté d’appréhension, de
pacification et de médiation tous-azimuts de la zone.
29 A. Kösebalaban (Istanbul, Şehir Üniv., décembre 2012) a ainsi passé près de 10 ans aux Etats-Unis (Utah
University) pour finir son doctorat après un passage par la Malaisie, où le MAE A. Davutoğlu était passé au
début des années 1990. T. Köse (Istanbul, Şehir Üniv.) 6 années de doctorat aux Etats-Unis (G. Mason
University) . Özlem Tür (Ankara, METU) 5 ans à Durham University (R.U.). Şaban Kardaş (TOBB
Universitesi, actuellement directeur du think-tank ORSAM, nommé par le MAE) a également effectué son
doctorat à la Utah University (2006-2010). 30 Il reste difficile pour ce type d’entité de mobiliser des financements privés s’ils n’ont pas déjà manifesté leur
convergence avec les intérêts d’une institution de l’Etat.
20
En prenant garde de ne pas exagérer le caractère nouveau ou endogène du phénomène, j’ai
d’abord tenté d’aborder le champ de l’expertise turque sur le « monde arabe » via une
ébauche d’étude sociologique des acteurs individuels et institutionnels.
Source : auteur
III. Ebauche d’une approche par les stratégies
Faire la sociologie d’un champ et de ses acteurs, quelques soient les questions qui restent pour
le moment en suspens quant à leur définition, requiert aussi que je m’intéresse aux stratégies
dont ces acteurs usent les uns vis-à-vis des autres. A cet égard, l’étude empirique a fait
21
émerger tout d’abord certains usages récurrents –vocabulaires, discours- qui laissent à penser
qu’il pourrait s’agir là d’instruments d’une palette tactique restant à analyser et que les
acteurs, coalitions d’acteurs et institutions impliquées mettent en œuvres dans le cadre de
stratégie d’auto-qualification, de labellisation et de disqualification des rivaux. Il existe aussi
des coups tactiques relevant de la captation et de l’allocation des ressources de l’Etat. Je
présente donc ici une vision encore très incomplète de segments de stratégies observés dans le
champ.
A. L’enjeu des définitions : Moyen-Orient, Monde arabe…
La multiplication des entretiens et l’accroissement du volume de la collecte documentaire m’a
rapidement confronté à la pluralité des définitions et appellations de ce que beaucoup
considèrent désormais comme une évidence géographique et culturelle : le « Moyen-Orient ».
Ce flou offre un angle alternatif quant à travailler la définition de mon objet: les divergences
de définition, les redéfinitions tactiques et, de manière plus large la construction d’une image
de l’autre via les définitions géographiques et géopolitiques. Ainsi parler des études arabes en
Turquie, des études moyen-orientales incluant l’Iran et Israël, de l’étude du Moyen-Orient au
prisme de la question kurde, l’étude des relations de la Turquie avec les parties de cet
ensemble, et à commencer par la question initiale de l’inclusion de la Turquie dans ce
« Moyen-Orient », voilà autant de dénominations renvoyant à des postures et options diverses
des acteurs. Prendre en considération spécifiquement l’expertise sur les pays arabes n’a de
sens que si l’on s’attarde d’abord sur ce flou déjà très informatif des appellations et que l’on
compare avec ce qui a été produit sur les pays limitrophes de pays arabophones et rendtrant
dans certaines définitions du Moyen-Orient.
Dit « Ortadoğu » en turc –traduction mot-à-mot du terme, le « Moyen-Orient » renvoie à un
ensemble géographique aux frontières contestées, ne serait-ce que parce qu’il peut ou non
inclure la Turquie. C’est même là un élément récurrent du questionnement identitaire turc.
L’un des universitaires interrogé affirme ainsi :
« Evidemment que la Turquie est au Moyen-Orient, nous sommes des moyen-orientaux, un
point c’est tout. Notre histoire, nos liens familiaux, notre religion sont moyen-orientaux. » 31
31 V. Ayhan, Ankara, avril 2013. Il faut noter ici qu’il est né au Kurdistan turc est lui-même kurde. C’est pourtant
là un acteur qui s’il s’identifie au projet de politique étrangère de l’AKP tel que manifesté jusqu’en 2011, n’est
pas complètement en phase avec la politique intérieure du gouvernement et ne correspond pas entièrement aux
caractéristiques sociologiques mentionnées pour désigner ce groupe d’intellectuels universitaires mobilisés.
22
Tandis qu’un chroniqueur –dit « köşe yazarı »- du quotidien Milliyet et ancien correspondant
de l’AFP disait :
« Le problème de ce gouvernement, c’est qu’il a cherché à trop moyen-orientaliser la
Turquie. Or c’est une erreur parce que si la Turquie se moyen-orientalise, elle ne peut plus
jouer le rôle d’intermédiaire entre Orient et Occident. »32
Ces deux extraits presque caricaturaux reflètent néanmoins la première tension qui existe sur
la définition de ce Moyen-Orient. Si la position exprimée dans le premier extrait s’approche
de la perception qui semble vouloir s’imposer dans les dernières années, la seconde est celle
qui paraissait devoir prévaloir depuis l’instauration de la République. A travers ce jeu de
définitions s’esquisse donc déjà le différend structurant de notre champ, qui oppose les
« défenseurs de l’identité authentique de la société turque » (moyen-orientale, musulmane)
aux partisans de l’identité kémaliste –moderne, laïque, républicaine, européenne- de la
Turquie et de son régime politique. Si tous parlent d’identité, les premiers paraissent nous
parler davantage de la société et les seconds des institutions, mais on se rend compte que tous
comptent sur ces dernières pour incarner et imposer l’identité nationale.
La question de l’inclusion de l’Etat d’Israël renvoie au même type clivage de position : si la
Turquie n’est pas au Moyen-Orient, Israël fait figure d’Etat-nation d’exception. A l’inverse,
elle représente bien la diversité sociale, politique et culturelle de la région. L’inclusion de
l’Iran dans l’appellation Moyen-Orient ne fait aucun doute, à la différence de l’Afghanistan et
du Pakistan, que la carte du futur « Grand-Moyen Orient » dessinée par Z. Brzezniski pour le
sommet du G8 de 2004 englobait volontiers. La présence de l’Afrique nord dans la zone
désignée par « Ortadoğu » peut également varier, certains précisant comme dans un effort de
rigueur méthodologique a minima Ortadoğu ve Kuzey Afrika –Moyen-Orient et Afrique du
Nord.
Pour les Turcs en général, évoquer le Moyen-Orient c’est évidemment et surtout parler des
Kurdes pour ne par dire de la « question kurde ». C’est ce qui fait que l’Iran, la Syrie et l’Irak,
outre l’aspect frontalier, sont le cœur du Moyen-Orient dans l’imaginaire turc. Groupe
ethnique partagé entre 4 Etats dont la Turquie et ses 3 voisins orientaux, les Kurdes sont cet
Autre de référence, à la fois intérieur et extérieur –l’Arabe est le second Autre de référence,
plus spécifiquement extérieur car même s’il existe plus d’un million d’arabophones dans la
32 K. Gürsel, Istanbul, janvier 2013
23
région sud-est de la Turquie, ils sont considérés officiellement comme Turcs. Les Kurdes
jouent autant le rôle d’ennemi intérieur que le rôle de passeur et de lien avec ce « Moyen-
Orient ». Cette pluralité des rôles et les jeux auxquels ils donnent lieu dans le champ qui
m’intéresse dans la thèse seront analysés plus en détails ultérieurement. Cependant, et pour
résumer, il semble parfois que développer une expertise sur la question kurde en Turquie
puisse revenir ou mener au fil du temps à passer pour un « expert du Moyen-Orient » -de
Bagdad à Rabat et de Sanaa à Alexandrie33.
En ce qui concerne plus spécifiquement l’expertise sur les pays arabes, les expressions
comme l’échelle-même de l’expertise varient aussi. Rares sont les universitaires spécialisés
sur un phénomène unique dans un pays unique34. Ceux-ci ont d’ailleurs pour réflexe de rejeter
les expression trop englobantes à comment par celle de « Moyen-Orient » ou d’associer pays
arabes et Iran en raison de leur appartenance au monde islamique. On entendra à l’inverse
plus volontiers parler de « monde arabe » -Arap dünyası35- , pays arabes –Arap ülkeleri-,
Afrique du Nord –Kuzey Afrika-, pays du Golfe –Körfez ülkeleri-, Pays du Printemps Arabe
–Arap Baharı ülkeleri-, voire de Proche-Orient –Yakın Doğu. L’usage de ces formules
regroupant 3, 8, 23… pays est peut-être aussi symptomatique de la forme de l’expertise
produite et à produire. Plutôt que des savoirs appuyés sur une expérience empirique à une
échelle micro dont certains résultats sont généralisables, il s’agit souvent de produire en flux
continu un discours généralisateur, vaguement comparatiste, facilitant son usage pour
l’administration publique tant pour déterminer a priori que pour légitimer a posteriori sa
politique. Cependant, on note à ce point comme il est aisé de glisser vers le jugement de
valeur. Pour résumer donc, l’usage de l’appellation Moyen-Orient par un « expert » de la zone
renvoie à une définition au prisme de la « question kurde » ou tout au moins où celle-ci
occupe une fonction explicative centrale et parfois tautologique.
Du coup, le clivage évoqué plus haut entre défenseurs de l’identité vraie et défenseur de
l’identité kémaliste s’estompe au profit d’un autre différend, entre les acteurs qui
33 Exemple caricatural du journaliste Cengiz Çandar, ancien militant maoïste qui a combattu au Liban aux côtés
de l’OLP dans les années 1970, a passé quelques années en prison en Israël avant de devenir conseiller des
princes (à commencer par Özal et jusqu’à Erdogan) ; mais aussi du journaliste et crhoniqueur K. Gürsel qui fut
un temps prisonnier du PKK. 34 L’une des rares exceptions serait F. Atacan, Yıldız Üniv. (Istanbul, octobre 2012), spécialisée en seconde
partie de carrière et à titre comparatif avec l’islamisme turc sur lequel elle avait d’abord travaillé, sur l’islamisme
égyptien. Je pense également au journaliste Mete Çubuçu (NTV), plus spécialisé sur l’Egypte même s’il a
d’abord travaillé en Palestine et en Irak. 35 Par symétrie avec « Türk dünyası », le monde turcique, expression renvoyant aux nations et Etats-nations
d’Asie centrale, du Caucase et du Proche-Orient employant un parler turc.
24
appréhendent les problématique régionale au filtre de la « question kurde », et ceux qui
cherchent à sortir ou à contourner ce paradigme tantôt en réduisant l’échelle de leur étude
(approche pays), tantôt –et plus souvent, en optant pour des appellations qui renvoient à des
aires plus petites.
Aussi utile que soit de refléter ces conflits de définitions géopolitiques, il semble encore
difficile d’attribuer avec précision telle appellation à tel groupe. L’une des raisons en est que
l’utilisation de tel ou tel terme n’est pas exclusive du recours à d’autres formules par un même
acteur. C’est aussi que cette nomination plurielle renvoie, outre à des stratégies du champ, à
un questionnement identitaire profond des turcs, et notamment de la frange d’universitaires
sur laquelle on se penche ici. En effet, ce qui est en jeu lorsque, par une démarche qui se veut
scientifique, qu’elle serve ou non des fins politiques, on tente de construire une image de
l’autre, c’est, par jeu de reflet, le retour sur l’image que l’on a de soi. A cet égard aussi, cette
étude devrait apporter des constats empiriques intéressants.
Source : auteur
25
B. Stratégie discursives
A l’issue des entretiens biographiques réalisés entre octobre 2012 et février 2014 dans les
universités et institutions « para-académiques » -auto-désignées du nom de think-tanks,
« düşünce kuruluşu »- de Turquie, j’ai pu recenser trois grands registres thématiques de
discours que je nommerai « discours de restauration », « discours particulariste» et « discours
sur la démocratisation ». Ce sont là trois facettes d’une même posture consistant à présenter la
période de l’AKP au pouvoir comme unique dans l’histoire de la république et produisant
donc des effets uniques dans la société turque. De part leur enchevêtrement, leur fluctuation et
leur caractère réactif, ces discours, qu’ils visent à cadrer l’action – registre néo-ottomaniste ou
concernant la démocratisation- ou d’une volonté d’enraciner une légitimité -restauration et
particularisme- me semble relever autant d’élément de structuration d’un champ que de ce que
M. Dobry appelle « un coup » dans un échange tactique (Dobry, 2009).
a. Le discours de restauration
Le discours de restauration est un discours que l’on entend bien avant d’entrer dans les
enceintes universitaires et qui est diffusé par les plus fervents soutiens du gouvernement AKP.
Son nom de « restauration » renvoie à l’expression employée en 2012 par l’actuel Ministre
turc des Affaires étrangères, Ahmet Davutoğlu36, pour qualifier les réalisations politiques de
l’AKP. Le « règne » de l’AKP aurait en effet lancé de vastes chantiers de restauration de la
Turquie « véritable ». Ces chantiers, intervenant tant dans le domaine des lois sociales37 que
des relations internationales38, auraient pour objectif d’autoriser la société turque tantôt
trompée tantôt spoliée sur le plan identitaire par les élites politiques antérieures, à renouer
avec les attributs de son identité musulmane et orientale. Dans la perspective de cette
restauration, Ahmet Davutoğlu formulait même dans un ouvrage un temps considéré comme
« la » nouvelle doctrine de politique étrangère turque, Stratejik Derinlik (2001), ce que
certaines sociologies appellent un « script » (Musselin, 2008), ensemble de prescriptions
normatives à l’attention de l’environnement institutionnel qui lui était familier39, le champ
académique. Proche d’un cadrage néo-ottomaniste, il invitait ainsi à la création de centres de
36 Terme utilisé par le Ministre turc des affaires étrangère A. Davutoğlu dans l’émission Sensürsüz Özel
(« Spécial non censuré »), Kanal 24, le 01/12/2012, pour qualifier les initiatives prises par le gouvernement AKP
depuis 2002 37 L’AKP a rapidement pris des mesures visant à amoindrir le rôle de l’armée dans la vie politique. Ce parti a
aussi cherché à réformer l’institution judiciaire - en supprimant, par exemple, les juridictions d’exception - et a
lancé une réforme du code pénal. 38 De le recherche d’une influence croissante au sein de l’Organisation de la Conférence islamique –objectif en
partie atteint du fait de la nomination d’E. Ihsanoğlu comme secrétaire général en 2004. 39 Davutoglu, A., Stratejik Derinlik, Küre Yayınları, 2001, p.452-453.
26
recherche consacrés à l’étude des zones sur lesquelles les Turcs avait jadis régné et dans
lesquelles ils devaient, dans un futur proche, s’efforcer de regagner en influence. Ce « script »
s’inscrivait dans une rhétorique d’économie de la connaissance, discours angélique et de ce
fait en décalage avec la réalité des relations consolidées ultérieurement entre ces
universitaires-experts et les organes de l’Etat en charge des Affaires extérieures telles que
nous aurons l’occasion de le détailler ci-après.
Au demeurant, la lecture « restauratrice », qui relève davantage du discours polémique que
d’une réécriture de mains d’expert, est aisément mise à mal, ne serait-ce que par la littérature
historique, turque40 et étrangère41 qui se charge d’analyser la période Özal de la politique
étrangère turque et les efforts déployés dès les années 1980 pour développer les relations
diplomatiques et commerciales avec le Moyen-Orient arabe et l’Afrique du Nord. Ce discours
est également remis en cause par nombre d’historiens s’étant interrogés sur les aléas de la
laïcité et la place accordée à l’islam dans le système politique turc d’une période à l’autre. A
cet égard, à chaque fois qu’un gouvernement turc s’est signalé par une tolérance accrue envers
l’expression de la piété musulmane dans la sphère politique turque –cela commence avec le
DP de Menderes, 1950-1960-, ce gouvernement s’est investi parallèlement dans le
développement des relations avec les pays arabes (Özdalga, 2006).
b. Le discours particulariste
Le discours particulariste qui relève de la rhétorique essentialiste paraît assez répandu dans le
champ académique (sciences humaines et sociales turques)42 et justifie jusqu’à certaines
formes de division du travail revenant à considérer que « les plus aptes à travailler sur les
Turkmènes sont les Turkmènes, les Tcherkesses sur les Tcherkesses, les alévis sur les alévis,
les Kurdes sur les Kurdes etc. ». Dans le champ qui m’intéresse, l’avatar de cette thématique
est celle qui affirme que l’histoire partagée –référence surtout à la période de domination
ottomane-, les similarités sociologiques, la proximité géographique et les liens de parenté
transnationaux constituent un avantage inégalable quant à analyser et comprendre les ressorts
sociaux et politiques des sociétés arabes. Autrement dit, étant turc, musulman, voisin de la
zone arabophone et ayant même parfois conservé des liens familiaux transnationaux, un Turc,
universitaire de surcroît, comprendra naturellement les sociétés de ses « cousins » arabes. Ce
40 Oran, Baskın. Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşindan Bugüne. Vol. Cilt 2: 1980–2001. Istanbul: İletişim,
2001.p.781-796. 41 Voir par exemple Picard, E. La Nouvelle Dynamique Au Moyen-Orient: Les Relations Entre l’Orient Arabe et
La Turquie. Paris: L’Harmattan, 2000. 42 Echange avec E. Massicard, Istanbul, avril 2014.
27
discours n’est pas uniquement celui des fervents soutiens du gouvernement. Il est aussi
dispensé par ceux qui par idéalisme autant que du fait de leur origine ethnique ou
géographique, adhèrent au « recentrage oriental » de la politique étrangère voulu par A.
Davutoğlu et notamment à l’axe nommé depuis « zéro problème » avec les voisins.
Confronté au péril anxiogène des révolutions arabes et notamment de la guerre civile
syrienne, certains des « experts » interrogés n’hésitent pas à marteler cet argument
particulariste en dépit du caractère indéniablement descriptif de leur production récente. Ce
jugement de valeur n’explique toutefois pas cette contradiction qui s’explique probablement
davantage par les modalités et contraintes de production de ces savoirs que par les
connaissances de leur producteur.
Par ailleurs, ce discours essentialiste, qui est présenté par ses locuteurs mêmes comme
rompant avec la perception négative des arabes entretenue par plusieurs groupes sociaux et
champs de la société turque –les kémalistes, les turcs « blancs », la junte militaire, les
nationalistes et autres idéalistes, certaines gauches…- n’est pas toujours exempt d’accents
condescendants voire méprisants43.
c. Le discours sur la démocratisation
Il est un troisième registre thématique développé par ces producteurs culturels intéressés, via
l’analyse du « Moyen-Orient »44, à défendre l’identité orientale de la Turquie, c’est celui de
la démocratisation. Il met en scène une société civile dynamique contre un Etat jadis
hégémonique mais en reflux. En ce qui concerne cette étude, c’est là un thème notamment
élaboré par les cadres et chercheurs des organismes se faisant appeler think-tanks ou düşünce
kuruluşları.
43 Certains sujets interrogés, manifestement ébranlés dans leurs certitudes par les révoltes arabes, soient qu’elle
virent au conflit ouvert ou qu’elles se traduisent par une transition politique plus ou moins pacifique mais sans
« adoption » pour autant d’un quelconque modèle turc, semblent parfois se trahir par des expressions de mépris
et l’emploi d’expressions totalisantes qui laissent à penser que l’Arabe est redevenu cet « Autre de référence »
(Dorronsoro, 2002), cet Autre chaotique, incohérent, ce traitre à lui-même et éventuellement aux autres, et non
plus le « presque semblable ». 44 Ce terme est souvent utilisé au détriment d’appellations plus précises qui existent cependant en turc – monde
arabe, Afrique du Nord, Bilâd Ach-Châm, Proche –Orient…-, reflétant peut-être ainsi la nécessité de parler
encore et toujours plus de cet « Ortadoğu » sans prendre toujours la peine des définitions préliminaires. C’est
que la zone, désignée par cette acception vague, concentre tout ce que beaucoup de Turcs, à commencer par les
élites, considèrent comme étranger, exogène, indésirable. Par ailleurs, sans que cela constitue un critère définitif,
on remarque que le terme « Ortadoğu », dramatique, sensationnaliste, est souvent utilisé par des acteurs et
institutions cherchant une visibilité médiatique. A l’inverse, parmi les observateurs les plus attentifs, parfois
arabophones, « Ortadoğu » est de plus en plus fréquemment récusé en faveur de « monde arabe », « pays
arabe ». Plus rares encore, quelques universitaires rejettent d’emblée les conclusions généralisées à l’échelle de
la zone et militent pour une analyse pays par pays.
28
Ce discours consiste à présenter les think-tanks turcs, institutions qui relèvent soit du statut de
fondation –vakıf-, soit du statut associatif –dernek-, et pour lesquelles le « Moyen-Orient » est
un fond de commerce, comme les émanations d’un champ intellectuel désormais autonomisé
du champ étatique mais militant pour la mise en œuvre de telle ou telle politique, tant sur le
plan intérieur qu’extérieur. La jeune littérature développée sur les « think-tanks » (Abelson,
2006 ; Medvetz, 2009 ; Struyk, 2002 ; Stone, 2007), notamment américains, est inopérante car
soit trop descriptive soit trop fonctionnaliste, prenant pour argent-comptant la rhétorique
développée par ces organismes concernant leur propre activité.
Or, ce discours ne s’adresse pas tant au chercheur occidental mais aux multinationales du
« brainstorming » qui s’appuient sur des réseaux de think-tanks nationaux auxquels elle
apportent des financements et une reconnaissance internationale relative moyennant
certifications et labels en contrepartie de la réalisation de projets dits scientifiques manifestant
la foi dans les valeurs démocratiques. Parmi ces organisations-cibles, on retiendra par
exemple le Carneggie Endownment, le German Marshall Fund ou encore l’Open Society
Foundation45.
A la question « Parvenez-vous donc à vous faire entendre du Ministères des Affaires
étrangères ou de la Primature et à ce que vos recommandations soient suivies ? », les réponses
varient, et ce peut-être influencé par la conjoncture nationale et internationale. C’est ainsi qu’à
la fin 2012, alors qu’il n’était pas encore question de complot guleniste contre l’actuel
Premier Ministre, que les révolutions arabes laissaient penser que l’exportation d’un modèle
turc ou AKP était possible et que le conflit syrien ne semblait pas encore une impasse, les
cadres des « think-tanks » proéminents comme SETA, USAK, ORSAM, TESEV46 se
plaignaient fréquemment de ne pas être entendu du gouvernement. A la fin 2013, le ton
paraissait avoir changé et les doléances se font désormais moins entendre47. Le jeu politique a
changé. Les cadres de « think-tanks » qui croyaient encore dans leur autonomie limitée ont été
45 Outre la mention du soutien de ces institutions dans nombre d’entretiens réalisés dans les « think-tanks » turcs,
leur logo figure sur toutes les publications des think-tanks réalisée en partenariat avec ces soutiens. 46 Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırma Vakfı (SETA ou SETAV, Fondation de recherche sur la politique,
l’économie et la société, idéologiquement proche du MAE turc) ; Uluslararası Stratejik Arastirma Kurulu
(USAK, Organisation pour la recherche stratégique internationale) ; Ortadoğu Stratejik Araştırma Merkezi
(ORSAM, Centre de recherche stratégique sur le Moyen-Orient, think tank de la fondation culturelle turkmène),
Toplum, Ekonomik ve Siyasal Etütleri Vakfı (TESEV, Fondation pour l’étude de la société , de l’économie et du
politique, l’un des plus anciens think tank , d’obédience libérale). 47 Entretiens avec H. Kanbolat, ORSAM, Ankara, décembre 2013. Entretien avec U. Ulutaş, SETA, décembre
2014. Entretien avec O. Orhan, ORSAM, janvier 2014.
29
sortis du jeu48. Ceux qui sont encore en place ne feignent plus la distance avec le
gouvernement et l’on parle moins de « société civile ». Voilà qui nous incite à réfléchir sur les
relations qu’entretiennent les locuteurs de ces discours avec le discours lui-même.
C. Accès et redistribution des ressources étatiques
Afin de poursuivre leur ouvrage les acteurs académiques doivent accéder voire
éventuellement accroître les ressources à disposition, qu’elles soient matérielles –
financement, soutien logistique- et/ou symbolique –pouvoir, prestige. Ces ressources sont,
pour eux, localisées principalement dans la sphère de l’Etat même si l’apparition médiatique
est un instrument incontournable de certains plans de carrière. Dans le cas présent, On pense
particulièrement au financement du Ministère des Affaires étrangères49, de la primature ainsi
que des organismes ayant pour mission d’organiser la recherche via la distribution de
financements sur projet tel le TÜBITAK ou de coordonner la coopération internationale
comme le fait la TIKA –Türk Işbirliği Koordinatörlüğü Ajansı, Agence Turque de
coopération…. Certaines entreprises privées distribuent aussi des financements via leurs
fondations ou les think-tanks –qui ont le statut de fondations- pour les activités de recherche
en sciences sociales. Outre les abattements fiscaux qui le récompense, ce financement privé
doit probablement être appréhendé surtout comme une manière dont usent les entreprises pour
signaler leur allégeance aux détenteurs du pouvoir politique50.
Pour accéder à ces ressources, les deux techniques les plus utilisées sont, dans un contexte de
politisation élevé des institutions d’Etat, le développement des canaux réticulaires et la
multipositionnalité des acteurs.
La politisation des institutions de l’Etat n’est pas une donnée nouvelle du système politique
turc, elle tendrait même relever de son mode de fonctionnement. L’implantation dans cet Etat
de mouvances politiques parvenant à monopoliser les ressources d’autorité –nominations,
allocation des ressources financières- a en outre déjà été décrit (Gourisse, 2012). Le champ
universitaire turc en sciences humaines et sociales, de part sa fonction originelle de
48 La deuxième partie de 2013 a en effet vu certains de ces organismes renouveler leurs équipes de chercheurs
(entretien avec B. Puntsmann, ex-senior researcher au Türkiye Ekonomi Politika Araştırma Vakfı, TEPAV). En
janvier 2014, l’ORSAM a vu son président et co-fondateur remplacé sur décision officieuse du Ministère des
Affaires étrangères (entretiens avec O. Orhan, Ankara, janvier 2014 ; et M. Özcan, MAE, janvier 2014). 49 Via la collaboration avec le centre de recherche du ministère –Stratejik Araştırma Merkezi, SAM, Centre de
recherche stratégique- en vue de publications ou d’événements, via aussi des réunions régulières avec les
membres du cabinet du ministre, via enfin les relations personnelles du ministre A. Davutoğlu avec ses anciens
collègues ou anciens étudiants. 50 Entretiens avec O. Orhan, Ankara, janvier 2014. Entretien avec E. Efeğil, Istanbul, février 2014.
30
transmission et de fabrication des connaissances, et même s’il renvoie moins à des institutions
de l’Etat qu’à des établissements publics autonomes, est également très politisé (Monceau,
2005). Cette politisation se traduit même occasionnellement par une forte polarisation et des
conflits sociaux durables. Les acteurs identifiés précédemment contribuent à la politisation du
champ disciplinaire des sciences humaines et sociales en entretenant des rapports d’allégeance
et de sous-traitance avec l’administration de l’Etat pénétré par la mouvance dite islamo-
conservatrice institutionnalisée dans le parti AKP.
Le rapport premier des universitaires repéré précédemment avec la sphère étatique est un
rapport interpersonnel avec des cadres du ministère des affaires étrangères, de la primature et
des institutions supérieures du champ académique –TÜBITAK, YÖK, TIKA51-, rapport
alimenté par l’affinité politique52. Les logiques réticulaires à l’œuvre se sont parfois mises en
place avant que les parties à la relation parviennent, dans leurs milieux professionnels
respectifs, à des postes d’autorité. En complément d’une identification au moins partielle au
projet politique de l’AKP, le fait d’avoir étudié dans la même université, d’avoir été dans le
même lycée, d’avoir séjourné dans la même université étrangère, même à des périodes
différentes, suffisent à faire naître l’affinité qui deviendra une relation constructive et utile au
gré des services rendus et projets menés en commun53. Quoiqu’il en soit, c’est en suivant cette
logique de réseau que grandissent ce que B. Gourisse nomment « réseaux collusifs », entre les
administrations d’Etat mentionnée et ce sous-champ universitaire. La consolidation de ces
liens facilitent ensuite la distribution des emplois et accroissent l’accumulation puis la
monopolisation des « ressources d’autorité » que sont le pouvoir de nomination et
d’affectation des ressources. La question de la rareté de telle ou telle compétence spécifique
est ainsi marginale puisque la question motrice n’est pas « qui sait quoi ? » mais « qui connaît
qui ?». En revanche, on note que certains sous-groupes ont pu fait figure de viviers de
compétence ou d’expérience. C’est par exemple le cas des anciens étudiants en théologie dont
51 Le YÖK, Yüksek Öğretim Kurulu, est le comité de supervision de l’enseignement supérieur, ses membres sont
nommés par le pouvoir politique. Le nombre des « experts » Moyen-Orient nommés au YÖK est disproportionné
au regard de la marginalité numérique de ce sous-champ académiqueCela tendrait à souligner l’importance de ce
domaine d’étude ainsi que l’activisme politico-académiques de certains de ses acteurs. Le TÜBITAK, Türk
Bilim Teknik Araştırma Kurulu, est le conseil supérieur des sciences, des techniques et de la recherche. La
TIKA, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı est l’agence turque de coopération internationale. Ces trois organes
sont très politisés du fait de la nomination de leur membre et des ressources financières importantes qu’elles sont
chargées d’allouer. 52 A cet égard, voir la place du « hem » dans la construction des réseaux sociaux dans Fliche, B. « De l’action
réticulaire à la recherche du semblable » in Dorronsoro (2002), opcit. p. 148-165. 53 La notion de « projet » est ici très importante car c’est en montant des « projets de recherche » et en les
présentant aux institutions susceptible de les financer que les acteurs de la recherche, individuelle ou collective,
parviennent à leurs objectifs de financement, d’élargissement de leur réseau et de pérennisation des relations
ainsi établies avec la sphère étatique.
31
le cursus reflète la maîtrise au moins théorique de l’arabe, d’éventuelles expériences de
longues durées en pays arabes –séjours étudiants- et une connaissance sanctionnée par des
diplômes de la théologie musulmane sunnite54. Ce peut être aussi le cas de certains
journalistes « vadrouillant » -ou « ayant vadrouillé- dans certains pays arabes et dont
l’expérience de terrain représente un capital valorisé55. Concernant l’origine géographique des
acteurs, si l’on note en effet la présence de plusieurs acteurs en provenance du sud-est du
pays, pour certains arabophones ou kurdophones avant de devenir turcophones, on hésitera à
les considérer comme un vivier de compétence ou de personnel au sens où leur présence dans
le champ ne paraît pas relever d’une politique spécifique de recrutement par le haut mais
plutôt d’affinités héritées et développées par chaque sujet au fil de son parcours56.
Ces logiques réticulaires, si elles correspondent à un mode ancien d’établissement des liens
entre administré set administration en Turquie (Fliche, 2005), se trouvent démultipliées du fait
l’existence des « think-tanks » qui, s’ils n’ont pas tant vocation à produire de recommandation
de politique publique que de légitimer les politiques gouvernementales, sont néanmoins le lieu
de sélection des experts que l’on met en situation de produire un consensus, de labelliser des
savoirs, tout assurant la circulation de ces savoirs consensuels par l’hybridation des
personnels universitaire, administratif et médiatique. En effet, lorsque l’on interroge un cadre
de SETA, USAK, ORSAM ou d’autres entités saillantes de ce type, il apparaît qu’outre la
publication de rapports, « policy briefs » et autres « Annales »57, activités qui mobilisent les
équipes de recherche, l’organisation de conférence, réunion de travail (toplantılar), ateliers
54 C’est aussi là que l’on mesure le caractère narratif et construit des CV recueillis. En effet, lorsque se présente
une opportunité de poste ou d’orientation de cursus, il convient de ré-agencer les éléments du CV pour
« raconter » le récit type attendu. Quoiqu’il en soit, les filières qui ont amené des étudiants turcs en théologie à
séjourner dans une université arabe (en Jordanie et Egypte notamment) et les trajectoires spécifiques de ces
étudiants font l’objet d’une analyse approfondie qui devrait donner lieu à une étude dans les institutions arabes
d’accueil prochainement. 55 Je pense ici aux journalistes collaborant ou ayant coopéré avec des “think-tanks” ou, plus directement, avec
des administrations ministérielles. A titre d’exemples, on pourra citer M. Çubukçu (NTV, collaborateur
occasionnel de SETA, auteur de plusieurs essais-reportages sur le Proche-Orient) Hakan Al-Bayrak (ancien de
Yeni Şafak passé à Akşam ; auteur de plusieurs ouvrages à prétention analytique sur la Syrie et l’Egypte ;
conseiller occasionnel de la primature), Sefer Turan (ex-journaliste de TRT-1 puis TRT-Arapça en poste depuis
2009 à la primature). 56 Parmi les personnes interrogées, deux sujets paraissent assez représentatifs de ces cas de figure : Y. Aktay
(reconstitution prosopographique : natif de Siirt, arabophone, membre du comité directeur de l’AKP, président
du think-tank SDE, professeur à Selçuk Üniversitesi) ; V. Ayhan (entretien : né au Kurdistan turc, kurdophone,
fondateur d’une association de chercheurs, IMPR, spécialisée sur le Moyen-Orient arabe et persan, professeur à
Bolu Üniversitesi). 57 İnat, Kemal, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, and et Alii. Ortadoğu Yıllığı 2008. Istanbul: Küre
Yayınları, 2009 ; mais aussi SETA, Dış Politika Yıllığı ( 2010, 2011, 2012).
32
(çalıştay) et autres forums avec, des chercheurs des universités turques et étrangères58, des
diplomates, membres de cabinets et journalistes spécialisés, constitue le cœur d’activité de ces
cadres59.
Le second outil d’accès et de distribution des ressources est le fait que certains acteurs
individuels occupent des fonctions ou soient au moins présents dans l’organigramme de
plusieurs institutions dans des secteurs d’activités différenciés. On trouve ainsi quelques rares
acteurs qui sont à la fois et par exemple professeur d’université (Marmara), directeur de centre
de recherche universitaire (Marmara, ODAE), cadre de « think-tank » (SETA), présentateur
d’un programme de politique étrangère sur la chaîne publique TRT, conseiller du ministre des
Affaires étrangères et du conseil d’administration du TÜBITAK60. Les capitaux symboliques
accumulés en résultante de ces activités diverses dans différents champs se combinent pour
consolider l’hégémonie de l’acteur-individu dans ces champs et affirmer le caractère
stratégique de la multipositionnalité dans le champ. Enfin, cette caractéristique suppose que
les acteurs concernés contrôlent des ressources financières et réticulaires qu’ils allouent de
manière discrétionnaire en suivant les lignes d’affinités décrites précédemment. En étant
professeur dans un centre de recherche public, l’acteur forme et sélectionne les
problématiques légitimes ainsi que les candidats à leur traitement. Occupant des fonctions
dans un think-tank ainsi qu’au TÜBITAK et auprès du ministre, l’acteur coordonne le lien
entre MAE et personnel académique, désignant les projets de recherches valorisés61 et influant
sur l’affectation des crédits sur ces projets. La conjoncture et notamment le besoin accru de
légitimation des détenteurs du pouvoir exécutif, en proie à la contestation au sein et en dehors
de la mouvance islamo-conservatrice, induisent des pressions qui produisent des effets de
verrouillage sur ces circuits réticulaires et positions multiples simultanées.
D. Labellisation de l’expertise
Ces éléments nous invitent à synthétiser, ne fusse que de manière temporaire, ce qui, dans le
champ étudié, semble fournir le label et donc la légitimité de l’expertise aux discours produits
et à leur producteurs. Il émerge de l’étude du champ, de la biographie des acteurs, des
58 L’étude détaillée des personnalités invitées et des équilibres recherchés entre provenances de ces invités feront
l’objet de développements plus longs dans la thèse. 59 Entretien avec T. Özhan (SETA, Ankara, janvier 2013), H. Kanbolat (ORSAM, Ankara, décembre 2013), S.
Senyücel Gündoğar (TESEV, Istanbul, décembre 2012), O. Bahadır Dinçer (USAK, Ankara, avril 2013). 60 Entretien avec T. Küçükçan (Marmara Üniv., Istanbul, décembre 2012). 61 Exemple, concernant les « Printemps arabes » du goût pour les annuaires biographiques d’acteurs pays par
pays ; ou pour les analyses mutliformat (thèse ou mémoire d’étudiant, policy report de think-tank) « softpower
turc » ; ou encore des études sur le sens des relations turco-arabes à l’aune de la candidature d’accesion à l’UE
33
stratégies mises en œuvre au niveau individuel et institutionnel, que ce qui détermine la
validité d’un savoir d’expert mais aussi ce qui permet d’attribuer à un individu ou à une
institution le label « d’expert » tient à la fois à des propriétés intrinsèques et au caractère de la
relation entretenue avec une administration publique spécifique. A ce titre, et en ce qui
concerne l’expertise sur une thématique en lien avec le « Moyen-Orient », être chargé par le
Ministère des Affaires étrangères ou la primature d’un « projet de recherche » -généralement
mené en partenariat avec d’autres institutions comme le TÜBITAK et/ou une université-
constitue une reconnaissance suprême dont les conséquences, notamment en termes de
financement public et privé à venir, sont importantes en ce qu’elles consacrent la prééminence
de ou des acteurs dans le champ de l’expertise et lui ouvre d’autres opportunités de
collaboration avec ces administration sur d’autres sujets. (Je m’étonne d’ailleurs de ne pas
avoir encore entendu évoquer de projets menés avec le ministère de la défense.) C’est en tout
cas ce qui ressort de la trajectoire institutionnelle du centre de l’Ortadoğu Çalıştımaları de
Sakarya üniversitesi (Sakarya) ou des think-tank SETA, ORSAM et SDE.
Qui plus est, au plan individuel, collaborer à des projets avec l’administration, signifie
prestige et médiatisation, mais également salaire complémentaire, financement de projets
ultérieurs, élargissement du réseau personnel et donc des opportunités éventuelles de
participer à des projets de recherche similaires.
En ce qui concerne les propriétés intrinsèques de l’acteur institutionnel, il doit avant tout avoir
stocké des ressources humaines qui constituent son capital scientifique. Les chercheurs qui
constituent cette ressource sont détenteur du titre de docteur ou encore doctorants et sont
invités à publier régulièrement, spécifiquement sur la problématique qui leur est familière
quitte à élargir à des enjeux plus larges62. Outre les think-tanks, il existe des centres de
recherche publics, dont l’Orta Doğu Araştırma Enstitüsü de Marmara üniversitesi (ODAE,
Istanbul), l’Ortadoğu Çalıştımaları de Sakarya üniversitesi (Sakarya), des Ortadogu Etütleri
du Sosyal Bilimi Enstitüsü de l’Université METU (Ankara), ou encore l’Ortadoğu
Araştırmaları Merkezi de la Fırat Üniversitesi (Elazığ).
Le second critère déterminant de l’expertise pour une institution est la visibilité médiatique de
ses chercheurs. Les médias publics et privés, et surtout les chaînes de télévision (TRT-1,
62 Ce qui conduit parfois à la mutation ou à la transhumance du « cœur d’expertise » d’une zone géographique à
l’autre, de l’Asie Centrale au Caucase puis aux Balkans.
34
TRT-Haber, TRT-Arapça) ont fréquemment recours à l’expertise des universitaires. Certains
programmes sont même préparés et présentés par des personnalités académiques63.
Cette propriété est opérationnelle à égalité avec la capacité des cadres de ces entités de
recherche à entretenir des rapports personnels avec des membres relativement éminents de
l’administration avec laquelle ils souhaitent que leur organisation entretienne des liens. Ainsi
connaître quelqu’un qui, au Ministère des Affaires étrangères, s’occupe des liens avec
l’université, est lui-même affecté à des fonctions de recherche64, ou est au cabinet du ministre,
ou encore avec un ambassadeur influent.
En somme, si l’expert ou l’organisation experte doit présenter certaines propriétés pour être
éligible au titre, c’est le fait d’être choisi et, de préférence de manière récurrente, qui lui
attribue et, par effet d’entraînement, consolide son statut d’expert dans tous les champs
d’activité où ils opèrent –université, médias, administration.
Ces logiques et notamment le fait qu’ils répondent à un besoin étatique, entretiennent un
malaise sur la légitimité du savoir ainsi créé. Le label « scientifique » est revendiqué par
l’ensemble des acteurs à raison du fait qu’ils opèrent dans des instances dont la vocation est la
production et la circulation de savoirs académique. Pour autant, cette revendication apparaît
comme un « coup » tactique dans une stratégie plus large de fabrication de légitimité. Le
directeur du think-tank SETA affirme ainsi :
« Nous sommes beaucoup critiqués. On dit : « SETA est proche du gouvernement ». Bon
d’accord, mais ça veut dire quoi être proche du gouvernement ? Nous, notre seul objectif,
c’est de produire du savoir académique. Ici on a de vrais chercheurs, des gens avec des
diplômes et des compétences. Personne ne cherche à les influencer. On leur demande d’être
objectifs, c’est tout. Et on leur permet d’aller faire des enquêtes de terrain. Ce n’est pas moi
qui doit dire à un chercheur ce qu’il a observé sur le terrain.»
En marge du fait que ce discours est dispensé par l’ensemble des cadres de centre de
recherche privé rencontrés, il pointe du doigt un élément qui par sa mention revient à un autre
63 Sur une quarantaine d’universitaires rencontrés, 6 présentent un programme de politique internationale ou
généraliste sur TRT. Ces mêmes personnes sont également sollicités dans d’autres programmes comparables au
leur sur des chaînes privées (CNN-Türk, CNBC, NTV, TV7, Oda-TV etc.). Parmi les 34 autres universitaires,
seuls 3 n’avaient jamais été sollicités par un média télévisuel, les autres ayant été contactés à au moins deux
reprises. 64 Le MAE dispose lui-aussi de son « think-tank », appelé Stratejik Araştırmaları Merkezi (MAE), créé en 1995.
Son directeur, nommé directement par le ministre des Affaires étrangères, est actuellement un universitaire après
avoir longtemps été incarné par des diplomates en fin de carrière.
35
coup dans le champ : faire du terrain. A la fois par tradition et par manque de moyens (Turan,
2009, les étudiants turcs font peu d’enquête de terrain durant avant la fin du doctorat et,
souvent, peu après également. Même si les choses changent progressivement – ce qui se
donne à voir notamment dans mon champ d’étude-, les thèses sont souvent des condensés
d’études théoriques et empiriques produites par d’autres. Evoquer donc la réalisation d’études
empiriques vise donc à accroître la scientificité du savoir produit. De même, l’allusion aux
« compétences », linguistiques en particulier, est un ultime coup appuyé sur l’explication des
critères de recrutement dans l’organisation et notamment sur la nécessité de connaître la
langue de sa zone de spécialité. Deux éléments explicatifs supplémentaires en font un trait
tactique : tous les think-tanks n’ont pas les moyens ou le souhait de se focaliser autant sur cet
« avantage comparatif » ; vu il n’y existe pas d’exigence d’apprentissage de la langue locale
pour les enseignant-chercheurs des universités, leur rapport au donné empirique est faible.
Source : auteur
Question conclusive : Une commande d’Etat ?
L’observation de liens réticulaires entre acteurs académiques et administration du MAE et
primature, autrement dit entre savoir et pouvoir ne nous permet pas de déterminer la nature de
36
leur relation. S’agit-il d’une commande d’Etat, ce qui supposerait de démontrer la préséance
de ce dernier ? Ou s’agit-il d’un partenariat, d’une alliance ad hoc entre un groupe de
personnes -qui s’identifient au projet politique des détenteurs du pouvoir politique, identifient
un besoin et trouvent leur utilité sociale dans la réponse à ce besoin- et des administrations
d’Etat cherchant à affermir la légitimité de leurs initiatives par une caution académique ?
S’il y a eu commande d’Etat, il semble que soit cela un fait minoritaire et qu’il conviendrait
d’étudier à part afin de comprendre les ressorts spécifique de cette « commande ». Si en
revanche les échanges observés s’avoisinent davantage à un « régime de collaborations »
portées par la conjoncture et une convergence d’intérêts, ce qui correspond, par hypothèse, au
cas majoritaire, alors il faudra persévérer pour décrypter les modalités de cette « entreprise de
production de discours » labellisé scientifique. A cet égard, en marge des finalités
poursuivies, des logiques mises en œuvres, des mécanismes institutionnalisés ou non, il faudra
peut-être appréhender l’activité de labellisation – auto-labellisation, labellisation des espaces,
des phénomènes sociaux, des opérations des acteurs et des institutions- comme l’une des
activités les plus stratégiques de « l’entreprise ».
37
Annexe : Essai de représentation des relations savoir-pouvoir à l’aide du modèle de la triple
hélice.
38
Calendrier 2014-2015
(3ème année de doctorat. Fin du contrat doctoral: novembre 2016)
Eté 2014
Poursuite du traitement de la collecte documentaire (revues, rapports, ouvrages)
Reconstitutions biographiques (universitairs turcs mais aussi arabes venus/venant ou résidant
en Turquie)
Lectures théoriques (Politiques publiques et expertise)
Rédaction d’un article pour la REMM (les sciences sociales au défi des révolutions
arabes)
Automne 2014
4ème série d’entretiens avec des universitaires et, plus largement, avec des intellectuels
turcs (cette fois-ci aux marges de la cible: le but est d’interroger sur leur parcours: (1) des
intellectuels dits “islamistes” formés en partie dans un pays arabe mais non considérés
comme experts MO (2) des intellectuels hors du champ universitaire ne s’identifiant pas à
la mouvance AKP et non insérés dans le réseau de politique publique identitfié. Objectif:
reconstituer les réseaux turcs et turco-arabes qui se sont tissés via les filières de
coopération universitaire turco-arabe)
Analyse prosopographique des biographies collectées depuis le début (80 environ)
Lecture empiriques (Turquie/pays arabes concernés par le terrain)
Hiver 2014-2015
Consultation selon disponibilité de quelques thèses produites récemment en Turquie sur
le monde arabe, universitaires intellectuels arabe.
Ebauche de plan de la thèse
1er terrain arabe (Egypte probablement: entretien avec universitaires locaux, cadres et
chercheurs en think-tanks égyptien et turcs implantés sur place, journalistes turcs
résidants. Objectif: reconstituer trajectoires individuelles et recueillir analyses des
événements égyptiens, des relations turco-égytienne et de la politique étrangère turque.
Collecte documentaire)
Traitement des entretiens et de la collecte
Printemps 2015
Préparation d’un article ou d’une communication en anglais
Préparation de la communication pour l’école d’été d’Aix
Eté 2015
Amélioration du plan de la thèse
Préparation 2ème terrain arabe (Maroc ou Tunisie)
Automne 2015
2ème terrain arabe (idem Egypte)
39
Traitement du matériau
Finalisation du Plan
Hiver 2015
Rédaction
Derniers entretiens en Turquie (associations “turco-arabes”, think-tanks stambouliotes
relativement marginaux sur les thématiques “MO” par rapport aux ankariotes)
Printemps 2015
Rédaction (dont un extrait sera présenté pour l’école d’été)
Eté 2015
Pause dans la rédaction
Vérifications bibliographiques
Automne 2015...
Reprise de la rédaction
Bibliographie
Atacan, F. Kutsal Göç, Radikal İslamcı Bir Grubun Anatomisi, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1993.
Abelson, Donald E. Do Think Tanks Matter? Assessing the Impact of Public Policy Institutes. Montréal: McGill-
Queens Universdity Press, 2002.
Barchard D., « Les intellectuels turcs et la crise des années 1980 » in La Turquie au seuil de L’Europe,
L’Harmattan, p. 151-165.
Béhar, D. Les Universités Privées d’Istanbul. Les dossiers de l’IFEA. Institut Français d’Etudes Anatoliennes,
Juin 2002.
Botiveau, B. & alii, Les intellectuels et le pouvoir. Syrie, Egypte, Tunisie, Algérie. Dossiers du CEDEJ n°3,
1985.
Bourdieu, P. “Les Conditions Sociales de La Circulation Internationale Des Idées.” Actes de Recherche En
Sciences Sociales, no. 145 (2002).
_ La noblesse d'État : grandes écoles et esprit de corps, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens
commun », 1989.
_ Homo Academicus. Paris: Editions de Minuit, 1984
_ La distinction. Critique sociale du jugement, Minuit : 1979.
Copeaux, Etienne. Espace et temps de la nation turque. Analyse d’une historiographie Nationaliste 1931-1993,
CNRS Editions, 1997.
Crozier, M. et Friedberg, E. L’acteur et le système, Seuil, 1977.
40
Davutoğlu A. Stratejik Derinlik , Küre Yayınları, 2001.
Küresel Bunalım, Küre Yayınları, 2002.
Dezalay, Y. “Les courtiers de l’international. Héritiers cosmopolites, mercenaires de l’impérialisme et
missionnaires de l’universel.” Actes de Recherche En Sciences Sociales, no. 151–52 (January 2004): 4–35.
Dobry, M. Sociologie Des Crises Politiques. La Dynamique Des Mobilisations Multisectorielles. 3ème ed.
Presses de Sciences Po’, 2009.
Dorronsoro, G. Que Veut La Turquie? Ambitions et Stratégies Internationales. Autrement, 2009.
Filleule, O. “Propositions pour une analyse processuelle de l’engagement individuel”, in Olivier Fillieule et
Nonna Mayer, (dir) dossier “Devenirs Militants”, Revue française de science politique, vol 51, n°1, 2001, p.
199-215.
_ avec Bennani-Chraïbi, M. Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes, Presses de
Sciences Po, 2003
Fliche, B. « De l’action réticulaire à la recherche du semblable » in Dorronsoro (2002), p. 148-165.
Foucault, M. L'Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.
Gaudin, J-P., Politiques de la ville, PUF, 1995.
Gingras, Y. “Les formes spécifiques de L’internationalité du champ scientifique.” Actes de Recherche En
Sciences Sociales 2, no. 141 (2002): 31–45.
Gourisse, B. “Participation Électorale, Pénétration de l’Etat et Violence Armée dans la crise politique turque de
la seconde moitié des années 1970. Contribution à l’analyse des crises politiques longues.” Politix 2012/2, no. 98
(2012): 171–93.
Granovetter, M. S. “The Strength of Weak Ties.” American Journal of Sociology 6, no. 76 (May 1973): 1360–
80.
Haas, P-M, “Epistemic Communities and International Policy Coordination”, International Organization, 46 (1),
Knowledge, Power, and International Policy Coordination (Hiver, 1992), pp. 1-35.
Habermas, J. La technique et la science comme idéologie, Gallimard, 1973.
Hassenteufel, Les médecins face à l’Etat. Une comparaison européenne, Montchrestien, 1997.
Heclo, H. et Wildavsky, A, The Private Government of Public Money, Community and Policy Inside British
Politics, MacMillan, 1974.
Kanbolat, H. et Karasar H.A. “Türkiye’de Stratejik Düşünce Kültürü ve Sratejik Araştırma Merkezleri:
Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları.” Nobel Yayın Dağıtım, 2009
Kepel G. et Richardson, Y. Intellectuels et militants de l’Islam contemporain, Seuil, 1990.
Khelfaoui, Hocine. “Le Champ Universitaire Algérien Entre Pouvoirs Politiques et Champ Économique.” Actes
de Recherche En Sciences Sociales 148, no. Juin 2003 (n.d.): 34–46.
Lahire Bernard, « 1. Champ, hors-champ, contrechamp », in Bernard Lahire , Le travail sociologique de Pierre
Bourdieu, La Découverte , 2001 p. 23-57.
Leydesdorff, L. et Etzkowitz, H. « Technology innovation in a triple helix of university-industry-government
relations, Asia Pacific tech », Monitor, XV (1), 1998, p. 32-38.
Boltanski, L. Les cadres. La formation d'un groupe social, Éditions de Minuit, 1982.
41
Mardin, S. Cultural Transitions in the Middle-East, Brill, 1994.
Meeker M., The new muslim Intellectuals in the Republic of Turkey, in Tapper, R. Islam in Modern Turkey.
Religion, politics and literature in a Secular State, I.B. Tauris & Co. Limited, 1991, pp. 189-219.
Medvetz, T. “Les Think-tanks Aux Etats-Unis. L’émergence D’un Sous-Espace de Production Des Savoirs.”
Actes de Recherche En Sciences Sociales, no. 176–77 (Eté 2009): 82–93.
Monceau, N. “Les intellectuels mobilisés: Le cas de la Fondation d’histoire de Turquie.” In La Turquie Conteste.
Mobilisations Sociales et Régime Sécuritaire, 109–26. CNRS Editions, 2005.
Musselin, C. “Vers Un Marché International de L’enseignement Supérieur?” Critique Internationale 2008/2, no.
39 (2008): 13–24.
Nay et Smith, Les intermediaires en politique. Médiation et jeux d’institutions in Nay et Smith (dir.) Le
gouvernement du compromis. Courtiers et généralistes de l’action publique, Economica, 2002, p.1-21.
Neveu, E. et François, B. Espaces publics Mosaïques. Acteurs, arènes et rhétoriques des débats publics
contemporains, Presses universitaires de Rennes, 1999.
Offerlé, M. Sociologie des groupes d’intérêt, Montchrestien, 1998 (2° éd.).
Oran, B. Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşindan Bugüne. Vol. Cilt 1: 1919–1989. Istanbul: İletişim, 2001
_ Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşindan Bugüne. Vol. Cilt 2: 1980–2001. Istanbul: İletişim,
2001.
Özdalga, E. “The Hidden Arab: A Critical Reading of the Notion of ‘Turkish Islam.’” Middle Eastern Studies
42, no. 4 (juillet 2006): 551–70.
Pareto, V., Traité de sociologie générale, Œuvres complètes, T.XII, Droz, 1968.
Picard, E. La Nouvelle Dynamique Au Moyen-Orient: Les Relations Entre l’Orient Arabe et La Turquie. Paris:
L’Harmattan, 2000.
Rhodes, R. et Marsh, D. Policy networks in British government, Oxford Clarendon Press, 1992.
Richardson, J. et Jordan, A. Policy Styles in Western Europe, Allen and Unvin, 1982.
Rioufreyt, Th. “Les passeurs de la 3ème Voie. Intermédiaires et médiateurs dans la circulation internationale des
idées.” Critique Internationale, no. 59 (Février 2013): 9–16.
Romani, Vincent. “Sciences Sociales Entre Nationalisme et Mondialisation. Le Cas Des Territoires Occupés
Palestiniens.” Sociétés Contemporaines, no. 78 (Février 2010): 137–56.
Saïd, E. L’orientalisme. L’Orient Créé Par l’Occident. Paris: Seuil, 2003.
Sapiro, G. “Modèles d’intervention politique des intellectuels. Le cas français.” Actes de Recherche En Sciences
Sociales, no. 176–77 (Janvier2009): 8–31.
Schmitter, P., “Still the century of corporatism”, Review of Politics, n°36, 1974.
Stampnitzky, L. “Experts, Etats et théorie des champs. Sociologie de l’expertise en matière de terrorisme.”
Critique Internationale, no. 59 (Février 2013): 89–104.
Stone, D. “Recycling Bins, Garbage Cans or Think Tanks? Three Myths Regarding Policy Analysis Institutes.”
University of Warwick, 2007. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00649.x.
42
Struyk, R. J. “Management of Transnational Think Tank Networks.” International Journal of Politics, Culture,
and Society 15, no. 4 (n.d.): 624–38. Accessed April 2, 2013.
Suleiman, E. Les élites en France, Grands corps et grandes écoles, Seuil, 1979.
Taşkın, Y. Intellectuals and the State in Turkey: The Case of Nationalist Conservatism during and after the Cold
War (thèse de doctorat), Boğaziçi Üniversitesi, 2001.
Turan, I. “Türkiye’de Siyasal Bilimin Gelişmesi: Tarihçe ve Kurumsal Gelişmeler,” I.Ü. SIYASAL BILGILER
FAKÜLTESI DERGISI. 40 (2009), 13-30. (The Development of Political Science in Turkey: History and
Institutional Developments).
Vauchez, A. “Le prisme circulatoire. Retour sur un leitmotiv académique.” Critique Internationale, no. 59
(February 2013): 9–16.
Vincent-Lancrin, S. “L’enseignement supérieur transnational: Un nouvel enjeu stratégique?” Critique
Internationale 2008/2, no. 39 (2008): 67–86.
Weber, M. Le savant et le politique (1919), La Découverte-Poche, 2003.
White, J. B. Islamist Mobilization in Turkey. A Study in Vernacular Politics, University of Washington Press,
2002.
_ Muslim Nationalism and the New Turks, Princeton University Press, 2002.
Yavuz, H. Islamic Political Identity in Turkey. Oxford University Press, 2003
Zengin, G. Hoca: Türk Dış Politikasında “Davutoğlu Etkisi.” Istanbul: İnkilâp, 2012.