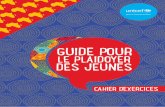Les jeunes en Afrique subsaharienne: bilan d'un champ en mutation
-
Upload
cegepmontpetit -
Category
Documents
-
view
21 -
download
0
Transcript of Les jeunes en Afrique subsaharienne: bilan d'un champ en mutation
Les jeunes en Afrique subsaharienne : bilan d'un champ en mutation Louis Audet Gosselin, doctorant, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal Cet article vise à faire le bilan de la littérature récente en sciences humaines concernant les jeunes en Afrique au sud du Sahara. Ce champ a connu un essor important depuis 1990, à la suite des changements démographiques et socio-économiques profonds vécus par le continent. En outre, le regard des chercheurs sur les jeunes s'est rapidement transformé, passant d'une vision alarmiste d'une génération « perdue » au début des années 1990 à une valorisation, depuis la fin des années 1990, de l'agencéité des jeunes considérés comme une catégorie sociale dynamique et créative. Plus récemment, certains chercheurs tentent de relativiser cette option de l'agencéité en mettant l'accent sur les liens entre les jeunes et le reste de la société, et notamment sur les relations intergénérationnelles. This article aims at reviewing recent scholarly literature in social science concerning youth in Africa South of the Sahara. This field has experienced a considerable growth since 1990, following major demographic and socioeconomic changes on the continent. Furthermore, the scholars' approach of youth has changed rapidly, from an alarmist vision of a « lost » generation at the beginning of the 1990s to a promotion of youth agency since the end of the 1990s, in which youth is seen as a dynamic and creative social category. More recently, some scholars try to question the agency paradigm, stressing the links between youth and the rest of society, especially intergenerational relations.
Le 6 août 2009, une contribution parue dans le quotidien burkinabè Le Pays attirait l'attention sur la
présence de jeunes mendiants sur l'avenue Charles-de-Gaulle, l'une des principales artères de la capitale
Ouagadougou1. L'auteur décrivait l'un des jeunes, un « adolescent », comme ayant une plaie béante au
bras et utilisant cette plaie pour attirer l'attention des automobilistes. Il était également question d'un
groupe de « gamins » qui tentait d'obtenir de l'argent par une mise en scène exagérant leur dénuement.
Le texte concluait par un appel à l'intervention des autorités: « Voilà des actes qui interpellent tout le
monde y compris les autorités communales qui devront en urgence jeter un coup d'œil sur ces artères et
ailleurs. » Cette brève contribution rejoint plusieurs aspects de l'imaginaire souvent évoqué concernant
les jeunes dans l'Afrique contemporaine. Ils sont marginalisés, réduits pour plusieurs à la mendicité. Ils
sont menacés dans leur intégrité physique, incapables de s'offrir des soins de base. Ils inspirent la pitié,
mais aussi le dégoût et la crainte, surtout lorsqu'ils s'organisent dans des initiatives considérées comme
malhonnêtes et illégales. Enfin, ils appellent une intervention de la part des autorités, intervention à la
fois dans le sens d'une prise en charge socio-sanitaire et d'une répression policière.
Cet imaginaire trouble entourant les jeunes est très présent en Afrique subsaharienne depuis la
fin du XXe siècle. La jeunesse est devenue un enjeu sécuritaire, social et politique majeur qui pèse
lourd dans le quotidien des sociétés africaines, même si l'essentiel du discours qui la concerne est
produit par des adultes. Cette réalité, issue en grande partie d'un contexte démographique où les jeunes
sont très nombreux (44,3% de moins de 15 ans en 2000 pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne2)
ainsi que d'une paupérisation accrue depuis les années 1980, a suscité un grand intérêt chez les
chercheurs en sciences humaines à partir des années 1990.
L'objectif de cet article est de tracer un bilan de la littérature récente issue de ce regain d'intérêt
1 Philippe Bama, Le Pays, 6 août 2009, no 4422, http://www.lepays.bf/spip.php?breve8, (consulté le 6 août 2009). 2 Dominique Tabutin et Bruno Schoumaker, « La démographie de l'Afrique au sud du Sahara des années 1950 aux années
2000. Synthèse des changements et bilan statistique », Population, 59, 3-4 (2004), p. 609.
pour les questions touchant les jeunes en Afrique subsaharienne. Il s'agit de dégager les principales
évolutions dans la façon d'aborder les jeunes, en mettant l'accent sur les tendances les plus récentes,
ainsi que de souligner les approches conceptuelles les plus intéressantes.
Dans un premier temps, je traiterai de la vision des jeunes comme éléments dominés ou
marginaux des sociétés africaines, vision très présente dans les travaux d'avant 1990, mais également
dans une littérature pessimiste des années 1990, insistant sur la marginalisation et les problèmes des
jeunes. Dans un second temps, je montrerai comment un accent sur l’agencéité (agency) des jeunes a
permis de donner une image plus dynamique et moins socialement déterminée des jeunes, tout en
soulevant de nouveaux problèmes. Enfin, j'exposerai les tentatives récentes pour contourner ces
problèmes en revenant à une vision des jeunes comme insérés dans un contexte socio-historique plus
large et dans des relations avec les autres générations.
Des jeunes présents mais passifs
Avant leur émergence comme source de fascination durant les années 1990, les jeunes n'étaient pas
complètement absents de la littérature scientifique. Cependant, ils ne constituaient pas le centre de
l'analyse dans l'ensemble des courants qui animaient les recherches africanistes au cours du XXe siècle,
qui les reléguaient au rang d'éléments dominés au sein d'une structure sociale plutôt rigide. Les
bouleversements sociopolitiques et économiques des années 1980 et surtout 1990 ont amené certains
chercheurs à adopter un discours alarmiste à propos des jeunes africains vus comme victimes des
événements.
Un intérêt clairsemé avant les années 1990
Le foisonnement d'études sur les jeunes en Afrique depuis les années 1990 donne l'impression de la
découverte d'un nouveau champ de recherches ignoré par les chercheurs précédents, « laissé à peu près
en friche »3. Cette impression est exagérée, dans la mesure où les jeunes ont été présents de façon
sporadique comme catégorie sociale dans les études anthropologiques. On peut par exemple noter les
travaux de Margaret Mead, qui a comparé la période de l'adolescence aux États-Unis et aux îles Samoa,
pour conclure au caractère variable de cette catégorie selon la société considérée4, à l'encontre des
conceptions alors en vogue aux États-Unis d'une adolescence comme période de crise universelle dans
le parcours de vie humaine. Ces travaux, bien que célèbres, ont toutefois eu une postérité limitée à une
anthropologie psychologique très peu présente sur le continent africain au cours du XXe siècle.
C'est surtout au sein de l'anthropologie sociale britannique que la place des jeunes dans les
sociétés africaines a été étudiée. Ils n'étaient cependant pas au centre des préoccupations de cette école
qui s'attelait surtout à décrire l'organisation sociale des différentes sociétés africaines et leurs
mécanismes de reproduction. Dans cette optique, les tenants de l’anthropologie sociale ont décrit les
systèmes de classes d'âges de diverses sociétés africaines, et ont documenté les rites de passages entre
ces différentes classes. L'un des pères de cette école, E. E. Evans-Pritchard, a notamment décrit ce
système chez les Nuer (Sud-Soudan) et les rites d'initiation permettant aux jeunes hommes de passer
d'un âge à l'autre5. Cette approche a inspiré plusieurs travaux aujourd’hui classiques sur les sociétés
africaines et le passage des générations6.
Ces travaux ont permis de mettre de l'avant la prédominance des aînés dans la plupart des
sociétés africaines, qualifiées parfois de « gérontocraties ». Ils ont également démontré le caractère
3 Catherine Coquery-Vidrovitch, « Des jeunes dans le passé et dans le futur du Sahel », dans Hélène D’Almeida-Topor et
al., dirs., Les jeunes en Afrique. Évolution et rôle, tome 1, Paris, L'Harmattan, 1992, p. 36. 4 Margaret Mead, Coming of age in Samoa: A psychological study of primitive youth for western civilization, New York,
William Morrow and Co., 1928. 5 Edward Evan Evans-Pritchard, The Nuer, Oxford, Oxford University Press, 1940. 6 Voir notamment Meyer Fortes, The Dynamics of Clanship among the Tallensi, London, Oxford University Press, 1945;
Victor Turner, The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Rituals, New York, Ithaca, 1967; P. T. W. Baxter et U. Almagor, dirs., Age, Generation and Time: Some Features of East African Age Organisations, New York, St. Martins Press, 1978.
socialement construit des catégories d'âges, très différentes d'une société à l'autre et souvent structurées
autour de marqueurs ayant peu de choses à voir avec l'âge biologique. Cependant, ces études donnaient
l'image d'une reproduction mécanique d'une structure sociale identique. Les travaux de l'anthropologie
marxiste à partir des années 1960 ont peu fait pour contrer cette vision. Un chercheur comme Claude
Meillassoux a insisté, à la différence de l'approche plutôt fonctionnaliste de l'anthropologie sociale
britannique, sur la question du pouvoir et de l'inégalité dans les relations de générations, où les aînés
ont accès aux ressources productives et aux femmes, plaçant les « cadets » dans une position
subalterne7. Malgré les différences majeures entre les deux approches, elles se rejoignent en ce qu'elles
insistent sur la continuité au sein d'un système social qui se reproduit sans réelle possibilité de
changements. Cette immobilité se reflète dans l'utilisation que le politologue Jean-François Bayart fait
des catégories d'aîné et de cadet. Il distingue un certain nombre d'initiatives politiques qu'il associe à
des tentatives de renversement de l'ordre social par les cadets (mouvements politiques talakawa au
Nord-Nigeria, révolution sankariste au Burkina Faso), pour ensuite minimiser les possibilités de
changements et les capacités d'adaptation des aînés aux bouleversements8.
De façon générale donc, les études sur les jeunes avant 1990 décrivaient une catégorie sociale
dominée, marginale, au sein de systèmes sociaux pratiquement immuables. Ces jeunes étaient à peu
près absents en tant qu'acteurs sociaux, mais au contraire complètement déterminés par leur société.
Les études africaines étaient donc peu outillées pour faire face aux bouleversements démographiques,
économiques, sociaux et politiques qui ont propulsé les jeunes à l'avant-scène de l'intérêt public en
Afrique à partir des années 1990.
La réémergence des jeunes comme problème
7 Claude Meillassoux, Femmes, greniers et capitaux, Paris, Maspero, 1975. 8 Jean-François Bayart, L'État en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, 1989.
À l'indépendance des pays africains, autour de 1960, de nombreux jeunes adultes ont connu une
ascension sociale rapide due aux places laissées vacantes par le départ des administrateurs coloniaux.
La fonction publique constituait un débouché stable pour la minorité de scolarisés urbains, alors que
dans les campagnes, la transition à l'âge adulte demeurait en théorie réglée par les mécanismes
traditionnels de gestion des générations, dans un contexte de croissance économique générée par le
développement des cultures d'exportation9. Progressivement toutefois, les bases de la stabilité
intergénérationnelle se sont effritées. Les pays africains ont connu une hausse démographique
spectaculaire au cours des années 1960 et 1970, particulièrement dans les villes10. Tout en contribuant à
la paix sociale, l'accès à l'argent via des emplois salariés et les cash crops, tendance entamée à l'époque
coloniale, a permis une certaine autonomisation des jeunes par rapport aux aînés, affaiblissant le
contrôle de ces derniers sur la transition des jeunes à l'âge adulte11.
L'effondrement du cours des matières premières à la fin des années 1970 a accéléré les
bouleversements sociaux en paupérisant les campagnes, favorisant un exode vers les villes et privant
les États de revenus. Incapables de continuer à entretenir une fonction publique nombreuse, ces
derniers ont dû adopter des politiques d'austérité très sévères au cours des années 1980, notamment
sous la pression du Fonds Monétaire International qui a favorisé la mise en place de Plans d'Ajustement
Structurel impliquant des privatisations et des licenciements massifs dans la fonction publique12. Ces
difficultés survenaient au moment où la génération des jeunes nés après 1960 arrivait sur le marché du
travail, qui se trouvait ainsi sursaturé de main-d'œuvre pour des emplois de plus en plus rares.
9 Alain Dubresson et Jean-Pierre Raison, L’Afrique subsaharienne : une géographie du changement, Paris, Armand
Colin, 2003, p. 12-17. 10 Andreas Eckert, « Urbanization in Colonial and Post-Colonial West Africa », dans Emmanuel Kwaku Akyempong, dir.,
Themes in West Africa's History, Oxford, Accra et Athens, James Currey, Woeli Publishing Services et Ohio University Press, p. 208-210.
11 Voir notamment Benedict Carton, Blood From your Children: The Colonial Origins of Generational Conflict in South Africa, Charlottesville, University Press of Virginia, 2000.
12 Dubresson et Raison, L’Afrique subsaharienne…, p. 17-30.
C'est ainsi qu'à partir de la fin des années 1980, sont apparus en très grand nombre des jeunes
urbains sans emplois, voir vivant dans la rue, et sans espoir d'une amélioration de leurs conditions. Ces
jeunes sont devenus une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics, d'autant plus qu'ils ont pris
part activement aux manifestations souvent violentes pour des réformes démocratiques à la fin des
années 1980 et au début des années 199013. Ce sentiment de menace s'est accentué à mesure que des
jeunes étaient impliqués dans divers mouvements armés qui ont secoué divers pays africains tout au
long des années 1990.
Les sciences humaines africanistes ont été prises de court par ces changements, elles qui
n'avaient accordé aux jeunes qu'une attention marginale jusque là14. Les connaissances sur les systèmes
complexes de classes d'âges et d'initiations à l'âge adulte semblaient de peu d'utilité devant cette masse
de jeunes en apparence détachés de tout ancrage dans la société et sur le point de sombrer dans la
criminalité et la violence. L'anthropologie psychologique, héritière des travaux de Margaret Mead, s'est
quant à elle intéressée aux transformations qui touchaient les jeunes en Afrique comme ailleurs à la fin
du XXe siècle à travers de nombreux projets de recherches sur l'adolescence partout dans le monde
lancés au cours des années 1990. Ces initiatives ont contribué à renforcer l'image d'une jeunesse
écrasée par les problèmes, en partie à cause des postulats de départ de cette école qui faisaient de
l'adolescence une catégorie biologique universelle caractérisée par une instabilité hormonale et une
acquisition incomplète des caractéristiques de l'âge adulte15. Selon ce présupposé, la disparition des
formes traditionnelles d'encadrement de cette période cruciale de la vie sont un gage de troubles
13 Michael Bratton, « Deciphering Africa's Divergent Transitions », Political Science Quarterly, 112, 1 (1997), p. 69-72. 14 Odile Goerg, Hélène D’Almeida-Topor et Catherine Coquery-Vidrovitch, « Avant-propos », dans Hélène D’Almeida-
Topor et al., dirs., Les jeunes en Afrique. Évolution et rôle, tome 1, Paris, L'Harmattan, 1992, p. 6. 15 Voir notamment A. Schlegel et H. Barry, Adolescence: An Anthropological Inquiry, New York, Free, 1991. Pour une
revue critique de cette approche, voir Mary Bucholtz, « Youth and Cultural Practice », Annual Review of Anthropology, 31 (2002), p. 528-529; Lesley Sharp, The Sacrified Generation: Youth, History and the Colonized Mind in Madagascar, Berkeley, University of California Press, 2002, p. 13-15.
sociaux importants16.
Ces inquiétudes ont été renforcées par des travaux plus récents en démographie sur les
transitions à l'âge adulte. En scrutant les marqueurs sociaux conventionnellement considérés comme
signes de l'entrée dans l'âge adulte (mariage, départ du foyer familial, emploi, etc.), les chercheurs ont
constaté que ces derniers surviennent en général plus tard, créant une nouvelle période floue et
généralement précaire entre l'adolescence et l'âge adulte, visible en Afrique comme ailleurs dans le
monde17. Ces transformations, documentées récemment mais perceptibles auparavant, ont donné lieu à
un discours alarmiste chez les autorités et certains chercheurs à propos d'une « génération perdue »18,
laissant présager le pire pour l'avenir du continent. Très influente au sein des organisations non-
gouvernementales, la vision d'une jeunesse comme population à risque nécessitant un encadrement a
mené à une pléthore de politiques d'intervention spécifiquement destinées à ce groupe19.
La vision pessimiste des jeunes, basée sur des marqueurs objectifs de transition à l'âge adulte,
sur une analyse macro-économique et politique de la marginalisation des jeunes et sur une conception
biomédicale de l'adolescence, peut être schématiquement catégorisée comme une analyse moderniste
de la situation de la jeunesse africaine. Afin d'échapper à cette vision pessimiste d'une jeunesse
africaine à la dérive ne pouvant être sauvée que par une tutelle soit socio-sanitaire ou policière, une
approche alternative des jeunes s'est popularisée au cours des années 1990. Il s'agissait de mettre
l'accent sur l'agencéité des jeunes, c'est-à-dire de présenter les jeunes comme capables d'agir
indépendamment sur leur vie et de s'auto-représenter dans la société, malgré les conditions matérielles
16 Bucholtz, « Youth and Cultural Practice »…, p. 529-532. 17 Voir notamment Anne E. Calvès et al., « Le passage à l'âge adulte : repenser la définition et l'analyse des “premières
fois” », États flous et trajectoires complexes : observation, modélisation, interprétation, GRAB (Groupe de réflexion sur l’approche biographique), Paris, INED/PUF, 2007, p. 137-156 ; Cynthia Lloyd, dir., Growing Up Global: The Changing Transitions to Adulthood in Developing Countries, Washington, The National Academies Press, 2005.
18 Donal Cruise O’Brien, « A lost generation? Youth identity and state decay in West Africa », dans Richard Werbner, dir., Postcolonial identities in Africa, London, Zed Books, 1996.
19 Jon Abbink, « Being young in Africa: the politics of despair and renewal », dans Jon Abbink et Ineke van Kassel, dirs.,
Vanguards or Vandals? Youth, politics and conflict in Africa, Leiden, Brill, 2005, p. 9-10.
difficiles. Cette approche s'est principalement déployée dans deux champs de recherches: la culture
populaire ainsi que le rapport entre jeunes et violence.
L’agencéité des jeunes
Afin de présenter un portrait moins sombre de la jeunesse africaine, de nombreux chercheurs ont puisé
dans la tradition des cultural studies britanniques et ont centré leur analyse sur les pratiques de culture
populaire propres aux jeunes, où l'agencéité était mise de l'avant. Par ailleurs, l'agencéité a également
servi de point de départ au renouveau des études sur la violence des jeunes en Afrique au début des
années 2000, qui tentaient de contrer la vision pessimiste d'une génération-victime en insistant sur les
capacités d'action des jeunes à travers la violence. Cette perspective de l'agencéité a certes permis de
contourner des insuffisances des études pessimistes, mais elle a à son tour soulevé de nouveaux
problèmes.
Autour de la culture des jeunes : une célébration de la marginalité
Au cours des années 1970, les chercheurs associés au Center for Contemporary Cultural Studies
(CCCS) à l'Université de Birmingham ont tourné leur attention vers ce qu'ils ont nommé youth culture
ou subculture20. Dans un premier temps, cette approche a été essentiellement appliquée aux pratiques
culturelles des jeunes Occidentaux, et à la façon dont ils détournaient de façon créative les éléments de
la culture dominante. Cependant, au cours des années 1990, des chercheurs ont commencé à transposer
les concepts des cultural studies aux pays du Sud. L'un des principaux ouvrages qui ont contribué à
populariser l'étude de la culture des jeunes en Afrique et ailleurs dans les pays du Sud est Youth
20 Voir notamment Dick Hebdidge, Subculture. The Meaning of Style, London, Routeledge, 1979.; Stuart Hall et Tony
Jefferson, dirs., Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain, London, Hutchinson and Co., 1976.
Cultures: A Cross-cultural Perspective, paru en 199521.
Cet intérêt nouveau était fortement associé au phénomène de la globalisation, thème
omniprésent dans les publications de l'époque. Via la globalisation, les jeunes Africains ont un accès
privilégié à de nouveaux produits culturels et peuvent se les approprier de façon créative pour
construire une identité générationnelle différenciée. Un grand nombre d'études, notamment sur la
musique populaire, sont apparues pour documenter comment des jeunes en apparence marginalisés
faisaient preuve d'initiative pour créer des pratiques culturelles adaptées à leur réalité en dépit des
contraintes22. Face à des cultures officielles sclérosées associées à des régimes discrédités, se
développait ainsi une culture des jeunes rompant totalement avec celle des aînés23 ou récupérant
certaines pratiques et valeurs traditionnelles pour les incorporer dans des formes culturelles
importées24. Les études sur la culture des jeunes ont mené à la vision d'une « culture globale de la
jeunesse »25. Sunaina Maira et Elisabeth Soep ont inventé le concept de youthscapes pour parler de
cette inscription des jeunes dans des perspectives géographiques et imaginaires nouvelles, plus globales
qu'auparavant26.
L'agencéité des jeunes est également au centre des études sur la « débrouille », qui peuvent être
21 Vered Amit-Talai et Helena Wulff, dirs., Youth Cultures: A Cross-cultural Perspective, London, Routeledge, 1995. 22 Voir notamment parmi de nombreux écrits: José Arturo Saaverda Casco, « The language of the young people: Rap,
urban culture and protest in Tanzania », Journal of Asian and African Studies, 41 (2006), p. 229-248; John Collins, « The generational factor in Ghanaian music: concert parties, highlife, simpa, kpanlogo, gospel and local techno-pop », Mai Palmberg et Annemette Kirkegaard, dirs., Playing with identities in contemporary music in Africa, Uppsala, Nordiska Afrikainstitutet, 2002, p. 60-74; Yacouba Konate, « Génération zouglou », Cahiers d’études africaines, 168 (2002), « Musiques du monde », p. 777-796; Richard Ssewakiryanga, « Imaginer le monde chez soi. Les jeunes et la musique internationale en Ouganda », Politique Africaine, 75 (1999), p. 91-106.
23 Eileen Moyer, « Street-Corner Justice in the Name of Jah: Imperatives for Peace among Dar es Salaam Street Youth », Africa Today, 51, 3 (2005), p. 31-58.
24 David A. Samper, « “Africa Is Still Our Mama”: Kenyan Rappers, Youth Identity and the Revitalization of Traditional Values », African Identities, 2, 1 (2004), p. 37-51.
25 Jean Comaroff et John Comaroff, « Réflexions sur la jeunesse : Du passé à la postcolonie », Politique africaine, 80 (2000), « Enfants jeunes et politique », p. 101-103.
26 Sunaina Maira et Elisabeth Soep, Youthscapes: The Popular, the National, the Global, Philadelphie, Philadelphia University Press, 2005.
liées à celles sur la culture populaire en ce sens qu'elles ouvrent sur les mêmes capacités des jeunes à
saisir les moyens limités dont ils disposent pour améliorer leurs conditions. Plusieurs études ont ainsi
souligné comment les jeunes, marginalisés dans l'économie, développaient des solutions créatives pour
subvenir à leurs besoins. Par exemple, Piet Konings a étudié comment les jeunes conducteurs de moto-
taxis à Douala, bien qu'à la marge de l'activité économique, ont utilisé leur métier pour s'imposer face
aux autres utilisateurs de la route et obtenir un statut respecté à l'échelle du quartier et de la ville. Ce
déploiement d'agencéité s'accompagne de la constitution d'une identité de groupe très forte27.
L'identité des jeunes s'est aussi manifestée par la construction d'une conscience politique et
historique particulière chez les jeunes de la postcolonie. L'un des ouvrages emblématiques de ce champ
d'études est celui de Lesley Sharp : The Sacrified Generation: Youth, History and the Colonized Mind
in Madagascar28. L'auteur va à l'encontre du discours public qui présente les jeunes nés et scolarisés
depuis l'indépendance comme une « génération sacrifiée ». Elle affirme au contraire, en se penchant sur
des jeunes d'une région très défavorisée, que ces derniers ont réussi à développer une conscience
politique et historique aiguë et très différente des étiquettes dépréciatives et misérabilistes accolées aux
jeunes par les autorités.
L'angle de l'agencéité a considérablement rafraichi l'étude des jeunes en Afrique par rapport aux
approches précédentes qui voyaient les jeunes comme des produits d'une situation sociale, passifs et
dominés. L'agencéité, liée en particulier à la culture populaire globalisée, a permis de montrer que les
jeunes pouvaient utiliser les maigres ressources matérielles et culturelles à leur disposition pour créer
un espace de liberté et définir une identité propre. Cependant, le danger est grand, et beaucoup de
chercheurs n'ont pu l'éviter, de construire le portrait d'une jeunesse complètement isolée du reste de la
27 Piet Konings, « “Bendskin” Drivers in Douala's New Bell Neighbourhood: Masters of the Road and the City », dans Piet
Konings et Dick Foeken, dirs., Crisis and Creativity: Exploring the Wealth of the African Neighborhood, Leiden, Brill, 2006, p. 46-65.
28 Sharp, The Sacrificed Generation…
société et repliée sur une identité de groupe fermée. De plus, l'enthousiasme de plusieurs chercheurs
pour cette créativité à la marge peut faire oublier l'ampleur des difficultés vécues par les jeunes.
Jennifer Cole, dans son étude sur les pratiques de sexe transactionnel à Tamatave, souligne la
débrouillardise des jeunes filles qui s'y adonnent, mais mentionne également que toutes les
informatrices affirment faire ce travail par nécessité et non par choix29. Trop de chercheurs concernés
par la culture des jeunes ont tendance à oublier de faire cette précision.
D'abord centrée sur la culture populaire, l'approche de l'agencéité s'est par la suite tournée vers
une facette plus inquiétante de la réalité des jeunes Africains et qui alimentait beaucoup de discours
alarmistes sur la jeunesse africaine, à savoir le lien en apparence très fort entre les jeunes et la violence.
Jeunes et violence: un intérêt démesuré ?
À première vue, la violence des jeunes en Afrique semble confirmer l'interprétation pessimiste d'une
« génération perdue » laissée à ses pulsions violentes par la déstructuration de la société. C'est
l'interprétation que fait le journaliste Robert Kaplan, qui considère la violence des jeunes dans les pays
du Sud comme naturelle dans les conditions de dégradation de l'autorité étatique30. Une telle
explication, souvent implicite dans le discours des autorités politiques, relève de préjugés que différents
chercheurs ont tenté de nuancer en s'attardant au lien entre jeunes et violence du point de vue des
acteurs.
L'un des sites privilégiés de discussion de l’agencéité des jeunes à travers la violence est le cas
des enfants-soldats, qui ont fortement marqué l'opinion internationale au cours des guerres civiles
africaines des années 1990-2000. La figure de l'enfant-soldat renferme en effet à la fois l'image de la
29 Jennifer Cole, « Fresh Contact In Tamatave, Madagascar: Sex, Money and Intergenerational Transformation »,
American Ethnologist, 31, 4 (2004), p. 575. 30 Robert Kaplan, The coming anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War, New York, Random House, 2000.
jeunesse victime d'une époque troublée ainsi que celle de la cruauté des jeunes lorsqu'ils ne sont pas
encadrés. Ce phénomène a donné lieu à un nombre impressionnant d'écrits débattant de la marche à
suivre pour intervenir et enrayer l'embrigadement des jeunes ou encore pour réinsérer les jeunes
combattants après la guerre31. Cependant, le champ d'études des enfants-soldats a été investi,
principalement depuis 2000, par des chercheurs ayant pour objectif de démontrer comment des
situations aussi extrêmes pouvaient être l'occasion pour les jeunes d'agir de façon indépendante.
C'est le cas notamment des travaux d’Alcinda Honwana, qui prennent en partie le contrepied
des politiques d'intervention qui considèrent les enfants-soldats essentiellement comme victimes des
conflits. Honwana tente plutôt de faire la part entre la contrainte et l'action autonome des enfants-
soldats32. C'est également le cas du livre de Rachel Brett et Irma Specht, Young Soldiers: Why they
Choose to Fight, où les auteurs nuancent la vision dominante voulant que les enfant-soldats soient
contraints à s'engager en soulignant que beaucoup sont des adolescents conscients de ce qu'ils font,
combattant pour des raisons diversifiées33. Mats Utas, pour sa part, s'emploie à montrer comment les
filles-soldats du Liberia ont pu profiter de la guerre pour déployer certaines stratégies de façon à
contourner leur marginalisation34. Enfin, Henrik Vigh souligne comment la guerre civile bissau-
guinéenne a constitué un cadre au sein duquel les jeunes pouvaient « naviguer » afin d'améliorer, de
façon très risquée, leurs perspectives de vie35.
Les groupes de jeunes urbains ont fourni un autre lieu d'exploration de l’agencéité des jeunes
par la violence. Le recours à la violence par les groupes de jeunes urbains, notamment lors de
31 Voir, parmi de très nombreux exemples, Laura, Stovel, « “There’s no bad bush to throw away a bad child”: “tradition”-
inspired reintegration in postwar Sierra Leone », Journal of Modern African Studies, 46, 2 (2008), p. 305-324. 32 Alcinda Honwana, « Innocents et coupables : Les enfants-soldats comme acteurs tactiques », Politique africaine, 80
(2000), p. 58-78. 33 Rachel Brett et Irma Specht, Young Soldiers: Why they Choose to Fight, Boulder, Lynne Rienner, 2004. 34 Mats Utas, « Victimcy, girlfriending, soldiering: tactic agency in a young woman’s social navigation of the Liberian war
zone », Anthropological Quarterly, 78, 2 (2005), p. 403-430. 35 Henrik Vigh, Navigating Terrains of War: Youth and soldiering in Guinea-Bissau, New York, Berghahn Books, 2006.
manifestations destructives, mais aussi dans les rapports quotidiens, est expliqué sous divers angles.
Souvent, il est vu comme la résultante du blocage des perspectives pour ces jeunes urbains et d'un rejet
des symboles associés au pouvoir36. Dans cette perspective, l'étude de la violence des jeunes rejoint
celle de la culture populaire des jeunes, notamment chez Tshikala Biaya pour qui la culture populaire
de jeunes urbains comporte toujours un aspect violent. L'apparent nihilisme de la violence des jeunes
Africains prend donc un sens lorsque compris du point de vue des acteurs. L'intérêt pour la violence
des jeunes s'est également manifesté par une étude des groupes de « vigilantes » de certains pays
(essentiellement Nigeria, Kenya et Afrique du Sud), composés de jeunes hommes se donnant pour
mission de faire régner l'ordre dans les villes à la place de la police37.
Contribuant à contrer l'image d'une jeunesse victime passive de la violence ou encore groupe
dangereux naturellement porté à la violence, l'analyse de la violence des jeunes sous l'angle de
l’agencéité comporte toutefois des limites. La principale est que, bien que la plupart des auteurs tentent
de donner une explication contextuelle à la violence, l'intérêt massif pour celle-ci contribue malgré tout
à perpétuer l'image d'un continent et d'une génération violents. Une illustration de cette contradiction
est le livre States of Violence. Politics, Youth and Memory in Contemporary Africa38. Issu d'un
colloque tenu en 2003 ayant pour thème la violence en Afrique, cet ouvrage propose une approche
contextuelle de la violence, seule à même d'éviter d'en faire un trait culturel propre aux Africains39.
Cependant, le résultat est ambigu, en grande partie à cause du titre du livre qui, contrairement aux
36 Voir notamment Mamadou Diouf, « Engaging Postcolonial Cultures: African Youth and Public Space », African
Studies Review, 46, 2 (2003), p. 7-10; Tshikala Kayembe Biaya, « Jeunes et culture de la rue en Afrique urbaine (Addis-Abeba, Dakar et Kinshasa) », Politique africaine, 80 (2000), p. 12-31; Ali El-Kenz, « Les jeunes et la violence », dans Stephen Ellis, dir., L’Afrique maintenant, Paris, Karthala, 1995, p. 88-109.
37 Voir notamment le numéro spécial « Perspectives on Vigilantism in Nigeria », Africa, 78, 1 (2008). 38 Edna G. Bay et Donald L. Donham, dirs., States of Violence. Politics, Youth and Memory in Contemporary Africa,
Charlottesville et Londres, University of Virginia Press, 2006. 39 Donald L. Donham, « Starting at Suffering. Violence as a Subject », dans Edna G. Bay et Donald L. Donham, dirs.,
States of Violence. Politics, Youth and Memory in Contemporary Africa, Charlottesville et Londres, University of Virginia Press, 2006, p. 18-19.
intentions annoncées par Donald Donham, projette plutôt l'image d'un continent africain caractérisé
essentiellement par la violence. De plus, le livre comporte une section sur la jeunesse, dont le lien avec
le thème général de la violence n'est pas problématisé mais plutôt pris pour acquis. Les travaux sur les
jeunes et la violence comportent aussi le défaut d'éclairer presque exclusivement la réalité des jeunes
hommes, ou plutôt de la minorité d'entre eux impliquée dans des actions violentes, et laisse dans
l'ombre, outre quelques travaux sur les filles-soldats, celle des jeunes filles.
De façon générale, on sent dans les études sur les jeunes et la violence une fascination pour les
phénomènes urbains et militaires spectaculaires mettant en scène des jeunes hommes. Cependant, ces
études occultent la réalité de la majorité des jeunes Africains pour qui la violence est rare. De la même
façon, les études sur la culture populaire trahissent un enthousiasme pour des pratiques à la marge d'une
norme contraignante et renferment une célébration de la marginalité, une attention démesurée pour des
phénomènes minoritaires et une sorte de négation des problèmes par une mise de l'avant de l’agencéité
des jeunes. Prenant conscience de ces limites, plusieurs chercheurs ont tenté de rattacher les jeunes au
reste de la société pour éviter une réification d'une jeunesse possédant son identité et ses moyens
d'action propres et sans ancrage dans leur environnement.
16
Vers une conception relationnelle des jeunes
Depuis 2000, beaucoup d'écrits sur les jeunes en Afrique s'affairent à tempérer l'enthousiasme pour
l’agencéité des jeunes sans nécessairement revenir à la vision d’une jeunesse complètement déterminée
par la société. C’est notamment perceptible dans l'irruption de l'étude des générations et en particulier
des jeunes au sein de la discipline historique, où les méthodes de recherche ont permis d'enrichir la
perspective de l’agencéité et de surmonter certaines de ses impasses. Émerge également une
anthropologie des jeunes qui tente de replacer ces derniers au sein de rapports sociaux plus larges.
Histoire : un intérêt obligé pour les générations et l'État
Si les historiens de l’Europe ont depuis longtemps porté leur attention sur les jeunes40, les historiens
africanistes s’y sont intéressés plus tardivement, soit au cours des années 1990, avec notamment la
parution en 1992 d'un ouvrage collectif fort volumineux dirigé par des historiennes de l'Université de
Paris VII41. Cependant, la plupart des contributions traitaient surtout des institutions associées aux
jeunes, des politiques en matière d'éducation ou d'encadrement, et donnaient peu de place à l'action des
jeunes comme telle. Ce n'est que plus récemment que les historiens ont tenté de retracer l'expérience
vécue et les initiatives des jeunes des époques passées.
Des travaux ont ainsi revisité le passé récent (XIXe et XXe siècles pour l'essentiel) afin de
réinterpréter différents événements selon la perspective des jeunes, relativisant la nouveauté de
phénomènes comme la culture populaire des jeunes, leur autonomisation, ou encore le problème de la
violence des jeunes. En particulier, les historiens ont souligné comment la colonisation, malgré sa
violence et le penchant des autorités coloniales pour l'ordre social assuré par le respect de la
gérontocratie, a fourni des opportunités pour les jeunes de court-circuiter les structures sociales
40 Voir notamment Philippe Ariès, L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris, Plon, 1960. 41 Hélène D’Almeida-Topor et al., dirs, Les jeunes en Afrique. Évolution et rôle, 2 tomes, Paris, L'Harmattan, 1992.
17
dominées par les aînés et d'obtenir une plus grande autonomie. En particulier, la mise en place du
travail salarié a permis à certains jeunes de gagner une certaine autonomie par rapport à une économie
villageoise où les aînés monopolisaient les dividendes. Entre autres, Benedict Carton a montré
l'émergence de conflits générationnels autour de ces questions vers 1900 en pays zulu42.
La christianisation a également fait l'objet d'une analyse centrée sur les jeunes. Meredith
McKittrick, en particulier, a interprété les conversions massives au christianisme, fin XIXe-début XXe
siècles, des jeunes du nord de la Namibie actuelle comme une recherche d'une nouvelle forme
d'encadrement répondant mieux aux défis de l'époque que les croyances traditionnelles qui mettaient
les aînés au centre de l'équilibre social43. Par ailleurs, les historiens ont également démontré de l'intérêt
pour la culture populaire des jeunes. Ils ont souligné les appropriations par les jeunes urbains, à partir
de l'entre-deux-guerres surtout, de genres culturels internationaux44. Enfin, des recherches se sont
penchées sur la criminalité urbaine et la violence des gangs tout au long du XXe siècle45.
À première vue, il s'agit essentiellement d'un prolongement de l'approche de l’agencéité
appliquée à des époques passées. Cette entreprise permet de relativiser la nouveauté de cette agencéité
et des phénomènes « découverts » par les chercheurs des années 1990 qui y sont associés, comme la
culture populaire des jeunes, la violence des groupes de jeunes ou la globalisation, qui étaient
perceptibles au moins à l'époque coloniale mais que les anthropologues de l'époque avaient omis
d'interroger. Cependant, les études historiques récentes sur les jeunes en Afrique apportent plus qu'une
42 Carton, Blood from your Children… 43 Meredith McKittrick, To Dwell Secure: Generation, Christianity and Colonialism in Ovamboland, Portsmouth, Oxford
et Cape Town, Heinemann, James Currey et David Philip, 2002. 44 Voir notamment Peter Alegi, « Leisure and youth culture in South Africa: football clubs in early Soweto, 1930s-
1950s », dans Barbara Trudell et al., dirs., Africa's Young Majority, Édimbourg, Center for African Studies, 2002; Andrew Ivaska, « “Anti-mini militants meet modern misses’’: urban style, gender, and the politics of ‘‘national culture’’ in 1960s Dar es Salaam, Tanzania », Gender and History, 14, 3 (2002), p.584–607; Maria Suriano, « Clothing and the changing identities of Tanganyikan urban youths, 1920s-1950s », Journal of African Cultural Studies, 20, 1 (2008), p. 95-115.
45 Voir notamment Murray Last, « The Search for Security in Muslim Northern Nigeria », Africa, 78, 1 (2008), p. 41-63; Clive Glaser, Bo-Tsotsi. The Youth Gangs of Soweto, Cape Town, David Philip, 2000.
18
simple démonstration supplémentaire de l’agencéité des jeunes considérée comme une faculté
universelle.
En effet, les contraintes et les méthodes propres à la discipline ont permis de contourner
certaines des limites rencontrées par des études culturelles trop enthousiasmées par des tendances
éphémères et des identités groupusculaires. La périodisation relativement longue et la recherche
d'évolution dans les tendances oblige les historiens des jeunes à prendre en compte plusieurs
générations au sein de leur analyse. Le danger de réifier une jeunesse coupée du reste de la société est
donc moins présent que dans une enquête ethnographique auprès d'un groupe ponctuel. Au contraire, la
question du rapport entre les générations est centrale dans plusieurs études, et notamment chez
McKittrick et chez Carton.
Cette prise en compte des rapports entre générations est également rendue nécessaire de par les
sources disponibles. Par exemple, pour retracer le parcours des jeunes Ovambo du début du XXe siècle,
McKittrick a procédé à des entretiens avec des aînés qui étaient jeunes à l'époque. Ainsi, elle avait
accès aux réflexions de personnes âgées sur leur jeunesse, qui avaient vécu de nombreuses années et
occupé plusieurs rôles générationnels, amenant ainsi une perspective moins immédiate. En ce qui
concerne les sources écrites, elles sont, comme le remarque Richard Waller, généralement l'œuvre des
adultes en position dominante46. L'expérience des jeunes doit donc être extraite de la vision des aînés,
obligeant les historiens à prendre en compte les relations entre les générations. Cette contrainte force
également les historiens à faire preuve de créativité pour trouver de nouveaux lieux pour observer les
jeunes : loisirs, relecture des mouvements nationalistes, mais aussi espaces communs aux différentes
générations47.
Les sources disponibles mais aussi les préoccupations des historiens ont également conduit à
46 Richard Waller, « Rebellious youth in colonial Africa », Journal of African History, 47 (2006), p. 87. 47 Ibid., p. 88-89.
19
une prise en compte du rôle de l'État dans la définition et les rôles attribués aux jeunes. Par exemple,
Laurent Fourchard a souligné comment l'État avait forgé la notion de délinquance juvénile telle que
comprise aujourd'hui au Nigeria au cours des années 1940 lorsqu'il s'est intéressé à la présence de
jeunes dans les rues des villes à partir de ce moment, bien que le phénomène existait auparavant48.
Burgess, quant à lui, fixe comme objectif aux historiens des jeunes en Afrique d'historiciser l'idée de
jeunesse en Afrique afin de lier l’agencéité au contexte social49. Cette démarche permet de rendre
compte de l'évolution de l'instrumentalisation, de la marginalisation ainsi que des stratégies d'action des
jeunes.
L'étude historique des jeunes en Afrique témoigne donc d'un souci, en partie dicté par les
sources et méthodes propres à la discipline, de concevoir cette génération comme étant en relation avec
le reste de la société tout en étant dotée d'une capacité d'action autonome. Ce souci est partagé par
plusieurs anthropologues, qui ont mené une importante réflexion théorique sur la façon d'aborder la
question et qui bâtissent une nouvelle anthropologie des jeunes puisant à la fois dans l'approche de
l’agencéité et dans les traditions plus anciennes.
Une anthropologie des jeunes
À partir de 2000, certains anthropologues ont émis des réserves par rapport à la perspective de
l’agencéité. Une partie d'entre eux ont senti le besoin de réactiver les approches classiques,
principalement celle de l'anthropologie sociale britannique, concernant les générations, les classes
d'âges et les rites de passage50. Ces travaux ont le mérite de montrer la possibilité d'une continuité des
48 Laurent Fourchard, « Lagos and the invention of juvenile delinquency in Nigeria, 1920–1960 », Journal of African
History, 47, 1 (2006), p. 115–137. 49 Thomas Burgess, « Introduction to youth and citizenship in East Africa », Africa Today, 51, 3 (2005), p. xiii. 50 Voir notamment Mario Aguilar, dir., Rethinking Age in Africa: Colonial, Post-Colonial and Contemporary
Interpretations of Cultural Representations, Trenton et Asmara, Africa World Press, 2007; Africa, 74, 1 (2004), « Grandparents and Grandchildren »; L'Homme, 167-168 (2003) « Passage à l'âge d'homme »; James A. Pritchett, The
20
structures « traditionnelles » de gestion des générations et leur adaptation au monde moderne. Ils
permettent également de mesurer l'ampleur des changements récents au niveau des structures sociales.
Cependant, ces études comportent des limites importantes, dans la mesure où elles semblent ignorer les
travaux récents concernant l’agencéité des jeunes plutôt que d’en fournir une réfutation argumentée.
Plus intéressante parce que critiquant de front la perspective de l’agencéité est l'entreprise de
Jean-Pierre Chauveau qui a souligné que l'intérêt récent pour l’agencéité des jeunes cachait une
fascination des chercheurs pour des phénomènes somme toute marginaux de culture populaire
underground et de sursauts violents de la part de jeunes trop rapidement vus comme autonomisés par
rapport à une famille oppressive. Chauveau propose plutôt de replacer les jeunes au sein de relations
sociales, notamment familiales, au sein desquelles ils évoluent. Pour ce faire, il suggère de remettre
l'accent sur les jeunes en milieu rural, pour éviter de prendre la culture populaire urbaine, les identités
alternatives des groupes de jeunes et la violence criminelle ou politique pour la totalité de l'expérience
des jeunes Africains51. Jay Straker renchérit sur cette critique en lançant l’hypothèse selon laquelle les
chercheurs préoccupés par l’agencéité des jeunes construisent un objet de recherche inquiétant et coupé
de toute attache avec le passé ou le reste de la société pour mieux se poser en interprètes indispensables
de cette nouvelle culture des jeunes violente et totalement inscrite dans la globalisation, et ainsi
renforcer leur position dans la communauté scientifique52.
Ces critiques rejoignent la démarche d'anthropologues principalement américains et
scandinaves qui s'inscrivent dans une nouvelle anthropologie des jeunes. Cette école tente de bâtir à la
fois sur les traditions classiques de l'anthropologie sociale ainsi que sur les développements plus
Lunda-Ndembu: Style, Change and Social Transformation in South Central Africa, Madison, University of Wisconsin Press, 2001; Mario Aguilar, dir., The Politics of Age and Gerontocracy in Africa: Ethnographies of the Past and Memories of the Present, Trenton et Asmara, Africa World Press, 1998.
51 Jean-Pierre Chauveau, « Introduction thématique : Les jeunes ruraux à la croisée des chemins », Afrique contemporaine, 214 (2005), p. 15-35.
52 Jay Straker, « Youth, Globalisation and Millenial Reflection in a Guinean Forest Town », Journal of Modern African Studies, 45, 2 (2007), p. 299-329.
21
récents centrés sur l’agencéité pour construire une conception relationnelle, sociale et dynamique des
jeunes. Cette anthropologie des jeunes est menée entre autres par Deborah Durham, qui propose pour
éviter l'écueil d'une réification d'une culture jeune à la marge d'aborder les jeunes comme des “social
shifters”. Le terme de shifter renvoie en linguistique à des mots dont l'objet de référence ne peut être
connu que dans un contexte précis (ex. : moi, lui, ici, avant, etc.). L'application de ce terme aux jeunes
permet de saisir le caractère mouvant du terme de « jeunes », catégorie avant tout relationnelle dont la
définition change selon le contexte et fait l'objet de luttes dans l'espace public53. Ainsi, les jeunes se
trouvent placés au cœur de la société et des luttes pour les définitions des catégories générationnelles.
Cette approche théorique permet en outre de contourner la question insoluble de la définition objective
de la jeunesse, puisqu'il s'agit d'une catégorie essentiellement définie par l'usage.
Durham ne rejette pas la perspective de l’agencéité, puisqu'elle considère les jeunes eux-mêmes
comme partie prenante du débat sur la définition de la catégorie et sur leur place dans la société.
Cependant, l'auteur exprime un malaise par rapport à ce concept, dont l'application par de nombreux
chercheurs témoigne selon elle d'un romantisme et d'un parti pris pour l'action rebelle des jeunes. De
plus, l’agencéité telle que conçue généralement implique une conception de l'individu comme unité
indépendante, conception essentiellement moderne et occidentale qui, sur le terrain, entre en conflit
avec d'autres conceptions sociales ou collectives54.
Insérée dans la société, la jeunesse est également, pour les tenants de cette nouvelle
anthropologie des jeunes, placée dans une continuité historique. Afin de rendre compte de ce lien avec
53 Deborah Durham, « Disappearing Youth: Youth as a Social Shifter in Botswana », American Ethnologist, 31, 4 (2004),
p. 592-593; Deborah Durham, « Youth and the Social Imagination in Africa: Introduction to Parts 1 and 2 », Anthropological Quarterly, 73, 3 (2000), p. 116-117.
54 Deborah Durham, « Apathy and Agency. The Romance of Agency and Youth in Botswana », dans Jennifer Cole et Deborah Durham, dirs., Figuring the Future. Globalization and the Temporalities of Children and Youth, Santa Fe, School for Advanced Research Press, 2008, p.151-153.
22
l'histoire, Jennifer Cole a proposé de reprendre le concept développé par Mannheim55 de “fresh
contact”, qui renvoie au processus par lequel les jeunes, lors de leur transition vers l'âge adulte,
prennent contact de façon renouvelée avec l'héritage culturel de leur société. La nouvelle génération se
crée donc à travers le nouveau regard qu'elle porte sur cet héritage, regard qui est adapté au contexte
socio-historique particulier dans lequel se produit ce contact, et qui modifie par la suite l’héritage
transmis aux générations suivantes56. La société se « régénère » en se transformant, à mi-chemin entre
la « reproduction sociale » immuable des anthropologies classiques et l’agencéité désincarnée des
chercheurs plus récents57.
Les auteurs s'inscrivant dans cette anthropologie des jeunes ont commencé à repenser le lien
entre les jeunes et leur environnement social, culturel et géographique. Par exemple, Karen Tranberg
Hansen insiste sur la nécessité de penser sérieusement le lien entre les jeunes et la ville. À l'inverse de
Chauveau, elle pose l'urbanité comme l'espace privilégié pour étudier les jeunes, étant donné
l'urbanisation rapide du Sud et la proportion très importante de jeunes citadins. Alors que, selon elle,
beaucoup d'études utilisent la ville comme simple toile de fond, elle propose d'analyser les jeunes
comme insérés au sein d'une géographie sociale particulière. Elle voit donc l'expérience des jeunes
comme façonnée par l'espace urbain mais également génératrice de transformations au niveau du tissu
de la ville58.
L’entreprise de cette anthropologie des jeunes est ardue, étant donnée la propension des
chercheurs à interroger les phénomènes les plus extrêmes dans une perspective de répondre à des
55 Karl Mannheim, « The Problem of Generations », dans Essays on the Sociology of Knowledge, Londres, Routeledge,
1972 [1952], p. 276-320. 56 Cole, « Fresh Contact »... 57 Jennifer Cole, et Deborah Durham, « Introduction: Age, Regeneration, and the Intimate Politics of Globalization », dans
Jennifer Cole et Deborah Durham, dirs., Generations and Globalization: Youth, Age, and Family in the New World Economy, Bloomington, Indiana University Press, 2007, p. 15-17
58 Karen Tranberg Hansen, « Introduction: Youth and the City », dans Karen Tranberg Hansen, dir., Youth and the City in the Global South, Bloomington, Indiana University Press, 2008, p. 3-23.
23
inquiétudes au sein de la société. De plus, plusieurs travaux se réclamant de ce courant ont de la
difficulté à véritablement intégrer les dynamiques socio-historiques au cœur de l'analyse des jeunes et
posent plutôt ces dynamiques comme cadre contextuel fixe posant les contraintes avec lesquelles les
jeunes doivent composer dans leur « navigation » sociale autonome59. Devant ces problèmes,
l'anthropologie des jeunes aurait intérêt à s'associer avec l'histoire émergente des générations, pour qui
la relation des jeunes avec le contexte plus large et le passage des générations est évidente.
Réciproquement, l'étude historique des générations pourrait s'enrichir de la réflexion théorique et
conceptuelle issue de l'anthropologie.
En définitive, on peut séparer l'étude récente des jeunes en Afrique en trois moments. Dans un premier
temps, influencée par des traditions considérant les jeunes soit comme un groupe marginal et déterminé
par une structure sociale contrôlée par les aînés, ou comme une étape de vie universelle caractérisée par
l'instabilité et l'acquisition incomplète des attributs de l'âge adulte, une perspective alarmiste s'est
développée face aux bouleversements majeurs des années 1980-1990 au cours desquelles les jeunes ont
acquis une visibilité inquiétante en Afrique. Cette perspective considérait les jeunes comme un
problème à résoudre, une catégorie vulnérable à protéger ou un danger à contenir. En réaction, des
chercheurs ont utilisé le concept d’agencéité pour aborder les jeunes sous un angle plus positif. Certains
ont cherché dans la culture populaire l'espace d'expression autonome des jeunes et le lieu de
constitution d'une identité distincte. D'autres ont plutôt plongé au cœur des zones de violence où les
jeunes sont au premier plan, pour démontrer que la violence peut être un moyen d'action réfléchi par
lequel les jeunes tentent d'avoir une prise sur leur destin. Réagissant au danger inhérent à la perspective
de l’agencéité de détacher les jeunes de la société dans laquelle ils sont insérés et de célébrer des petites
59 Voir notamment les contribution de Catrine Christiansen, Mats Utas et Henrik E. Vigh, « Introduction », dans Caterine
Christiansen, Mats Utas et Henrik E. Vigh, dirs., Navigating Youth, Generating Adulthood: Social becoming in an
African context, Uppsala, Nordiska Afrikainstitutet, 2006.
24
victoires remportées par les jeunes à la marge, des travaux récents, principalement en histoire et en
anthropologie, ont mis de l'avant une conception relationnelle des jeunes et insisté en particulier sur les
rapports entre les générations.
Bien entendu, les trois moments ne sont pas hermétiquement cloisonnés, et constituent plutôt
des pôles d'interprétation présents à divers degrés dans les différentes analyses. De plus, les tenants de
la « troisième voie » présentée ici, en nombre grandissant mais tout de même restreint, naviguent une
ligne très étroite entre la fascination sans cesse renouvelée pour les initiatives hors-normes des jeunes
et un discours objectiviste et paternaliste toujours très présent au sein des autorités politiques, des
institutions internationales, des ONG et de l'abondante littérature scientifique orientée vers
l'intervention. En particulier, l'appel à détacher la recherche des phénomènes les plus spectaculaires ou
alarmants risque de se limiter à une minorité de chercheurs, étant données les inquiétudes bien réelles
des citoyens comme des scientifiques, sans parler des institutions subventionnaires. Les jeunes
mendiants présentés en introduction appellent une réaction, et les chercheurs ne peuvent abandonner le
champ à des États aux réflexes sécuritaires aiguisés.
25
Bibliographie
Africa, 74, 1 (2004), “Grandparents and Grandchildren”.
Africa, 78, 1 (2008), “Perspectives on Vigilantism in Nigeria”.
L'Homme, 167-168 (2003), « Passage à l'âge d'homme ».
Abbink, Jon, “Being young in Africa: the politics of despair and renewal”, Jon Abbink et Ineke van
Kassel, dirs., Vanguards or Vandals? Youth, politics and conflict in Africa, Leiden, Brill, 2005, p.
1-34.
Aguilar, Mario, dir., Rethinking Age in Africa: Colonial, Post-Colonial and Contemporary
Interpretations of Cultural Representations, Trenton et Asmara, Africa World Press, 2007.
Aguilar, Mario, dir., The Politics of Age and Gerontocracy in Africa: Ethnographies of the Past and
Memories of the Present, Trenton et Asmara, Africa World Press, 1998.
Alegi, Peter, “Leisure and youth culture in South Africa: football clubs in early Soweto, 1930s-1950s”,
Barbara Trudell et al., dirs., Africa's Young Majority, Édimbourg, Center for African Studies,
2002.
Ariès, Philippe, L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris, Plon, 1960.
Baxter, P. T. W. et U. Almagor, dirs., Age, Generation and Time: Some Features of East African Age
Organisations, New York, St. Martins Press, 1978.
Bayart, Jean-François, L'État en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, 1989.
Biaya, Tshikala Kayembe, « Jeunes et culture de la rue en Afrique urbaine (Addis-Abeba, Dakar et
Kinshasa) », Politique africaine, 80 (2000), « Enfants jeunes et politique », p. 12-31.
Bratton, Michael, “Deciphering Africa's Divergent Transitions”, Political Science Quarterly, 112, 1
(1997), p. 67-93.
Brett, Rachel et Irma Specht, Young Soldiers: Why they Choose to Fight, Boulder, Lynne Rienner,
2004.
26
Bucholtz, Mary, “Youth and Cultural Practice”, Annual Review of Anthropology, 31 (2002), p.525-552.
Calvès, Anne E. et al., « Le passage à l'âge adulte: repenser la définition et l'analyse des « premières
fois » », États flous et trajectoires complexes : observation, modélisation, interprétation, GRAB
(Groupe de réflexion sur l’approche biographique), Paris, INED/PUF, 2007, p. 137-156.
Carton, Benedict, Blood From your Children: The Colonial Origins of Generational Conflict in South
Africa, Charlottesville, University Press of Virginia, 2000.
Casco José Arturo Saaverda, “The language of the young people: Rap, urban culture and protest in
Tanzania”, Journal of Asian and African Studies, 41 (2006), p. 229-248.
Chauveau, Jean-Pierre, « Introduction thématique : Les jeunes ruraux à la croisée des chemins »,
Afrique contemporaine, 214 (2005), dossier « Jeunes ruraux », p. 15-35.
Christiansen, Catrine, Mats Utas et Henrik E. Vigh, “Introduction”, Caterine Christiansen, Mats Utas et
Henrik E. Vigh, dirs., Navigating Youth, Generating Adulthood: Social becoming in an African
context, Uppsala, Nordiska Afrikainstitutet, 2006.
Cole, Jennifer, “Fresh Contact in Tamatave, Madagascar: Sex, Money and Intergenerational
Transformation”, American Ethnologist, 31, 4 (2004), p. 573-588.
Cole, Jennifer et Deborah Durham, “Introduction: Age, Regeneration, and the Intimate Politics of
Globalization”, Jennifer Cole et Deborah Durham, dirs., Generations and Globalization: Youth,
Age, and Family in the New World Economy, Bloomington, Indiana University Press, 2007, p. 1-
28.
Collins, John, “The generational factor in Ghanaian music: concert parties, highlife, simpa, kpanlogo,
gospel and local techno-pop”, Mai Palmberg et Annemette Kirkegaard, dirs., Playing with
identities in contemporary music in Africa, Uppsala, Nordiska Afrikainstitutet, 2002, p. 60-74.
Comaroff, Jean et John Comaroff, « Réflexions sur la jeunesse : Du passé à la postcolonie », Politique
africaine, 80 (2000), « Enfants jeunes et politique », p. 90-110.
27
Coquery-Vidrovitch, Catherine, « Des jeunes dans le passé et dans le futur du Sahel », Hélène
D’Almeida-Topor et al., dirs., Les jeunes en Afrique. Évolution et rôle, tome 1, Paris,
L'Harmattan, 1992, p. 35-43.
D’Almeida-Topor, Hélène et al., dirs, Les jeunes en Afrique. Évolution et rôle, 2 tomes, Paris,
L'Harmattan, 1992.
Diouf, Mamadou, “Engaging Postcolonial Cultures: African Youth and Public Space”, African Studies
Review, 46/2 (2003), p. 1-12.
Donham, Donald L., “Starting at Suffering. Violence as a Subject”, Edna G. Bay et Donald L. Donham,
dirs., States of Violence. Politics, Youth and Memory in Contemporary Africa, Charlottesville et
Londres, University of Virginia Press, 2006, p. 16-33.
Durham, Deborah, “Apathy and Agency. The Romance of Agency and Youth in Botswana”, Jennifer
Cole et Deborah Durham, dirs., Figuring the Future. Globalization and the Temporalities of
Children and Youth, Santa Fe, School for Advanced Research Press, 2008, p. 151-178.
Durham, Deborah, “Disappearing Youth: Youth as a Social Shifter in Botswana”, American
Ethnologist, 31, 4 (2004), p. 589-605.
Durham, Deborah, “Youth and the Social Imagination in Africa: Introduction to Parts 1 and 2”,
Anthropological Quarterly, 73, 3 (2000), p. 113-120.
Eckert, Andreas, “Urbanization in Colonial and Post-Colonial West Africa”, Emmanuel Kwaku
Akyeampong, dir., Themes in West Africa's History, Oxford, Accra et Athens, James Currey,
Woeli Publishing Services et Ohio University Press, p. 208-223.
El-Kenz, Ali, « Les jeunes et la violence », Stephen Ellis, dir., L'afrique maintenant, Paris, Karthala,
1995, p. 88-109.
Evans-Pritchard, E. E., The Nuer, Oxford, Oxford University Press, 1940.
Fortes, Meyer, The Dynamics of Clanship among the Tallensi, London, Oxford University Press, 1945.
28
Goerg, Odile, Hélène D’Almeida-Topor et Catherine Coquery-Vidrovitch, « Avant-propos », Hélène
D’Almeida-Topor et al., dirs., Les jeunes en Afrique. Évolution et rôle, tome 1, Paris,
L'Harmattan, 1992, p. 5-9.
Hall, Stuart et Tony Jefferson, dirs., Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Post-War
Britain, London, Hutchinson and Co., 1976.
Hansen, Karen Tranberg, “Introduction: Youth and the City”, Karen Tranberg Hansen, dir., Youth and
the City in the Global South, Bloomington, Indiana University Press, 2008, p. 3-23.
Hebdidge, Dick, Subculture. The Meaning of Style, London, Routledge, 1979.
Honwana, Alcinda, « Innocents et coupables : Les enfants-soldats comme acteurs tactiques », Politique
africaine, 80 (2000), « Enfants jeunes et politique », p. 58-78.
Ivaska, Andrew, “‘‘Anti-Mini Militants Meet Modern Misses”: Urban Style, Gender, and the Politics
of ‘‘National Culture’’ in 1960s Dar es Salaam, Tanzania”, Gender and History, 14, 3 (2002),
p.584–607.
Kaplan, Robert, The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War, New York,
Random House, 2000.
Konate, Yacouba, « Génération zouglou », Cahiers d’études africaines, 168 (2002), « Musiques du
monde », p. 777-796.
Konings, Piet, “'Bendskin' Drivers in Douala's New Bell Neighbourhood: Masters of the Road and the
City”, Piet Konings et Dick Foeken, dirs., Crisis and Creativity: Exploring the Wealth of the
African Neighborhood, Leiden, Brill, 2006, p. 46-65.
Last, Murray, “The Search for Security in Muslim Northern Nigeria”, Africa, 78, 1 (2008),
“Perspectives on Vigilantism in Nigeria”, p. 41-63
Maira, Sunaina et Elisabeth Soep, Youthscapes: The Popular, the National, the Global, Philadelphie,
Philadelphia University Press, 2005.
29
Mannheim, Karl, “The Problem of Generations”, Essays on the Sociology of Knowledge, Londres,
Routeledge, 1972 [1952], p. 276-320.
McKittrick, Meredith, To Dwell Secure: Generation, Christianity and Colonialism in Ovamboland,
Portsmouth, Oxford et Cape Town, Heinemann, James Currey et David Philip, 2002.
Mead, Margaret, Coming of age in Samoa: A psychological study of primitive youth for westem
civilization, New York, William Morrow and Co., 1928.
Meillassoux, Claude, Femmes, greniers et capitaux, Paris, Maspero, 1975.
Moyer, Eileen, “Street-Corner Justice in the Name of Jah: Imperatives for Peace among Dar es Salaam
Street Youth”, Africa Today, 51, 3 (2005), p. 31-58.
Pritchett, James A., The Lunda-Ndembu: Style, Change and Social Transformation in South Central
Africa, Madison, University of Wisconsin Press, 2001.
Samper, David A., “'Africa Is Still Our Mama': Kenyan Rappers, Youth Identity and the Revitalization
of Traditional Values”, African Identities, 2, 1 (2004), p. 37-51.
Schlegel, A. et H. Barry, Adolescence: An Anthropological Inquiry, New York, Free, 1991.
Sharp, Lesley Alexandra, The Sacrified Generation: Youth, History and the Colonized Mind in
Madagascar, Berkeley, University of California Press, 2002.
Ssewakiryanga, Richard, « Imaginer le monde chez soi. Les jeunes et la musique internationale en
Ouganda », Politique Africaine, 75 (1999), p. 91-106.
Straker, Jay, “Youth, Globalisation and Millenial Reflection in a Guinean Forest Town”, Journal of
Modern African Studies, 45, 2 (2007), p. 299-329.
Suriano, Maria, “Clothing and the Changing Identities of Tanganyikan Urban Youths, 1920s-1950s”,
Journal of African Cultural Studies, 20, 1 (2008), p. 95-115.
Tabutin, Dominique et Bruno Schoumaker, « La démographie de l'Afrique au sud du Sahara des années
1950 aux années 2000. Synthèse des changements et bilan statistique », Population, 59, 3-4
30
(2004), p. 521-621.
Turner, Victor, The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Rituals, New York, Ithaca, 1967.
Utas, Mats, “Victimcy, girlfriending, soldiering: tactic agency in a young woman’s social navigation of
the Liberian war zone”, Anthropological Quarterly, 78, 2 (2005), p. 403-430.
Vigh, Henrik, Navigating Terrains of War: Youth and soldiering in Guinea-Bissau, New York,
Berghahn Books, 2006.