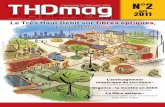Le parrainage à la fin du Moyen Âge : savoir public, attentes théologiques et usages sociaux
-
Upload
uni-frankfurt -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Le parrainage à la fin du Moyen Âge : savoir public, attentes théologiques et usages sociaux
LE PARRAINAGE A LA FIN DU MOYEN AGE:
SAVOIR PUBLIC, ATTENTES TH?OLOGIQUES
ET USAGES SOCIAUX
BERNHARD JUSSEN
/. Le parrainage comme champ de recherches
Cit?e comme t?moin au proc?s en nullit? de la condamnation de Jeanne
d'Arc, en 1456, Isabelle, la femme du laboureur de Domr?my, G?rardin
d'?pinal, d?clara que Jeanne ?se confessait volontiers et souvent?, et elle
indiqua dans son t?moignage comment elle le savait : ? comme elle le vit, car
cette Jeannette la Pucelle ?tait sa comm?re et avait tenu sur les fonts baptis maux un de ses fils, Nicolas ? K
Le parrainage servait donc d'argument. Il devait rendre plausible le fait
qu'Isabelle voyait souvent sa comm?re Jeanne.
Isabelle ne d?veloppa pas cet argument dont l'?vidence ?tait acquise. Elle
pouvait en effet supposer connu un autre argument, ? savoir que le parrainage cr?ait un lien de ?parent?? non seulement entre parrain et baptis? mais en
m?me temps ?
et ce avant tout dans les pratiques sociales ? un lien de ? com
paternit??, entre le parrain et les parents du baptis?. D?s les premiers t?moi
gnages sur le parrainage de bapt?me, aux alentours de 500, on a utilis? le voca
bulaire de la relation parents-enfants pour d?signer ces liens2. Depuis, les cher
cheurs ont pris l'habitude de d?crire le parrainage et la ? compaternit? ? comme
une forme de parent?, plus exactement comme une ?parent? artificielle?, une
?pseudo-parent?? ou ? de mani?re plus sp?cifique
? une ?parent? spiri tuelle ? et souvent une ? parent? rituelle ?3.
Pour des soci?t?s comme celles du Moyen Age, c'est en tout cas une expres
sion peu surprenante et sous cette forme g?n?rale de peu de secours. La parent? ?tait tout simplement le mode d'expression privil?gi? servant ? la formation
d'un groupe. Au Moyen Age, presque tous les groupes sociaux en employaient le r?pertoire terminologique pour se caract?riser eux-m?mes et se fixer des
normes. On a constitu? avec le parrainage une forme de parent?. Comment pro
467
Annales ESC, mars-avril 1992, n? 2, pp. 467-502.
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
c?dait-on? Quelle ?tait la fonction de cette parent? par rapport aux autres
formes de liens d?finis familialement ? L? o? nous parlons de ? parent? artifi
cielle ?, nous ne parlons que d'un code recouvrant le r?seau complexe de toutes
ces pratiques qui constituent, transforment, d?finissent les groupes sociaux,
fournissent une norme au comportement de leurs membres et le l?gitiment. La
? parent? artificielle ? est un code pour des groupes clairement d?finis en appa
rence, dont les fronti?res et les d?finitions ?taient en r?alit? aussi variables que
les situations dans lesquelles les groupes apparaissaient, et que les interpr?
tations, les int?r?ts et les modes de perception de leurs repr?sentants respectifs. D?chiffrer ce code, c'est d?crire les pratiques sociales. Quand et comment
les repr?sentants d'un groupe de parents, les juristes de l'?glise et ceux du pou
voir s?culier ont-ils publiquement d?crit et d?fini la parent? ou une parent? concr?te ? Comment les parents choisissaient-ils un parrain ? Et comment, dans
la pratique quotidienne, parrains et filleuls, comp?res et comm?res ont-ils uti
lis?, explicitement et implicitement, les r?gles de la parent?? Dans les paragraphes suivants, je traiterai trois cas qui montrent des moda
lit?s diff?rentes de ces pratiques dans des contextes diff?rents. Je commencerai
par un t?moignage unique sous cette forme : les actes du proc?s en r?habilita
tion de Jeanne d'Arc, plus exactement la partie qui contient les t?moignages recueillis dans le village natal de Jeanne, Domr?my. Ce que nous apprenons ici
sur les relations de Jeanne avec ses parrains, nous le tenons d'un point de vue
rare en ce qui concerne la fonction sociale du parrainage : le souvenir et la per
ception ?publiques? de ces relations. A partir de l'examen des statuts syno
daux de la fin du Moyen Age, je montrerai les liens qui existent entre la pratique des canonistes et celle des la?cs, liens que l'on ne retrouve pas au Haut Moyen
Age, d?j? bien ?tudi?. Pour finir, j'utiliserai le ?regard ethnographique? d?j? tr?s c?l?bre de l'inquisiteur Jacques Fournier pour faire appara?tre, ? l'aide de
ses registres, les mani?res d'agir entre comp?res dans tel ou tel contexte social,
mani?res qui n'apparaissent gu?re dans d'autres t?moignages narratifs, en tout
cas pas avec une telle densit?.
Auparavant, la recherche sur le parrainage ?tant encore relativement
r?cente, il n'est peut-?tre pas superflu de pr?senter ? grands traits l'ensemble de
ses d?terminants structurels et fonctionnels (et leurs variations), mis en ?vi
dence ? ce jour par la recherche et fournissant une grille de questionnement
appropri?e ? l'examen des cas qui suivent.
I. 1 -
?tude syst?matique
Syst?matiser les formes de parent? peut ?tre utile quand on ne se laisse pas s?duire par le caract?re statique de ces classifications. Lorsqu'on d?signe le par
rainage comme une ? parent? artificielle ?, cela ne veut naturellement pas dire
que ces formes artificielles de parent? aient ?t? moins r?elles ou m?me moins
efficaces qu'une parent? par le sang ou par alliance. Le terme ? artificiel ? doit
cependant tenir compte d'une chose : la parent? par le sang servait toujours de
mod?le et nous ne pouvons trouver nulle part identification, ni m?me confusion
de l'une de ces formes avec les groupes de filiation et d'alliance4. M?me lors
qu'on ?tendit au parrainage la prohibition de l'inceste limit?e jusque-l? ? la
parent? de sang et d'alliance5, les protagonistes savaient qu'ils n'avaient pas ?
468
B. JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
faire ? une parent? ?naturelle?, de m?me qu'ils savaient que les formes de la
parent? artificielle ?taient tr?s diff?rentes les unes des autres.
Ainsi, au d?but du Moyen Age, on n'a jamais cess? de d?signer les parrai
nages comme des adoptiones6 ? sans pour autant conf?rer le statut d'un parent
par le sang, comme dans le cas d'une adoptio, gr?ce ? la fiction intentionnelle
d'un ? faire semblant ?, gr?ce ? l'acte formel de nomination7. La parent? issue
du bapt?me ?tait, au Moyen Age, l'une des formes rituelles choisies pour ?tablir
un pacte d'amiti?. L'utilisation du vocabulaire de la parent? pour d?signer les
liens de parrainage ressemble moins aux formes de l'adoption qu'? celles des
confr?ries ? serment ou encore ? la d?signation de l'?v?que comme p?re de son
dioc?se. Ce qui ?tait en jeu, ce n'?tait pas le statut fictif d'un parent par le sang mais une qualit? de comportement. Ces parent?s pouvaient ?tre soumises ? une
normalisation sociale, devenir une m?taphore litt?rale, une simple convention
de langage. Mais elles pouvaient aussi r?sulter d'un vaste transfert analogique des (ou de quelques-uns des) droits et devoirs des parents ? naturels ? au b?n?
fice d'une parent? artificielle concr?te. On peut donc, ? juste titre, caract?riser
la parent? entre tous les chr?tiens, ou celle de l'?v?que avec son dioc?se, de
parent? m?taphorique. A l'inverse, on peut caract?riser la parent? entre
confr?res jur?s ou compagnons de guilde, de parent? analogique, parce qu'elle r?sulte d'un transfert litt?ral bien plus net et qu'elle est confront?e ? une pres
sion sociale bien plus forte8.
Les parrainages ne rentrent dans aucune de ces cat?gories. Lorsqu'on relit
par exemple comment Gr?goire de Tours ? le t?moin le plus ancien
? d?crit
ces liens, on peut interpr?ter ces descriptions comme un ?transfert analo
gique?, et m?me occasionnellement comme une fiction de statut9. Cependant, diverses recherches sur les liens de parrainage dans des r?gions, des contextes
sociaux et des p?riodes tr?s diff?rents, ont montr? qu'il existait de nombreuses
variantes, et que le parrainage offrait bien plus de possibilit?s qu'aucun autre
moyen de constitution d'une parent?. Quand nous qualifions le parrainage de
parent? artificielle, il s'agit moins d'un mod?le explicatif que d'un programme
de recherche. Seule a valeur explicative l'?tude des mani?res d'agir, c'est-?-dire
l'?tude des pratiques sp?cifiques ? l'?gard de chaque type de parent? artifi
cielle.
I. 2 ?
L'?tude des pratiques : les choix
Pour expliquer par des int?r?ts d?finis le choix d'un parrain par les parents,
il faut d'abord s'attacher aux conditions de ce choix. Il peut alors ?tre utile de
confronter les diff?rentes pratiques d?gag?es par la recherche pour des ?po
ques, des r?gions et des syst?mes sociaux diff?rents, non parce qu'elles seraient
d'une certaine fa?on comparables, mais parce qu'elles montrent les possibilit?s et les limites de ce choix et de l'usage qui en est fait, possibilit?s et limites avec
lesquelles il faut compter et sur lesquelles il faut s'interroger. On trouve ainsi, parmi les exemples d'une forte contrainte coutumi?re, que
des parents pouvaient au besoin contourner par des techniques compliqu?es
(pour le moins remarquables), mais qu'ils ne pouvaient pas ignorer10. Dans
d'autres exemples, les protagonistes avaient une grande marge de man uvre
pour leur d?cision11. Parfois, les relations ?taient pr?vues pour ?tre durables
469
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
? quel que soit au reste le sort qu'elles aient defacto connu ult?rieurement ?,
parfois pour ?tre temporaires et limit?es plus ou moins ? la f?te du bapt?me.
Dans plusieurs des cas ?tudi?s, les d?penses financi?res engag?es par le parrain
?taient insignifiantes, dans d'autres cas elles ?taient importantes et d?cisives
pour la constitution d'une relation. Parfois, les dons (mat?riels) ?taient unilat?
raux, parfois ils donnaient lieu, sous une forme ritualis?e, ? une r?ponse de la
part des parents, imm?diate ou ult?rieure. Tant?t ils ?taient uniques, tant?t
p?riodiques ; tant?t (rarement) ils valaient pour l'enfant, tant?t (plus souvent)
pour les parents12. En outre, on ne d?clarait parfois comme concern?es par les
liens de parrainage que les parties prenantes, parfois aussi leur parent?13. Le
r?le du lien de parrainage pouvait ?tre d?fini ou bien ? l'int?rieur du syst?me de
parent? (comme par exemple avec les prohibitions religieuses de l'inceste), ou
du moins admettre des recouvrements possibles14, ou bien en concurrence avec
la parent? (comme avec la fraternitas des compagnons d'une guilde ou des
moines). Certains ?l?ments exer?aient une grande influence sur le profit que
l'on pouvait retirer du parrainage : l'attribution au baptis? du nom d'un par
rain 15, le choix de femmes ou d'hommes16, d'adultes ou ? il faut compter avec
cela aussi ?
d'enfants17, de gens d'un rang social sup?rieur, ?gal ou inf?rieur,
de personnes mari?es ou de c?libataires, de voisins ou de forains. Par ailleurs, la
date du bapt?me limitait ou ?largissait les possibilit?s, soit que l'on baptis?t imm?diatement apr?s la naissance, soit que l'on p?t attendre, durant des mois
ou des ann?es, un moment propice18.
La taille d'un groupe de parrainage en d?terminait fondamentalement la
valeur sociale. Elle modifiait la qualit? des diff?rents liens (par exemple la dur?e
et l'intensit?), les attentes r?ciproques des parties prenantes, la possibilit? d'un
contr?le ?public?, les possibilit?s de diff?renciations internes. Elle modifiait
aussi les possibilit?s de repr?sentation publique et de positionnement social
accompagnant une f?te de bapt?me. Sur ce point, les pratiques ?tudi?es diver
gent d'une mani?re particuli?rement forte. Des parents n'ont ainsi parfois choisi qu'un parrain pour chaque enfant et sont au total parvenus ? peut-?tre
vingt ou trente comp?res ou comm?res19. Les t?moignages abondent davantage en faveur du choix de plusieurs ou de nombreux parrains, de telle sorte que l'on
pouvait arriver ? cent filleuls (des ethnologues en ont trouv? aussi jusqu'? mille) et en cons?quence par corr?lation, plus de comp?res et comm?res. Parfois on
pouvait, ? l'occasion de chaque bapt?me, red?finir le nombre des parrains, comme ? Florence au xve si?cle, ou bien on s'en tenait, comme dans la ville voi
sine de Mod?ne ? la m?me ?poque, ? une pratique usuelle (par exemple le
couple de parrains)20. Dans de nombreuses r?gions aussi, les parents ont choisi
pour chaque enfant de nouveaux parrains. Dans d'autres en revanche, ils ont
pris les m?mes parrains pour tous les enfants et limit? ainsi le nombre des enga
gements21.
Des d?tails moins visibles ne modifiaient pas moins la valeur sociale d'un
parrainage : s'agissait-il par exemple du bapt?me du premier ou du cinqui?me enfant ? D'une fille ou d'un gar?on ? ?tait-ce le parrain qui avait sollicit? le par
rainage22, ou les parents de l'enfant qui avaient choisi le parrain? La r?gle double et compl?mentaire selon laquelle, d'une part, on ne doit pas refuser une
demande de parrainage et, d'autre part, on ne doit demander que si l'on est s?r
d'une r?ponse positive23, pesait ?galement d'un poids diff?rent dans chaque
470
B. JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
situation. Le montant du risque couru lors d'une demande (comme lors d'un
refus) ou d'une tractation pour faire ?monter les ench?res? (en jouant sur la
possibilit? d'un refus) d?pendait des r?les sociaux des personnes concern?es et
de leur position relative les unes par rapport aux autres24.
Chaque ?grandeur? de ce jeu ?tait variable et la valeur de chacune des
variables d?pendait des autres. La combinaison, chaque fois sp?cifique, de ces
d?terminants montre, dans l'utilisation du parrainage, comment le point de vue
d'un berger de Montaillou diff?rait par exemple de celui des notables de
Domr?my, qui n'avaient pas eux-m?mes celui de leur seigneur. Enfin, nous
devons compter avec le fait que toutes ces pratiques collectives pouvaient
changer fondamentalement en l'espace de quelques d?cennies. Ainsi, ? Flo
rence, dans la couche sociale sup?rieure, les marraines perdirent leur r?le parti culier. De la m?me mani?re, au d?but de l'industrialisation, les ? petites ? gens
de Leipzig comme du village souabe de Neckarhausen dirig?rent leur choix non
plus vers les patrons mais vers leurs ?gaux25. Outre 1'?industrialisation?,
?'?urbanisation? semble aussi ?tre un mot clef excellent pour comprendre la
transformation des pratiques de parrainage, et il faudrait en v?rifier la valeur
heuristique pour la fin du Moyen Age. Au total, il serait difficile d'esquisser une typologie du parrainage. Il est
plus appropri? d'observer comment cet ensemble de variantes structurelles et
fonctionnelles a ?t? dans chaque cas combin? et utilis?. On ne peut que citer
quelques crit?res qui permettent de s'orienter dans la description des groupes de
parrainage dans un syst?me social concret, notamment : le choix du parrain ?tait-il fait dans la parent? ? ?tait-il fait dans la m?me classe sociale ? Y avait-il
recoupement des relations de parrainage et des relations de parent? ?
1.3 ?
L'?tude des pratiques: l'usage des r?gles
Le fait que les acteurs aient dispos? d'une s?rie de possibilit?s pour ?tablir
un lien de parent? avec certaines personnes et pour d?clarer valables, en relation
avec ces personnes, des r?gles plus ou moins ?
plut?t moins26 ?
fixes, ne dit
encore rien sur la valeur pratique de ce lien pour les conduites quotidiennes. Sur
la mani?re dont les parents spirituels se sont effectivement comport?s et sur
l'usage qu'ils ont fait des ? r?gles ? de la parent?, ces ? r?gles ? ne permettent de
conclure que de fa?on tr?s limit?e. Certes, elles influen?aient la conduite
adopt?e. Elles constituaient un ?l?ment de ces conditions ?objectives? et
?incorpor?es? toujours reconnues et reproduites dans la conduite adopt?e27. Mais quand elles entraient en concurrence avec des int?r?ts ou encore avec
d'autres ?r?gles?, ?ventuellement contradictoires, emprunt?es ? d'autres rela
tions sociales, elles apparaissent alors plut?t comme un ?l?ment du calcul indi
viduel ou comme le pr?texte ? la mise en place de strat?gies. En bref, il s'agit de
montrer comment la relation, cr??e par le parrainage, avec son caract?re repr?
sentatif et normatif fonctionnait concr?tement, comment et ? quelles condi
tions on lui faisait effectivement confiance.
On peut utiliser ce qui a ?t? ?labor? aussi bien pour d?crire les pratiques
mises en uvre dans les relations de parent? que pour ?tudier le parrainage,
bien plus ouvert et flexible28. Cela commence avec la pr?paration. Comme pour un mariage, arranger un parrainage c'?tait aussi mettre en jeu une strat?gie de
471
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
l'honneur et cela requ?rait un ?sens pratique?. Certes, ces pr?paratifs ren
voyaient justement ? ces pratiques informelles que les t?moignages ne pr?cisent
gu?re mais dont on trouve cependant quelques mentions29. De fa?on plus d?ci
sive encore, on notera que le d?nombrement des devoirs impos?s aux parents
spirituels n'est pas d'un grand secours. Du point de vue de l'histoire sociale, il
est int?ressant de savoir ce que ces parents ont fait de ce lien, comment ils s'y sont pris avec ces devoirs, comment ils les ont tant?t cit?s pour se justifier,
tant?t invoqu?s pour obliger leurs parents spirituels, comment tant?t ils se sont
soustraits ? ces r?gles et comment tant?t ils s'y sont soumis jour apr?s jour de
mani?re tacite et, ? l'occasion, de mani?re repr?sentative. Les protagonistes dis
cernent la valeur sociale de ces r?gles quand ils se r?servent une marge de
man uvre pour les modifier ou les manipuler quand ils pr?sentent en fonction
de chaque situation d'autres lectures possibles, quand ils ? oublient ? ce qui est
d?plaisant, quand, dans un cas, ils se ? soumettent ?, non sans ruse, ? un devoir
importun, quand dans un autre cas, ils cultivent une relation et en n?gligent une
autre, quand tant?t ils se d?robent et diff?rent, tant?t ils cherchent ? raviver
une ancienne relation, et ainsi de suite. Usages que r?glementaient aussi ?les
autres ?, par exemple les voisins qui enregistraient les relations de parrainage et
les soumettaient ainsi au jeu de la morale publique, c'est-?-dire de la conduite
d'honneur.
Si les pr?f?rences sont exprim?es lors du choix des parrains et si des int?r?ts
se manifestent lors de la constitution de groupes de parrainages, on ne peut pas
pour autant saisir ces relations entre parents spirituels ? l'aide de sources exploi tables statistiquement, comme par exemple les registres de bapt?me. Pour
l'?tude de ces relations, on aura plut?t recours aux t?moignages narratifs. Les
r?cits par exemple d'un Gr?goire de Tours ainsi que les vies de saints m?rovin
giens et carolingiens se sont r?v?l?s dans cette optique ?tonnamment riches
d'informations30. Dans les paragraphes suivants, je voudrais d?crire trois
t?moignages m?di?vaux: le savoir ?public? des parrains de Jeanne d'Arc ?
Domr?my, les besoins sociaux des la?cs dans le droit canon, l'utilisation de la
compaternit? dans la soci?t? des bergers de Montaillou devant l'inquisiteur
Jacques Fournier.
//. Le parrainage comme savoir public ?
l'exemple de Jeanne d'Arc
Plus de quarante ans apr?s la naissance de Jeanne d'Arc et plus de vingt ans
apr?s son ex?cution spectaculaire, alors que la m?moire individuelle et la
m?moire collective sur l'enfance de Jeanne s'?taient depuis longtemps m?lan
g?es, on interrogea des personnes de son entourage proche sur les premi?res ann?es de Jeanne : ses amis d'enfance et des relations de ses parents, ?g?s res
pectivement, au moment de l'interrogatoire, de quarante et d'environ soixante
dix ans. Parmi les douze questions auxquelles les trente-quatre t?moins origi naires du pays de Jeanne d'Arc durent r?pondre, c'est la troisi?me qui nous
int?resse ici particuli?rement : ? Qui ?taient ses parrains et marraines ?31 ?. Pour
dix-neuf des trente-quatre t?moins, le protocole indique, pour cette troisi?me
question, qu'ils avaient d?clar? ne rien savoir. Pour un autre t?moin, les inqui siteurs se content?rent de cette r?ponse : ? Jeanne eut des parrains et marraines,
472
B. JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
comme il l'a entendu dire?32. Les quatorze autres t?moins nomm?rent des
noms.
Si l'on regarde plus pr?cis?ment ces trente-quatre t?moins, on s'aper?oit que sur les quatorze t?moins qui cit?rent des noms, treize font partie des seize
t?moins qui habitaient en 1456 dans la paroisse de Domr?my/Greux. Sur les
dix-huit t?moins au total ?trangers au village, seul un t?moin, une femme, nomma quelques parrains par leur nom. Et cette femme (n? 7) avait elle-m?me
fait fonction de marraine lors du bapt?me de Jeanne. L'univers social des
parents de Jeanne, des paysans33, est constitu?, comme on pouvait s'y attendre,
par le village, et le savoir sur les relations sociales, comme par exemple les par
rainages, est un savoir circonscrit ? cet univers, village et paroisse. A la v?rit?, chez ces t?moins provenant du village, les r?ponses diff?rent de
fa?on ?tonnante. Un tableau, o? les t?moins de Domr?my figurent en abcisse et
les noms des parrains cit?s respectivement par ces t?moins en ordonn?e, en
donne une premi?re image. J'ai relev? par ailleurs les t?moins qui avaient habit?
ant?rieurement ? Domr?my, ainsi qu'une femme qui n'habitait pas ? Domr?my mais connaissait cependant des parrains. Enfin, compar?e ? ce que Jeanne elle
m?me a d?clar? au cours de son proc?s (d'apr?s le protocole latin [La] ou la
minute fran?aise [Fr]), la m?moire du village est particuli?rement remar
quable34.
Tableau 1. ?
Savoir public : parrains et marraines de Jeanne d'Arc
Domicile:
N? du t?moin3<
auparavant/
lors de l'interrogatoire occasionnellement3
Domr?my/Greux Domr?my
1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 34 (=) 2, 5, 20, 23,
Vittel
(=)7(=)
D?claration
de Jeanne
La/Fr
Parrains cit?s
Jeannette le Royer (4)
Jean Morel (1), Greux
Jeannette Thiessellin (7)
B?atrice Estellin (3)
Jeanne le Charpentier
Jean le Langart/Lingu?38
Jean Rainguesson
Jean Barre, Neufch?teau
?dette Barre, Neufch?teau
Agn?s
Jeanne Aubery, D.
Sibille
(12)
(10)
(7)
(4)
( D
( D
( D
( D
( D
( )
( )
( )
4,6,4,1,2,2,2, 3,0, 3,2,0, 3, 3,2,0 ( ) 0, 0, 0, 0, ()2()
Quatre points sont remarquables : 1) de nombreux parrains sont nomm?s
souvent ou plusieurs fois, d'autres une seule fois. 2) Certains t?moins nomment
plus de parrains, d'autres moins. Il y avait donc des parrains bien connus et
d'autres qui l'?taient moins; des t?moins dont les informations ?taient appa remment plus pr?cises que celles des autres. 3) Il est manifeste que ceux qui ne
473
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
vivaient plus dans le village ne savaient plus rien des parrains. 4) Les personnes
mentionn?es par Jeanne d'Arc, elle-m?me, ne l'ont gu?re ?t? par les t?moins.
Les trois marraines ne le sont pas du tout et les deux parrains ne le sont respecti
vement qu'une fois.
Attardons-nous d'abord sur ces ?carts ? l'int?rieur du savoir ? du village ?.
Les d?clarations les plus pr?cises ?manent de trois t?moins (nos 1, 3, 4); les
autres t?moins nomm?rent au plus trois parrains (nos 13, 15, 18, 19), la plupart
deux (nos 7, 10, 11, 12, 16, 21). Enfin, trois villageois ne cit?rent aucun nom
(nos 14, 17, 34).
//. 1 ?
Ou?-dire
Les trois t?moins de Domr?my dont les informations ?taient les plus pr? cises (nos 1,3,4) partageaient entre eux une exp?rience simple : ils ?taient pr? sents au bapt?me, et ce en tant que parrains39. En revanche, sur les dix autres
t?moins, il n'y en a pas moins de sept pour indiquer qu'ils ne savaient que par
ou?-dire ce qu'il en ?tait des parrains. Le paysan G?rardin d'?pinal (n? 16)
relata, selon le protocole, ?ce qu'il a entendu dire [quod audivit dicij?, de
m?me que les paysans Jean Colin (n? 21) et Jaquier de Saint-Amant (n? 10). Le
couvreur Berthrand Lacloppe (n? 11) entendait relater ?ce qu'on dit g?n?rale ment fprout communiter diciturj?, de m?me qu'un certain Perrin Drappier
(n? 12) et la paysanne Mengette Joyart (n? 19)40. Le laboureur G?rard Guille
mette (n? 13), qui, comme Mengette, nomma trois parrains, s'en remet ?? ce
qu'on dit fut asseritur]?. Ces ou?-dire ?taient apparemment une affaire propre au village. Tout se
passe comme si celui qui ne vivait pas au village ne connaissait pas non plus les
parrains. Les t?moins qui avaient quitt? le village (nos 2, 5, 23) d?pendaient de
leurs propres souvenirs et l'un d'entre eux (Jean Moen, n? 5) dit tout expr?s
?qu'il ne saurait d?poser, car il ne s'en souvient pas?. En outre, le cur? Jean
Colin, qui apparemment ne r?sidait pas ? Domr?my, n'a manifestement rien
entendu dire ? propos des parrains (n? 20)41. Apparemment enfin, les ou?-dire
n'avaient pas atteint cette femme venue du village de Vittel, seule ?trang?re ?
pouvoir citer des parrains (n? 7) ? en v?rit? deux seulement, dont elle-m?me.
Par cons?quent, bien qu'elle ait pris elle-m?me une part active au bapt?me, elle
n'a pu nommer qu'une seule autre personne, moins donc que presque tous les
villageois. Ce qui ne signifie pas que le ou?-dire n'?tait pas parvenu jusqu'aux oreilles
des gens ?trangers au village ou l'ayant quitt?. Les protocoles donnent plut?t
l'impression qu'en ce qui concerne le savoir par ou?-dire les inquisiteurs n'avaient pas manifest? le m?me int?r?t aupr?s de chaque t?moin. A propos d'un pr?tre de Montiers-sur-Saulx (Dominique Jacob, le t?moin n? 2), qui a
manifestement grandi ? Domr?my, le greffier nota que le t?moin ? ne saurait
d?poser ? ce sujet [celui des parrains], sinon par ou?-dire?42. Dans le cas du
cur? de Domr?my, qui r?sidait apparemment ailleurs, on a accept? la r?ponse ?
une question sur la vie au village, sur laquelle il ne savait rien sinon par ou?
dire43. Il n'en va pas autrement pour une villageoise: pour la paysanne Hau
viette (n? 14), on se contenta pareillement de la r?ponse selon laquelle elle ne
savait rien des parrains, sinon par ou?-dire.
474
B. JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
Dans bien des cas donc, les ou?-dire semblent n'avoir eu aucune valeur pour les inquisiteurs. C'est le cas apparemment lorsque ces ou?-dire circulaient en
dehors du village (t?moignages n?2 et 20) mais aussi quand les t?moins ?taient
plus jeunes que Jeanne d'Arc. Deux t?moins justifi?rent express?ment par leur
?ge le fait qu'ils ? ne savaient rien sinon par ou?-dire ? (nos 2, 14). Parmi ceux qui nomm?rent trois parrains sur ou?-dire (nos 13, 15, 18, 19),
quelques-uns se r?v?lent ?tre de ceux qui avaient bien connu Jeanne. L'un
d'entre eux, Jean Waterin (n? 15), ? d?clara avoir vu plusieurs fois [pluries : ou
?souvent??] Jeannette la Pucelle. Dans sa jeunesse, il alla avec elle ? la
charrue du p?re de cette Jeanne ?44. La paysanne Isabelle (n? 18), dont le t?moi
gnage a ?t? cit? en introduction, connaissait Jeanne et ses parents depuis sa jeu nesse. Elle avait souvent fait la veill?e chez eux et finalement, elle avait fait de
Jeanne la marraine de son fils45. Et la maison de la paysanne Mengette Joyart
(n? 19) ?tait ? presque contigu? ? celle des d'Arc ?46. On ne peut cependant pas en conclure que ceux qui ?taient ? proximit? personnelle de Jeanne en savaient
plus sur les parrains que ce ? on dit ?. De fait, deux t?moins de Domr?my qui ne
cit?rent aucun parrain (nos 14, 17) ont manifestement pareillement bien connu
Jeanne. Ils ?taient de son ?ge. L'un, Simonin Musnier (n? 17), ? d?clara par ser
ment qu'il fut ?lev? [nutritus] avec Jeanne appel?e la Pucelle et habitait ? c?t? de
la maison de son p?re ?47. L'autre, une femme (n? 14), d?clara qu'elle avait ?t? la
socia de Jeanne et qu'elle en savait long sur elle ? car souvent elle s'est trouv?e et
a dormi (mult?se jacuit) amicalement dans la maison de son p?re ?48. Deux des
t?moins ?galement qui, en 1456, n'habitaient plus au village (nos 5 et 23) ont
apparemment connu Jeanne. L'un (n? 5) la connaissait, ?car lui ?tait leur
voisin?, tout comme Mengette (n? 19) et Simonin Musnier (n? 17)49. Et le
t?moin (n? 23), qui avait certes entendu parler des parrains mais ne pouvait citer
aucun nom, a aussi ? bien connu cette Jeanne la Pucelle d?s sa jeunesse ?50.
En bref, ceux qui avaient souvent eu ? faire ? Jeanne n'en savaient pour autant pas plus sur ses parrains que ceux qui d?pendaient des ou?-dire. La corr?
lation de l'?ge des t?moins avec celui de Jeanne ne permet pas non plus de
conclure sur la connaissance qu'ils avaient de ces relations51. Cela sugg?re deux
conclusions de prime abord contradictoires. D'une part, les parrains semblent ?
peine avoir jou? un r?le dans la vie quotidienne de ces jeunes gens, dans leur
?ducation par exemple ou leur prise en charge. L'un des jeunes gens situ?s dans
l'entourage de Jeanne connaissait un ou deux noms, l'autre aucun. D'autre
part, certains des parrains et marraines de Jeanne jouaient ?
du moins au
temps de la r?habilitation ? un r?le social ?public?. Au moins dans ce cas,
d?j? c?l?bre en son temps, ?on? savait au village quelque chose des parrains. Pour de nombreux villageois, une partie de ces parrainages avait d?, d'une
fa?on ou d'une autre, devenir visible et fournir mati?re ? conversation. Et cela
n'avait rien ? voir avec la c?l?brit? de Jeanne car, comme on le verra, il en allait
de m?me ? Montaillou.
II. 2 -
Parrains comm?mor?s et oubli?s
On ne peut donc tirer de conclusions h?tives sur la mise en uvre au quoti dien des relations de parrainage, ? partir des souvenirs (officiels et relat?s
devant un tribunal) des villageois. De fait, lors de son proc?s, Jeanne n'avait
475
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
pas seulement cit? quelques noms qui diff?raient de ceux cit?s par les t?moins,
mais elle avait aussi plusieurs fois assur? qu'elle avait effectivement des contacts
avec une de ses marraines. C'?tait Jeanne Aubery, selon le protocole, la femme
du maire. Jeanne assure plusieurs fois que, ?de sa marraine?, elle aurait
?beaucoup entendu parler de visions et apparitions des F?es ou esprits des
F?es ?. Cette marraine pr?tendait m?me avoir vu elle-m?me des f?es pr?s d'un
arbre important dans la vie de la jeunesse du village, ce que les inquisiteurs entendirent interpr?ter dans le sens d'une initiation de Jeanne ? la sorcellerie52.
Or, aucun des t?moins ult?rieurs ne mentionna justement cette marraine, qui,
puisqu'elle ?tait la femme du maire, ne pouvait gu?re avoir jou? un r?le social
secondaire. A sa place, treize des quatorze t?moins qui savaient quelque chose
nomm?rent comme matrina une certaine Jeannette le Royer de Domr?my, et
pas moins de dix sur les quatorze nomm?rent encore un patrinus : le paysan
Jean Morel de Greux. Non seulement Jeanne n'a pas mentionn? ces deux per sonnes mais tous les parrains et marraines (Jeannette le Royer, Jean Morel,
Jeannette Thiessellin, B?atrice Estellin) relativement pr?sents dans le ? discours
du village?, en 1455, manquent dans la d?position de Jeanne, ? l'inverse de
tous les parrains et marraines qu'elle a cit?s. Il se peut naturellement que cette
multitude de noms ait produit en partie des erreurs. Il se peut ?galement que les
strat?gies mises en uvre pour r?pondre aux inquisiteurs aient jou? un r?le en
ce domaine, de m?me que certains ph?nom?nes appartenant au domaine de la
perception ou de la repr?sentation. Arr?tons-nous un instant sur ce point. Il est concevable tout d'abord que
cette marraine, qui a jou? lors du premier proc?s un r?le manifestement
n?gatif, ait disparu de l'image que les d'Arc voulaient donner d'eux-m?me et
que de ce fait elle ait ?t? moins pr?sente ou qu'elle n'ait plus ?t? pr?sente dans
les ou?-dire. L'histoire avec les f?es posait apparemment un probl?me lors du
second proc?s. Les t?moins originaires du village ont r?pondu sur ce point de
mani?re remarquablement d?taill?e, rendant cependant l'affaire totalement
anodine. Certes, on ne fit pas dispara?tre l'histoire de 1'? arbre aux f?es ? mais
on pr?tendit n'avoir jamais entendu dire que quelqu'un y ait r?ellement vu des
f?es. On rapporta qu'on y c?l?brait occasionnellement des messes et on donna ?
l'attrait de la jeunesse pour cet arbre une explication plus naturelle, ? savoir
qu'il ?tait extr?mement beau. Finalement, les t?moins repouss?rent cette his
toire ? l'arri?re-plan en recourant ? des anecdotes plus inoffensives. A les
croire, l'arbre ?tait aussi nomm? ?arbre aux dames? parce que les dames du
seigneur elles-m?me avaient coutume d'aller s'y promener, ou encore qu'?un
seigneur [...] allait rencontrer sous cet arbre une certaine dame d?nomm?e
?F?e? et qu'ils parlaient ensemble?53. L'image que les d'Arc entendaient
donner d'eux-m?me ou de leurs relations quotidiennes s'est peut-?tre beaucoup
modifi?e dans la p?riode pr?c?dant 1455 au point que, dans le ? discours du vil
lage ?, on ait oubli? Jeanne Aubery, ainsi qu'Agn?s et Sibille, ou qu'en tout cas
on ne les ait plus nomm?es. Comme exemple ?vident de pareilles techniques ?
introduites ni de mani?re totalement inconsciente ni dans un but pr?cis et pour tant adapt?es ? leur but
? on peut renvoyer au ph?nom?ne ? Jeanne d'Arc dans
l'histoire ?, par exemple ? la longue r?serve entretenue ? son ?gard et finalement
? sa r?appropriation par les catholiques54. Ceci n'explique pas le fait que Jeanne n'a nomm? aucun des parrains
476
B. JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
connus ult?rieurement dans le village. Sur ce point, on peut tout d'abord penser
que les perceptions et les int?r?ts de la fill(eul)e aient pu ?tre diff?rents de ceux
des parents. Nous savons par beaucoup d'?tudes (et cela sera encore confirm?
par l'exemple de Montaillou) que ce qui ?tait int?ressant lors du choix du par rain n'?tait pas le parrainage mais la compaternit?, c'est-?-dire l'usage ? l'avan
tage des parents de l'enfant. Jeanne Aubery doit son entr?e dans les sources
simplement au fait qu'elle a racont? ? la jeune Jeanne d'Arc une histoire pas
sionnante. Pour les parents, de ce fait, elle ne devait pas encore pr?senter d'int?r?t. Il n'en va pas autrement pour Agn?s et Sibille dont nous ne savons
rien d'autre que les noms.
Il est plus important encore de noter que l'int?r?t manifest? par les inquisi teurs qui, en 1431, interrog?rent Jeanne sur ses parrains, ?tait tr?s diff?rent de
l'int?r?t manifest? par ceux qui, en 1456, pos?rent la m?me question aux
t?moins. Nous devons donc compter avec des comportements respectivement diff?rents dans les r?ponses. Alors que Jeanne mettait en danger toute personne
qu'elle citait, il se peut qu'il ait ?t? de nouveau rentable, lors du proc?s en nul
lit?, pour les personnes concern?es, d'?tre associ?es ? Jeanne quand on les nom
mait.
Pr?cis?ment ? propos de l'histoire des f?es, une r?ponse de Jeanne montre
combien elle ?tait soucieuse de prot?ger sa famille :? Item dit qu'elle a ouy dire
a plusieurs anciens, non pas de son lignaiges, que les f?es y reperoyent ; et a ouy
dire a une nomm?e Jhenne, femme du maire de la ville de Dompremy, sa mar
raine, qu'elle les avoit veues la? (d'apr?s la minute fran?aise). Pour le
?lignaige?, Jeanne construisit expr?s une incise protectrice, mais elle mit sa
marraine Jeanne Aubery en danger. Quand Jeanne pr?tend ne pas savoir ce
que, du moins plus tard, beaucoup savent dans le village, cela peut par cons?
quent avoir ?t? une r?ponse tactique. Jeanne savait qu'elle n'avait pas nomm?
tous ses parrains et elle l'a expliqu? par cette formule ? qu'elle a eu plusieurs autres marraines, ? ce qu'elle entendit dire ? sa m?re ?55. Interrog?e sur ses par
rains, elle devait cependant r?pondre quelque chose. Si elle a cit? pr?cis?ment ceux qui
? si on en croit la m?moire ? du village ? ?
n'?taient gu?re apparus comme parrains, c'?tait peut-?tre une r?ponse tactique pour prot?ger ceux qui, en r?alit?, avaient ?t? importants.
Reste ? se demander comment les parents de Jeanne ou cette marraine Jean
nette sont parvenus ? ce que treize des quatorze t?moins aient connu cette rela
tion de parrainage. Les sources ne permettent pas de le savoir. Cit?e comme
t?moin, Jeannette Thiesselin a simplement mentionn? qu'elle s'?tait rendue
jadis (alias), une fois, avec Jeanne, ? une ?glise de p?lerinage proche56. Ce
contact n'a rien de surprenant. A titre de comparaison, notons que Jeanne elle
m?me avait racont? qu'elle avait ? beaucoup ? ? faire avec Jeanne Aubery57. La relation entre les parents de Jeanne et la marraine Jeannette Thiesselin
garde aussi ses zones d'ombres. On ne sait ni comment ils ont mis en sc?ne cette
relation face aux ?autres?, ni quelle valeur ce lien et sa pr?sentation ? publique ? avaient pour la marraine et pour les d'Arc, et s'il ?tait socialement
rentable, en 1450, au village, de passer pour parrain de Jeanne d'Arc. Il nous
manque, en ce qui concerne la valeur de cette relation, des informations par
exemple sur la fonction dans le village de la marraine Jeannette, sur la position
de son mari et de sa famille, sur la distance entre sa maison et celle des d'Arc,
477
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN AGE
ou sur la fr?quence, peut-?tre remarquable, de ses relations avec les parents
d'Arc. On retrouve des aspects de cette mise en sc?ne du parrainage tout au plus ? Montaillou58. Mais m?me avec ce genre d'informations, il resterait difficile
d'expliquer cette m?moire privil?gi?e. Jeanne Aubery par exemple ?tait la
femme du maire et on a oubli? malgr? tout son parrainage. M?me si, dans le cas de Jeanne d'Arc, on ne d?passe pas l'?num?ration des
cas de figure possibles, on y gagne cependant une remarque de m?thode : des
mod?les explicatifs selon lesquels ? le ? parrainage constituait un ? groupe rela
tivement large ? ou un ? ?tat formel d'amiti? situ? entre la parent? spirituelle et
la parent? naturelle?59 et ?cr?ait v?ritablement une famille?60, parrainage dont les r?gles pouvaient ? avoir de la valeur ? et dont la protection pouvait s'? amoindrir ? ou ? ne plus obliger ?61, ne peuvent expliquer cette m?moire tr?s
diffuse. Ils ignorent des aspects d?cisifs des pratiques sociales, orientent trop
fortement le regard sur le parrainage en tant qu'institution ?
d?crite de
mani?re relativement statique ? au lieu de le diriger vers les acteurs et leurs
agissements. Certes, on peut consid?rer comme une ?mise en application? la
mani?re dont les acteurs se sont comport?s ? l'?gard de ces r?gles. Les r?gles du
parrainage ?taient reconnues ou reproduites par les acteurs dans leur compor
tement, de mani?re objective ou int?rioris?e. Mais la confrontation avec ces
conditions ? objectives ? signifiait aussi la mise en uvre de strat?gies pour les
ma?triser ou l'institution de ces r?gles comme ?l?ment d'un calcul social ou poli
tique. De la combinaison toujours sp?cifique de ces aspects d?pendaient: la
r?alisation effective des modalit?s de cette relation constitu?e rituellement et
d?sign?e comme relation de parent? ; le choix des aspects de cette ? parent? ?
que l'on voulait dans chaque cas mettre en acte. On mettait en acte (et notam
ment ? publiquement ?) la relation avec l'un des parrains plus minutieusement
qu'avec un autre, on faisait d'un parrainage une relation de parrainage visible
dans le village, d'un autre pas. Si groupe unique il y a (constitu? des parents, du
baptis? et de nombreux parrains li?s d'amiti?), son apparition au grand jour ne
pouvait dater tout au plus que du bapt?me, et encore ? condition de ne pas y
regarder ? deux fois.
Tout se passe en effet comme si le groupe r?uni lors du bapt?me se pr?sen tait d?j? comme un groupe h?t?rog?ne. La diff?renciation des parrains, telle
que le souvenir des villageois la montre, semble avoir ?t? d?j? visible lors du
bapt?me. La marraine Jeannette le Royer ?tait de fait priviligi?e non seulement
dans la m?moire du village, mais aussi, si on en croit une remarque de son mari
(t?moin n?9), lors de la c?r?monie : ? ?lle [Jeannette] la tint [Jeanne] au dessus
des fonts baptismaux (tenuerat supra fontem), avant de se porter garant pour elle ?62. Jeannette, la seule marraine connue de presque tous les t?moins, a donc
accompli cet acte de parrainage rituel proprement dit : elle a pr?sent? l'enfant et
a manifestement parl? au nom de ce dernier. Il y a dans le protocole un
deuxi?me exemple en faveur pr?cis?ment de cette diff?renciation entre une mar
raine ?active? et une marraine ?passive?: la paysanne Isabelle (n? 18) a
racont? que ? Jeannette la Pucelle ?tait sa comm?re et avait tenu sur les fonts
(tenuerat ad fontem) un de ses fils, Nicolas ?63.
Dans les statuts conciliaires de la fin du Moyen Age, on renouvelle toujours l'interdiction d'augmenter le nombre des parrains. On ne devait ? pas autoriser
plus de trois parrains?64, et deux seulement, comme on le pr?cisait parfois
478
B. JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
express?ment, pour le bapt?me. De fait, on demandait un parrain pour le cat?
chum?nat (qui ?tait en pratique un ?l?ment du rituel baptismal), un parrain
pour le bapt?me, le dernier enfin pour la confirmation, conf?r?e bien plus tard65. Certes on ne trouve gu?re de justifications ? ces restrictions, comme par
exemple le danger d'inceste66, mais le rituel ne pr?voyait que l'intervention de
ces deux parrains. L'un pr?sentait l'enfant, l'autre intervenait pendant le bap t?me. Il semble donc que les parrains convi?s en surnombre, sans y ?tre auto
ris?s par les prescriptions eccl?siastiques, n'aient fait qu'acte de pr?sence. Les
parrains ?taient donc rituellement diff?renci?s et l'on pouvait ais?ment utiliser
ce fait pour les diff?rencier aussi socialement et rendre certains plus respon
sables que d'autres. On pouvait donc d?j? rituellement d?signer le parrain avec
lequel la relation devait ult?rieurement ?tre actualis?e, et donc rester dans Jes
m?moires, et le distinguer de ceux qui ult?rieurement n'avaient plus grande
importance.
II.3 ?La multiplication des parrains ?
Diff?renciation des valeurs d'?change et repr?sentation
La fonction sociale de chacun des parrains semble donc avoir ?t? diff?rente.
Il ne suffit pas de voir (avec John Bossy) dans la multiplication des parrains le
?mode pr?dominant? (predominant mode), ?soit d'?tablir des liens fermes
entre parents dont les relations auraient ?t? sans cela trop distendues pour ?tre
effectives, soit de les ?tablir l? o? ils n'existaient pas jusque-l? ?67. Cela masque
m?me plut?t l'usage qui est fait des parrains en nombre. Comme le remarque
justement J. Bossy, il s'agissait sans aucun doute, lors de la qu?te des parrains, de cr?er des relations formelles ou de les renforcer. Il faudrait ajouter qu'il y
avait deux mani?res de cr?er des relations formelles : soit les gens formalisaient
des relations existant d?j? en pratique (par exemple dans le cas de voisins ou de
partenaires commerciaux), soit ils en constituaient de nouvelles (par exemple dans le cas des rois ? la suite d'un assujettissement).
Mais ces fonctions ?
formalisation, constitution, renforcement ?
valent
pour l'ensemble du Moyen Age et n'expliquent pas de fa?on sp?cifique la multi
plication des parrains ? la fin du Moyen Age. Le ?principal objectif vis??
(chief object in view) dans une multiplication des parrains n'?tait pas simple ment la possibilit? de multiplier cet ? ?tat formel d'amiti? ? qui ? ressemblerait
un peu ? celui de la fraternit? du sang ou de la fraternit? en g?n?ral ?68. Certes, il n'est pas faux de recourir aux cat?gories de la constitution ou de l'intensifica
tion des relations familiales pour d?crire la valeur sociale de ces parrains en sur
nombre, alors que dans le ?discours du village?, quarante ans apr?s, on les
avait oubli?s depuis longtemps. Mais cela masque les diverses possibilit?s dont
les parents disposaient dans leurs mani?res d'agir avec les parrains. La valeur de
ces parrains en surnombre, manifestement vite oubli?s, ne peut avoir ?t? au pre
mier chef un ? ?tat formel d'amiti? ?. Cela avait ? voir plut?t avec leur pr?sence lors de la f?te. Par la pr?sence d'un grand nombre de parrains et de marraines, on faisait du bapt?me un rituel, une f?te de repr?sentation. Les d'Arc, gens
estim?s dans le village, se sont entour?s des gens estim?s du village : le parrain Jean Rainguesson appara?t en 1423 comme maire de Greux69, la marraine
Jeanne Aubery fut d?sign?e dans le proc?s contre la Pucelle comme femme du
479
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
maire de Domr?my70. En 1427, lors d'un litige, le parrain Jean Morel ?tait avec
Jacques d'Arc procureur du village71 et il faisait partie, comme Jacques d'Arc,
du groupe des habitants estim?s du village qui conclurent en 1423 un contrat de
protection avec Robert de Sarrebruck72. Dans ce groupe, outre Morel, il y avait
avec Aubery (par sa femme)73 et Rainguesson, encore deux autres comp?res de
Jacques d'Arc. La marraine Jeannette Thiessellin ?tait la femme du greffier du
tribunal. Enfin, il y avait avec Jean et Edette Barre de Neuf ch?teau deux ?tran
gers au village, et qui plus est des ? citadins ?. Un choix ?
si nous nous r?f?rons
aux recherches de Pierre Bourdieu74 ?
qui pouvait ?tre pareillement porteur de
prestige. Autant qu'on puisse le savoir, il n'y avait pas de parents parmi les par
rains. Rien n'indique ?galement que les femmes aient ?t? choisies selon un autre
mod?le que les hommes, comme on peut le voir ? Florence ? peu pr?s ? la m?me
?poque75. Bref, Jacques et Isabelle d'Arc ont clairement utilis? le bapt?me de
leur fille Jeanne pour repr?senter et stabiliser leur position sociale dans le village.
Par ailleurs, on peut d?crire l'usage de ces parrainages vite oubli?s pr?cis? ment par le fait qu'ils ?taient vite oubli?s et qu'ils restaient apparemment sans
grandes cons?quences ?familiales?. Naturellement, il en allait aussi pour ces
parrains de leur relation avec les parents du baptis?. Et on peut les caract?riser, eux aussi, avec ce m?me vocabulaire familial. Mais avec un tel parrainage, il
semble que l'on avait plut?t transmis un honneur, que celui-ci f?t ? l'avantage du
parrain ou ? l'avantage des parents. C'?tait plut?t un de ces moyens d'?change
social, du niveau des petits cadeaux qui entretiennent l'amiti?, mais dont le
?prix?, pour faciliter le contre-don, devait justement ne pas ?tre trop ?lev?76.
En bref, la multiplication des parrains ? la fin du Moyen Age ne s'explique
pas seulement par l'int?r?t qu'il y avait ? accro?tre le nombre des liens fami
liaux. Dans l'exemple pr?sent? ici, les parrains en surnombre ?taient vite oubli?s
et, defacto donc, les relations familiales n'?taient pas renforc?es. Avec ces par
rains en surnombre, sans participation rituelle, officiellement interdits par
l'?glise mais tol?r?s par le clerg? local, les la?cs satisfaisaient des besoins sup
pl?mentaires. Ils multipliaient les possibilit?s du parrainage comme repr?senta tion et comme valeur d'?change. A cet ?gard, les exemples florentins contem
porains sont plus frappants encore que l'exemple de Jeanne d'Arc, dont les par
rains semblent m?me tous avoir ?t? choisis selon un mod?le identique. A Flo
rence, de riches parents ont apparemment choisi les parrains selon une sorte de
calcul savamment dos?. Certains ? en r?gle g?n?rale des hommes
? ?taient des
notables qui n'?taient pas apparent?s aux parents. D'autres ?taient des pauvres
choisis au hasard, d'autres encore des femmes choisies dans la famille, d'autres
enfin des femmes choisies dans la client?le, par exemple des nourrices. Comme
le nombre des parrains ?tait variable ?
jusqu'? vingt et plus ?
les int?r?ts les
plus divers d'un couple pouvaient ?tre concili?s lors d'un seul bapt?me : am?
liorer ou entretenir des relations dans sa couche sociale, accentuer certaines des
relations au sein de la parent? par le sang et par alliance, permettre une repr? sentation religieuse avec les pauvres et patrimoniale avec les nourrices et les
femmes d'artisans. Il n'est pas ?tonnant que, dans un village souabe comme
Neckarhausen, on d?c?le d'autres pratiques ? l' uvre dans le choix des parrains
que celles utilis?es ? Florence. D. Sabean suppose que l'on satisfaisait les diff?
rents int?r?ts des deux conjoints et de leurs familles respectives, en choisissant
les parrains correspondants aux deux parties77.
480
B.JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
///. Le parrainage comme pr?cepte eccl?siastique :
l'influence des pratiques sociales
Autant l'accent est mis dans la recherche sur la diff?rence entre les prescrip tions de l'?glise et les pratiques sociales, autant, quand il en va des descriptions
concr?tes, on oublie cette diff?rence et l'on reconstitue ces pratiques sur la base
de ces prescriptions78. Cela n'est pas n?cessairement faux. On doit chaque fois
d?crire la relation entre la norme de l'?glise et les pratiques des la?cs. L? encore,
les t?moins de Domr?my fournissent un bon exemple du savoir concernant le
r?le d'un parrain, tel que le r?clamait l'?glise, et de la mani?re d'agir ? l'?gard de ce savoir. De fait, dans la quatri?me de leurs questions, les inquisiteurs vou
laient savoir ? si dans son plus jeune ?ge elle [Jeanne d'Arc] a ?t? convenable
ment ?lev?e dans la foi et les bonnes m urs?79. Les r?ponses de tous les
t?moins ?taient plus ou moins st?r?otyp?es, renvoyaient ? la pi?t? de Jeanne, au
fait qu'elle allait de son plein gr? et de fa?on notoirement fr?quente ? l'?glise,
rappelaient les moqueries de ses contemporains sur ses pri?res fr?quentes, ses
aum?nes et sa pratique de la confession.
Ce sont justement les trois parrains (nos 1,3,4) connus et vivant ? Domr?my
qui ont ins?r? une information compl?mentaire significative. Jean Morel a dit
qu'? elle savait, en effet, semblable aux autres jeunes filles, ses articles de foi, le
Pater noster, l'Ave Maria ?. La marraine B?atrice Estellin a dit que ? Jeannette
?tait bien et suffisamment instruite dans la foi catholique? et Jeannette le
Royer tenait ?galement sa filleule pour ?suffisamment instruite dans la foi, comme ses semblables ?80. Trois t?moignages ? la fois isol?s et remarquable
ment semblables, tous sortis de la bouche des parrains : les t?ches religieuses des
parrains, telles que l'Eglise les d?finissait, ?taient connues et les parrains
jouaient leur r?le ?
ici devant un tribunal eccl?siastique ?
de mani?re repr?
sentative, sous une forme qui conduisait le greffier ? des expressions st?r?oty
p?es.
Voil? qui peut suffire comme exemple de la pr?sence des r?gles de l'?glise dans les agissements des la?cs. Je veux m'occuper de la perspective oppos?e : de
la pr?sence des pratiques du la?cat dans l'activit? normative des experts de
l'?glise. C'est de la m?me fa?on tr?s diff?rent d'un cas ? l'autre. Tant?t on a
l'impression que les canonistes n'ont jamais cess? de d?velopper leurs prescrip tions sans tenir compte des pratiques des la?cs, comme pour la prohibition de
l'inceste. Tant?t, tout se passe comme s'ils s'?taient orient?s en fonction des
besoins des la?cs, comme s'ils avaient tent? de concilier leurs ?contraintes?
th?ologiques avec les int?r?ts des la?cs. Sur ce point, il existe justement dans les
statuts synodaux de la fin du Moyen Age d'int?ressants aspects.
III. 1 -
Le parrainage comme syst?me contr?lable et volontaire
La ? famille spirituelle ? ou le ? groupe ? sugg?rent tout d'abord un lien que
l'on ne trouve pas dans les pratiques, ? savoir la relation des parrains entre eux.
Il n'est jamais question de ?comparrains?81. Les parents d'un enfant pou
vaient susciter par le bapt?me une relation unique avec un parrain, son conjoint ou ? au moins pour le droit canon ? avec les enfants du parrain. Lors d'un
481
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
bapt?me, on d?finissait donc en fonction du nombre des parrains un nombre
plus ou moins grand de ces groupes, mais pas un groupe unique, plus ou moins
grand en fonction du nombre des parrains. Le fait que l'on n'ait pas ?tabli de relations entre les diff?rents parrains
semble moins li? ? une logique syst?matique qu'? une logique pratique ; ces
relations entre parrains devaient ?tre moins fond?es sur la logique que sur l'uti
lit?. Comparable ? la pr?paration d'un mariage, l'organisation de ces relations
?tait pour les parents l'occasion d'exercer leur savoir-faire. Y consentir signi fiait aussi admettre des contraintes, dont il n'?tait certes pas impossible de se
lib?rer mais au risque alors de menacer sa r?putation et son ? cr?dit ? social. Si
le parrainage fonctionnait comme lien social, la r?alisation devait rester, en
quelque sorte, contr?lable pour les parties prenantes, les cons?quences ?tre cal
culables, et le cercle de ceux qui pouvaient exercer cette pression des devoirs de
parent? ?tre ma?trisable. Il n'?tait donc pas convenable d'imposer simultan?
ment ? un parrain, en plus du lien contract? avec les parents, un lien avec bon
nombre d'autres parrains, lien qu'il ne pouvait choisir lui-m?me. De plus, si la
multiplication (au moins par deux) des parrains avait entre autres ? prendre en
compte les int?r?ts sp?cifiques et diff?rents de l'homme et de la femme82, on
aurait risqu? de d?truire cette fonction en pr?tendant que les parrains, choisis
selon des int?r?ts divergents, ?taient li?s les uns aux autres.
C'est cette possibilit? du contr?le individuel par les participants qui peut
expliquer une autre prescription. Dans son recueil de canons, largement dif
fus?, Pierre de Sampson a par exemple d?fini qu'un veuf pouvait se remarier
avec n'importe laquelle des commatres que son ?pouse d?funte avait eues avant
son mariage. L'?pouse les ayant pour ainsi dire apport?es dans le couple, elles
ne devaient donc pas ?tre consid?r?es comme les commatres de l'?poux. Autre
ment dit, d'apr?s cette d?finition, on n'entrait pas par le mariage dans une
parent? spirituelle, et on pouvait donc, lors d'un mariage, garder soi-m?me le
contr?le de sa parent? de parrainage83. De fa?on analogue, en g?n?ral, on ne
donna pas de d?finition pour la relation de parrainage ?? la mode de Bre
tagne?, ni pour celle de neveu ou de grands-parents spirituels. Remarquons bien: en r?gle g?n?rale! Car, on verra dans l'exemple de Montaillou84 que,
lorsque cela en valait la peine, de mani?re ? peine perceptible, les gens consi
d?raient ?galement comme allant de soi de telles relations.
III.2 ?Le bapt?me d'urgence: les pratiques sociales comme norme
de la solution liturgique
Ce que les hommes d'?glise tenaient pour indispensable n'?tait pas toujours
appropri? aux yeux des la?cs. La limitation du nombre des parrains ne l'?tait pas,
pas plus que ne l'?taient les prohibitions de l'inceste, dans le d?dale desquelles m?me les sp?cialistes ne parvenaient pas ? se retrouver85. Dans les deux cas, les
?v?ques ont interdit, dans les deux cas manifestement sans grand succ?s. Lors
qu'au xiiie si?cle, l'?glise demanda en plus de publier les bans trois semaines avant
la c?l?bration d'un mariage ? sans que cette n?gligence ne remette en cause la vali
dit? d'un mariage ?
c'est la compl?te vanit? de la prohibition de l'inceste qui ?clata86. Un regard sur la m?moire ? publique ? concernant les parrains de Jeanne
d'Arc montre que l'?glise n'avait que peu ? attendre de ce caract?re public.
482
B. JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
Les hommes d'?glise durent diffuser autrement une demande qu'ils ne pou vaient imposer par des interdits, mais seulement par la persuasion : le bapt?me tr?s rapide de toute ?me n?e. L'opinion selon laquelle les enfants mort-n?s sont
damn?s, comme Fulgence de Ruspe, suivant en cela son ma?tre Augustin, l'avait expos? dans l'Antiquit? tardive87, survit encore implicitement ? la fin du
Moyen Age88. D?j? si l'on pronon?ait mal les formules du bapt?me, ? dans les
quelles? ?
pour citer les statuts parisiens d'Odon de Sully, r?pandus dans
toute l'Europe89 ? ? r?side toute la vertu du sacrement et le salut des enfants ?,
cela suffisait ? la damnation. Et cela valait ? plus forte raison pour une mort
pr?coce lors de la naissance sans bapt?me. Les pr?tres devaient donc en tout cas
?r?guli?rement? pr?cher sur ce point. Ils devaient sans cesse rappeler aux
croyants les formules du bapt?me, au besoin en langue vernaculaire, de sorte
que chacun ?
?m?me le p?re et la m?re? ?
puisse baptiser rapidement l'enfant lors d'une naissance difficile90. D'apr?s le synode de Canterbury, en
1214, une coupe d'eau devait ?tre pr?te pour chaque naissance et, selon les sta
tuts de N?mes, on pouvait baptiser d?s que l'on pouvait voir la t?te du nour
risson91.
On peut supposer que ces bapt?mes d'urgence n'?taient pas souhait?s par les
parents, entre autres parce qu'on ne pouvait pas les pr?voir et qu'en cons?
quence, on ne pouvait pas inviter les parrains appropri?s. Pire encore : si les
parents baptisaient de leur propre main ou tenaient eux-m?me l'enfant au
dessus de l'eau, ils devenaient des parents spirituels l'un envers l'autre et
auraient d? donc s'attendre ? devoir rompre leur couple. Il semble que les la?cs
le savaient car, du d?but ? la fin du Moyen Age, il y a des t?moignages qui mon
trent que ce proc?d? fut employ? ? dessein pour obtenir l'annulation du
mariage92. En ce domaine, on ne pouvait rien interdire, et les hommes d'?glise ne pouvaient pareillement gu?re compter sur la peur de la damnation de
l'enfant, comme ils avaient pu le voir avec la prohibition de l'inceste.
On devait donc se livrer ? un travail de persuasion. Dans ce but, les pr?tres
devaient alors attirer l'attention sur toutes sortes de subtilit?s qui pouvaient
donner l'impression que l'on avait interpr?t? les n?cessit?s religieuses des sp?
cialistes ? la lumi?re des int?r?ts pratiques des la?cs. Les pr?tres devaient ainsi
sans cesse enseigner qu'un bapt?me accompli par les parents ne nuisait pas au
mariage de ces derniers93. Une s?rie de d?finitions donne l'impression que l'on
a rendu le bapt?me d'urgence plus attrayant en garantissant le choix des par
rains m?me apr?s un bapt?me d'urgence. Dans le synodal de l'Ouest (1216
1219), on exigeait des pr?tres ? qu'ils disent aux la?cs de ne pas donner de nom ?
l'enfant ? pendant le bapt?me d'urgence. En lieu et place, le pr?tre devait ult?
rieurement faire ?apporter l'enfant au seuil de l'?glise pour compl?ter ce qui
reste ? faire, c'est-?-dire l'imposition du sel et l'onction des oreils avec la
salive ?. En bref : ? on fera sur les fonts baptismeaux tout ce qu'on a l'habitude
de faire, sans immersion?94. D'apr?s Jean Gerson, les visiteurs paroissiaux devaient v?rifier aupr?s des sage-femmes la connaissance d'une formule en
langue vernaculaire (interrogare et docere) qui ne contienne pas de nom propre :
? enfant, je te batize ou [ !] nom du P?re et du Fiz et du saint Esperit. Amen ?95.
Et le recueil de statuts pour N?mes, de Pierre de Sampson, dit express?ment que
les bapt?mes d'urgence sont valides, m?me sans d?nomination et sans par
rains96, ce qui veut dire en clair : on peut baptiser en toute tranquillit?, sans se
483
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
priver des fruits sociaux d'un bapt?me, des relations de parrainage. Car, en
Gaule, depuis les origines du parrainage, la d?nomination faisait partie des acti
vit?s rituelles des parrains97. Ce recueil de statuts autorisait m?me que l'on
change?t encore une fois le nom de l'enfant lors de la confirmation, si on le sou
haitait, ? une sorte de revalorisation sociale de ce moyen, gu?re pris en compte
dans les relations sociales98. Tout se passe comme si les experts, qui, depuis tou
jours, s'?taient montr?s plus press?s de baptiser que les croyants99, avaient faci
lit? le bapt?me d'urgence pour les croyants, en en supprimant les inconv?nients
sociaux. On pouvait baptiser et, plus tard, si l'enfant survivait, c?l?brer ?
l'?glise un rituel presque complet, avec parrains et d?nomination. Une s?rie de
statuts ?
par exemple celui de Pierre de Sampson et le synodal de l'Ouest ?
sugg?rent m?me une solution encore plus souple : ils font du bapt?me ? la nais
sance une action suppl?mentaire, sans aucun effet sur la f?te de bapt?me ult?
rieure et sur les int?r?ts sociaux (comme cela existe d'ailleurs encore aujour
d'hui). Selon la lettre m?me de ces statuts largement r?pandus, si la personne
ayant administr? le bapt?me ne se souvient plus exactement des mots prononc?s
lors du bapt?me d'urgence, on ne r?p?te pas seulement la c?r?monie concernant
l'acte de bapt?me, mais on r?it?re aussi le rituel de bapt?me lui-m?me ? avec
un seul petit ajout dans la formule baptismale: ?si tu es baptis??, devait-on
alors dire, ?je ne te rebaptise pas, mais si tu n'es pas baptis?, moi je te baptise au nom du P?re, du Fils et du Saint-Esprit ? 10?. C'?tait defacto une solution qui
pouvait satisfaire et les int?r?ts th?ologiques et les int?r?ts sociaux.
IV. Le parrainage comme pratique sociale:
l'exemple de Montaillou
L'exemple de Jeanne d'Arc n'a pas montr? les applications pratiques des
relations de parrainage. Pour en ?clairer quelques aspects, je vais utiliser le
? registre d'inquisition ? de Jacques Fournier. Dans sa c?l?bre ?tude sur Mon
taillou, Emmanuel Le Roy Ladurie a plusieurs fois attir? l'attention sur le fait
que ?bapt?me et mariage figurent les deux p?les [du] "comment se faire des
amis" que pratique chaque Montalionais?101. Il est vrai que l'auteur de Mon
taillou n'a pas d?velopp? cela pour les parrainages et qu'il ne s'est pas pr?oc
cup? de savoir comment on a traduit ces pratiques rituelles en pratiques sociales. Comment fonctionnaient ces relations? Comment les gens s'y pre naient-ils ? l'?gard de leurs comp?res, de leurs parrains et de leurs filleuls?
Autrement dit, quelle utilit? avaient les r?gles de parent? et les r?f?rences
constantes ? l'amiti? ? Comment ces r?gles dictaient-elles aux protagonistes leur
comportement ?
Devant cet inquisiteur extr?mement dou?, les pr?venus, dont un quart
approximativement venait de Montaillou, se sont souvent r?f?r?s ? leurs rela
tions de parrainage. Ils ont ainsi montr? diverses facettes de l'utilit? pratique de
ces liens ainsi que leur mise en sc?ne. L'exemple de Montaillou pr?sente un
int?r?t particulier : les personnes interrog?es ?taient en bonne partie des bergers, c'est-?-dire souvent des c?libataires menant une vie errante. Pour eux, les par
rainages ont d? jouer un autre r?le que celui, par exemple, des t?moins s?den
taires, fermement ins?r?s dans des structures de consanguinit? et d'affinit?s.
484
B. JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
IV. 1 ?
La repr?sentation des comp?res : amiti? et m?rite
Suspect? d'h?r?sie, le cordonnier Pierre Guilhem r?pondit ? la question de
savoir s'il avait ?t? ?li? d'amiti?? avec un autre h?r?tique: ?oui, c'?tait mon
comp?re ?. Un autre pr?venu, Guillaume Escaunier, d?clara que sa m?re s'?tait
li?e d'une grande amiti? [familiaritatem contraxisset] avec sa comm?re. Le ? parfait ? Guillaume B?libaste aurait dit que la compaternit? ? sert ? acqu?rir des amiti?s humaines?, et Pierre Maury, la figure centrale du registre, d?clara
qu'avec la compaternit?, il ? acqu?rait l'amiti? de beaucoup de personnes ?. Et
le cur? Pierre Clergue, issu de la famille la plus puissante du village, ??tait
grand ami et comp?re ? de B?atrice de Planissoles, la veuve du ch?telain102. La
d?signation ? comm?re/comp?re ? semble donc ?tre une forme particuli?re de
la d?signation ? amie/ami ?. Les t?moins ?voquent ainsi une opinion commune
qui s'?tait r?pandue depuis des si?cles bien au-del? de leur univers social. Ainsi ? en usant du vocabulaire des auteurs des d?buts du Moyen Age et de la
p?riode qui suivit ? le parrainage et la compaternit? devaient cr?er un ? lien
d'amour? (dilectionis vinculum, amor, caritas), un lien d'amiti? (amicitia,
pactum amicitiae) ou de fraternit? (fraternitas) m.
Si dans les t?moignages de Montaillou, il n'est presque jamais question ni
des filleuls ni du parrainage104, on peut ? juste titre en d?duire que ces r?alit?s
n'?taient pas tellement int?ressantes en soi. Il ne faut cependant pas oublier ici
que ce d?sint?r?t d?pendait aussi des situations concr?tes et que le lien entre
parrain et filleul, en d'autres temps et en d'autres circonstances, pouvait ?tre
pareillement int?ressant. C'est le cas par exemple lors de la politique de mis
sion des d?buts du Moyen Age et de la p?riode qui suivit : il n'?tait pas rare
que l'on harmonis?t les rapports de force en confiant ? l'empereur le r?le de
parrain du seigneur ? converti ?. On conserva le rite de la vassalit? mais on lui
donna un cadre familial. Au cours du bapt?me, le vassal nouvellement soumis
?tait d?clar? fils ?adoptif? et recevait des cadeaux de bapt?me105. Ce type d'harmonisation c?l?br?e de mani?re repr?sentative n'?tait pas seulement utile aux assujettis. Sous les apparences d'un parrainage, Charles III le Simple, par
exemple, avait en r?alit? ?t? contraint d'acheter la paix avec Gottfrid, le chef
des Normands, en 882, par des contribu tions et la remise d'une forte somme
en ducats. Ainsi, bien qu'aucune commendatio n'ait eu lieu, Charles pouvait du moins faire rituellement une d?monstration de supr?matie en tant que ? p?re ? de Gottfried. Il pouvait faire passer les contributions pour des cadeaux
de bapt?me et, finalement, se ranger dans la lign?e des ?reges christiani??,
qui, en tant que ?rex et sacerdos?, avaient toujours pr?tendu ? des t?ches
eccl?siales106.
Utiliser le rituel de bapt?me pour concevoir sur le mod?le d'une relation
p?re-fils une relation asym?trique comme la vassalit? n'?tait qu'une possibilit?
parmi d'autres. Les relations de client?le ?taient souvent repr?sent?es en recou
rant ? la compaternit? rituellement sym?trique. A l'inverse, lorsqu'en 592 le roi
m?rovingien Gontran devint le parrain de son neveu Clothaire, on conclut par ce rituel asym?trique de 1'? adoption spirituelle ? une paix familiale sym?trique ou, comme l'exprima avec col?re le neveu Childebert II, on ? conclut une amiti?
(amicitias conlegare) ?107. Dans un exemple irlandais, un p?re par bapt?me
promettait la ? fraternit? ? ? son ? fils par bapt?me ? et ? ce que l'on peut voir
485
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
comme un renversement de l'asym?trie ?
s'en remettait ? la saintet? de ce fils
(commendo me sanctitate tue)108. Cela d?pendait naturellement de la perspective selon laquelle on jugeait ces
formes de relations amicales. Ainsi, c'est une interpr?tation bien particuli?re, dict?e par un r?le social plut?t inhabituel, li? ? des int?r?ts et des mani?res de se
mettre en sc?ne sp?cifiques que, lors de son interrogatoire, Pierre Maury a mise
dans la bouche du ? parfait ? cathare B?libaste. B?libaste passe pour avoir dit :
? Pierre Maury se fait bien des comp?res ; et pourtant, il lui sont de peu d'avan
tage, car ces compaternit?s ne servent ? rien d'autre qu'? acqu?rir des amiti?s
humaines?. Dans ce cas pr?cis, Pierre Maury partagea l'interpr?tation fournie
par son ami et n'accepta pas, cette fois, que l'on pr?sent?t ses parrainages comme une ? amiti? humaine ?, d?clarant : ? avec ce que je gagnai par mon tra
vail, je voulais faire du bien aux uns et aux autres, car je ne savais pas quelle ?tait la foi qui valait le mieux ?109. Il voyait donc plut?t le parrainage comme un
service divin ou, selon la formulation du ?parfait? cathare Raimond Authi?,
?pour l'amour de Dieu?. Raimond Authi? compara le ?vrai? parrainage ?
une ? vraie ? aum?ne : ? Car ?
disait-il ?
pour certaines aum?nes on a du
m?rite, et pour d'autres, ?be star? [= bonne r?putation]. [...] Il disait aussi
que pour certains filleuls on avait du m?rite, quand on en faisait, mais pour
d'autres, ? be star ? [ = bonne r?putation] ? no.
Si Pierre Maury s'est ici laiss? aller au jeu de la d?finition simplement rema
ni?e, en une autre occasion il a mis fin autrement ? une dispute avec B?libaste
commenc?e de mani?re presque identique. Pierre fit cette fois commencer B?li
baste ainsi : ? Vous faites beaucoup de comp?res et de comm?res, vous baptisez les enfants, et vous d?pensez vos biens ? le faire. Pourtant, ce bapt?me et ces
compaternit?s ne sont bons ? rien, sinon ? faire contracter des amiti?s entre les
hommes ?. Le protocole continue : ? Je lui r?pondis, que mes biens, je les avais
gagn?s, que je voulais les d?penser comme cela, et que je ne cesserais pas de le
faire pour lui ni pour un autre, car ainsi j'acqu?rais l'amiti? de beaucoup de
personnes. Je lui dis qu'il faut faire le bien ? tout le monde, car on ne sait pas
qui est bon ou qui est mauvais, et que j'avais entendu dire qu'on devait faire du
bien ? n'importe quel homme, car s'il ?tait bon, c'est-?-dire h?r?tique ou
croyant, on en aurait du m?rite [c?leste], et s'il ?tait mauvais, on en aurait des
remerciements?111.
Alors que B?libaste reprenait ? nouveau l'argument de l'homme de Dieu,
orient? vers l'au-del?, Maury persistait cette fois dans sa vision intra-mondaine
de la compaternit?. Tous deux montr?rent clairement cette fois les int?r?ts et les
pratiques qui se cachaient derri?re chacune de ces interpr?tations112.
IV.2-Des besoins diff?rents: Pierre Maury et Guillaume B?libaste
Maury et B?libaste ne cachaient pas que des int?r?ts mat?riels ?taient en jeu. Comme nous pouvons le conclure de la dispute, tisser et entretenir un r?seau de
parrainages ?tait co?teux et en m?me temps, d'un grand int?r?t. On ne peut pas
savoir avec pr?cision ce qui ?tait cher. ?tait-ce, la f?te, que le parrain payait? Faisait-on des cadeaux de bapt?me et si oui, ?taient-ils uniques ou fr?quents. Une fois, Pierre raconte qu'il avait offert six moutons d'un an ? six de ses fil
leuls113. Et l'h?r?tique Blanche, lorsqu'elle d?t fuir devant l'inquisition, passe
486
B. JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
pour avoir laiss? ? sa comm?re une cape, une couverture et un oreiller, ? charge de les lui rendre ? son retour. Si elle ne revenait pas, la cape devait alors appar tenir ? sa filleule114. On notera que la comm?re a ?t? mieux lotie que la filleule et
on ne manquera pas de relever non plus cette mani?re informelle de donner et
d'esp?rer r?cup?rer, qui fait penser plut?t ? une attitude familiale et amicale.
Mise ? part une affirmation d'ordre g?n?ral de Pierre, selon laquelle il ne vou
lait pas cesser de ? faire le bien, autant qu'il le pouvait ?115 ? ses filleuls, ce sont
les seuls indices en faveur de l'aspect mat?riel de ces relations. Leur importance n'en est cependant que plus claire.
A la lecture du registre, on a l'impression que le parrainage fut vraiment
pour Pierre Maury la forme centrale d'alliance. Pierre, qui dut fuir plusieurs fois devant l'inquisition, n'a manifestement jamais cess? de renouveler son
r?seau de compaternit?. Dans deux villages, Plan?zes et Flix, o? il avait
s?journ? plusieurs ann?es, il avait, selon le protocole, ? plusieurs ? comp?res116. Des ?trangers, de plus c?libataires, comme Pierre Maury, devaient davantage investir (au sens le plus litt?ral du terme) dans la compaternit?, ? d?penser ses
biens ?, selon les termes de B?libaste, que des personnes pouvant compter sur
des liens de consanguinit? et d'affinit?. Pierre ne pouvait pas ?
pour reprendre ses propres mots ? ? cesser de le faire [ni] pour lui [B?libaste] ni pour un autre, car ainsi j'acqu?rais l'amiti? de beaucoup de personnes ?117. Pour un berger iti
n?rant et c?libataire comme Pierre Maury, peu de choses semblent avoir ?t?
plus ?conomiques que de d?penser tout son argent en relations de parrainage. Parce que son propre int?r?t ?tait pr?cis?ment de d?masquer les conceptions
courantes, B?libaste pouvait mentionner un aspect qui ressortissait sinon ? ce
savoir n?cessaire mais pr?cis?ment tacite : la construction et l'entretien des rela
tions de parrainage r?clamaient de ?l'adresse? (bene facer?)118. On devait
nouer les relations de parrainage au bon moment et avec les bonnes personnes.
On devait se les rappeler quotidiennement, parfois aussi savoir les oublier, et, comme le montrent les deux dialogues entre Maury et B?libaste, les concevoir
de mani?re diff?rente selon les situations, mais toujours comme accomplisse ment fid?le d'un devoir119.
Pour mesurer 1'?adresse? dont Pierre Maury dut effectivement faire
preuve, il suffit de rappeler qu'il ?tait lui-m?me c?libataire et n'avait pas
d'enfants l?gitimes120 et qu'il n'?tait donc pas en mesure de choisir lui-m?me
officiellement des parrains. Si pourtant, selon B?libaste, il avait su ? se faire
avec adresse des comp?res ?, c'est qu'il avait d? ?
lui, le berger itin?rant ?
rentrer pour ainsi dire ? dans le jeu ? des parents des baptis?s et appara?tre de
plus comme un parrain attirant. Qu'il y ait investi de l'argent, c'est ce qu'on ne
peut pas prouver. Tout au plus peut-on le supposer ? partir des t?moins qui
avaient fait l'exp?rience de sa g?n?rosit?. L'un savait ainsi combien de farine
Pierre se procurait chaque semaine et distribuait ? d'autres, un autre savait
qu'une fois, Pierre avait habill? treize h?r?tiques121. B?libaste savait pourquoi il bl?mait l'investissement de Pierre dans la com
paternit? : il ?tait lui m?me un profiteur de la g?n?rosit? de Pierre mais ne ren
trait pas bien dans le syst?me explicitement d?crit par Pierre : celui qui voulait
fonder une amiti? ? et en tant que berger itin?rant se devait d'en fonder
?
parce qu'il ? en aurait des remerciements ?, ne donnait pas ? un h?r?tique vaga
bond et sans moyens comme B?libaste, qui vivait d'aum?nes. B?libaste n'avait
487
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
pas de moyens mat?riels et devait plut?t se faire entretenir par Pierre Maury ou
d'autres121. Par cons?quent, il n'?tait pas en mesure de fournir la forme habi
tuelle du ? remerciement ?. Aussi, on n'a pas entendu dire que quelqu'un en ait
fait son comp?re, ? quoi, il est vrai, par les refus qu'il opposait ? ces pratiques, il fournissait de nouveau une excellente justification. Pour survivre, il devait
donc fournir une explication concurrente, sur laquelle le syst?me de la saintet?
du Haut Moyen Age et surtout de l'aum?ne nous renseignent abondamment :
B?libaste se pr?sentait comme intercesseur d'un m?rite c?leste. Celui qui don
nait son argent ? B?libaste ou ? Authi?, ?pour l'amour de Dieu?, comme ils
disaient ?
parce qu'ils en vivaient, faudrait-il ajouter ?
y gagnait du m?rite.
Au Haut Moyen Age, les saints pouvaient, pour renforcer leurs chances de
survie, investir le parrainage. Par le bapt?me, ils transf?raient leur virtus aux
enfants de parents riches et pouvaient (et m?me : ? devaient ?) sans cesse ult?
rieurement revenir chez ces parents, y passer la nuit, le cas ?ch?ant m?me
obtenir des biens pour la construction d'un monast?re123. Au contraire, en
raison de la complexit? de leurs pratiques baptismales, les ?parfaits? cathares
ne pouvaient pas utiliser le parrainage. Il est donc ?tonnant que le ? parfait ? Raimond Authi? parle d'un bon par
rainage, qui ?
serait-on fond? ? penser ?
n'a pas sa place dans la doctrine
cathare124, mais qui toutefois, comme une bonne aum?ne, rapporte du m?rite.
Mais, comme le remarqua express?ment l'informateur, ?il ne pr?cisa pas pour
lesquels on avait du m?rite et pour lesquels ? be star ? [bonne r?putation] ?125.
Cette interpr?tation, expos?e ici par Authi?, pourrait bien avoir rempli une
fonction simple et importante pour les relations sociales. Elle offrait une solu
tion harmonieuse ? un probl?me simple, ? savoir que les parrainages pr?sen taient rarement les m?mes avantages pour tous les contractants, qu'ils n'?taient
pas porteurs pour tous, d'une mani?re pareillement manifeste, de cette ? bonne
r?putation ? qu'Authi? caract?risait comme le but courant de l'aum?ne aussi
bien que du parrainage. Si par exemple les parents cherchaient comme parrains des personnes plus haut plac?es dans la soci?t?, l'utilit? de cette ? amiti? ? ?tait
pour ces personnes moins directement tangible, quoique ?
que l'on pense au
bon patron ?
?videmment pr?sente. Contracter des relations de parrainage,
pour ainsi dire ?vers en bas?, n?cessitait cette id?e d'un m?rite c?leste con?u comme un ?l?ment de prestige suppl?mentaire.
Les quelques exemples emprunt?s ? Montaillou ne permettent gu?re de
savoir comment le statut social et le choix du parrain ?taient interd?pendants dans toute soci?t? villageoise. Il y a certes quelques exemples de relations de
parrainage socialement ?quilibr?es126. Ainsi, le cur? Pierre Clergue ?tait com
p?re de la ch?telaine B?atrice de Planissoles127, et la m?re du cur?, Mengarde
Clergue, ?tait comm?re de la vieille Guillemette Belot128. On tenait ces deux
femmes pour les plus puissantes du village. Elles ?taient de plus familialement
li?es, ?tant les m?res de Bernard Clergue, du bayle de Montaillou et de sa
femme, Raymonde Belot. Un autre couple Clergue, Bernard et Gauzia, ne fai
sait pas partie de la puissante domus des Clergue. Le couple, dont le statut
social est estim? comme ?moyen? par E. Le Roy Ladurie, a choisi Guillaume
Ben?t comme parrain pour sa fille, lequel provenait certes d'une des trois
familles riches, mais faisait lui-m?me partie des ? moyens ?129. Mais il n'existe
pas d'autres exemples, et cela ne suffit naturellement pas pour g?n?raliser.
488
B. JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
Selon quel mod?le de comportement par exemple le bayle de Saint-Paul de
Fenouillet a-t-il justement choisi pour comp?re Pierre Maury, le berger? Le
protocole ne permet pas de savoir si nous devons ici penser par exemple ? des
relations de client?le 13?.
IV.3 ?
Les mani?res du ? remerciement ?
Nous sommes mieux renseign?s sur ce qu'?tait le ?remerciement? que
Pierre Maury attendait de ses comp?res. Le berger Guillaume Maurs rapporte
que Pierre Maury l'avait une fois laiss? seul aux pr?s, en lui expliquant ? qu'il voulait aller vers un de ses comp?res nomm? Eyssalda, de Flix, o? il avait aussi
plusieurs autres comp?res, entre autres un nomm? Pierre Joyer ?, ajoutant : ? Il
y fut trois semaines ou environ?131. Pierre lui m?me raconta ? l'inquisiteur
qu'il ?tait all? une fois d?jeuner ? Flix chez un comp?re nomm? Pons Ortola, alors qu'il ?tait en train de faire un voyage, qui n'?tait pas sans danger, avec
B?libaste et deux autres h?r?tiques, et qu'il se rendait d'un endroit s?r ? un
autre132.
Voici un autre exemple : ? Je restai cet hiver-l?, raconte Pierre Maury, ?
Castelldans avec mon fr?re [Jean] ? et plus pr?cis?ment : ? Nous habit?mes tous
deux dans la maison de B?renger de Sagria, dudit lieu, le comp?re de Jean?.
Quelle qu'ait ?t? la relation de Pierre avec ce B?renger, il la d?finit du moins
devant l'inquisiteur par la compaternit? de son fr?re133. La propre histoire de ce
fr?re permet de savoir quelle importance ces relations devaient avoir pour lui. A
la suite d'une dispute, il dut quitter Montaillou et partit habiter ? Castelldans.
Plus pr?cis?ment, cela signifie qu'il y passa plusieurs hivers puis qu'il en fut ?
nouveau chass?, n'ayant pas pu trouver de femme134. Pierre s'?tait b?ti un
r?seau de relations de parrainage ? Flix et ? Plan?zes apr?s sa fuite de Mon
taillou. Il en allait de m?me pour Jean: la compaternit?, que son g?te de
quelques hivers lui avait au moins apport?e, ?tait une des rares possibilit?s de
prendre pied dans cet environnement nouveau de Castelldans. Que l'on ait pu
finalement tirer argument de son ?chec dans la qu?te d'une femme pour
l'expulser montre une fois encore les fortes diff?rences de valeur d'usage parmi ces formes de parent?, et les limites du champ d'action couvert par le parrai
nage (con?u comme protection sociale et comme argument), compar? ? la pro tection beaucoup plus concr?te et beaucoup plus solide apport?e par le mariage.
Pierre et Jean Maury n'avaient pas seulement besoin de leurs comp?res pour le couvert et le g?te, en partie de longue dur?e. Pierre Maury parle aussi d'une
autre forme de ?remerciement?, qui ?tait pour lui d'une importance vitale.
Alors qu'il comparaissait un jour devant le procureur de l'archev?que de Nar
bonne parce qu'il ?tait cens? avoir h?berg? deux h?r?tiques en fuite, ? beaucoup des personnes pr?sentes ? ? et parmi elles le seigneur de la ville
? dirent que ce
n'?tait pas Pierre qui avait re?u des h?r?tiques. Pierre ajouta alors : ?Arnaud
de n'Ayglina, bayle du lieu, mon comp?re, dit de m?me, et ajouta qu'au besoin
il se porterait volontiers caution pour moi ?. Le comp?re se porta donc caution.
Et l'inquisiteur, qui manifestement ne croyait pas les t?moins, n'eut plus d'autre solution que de reporter l'affaire, parce qu'? entre temps il s'informe
rait plus compl?tement du fait ?135. Apparemment, Pierre pouvait compter sur
un comportement de ce genre de la part de son comp?re, car un autre inculp?
489
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
mentionna que Pierre Maury avait dit avant m?me cette arrestation ? ? un de
ses comp?res de ne se porter caution pour lui ou ses biens en aucune fa?on ?,
parce qu'il savait aussi comment se lib?rer sans caution136. Par l?, Pierre
d?chargeait ainsi son comp?re, et lui aussi par la m?me occasion. Il ?vitait ainsi
de contracter inutilement une dette ? l'?gard de ce comp?re et ?conomisait pour
ainsi dire son ? remerciement ?, puisqu'il pouvait en ?tre autrement.
Pierre avait un autre probl?me qui appara?t deux fois dans les actes : il
n'avait pas de domicile fixe et donc gu?re de possibilit?s de mettre ses biens en
d?p?t. En cons?quence, il ne poss?dait gu?re plus que ce qu'il portait sur lui ; il
gagnait pourtant de l'argent et il ?prouvait bien des difficult?s ? le conserver.
Deux fois au cours de l'interrogatoire, des t?moins cit?s racont?rent que Pierre
avait confi? ses gains ? quelqu'un et dans les deux cas, contrairement ? l'habi
tude, ils indiqu?rent non pas les noms, mais seulement la fonction. Tous deux
parl?rent d'un comp?re de Pierre et dirent ? ce propos que celui-ci n'avait pas
r?cup?r? son argent137. Ces deux ?pisodes de l'interrogatoire sont tout ? fait
remarquables et contribuent ? ?clairer un couple plus important : celui asso
ciant l'amiti? et la compaternit?.
IV.4 ?La repr?sentation des amis: la compaternit?
Il faut noter tout d'abord que l'inquisiteur ne tenait pas ces deux histoires de
la bouche de Pierre, mais d'autres personnes. L'une d'elles lui fut racont?e par
le berger Guillaume Maurs, qui avait pendant quelque temps gard? les moutons
avec Pierre. Cet informateur, Guillaume, n'a manifestement pas totalement cru
cette histoire. Tout d'abord, ainsi qu'il le souligne express?ment, Pierre ? ne lui
a pas nomm? le nom [du comp?re] ?. Puis il ajoute : ? Je le vis plus de vingt
cinq fois... partir en disant qu'il allait trouver son comp?re pour lui redemander
ces 500 sous. Il restait parfois tout un mois, et pourtant... il n'y avaient pas
deux journ?es jusqu'? ce lieu de Plan?zes o? habitait sondit comp?re?. Et il
ajouta alors : ? Pierre ne me disait pas qu'il allait en quelque autre endroit que vers son comp?re de Plan?zes?138. Le berger tenait manifestement l'histoire
pour un pr?texte. Il indiquait ainsi un autre champ d'action du parrainage,
pour lequel, il est vrai, le comportement de Pierre n'est pas un exemple particu li?rement subtil. Comme forme de relation permise et reconnue, la compater
nit? offrait ? Pierre un argument, une version ?officielle?, pour masquer des
choses moins permises et moins reconnues.
Certes, il est possible que Pierre ait ici tout simplement menti. On sait pour tant par d'autres exemples que, dans cette utilisation du parrainage, ce qui ?tait
en jeu ?tait moins la v?rit? que des opinions parfois sp?ciales et li?es ? des situa
tions concr?tes, de faibles modifications et de g?n?reuses interpr?tations de la
notion de parrainage qui offraient la possibilit? de coller l'?tiquette protectrice
?parrainage? sur une relation qui avait re?u ou pouvait recevoir l'?tiquette ?amiti??.
Un Guillaume Escaunier d'Ax a utilis? cette technique devant l'inquisiteur d'une fa?on particuli?rement manifeste et instructive. Il devait expliquer ce
fait, d?licat, ? savoir que sa m?re avait entretenu une ?grande familiarit? avec
Sibille den Balle, qui fut br?l?e comme h?r?tique?. Il commen?a d'abord par
?voquer une autre relation de sa m?re : ? Gaillarde, ma m?re, avait li? grande
490
B. JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
familiarit? avec Alaza?s den Balle d'Ax, sa comm?re?, qui, ?il y avait long
temps... a quitt? Ax ?. Alors seulement il expliqua le r?le de Sibille : ? Apr?s le
d?part de cette Alaza?s, Gaillarde ma m?re noua une grande familiarit? avec
cette Sibille den Balle ?, et donna pour justification : ? ? cause de sa s ur ?139.
Dans sa d?tresse, pour justifier l'amiti? que sa m?re portait ? Sibille, Guillaume
a ?tendu devant l'inquisiteur sa parent? artificielle avec Alaza?s ? la s ur de
celle-ci, Sibille. Bref, un type de lien qui habituellement n'?tait pas d?fini140. Il a
? logiquement ? un peu ?largi l'analogie g?n?ralement reconnue entre compa
ternit? et affinit?/consanguinit?, et pr?sent? ainsi cette Sibille comme une sorte
de parente. Dans cette perspective, l'amiti? port?e ? Sibille par la m?re se trans
formait en obligation de parent? ? ? cause de sa s ur ?.
Quelques phrases plus loin seulement, il se sauva lui-m?me avec une autre
variante de cette m?me strat?gie. Ayant une fois pass? la nuit chez Raimond
Peyre d'Arqu?s, un h?r?tique, il donna cette explication ? l'inquisiteur: ?En
raison des b?tes... et pour voir ma s ur, je me rendis ? Arques, chez Raimond
Peyre d'Arqu?s, car il ?tait mon comp?re141?. Cette argumentation m?lant
int?r?t et compaternit? pla?ait adroitement, devant l'inquisiteur, sa relation
avec Raimond Peyre sous un ?clairage juste, celui du devoir de parent?, tandis
que son int?r?t se portait en r?alit? sur les vaches et la s ur.
Pierre Maury ?galement, qui avait une fois pass? l'hiver chez B?renger de
Sagria ? Castelldans, a express?ment ?officialis?? cette relation devant les
inquisiteurs : il dit avoir pass? l'hiver avec son fr?re Jean chez B?renger, lequel ?tait le comp?re de Jean142. Comme l'avait d?j? fait Guillaume d'Ax, Pierre a
lui aussi sugg?r? une parent? ? la mode de Bretagne. Dans ce contexte, on peut aussi mentionner que B?atrice, la ch?telaine, n'?tait pas seulement la comm?re
du cur? Pierre Clergue, mais aussi sa ma?tresse. On peut supposer ici qu'il s'agit d'une de ces techniques de d?signation ? convenable ? : l'amant se m?nageant comme comp?re une entr?e ? officielle ? dans la maison de sa ma?tresse143.
Devant le tribunal, on a donc parl? de parrainage pour donner ? une amiti?
une forme autoris?e et pr?senter une relation de fait comme une relation for
melle, et impliquant donc des obligations. Du mot ?comp?re?, on faisait un
vocable de l?gitimation. Le fait que les t?moins aient parl? durant ces interroga toires de relations de parent?, qui, ? ce que nous savons, n'?taient normalement
pas d?finies ni utilis?es, montre ? nouveau la souplesse du parrainage dans
l'usage qui en ?tait fait par les la?cs. Ce qui r?clame en m?me temps une descrip tion plus large de ces pratiques. A la diff?rence des statuts synodaux, qui ont
parfois effectivement r?tr?ci les limites de la compaternit? et du parrainage, comme nous l'avons vu plus haut, ces la?cs n'ont pas d?crit ces notions. Ils les
ont utilis?es. Devant le tribunal, Pierre Maury ou Guillaume Escaunier pou
vaient s'en tenir ? la vague signification d'une d?finition, et s'apparenter pour
ainsi dire un peu plus l'ami pr?sent? comme comp?re du fr?re, l'amie de la m?re
pr?sent?e comme s ur de la comm?re, tout en sachant bien qu'il aurait ?t?
d?cevant d'attendre des personnes ainsi d?finies les prestations d'un parent spi rituel. Ce ?je ne sais quoi? ou ce ?presque rien? de parent?, qu'une logique
syst?matique ne peut comprendre, ne sont pas du tout l'apanage des la?cs. Ils
apparaissent aussi dans les statuts synodaux. Dans ceux de N?mes, de 1252,
Pierre de Sampson a ajout? ? un catalogue tr?s ?labor? des prohibitions cl?ri
cales de l'inceste, la d?cision selon laquelle les fr?res et s urs du baptis? pou
491
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
vaient ?pouser les enfants du parrain, mais qu'il serait plus honorable de ne pas
le faire (licet sit honestum a tali coniuge abstiner?)144. L'auteur pensait donc
qu'ils ?taient manifestement, ?d'une fa?on ou d'une autre? pourtant ?un
peu ? concern?s par les relations de parrainage de leurs fr?res et s urs ou de
leurs parents.
IV. 5 ?
La valeur des r?gles
Les liens de parrainage ?taient au Moyen Age une forme du lien d'amiti?.
Tout au plus compl?mentaires des liens de parent? par le sang ou par alliance,
ils peuvent ?tre utilis?s dans un autre domaine. Jean Maury, ? Castelldans, ne
pouvait faire ?tat de liens familiaux acceptables, bien qu'il ait eu un comp?re. Le rite du bapt?me ne permettait aux personnes concern?es rien de plus que de
pouvoir ?tablir entre elles et devant les ? autres ?, le vocabulaire et l'ensemble
des r?gles de la parent?. Les expressions ?comp?re? ou ?comm?re? ?taient
normatives. C'?taient des mots charg?s de valeur, dont l'emploi ?tait toujours
exigence de ce ? lien d'amour ? propre ? la parent?145. L? o? les relations sociales sont d?finies par 1'?amour? et ses obligations,
on peut renvoyer ? la fonction stabilisatrice des ? ?motions ? et de la ? morale ?.
Lucien Febvre a soulign? que les ?motions, cat?gorie conceptuelle utilisable en
histoire sociale, n'?taient pas de ? simples automatismes de r?action ? instables
mais plut?t ?une sorte d'institution?, avec ?en quelque sorte des r?gles
rituelles? et donc des r?actions relativement ?valuables146. Les ?motions ont
leur propre ?grammaire?147, transmise culturellement et ?sue? ? l'int?rieur
des espaces sociaux respectifs. C'est seulement pour cette raison qu'il ?tait rai
sonnable d'introduire ? l'amour ? dans les textes juridiques148. Cela vaut d'autant plus pour la ? morale ? que l'on peut d?finir, pour le tra
vail du chercheur en histoire sociale, comme ?l'ensemble des conditions?
?d'apr?s lesquelles, dans un syst?me, on tranchera entre respect et non-res
pect ?149. Lorsque les normes du parrainage pouvaient l?gitimer et r?glementer les ?changes, alors l'accomplissement des normes devait avoir une place corres
pondante dans la matrice du respect et du non respect. Les actions morales
?taient toujours simultan?ment des comportements d'honneur. C'?tait la valeur
centrale d'un lien de parrainage : la demande adress?e ? un parent spirituel ?tait
en fait ? en tant que renvoi implicite aux obligations
? une de ces formes de
?violence douce?, ? laquelle on ne pouvait s'opposer qu'au prix de tensions
sociales ou d'une perte de prestige (capacit? ? m?riter la confiance, cr?dit). A
dire vrai, pour pouvoir utiliser cette violence, on devait entretenir les relations
de parrainage, on devait m?me exercer cette g?n?rosit? et cette hospitalit? que des gens comme Pierre Maury ont t?moign? ? leurs comp?res, sauf ? manquer au code de ce lien en s'y opposant. C'est ce que traduit parfois la langue utilis?e
par un t?moin. Un comp?re de l'homme de Dieu, Trudo par exemple, a
?exig?? (postulare) de celui-ci qu'il lui rende visite. C'est dans les m?mes
termes que cela nous a ?t? transmis pour saint Phal 15?.
Dans les pratiques quotidiennes des parents spirituels entre eux, il nous faut
plus compter avec cette informelle ? violence de la confiance, de l'obligation, de
la fid?lit? personnelle, de l'hospitalit?, du don, de la dette, de la reconnais
sance, de la pi?t?, de toutes les vertus en un mot qu'honore la morale de l'hon
492
B. JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
neur151 ?, que pouvoir la prouver dans un cas particulier. Et le spectre des r?ac
tions ?tait ?tendu. Qu'une demande, une harangue ou m?me une exigence en
mati?re de devoirs fussent une violence ou non, qu'il ait fallu ? payer ? pour un
refus, cela d?pendait d'une multitude de facteurs : de l'entretien d'une compa
ternit?, de son caract?re public, de rapports de force et de d?pendance, de liens
concurrents, de l'appr?ciation des int?r?ts. Les personnes concern?es pouvaient ?
si elles le voulaient ? en vertu de l'acte rituel, se d?signer mutuellement
comme p?re, fils ou comp?re. Et elles pouvaient ?
si elles le voulaient ?
exiger mutuellement les r?gles du comportement de parent? et en faire ?talage devant
les autres, ? savoir un ?lien d'amour? et de fraternit? (dilectionis vinculum,
amor, pactum amicitiae, fraternitas)152. Un lien dont l'interpr?tation et la r?ali
sation concr?tes n'?taient pas laiss?es ? l'arbitraire mais qui offrait n?anmoins
autant de possibilit?s qu'il y avait de situations concr?tes.
Bernhard Jussen
Max-Planck Institut f?r Geschichte, G?ttingen
Traduit par Florence et Gerald Chaix
NOTES
* Je remercie Florence et Gerald Chaix d'avoir traduit mon texte et d'avoir ?t? ainsi les pre
miers lecteurs critiques de la version fran?aise.
1. Proc?s en nullit? de la condamnation de Jeanne d'Arc, Pierre Duparc ?d., Paris, 1977, t. 1,
pp. 282-283 ; trad, fr., Paris, 1983, t. 3, p. 270; voir aussi l'?tude juridique de P. Duparc (t. 5,
Paris, 1988). J'ai substitu? dans la traduction de P. Duparc le terme de ?comm?re? ? celui de
? marraine ? pour respecter l'original latin comma ter.
2. Sur le parrainage au d?but du Moyen Age, voir A. Angenendt, Kaiserherrschaft und
K?nigstaufe. Kaiser, K?nige und P?pste als geistliche Patrone in der abendl?ndischen Mission
geschichte (Arbeiten zur Fr?hmittelalterforschung, 15), Berlin-New York, 1984; B. Jussen,
Patenschaft und Adoption im fr?hen Mittelalter. K?nstliche Verwandtschaft als soziale Praxis
(Ver?ffentlichungen des Max-Planck-Instituts f?r Geschichte, 98), G?ttingen, 1991 ; J. Lynch,
Godparents and kinship in early medieval Europe, Princeton, 1986; id., ?Spirituale vinculum.
The vocabulary in spiritual kinship in early medieval Europe ?, dans T.F.X. Noble, J. J. Contre
ni, Religion, culture and society in the early middle ages. Studies in honour ofR.A. Sullivan, Kala
mazoo, 1987, pp. 181-204; sur les premiers t?moignages concernant le parrainage, cf. B. Jussen,
Patenschaft, op. cit., pp. 153-158; sur le t?moignage le plus ancien concernant une compaternitas,
ibid. p. 200 ss.
3. On trouve une description tr?s utile dans J. Pitt-Rivers, ?Kinship III. Pseudo-kinship?,
dans International encyclopedia of the social sciences, t. 8, 1968, col. 408-413; les chercheurs
anglo-saxons nomment le plus souvent le parrainage: ?ritual kinship?; avec ce terme, on ne
prend pas en compte le fait que chaque forme de parent?, lorsqu'elle a une r?alit? sociale, est
rituellement constitu?e, d?finie et repr?sent?e ; le terme souvent employ? de ? parent? spirituelle ?
a ?galement des inconv?nients, car on fait alors sienne la version des auteurs eccl?siastiques dont la
r?alit? ?tait plut?t la pr?dication et le discours th?ologique que le parrainage et les pratiques
sociales mises en uvre par ses utilisateurs. Naturellement, ? c?t? de ces repr?sentations spiri
tuelles, ceux-ci avaient aussi des int?r?ts temporels concrets et notamment mat?riels.
4. Cf., par exemple J. Pitt-Rivers, ? Pseudo-kinship ?, op. cit. ; ?tude pr?cise de D.V. Hart,
Compadrinazgo. Ritual Kinship in the Philippines, Dekalb (Illinois) 1977, pp. 159-195, qui donne
un aper?u comparatif des r?sultats de la recherche ethnologique.
493
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
5. Il y avait ? tout le moins ici, il est vrai, dans les d?cisions eccl?siastiques une confusion, dans
la mesure o? les r?gles de l'inceste appliqu?es au parrainage n'ont pas ?t? constitu?es seulement en
?tendant par analogie celles appliqu?es ? la parent? de sang et d'alliance, mais pour ainsi dire en les
prolongeant. ?taient concern?s par la prohibition de l'inceste, non seulement les parties prenantes
au bapt?me, mais encore leurs conjoints et leurs enfants. Il faut en particulier souligner que nous ne
devons pas conclure de cette prohibition de l'inceste ? un tabou de l'inceste, ? une ? popular aver
sion toward the products of incest ? (J. Lynch, Godparents, op. cit., p. 241). Pour le Moyen Age,
nous ne pouvons pas dire grand-chose sur la mani?re dont on a effectivement ?vit? de tels mariages,
mais on a de bonnes raisons de penser qu'on n'a plut?t rien fait pour les ?viter (cf. B. Jussen,
Patenschaft, op. cit., pp. 26-38) ; J. Lynch, Godparents, op. cit., pp. 234-257 a montr? qu'il s'agis
sait de prohibitions impos?es ? d'en haut ? et prononc?es par Byzance. Dans la recherche ethnolo
gique, l'opinion autrefois largement r?pandue d'un tabou de l'inceste est en partie refutable ; on
trouvera une vue d'ensemble dans D.V. Hart, Compadrinazgo, op. cit., pp. 190-192.
6. Cf. Rimbert, VitaAnskarii 7, G. Waitz ?d. (MGH SS rer. Germ. 55, Hanovre 1884, pp. 3
79, voir p. 26) ? propos du parrainage de Louis le Pieux en faveur de Harald de Danemark : ipse de
sacro fonte suscepit sibique in filium adoptavit; Dhuoda, Manuel pour mon fils ?
Dhuoda, Liber
manualis VIII, 15, P. Riche ?d. (Sources chr?tiennes, 225), Paris, 1975, p. 3202-6 : Nec hocprae
tereundum est, fili, de illo qui te, ex meis suscipiens brachiis, per lauacrum regenerationis f ilium
adoptauit in Christo; en outre infra, n. 105.
7. A dire vrai, l'?tude de ce que nous devons imaginer des adoptiones m?di?vales n'est pas tr?s
avanc?e ; la th?se de Jack Goody, L'?volution de la famille et du mariage en Europe (trad, fr.),
Paris, 1985, selon laquelle ces formes n'auraient tout simplement pas exist? n'est pas rest?e sans
contestation ; de m?me, les chercheurs qui concluent sur la base de formulations apparemment
antiques recueillies dans les formulaires que de telles formes auraient exist? au Moyen Age sous des
formes comparables ? la pratique antique simplifient ?galement certainement ; on trouvera une
analyse des adoptiones m?rovingiennes dans B. Jussen, Patenschaft, op. cit., pp. 47-130.
8. Voir la d?finition dans J. Pitt-Rivers, ?Pseudo-kinship?, op. cit., p. 408.
9. J'ai d?crit cet aspect dans le troisi?me chapitre de mon livre, Patenschaft, op. cit., pp. 131
311; dans certaines situations, on peut cependant discerner une tentative de repr?senter une
parent? analogique comme une parent? fictive, lorsque les protagonistes ont attribu? ?galement ?
un lien de parrainage une influence sur les comportements de possession et d'h?ritage (voir les
exemples de Praetextatus de Rouen et de Childebert II, ibid. pp. 187-188 et 247-251).
10. Ainsi par exemple on se doit aujourd'hui encore dans certaines r?gions de Gr?ce de prendre comme parrains des enfants les t?moins du mariage, mais cette obligation est contournable ; cf.
J.K. Campbell, Honour, family and patronage. A study of institutions and moral values in a
Greek mountain community, Oxford, 1964, pp. 222-223.
11. Il en ?tait ainsi ? Florence au xve si?cle ; C. Klapisch-Zuber donne plusieurs mod?les de
comportement tr?s diff?rents (cf. infra n. 16), qui avaient chacun plusieurs variantes possibles
(? Au p?ril des comm?res. L'alliance spirituelle par les femmes ? Florence ?, dans P. Toubert ?d.,
et al. Femmes, mariage, lignages au Moyen Age, M?langes en l'honneur de Georges Duby, 1992,
sous presse) ; je remercie Christiane Klapisch-Zuber de m'avoir confi? son manuscrit.
12. Au xve si?cle, les Florentins faisaient une utilisation relativement libre de ces formes:
C. Klapisch-Zuber, ? P?ril ?, art. cit. ; sur Montaillou, cf. infra notes 113 ? 130 ; on trouvera des
exemples pour le Haut Moyen Age dans B. Jussen, Patenschaft, op. cit., pp. 266-270 ; on peut
comparer avec la pr?sentation de D.V. Hart, Compadrinazgo, op. cit., pp. 176-177, non pas pour
y emprunter des informations que l'on transposerait au Moyen Age mais pour y trouver les possi
bilit?s que les t?moignages m?di?vaux taisent ?ventuellement ; selon lui, aujourd'hui en Am?rique
latine ou aux Philippines, les parrains doivent payer les frais et la robe de bapt?me, parfois le repas
et les boissons, les musiciens pour la f?te, un cadeau au filleul ; en revanche, un an plus tard, dans
beaucoup de r?gions, les parents invitent les parrains ? une co?teuse ablution rituelle des mains
suivie d'un repas. D'apr?s cette recherche, les cadeaux des parrains au filleul sont plut?t rares.
13. David Sabean par exemple montre dans le deuxi?me volume, encore in?dit, de son ?tude
sur la parent? dans le village souabe de Neckarhausen (Property, production and family in Neckar
hausen 1700-1870, t. 1, Cambridge, 1990; t. 2 en pr?paration) que les relations de parrainage
?taient transmissions ?par h?ritage?, c'est-?-dire qu'un couple choisissait d'abord un seul et
m?me parrain pour tous ses enfants, lequel, en cas de d?c?s, ?tait remplac? par son fils. Je remercie
David Sabean de m'avoir confi? son manuscrit.
494
B. JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
14. Cf. n. 5 ; on trouvera des exemples emprunt?s aux recherches ethnologiques en Am?rique
latine dans D.V. Hart, Compadrinazgo, op. cit., pp. 166-167; pour les exemples tir?s de Mon
taillou, cf. infra, note 138-142.
15. Voir le cas de Jeanne d'Arc, cf. infra, n. 58 ; dans les t?moignages francs, anglo-saxons ou
irlandais du Haut Moyen Age, on en trouve ? peine un exemple.
16. C. Klapisch-Zuber, ?P?ril?, art. cit., a montr? qu'? Florence, au xve si?cle, on choisis
sait les parrains et les marraines d'apr?s des conceptions concurrentes : par le truchement des par
rains, on cr?ait donc les relations extra-familiales, ? l'int?rieur de sa couche sociale, par le truche
ment des marraines, les relations intra-familiales et les relations de patronage. Vers 1500, cet
aspect particulier des parrainages f?minins avait disparu : cf. aussi C. Klapisch-Zuber, ? Comp?
rage et client?lisme ? Florence (1360-1520)?, dans Ricerche storiche, 15, 1985, pp. 123-133.
17. Voir J. Bossy, ?Blood and baptism: kinship, community and Christianity in Western
Europe from the fourteenth to the seventeenth centuries ?, dans D. Baker ?d., Sanctity andsecu
larity: the church and the world, [Studies in Church History 10], Oxford, 1973, pp. 129-143,
p. 134.
18. Tels les rois du Haut Moyen Age (par exemple lors du bapt?me des M?rovingiens de Neus
trie : M?rov?e, Samson et Clothaire II, cf. Jussen, Patenschaft, op. cit., p. 79, p. 178 ss, 205 ss et
229 ss), et apparemment aussi les la?cs comme le montrent les p?nitentiels ; les sources sont pr?sen
t?es dans M. Rubellin, ?Entr?e dans la vie, entr?e dans la chr?tient?, entr?e dans la soci?t?:
autour du bapt?me ? l'?poque carolingienne ?, dans Les entr?es dans la vie. Initiation et apprentis
sages. xiie Congr?s de la Soci?t? des historiens m?di?vistes de l'enseignement sup?rieur public
(Nancy, 1981), Nancy, 1982, pp. 31-51, voir pp. 38-39, et les notes 26 et 27).
19. C'est ce que montrent par exemple les t?moignages francs du Haut Moyen Age ; voir les
travaux cit?s supra n. 2 ; c'est ce que montrent aussi, en Styrie, les registres de bapt?me de l'?poque
moderne, cf. P. Becker, Leben, Lieben, Sterben. Die Analyse von Kirchenb?chern (Halbgraue
Reihe zur historischen Fachinformatik, 5), St. Katharinen, 1989, p. 33 et pp. 66-69.
20. Voir : pour Florence, C. Klapisch-Zuber, ? P?ril ?, art. cit. ; pour Mod?ne, ibid., n. 8 ;
voir le comportement des parents de Jeanne d'Arc et les cas pris ? Montaillou (cf. infra, ? 2 et 4) ;
on trouvera des exemples des recherches ethnologiques, sous une forme r?sum?e, dans D.V. Hart,
Compadrinazgo, op. cit., pp. 161-166.
21. C'est le cas ? Neckarhausen ? l'?poque moderne (cf. D. Sabean, Property, op. cit., t. 2,
chap. 1) ; on trouvera des exemples emprunt?s aux recherches ethnologiques dans D.V. Hart,
Compadrinazgo, op. cit., pp. 164-166.
22. On trouvera des exemples dans Agnellus, Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis,
O. Holder-Egger ?d. (MGH SS rer. Lang., Hanovre 1878, pp. 265-391, voir p.294); Pierre le
Chantre, Summa de sacramentis et animae consiliis, 1.3, c.2, ? 334, J.-A. Dugauquier ?d., (Ana
lecta mediaevalia Namurcensia, 16), Louvain-Lille 1963, p. 404; Jonas de Bobbio, Vita Colum
bani, 1. I, c. 14, B. Krusch ?d. (MGH SS rer. Germ. 37, Hanovre-Leipzig, 1905, pp. 1-294, voir
p. 174) ; B. Jussen, Patenschaft, op. cit., pp. 26 et 296 (Agnellus), p. 31 (P. le Chantre), pp. 288
289 (Colomban).
23. C'est ce qu'ont montr? par exemple Nutini et Bell pour Tlaxcala, H.G. Nutini, B. Bell,
Ritual kinship. The structure and historical development of the compadrazgo system in rural Tlax
cala, Princeton, 1980, pp. 56-57 ; le chroniqueur Gr?goire de Tours donne un exemple pour le
Haut Moyen Age : lorsqu'on lui reprocha le parrainage en faveur de son neveu Clothaire, le roi de
Neustrie, Gontran, avan?a comme argument l'?l?ment ? officiel ? (c'est-?-dire explicite), ? savoir
que personne ne doit refuser une proposition de parrainage ; le chroniqueur tait dans sa relation
des ?v?nements l'?l?ment ?non officiel? (implicite), ? savoir que Gontran avait donn? au pr?a
lable son accord ; sur ce point, cf. B. Jusse?, Patenschaft, op. cit., pp. 251-254.
24. Voir les exemples de la n. 22 ; en refusant le parrainage d'un fils de roi, saint Amand a jou?
une v?ritable ? partie de poker ? : avec un bon argument, il a d?clin? ce parrainage jusqu'? ce que le
roi finisse par am?liorer le ton et les conditions ; sur ce point, cf. B. Jussen, Patenschaft, op. cit.,
pp. 293-294 ; J. K. Campbell, Honour, op. cit., p. 222 raconte qu'un p?re s'est soustrait ? l'obliga
tion contract?e ? l'?gard d'un parrain ? l?gitime ? selon l'usage, en posant la question sp?cieuse de
savoir ? if he would mind surrendering his right on this occasion because X has asked him if he
might have that honour ?, parce que ? as X is an important man he fears to give him offense ?.
8 495
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
25. Cf. pour Leipzig, H. Zwahr, Zur Konstituierung des Proletariats als Klasse. Struktur
untersuchung ?ber das Leipziger Proletariat w?hrend der industriellen Revolution (Akademie der
Wissenschaften der DDR. Schriften des Zentralinstituts f?r Geschichte, 56), Berlin, 1978, pp. 163
189, notamment pp. 167-170 ; pour Neckarhausen, cf. D. Sabean, Property, op. cit., t. 2, chap. 1 ;
pour Florence, cf. supra, n. 16.
26. C'est ce qu'a montr? par exemple S.D. White, Custom, kinship and gifts to saints. The
? laudado parentum ? in western France 1050-1150, Chapel Hill-Londres, 1988, pp. 55, 71, 120 ;
pour le Moyen Age, dans des groupes de parent? fond?s sur l'affinit? et la consanguinit? ; c'est
encore plus frappant avec les parent?s de parrainage, telles qu'elles apparaissent par exemple ?
Montaillou (cf. infra, ? 4).
27. Voir le chapitre ?La croyance et le corps?, dans P. Bourdieu, Le sens pratique, Paris,
1980, pp. 111-134; M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, t. 1, J. Winckelmann ?d., Cologne
Berlin, 1974, par exemple p. 195, appelle cela ?eingelebt? (acclimat?).
28. Par Pierre Bourdieu au premier chef. C'est dans une perspective comparable ? celle de
Bourdieu (ou en faisant leur pour partie ses analyses), mais plus r?solument historique, que travail
lent les auteurs de l'ouvrage collectif: Emotionen und materielle Interessen. Sozialanthropolo
gische und historische Beitr?ge zur Familienforschung, H. Medick et D. Sabean ?ds (Ver?ffentli
chungen des Max-Planck Instituts f?r Geschichte, 75), G?ttingen, 1984 ; trad, angl., Interests and
Emotions. Essays on the study of family and kinship, Cambridge, 1984.
29. J'ai trait? quelques cas dans Patenschaft, op. cit., pp. 291-295.
30. J'ai tent? de les exploiter dans Patenschaft, op. cit., pp. 271-311.
31. Cf. Proc?s en nullit?, op. cit., t. 1, pp. 244-315, la question p. 250; trad, fr., op. cit., t. 3,
pp. 232-298, et notamment p. 238.
32. Ibid., t. 1, p. 292 (t?moin n? 23) et t. 3, p. 279 ; les 18 autres : n? 2, 5, 6, 8, 14, 17, 20, 22, 24
? 34.
33. Je ne m'occupe pas ici des diff?rents points de vue d?velopp?s par la recherche sur le statut
de la famille d'Arc et renvoie sur ce point au commentaire de P. Duparc dans Proc?s en nullit?,
op. cit., pp. 132-142.
34. D'apr?s le Proc?s de condamnation de Jeanne d'Arc, P. Tisset ?d., 3 vols, Paris, 1960.
35. Les t?moins n? 5 et n? 23 (Jean Moen et Michel le Buin) ont pass? leur jeunesse avec
Jeanne d'Arc ? Domr?my et demeuraient ailleurs au moment de l'audition ; le t?moin n? 20 (Jean
Colin) ?tait ?cur? de l'?glise paroissiale de Domr?my et chanoine de l'?glise coll?giale Saint
Nicolas de Brixey au dioc?se de Toul, pr?tre ? {Procesen nullit?, op. cit., t. 1, p. 286, trad, fr., t. 3,
p. 273), selon le protocole, il ne relate que ses rencontres avec Jeanne ? Vaucouleurs, o? il a appa
remment re?u sa confession (ibid.); le t?moin n? 2, cur? de Montiers-sur-Saulx en 1456, a grandi ?
Domr?my, ? en croire ses r?ponses : ce qu'il raconte sur la jeunesse de Jeanne d?coule de sa propre
vision des choses, mais il ?tait plus jeune que celle-ci (Procesen nullit?, op. cit., pp. 255-257, trad,
franc., op. cit., pp. 243-245).
36. Dans l'ordre, les t?moins sont : 1. Jean Morel ; 2. Dominique Jacob ; 3. B?atrice Estellin ;
4. Jeannette le Royer ; 5. Jean Moen ; 7. Jeannette Thiessellin ; 9. Th?venin le Royer ; 10 Jaquier de
Saint-Amant; 11. Bertrand Lacloppe; 12. Perrin Drappier; 13. G?rard Guillemette; 14. Hau
viette de Syonne; 15. Jean Waterin; 16. G?rardin d'?pinal; 17. Simonin Musnier; 18. Isabelle
d'?pinal ; 19. Mengette Joyart ; 20 Jean Colin ; 21. Colin (fils de Jean Colin de Greux) ; 23. Michel
le Buin ; 34. Jean Jaquard.
37. Les parrains portant un num?ro ?taient en m?me temps t?moins.
38. Un certain Jean le Langart fut nomm? par la marraine B?atrice, un Jean Lingue fut
nomm? par Jeanne elle-m?me; d'apr?s P. Duparc, Proc?s en nullit?, op. cit., t. 5, p. 134, c'?tait
bien la m?me personne.
39. Jean Morel (t?moin n? 1), B?atrice Estellin (n? 3), Jeannette le Royer (n? 4).
40. Voir Proc?s en nullit?, op. cit., t. 1, pp. 268, 269, 271, 273, 279, 284, 287.
41. Il ne savait presque rien de Domr?my, ?tait en outre chanoine dans une autre ?glise et avait
plusieurs fois entendu Jeanne d'Arc en confession ? Vaucouleurs ; on peut voir par l? ? quel point le
clerg? avait de faibles chances de contr?ler les prohibitions de l'inceste spirituel ; sur ce d?calage des
prohibitions de l'inceste par rapport aux pratiques, cf. B. Jussen, Patenschaft, op. cit., pp. 26-38.
496
B. JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
42. Proc?s en nullit?, op. cit., t.l, p. 256 ; dans la traduction fran?aise (Proc?s en nullit?, op.
cit., t. 3, p. 244), la seconde moiti? de la phrase manque.
43. Lors de sa r?ponse ? la question 9.
44. Proc?s en nullit?, op. cit., t. 1, p. 277 ; trad, fr., op. cit., t. 3, p. 265.
45. Ibid., pp. 282-283 ; trad, fr., pp. 269-271.
46. Ibid., p. 284; trad, fr., p. 272.
47. Ibid., p. 280; trad, fr., p. 268.
48. Ibid., pp. 275-276; trad, fr., p. 263.
49. Ibid., p. 261 ; trad, fr., p. 249; cf. en outre supra les notes 46 et 47.
50. Ibid., p. 292 ; trad, fr., p. 279; les deux t?moins restant (nos 2 et 34) qui ne savaient rien,
?taient plus jeunes que Jeanne ; bien que dans le proc?s de r?habilitation cette mention fr?quente
de bonnes relations avec Jeanne d'Arc ait eu pour objet ?vident de donner du poids aux descrip
tions ?logieuses en tous points, les deux t?moins n'en restent pas moins des voisins, du m?me ?ge
que Jeanne, dont les souvenirs concernant maints d?tails rendent utilisables leurs d?clarations.
51. En 1456, Jeanne aurait eu environ 44 ans ; si l'on met en relation l'?ge des t?moins et le
nombre des parrains connus, on obtient la liste suivante : ?
4-6 parrains connus, ?ge des t?moins : 80, 70, 70 ans ?
3 parrains connus, ?ge des t?moins : 50, 46, 45, 40 ans ?
2 parrains connus, ?ge des t?moins : 90, 60, 60, 60, 60, 50 ans ?
1 parrain connu, ?ge des t?moins : 56, 47, 45, 44, 35 ans
52. Cf. Proc?s de condamnation, op. cit., pp. 66, 168, 196, 198, voir la citation p. 196; trad,
fr., op. cit., t. 2, p. 67, 140, 163, 165, voir la citation p. 163.
53. Voir en particulier les r?ponses ? la question 9 chez les parrains n? 1, 2, 3, 4, 7, 11, 17 ; cita
tion de Jeannette Thiesselin (n? 7), Procesen nullit?, op. cit., pp. 264-265 ; trad, fr., op. cit., t. 3,
p. 252.
54. Cf. G. Krumeich, Jeanne d'Arc in der Geschichte. Historiographie, Politik, Kultur (Bei
hefte der Francia, 19), Sigmaringen, 1989.
55. Proc?s de condamnation, op. cit., t.l, p. 40; trad, fr., op. cit., t. 2, p. 40.
56. Voir Proc?s en nullit?, op. cit., t. 1, p. 264 (question 4).
57. Cf. n. 52.
58. Un mot sur l'homonymie: elle ne devrait gu?re ?tre responsable du traitement privil?gi?
que Jeannette le Royer re?oit dans la m?moire collective du village. Seuls deux t?moins (n? 15 et
n? 18) indiquent que Jeanne aurait re?u son nom de Jeannette le Roy er et de Jeannette Thiesselin,
et Jeannette Thiesselin (n? 7) revendiquait cette transmission du nom exclusivement pour elle.
59. Voir par exemple J. Bossy, Blood, op. cit., p. 134: ?comparatively large group? et
? formal state of friendship between the spiritual kin and the natural kin ?.
60. J. Lynch, ?Spiritual kinship and sexual prohibitions inearly medieval Europe?, dans
Monumento iuris canonici. Series C. Subsidia 1, Rome, 1985, pp. 271-288, voir p. 274; la
? famille ? est en g?n?ral, dans les sources, plus sugg?r?e que vraiment caract?ris?e par la termino
logie p?re-m?re-enfant.
61. Voir par exemple A. Angenendt, Kaiserherrschaft, op. cit., p. 104, pp. 266-267'.
62. Proc?s en nullit?, op. cit., p. 267 ; trad, fr., op. cit., p. 255.
63. Proc?s en nullit?, op. cit., p. 283 ; trad, fr., op. cit., p. 270.
64. Voir par exemple les statuts de Paris, c. 11, O. Pontal ?d., Les statuts synodaux fran?ais
du XIIIe si?cle, t.l: Les statuts de Paris et le synodal de l'Ouest. XIIIe si?cle, (Collection de docu
ments in?dits sur l'histoire de France 9), Paris, 1971, p. 57.
65. Voir les statuts de Sisteron des ann?es 1225/1235 c. 4, O. Pontal ?d., Les statuts synodaux
fran?ais du XIIIe si?cle, t. 2. : Les statuts de 1230 ? 1260 (Collection de documents in?dits sur l'his
toire de France, 15), Paris 1983, p. 189 ; voir aussi les statuts de Pierre de Sampson (N?mes, Arles,
B?ziers, etc.) datant de 1254, c. 13 (ibid., p. 279).
497
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
66. C'est lui qui sert de justification ? Sisteron ; cf. Sisteron c. 4, O. Pontal ?d., op. cit., t. 2,
p. 188.
67. Telle est l'opinion courante, dans la formulation ici de J. Bossy, Blood, op. cit., p. 133 :
? either of making firm connections between kin, whose relationship would otherwise have been to
distant to be effective, or of establishing them where they had not existed hitherto ?.
68. Telle est l'opinion g?n?rale, dans la formulation ici de J. Bossy, Blood, op. cit., pp. 133
134 : ? formal state of friendship ?, qui ? would somewhat resemble that to bloodbrotherhood, or
of fraternity in general ?.
69. Cf. S. Luce, Jeanne d'Arc ? Domr?my. Recherches critiques sur les origines de la mission
de la Pucelle accompagn?es de pi?ces justificatives, Paris, 1886, document n? 51, p. 98.
70. Cf. supra, n. 52.
71. Cf. S. Luce, Jeanne, op. cit., document n? 42 (pi?ce additionnelle), pp. 359-362.
72. Cf. supra, n. 69.
73. En cas de besoin, une relation tout ? fait utile comme on le voit ? Montaillou.
74. Cf. P. Bourdieu, Le sens pratique, op. cit., pp. 300-303.
75. Cf. supra, n. 16.
76. Voir la description de P. Bourdieu, par exemple dans Le sens pratique, op. cit., pp. 168
169.
77. Cf. C. Klapisch-Zuber, ?P?ril?, art. cit., et D. Sabean, Property, op. cit., t. 2, chap. 1.
78. Je prendrai un exemple tout r?cent dans l'?tude, par ailleurs tr?s d?taill?e et tr?s riche de
Matthias Benad, Domus und Religion in Montaillou. Katholische Kirche und Katharismus im
?berlebenskampf der Familie des Pfarrers Petrus Clerici am Anfang des 14. Jahrhunderts (Sp?t
mittelalter und Reformation. Neue Reihe, 1), 1990, p. 264 : ?Mais... comme les bergers ?trangers
pouvaient ?tre livr?s sans d?fense aux chicanes des habitants du lieu ou ? l'arbitraire des seigneurs
locaux, l'institution traditionnelle du parrainage religieux offrait le cadre d'une solution. La (...)
parent? spirituelle ?tait depuis les d?buts du Moyen Age de plus en plus identifi?e [gleichgesetzt !] ?
la parent? par le sang et trait?e de plus en plus pr?cis?ment dans les synodes. Les m?mes d?finitions
de l'inceste valaient [galten !} pour elle comme pour la parent? par le sang. L'?glise apparaissait
ainsi comme le garant de relations sociales ?largies ?. Cette ? identification ? a peut-?tre ?t? le fait
des experts de l'?glise (et encore pas tous et pas toujours), mais pr?cis?ment pas celui des la?cs, qui
ont toujours utilis? le parrainage plut?t dans d'autres domaines que celui de la parent? par le sang
et par alliance, pour laquelle ils ont form? des transferts analogiques partiels et variables en fonc
tion des situations. On doit aussi se demander si une r?gle ?valait? quand l'?glise l'?tablissait,
sans qu'il faille s'interroger sur sa mise en application. Sur ce dernier point, cf. B. Jussen, Paten
schaft, op. cit., pp. 26-38.
79. Proc?s en nullit?, op. cit., t. 1, p. 250; trad, fr., op. cit., t. 3, p. 238.
80. Procesen nullit?, op. cit., t. 1, pp. 253, 258, 260; trad, fr., op. cit., t. 3, pp. 241, 246, 248.
81. L'interpr?tation des termes compater et commater, comme on le fait parfois, par ceux de
? comparrain ? et de ? commarraine ? est erron?e.
82. C'est ce que sugg?re l'exploitation des registres paroissiaux du village souabe de Neckar
hausen, de 1700 ? 1870, que D. Sabean a entrepris dans le second volume de son ?tude, voir
D. Sabean, Property, op. cit., t. 2, chap. 1.
83. Cf. Le synodal de N?mes, op. cit., chap. 158 [ = statuts de Pierre de Sampson], O. Pontal
?d., t. 2, pp. 384-387.
84. Cf. infra, ?3.4.
85. Nous ne traiterons pas ce point ici ; sur l'impossibilit? ? s'y retrouver dans les prohibitions, cf. B. Jussen, Patenschaft, op. cit., pp. 26-38; en outre, sur les interdits, cf. J. Lynch, Godpa
rents, op. cit., pp. 219-281.
86. C'est le cas d'abord dans les Statuts de Paris, c. 40, O. Pontal ?d., op. cit., t. 1, p. 66 ;
Statuts d'Albi, de 1230, c. 55, ibid., t. 2, p. 28 et n. 3 ; Statuts de Bordeaux, de 1234, c. 45, ibid.,
p. 66; Statuts de Sisteron, de 1225/1235, c. 47, ibid., p. 206; cf. J. Gaudemet, Le mariage en
Occident. Les m urs et le droit, Paris, 1987, p. 231.
498
B. JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
87. Cf. Fulgence de Ruspe, De fide adPetrum (Fulgentii episcopi Ruspensis opera, J. Fraipont ?d. [CCSL 91A], Turnhout, 1968, pp. 709-760, p. 735, lignes 1247-1253) : ?Firmisse tene et nulla
tenus dubites, [...]p?rvulos, quisiue in uteris matrum uiuire incipiunt et ibi moriuntur [...], ignis aeterni sempiterno supplicio puniendos ?, voir, sur ce point, J. J. Gavigan, ?Fulgentius of Ruspe on baptism ?, dans Traditio 5, 1947, pp. 313-322.
88. Dans la prescription d'ouvrir le ventre d'une femme enceinte d?c?d?e pour sauver l'enfant
comme par exemple dans le Synodal de N?mes, de 1254, op. cit., c. 19, p. 282, o? il est express? ment mentionn? que les la?cs ne le faisaient manifestement pas de leur plein gr? ; Jean Gerson vou
lait que l'on contr?l?t lors des visites pastorales l'application de cette r?gle, alors qu'il ne dit rien
par exemple du non respect des r?gles de l'inceste, cf. J. Gerson, De visitatione praelatorum
(L' uvre spirituelle et pastorale), [Oeuvres compl?tes t. 8], Paris-Tournai, 1971, p. 51 : ?Item si
morientes in puerperio aperiuntur ut infans vivus recipiatur et baptizetur?.
89. Voir la pr?sentation r?sum?e donn?e par P. Johanek, ? Die Pariser Statuten des Odo von
Sully und die Anf?nge der kirchlichen Statutengesetzgebung in Deutschland ?, Proceedings of the
seventh international Congress of medieval canon law, P. Linehan ?d., [Monumenta iuris cano
nici, Series C. : Subsidia 8], Rome, 1988, pp. 327-347.
90. Cf., Statuts de Paris, op. cit., c. 7, p. 54; de m?me le Synodal de l'Ouest, op. cit., c. 4,
pp. 140-142 ; Statuts de Sisteron, op. cit., c. 4, p. 188 ; A Ibi, op. cit., c. 31, p. 18 ; Bordeaux, op.
cit., c. 2, p. 45 ; le recueil des statuts de Pierre de Sampson, largement r?pandu, est particuli?re ment explicite, N?mes, op. cit., c. 9. 10, pp. 274-276; Jean Gerson (De visitatione praelatarum,
op. cit.) voulait lors des visites paroissiales ? interroger et enseigner les sages-femmes ?.
91. Cf. Statuts de Canterbury, de 1214, c. 36, C. R. Cheney ?d. (Councils and synods with
other documents relating to the English Church, 2, 1 a. d. 1205-1265, Oxford, 1964, p. 35);
Synodal de N?mes, op. cit., de 1252 (= Pierre de Sampson), c. 18, O. Pontal ?d., op. cit., t. 2,
pp. 280-282.
92. Cf. Concile de Chal?n, en 813, c. 31 (Concilia aevi Karolini 1. 1., A. Werminghoff ?d.,
[MGH Concilia 2.1], Hanovre-Leipzig, 1906, p. 279): Dictum etiam nobis est quasdam feminas
desidiose, quasdam vero fraudulenter, ut a viris suis separentur, proprios filios coram episcopis ad
confirmandum tenuisse. Unde nos dignum duxit, ut, si qua mulier filium suum desidia aut fraude
aliqua coram episcopo ad confirmandum tenuerit, propter fallatiam suam paenitentiam agat, a
viro tarnen suo non separatur; d'apr?s une histoire extraite du Liber historiae Francorum 31 A,
(Fredegarii et aliorum chronica. Vitae sanctorum, B. Krusch ?d. [MGH SS rer. Merov. 2],
Hanovre, 1888, pp. 215-328, p. 29227-29331), le roi Chilp?ric a pu se s?parer de sa femme Audo
v?re, parce que celle-ci, gr?ce ? une ruse de Fr?d?gonde, a tenu son propre fils sur les fonts baptis maux ; Hincmar dut une fois trancher dans un proc?s dans lequel on reprochait ? un noble nomm?
Etienne de refuser de consommer son mariage. Etienne se r?f?ra au fait qu'il avait eu auparavant
comme concubine une parente de son ?pouse et qu'il craignait de ce fait de commettre un inceste,
cf. Hincmar, ep. 136 (Hincmari archiepiscopiRemensisepistolae, ?. Perels ?d., [MGH Epp. 8],
Berlin 1939, pp. 87-107) ; sur ce point, voir J. D?visse, Hincmar. Archev?que de Reims 845-882,
t. 1, Gen?ve, 1975, pp. 432-436; Dans le Decretum Gratiani C. XXX, ?. Friedberg ?d., [Corpus
iuris canonici 1, ?. Friedberg ?d.], Leipzig, 1879, col. 1095, il y a un cas tr?s compliqu? dans
lequel, entre autres, une femme rou?e (callide) voulait tenir son propre fils sur les fonts baptis maux ; Pierre le Chantre (Summa desacramentis et animae consiliis3, 2 ? 334, J.-A. Dugauquier
?d., [Analecta mediaevalia Namurcensia 16], Louvain-Lille, 1963, p. 404) s'occupe d'un cas dans
lequel un p?re refuse une demande de parrainage, avec l'argument selon lequel le demandeur est
d?j? le parrain d'un enfant (d?c?d?), et qu'un nouveau parrainage est donc un inceste. S'il se peut
que certains de ces cas soient plut?t le produit de l'art raffin? des experts, l'exemple d'Etienne, la
tradition concernant Fr?d?gonde, ainsi que la formulation du concile de Chal?n permettent cepen
dant de conclure ? un ? savoir ? correspondant chez les la?cs.
93. Cf. Synodal de N?mes, etc., c. 4, O. Pontal ?d., op. cit., t. 2, p. 270.
94. Synodal de l'Ouest, op. cit., c. 4, O. Pontal ?d., t. 1, p. 141 ; m?me lorsqu'un recueil
comme celui de Sisteron, c. 4, O. Pontal ?d., op. cit., t. 2, r?clame la d?nomination, il reste tou
jours assez d'actes rituels qui peuvent ?tre accomplis apr?s le bapt?me avec les parrains et le pr?tre.
95. Jean Gerson, De visitatione praelatorum, op. cit., p. 49.
96. Voir Synodal de N?mes, etc., chap. 6, O. Pontal ?d., op. cit., t. 2, p. 272.
499
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
97. Sur la d?nomination comme innovation gallicane dans le rite du bapt?me, cf. B. Jussen,
Patenschaft, op. cit., pp. 238-242.
98. Cf. J. Lynch, Godparents, op. cit., pp. 211-213.
99. Tertullien s'?tait encore prononc? contre un bapt?me dans ?l'?ge de l'innocence?, cf.
Tertullien, De baptismo, 18, 5, J.G.Ph. Borleffs ?d. (Quinti Septimi Florentis Tertulliani
opera, t. 1 [CCSL], Turnhout, 1954, pp. 275-295, p. 2932932) ; une g?n?ration plus tard, les ?v?ques
discutaient d?j? en terme de jours ; Cyprien, Ep. 64, 2 (S. Thasci Caecili Cypriani opera omnia,
t. 2, W. H artel ?d., [CSEL 3.2], Vienne, 1871, p. 718) rapporte ? propos d'un synode: ?
Quantum vero ad causam infantium pertinet, quos dixisti intra secundum vel tertium diem quam
nati sint constituios baptizan non opportere et consid?randam esse legem circumcisionis antiquae,
ut intra octauum diem eum qui natus est baptizandum et sanctificandum non putares: longe aliud
in concilio nostro uisum est. In hoc enim quod tu putabas esse faciendum nemo consensit, sed
uniuersi potius iudicauimus nulli hominum nato misericordiam Dei et gratiam denegandam ?. Il
suffit de rappeler le bapt?me de Constantin sur son lit de mort ; cf. supra, n. 18, les exemples m?ro
vingiens.
100. Ainsi dans le Synodal de N?mes (= Pierre de Sampson), c. 9, O. Pontal ?d., op. cit., t. 2,
p. 274; voir pareillement les Statuts d'Albi, c. 32, op. cit., p. 18; Synodal de l'Ouest, c. 4,
O. Pontal ?d., op. cit., p. 142.
101. E. Le Roy Ladurie, Montaillou. Village occitan de 1294 ? 1324, Paris, 1975, p. 260. Cf.
aussi par exemple, ibid., pp. 176, 251, 310, 501.
102. Sur Pierre Guilhem, voir Le registre d'inquisition de Jacques Fournier, ?v?que de
Pamiers (1318-1325), J. Duvernoy ?d., 3 vols, Toulouse, 1965, t. 3, p. 335 ; trad. fr. : Le registre
d'inquisition de Jacques Fournier (?v?que de Pamiers), 1318-1325, J. Duvernoy ?d., 3 vols, Paris
La Haye-New York, 1978, t. 3, p. 1191 ; sur Guillaume Escaunier, ibid., t. 2, p. 9 ; trad, fr., t. 2,
pp. 555-556 ; sur B?libaste, ibid., t. 3, p. 209 ; trad, fr., t. 3, p. 988 ; sur Pierre Maury, ibid., t. 3,
p. 185 ; trad., t. 3, p. 971 ; sur Pierre Clergue, ibid., t. 1, p. 253, trad, fr., t. 1, p. 293.
103. Cf. supra n. 2; quelques exemples: Jean Diacre, Cr?nica Veneziana, (Cronache vene
ziane antichissime, t. 1, G. Monticolo ?d., [Fond per la storia d'Italia, 9], Rome, 1890, pp. 57-171,
p. 11611) : ?ad dilectionis seu pacis vinculum corroborandum ? ; Chronica S. P?tri ?rfordensis
moderna ad a. 1127, (Monumenta Erphesfurtensia saec. XII. XIII. XIV, O. Holder Egger ?d.,
[MGH SS rer. Germ. 42], Hanovre, 1899, pp. 153-206, voir p. 16518/19): ?Rex Lotharius apud
Marseburg penthecosten celebrans Udalricum ducem Boemorum in amiciciam recepit et f ilium
eius de sacro fonte baptismatis suscepit?; Vita Faronis episcopi Meldensis 22, J. Mabillon ?d.
(Acta sanctorum Ordinis sancti Benedicti, t. 2, Paris, 1669 [repr. 1938], pp. 606-625, voir p. 613) :
?pro pacto amicitiae f ilium Chilperici Regis a sacro fonte suscipiens, Baptismatis novus regene
rator efficeretur ? ; un exemple irlandais, o? ce sont toujours ceux qui baptisent qui tiennent le r?le
habituellement d?volu aux parrains : Vita sancti Declani episcopi de Ard Mor 5 (Vitae sanctorum
Hiberniae, t. 2, C. Plummer ?d., Oxford, 1910, pp. 32-59, voir p. 37): ?Colmanus baptizauit
sanctissimum infantulum, Declanum nomen ei imponens. Et post baptismum ait [...] Et il?cito fra
ternitatem tecum habebo, et commendo mesanctitate tue?.
104. On en trouve un exemple dans le Registre, J. Duvernoy ?d., op. cit., t. 3, p. 362 ; trad,
fr., p. 1124.
105. C'est le th?me principal de l'ouvrage d'A. Angenendt, Kaiserherrschaft, op. cit. ; ? titre
d'exemple, on peut citer le parrainage qu'exer?ait le roi de Mercie Wulfhere sur Aethelwealh de
Sussex, cit? d'apr?s Bede, Historia ecclesiastica gentis Anglorum ?
Beda der Ehrw?rdige, Kir
chengeschichte des englischen Volkes IV, 34, 2 vols, G. Spitzbart ?d. (Texte der Forschung, 34),
Darmstadt, 1982, p. 356 : ? a quo etiam egressus de fonte loco filii susceptus est; in cuius signum
adoptionis duas Uli provincias donauit, Uectam uidelicet insulam et Meanuarorum prouinciam in
gente Occidentalium Saxonum ?.
106. Annales Fuldenses sive annales regni Francorum orientalis a. 864-882, G.H. Pertz et
F. Kurze (MGH SS rer. Germ. 7, Hanovre, 1891, pp. 1-107, voir p. 99): ?Sed Imperator [...]
Gotafridum de fonte baptismatis levavit et, quem maximum inimicum de desertorem regni sui
habuerat, consortem regni constituit. Nam comitatus et beneficia, quae Rorich Nordmannus Fran
corum regibus fidelis in Kinnin tenuerat, eidem hosti suisque hominibus ad inhabitandum dele
gavit?; Annalium Fuldensium continuado Ratisbonensis a. 882, ibid., p. 108 : ? Duos ibi dies laeti
insimul versabant, turn remissis nostris obsidibus de munitione ipse e contrario cum maximis
500
B. JUSSEN LE PARRAINAGE M?DI?VAL
muneribus remissus ad sua. Mu?era autem talia erant : in auro et argento duo mille libras et
LXXX vel paulo plus ; quam libra XX solidos computamus expletam ? ; sur ce point, cf. A. Ange
nendt, Kaiserherrschaft, op. cit., pp. 260-262 et B. Jussen, Patenschaft, op. cit., pp. 285-286.
107. Die Patenschaft bei Gregor von Tours, libri historiarum X, 28, B. Krusch et W. Levison
?ds (MGH SS rer. Merov. 1, 1), Hanovre, 19512, pp. 520-522 ; l'interpr?tation de Childebert, ibid.,
X, 28, p. 52189; on trouvera une analyse pr?cise de ce cas tr?s riche du point de vue de l'histoire
sociale dans B. Jussen, Patenschaft, op. cit., pp. 229-270.
108. VitaDeclani, t. 5, op. cit.
109. Registre, J. Duvernoy ?d., op. cit., t. 3, p. 209 ; trad, fr., t. 3, p. 988 ; sur la mani?re de
vivre de Pierre Maury, cf. E. Le Roy Ladurie, Montaillou, op. cit., pp. 119-132.
110. Registre, J. Duvernoy ?d., op. cit., t. 3, p. 307; trad, fr., t. 3, pp. 1165-1166. Ce passage
est plut?t n?buleux, car les parrains n'avaient en fait aucune place dans la c?r?monie du bapt?me
cathare; c'est peut ?tre la raison pour laquelle Authi?, comme cet informateur le mentionne
express?ment, a expliqu? ce qu'?tait une aum?ne juste ?
celle faite ? un h?r?tique ?
mais pas
pour quel parrainage il y a du m?rite.
111. Registre, J. Duvernoy ?d., op. cit., t. 3, p. 185 ; trad, fr., t. 3, p. 971.
112. Le fait que B?libaste pr?tende que Pierre Maury avait aussi baptis? est curieux : ni la doc
trine catholique ni la doctrine cathare, telle qu'on la pr?sentait g?n?ralement, ne le permettaient, si
on exclut le bapt?me d'urgence, impr?visible et donc peu utile socialement ; il n'y en a d'ailleurs
aucune preuve.
113. Cf. Registre, J. Duvernoy ?d., op. cit., t. 3, p. 243; sur la valeur des moutons, voir
M. Benad ?d., Domus, op. cit., pp. 277-278. Sur l'?ventail des cadeaux imaginables, cf. supra,
n. 12.
114. Cf. Registre, J. Duvernoy, op. cit., t. 3, p. 268 ; trad, fr., t. 1, p. 1141.
115. Ibid., p. 243; trad, fr., p. 1015..
116. A propos de Plan?zes, Guillaume Maurs parle deux fois d'? un de ses comp?res (cuidam/
cuidem compatri) ? ; ? propos de Flix, Guillaume Maurs rapporte que Pierre y avait ? beaucoup
[multos] de comp?res?; cf. Registre, J. Duvernoy ?d., op. cit., t. 2, pp. 175-177; trad, fr., t. 3,
pp. 806-807.
117. A un autre endroit, Pierre Maury a plus clairement indiqu? cet aspect de formalisation et
d'intensification d'amiti?s d?j? existantes par la formule: ?per compaternitas homo acquirat
maiores amicicias?, Registre, J. Duvernoy ?d., op. cit., t. 3, p. 228; ?galement, ibid., p. 243.
118. Cf. supra n. 109. Les conteurs permettent parfois de reconna?tre cet aspect: le p?re de
Guillaume de Dijon fut ainsi cens? avoir ? amen? ? l'empereur Otton 1er ? devenir le parrain de son
fils ? parce qu'il avait ?t? intelligent et r?solu ? ; cf. Rodolphus Glaber, Vita domni Willelmi
abbat is. Nouvelle ?dition d'apr?s un manuscrit du xie si?cle, Paris, Biblioth?que Nationale, lat.
5390, N. Bulst ?d. (DA 30, 1974, pp. 450-487, voir p. 464) : ? Tune quoque isdem Rotbertus, ut
erat vir prudens ac strenuus, suggessit impera tori, ut filium, quem ei uxor sua [...] peperat, catecu
minum fieri per manum imperialem preciperet. Quod Ule libenter annuens [...]?.
119. On trouvera une analyse d?taill?e de ces pratiques sur la base des r?cits de Gr?goire de
Tours et des vies de saints du Haut Moyen Age dans B. Jussen, Patenschaft, op. cit., notamment
pp. 271-311.
120. Le fait qu'il avait peut-?tre un fils ressort du Registre, J. Duvernoy ?d., op. cit., t. 3,
p. 191 ; cf. M. Benad, Domus, op. cit., p. 298.
121. Sur la farine, cf. Registre, J. Duvernoy, op. cit., t. 2, p. 176 ; sur l'habillement des h?r?
tiques, ibid., t. 2, p. 38.
122. Cf. Registre, J. Duvernoy, op. cit., t. 2, p. 69 : Pierre Maury et Arnaud Sicre payent la
f?te de No?l pour B?libaste et sa concubine Raymonde.
123. Sur ce point, cf. B. Jussen, Patenschaft, op. cit., pp. 216-211 et 299-301, cf. note 150.
124. Voir la description du bapt?me cathare donn?e par J. Duvernoy, Le catharisme, t. 1, La
religion des cathares, Paris, 1976, pp. 143-170.
125. Cf. Registre, J. Duvernoy ?d., op. cit., t. 3, p. 307 ; trad, fr., t. 3, p. 1165.
501
LES PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ?GE
126. Je reprends ici chaque fois l'appr?ciation du statut social donn?e par E. Le Roy Ladurie.
127. Cf. Registre, J. Duvernoy ?d., op. cit., t. 1, p. 253 ; trad, fr., t. 1, p. 293.
128. Ibid., t. 2, p. 224; trad, fr., t. 2, p. 480.
129. Cf. E. Le Roy Ladurie, Montaillou, op. cit., p. 378.
130. Voir Registre, J. Duvernoy ?d., op. cit., t. 3, p. 160; trad, fr., t. 3, p. 952.
131. Ibid., t. 2, p. 177; trad, fr., t. 3, p. 807.
132. Ibid., t. 2, p. 209; trad, fr., t. 3*, p. 988.
133. Ibid., t. 2, p. 194; trad, fr., t. 3, p. 978.
134. Ibid., t. 2, p. 487 ; trad, fr., t. 3, p. 883.
135. Ibid., t. 3, p. 160; trad, fr., t. 3, p. 952.
136. Ibid., t. 2, p. 175 ; trad, fr., t. 3, p. 806.
137. Ibid., t. 2, p. 30; trad, fr., t. 3, pp. 758-759; ibid., t. 2, p. 175 ; trad, fr., t. 3, p. 806.
138. Ibid., t. 2, p. 175 ; trad, fr., t. 3, p. 806.
139. Ibid., t. 2, p. 9 ; trad, fr., t. 2, p. 555.
140. Voir par exemple A. Guerreau-Jalabert, ? Sur les structures de parent? dans l'Europe
m?di?vale?, Annales ESC, 36, 1981, pp. 1028-1049, qui souligne p. 1038 qu'il n'existe pas de rela
tion avunculaire.
141. Cf. Registre, J. Duvernoy ?d., op. cit., t. 2, p. 10; trad, fr., t. 2, p. 556.
142. Cf. supra n. 133.
143. M. Benad, Domus, op. cit., p. 94, n. 21, a attir?, ? juste titre, l'attention sur le fait que
cette compaternit? peut aussi d?signer la relation entre celui qui baptisait et les parents. Mais que
cela puisse signifier ici ? ami intime?, tout ? fait ind?pendamment d'une constitution rituelle, ne
me para?t pas vraisemblable faute de preuve indiscutable. Dans une de ses histoires (Decameron,
septi?me jour, troisi?me histoire), Boccace a explicit? cette technique de la d?signation ? conve
nable? d'une liaison amoureuse.
144. Synodal de N?mes, O. Pontal ?d., op. cit., c. 154, p. 384.
145. Cf. supra, n. 103.
146. L. Febvre, ?Comment reconstituer la vie affective d'autrefois? La sensibilit? et l'his
toire?, Annales d'Histoire sociale, 3, 1941 (repr. id., Combats pour r Histoire, Paris, 1965,
pp. 221-239, voir pp. 223-224), voir aussi N. Luhmann, Soziale Systeme. Grundriss einer all
gemeinen Theorie, Francfort-sur-le Main, 1984, notamment p. 253.
147. Cf. H. Medick et D. Sabean, Emotionen und materielle Interessen in Familie und Ver
wandtschaft, op. cit., pp. 21 SA.
148. Cf. Formulae Turonenses, op. cit., n? 25, p. 1496/7: ?Pactum inter parentes. Caritatis
studio et dilectionis affectu inter propinquos decet?; d'apr?s cette r?flexion, il n'est pas utile de
d?clarer la caritas ?moins empreinte de sentiment? parce qu'elle est une ?norme objective de
comportement? (comme le fait R. Schneider, Br?dergemeinde, op. cit., p. 119); il se peut au
contraire que son effet stabilisateur r?side dans le fait qu'elle a l'un et l'autre trait en m?me temps.
149. D?finition de N. Luhmann, System, op. cit., p. 319 qui me semble ?galement acceptable
dans le contexte d'autres m?thodes sociologiques que celles utilis?es par N. Luhmann.
150. Cf. Vita Trudonis, op. cit., c. 19, p. 290: ?quidam vir religiosus nomine Godmundus,
cuius etiam f ilium vir Dei a sacro fonte susceperat, postulavit ab eo, ut domum suum visitaret, ut
sua etiam benedictione consecraret ? ; Vita Fidoli, op. cit., c. 10, p. 43031-33 : ? Praemissa postu
latione, ut domum ipsius visitaret unici obtinuit caritas. In cuius nomine fides integra lagenam meri vini uberius servaverat plena ? ; sur la fa?on dont Pierre Maury entretient son r?seau de rela
tions de parrainages, cf. supra, notes 115-121.
151. P. Bourdieu, Le sens pratique, op. cit., p. 219.
152. Cf. supra, n. 103.
502