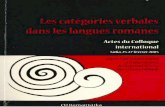Entre la cour et la ville. Les gens de savoir au service de l’empereur Charles IV à Prague
" La nature du savoir sociologique : considérations sur la conception wébérienne " (2006...
-
Upload
univ-bordeaux -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of " La nature du savoir sociologique : considérations sur la conception wébérienne " (2006...
LA NATURE DU SAVOIR SOCIOLOGIQUE :
CONSIDÉRATIONS SUR LA CONCEPTION WEBERIENNE.
Paru in L’Année sociologique, 2006, vol. 56/2, pp. 369-388.
Quels sont les effets cognitifs de l’abstraction scientifique dans le domaine
de la sociologie1 ? Il n’est évidemment pas question, ici, de réitérer une enquête
maintes fois effectuée et, moins encore, de trancher entre les différentes réponses
apportées à chaque fois. On voudrait seulement (et c’est déjà d’une ambition sans
doute excessive) faire retour sur la conception weberienne dans ce domaine. La
démarche d’abstraction est en effet centrale dans la méthodologie weberienne,
dans la mesure où son auteur affirme, d'une part, que l’objet sociologique (à
l’instar de tout objet scientifique) n’est jamais « donné » au chercheur qui doit le
constituer à partir d’un matériau empirique essentiellement chaotique et
insignifiant et, d'autre part, que cet objet n’est pas autre chose que des
significations collectives qui ne peuvent elles-mêmes être appréhendées qu’à
partir des significations qu’elles ont pour l’observateur, le sociologue.
On abordera ici deux questions : celle, d'une part, de la nature de l’objet
sociologique tel que celui-ci ressort de la méthodologie weberienne, et celle,
d'autre part, de la nature du savoir produit par la même méthodologie à propos de
cet objet. Dans un dernier temps, on montrera, à travers un exemple choisi dans
la littérature sociologique contemporaine, les fourvoiements qui menacent un
usage mal contrôlé de cette méthodologie. Signalons enfin que le choix d’un abord
des Essais sur la théorie de la science par ce qu’ils ne sont pas principalement –
c'est-à-dire une méthodologie – permettra peut-être d’éviter de s’enliser dans les
apories épistémologiques souvent suscitées par un texte difficile et parfois obscur.
I – Weber insiste avec force sur le caractère « empirique » des disciplines
scientifiques qu’il subsume sous le nom de science sociale [Sozialwissenschaft].
1 Cet article reprend et développe le texte d’une communication faite lors du Colloque organisé sur le thème « L’explication en sociologie : quels sont les niveaux d’abstraction légitime ? » par l’Université de Nancy 2, les 17, 18 et 19 octobre 2005.
2
Celle-ci ne peut admettre comme objet que des phénomènes empiriques, et tant
leur explication que la validation de cette explication doivent être empiriquement
fondées. Il s’agit pour lui, à l’évidence, de soustraire les sciences sociales et, plus
généralement, les « sciences de la culture » à des fondements purement
conceptuels, à la pure spéculation interprétative, aux jugements de valeurs et
aux vaticinations socio-politiques. Bref, selon les mots mêmes de Weber, « la
science que nous pratiquons est une science de la réalité
[Wirklichkeitswissenschaft] » 2 – tout le reste n’étant qu’ « exercices à base de
concepts collectifs dont le spectre rôde toujours » faute de procéder directement
de l’action d’ « individus singuliers » [Einzelnen] 3.
Pour ce faire, le matériau ne manque pas. Il serait même surabondant dans
la mesure où il est constitué d’une infinité de conduites humaines (physiques et
morales) et des objets (matériels et symboliques) qui en résultent. Ces
« événements » discontinus, diversifiés à l’extrême et perpétuellement produits et
reproduits (« une diversité absolument infinie de coexistences et de successions
d’événements qui apparaissent et disparaissent » 4) sont dépourvus du moindre
principe d’organisation interne et, donc, de sens intrinsèque. La réalité sociale
empirique, décrite poétiquement par Weber comme un « chaos » traversé par le
« flux du devenir », est donc incapable d’offrir au sociologue des objets
substantiels. La seule réalité immédiatement objectivable est celle d’actions
individuelles qui produisent un monde social bien réel mais qui ne se laisse pas
classifier ou spécifier de manière univoque et stable. En d’autres termes, le sens
propre du monde social (pas plus, d’ailleurs, que celui du monde « naturel ») n’est
2 WEBER Max, « L’objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales » (1904), Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1965, p. 152. Voir aussi : « Le point de départ de l’intérêt que nous portons aux sciences sociales est indubitablement la configuration réelle, donc singulière de la vie culturelle et sociale qui nous environne (…). », Ibid., p. 155, souligné dans le texte.
3 « [s]i, au bout du compte, je suis moi-même devenu sociologue (…), c'est essentiellement pour mettre un terme à la pratique qui hante encore les lieux et qui consiste à travailler avec des concepts de collectifs [Kollektivbegriffe]. En d'autres termes, la sociologie, elle aussi, ne peut se pratiquer qu’en partant de l’action d'un, de plusieurs ou d’un grand nombre d’individus, par conséquent de manière strictement ‘individualiste’ quant à la méthode. » in « Max Weber à Robert Liefmann (lettre du 9.03.1920, traduite par J.-P. Grossein) », Revue française de sociologie, 46-4, 2005, p. 923 (souligné dans le texte).
4 WEBER Max, Op. cit., p. 153.
3
ni donné ni à découvrir – ou, plus exactement, est en permanence produit par les
acteurs sociaux qui le découvrent en même temps qu’ils le construisent. Les faits
sociaux ne sont pas des champignons que l’on rencontre sous ses pas et que l’on
cueille, ou que l’on peut découvrir si on sait les chercher. S’ils ont bien une
existence a priori, c'est-à-dire extérieure au chercheur, ils sont dépourvus des
signes d’identification qui permettraient de les reconnaître – comme chez
Durkheim, par exemple, avec le double critère de l’extériorité et de la contrainte5.
Le sociologue weberien se trouve donc face à une réalité sociale qui n’a pas
de signification intrinsèque et qui, de ce fait, ne peut lui offrir spontanément ni
objet ni problématique. Il n’existe pas de phénomènes sociaux qui s’imposent
immédiatement à son observation et à son investigation. Pourtant, s’il se livre
nonobstant à l’activité sociologique, c’est bien parce qu’il est parvenu à constituer
l’objet de cette activité selon un principe subjectif – parce qu’il a pu introduire un
ordre quelconque dans le « chaos ».
Le sociologue (mais c’est également vrai de l’historien ou de l’économiste)
est en effet animé par ce que Weber appelle des « intérêts de connaissance »
[Erkenntnisinteresse] 6, c'est-à-dire qu’il est porteur d’une demande cognitive qui
reflète des enjeux personnels ou, le plus souvent, collectifs – pour un groupe
social donné, à une époque donnée et dans un lieu donné. Ces enjeux sont
évidemment fonction d’un « rapport aux valeurs » [Wertbeziehung] particulier du
sociologue et d’une partie de ses contemporains, rapport qui définit et hiérarchise
les objectifs de toute représentation et de toute conduite sociales. La réalité
sociale n’est donc pas vraiment muette ; disons plutôt qu’elle ne sait s’exprimer
que dans le langage de son observateur. Et c’est, comme on le sait, en
sélectionnant parmi l’infinité d’évènements qui s’offrent à lui ceux qui, seuls, ont
pour lui (ou ses commanditaires) une « signification culturelle » 7, que ce dernier
va définir son objet d’étude – et ce de manière totalement arbitraire.
5 DURKHEIM Émile, Les Règles de la méthode sociologique [1895], Paris, P.U.F., 1995.
6 WEBER Max, Op. cit., p. 140.
7 « La réalité empirique est culture à nos yeux parce que et en tant que nous la rapportons à des idées de valeurs, elle embrasse les éléments de la réalité et exclusivement cette sorte d’éléments qui acquièrent une signification pour nous par ce rapport aux valeurs. », Ibid., p. 159, souligné dans le texte.
4
Weber nous rappelle donc – et c’est un point essentiel – qu’il n’y a pas
d’objet sociologique (ou historique) sans problématique socio-culturelle donnée.
Et ce rappel va bien au-delà de la prescription bachelardienne de construction de
l’objet, voire du perspectivisme saussurien. Cette problématique, le sociologue la
projette en quelque sorte sur le monde socio-historique, et c’est cette projection
qui va permettre de révéler les phénomènes sociaux qui vont constituer ses objets
théoriques. Dans une telle perspective, la distinction habituelle entre l’objet et la
problématique de recherche devient sans grande pertinence : l’objet n’est pas
construit indépendamment de la question qui lui est posée. (On constatera au
passage que cette opération de constitution de l’objet n’est nullement inductive,
qu’elle ne crée pas cet objet à partir du donné empirique mais bien à partir d’une
question – celle qui naît d’un rapport aux valeurs et, donc, d’un intérêt de
connaissance spécifiques chez le sociologue.) C’est ainsi que des éléments a priori
insignifiants et discontinus de la réalité sociale sont sélectionnés puis assemblés
pour constituer un ensemble phénoménal significatif – qu’il s’agisse du
catholicisme médiéval, de l’artisanat urbain ou de la domination charismatique,
toutes entités qui n’ont évidemment pas d’autre réalité que celle que le chercheur
leur confère à titre temporaire et pour satisfaire son « intérêt de connaissance »
tant sur le plan intellectuel que sur le plan culturel.
La question qui se pose ici est celle de la nature exacte de l’objet ainsi
construit. Cette construction est-elle, d’un point de vue empirique, totalement
arbitraire – « subjective » – ou bien a-t-elle aussi une base objective et laquelle ?
La méthode weberienne est-elle, comme on a pu le prétendre parfois 8 en
l’opposant radicalement au positivisme, un nominalisme absolu ?
Une lecture trop rapide des Essais sur la théorie de la science pourrait
laisser penser que, pour utiliser une formule célèbre, le sociologue « ne s’autorise
que de lui-même » lorsqu’il construit son objet en sélectionnant puis en
assemblant des éléments épars et individuellement non significatifs d’une réalité
empirique totalement amorphe. Weber n’écrit-il pas lui-même que « ce qui devient
objet de recherche ainsi que les limites de cette recherche au sein de l’infinité des
8 GURVITCH Georges, Traité de Sociologie/I, Paris, P.U.F., 1962, en part. pp. 15 et 58.
5
connexions causales, ce sont les idées de valeurs dominant le savant et une époque
qui les déterminent » 9 ? Mais, dans le même temps, ne serait-ce pas négliger la
définition donnée plus tard de la sociologie dans Économie et société, selon
laquelle la vocation de cette discipline est l’étude des régularités sociales10 ?
Malgré l’irréductible insignifiance du donné empirique, Weber a bien le
sentiment que les intérêts et les valeurs du sociologue ne peuvent pas constituer
le seul et unique principe d’organisation de ce chaos. S’il est vrai que la condition
pour qu’un phénomène social soit tenu pour un objet de recherche légitime est
qu’il revête une « signification culturelle » pour le sociologue (ou, c’est souvent la
même chose, pour certains de ses contemporains), cette signification ne peut pas
reposer sur les seules valeurs signifiées : elle doit aussi renvoyer à un objet
signifiant ! Dans le cas contraire, l’objectivation sociologique se réduirait à pure
herméneutique close, ou encore à un solipsisme, un peu comme la lecture dans
du marc de café. En d’autres termes, il faut, pour décider du caractère
culturellement significatif d’un phénomène social, que ce phénomène ait été
préalablement identifié.
Weber reconnaît sans difficulté que, à l’instar de ce qui se pratique dans les
sciences naturelles ainsi que chez les tenants d’une sociologie positiviste, il est
parfaitement légitime de rechercher inductivement des régularités empiriques
dans le but d’ordonner le chaos empirique à travers des « lois » de divers types. Il
est d’ailleurs pleinement favorable – il le répète à l’envi – à la conquête de cette
« connaissance nomologique » 11 qui s’avèrera indispensable au sociologue à la
9 WEBER Max, Op. cit., p. 171, c’est nous qui soulignons. Voir également : « On ne saurait jamais déduire d’une étude sans présuppositions […] du donné empirique ce qui prend à nos yeux une signification. Au contraire la constatation de cette signification est la présupposition qui fait que quelque chose devient objet de l’investigation. », Ibid., p. 160, souligné dans le texte. Ou encore : « La qualité d’un événement qui nous le fait considérer comme un phénomène ‘social et économique’ n’est pas un attribut qui, comme tel, lui est ‘objectivement’ inhérent. Elle se laisse plutôt déterminer par la direction de l’intérêt de notre connaissance telle qu’elle résulte de l’importance culturelle spécifique que nous accordons à l’événement en question dans le cas particulier. », Ibid., p. 140, souligné dans le texte.
10 « La sociologie […] élabore des concepts de types et elle est en quête de règles générales du devenir. Elle s'oppose à l'histoire qui a pour objet l'analyse et l'imputation causale d'actes, de structures et de personnalités individuelles, culturellement importantes. » (WEBER Max, Économie et société/I [1920], Paris, Plon (« Agora »), 1995, T. I, p. 48, souligné dans le texte.)
11 Par exemple : « (…) il n’est, en général, pas possible de faire une imputation valable d’une conséquence singulière quelconque sans le secours de la connaissance ‘nomologique’, c'est-à-dire
6
fois pour la formulation de ses hypothèses et pour conduire la phase probatoire
de l’explication. Il n’y a donc, de sa part, aucune forme de proscription
nomothétique ; il n’y a que l’affirmation constante de l’insuffisance de la seule
explication (déductive-)nomologique dans une domaine de la réalité où l’on peut –
par une démarche « compréhensive » – remonter non seulement à des conduites
mais aussi à leurs « motifs », c'est-à-dire à certaines de leurs causes12.
Mais il y a plus encore. Il semble en effet, à bien le lire, que Weber situe le
travail nomothétique à l’origine même du processus de constitution de l’objet
sociologique. Cela apparaît clairement lorsqu’il écrit que le but de la sociologie est
« la connaissance de la signification culturelle et des rapports de causalité de la
réalité concrète, grâce à des recherches portant sur ce qui se répète conformément à
des lois »13. C’est peut-être parce que Weber aborde toujours la question des
« lois » de façon négative (pour affirmer qu’elles ne sont pas le « but » mais
seulement un « moyen » de la recherche sociologique14) que l’on a généralement
négligé ces passages où il affirme clairement que c’est bien l’observation de
régularités empiriques qui est au commencement de l’entreprise sociologique. Il
en est ainsi dans la phrase suivante qui prend tout son sens méthodologique si
l’on en supprime la forme restrictive : « L’établissement de ces ‘lois’ et ‘facteurs’
(hypothétiques) ne constituerait jamais que la première des multiples opérations
auxquelles nous conduirait la connaissance que nous nous efforçons
d’atteindre »15. Et c’est bien là, de fait, le protocole suivi par Weber dans L’Éthique
protestante et l’esprit du capitalisme dont le prologue est constitué par la mise en
sans la connaissance de régularités des connexions causales. » (WEBER Max, Essais sur la théorie de la science, Op. cit., p. 164, souligné dans le texte.)
12 On ne peut, à cet égard, que partager le jugement de Catherine COLLIOT-THÉLÈNE (in « Expliquer/comprendre : relecture d’une controverse », Espaces Temps, 2004 (84/85/86), pp. 6-23), selon lequel « […] il est urgent d’arracher définitivement son œuvre [celle de M. Weber] aux volontés annexionnistes de la philosophie herméneutique (voire de la phénoménologie quand celle-ci lie son sort à l’herméneutique) » (p. 15).
13 WEBER Max, Essais sur la théorie de la science, Op. cit., p.157, c’est nous qui soulignons la dernière partie de la phrase.
14 Ibid., p. 163.
15 Ibid., p. 158, souligné dans le texte.
7
évidence d’une corrélation positive entre appartenance à la religion protestante et
participation au monde industriel en Allemagne16.
Ainsi, si toute régularité empirique (qu’il désigne souvent par le terme très
large et évidemment abusif de « lois »17) ne constitue pas nécessairement un
phénomène social, tout phénomène social manifeste nécessairement une certaine
régularité empirique18. On pourrait, sur ce point, faire tenir la position de Weber
dans trois propositions : d'une part, tout phénomène social manifeste, ou s’inscrit
dans, une régularité empirique (sinon, il ne s’agit que d’un événement historique
singulier, ou encore d’une conduite non sociale) ; d’autre part, une telle régularité
empirique n’intéresse le sociologue que si elle revêt pour celui-ci, hic et nunc, une
« signification culturelle » ; enfin et surtout, aucune « loi » ne livrera jamais le sens
d’un phénomène social19 et, donc, aucune connaissance purement nomologique
ne peut permettre cette « compréhension » dans laquelle consiste et à laquelle vise
la démarche sociologique afin d’appréhender le « sens subjectivement visé » des
conduites sociales. (Le seul problème, pour le lecteur, est que Weber emploie le
même terme de « signification culturelle » [Kulturbedeutung] dans – au moins –
deux sens distincts : d'une part, l’intérêt culturel pour le sociologue et, d'autre
part, le sens de l’action des acteurs20 ; et ce n’est pas parce que les deux peuvent
facilement se rejoindre qu’il faut les confondre…)
C’est donc par une opération d’abstraction de nature sélective ou, mieux
encore, élective que le sociologue weberien détermine et constitue son objet
puisqu’il s’agit de désigner, parmi les événements empiriques de nature
16 WEBER Max, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme [1904-05], Paris, Gallimard, 2004.
17 Nous nous permettons de renvoyer à notre : CUIN Charles-Henry, « Esistono leggi sociologiche ? » in BORLANDI Massimo et SCIOLLA L. (Éd.), La Spiegazione sociologica. Metodi, tendenze, problemi, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 33-44.
18 Cette régularité ne provient pas, comme chez Durkheim, du caractère « institutionnalisé » de conduites « contraintes » par les mêmes normes mais, outre « l’usage » et « la coutume », de « l’intérêt mutuel » – c'est-à-dire d’ « une orientation purement rationnelle en finalité de l’activité des divers individus d’après des expectations similaires. » (WEBER Max, Économie et société, Op. cit., T. I, p. 62, souligné dans le texte.)
19 « La signification de la structure d’un phénomène culturel et le fondement de cette signification ne se laissent titrer d’aucun système de lois, si parfait soit-il, pas plus qu’ils n’y trouvent leur justification ou leur intelligibilité, car ils présupposent les rapport des phénomènes culturels à des idées de valeur [Beziehung auf Wertideen]. » (WEBER Max, Essais sur la théorie de la science, Op. cit., p. 159.)
8
hétérogène offerts à l’observation ceux qui présentent, tout à la fois, la régularité
d’une conduite collective et une importance culturelle directe ou indirecte pour
l’observateur. Il reste évidemment à savoir si ces régularités sont purement
empiriques ou si elles sont elles-mêmes constituées ex post. Dans une perspective
néo-kantienne, c’est très certainement la deuxième hypothèse qui est la bonne : il
n’existe de régularités que construites par l’observateur en fonction de ses
objectifs, de ses critères et des instruments d’observation et de mesure dont il
dispose. Sans doute existe-t-il bien, selon les lieux et les époques, certains
phénomènes collectifs empiriquement identifiables comme tels et dont l’objectivité
est indépendante de l’observateur. Il s’agit de ces entités socioculturelles
construites par les acteurs, de « représentations de quelque chose (…) qui flotte
dans la tête des hommes réels »21 et par lesquelles ils désignent à leur façon
certains produits de l’interaction sociale : l’État, la ville, la famille ou encore
l’Église catholique. Pourtant, le sociologue qui les prendrait, en l’état, comme
objet n’étudierait en fait que des « prénotions » durkheimiennes dont il pourrait
sans doute donner une description rigoureuse mais dont l’analyse ne livrerait
rien d’autre que l’état momentané des représentations collectives d’un groupe
social plus ou moins large. Or, toute la différence entre les ambitions respectives
d’un Durkheim et d’un Weber réside en ceci que, tandis que le premier cherche à
atteindre l’ « essence » de ce que le sens commun désigne comme un phénomène
social (par exemple, la « réalité » sociologique du châtiment, de l’éducation ou du
suicide, par opposition avec la définition « vulgaire » correspondante), le second
vise au contraire la signification de ces notions pour les acteurs qui les forgent et
les utilisent. En sorte que le sociologue weberien n’invalide pas ces
représentations spontanées dans la mesure où elles « orientent » les conduites
des acteurs22, mais reste particulièrement attentif au fait qu’elles ne constituent
pas nécessairement (et, à dire vrai, ne constituent que rarement) des effets
20 WEBER Max, « L’objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales », Op. cit. 21 WEBER Max, Économie et société/I, Op. cit., p. 42, souligné dans le texte.
22 « (…) ces structures comme telles ont une importance causale fort considérable, souvent même dominante, pour le déroulement de l’activité des hommes réels », Ibid., p. 42.
9
collectifs émergents de conduites « réelles » et qu’elles peuvent fort bien n’exister
en tant que phénomènes sociaux que « dans la tête » des acteurs23.
L’objet sociologique weberien possède donc des caractéristiques toutes
particulières. Il est évidemment, comme tout objet scientifique, un objet « virtuel »
mais qui, paradoxalement, n’a pas pour vocation d’être en correspondance avec la
réalité empirique et les objets « réels » qu’elle exhibe de façon discontinue et
insignifiante24. Sa sous-détermination empirique est très accentuée – non
seulement du fait de son caractère « générique » mais aussi et surtout parce qu’il
ne constitue pas, en fin de compte, le véritable objectif cognitif du chercheur. En
effet, ce dernier cherche moins, comme on va le voir, à « expliquer » un objet
empirique (c'est-à-dire à en appréhender l’essence) qu’à reconstituer un
processus historique particulier en lien avec cet objet (c'est-à-dire à répondre à
une question de type « pourquoi ? »).
II – Quelle est, maintenant, la nature du savoir sociologique produit ? Le
but du sociologue est bien, chez Weber, d’expliquer les phénomènes sociaux par
la signification subjective des conduites dont ils procèdent. Toutefois, si les
phénomènes sociaux sont bien le résultat émergent de ces conduites et si ces
conduites ont (presque) toujours un sens subjectif pour leurs acteurs, elles ne
procèdent ni toujours ni nécessairement de ce sens – pour des raisons
généreusement exposées par Weber, largement commentées et, donc, bien
connues – même si beaucoup d’analyses empiriques qui se prétendent
« compréhensives » n’en tiennent pas toujours compte…25 En outre, les acteurs
eux-mêmes ne sont pas toujours directement accessibles (c’est le cas auquel
l’historien se trouve généralement confronté). Enfin, les processus d’agrégation
dont résultent ces phénomènes leur confèrent souvent, pour des raisons bien
23 Par exemple, un État peut fort bien n’avoir plus d’existence que juridique, ou une règle morale n’avoir jamais été appliquée par quiconque.
24 Sur la distinction entre objet virtuel et objet réel, voir : GRANGER Gilles-Gaston, La Vérification, Paris, Odile Jacob, 1993.
25 Pour une développement de cette critique, voir : CUIN Charles-Henry, Ce que (ne) font (pas) les sociologues. Petit essai d’épistémologie critique, Genève, Librairie Droz, 2000 (en part. Chap. VI).
10
connues26, des caractéristiques relativement indépendantes de celles des
conduites dont ils résultent. Les phénomènes (macro-) sociaux ne sont donc pas
toujours immédiatement explicables – et ils le sont même fort rarement – par leur
sens subjectif.
C’est pour résoudre cette antinomie que Weber élabore la méthode de
l’« idéaltype » [Idealtypus] 27. Celui-ci n’est nullement un substitut conceptuel de
la réalité ou d’un de ses segments (d’une « chose » dirait Durkheim). Il est
essentiellement une image mentale possible du type de conduites collectives dont le
phénomène étudié est un produit. La méthode consiste, dans les cas les mieux
opérants, à construire le phénomène étudié comme s’il résultait de l’agrégation et
de l’enchaînement de conduites orientées par une « rationalité en finalité »
[Zweckrationalität] – pour la simple et bonne raison que ce type de conduite est le
plus aisément compréhensible de façon directe pour un observateur extérieur.
Mais, parce que l’on ne peut pas préjuger du sens « réel » des conduites
collectives, l’idéaltype doit être systématiquement comparé à la réalité empirique.
L’idéaltype, qui ne saurait constituer une hypothèse relative à la nature du
phénomène étudié, constitue donc plutôt un instrument permettant de faire des
hypothèses – non sur la nature de ce phénomène (qui reste à jamais inconnue)
mais sur les causes sociales (« culturelles ») de ce phénomène28. L’objet ainsi
construit ne renvoie en effet qu’à des actions et, à travers elles, aux « raisons » des
acteurs et, donc, aux « causes » du phénomène auquel il correspond.
Mais, ce faisant et pour des raisons proprement méthodologiques, l’objectif
weberien se trouve partiellement abandonné. Il importe en effet de bien voir que
l’idéaltype ne permet pas d’accéder aux « motifs » subjectifs des acteurs dans la
mesure où sa construction concerne non pas des significations individuelles (le
sens donné par les acteurs à leurs conduites) mais seulement leur produit
collectif. Ainsi, la procédure propre à la méthode idéaltypique fait que
26 BOUDON Raymond, Effets pervers et ordre social, Paris, P.U.F., 1977, et La Logique du social, Paris, Hachette, 1979.
27 Nous utilisons, dans ce texte, la transposition française du mot allemand Idealtypus.
28 COENEN-HUTHER Jacques, « Le type idéal comme instrument de la recherche sociologique », Revue française de sociologie, 44-3, 2003, pp. 531-547.
11
l’imputation d’une signification aux conduites renvoie nécessairement à des
causes objectives et non à des raisons subjectives – à des « motifs ». L’observateur
ne peut en effet rendre compte que de ce qu’il peut observer empiriquement, c'est-
à-dire du déroulement réel de l’action, et non des motifs qui restent cachés dans
le for intérieur des acteurs et qui doivent être reconstruits. La procédure place
l’interprète non face à des acteurs mais face à des actions et à leurs cours. Au
contraire des acteurs qui, même lorsqu’ils sont accessibles et interrogeables, ne
sont pas nécessairement disposés à – ou capables de – révéler leurs « motifs »
subjectifs, les cours d’actions s’offrent sinon totalement du moins sans grande
ambiguïté à l’observation.
Ainsi, pour reprendre un exemple fameux de Jaspers, la comparaison de
l’événement de la gifle maternelle avec un idéaltype de la mère « rationnelle en
finalité » pourra me convaincre que la mère « réelle » a agi sous le coup de
l’émotion si j’observe par ailleurs que l’enfant n’arrête généralement pas de
pleurer quand on le gifle et que, de surcroît, la mère était alors rouge de colère.
Mais je ne saurai sans doute jamais si cette émotion était due au caractère
insupportable des cris de l’enfant, à un sentiment inconscient de culpabilité de la
mère ou encore au fait que le père venait de la quitter… – même si je l’interroge
sur ce point29.
En toute rigueur, la méthode de l’idéaltype ne permet donc d’atteindre
(dans les meilleurs des cas) que des causes objectives du cours d’action emprunté
par un acteur – pour la simple raison que l’idéaltype est un tableau d’actions et
non pas un tableau d’acteurs et que, en outre, c’est de l’action déjà accomplie qui
est référée à l’idéaltype30. Il est, bien sûr, toujours possible, pour des raisons
théoriques parfaitement justifiables par ailleurs31, de poser en principe que les
29 Voir, sur ce point : CUIN Charles-Henry, « Sociologie sans paroles : Durkheim et le discours des acteurs », in BORLANDI Massimo et CHERKAOUI Mohamed (Éd.), Le Suicide. Un siècle après Durkheim, Paris, P.U.F. (“Sociologies”), 2000, pp. 125-146.
30 Nous voulons signifier par là que le phénomène étudié est non seulement un effet « émergent » de conduites dont l’intention originelle peut être (et est généralement) étrangère aux conséquences collectives produites, mais aussi et encore que les cours d’action connaissent des modifications continuelles qui rendent quasiment impossible de les imputer à un nombre fini de « motifs » subjectifs. Selon la formule frappante de Colette MOREUX (« Weber et la question de l’idéologie », Sociologie et sociétés, XIV-2, octobre 1982, pp. 9-31), « Comment tirer un modèle unique et cohérent d’un chaos de comportements liés chaotiquement à un chaos de motifs ? »
31 BOUDON Raymond, Raison, bonnes raisons, Paris, P.U.F., 2003.
12
causes objectives de l’action sont réductibles à ses raisons subjectives. Mais on a
aussi le droit de continuer à douter que l’ « éthique protestante » ait
nécessairement joué un rôle quelconque dans le développement du capitalisme
occidental32.
Toutefois, si la méthode idéaltypique ne permet pas toujours d’assurer la
validité d’une explication et, a fortiori, d’une explication par le « sens visé », elle
permet en revanche d’écarter raisonnablement certaines hypothèses relatives à la
nature des conduites. Je peux – aujourd’hui – expliquer par « compréhension
directe [aktuelle] » que l’entrepreneur capitaliste cherche à faire du profit et en
réinvestisse une certaine partie, car il s’agit là d’une action parfaitement
rationnelle en finalité. En revanche, il m’est plus difficile de comprendre d’emblée
pourquoi le calviniste du XVIè s. travaille aussi durement et ne profite pas du
fruit de son travail. Soit il est fou, soit il est pervers. Si je fais plutôt l’hypothèse
qu’il est rationnel et qu’il doit alors avoir de bonnes raisons de faire ce qu’il fait, il
semble alors évident que ces raisons ne sont pas de type utilitaire mais bien,
selon la typologie weberienne, de type « axiologique ».
Le savoir que la méthode weberienne permet d’atteindre n’est donc pas
négligeable, même s’il est de nature très différente de celui que les méthodes
positivistes sinon atteignent, du moins prétendent atteindre. Grâce à la procédure
liée à l’emploi de l’idéaltype, cette méthode permet essentiellement de proposer
des hypothèses fortement étayées empiriquement sur l’explication des
phénomènes sociaux. Si l’on veut être un peu précis, il semble possible de parler
d’un savoir conjectural non gratuit qui est moins relatif à l’explication générale d’un
phénomène empirique qu’à la solution d’une énigme spécifique. Cette formulation
réclame évidemment quelques justifications.
Le sociologue weberien, parce qu’il ne dispose pas d’un objet empirique
constitué indépendamment d’un point de vue de connaissance et de valeur
particulier, n’est en mesure ni de le décrire de façon réaliste ni d’en définir
l’essence – qu’il s’agisse du capitalisme, de l’école républicaine ou encore de la foi
chrétienne. Il peut, en revanche, tenter de répondre à des questions spécifiques
32 DISSELKAMP Annette, L’Éthique protestante de Max Weber, Paris, P.U.F., 1994.
13
relatives à certaines caractéristiques partielles de la réalité empirique. Ainsi, s’il
ne saurait répondre aux questions de type « qu’est-ce que ? » (le capitalisme, etc.),
il est parfaitement à même d’avancer des hypothèses solides relatives à des
questions de type « pourquoi ? ». Pourquoi le capitalisme occidental s’est-il plus
rapidement développé dans les sociétés protestantes que dans les autres ?
Pourquoi l’école républicaine manifeste-t-elle une telle propension à sanctionner
scolairement les inégalités sociales ? Etc.
On pourrait donc soutenir sans contradiction ni incohérence que, dans la
perspective weberienne, l’objet sociologique n’existe pas, au sens où il aurait une
existence, même conceptuelle, clairement et définitivement identifiable. Dans
l’épistémologie positiviste, le statut de l’objet scientifique est clair. Il est un
phénomène naturel et l’explication de ce phénomène, si elle est convenablement
conduite, revêt une valeur de vérité intemporelle puisque c’est bien, dans ce cas,
une partie de « la nature » qui se trouve mise au jour. Lorsque Durkheim aborde
l’explication sociologique du suicide ou du châtiment, il affirme tenir un discours
sur quelque chose qui existe dans la nature. Sans doute l’objet du discours
scientifique a-t-il été préalablement élaboré, mais c’est à la fois pour le dégager de
la gangue culturelle dans laquelle il est parfois presque entièrement pris, et pour
donner naissance à un concept dont la signification est intégralement explicitée
et qui, par là, est réputé réaliser une adéquation quasi totale entre le concept (la
réalité scientifique) et sa signification (la réalité empirique). (Il reste, en fait, bien
évident que les « définitions préalables » durkheimiennes doivent leur valeur
heuristique aux présupposés théoriques qui les rendent possibles, plus qu’à la
seule induction empirique33.) Le sociologue weberien, lui, demeure indéfiniment
en quête de la définition d’un objet qui se situe plutôt dans la tension existant
entre une réalité empirique et un idéaltype qui ne peut pas en proposer d’autre
représentation que désespérément irréaliste.
33 C’est ce que reconnaît François-André ISAMBERT (« De la définition. Réflexions sur la stratégie durkheimienne de détermination de l’objet », L’Année sociologique, XXII, 1982, pp. 163-192) lorsqu’il affirme qu’ « il n’est donc pas outrecuidant de voir dans les définitions préalables de Durkheim en réalité de premières hypothèses théoriques, ou plus exactement le produit de toute une construction hypothético-déductive, où effectivement le ‘caractère extérieur’ joue un rôle fondamental, mais en supposant en arrière-fond une théorie déjà ébauchée ». (p. 177)
14
L’épistémologie weberienne place ainsi le chercheur devant le redoutable
paradoxe selon lequel on pourrait expliquer un phénomène social sans qu’il soit
cependant possible d’en donner une définition substantielle. Pourtant, le
paradoxe est facilement levé si l’on accepte, avec Weber, de considérer tout
phénomène social comme de l’action objectivée34 : dans cette perspective, en effet,
autant ces phénomènes ne sont que des « idéaux » culturels plus ou moins
conceptualisés (et qui « flottent dans la tête » des acteurs, voire des sociologues
eux-mêmes), autant les conduites qui s’y rapportent (pour les constituer ou pour
s’y régler) sont bien, comme nous l’avons noté plus haut, observables et
analysables. Ainsi, « expliquer » la magie revient à expliquer pourquoi des
individus la pratiquent, et non pas à tenter de déterminer ce qui en constituerait
l’être essentiel, la « vraie nature » 35. Dans une perspective « actionniste », la
magie n’existe que parce que des individus la pratiquent ; elle n’est donc pas
autre chose que la somme des « raisons » pour lesquelles ces pratiques
individuelles existent. Chercher à répondre à la question « qu’est-ce que la
magie ? » (pour savoir, par exemple, si elle se différencie – et en quoi – de la
religion ou de la science) reviendrait ainsi à chercher à définir un objet qui
n’existe que parce qu’on l’a défini comme tel… La question est donc plutôt celle
de savoir pourquoi des individus se livrent à certaines conduites qui semblent
être partiellement ou totalement dépourvues de rationalité aux yeux de certains
observateurs qui, pour cela, les qualifient de « magiques »36. Quant à la différence
entre (par exemple) la magie et la religion, elle est évidemment tout entière
indiquée par celle qui existe entre les définitions respectives qu’anthropologues et
sociologues en donnent – sans toujours prendre garde à ne pas glisser de
34 L’expression, empruntée à Philippe RAYNAUD (Max Weber et les dilemmes de la raison moderne [1987], Paris, P.U.F., 1996), pourrait prêter à confusion si l’on ne précisait pas que cette « objectivité » des phénomènes (macro-) sociaux ne doit pas être entendue de façon réaliste (par exemple, comme dans le « chosisme » durkheimien) mais seulement comme signifiant que ces phénomènes revêtent une réalité pour les acteurs.
35 C’est ce que montre, avec brio et au terme d’une enquête particulièrement bien informée, Pascal SANCHEZ dans sa Thèse : Les théories explicatives de la magie : les sciences sociales à l’épreuve d’une croyance collective, Thèse de Doctorat de Sociologie (ss. la dir. de R. Boudon), Université Paris-IV, ronéo, 2005, 749 p.
36 Voir, pour un abord « cognitif » de la question des croyances et des pratiques magiques : BOUDON Raymond, Le Sens des valeurs, Paris, P.U.F., 1999 et Raison, bonnes raisons, Op. cit.
15
définitions nominales vers des définitions réalistes. Identifier l’entreprise cognitive
weberienne à une « sociologie de l’action » n’est donc pas une vaine expression :
s’il est vrai que toute réalité sociale n’est qu’action, alors la sociologie doit
rabattre l’analyse des phénomènes sociaux sur l’analyse des conduites et des
interactions dont, aux yeux de l’observateur, ils procèdent. L’épistémologie
weberienne précède donc, dans ce domaine comme dans bien d’autres, celle de
Karl Popper qui nous enseignera que les questions de type « Qu’est-ce que ? »
doivent être rejetées par l’esprit scientifique. La première le fait au nom du
caractère purement nominal des définitions conceptuelles, le second pour lutter
contre un essentialisme stérilisant37. Mais l’une et l’autre nous permettent de
dépasser le paralogisme selon lequel on peut expliquer un phénomène collectif
sans en connaître nécessairement la nature essentielle.
Aussi pourrait-on affirmer successivement que :
1 - les idéaltypes weberiens ne constituent pas les objets de la recherche du
sociologue : ils n’en constituent qu’un instrument (ils ne sont, si l’on accepte
l’expression, que des « objets méthodologiques ») ;
2 - dans la méthodologie weberienne, l’objet sociologique n’existe donc pas
comme une entité – même virtuelle – descriptible et analysable en tant que telle ;
il existe d’abord comme une énigme empirique à résoudre (ce n’est pas tant le
capitalisme que l’on cherche à expliquer que, par exemple, pourquoi il s’est
développé ici plus ou mieux que là) ;
3 - en conséquence, le sociologue ne peut rien affirmer scientifiquement sur
la nature d’un phénomène social quelconque ; il ne peut que se prononcer, et
seulement en termes probabilistes, sur l’explication de certaines dimensions de ce
phénomène.
37 POPPER Karl, Le Réalisme et la science, Paris, Hermann, 1990. « (…) je rejette toute les questions du type ‘Qu’est-ce que ?’ – autrement dit les questions qui concernent ce qu’est une chose, son essence, sa vraie nature.(…) Cette conception animiste n’explique rien, mais elle a conduit certains essentialistes (comme Newton), à fuir les propriétés relationnelles, telle la gravitation, et à croire, pour des raisons considérées comme valides a priori, que toute explication satisfaisante doit se fonder sur des propriétés inhérentes (par opposition aux propriétés relationnelles). » (pp. 155-156, souligné dans le texte.)
16
III – On peut, pour illustrer ce dernier propos par un exemple significatif,
examiner rapidement les effets de connaissance d’une recherche célèbre où
d’aucuns ont naguère voulu voir une analyse réaliste du système scolaire
français. De fait, ce que les auteurs de La Reproduction38 étudient n’est sans
doute rien moins que l’idéaltype d’un système scolaire lorsque – et seulement
lorsque – il est conçu et construit comme un instrument de « reproduction
sociale ». L’erreur serait donc bien d’identifier une réalité sociale particulière
historiquement et spatialement située (ici, l’École française des années soixante) à
l’un de ses idéaltypes. Ce faisant, on prendrait pour la réalité ce qui n’en est
qu’une interprétation possible si l’on se place d’un « point de vue de valeurs »
particulier.
Or, le seul enseignement qui nous est fourni par La Reproduction est qu’il
existe bien, dans la structure et le fonctionnement du système scolaire français,
un certain nombre de traits qui pourraient permettre d’expliquer les effets
« reproductifs » de ce système. En effet, la confrontation de l’objet empirique à un
idéaltype construit en référence à un fonctionnement rationnel de « reproduction
sociale » révèle une grande proximité entre les deux éléments de la comparaison.
(Pour le dire autrement : si les acteurs du système scolaire avaient voulu qu’il
fonctionne ainsi qu’il fonctionne, ils ne l’auraient pas conçu autrement.) Mais
cette proximité d'une part ne signifie pas une identité et, d'autre part, ne peut pas
être analysée comme résultant nécessairement d’une intention des acteurs et,
moins encore, d’une « intention » du système lui-même. Se vérifie ici le risque que
l’on prend à déduire mécaniquement les intentions des acteurs, toujours
inaccessibles à l’analyste, de l’analyse du produit de leurs actions et d’en faire
ainsi les « causes » du phénomène étudié39.
Cette proximité entre l’objet empirique et l’objet méthodologique (un
idéaltype) signifie seulement que l’École possède certaines des caractéristiques
structurelles qui sont susceptibles (Weber parlerait de « chances ») de rendre
38 BOURDIEU Pierre et Jean-Claude PASSERON, La Reproduction ; éléments pour une théorie du système d'enseignement, Paris, Minuit, 1970.
39 Weber lui-même n’aurait jamais affirmé que les Puritains du XVIème siècle avaient l’intention de créer le capitalisme !
17
compte des phénomènes de reproduction sociale qui s’y jouent. Elle ne signifie
aucunement ni qu’elle puisse être réduite à ces caractéristiques structurelles ni
que ces potentialités soient nécessairement actualisées et produisent de la
reproduction. En effet, ces caractéristiques favorables à la reproduction ne sont
pas – en principe – exclusives d’autres caractéristiques qui, elles, permettraient
au contraire de rendre compte de phénomènes non plus de « reproduction » mais
bien d’ « émancipation » (ou encore de mobilité scolaire ascendante). Ainsi,
d’autres chercheurs porteurs d’autres « intérêts sociaux » et animés de valeurs
différentes pourraient fort bien élaborer une autre problématique relative non plus
à l’explication des phénomènes de reproduction sociale engendrés par l’École
mais à celle des phénomènes de promotion sociale qui s’y jouent également – et
dans des proportions d’autant plus significatives que, à l’époque où cette
recherche fut menée, ces phénomènes prenaient une importance croissante 40.
Mais, bien sûr, il eût fallu pour cela ne pas rejeter purement et simplement
l’évidence empirique de l’accroissement de la mobilité sociale inter-
générationnelle, et qu’il ne considèrent pas non plus les « succès » scolaires des
plus défavorisés comme résiduels et, donc, insignifiants41.
Mais ce n’est pas tout. La thèse cardinale, même si elle reste implicite, des
auteurs de La Reproduction semble bien être que les effets de « reproduction »
qu’ils dénoncent possèdent des conséquences fonctionnelles pour le maintien
d’un statu quo social qui serait favorable tout à la fois aux intérêts des classes
dominantes de la société et à ceux des acteurs (les enseignants) du système
scolaire lui-même. On est là dans un « hyper-fonctionnalisme » qui veut que tout
phénomène social ne soit pas seulement une conséquence d’un fonctionnement
mais l’objectif visé par une fonction42. (« Si c’est ainsi que ça fonctionne, c’est que
c’est fait pour fonctionner ainsi ! ») Et c’est sans doute ceci qui explique que l’on
ait pu tenter d’imposer l’idéaltype de l’ « École reproductrice » comme une
définition ontologique du système scolaire français de la fin des années soixante,
et que l’on ait ainsi réduit l’École au modèle théorique construit dans La
40 Voir, sur ce point : CUIN Charles-Henry, « La sociologie et la mobilité sociale : les énigmes du cas français », Revue française de sociologie, XXXVI, 1, 1995, pp. 33–60.
41 À l’aune quantitative du phénomène, Durkheim n’aurait jamais dû s’intéresser au suicide…
18
Reproduction. C’est là, sans doute, une négligence particulièrement regrettable de
la leçon weberienne qui enseigne pourtant ad nauseam qu’aucun concept
idéaltypique n’est assimilable à la réalité empirique qu’il a pour vocation
d’expliquer.
*
* *
L’épistémologie weberienne nous représente l’espace sociologique comme
une métaphore de l’espace social. Le sociologue, tout comme l’acteur social, y agit
en fonction des significations qu’il y décèle et qui sont elles aussi fonction
d’ « idées de valeur ». Mais cette démarche qui, chez l’acteur, possède une portée
pratique reste, chez le sociologue, à visée essentiellement cognitive. S'il s’agit bien,
pour ce dernier, de connaître les représentations et les croyances qui orientent
l’action sociale, cette connaissance n’est jamais indifférente à l’objet à connaître ;
au contraire, elle est culturellement motivée par des « intérêts » sociaux (y
compris des « intérêts de valeurs ») qui, dans le même temps, en suscitent la
recherche et en orientent les procédures de découverte. Chez l’un comme chez
l’autre, les significations recherchées ne se trouvent dans l’objet à connaître ou
dans les situations objectives de l’action mais bien dans l’environnement culturel
du sujet43. Quand Weber évoque la « signification culturelle » qu’un phénomène
social revêt pour les acteurs, il fait référence aux motivations subjectives des
conduites qui, dans la mesure où leur agrégation donne lieu à ce phénomène,
s’objectivent en lui. Et quant il évoque – en utilisant exactement la même
expression (« Kulturbedeutung ») – la « signification culturelle » qu’un phénomène
social revêt pour le sociologue, il fait référence aux motivations tout aussi
42 BOURRICAUD François, « Contre le sociologisme : une critique et des propositions », Revue française de sociologie, XVI (suppl.), 1975, pp. 583-603. 43 Herbert G. BLUMER (Symbolic Interactionism, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1969) développera cette conception proprement weberienne selon laquelle les significations ne sont inhérentes ni aux choses ni aux sujets. Les sujets ne sont ni des traducteurs (de signes que les choses leur
19
subjectives qui amènent celui-ci à constituer en objet d’étude un fragment de la
réalité empirique. Ainsi, le processus par lequel le sociologue constitue sa
problématique cognitive est de même nature que celui par lequel les acteurs
sociaux constituent leur problématique pratique. Ce qui différencie, pour
l’essentiel, le « sujet épistémique » qu’est le sociologue du « sujet égocentrique »
qu’est tout acteur social44, ne peut donc résider que dans la procédure active et
réflexive du « rapport aux valeurs » (Wertbeziehung)45 qui, généralement
inexistante chez l’acteur, devient chez le sociologue un principe méthodologique
de construction de son objet et de relativisation de ses résultats analytiques –
relativisation consistant à indexer ces résultats au point de vue particulier qui les
a suscités et produits.
Si l’entreprise weberienne s’avérait être tout entière dirigée, ainsi qu’on a
pu l’affirmer, par une « problématique » de la culture et de la civilisation, et ne
s’intéressait que par épithèse au social et à « la société » 46 (mais il faudrait alors
rendre raison de la publication, même posthume, de Économie et société !), les
problèmes méthodologiques que nous avons mis au jour et soulignés ne seraient
pas bien graves. Si, en revanche, on estime pouvoir lire Weber comme un
authentique sociologue47, alors la portée et les limites mêmes de sa méthode
invitent ses collègues tout à la fois à justifier et à modérer leurs ambitions en
prenant, grâce à elle, la mesure tant du possible (qui est vaste) que du
chimérique (qui n’est jamais très loin).
enverraient) ni des herméneutes autonomes. Ils produisent des significations des choses en raison de et grâce à l’ « univers symbolique » qui leur est commun.
44 Nous empruntons cette distinction à : PIAGET Jean, Épistémologie des sciences de l'homme, Paris, Gallimard, 1970.
45 Nous nous référons ici à l’interprétation donnée par Julien FREUND (Sociologie de Max Weber, Paris, P.U.F., 1966) du « rapport aux valeurs » (Wertbeziehung) comme procédure méthodologique d’objectivation, par le chercheur, de son rapport personnel à certaines valeurs dans le but d’expliciter les « motifs » subjectifs de sa recherche au plan de sa problématique, de ses hypothèses et, donc, de ses résultats.
46 « ‘Intellectuellement’, Weber et la sociologie actuelle vivent chacun de son côté, sans contact. Une sociologie dont le courant dominant a incontestablement comme objet primordial la ‘société’, qui, dans son orientation devenue essentielle, veut explicitement être ‘sociologie et uniquement sociologie’ une tendance qui […] s’oppose expressément à la sociologie ‘historico-existentialiste’, ne peut pas du tout suivre les traces de Weber. » (HENNIS Wilhelm, La Problématique de Max Weber, Paris, P.U.F., 1996, p. 73.). Voir, pour une analyse dans cette veine : WATIER Patrick, « M. Weber : analyste et critique de la modernité », Sociétés, n° 66, 1999/4, pp. 73-93.
47 CHAZEL François, Aux fondements de la sociologie, Paris, P.U.F., 2000 (voir le chap. 1 : « Comment faut-il interpréter l’œuvre de Weber ? », pp. 17-47).
20
L’enseignement le plus rassurant de la méthodologie (mais aussi de
l’épistémologie) weberienne est en effet que la sociologie n’est susceptible de
donner réponse qu’aux questions qu’on lui pose, et à condition de préciser que
ces réponses ne sont qu’hypothétiques et que ces questions sont de type explicatif
et nullement de type ontologique. Le tout sans préjudice du caractère
éventuellement différent, voire contradictoire, des réponses qu’elle pourrait
donner à d’autres questions si on les lui posait. En fait, son trait le plus
désenchanteur est bien que le savoir sociologique, relatif et partiel comme il l’est,
exclut toute affirmation dogmatique et, par là, ne peut constituer qu’une
ressource très fragile pour l’action48. La leçon weberienne n’est donc pas tout à
fait négligeable pour un monde sociologique auquel il peut arriver de naturaliser
outre mesure tant les objets qu’il construit que les explications qu’il propose et
qui, par ailleurs, n’est pas toujours totalement attentif au fait que, entre les
phénomènes étudiés et les discours des acteurs, s’intercalent des processus
d’agrégation ou de composition où se situent sans doute les véritables enjeux de
l’analyse sociologique puisque c’est à travers ces processus que s’opère la
transformation bien mystérieuse des « motifs » en « réalités sociales ».
Charles-Henry CUIN Université Victor Segalen-Bordeaux 2 LAPSAC [email protected]
Références bibliographiques :
BLUMER Herbert G., Symbolic Interactionism, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1969.
BOUDON Raymond, Effets pervers et ordre social, Paris, P.U.F., 1977.
– , La Logique du social, Paris, Hachette, 1979.
– , Le Sens des valeurs, Paris, P.U.F., 1999.
– , Raison, bonnes raisons, Paris, P.U.F., 2003.
48 WEBER Max, Le Savant et le politique, Op. cit.
21
BOURDIEU Pierre et Jean-Claude PASSERON, La Reproduction ; éléments pour une théorie du système d'enseignement, Paris, Minuit, 1970.
BOURRICAUD François, « Contre le sociologisme : une critique et des propositions », Revue française de sociologie, XVI (suppl.), 1975, pp. 583-603.
CHAZEL François, Aux fondements de la sociologie, Paris, P.U.F., 2000.
COENEN-HUTHER Jacques, « Le type idéal comme instrument de la recherche sociologique », Revue française de sociologie, 44-3, 2003, pp. 531-547.
COLLIOT-THÉLÈNE Catherine, « Expliquer/comprendre : relecture d’une controverse », Espaces Temps, 2004 (84/85/86), pp. 6-23.
CUIN Charles-Henry, « La sociologie et la mobilité sociale : les énigmes du cas français », Revue française de sociologie, XXXVI, 1, 1995, pp. 33–60.
– , Ce que (ne) font (pas) les sociologues. Petit essai d’épistémologie critique, Genève, Librairie Droz, 2000.
– , « Sociologie sans paroles : Durkheim et le discours des acteurs », in BORLANDI Massimo et CHERKAOUI Mohamed (Éd.), Le Suicide. Un siècle après Durkheim, Paris, P.U.F. (“Sociologies”), 2000, pp. 125-146.
– , « Esistono leggi sociologiche ? » in BORLANDI Massimo et Loredana SCIOLLA (Éd.), La Spiegazione sociologica. Metodi, tendenze, problemi, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 33-44.
DISSELKAMP Annette, L’Éthique protestante de Max Weber, Paris, P.U.F., 1994.
DURKHEIM Émile, Les Règles de la méthode sociologique [1895], Paris, P.U.F., 1995.
FREUND Julien, Sociologie de Max Weber, Paris, P.U.F., 1966.
– , « Méthodologie et épistémologie comparées d'Émile Durkheim, Vilfredo Pareto et Max Weber », Recherches sociologiques, 5 (2), 1974, p. 282-309.
GRANGER Gilles-Gaston, La Vérification, Paris, Odile Jacob, 1993.
GURVITCH Georges, Traité de Sociologie/I, Paris, P.U.F., 1962.
HENNIS Wilhelm, La Problématique de Max Weber, Paris, P.U.F., 1996.
ISAMBERT François-André, « De la définition. Réflexions sur la stratégie durkheimienne de détermination de l’objet », L’Année sociologique, XXII, 1982, pp. 163-192.
MOREUX Colette, « Weber et la question de l’idéologie », Sociologie et sociétés, XIV-2, octobre 1982, pp. 9-31.
PIAGET Jean, Épistémologie des sciences de l'homme, Paris, Gallimard, 1970.
POPPER Karl, Le Réalisme et la science, Paris, Hermann, 1990.
RAYNAUD Philippe, Max Weber et les dilemmes de la raison moderne [1987], Paris, P.U.F., 1996.
SANCHEZ Pascal, Les théories explicatives de la magie : les sciences sociales à l’épreuve d’une croyance collective, Thèse de Doctorat de Sociologie (ss. la dir. de R. Boudon), Université Paris-IV, ronéo, 2005, 749 p.
WATIER Patrick, « M. Weber : analyste et critique de la modernité », Sociétés, n° 66, 1999/4, pp. 73-93.
22
WEBER Max, « L’objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales » [1904], Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1965.
– , L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme [1904-05], Paris, Gallimard, 2004.
– , Économie et société/I [1920], Paris, Plon (« Agora »), 1995.
– , « Max Weber à Robert Liefmann [lettre du 9.03.1920, traduite par J.-P. Grossein] », Revue française de sociologie, 46-4, 2005, p. 923-928.