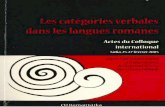L’image empreinte d’intentions : la ‘Vénus Tailladée’, considérations sur un acte d’iconoclasme
Gabriel Monod, lecteur des Considérations inactuelles (1874-75)
Transcript of Gabriel Monod, lecteur des Considérations inactuelles (1874-75)
Martine BélandRéception des Considérations inactuelles en France (1874 -1875)
EuroPhilosophie
Éditions d'Ariane
Le présent texte est édité par EuroPhilosophie et les
ÉDITIONS D’ARIANE
GIRN - Groupe International de Recherches sur Nietzsche GIRN - Gruppo Internazionale di Ricerche su Nietzsche GIRN / INRG - International Nietzsche Research Group
GIRN / INFG - Internationale Nietzsche-Forschungsgruppe GIRN / GIIN - Grupo Internacional de Investigações sobre Nietzsche GIRN/GIIN - Grupo Internacional de Investigaciones sobre Nietzsche
Les ouvrages publiés sur EuroPhilosophie sont protégés par le droit d'auteur. Conformément au code de la propriété intellectuelle, les courtes citations sont
autorisées sous réserve de mention des auteurs et des sources. Toute autre reproduction ou représentation du contenu de cet ouvrage par quelque
procédé que ce soit, doit faire l'objet d'une autorisation expresse de l’éditeur. Diffusion numérique interdite sur d’autres sites.
Pour faire un lien ou citer ce texte :
Martine Béland, Réception des Considérations inactuelles en France (1874-1875)
Éditions d’Ariane http://www.europhilosophie-editions.eu
Dépôt légal : Novembre 2010
© EuroPhilosophie / ÉDITIONS D’ARIANE
Site : www.europhilosophie-editions.eu
Illustration de couverture :
Tiziano Vecellio, Bacchus et Ariane, détail, 1523-1524, huile sur toile, National Gallery,
Sommaire
Réception des Considérations inactuelles en France (1874-1875) 5
Nietzsche en son temps 5
Gabriel Monod, lecteur et critique de Nietzsche 6
Angles interprétatifs 10
Ouvrages cités 12
Textes 13
1 13
2 15
3 17
RÉCEPTION DES CONSIDÉRATIONS INACTUELLES
EN FRANCE (1874-1875)
MARTINE BÉLAND
Nietzsche en son temps
C’est une chose bien connue que Nietzsche s’est nourri de la culture de son temps. Il était un lecteur fin et passionné, intéressé autant par ce qui s’écrivait en Allemagne qu’ailleurs en Europe. Ce que l’on connaît moins, c’est la manière dont la culture de son temps s’est nourrie de lui : comment Nietzsche fut-il lu de son vivant ? Voilà une question à laquelle les études nietzschéennes, l’histoire des idées ou la germanistique ont toujours à répondre.
Suivant ce constat, les textes vers lesquels le chercheur peut se tourner sont nombreux. En guise d’exemple, et pour contribuer à l’étude de la réception de Nietzsche par ses contemporains germanophones qui le lisaient selon une perspective extérieure à l’Allemagne, nous nous tournons vers un cas précis qui touche la France et l’Allemagne — à savoir la parution, dans une revue savante parisienne, de recensions des trois premières Considérations inactuelles, en 1874 et 1875. Ce cas montre l’apparition d’une réception germano-européenne de Nietzsche. Dans l’esprit de l’esthétique de la réception et de la méthode des transferts culturels — qui soulignent que les frontières culturelles sont mouvantes —, cette étude de cas présente Nietzsche autrement que comme un auteur allemand publiant en Allemagne pour un public
www.europhilosophie.eu
5
germanophone. En effet, l’on voit que Nietzsche s’inscrivait dans l’Europe culturelle, un univers intellectuel transgressant les frontières politiques et sur la définition duquel essayistes et philosophes se penchaient alors. L’examen contextuel de ces documents dévoile les orientations générales en fonction desquelles Nietzsche était lu : la critique culturelle ; la question nationale ; les orientations académiques de la philosophie et l’héritage de Schopenhauer.
Gabriel Monod, lecteur et critique de Nietzsche
De septembre 1874 à janvier 1875 paraissent des recensions anonymes des trois premières Considérations inactuelles dans la Revue critique d’histoire et de littérature. Cet organe parisien avait pour objectif de « faire connaître, à mesure qu’elles paraîtront, les principales productions de l’érudition française et étrangère […]. Les articles seront courts et substantiels […]. Ils donneront du livre une idée complète, et, quand il y aura lieu, une analyse détaillée ; ils signaleront ce que chaque ouvrage apporte de nouveau à la science et relèveront les erreurs et les lacunes qui pourraient s’y trouver »1. Toutefois, l’on ne peut dire que les Inactuelles eurent droit à toute cette considération dans les pages de la Revue critique. La recension de David Strauss, der Bekenner und der Schriftsteller, fort brève, consiste pour la plus grande part en une longue citation sur les rapports de l’Allemagne à la France suite à la guerre franco-prussienne, après quoi l’auteur précise : « Il ne peut être question ici de l’analyser, encore moins de l’apprécier. Nous nous bornons à attirer l’attention
1 Description du but proposé en 1866 par les éditeurs de la Revue
critique, telle que retranscrite dans la revue de la Bibliothèque de l’École des Chartes. Revue d’érudition consacrée spécialement à l’étude du Moyen Âge, 27e année, t. II, 6e série, Paris, Librairie A. Franck, 1866, p. 190-191.
www.europhilosophie.eu
6
sur cette publication originale, écrite avec une verve extraordinaire »2. Autrement dit, ce texte annonce la publication de l’essai nietzschéen plutôt qu’il n’en offre une analyse.
Cet organe parisien se targuait aussi de « faire en sorte que les livres dont la Revue critique rendra compte soient toujours jugés par des hommes spéciaux ; ceux-là seuls peuvent discerner le fort et le faible de chaque ouvrage et se passent des amplifications que suggère une connaissance imparfaite du sujet »3. Mais qui était l’auteur de ces trois recensions anonymes ? Le style et les références de ces recensions démontrent qu’elles furent écrites par une même plume. D’emblée, Nietzsche montrait peu d’estime pour cet auteur inconnu : « Le “critique” doit être plutôt un garçon de café français qu’un savant français »4. L’auteur devait pourtant être un historien (vu l’orientation de la revue) germaniste (les Inactuelles n’étant pas traduites en français). Or, tout pointe vers un nom précis : celui de l’historien Gabriel Monod.
Nietzsche connaissait les travaux de G. Monod (1844-1912)5. Ce dernier était un familier de l’univers intellectuel allemand, depuis qu’Hippolyte Taine l’eût « encouragé à entreprendre un séjour universitaire en Allemagne pour compléter sa formation »6. Il rencontra Nietzsche à Bâle en août 1872 avec leur amie commune Malwida von Meysenbug7. Peu après cet événement, Nietzsche décrit son impression dans une lettre à Carl von Gersdorff : « c’est un historien formé en Allemagne, et bien qu’il soit authentiquement français, il est habité du désir le plus pur de
2 Anonyme, Recension de la première Betrachtung, in : Revue critique
d’histoire et de littérature (Paris), vol. 8, n° 39, 26 sept. 1874 (attribuée à Gabriel Monod), p. 206.
3 Bibliothèque de l’École des Chartes, 1866, p. 191. 4 F. NIETZSCHE, Lettre à Schmeitzner du 10 février 1875 / KSB 5. 5 Cf. Lettre à Meysenbug du 27 août 1872 / KSB 4. 6 J. LE RIDER, Nietzsche en France, Paris, P.U.F., 1999, p. 47. 7 Monod y séjourna à nouveau en septembre 1877.
www.europhilosophie.eu
7
ne pas perdre son impartialité vis-à-vis de l’être allemand »8. Après cette rencontre, Nietzsche fait demander à Monod (par l’entremise de Meysenbug) de le mettre en contact avec un éditeur parisien afin que puisse être publiée en France la traduction de sa troisième Inactuelle, à laquelle travaillait alors Marie Baumgartner-Köchlin9. Ce projet n’eut toutefois pas de suites : Monod ne trouva pas (car il ne chercha pas) d’éditeur parisien pour l’essai sur Schopenhauer. De plus, Nietzsche apprit que Monod était l’auteur de la recension négative de cet essai, parue dans la Revue critique en janvier 187510.
Les deux premières Inactuelles, pourtant, avaient fait bonne impression à Gabriel Monod. Suite à la première recension qui souligne l’originalité de l’essai sur David Strauss et qui approuve sa perspective non théologique, la deuxième recension repère les sources schopenhaueriennes de la réflexion nietzschéenne sur l’histoire et souligne à nouveau la « verve originale et mordante »11 ainsi que la passion dont témoigne la deuxième Inactuelle. Monod critique toutefois la langue de Nietzsche et juge son style « incohérent », « abstrait » et « trivial », « plein de recherche et de mauvais goût »12. L’intérêt de son propos le rendrait néanmoins digne d’être lu en Allemagne et en Europe. Curieusement, tout historien qu’il soit, l’auteur de cette recension refuse d’apprécier les thèses nietzschéennes sur l’histoire, qu’il
8 Lettre à Gersdorff du 5 octobre 1872 / KSB 4. L’allemand se lit : das
deutsche Wesen. 9 Cf. Lettre à Meysenbug du 7 février 1875 / KSB 5, ainsi que les
nombreuses lettres échangées entre Nietzsche et M. Baumgartner en 1875.
10 Cf. Lettre à Gersdorff du 21 mai 1875 / KSB 5 ; et la lettre n° 671 de Gersdorff à Nietzsche du 22 mai 1875.
11 Anonyme, Recension de la deuxième Betrachtung, in : Revue critique d’histoire et de littérature (Paris), vol. 8, n° 46, 14 nov. 1874 (attribuée à Gabriel Monod), p. 318.
12 Anonyme, Recension de la deuxième Betrachtung, in : Revue critique d’histoire et de littérature (Paris), vol. 8, n° 46, 14 nov. 1874 (attribuée à Gabriel Monod), p. 319.
www.europhilosophie.eu
8
résume simplement selon les deux lignes directrices pour lesquelles cet essai est réputé : la critique de l’érudition historique et l’importance du non-historique (la « vie active » et l’art) pour la vie.
Cependant, la seule recension de la Revue critique ayant retenu l’attention de Nietzsche13 est la troisième. Or, celle-ci témoigne d’une déception : Monod remarque que loin d’être ce que son titre annonce — un essai sur la théorie schopenhauerienne de l’éducation —, la troisième Inactuelle se présente comme une autre « satire »14 contre l’Allemagne et les savants allemands, exactement dans la lignée des deux précédentes. Monod fait remarquer que Schopenhauer est pourtant « devenu aujourd’hui le plus lu et le plus goûté des philosophes allemands. Les officiers l’emportent avec eux en campagne, les hommes du monde et les femmes mêmes s’en nourrissent avec passion »15. Aussi se dit-il déçu de relire du Nietzsche : « Ses critiques manquent de variété et leur exagération leur enlève une partie de leur force »16. Le verdict de Monod est sans appel : « nous ne saurions approuver sans restriction ses attaques contre la science allemande et les savants allemands. Au milieu de la décadence morale et intellectuelle que M. N.[ietzsche] signale en Allemagne et que nous n’avons garde de nier, les travaux scientifiques qui sortent des Universités devraient être pour lui un sujet de consolation et non de colère »17. Selon l’historien français, si 13 Du moins, suffisamment pour qu’il en parle dans sa correspondance. 14 Anonyme, Recension de la troisième Betrachtung, in : Revue critique
d’histoire et de littérature (Paris), vol. 9, n° 4, 23 janv. 1875 (attribuée à Gabriel Monod), p. 63.
15 Anonyme, Recension de la troisième Betrachtung, in : Revue critique d’histoire et de littérature (Paris), vol. 9, n° 4, 23 janv. 1875 (attribuée à Gabriel Monod), p. 63.
16 Anonyme, Recension de la troisième Betrachtung, in : Revue critique d’histoire et de littérature (Paris), vol. 9, n° 4, 23 janv. 1875 (attribuée à Gabriel Monod), p. 63.
17 Anonyme, Recension de la troisième Betrachtung, in : Revue critique d’histoire et de littérature (Paris), vol. 9, n° 4, 23 janv. 1875 (attribuée à Gabriel Monod), p. 64.
www.europhilosophie.eu
9
les Allemands « n’ont en ce moment que des savants, c’est qu’ils ne peuvent pas produire autre chose ; mais grâce à ces savants, ils font encore assez bonne figure en Europe »18.
Malgré que cette première incursion de ses idées en France ne fut pas positive19, Nietzsche persistait à chercher une tribune en Europe, et particulièrement en France. Sa première publication en français fut finalement la quatrième et dernière Considération inactuelle, sur Richard Wagner, traduite par Marie Baumgartner-Köchlin et publiée par son éditeur allemand (Schmeitzner, à Schloss-Chemnitz), plutôt que par un éditeur français. Cette traduction devait toutefois « connaître une diffusion des plus limitées », ne touchant « que les wagnériens de Suisse romande »20.
Angles interprétatifs
L’épisode Monod permet de constater que si les premiers pas de l’œuvre de Nietzsche en français étaient initialement l’écho de ses positions envers le wagnérisme culturel, les premiers transferts culturels de son œuvre en Europe furent néanmoins tributaires d’autres angles interprétatifs dont le chercheur d’aujourd’hui doit tenir compte. En effet, les textes de Monod, bien qu’ils soient succincts, montrent que Nietzsche est entré dans le paysage intellectuel européen en fonction de la question de la spécificité académique allemande et de l’héritage de la philosophie de Schopenhauer. Aussi les textes de Monod permettent-ils d’entrevoir la place de 18 Anonyme, Recension de la troisième Betrachtung, in : Revue critique
d’histoire et de littérature (Paris), vol. 9, n° 4, 23 janv. 1875 (attribuée à Gabriel Monod), p. 64.
19 Comme le résume le germaniste Jacques Le Rider : « Les premiers contacts de Nietzsche avec des intellectuels français avaient été autant d’échecs » (Nietzsche en France, Paris, P.U.F., 1999, p. 44).
20 J. LE RIDER, Nietzsche en France, Paris, P.U.F., 1999, p. 43 ; Le Rider se fie à l’étude de G. BIANQUIS, Nietzsche en France, Paris, Alcan, 1929.
www.europhilosophie.eu
10
Nietzsche dans la constellation philosophique de son époque — ce que les articles généralistes du philosophe allemand Wilhelm Wundt (1832-1920), parus dans des revues parisienne et londonienne en 1876 et 1877, donnent à voir de manière plus précise.
www.europhilosophie.eu
11
Ouvrages cités
- Anonyme, Recension de la première Betrachtung, in : Revue critique d’histoire et de littérature (Paris), vol. 8, n° 39, 26 sept. 1874, p. 206. Attribuée à Gabriel Monod.
—, Recension de la deuxième Betrachtung, in : Revue critique d’histoire et de littérature (Paris), vol. 8, n° 46, 14 nov. 1874, p. 318-319. Attribuée à Gabriel Monod. —, Recension de la troisième Betrachtung, in : Revue critique d’histoire et de littérature (Paris), vol. 9, n° 4, 23 janv. 1875, p. 63-64. Attribuée à Gabriel Monod.
- Bianquis, Geneviève, Nietzsche en France. L’influence de Nietzsche sur la pensée française, Paris, Félix Alcan, 1929.
- Bibliothèque de l’École des Chartes. Revue d’érudition consacrée spécialement à l’étude du Moyen Âge, 27e année, t. II, 6e série, Paris, Librairie A. Franck, 1866.
- Le Rider, Jacques, Nietzsche en France. De la fin du XIXe siècle au temps présent, Paris, P.U.F., coll. Perspectives germaniques, 1999.
- Nietzsche, Friedrich, Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe, dir. G. Colli et M. Montinari, Berlin / New York, de Gruyter, 8 vol., 2003. [KSB]
- Wundt, Wilhelm, « Mission de la philosophie dans le temps présent », Revue philosophique de la France et de l’étranger (Paris), vol. 1, janv.-juin 1876, p. 113-124.
—, « Philosophy in Germany », Mind (Londres), vol. 2, n° 8, oct. 1877, p. 492-518.
www.europhilosophie.eu
12
TEXTES
1
Revue critique d’histoire et de littérature (Paris), vol. 8, n° 39, 26 sept. 1874, p. 206.
169. — Unzeitgemæsse Betrachtungen von Dr Friedrich
NIETZSCHE, Erstes Stück. David Strauss, der Bekenner und der Schriftsteller. Broch. in-8°, 101 p. Leipzig. E. W. Fritzsch. 1873. — Prix : 4 fr.
« De toutes les conséquences fâcheuses que la dernière
guerre avec la France a amenées, la plus fâcheuse, dit M. N., est peut-être cette erreur si répandue, on peut dire cette erreur universelle, que la culture allemande elle aussi a remporté la victoire dans cette guerre… » — « Cette illusion est détestable car elle est capable de transformer notre victoire en un désastre complet qui est l’extirpation de l’esprit allemand au profit de l'empire allemand. » Il ne saurait d’ailleurs être question d’une victoire de la culture allemande, au moins pour cette bonne raison « que la culture française continue d’être comme auparavant et que, comme auparavant, nous en dépendons. » — « Parler de la victoire remportée par la civilisation et la culture allemandes, n’est qu’un quiproquo qui vient de ce qu’en Allemagne l’idée pure de la culture a été perdue » (p. l, 2, 5). Ce défaut d’une culture nationale, continue M. N., nos hommes instruits ne le voient pas ; au contraire ils témoignent d’une satisfaction qui, depuis la dernière guerre, s’épanche bruyamment et à tous propos. Ces hommes méritent le nom de Bildungsphilister. Ce qui distingue la nouvelle espèce de philistins, c’est la prétention qu’affichent ses membres d’être des « fils des Muses et des hommes de culture (Kulturmensch). » Strauss en est l’exemplaire le plus parfait.
www.europhilosophie.eu
13
Le curieux pamphlet de M. N. est donc consacré au célèbre écrivain (encore vivant alors) à l’occasion de la publication de son dernier ouvrage qui eut un si grand retentissement, La foi ancienne et la foi nouvelle. Il ne peut être question ici de l’analyser, encore moins de l’apprécier. Nous nous bornons à attirer l’attention sur cette publication originale, écrite avec une verve extraordinaire. La critique de M. N., il est bon d’en prévenir, n’est point inspirée par son point de vue théologique, mais, — ce qui fait l’intérêt principal du premier morceau des Considérations inopportunes, — par le point de vue littéraire et philosophique que nous avons indiqué plus haut. M. N. s’est en particulier attaqué au style de Strauss avec la même animosité qu’il montre pour sa doctrine.
www.europhilosophie.eu
14
2
Revue critique d’histoire et de littérature (Paris), vol. 8, n° 46, 14 nov. 1874, p. 318-319.
199. — F. NIETZSCHE. Unzeitgemæsse
Betrachtungen. Zweites Stück : Vom Nutzen und Nachtheil der Historie fur das Leben. Leipzig, Fritzsch. 1874. In-8°, vj-111 p.
M. Nietzche [sic.] continue le cours de ses Considérations
inopportunes. Récemment, il attaquait en Strauss1 le représentant le plus éminent des Bildungsphilister, de ceux à qui l’infatuation scientifique inspire un optimisme universel. Aujourd’hui, c’est à la science, à l’érudition même qu’il s’en prend. Par le mot « Historie » il entend toute espèce d’étude du passé, philologie, archéologie ou histoire proprement dite. Prenant pour mot d’ordre les paroles de Gœthe : « Je hais tout ce qui ne fait que m’instruire, sans augmenter ou exciter mon activité, » il raille impitoyablement, avec esprit et souvent avec éloquence, la tendance des Allemands à croire que toute l’éducation consiste à accumuler des connaissances sur le passé. Il montre comment les jeunes gens éblouis, accablés par la variété infinie des faits, des idées, des systèmes qui défilent devant leurs yeux, deviennent incapables de penser par eux-mêmes, de sentir avec fraîcheur, d’agir avec énergie. Il déplore chez ses compatriotes l’absence de personnalité, de caractère, de sens du beau et de la vie ; et il trouve la cause de ces défauts dans l’excès avec lequel la jeunesse est soumise aux travaux d’érudition. « On honore plus, dit-il l’histoire que la vie. Oui, on triomphe de ce que la science commence à diriger la vie. Il est possible qu’on en soit là, mais certes la vie ainsi dirigée n’en vaudra pas mieux ; car elle sera moins vivante et promettra moins de vie pour l’avenir, que la vie d’autrefois 1 Cf. Rev. crit., 1874, n° 39, art. 169.
www.europhilosophie.eu
15
dirigée non par la science mais par des instincts et par de puissantes imaginations2. » Le culte de l’histoire est même une cause de démoralisation, d’abaissement des caractères. « Celui qui a appris à plier l’échine et à courber la tête devant “la puissance de l’histoire,” celui-là donne à la manière mécanique des Chinois son assentiment à toute puissance, que ce soit un gouvernement, une opinion publique ou une majorité numérique, et il se meut correctement en mesure comme une marionnette, quelle que soit la puissance qui tienne le fil3. » Il faut qu’à côté de la connaissance du passé l’homme se nourrisse aussi de ce qui est en dehors de l’histoire (das Unhistorische), c’est-à-dire la vie réelle et active, et de ce qui est au-dessus de l’histoire (das Ueberhistorische), c’est-à-dire le monde idéal de l’art, de la religion et de la poésie.
Les pensées exprimées par M. N. dans cette brochure se trouvent en germe dans Schopenhauer, qui a poursuivi de ses sarcasmes l’étude de l’histoire ainsi que la philosophie hégélienne de l’histoire, d’après laquelle tous les événements s’enchaînent par une nécessité divine, constituent un progrès continu et révèlent le développement logique d’une Idée. Mais M. N. reprenant pour son compte les vues de Schopenhauer les a développées avec une grande chaleur de passion et une verve originale et mordante. Par malheur s’il est disciple de Schopenhauer philosophe, il ne l’est pas de Schopenhauer écrivain. Son style est expressif, sans doute, souvent vigoureux et coloré ; mais il est heurté, incohérent, à la fois abstrait et trivial, plein de recherche et de mauvais goût. Cela est fâcheux, car ces défauts rendent difficile la lecture d’un écrit plein de talent, et assurément digne d’être lu et médité, même hors d’Allemagne.
2 p. 68. 3 p. 81.
www.europhilosophie.eu
16
3
Revue critique d’histoire et de littérature (Paris), vol. 9, n° 4, 23 janv. 1875, p. 63-64.
20. — F. NIETZSCHE. Unzeitgemæsse Betrachtungen.
Drittes Stück : Schopenhauer als Erzieher. Schloss Chemnitz, Schmeitzner. In-8°. 113 p. — Prix : 8 fr.
Cette troisième brochure a été pour nous une déception.
Le titre nous avait fait espérer une œuvre d’une tout autre portée ; nous pensions qu’après avoir, au nom de la philosophie de Schopenhauer, attaqué Strauss et l’érudition des Universités allemandes, l’auteur allait mettre en regard l’éducation telle que Schopenhauer l’a comprise et telle qu’elle devrait être dirigée d’après ses théories. Au lieu de cela, M. Nietzsche s’est contenté de faire une troisième satire contre ses compatriotes en général et contre les savants allemands en particulier. Ses critiques manquent de variété et leur exagération leur enlève une partie de leur force. Il descend même à des personnalités aussi dépourvues de convenance que de vérité, par exemple quand il écrit : « J’aime mieux lire Diogène Laerce que Zeller, car je retrouve du moins chez lui l’esprit des anciens philosophes, tandis que chez Zeller je ne retrouve ni leur esprit ni aucun autre » (p. 101).
Le sujet choisi par M. N. était pourtant du plus haut intérêt. Schopenhauer, après avoir vécu pendant de longues années au milieu de l’indifférence universelle, est devenu aujourd’hui le plus lu et le plus goûté des philosophes allemands. Les officiers l’emportent avec eux en campagne, les hommes du monde et les femmes mêmes s’en nourrissent avec passion. Il vaut certes la peine de se demander quelle influence il peut exercer et quelle éducation il donne à ceux qui se mettent à son école. M. N. aurait pu expliquer plus qu’il ne l’a fait le rôle prédominant que Schopenhauer assigne à l’art et au-dessus de l’art à la sainteté dans la vie humaine, et
www.europhilosophie.eu
17
les préceptes héroïques qu’il tire de sa conception pessimiste du monde. Il aurait cherché à réfuter ceux qui voient dans le pessimisme outré de Schopenhauer, dans son mépris de l’action, dans le cynisme avec lequel il démontre à l’homme non-seulement le néant, mais la bassesse de ses plus sublimes émotions, dans la malédiction dont il frappe la nature entière, les signes d’une philosophie de décadence, faits pour une époque blasée et impuissante. Au lieu de cela, M. N. se contente de retourner sur toutes ses faces une seule idée ; il répète sous cent formes diverses que Schopenhauer était un homme complet, et non un pédant, et que le vrai philosophe doit être avant tout un homme, non un savant, doit être instruit par la vie, non par les livres. On retrouve bien dans certaines parties de cette brochure la verve et l’énergie pittoresques que nous avons signalées dans les précédentes, mais l’ensemble est faible et abondant en redites. Quand M. N. se moque de ceux qui comme Strauss pensent que la fondation de l’empire allemand a porté un coup mortel au pessimisme philosophique, ou de ces vainqueurs de 1870 qui n’ont rien de plus pressé que de copier avec plus d’ardeur que jamais les modes et les actes des vaincus comme des barbares qui auraient été pour la première fois en contact avec la civilisation, nous ne pouvons que le féliciter de sa franchise et de son courage ; mais nous ne saurions approuver sans restriction ses attaques contre la science allemande et les savants allemands. Au milieu de la décadence morale et intellectuelle que M. N. signale en Allemagne et que nous n’avons garde de nier, les travaux scientifiques qui sortent des Universités devraient être pour lui un sujet de consolation et non de colère. Les modestes et laborieux érudits d’aujourd’hui amassent des matériaux qu’utiliseront un jour des esprits généralisateurs et créateurs. Quant aux [sic.] pédantisme et à tous les vices qui en sont la conséquence, ce ne sont pas les protestations de M. N. qui le feront fuir, ni même cette destruction sauvage de tous les livres qu’il prédit avec une sorte de joie ; une seule belle œuvre de poésie ou d’art fera plus pour mettre les pédants en déroute que toutes les injures, plus même que les plus éloquentes apostrophes. Ce n’est pas
www.europhilosophie.eu
18
l’érudition des Universités qui empêche les Allemands d’avoir des écrivains, des poètes, des peintres, des musiciens ; s’ils n’ont en ce moment que des savants, c’est qu’ils ne peuvent pas produire autre chose ; mais grâce à ces savants, ils font encore assez bonne figure en Europe.
www.europhilosophie.eu
19