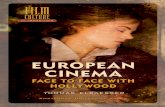Face To Face Proximity Estimation Using Bluetooth on ... - IJESC
Le canada face aux defis environnementaux
-
Upload
usherbrooke -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Le canada face aux defis environnementaux
ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉEFaculté des lettres et sciences humaines
Université de Sherbrooke
LE CAS DES RÉFUGIÉS ENVIRONNEMENTAUX CANADA
parMARIE-CHRISTINE CÔTÉ
RAÏS KIBONGERALPH-ALFRED LEDANMARIE-CLAUDE ROBERT
travail présenté à EMMANUEL CHOQUETTE
dans le cadre du coursGEP113
Analyse et sciences politiques
Table des matièresIntroduction..............................................31. Problématique..........................................41.1 Pertinence sociale..................................41.2 Pertinence scientifique.............................5
2. Considérations théoriques..............................62.1 Cadre générale......................................62.2. Conceptualisation..................................7
3. Question et hypothèse de recherche.....................84. Méthodologie...........................................84.1 Variables et indicateurs............................84.2 Stratégie de recherche..............................9
5.Analyse.................................................95.1 Droit international................................105.2 Pratique du Canada.................................12
Conclusion...............................................14Bibliographie............................................15
iii
Introduction
Le Canada fait partie des pays qui accueillent le plus de
réfugiés et la tendance devrait se maintenir1. Selon les
statistiques du gouvernement canadien, en 2013 il y aurait près
de 24 000 nouveaux réfugiés à avoir obtenu le statut de résident
permanent2.
D’autre part, les changements climatiques actuels pourraient
amener de plus en plus de personnes à quitter leur pays de force.
Cet état des faits amène un nouveau type de demandeurs d’asiles,
les réfugiés environnementaux. Ce concept pose plusieurs
problèmes entre autres, la définition des réfugiés dans la
Convention de Genève : « [...] [personne] craignant avec raison
d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques [et qui] ne veut se réclamer de la
protection de [son] pays […] ».3 Cette définition n’inclut pas les
personnes obligées de quitter leur pays à cause de désastres
climatiques. Donc, un questionnement s’impose : quelles sont les
1 Becklumb, Penny, Parlement du Canada, Les changements climatiques pourraient entraîner la pire crise migratoire de l’histoire de l’humanité, 1er février 2013, http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2010-04-f.htm#a1, (Pageconsultée le 31 octobre 2014).2 Gouvernement du Canada, Les tableaux préliminaires – Résidents permanents et temporaires, 2013, Canada – Résidents permanents par catégorie, 2009-2013, 17 juin 2014, http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2013-preliminaire/01.asp, (Page consultée le 31 octobre 2014).3 Convention internationale relative au statut des réfugiés, Genève, 28 juillet 1951, Article 1-a, alinéa 2.
4
politiques visant à encadrer les réfugiés environnementaux? C’est
ce que nous allons découvrir à travers un examen de la situation.
Ainsi, ce texte vise à comprendre plus en profondeur le phénomène
de réfugié environnemental. En premier lieu, nous démontrerons en
quoi ce phénomène est pertinent dans notre société moderne, mais
aussi dans la communauté scientifique. En second lieu, nous
définirons les concepts entourant cette question. En troisième
lieu, nous poserons notre question de recherche afin d’avoir une
ligne directrice claire pour mener notre analyse. Enfin, nous
émettrons une hypothèse qui sera éprouvée à l’aide d’une étude de
cas. Cette stratégie de vérification comportera deux méthodes de
collectes de données : l’observation documentaire et l’entrevue
semi-dirigée.
5
1. Problématique
Lors de notre recherche préliminaire, nous avons tenté de bien
cerner notre sujet, soit les réfugiés environnementaux.
Effectivement, les prochains paragraphes exposent l’opinion
publique et les réactions de différents membres de la société
quant à ce phénomène. Nous avons également exploré la littérature
scientifique et découvert quelques auteurs qui ont mené des
recherches pertinentes en lien avec ce type de réfugiés. Nous
vous présenterons donc les théories et conclusions que nous avons
retenues et qui dirigeront notre travail jusqu’à sa fin.
1.1 Pertinence sociale
Depuis la fin du XXe siècle, le nombre de migrations forcé dû à
des catastrophes environnementales explose. En effet, d’après un
article du journal Le Devoir, « Les catastrophes naturelles ont
provoqué le déplacement de 21,9 millions de personnes dans le
monde [en 2013] 4 ».
Même si les migrations environnementales surviennent depuis
toujours5, le réchauffement climatique a pour effet d’intensifier
ce phénomène à un point tel que la communauté internationale
appréhende de devoir faire face, sans y être préparée, à un
4 Agence France-Presse, Près de 22 millions de déplacés après des catastrophes naturelles en 2013, Le Devoir, 17 septembre 2014, http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/418677/pres-de-22-millions-de-deplaces-apres-des-catastrophes-naturelles-en-2013, (Page consultée le 21 octobre 2014).5 Vanderstappen, Cécile, « Migrants de l’environnement », Point sud : les études du CNCD-11.11.11, vol n°.11, février 2014, p. 3.
6
nombre toujours grandissant de migrants climatiques6. Selon le
site internet du parlement du Canada, il n’existerait pas, pour
le moment, de mesures prévues pour répondre à cette probable
migration de masse7.
En réaction à ces constats, plusieurs acteurs influents
entreprennent des actions pour sensibiliser le peuple, on pense
entre autres à certains musiciens populaires et à la montée des
groupes activistes tel que « Greenpeace ». Bref, avec les
changements climatiques de plus en plus marqués, le phénomène des
réfugiés environnementaux est plus d’actualité que jamais.
1.2 Pertinence scientifique
Christel Cournil affirme que « le concept de réfugié
environnemental est problématique, car il tend d’une relation
causale simpliste entre environnement et migration8 ». Cette
affirmation nous décrit bien la complexité qui entoure la prise
en compte des réfugiés environnementaux. Analysons le débat
scientifique autour de cette situation afin de mieux comprendre
le problème.
Nous avons compilé et analysé des données de champs d’études
aussi diversifiées que le droit international, les sciences
politiques, la sociologie et l’écologie. Les travaux de plusieurs
6 Becklumb, Penny, Parlement du Canada, Les changements climatiques pourraient […].7 Becklumb, Penny, Parlement du Canada, Les changements climatiques pourraient […].8 Cournil, Christel, Mayer, Benoît, Les migrations environnementales : Enjeux et gouvernance. Paris, Presses de Sciences PO, 2014. 165 pages.
7
scientifiques tels que Luc Cambrézy, Carol Farbotko, Helmut
Geist, Norman Myers et autres constituent l’assise de notre
recherche. Les données quantifiables et qualifiables contenues
dans le présent document proviennent de leurs travaux.
Ainsi, selon ces scientifiques, de plus en plus de rapports
sembleraient indiquer que certaines populations vivant dans les
îles du Pacifique pourraient tout simplement se retrouver sans
territoire à cause de la montée des eaux, entrainant ainsi un
déplacement massif de populations9. Outre la montée des eaux, la
désertification fait partie des pires conséquences des
changements climatiques10. À la suite des recherches de Norman
Myers, les constats faits en 2002 sur la croissance graduelle du
nombre de réfugiés environnementaux prévoyaient une augmentation
de 25 millions à 200 millions du nombre de réfugies pour la
période s’étalant de 1995 à 2050 à travers le monde11.
Cette possibilité de multiplication du nombre de réfugiés et
autres demandeurs d’asile a été renforcée par plusieurs
recherches menées dans certains territoires insulaires12 ou
côtiers du Pacifique13. En bref, ces différents phénomènes ont
pour conséquence d’engendrer un déplacement de population.9 Farbotko, Carol, « Wishful sinking: Disappearing islands, climate refugees and cosmopolitan experimentation», Asia Pacific Viewpoint, avril 2010, p. 47 à 60.10 Geist, Helmut, « The causes and progression of desertification », Aldershot, Ashgate, 2005, p. 192 à 220.11 Myers, Norman, « Environmental refugees: a growing phenomenon of the 21st century» Philosophical transaction of the royal society, Vol. 357 no. 1420, avril 2002, p. 609 à 613.12 McNamaraa, Karen E. and Gibson, Chris, « We do not want to leave our land’: Pacific ambassadors at the United Nations resist the category of climate refugees », Geoforum, Vol. 40, Issue 3, Mai 2009, p. 475 à 483.
8
2. Considérations théoriques
Les aspects vus ci-dessus nous ont aidés à mettre en évidence les
enjeux entourant notre sujet. Afin d’encrer un peu plus le cas
des réfugiés environnementaux dans la réalité, il importe de
définir les concepts entourant cette question et de mettre en
évidences les théories qui peuvent nous aider à interpréter ce
phénomène.
2.1 Cadre générale
En ce qui a trait à l’immigration, les États sont guidés par
différentes théories qui influencent leurs décisions. Dans
« les théories de la migration » de Victor Piché, nous en
considérons deux qui paraissent pertinentes pour notre sujet de
recherche : le libéralisme et le réalisme.
L’auteur nous présente le libéralisme comme étant plus ouvert, et
souligne les avantages économiques de l’ouverture des frontières
et de la collaboration entre les États14. Les partisans de ce
paradigme pensent que l’interdépendance entre les États est si
fragile que les problèmes de l’un nuisent à l’équilibre de la
paix mondiale15. Cependant, les critiques accusent cette théorie
de ne pas prendre en compte les couts liés à l’accueil et aux
services sociaux mis à la disposition des migrants.
13 Cometti, Geremia. « Réchauffement climatique et migrations forcées : le cas de Tuvalu », Nouvelle édition, Genève : Graduate Institute Publications, 2010.14 Piché, Victor, « La théorie des migrations », Édition ined, Paris, 2013, p. 498.15 Batistella, Dario, « Théorie des relations internationales », 3 éd. Mises àjour et argumentée, Presse de Sciences Po, 2009, p. 125.
9
Pour la théorie réaliste, l’auteur la présente comme plus
restrictive, car la migration peut être une menace pour
l’économie et la sécurité dans les pays d’accueil. De plus, Dario
Battistella stipule que « [l]’existence et l’effectivité du droit
international et des institutions de coopération sont fonction de
leur conformité aux intérêts des États les plus puissants. »16
Cette déclaration se rapporte à la théorie réaliste puisque ce
paradigme précise que les États sont guidés par leurs intérêts
sur la scène internationale. Dès lors, elle nous éclaire quant
aux réelles intentions des différents organismes qui militent
pour une prise en charge des réfugiés environnementaux. Aussi,
les points de vue de ces deux auteurs sont assez pertinents pour
notre travail, car ils nous permettent de mieux comprendre les
réponses du Canada relativement à la question de ces réfugiés.
2.2. Conceptualisation
Les deux concepts clés de notre travail sont les réfugiés
environnementaux, car c’est le sujet au cœur de notre recherche
et le concept de droit international, puisque c’est lui qui tente
d’encadrer les procédures à suivre pour les pays concernant les
réfugiés. Afin de bien les saisir, nous vous présenterons des
définitions proposées par différents auteurs et encyclopédies.
Tout d’abord, il existe plusieurs terminologies qui signifient
sensiblement la même chose, telle que réfugiés climatiques,
migrant climatique et réfugiés environnementaux. C’est ce dernier
16 Batistella, Dario, « Théorie des relations […].10
terme que nous utiliserons. L’Organisation des Nations Unies les
définit comme suit :
Des personnes forcées de quitter leurs habitations
traditionnelles d'une façon temporaire ou permanente, à
cause (naturelle ou humaine) d'une dégradation nette de
leur environnement qui bouleverse gravement leur cadre
de vie et/ou qui déséquilibre sérieusement leur qualité
de vie.17
Ensuite, le droit international est une forme de système
juridique qui concerne les États. Il tente de régir les actions
des pays dans le cadre des relations internationales. Le
professeur Jean Combacau définit le droit international public
comme :
Le droit international public est la branche du droit
qui rassemble les règles dont la production et
l'application échappent à l'État agissant
unilatéralement. Dans cette définition, qui caractérise
ce système de droit par l'origine de ses règles et
l'oppose ainsi au « droit interne », aucun élément
matériel, tiré du contenu des règles en cause, n'entre
en ligne de compte, alors que dans l'expression « droit
international privé », les deux adjectifs se réfèrent à
17 Seghier, Carine, Réfugiés environnementaux : bientôt une nouvelle catégorie d'exilés ?, Actu-Environnement, http://www.actu-environnement.com/ae/news/1300.php4, 17 octobre2005, (Page consultée le 24 novembre 2014).
11
l'objet même du droit, qui est de régir des relations
internationales ressortissant au droit privé.18
Tel est le concept qui nous concerne et la définition que nous
utiliserons tout au long de notre travail de recherche.
3. Question et hypothèse de recherche
Le but de ce dossier est de comprendre davantage les politiques
visant à encadrer les réfugiés environnementaux. Lors de notre
recherche sur le sujet, nous avons trouvé peu de documentation
traitant directement de la position du Canada quant à ce
phénomène. Par contre, nous avons trouvé plusieurs articles
traitants de ce sujet dans le cadre du droit international. Ces
constats nous ont amenés à nous demander, dans quelle mesure le
Canada est-il en accord avec le droit international en matière de
réfugiés environnementaux?
L’une des réponses possibles est que le Canada est en accord avec
le droit international puisqu’il n'y a pas de règles spécifiques
encadrant les réfugiés environnementaux dans la Convention de
Genève.
4. Méthodologie
Nous établirons certaines bases méthodologiques que nous suivrons
tout au long de notre travail, afin d’assurer la fiabilité de nos
résultats. Ces bases s’assoient sur des variables, dépendantes et
18 Combacau, Jean, « Droit public international », […].12
indépendantes, desquelles découleront des indicateurs et
finalement une stratégie globale de recherche.
4.1 Variables et indicateurs
Deux variables se trouvent au cœur de notre recherche, soit : le
droit international en matière de réfugiés environnementaux et le
traitement qui leur est réservé par le Canada. Ces variables
viennent préciser les concepts que nous avons vus plus tôt.
Ainsi, notre travail vise à comprendre si l’agissement du Canada
relativement aux réfugiés environnementaux est conforme ou non
avec les mesures recommandées par le droit international. Dans le
cas présent, le droit international en matière de réfugiés
environnementaux devient notre variable indépendante puisque le
Canada s’est engagé à suivre ses directives. Inversement, le
traitement des réfugiés environnementaux de la part du
gouvernement canadien est notre variable dépendante puisque la
pratique du Canada risque d’être influencé par le droit
international.
Maintenant, il faut encrer ces variables dans la réalité à l’aide
d’indicateurs nous servant à mesurer et évaluer la distance entre
la théorie et les faits concrets. C’est la raison pour laquelle
nous avons retenu trois indicateurs soit la Convention de Genève,
les politiques du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR)19 et
les lois et règlements du ministère de la Citoyenneté et de
19 Unhcr, statute of the office of the United Nations high commissioner for refugees, 14 décembre 1950, http://www.unhcr.org/3b66c39e1.pdf, (Page consultée le 7 novembre 2014).
13
l’Immigration du Canada20. Ces deux indicateurs nous serviront de
principaux instruments de mesure.
4.2 Stratégie de recherche
Afin de faciliter la compréhension de notre sujet de recherche et
d’obtenir la réponse à notre question, nous avons choisi
d’effectuer une étude de cas. Dans le cadre de cette étude, nous
allons utiliser deux méthodes de collectes de données, l’entrevue
semi-dirigée et l’observation documentaire.
Pour ce qui est de notre observation documentaire, nous nous
sommes concentrés sur une quinzaine de revues scientifiques qui
traitent de divers enjeux entourant les réfugiés
environnementaux. Nous allons analyser ces différent documents
afin de mieux saisir la complexité du phénomène. Aussi, nous
allons consulter des publications de divers juristes qui, à
partir d’instruments du droit international, essaient de trouver
une protection pour cette nouvelle catégorie de migrants. En ce
qui a trait aux politiques publiques canadiennes, nous allons
analyser des publications gouvernementales en lien avec notre
champ d’intérêt. Cette stratégie bien établie en fonction de nos
lignes directrices nous permettra de mieux comprendre les
activités de cet État. Par contre, puisque ce document comporte
seulement une quinzaine de pages, il nous sera impossible de
traiter de tous les aspects concernant ce sujet, pour cette
raison, nous avons ciblé un angle de vision précis, soit20 Gouvernement du Canada, ministère de l'Immigration et de la Citoyenneté, 1er octobre 2014, http://www.cic.gc.ca/francais/, (page consultée le 7 novembre 2014).
14
l’agissement du Canada en matière de réfugiés environnementaux
vis-à-vis le droit international.
De plus, pour pousser plus loin nos connaissances sur le sujet,
nous avons fait une entrevue avec le professeur Oliver Barsalou
ce qui nous permettra d’obtenir une vision concrète du phénomène.
15
5.Analyse
Maintenant que les bases théoriques de notre recherche sont
posées, passons à l’analyse de ce phénomène. D’abord, nous
verrons en détail ce qui encadre les réfugiés environnementaux
dans le cadre du droit international. Ensuite, nous allons mettre
en évidence les pratiques du Canada quant à ce type de migrants.
Enfin, nous allons conclure avec une discussion qui viendra
confirmer ou infirmer notre hypothèse de départ.
5.1 Droit international
Dans le domaine du droit international, plusieurs options sont
considérées afin d’arriver à une protection des réfugiés
environnementaux. Selon Christel Cournil, « Deux voies sont
envisageables : la première consiste à construire un véritable
droit pour les réfugiés environnementaux et la seconde consiste à
amender le droit international des réfugiés. 21 » De son côté,
Olivier Barsalou, enseignant en relation internationale à
l’Université de Sherbrooke, nous dit « ça me surprendrait
énormément que ce soit un accord de type immigration [qui
encadrerait les réfugiés environnementaux], ce serait [plutôt] un
accord de type relocalisation en finançant des pays tiers pour
accueillir cette population-là […]22 ». Cependant, le concept de
réfugié environnemental entre en contradiction avec les
instruments juridiques déjà en place, car les catastrophes
21 Cournil, Christel, Mayer, Benoît, Les migrations environnementales […]22 Côté, Marie-Christine, Robert, Marie-Claude, Entrevue avec Olivier Barsalou,Université de Sherbrooke, 17 novembre 2014, entrevue (55 minutes).
16
naturelles constituent difficilement des persécutions proprement
dites, ce qui est actuellement le critère premier dans la
définition des réfugiés23.
D’ailleurs, la question des réfugiés environnementaux a longtemps
été divisée par deux écoles de pensée. D’un côté, les
environnementalistes qui pensent que le problème est
nécessairement lié à la dégradation de l’environnement et
imputent la responsabilité aux pays développés. De l’autre, les
sceptiques qui croient que le problème de l’environnement est
l’un des multiples facteurs qui provoquent ces déplacements24.
Comme le stipule Richard Black : « Bien que la dégradation de
l’environnement et les catastrophes puissent être des facteurs
importants dans la décision de migrer […] Leur conceptualisation
comme cause principale est aléatoire intellectuellement, et en
pratique inutile »25.
Bien que l’impact de la civilisation sur le réchauffement
climatique soit maintenant un consensus, la division concernant
les réfugiés environnementaux a longtemps ralenti la mise en
place d’instruments juridiques visant à les protéger26. Cet état
des faits a commencé à changer à la fin du XXe siècle, moment où
23 Convention internationale relative au statut des réfugiés…24 Cournil, Christel, Mayer, Benoît, Les migrations environnementales […]25 Black, Richard, Environmental Refugees : Myth or Reality?, New Issues in Refugee Research, Working paper 34, Unhcr, 2001, http://filebox.vt.edu/users/nkehler/refugeeissues/environment.pdf, (Page consultée le 24 novembre 2014).26 Bates, Diane C, « Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change», Population and Environment, Volume 23, Issue 5, mai 2002, p. 465 à 477.
17
cette question est passée de préoccupation infranationale à
internationale27. Que ce soit à la suite de l’avance de la
désertification28 ou de la montée du niveau de la mer dans le
Pacifique29, les nombreux déplacements de populations ont attiré
l’attention des instances internationales telle le Haut-
commissariat pour les réfugiés (HCR). Ces instances se sont
référées aux institutions encadrant les réfugiés pour demander
des directives spécifiques pour les réfugiés environnementaux, ce
qui, à la longue, conduit à la reconnaissance progressive30 de
cette catégorie de réfugiés et à l’adaptation des lois du droit
international les concernant31. Par contre, la plupart des
documents juridiques concernant le sujet sont flous, ce qui amène
différents États et organisme, peu soucieux de s’occuper de ce
problème, à exploiter ce vide juridique32.
Une déclaration de Luc Cambrézy nous pousse à réfléchir quant aux
véritables volontés des Occidentaux à une prise en charge du
problème : « Dans une situation de très forte tension, la27 William, Angela, « Turning the Tide: Recognizing Climate Change Refugees in International Law», Law & Policy, Vol. 30, No. 4, octobre 2008, p. 502 à 529. 28N. LeHouérou, Henry, « Climate change and desertification, drought and desertification », Journal of Arid Environments, Volume 34, Issue 2, octobre 1996, p.133 à 185. 29 Radio New Zealand, Pacific leaders […].30 Bates, Diane C, « Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change », Population and Environment, Volume 23, Issue 5, mai 2002, p. 465 à 477.31 Manfred, Nowak, Hafner, Gerhard, « Legal Status and Legal Treatment of Environmental Refugees », German federal environment agency, novembre 2010, p. 4 à 15.32 Charlebois, Pierre-Olivier, « Une protection juridique pour le réfugiés environnementaux : approche universelle pour la reconnaisse d'une responsabilité collective », Sécurité Mondiale : programme paix et sécurité internationales, No. 41, novembre 2009, p. 1 à 4.
18
question hautement sensible du contrôle des flux migratoires est
au cœur des débats politiques, il semble évident que
l’élargissement du statut [de réfugiés] n’a aucune chance de voir
le jour dans un avenir prévisible33 ». Affirmation qui reflète
bien la réalité actuelle puisque des mesures migratoires, de plus
en plus restrictives, sont appliquées.
Ainsi nos observations nous ont permis de constater qu’il existe
des balises concertant la reconnaissance des réfugiés
environnementaux et leurs gestions par les pays qui y sont
confrontés. Cependant, le fait qu’elles ne soient pas aussi
solidement implantées que les mesures encadrant les réfugiés de
zone de guerre laisse au gouvernement canadien une immense
latitude d’interprétation dans son traitement des réfugiés
environnementaux.
5.2 Pratique du Canada
Partant de la théorie selon laquelle la réponse à une question
vise à combler l’écart existant entre ce que l’on sait et ce que
l’on cherche à savoir, nous avons approfondi notre recherche afin
de mieux comprendre l’accueil des réfugiés environnementaux au
Canada.
En analysant le système juridique international concernant les
réfugiés classiques, on peut se rendre compte que les pays
s’adaptent au contexte politique des époques. Ainsi, durant la33 Cambrézy, Luc., « Enjeux environnementaux et nouvelles catégories de migrants : de la sémantique à la géopolitique », Pouvoirs, n° 144, 2013, p. 141.
19
période de la guerre froide, les réponses apportées aux réfugiés
classiques ont été considérables. Le Canada a même reçu le prix
Nansen pour sa contribution majeure et soutenue à la cause des
réfugiés34. Ce sont 50 000 réfugiés par années que le Canada a
accueillis durant cette période contre 12 100 en 201035. Qu’est-ce
qui explique cette diminution? Plusieurs facteurs entrent en
ligne de compte, dont l’augmentation des fausses demandes d’asile
politique et le début des débats entourant les réfugiés
environnementaux36. De plus, la règle du tiers pays sûr oblige les
demandeurs du statut du réfugié à faire la demande dans le
premier pays où ils mettront les pieds. Le Canada tire profit de
cette règle puisque, pour venir au Canada, la plupart des vols
d’avions font escale dans un autre pays qui accueille des
réfugiés, ce qui lui permet d’éviter un grand nombre de
demandeurs d’asile37.
Pendant une période où la question de la responsabilité des États
relativement aux problèmes environnementaux est d’actualité, les
déplacés dus aux problèmes climatiques ont en quelque sorte
chargé les États d’une double responsabilité, soit la question de
la migration et la dimension environnementale38. L’actuelle34 Gouvernement du Canada, Le Canada, terre d’asile, 18 juin 2012, http://www.cic.gc.ca/francais/jeux/coin-des-enseignants/refugie/asile.asp/, (Page consultée le 28 novembre 2014). 35 Becklumb, Penny, Changements climatiques et migration forcée : le rôle du Canada, le 9 février 2010, http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2010-04-f.htm, (Page consultée le 28 novembre 2014).36William, Angela, « Turning the Tide: Recognizing Climate Change Refugees in International Law », Law & Policy, Vol. 30, No. 4, octobre 2008, p. 502 à 52937 Côté, Marie-Christine, Robert, Marie-Claude, entrevue avec Olivier Barsalou […].38 Cournil, Christel, Mayer, Benoît, «Les migrations environnementales […].
20
position du gouvernement canadien en comparaison aux autres
membres de l’OCDE a souvent été le choix d’une politique du
strict minimum. Le gouvernement du Canada s’est souvent placé en
situation de transgressions des accords environnementaux allant
même jusqu’à se retirer du protocole de Kyoto en 2012.
Aussi, si l’on se réfère à la théorie réaliste vue selon Victor
Piché, les 200 millions de déplacés prévus dans les années à
venir pourraient constituer une menace à la sécurité et à
l’économie des pays d’accueil39. De la même façon, Luc Cambrézy
nous explique les États sont libres de mener les politiques
migratoires qu’ils veulent40. En effet, la Convention de Genève
donne les grandes lignes sur ce que les États doivent faire
concernant les réfugiés, mais elle laisse l’entière liberté aux
États pour ce qui est de la mise en application, ce qui permet au
Canada d’être extrêmement sélectif dans sa procédure
d’immigration41.
Pour ce qui est de la législation canadienne, nous nous sommes
basés sur un document du Parlement du Canada, où il est stipulé
« [qu’] aucun des volets du programme canadien d’immigration ne
reconnait les réfugiés climatiques42. » Cette absence de
règlementation s’explique par l’encadrement juridique presque
inexistant pour cette catégorie de réfugiés et par l’absence, au
39 Myers, Norman, « Environmental refugees: a growing […].40 Cambrézy, Luc, « Enjeux environnementaux et nouvelles catégories de migrants[…].41 Côté, Marie-Christine, Robert, Marie-Claude, entrevue avec Olivier Barsalou […].42 Becklumb, Penny, Parlement du Canada, Les changements […].
21
Canada, d’une définition claire du terme « réfugié
environnemental »43. Tout comme le résume Chloé Vlassopoulos :
« Les politiques publiques procèdent toujours par [la]
simplification des problèmes qu’elles visent à réguler, mais pour
qu’il y ait politique publique il faut de prime abord que les
problèmes à traiter aient fait l’objet d’une définition claire
[…]. 44»
Malgré ce qui précède, il semblerait qu’un changement s’opère
dans les pratiques du Canada en matière d’immigration et
d’accueil aux réfugiés. On a pu constater que lors de la récente
réforme de 2012 au travers de la loi C-3145, la notion de réfugiés
environnementaux commence à s’intégrer de façon assez timide à la
classification des différentes sortes de réfugiés admissibles au
pays46.
Conclusion
Comme nous l’avions anticipé, nos résultats confirment que le
Canada est en accord avec le droit international en ce qui
concerne les réfugiés environnementaux puisque, dans les deux
43 Cournil, Christel, Mayer, Benoît, «Les migrations environnementales […].44 Vlassopoulos, Chloé Anne, « Des migrants environnementaux aux migrants climatiques : un enjeu définitionnel complexe.» Cultures et conflits, L’Harmattan, no 88, hiver 2012, p. 1245 Canadian House of commun Government Bill, An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act, the Balanced Refugee Reform Act, the Marine Transportation Security Act and the Department of Citizenship and Immigration Act, 28 juin 2012, http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=5383493&Language=E, (page consultée le 5 novembre 2014).46 Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, Refugees & asylum status, mise àjour le 30 septembre 2014, http://www.cic.gc.ca/English/refugees/index.asp, (page consultée le 5 novembre 2014).
22
cas, il n’existe aucun instrument officiel pour encadrer ce type
de réfugiés. Dans le cadre de ce document, nous avons exploré
plusieurs pistes de solution proposée par différents auteurs afin
de remédier à cette situation. Toutefois, étant dans un contexte
migratoire très restrictif ces dernières décennies, les États se
limitent au strict minimum en ce qui concerne l’accueil des
réfugiés classiques sur leur territoire. Alors, quel avenir pour
les réfugiés environnementaux?
Nos recherches nous ont permis de découvrir que, quoiqu’il y ait
une amélioration de la prise en charge de ce phénomène, plusieurs
facteurs constituent une limite à la législation de ce type de
déplacés. Se basant sur la politique du tiers pays sûr, certaines
critiques avancent que le fait que le Canada ne soit pas
directement touché par ce phénomène explique sa position. La
question environnementale qui est un débat très fragile pour le
gouvernement canadien et le contexte migratoire qui constitue un
risque pour la sécurité ainsi que l’économie pourrait également
expliquer l’action du Canada en matière de réfugiés. Enfin, la
question des réfugiés se heurte tant à des problèmes de
conceptualisation qu’aux politiques des États.
D’autre part, comme l’a proposé Olivier Barsalou, une des
solutions envisageables pourrait être un accord type relocalisation
en finançant des pays tiers pour accueillir ces déplacés47.
Actuellement, les pays occidentaux financent des dizaines de
47 Côté, Marie-Christine, Robert, Marie-Claude, entrevue avec Olivier Barsalou […].
23
camps de réfugiés localisés dans des zones où les déplacements
sont accrus. Cependant, divers organismes des droits de l’homme
critiquent les conditions de vie critique qui y règnent. Cette
pratique des États témoigne d’une déresponsabilisation quant à la
Convention et Genève. Est-ce que ces mesures restrictives et
réactionnaires48 apportent une solution ou ne font qu’aggraver les
problèmes migratoires?
Bref, le phénomène des réfugiés environnementaux restera
d’actualité dans les années à venir. Il sera intéressant
d’observer l’évolution de l’action des différents États en la
matière.
48 Piché, Victor « La théorie des migrations » […].24
BibliographieAgence France-Presse, Près de 22 millions de déplacés après des catastrophes naturelles en 2013, Le Devoir, 17 septembre 2014, http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/418677/pres-de-22-millions-de-deplaces-apres-des-catastrophes-naturelles-en-2013, (Page consultée le 21 octobre 2014).
Barbier, Christophe, « La vie en noir », L’Express, n° 3070, 2010, p.11.
Bates, Diane C., « Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change», Population and Environment, Volume 23, Issue 5, May 2002 p.465 à 477.
Becklumb, Penny, Parlement du Canada, Les changements climatiques pourraient entraîner la pire crise migratoire de l’histoire de l’humanité, 1er février2013, http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2010-04-f.htm#a1, (Page consulté le 21 octobre 2014).
Black, Richard, « Environnemental refugees : Myth or reality?», UNHCR working paper, no 24, 2001, p.3 à 18.
Cambrézy, Luc., « Enjeux environnementaux et nouvelles catégoriesde migrants : de la sémantique à la géopolitique », Pouvoirs, n° 144, 2013, p.137 à 147.
Cambrézy, Luc, Lassailly-Jacob, Véronique, « Du consensus de la catastrophe à la surenchère médiatique-introduction », Revue Tiers Monde, n⁰204, 2010, p.7 à 18.
Canadian House of commun Government Bill, An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act, the Balanced Refugee Reform Act, the Marine Transportation Security Act and the Department of Citizenship and Immigration Act, 28 juin 2012, http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?
25
Mode=1&billId=5383493&Language=E (page consultée le 5 novembre 2014).
Charlebois, Pierre-Olivier, « Une protection juridique pour les réfugiés environnementaux : Une approche universelle pour la reconnaissance d’une responsabilité collective », Sécurité mondiale, n°41, 2009, p.1 à 4.
Colard-Fabregoule, Catherine, Cournil, Christel, Changements climatiques et défis du droit, édition Bruylant, Bruxelles, 2010, 450 pages.
Combacau, Jean, « Droit public international », Encyclopædia Universalis [en ligne], http://www.universalis.fr/encyclopedie/droit-international-public/, (Page consultée le 7 novembre 2014).
Convention internationale relative au statut des réfugiés, Genève, 28 juillet 1951.
Cournil, Christel, «Émergence et faisabilité des protections en discussion sur les « réfugiés environnementaux », Revue Tiers Monde,n°204, 2010, p.35 à 54.
Cournil, Christel, Mayer, Benoît, Les migrations environnementales : Enjeux et gouvernance, Paris, Presses de Sciences PO, 2014. 165 pages.
Daussy, Laure, « Le casse-tête du statut des futurs réfugiés climatiques », Le Figaro, 2009.
Dictionnaire Environnement, Réfugiés environnementaux, http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/refugies_environnementaux.php4, (Page consultée le 24 octobre 2014).
Emploi et Développement social Canada, Canadiens en contexte-Immigration, 6 novembre 2014, http://www4.rhdcc.gc.ca/[email protected]?iid=38, (page consultée le 6 novembre 2014).
26
Failler, Pierre, Binet Thomas, « Sénégal. Les pêcheurs migrants :réfugiés climatiques et écologiques », Hommes et migrations, n° 1284, 2010, p.98 à 111.
Farbotko, Carol, « Wishful sinking: Disappearing islands, climaterefugees and cosmopolitan experimentation», Asia Pacific Viewpoint, Vol. 51, Issue 1, April 2010, p.47 à 60.
France-Presse, Agence, « Bush fait son mea-culpa », Le Devoir, 2005, p. a1.
Geist, Helmut, The causes and progression of desertification, Aldershot, Ashgate, 2005, 258 pages.
Gibert, Patrick, Meny, Yves, Thoenig, Jean-Claude, Politiques Publiques, Politiques et management public, 1990, vol. 8, n° 1, p130.
Gonin, Patrick, Lassailly-Jacob, Véronique, « Les réfugiés de l’environnement », REMI, vol. 18, n°2, 2002, p.139 à 160.
Gouvernement du Canada, Les tableaux préliminaires – Résidents permanents et temporaires, 2013, Canada – Résidents permanents par catégorie, 2009-2013, 17 juin 2014, http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2013-preliminaire/01.asp, (Page consulté le 31 octobre 2014).
Gouvernement du Canada, Lois et règlements, Citoyenneté et ImmigrationCanada, 2014, http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/lois-reglements/index.asp, (Page consultée le 24 octbore 2014).
Green L., Nancy, « Concepts historiques des flux migratoires : dualités et fausses découvertes », Revue internationale et stratégique vol n° 50, février 2003, p.79 à 84-609 à 613.
Harguindéguy, Jean-Baptiste, Policy development, Encyclopedia of governance, 2007, Thousand Oaks, Canada, SAGE Publications, Inc. p.692 à 693.
27
Lochak, Danièle, « Qu'est-ce qu'un réfugié? La construction politique d'une catégorie juridique », Pouvoirs, n⁰144, 2013, p.33à 47.
Manfred Nowak, Hafner, Gerhard, «Legal Status and Legal Treatmentof Environmental Refugees», german federal environment agency, november 2010, p.4 à 15.
Mcnamara, Karen E., Gibson Chris, « Mobilité humain et changements environnementaux : Une analyse historique et textuelle de la politique de nation Unies », Cultures et conflits/ L’Harmattan, no 88, 2012, p.45 à 61.
McNamaraa, Karen E., and Gibson, Chris, « We do not want to leaveour land’: Pacific ambassadors at the United Nations resist the category of ‘climate refugees », Geoforum, Vol. 40, Issue 3, May 2009, p475 à 483.
McNutt, Marcia, « Climate Change Impacts », Science, Vol.341, no.6145, August 2013, p.435.
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, Refugees & asylum status, mise à jour le 30 septembre 2014,http://www.cic.gc.ca/English/refugees/index.asp (page consultée le 5 novembre 2014).
Muller, Pierre, Les politiques publiques, 10e éd., Paris, Presses Universitaires de France « Que sais-je? », ISBN : 9782130625742, 2013, p.20.
Morel, Michèle et Moor, Nicole, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit international? », Cultures & Conflits, n⁰88, 2012, p.61 à 84.
Myers, Norman, Kent, Jennifer, Environmental exodus: An emergent crisis in the global arena, Oxford University, 1995, 246 pages.
28
Myers, Norman, « Environmental refugees: a growing phenomenon of the 21st century» Philosophical transaction of the royal society,Vol. 357 no. 1420, April 2002, p.609-613.
N. LeHouérou, Henry, « Climate change and desertification, drought and desertification», Journal of Arid Environments, Volume 34, Issue 2, October 1996, p.133 à 185.
Noblet, Melinda, Planèete urgence, Réfugiés environnementaux : les actions possibles, France, 2009, 75 pages.
Programme Environnemental des Nations Unies (PENU), http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/refugies_environnementaux.php4.
Radio New Zealand, Pacific leaders demand urgent action to stop sea levels from rising, http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/174311/pacific-leaders-demand-urgent-action-to-stop-sea-levels-from-rising, Décembre 2007 (page consultée le 30 octobre 2014).
Schade, Jeanette, « Les migrants des politiques climatiques : nouveaux défis face aux déplacements générés par le changement climatique », Cultures & Conflits, n⁰88, 2012, p.85 à 110.
Science-Presse, Agence, Quel avenir pour les réfugiés climatiques?, Agence Science-Presse, décembre 2013, http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2013/12/16/avenir-pour-refugies-climatiques, (Page consultée le 17 octobre 2014).
Seghier, Carine, Réfugiés environnementaux : bientôt une nouvelle catégorie d'exilés ?, Actu-Environnement, http://www.actu-environnement.com/ae/news/1300.php4, 17 octobre 2005, (Page consultée le 24 novembre 2014).
Terranova, Giuseppe et Herzog, Nathanaël, « Géopolitique des réfugiés climatiques », Outre-terre, n⁰35-36, 2013, p.91 à 97.
29
Vanderstappen, Cécile, « Migrants de l’environnement », Point sud : les études du CNCD-11.11.11, vol n°.11, février 2014, 30 pages.
Vyas, Karishma, Agence France-Presse, Aux Maldives, la lutte contre le réchauffement est une question de survie, Journal Internet, décembre 2008,http://www.ladepeche.fr/article/2008/12/04/504560-maldives-lutte-contre-rechauffement-est-question-survie.html, (Page consultée le17 octobre 2014).
Vlassopoulou, Chloé Anne, « Des migrants environnementaux aux migrants climatiques : Un enjeu définitionnel complexe », Cultures et conflits/L’Harmattan, 2012, p.7 à 19.
Vlassopoulou, Chloé Anne, « L’environnement source de migrations », Asylon(s), n°6, novembre 2008, http://www.reseau-terra.eu/rubrique154.html, (Page consultée le 17 octobre 2014).
Withol de Wenden, Catherine, « Les enjeux migratoires comme facteurs de recomposition des sphères d’influence », Revue internationale et stratégique, no 80, Avril 2010, p.75-83.
William, Angela, « Turning the Tide: Recognizing Climate Change Refugees in International Law», Law & Policy, Vol. 30, No. 4, October 2008, p.502 à 529.
Zaenzig, Raoul et Piquet, Etienne, « Migration et changement climatique en Amérique Latine : Quels enjeux », La revue électronique en sciences de l’environnement, Volume 11, n⁰3, 2012, p.2 à 18.
30