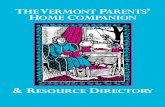Les parents de nourrissons face aux prescriptions diététiques et nutritionnelles
-
Upload
nationalagriculturalresearchinra -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Les parents de nourrissons face aux prescriptions diététiques et nutritionnelles
Séverine Gojard
Les parents de nourrissons face aux prescriptions diététiques etnutritionnellesIn: Recherches et Prévisions, N. 57-58, Septembre – décembre 1999. Petite enfance, normes et socialisation :points de vue. pp. 59-73.
RésuméLa diversité des normes portant sur l'alimentation dans la prime enfance est-elle créatrice d'anomie? L 'étude des pratiquesd'alimentation des nourrissons permet de répondre à cette question. Les âges d'introduction de la viande et des légumes dansl'alimentation des nourrissons présentent des régularités statistiques, ce qui écarte l'idée d'une situation d'anomie généralisée.Les étapes de la diversification alimentaire et l'ajout de sucre ou de sel permettent de mettre en évidence des comportementsd'éducation alimentaire. Ces comportements sont pour partie liés à la consultation de manuels de puériculture. Ils sont aussi, etsurtout, socialement déterminés. Dans l'ensemble, les femmes de milieux populaires se caractérisent par une plus grandeindifférence vis-à-vis des prescriptions diététiques, celles des milieux supérieurs pratiquent une application souple de cesprescriptions, et les femmes de milieux intermédiaires, surtout si elles sont en situation d'ascension sociale, sont celles qui lesmettent en pratique de la manière la plus scrupuleuse.
Citer ce document / Cite this document :
Gojard Séverine. Les parents de nourrissons face aux prescriptions diététiques et nutritionnelles. In: Recherches et Prévisions,N. 57-58, Septembre – décembre 1999. Petite enfance, normes et socialisation : points de vue. pp. 59-73.
doi : 10.3406/caf.1999.1862
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/caf_1149-1590_1999_num_57_1_1862
Les parents de nourrissons face aux
prescriptions diététiques et nutritionnelles
Séverine Gojard *
La diversité des normes portant sur V alimentation dans la prime enfance est-elle créatrice d'anomie ? L 'étude des pratiques d'alimentation des nourrissons permet de répondre à cette question. Les âges d'introduction de la viande et des légumes dans l'alimentation des nourrissons présentent des régularités statistiques, ce qui écarte l'idée d'une situation d'anomie généralisée. Les étapes de la diversification alimentaire et l'ajout de sucre ou de sel permettent de mettre en évidence des comportements d'éducation alimentaire. Ces comportements sont pour partie liés à la consultation de manuels de puériculture. Ils sont aussi, et surtout, socialement déterminés. Dans l'ensemble, les femmes de milieux populaires se caractérisent par une plus grande indifférence vis-à-vis des prescriptions diététiques, celles des milieux supérieurs pratiquent une application souple de ces prescriptions, et les femmes de milieux intermédiaires, surtout si elles sont en situation d'ascension sociale, sont celles qui les mettent en pratique de la manière la plus scrupuleuse.
» INRA/CORELA. Chargée de recherche.
a recherche partait du constat de la diversité des normes concernant les calendriers de diversification
alimentaire (1). L'objectif initial était de voir dans quelle mesure les parents suivaient les prescriptions qui leur étaient délivrées en matière de diversification alimentaire. On a donc cherché à constituer un calendrier correspondant à ce qui est prescrit par les spécialistes (médecins, auteurs de manuels de puériculture, spécialistes de la petite enfance) afin de le comparer aux pratiques des parents.
Plusieurs ouvrages ont été consultés (2) à la recherche de « la » norme de diversification alimentaire. On a alors découvert que les calendriers étaient variables d'un manuel à l'autre et que les âges indiqués étaient souvent vagues : certains auteurs n'indiquent qu'une fourchette très large,
sant qu'il n'y a guère de norme fixe et que le choix doit être laissé au pédiatre de l'enfant ; d'autres n'hésitent pas à se contredire d'une ligne à l'autre (3).
Les conseils des médecins sont loin d'être unanimes
On peut être tenté de relier ces variations aux caractéristiques des auteurs de manuels de puériculture (médecins, puéricultrices, psychologues, ouvrages collectifs). Cependant, les médecins eux-mêmes ne sont unanimes ni sur les âges auxquels il faut commencer la diversification ni sur l'aii- mentpar lequel il faut commencer. Le simple fait qu'au programme de formation médicale continue du Salon de la médecine (Medec) figurent régulièrement des conférences consacrées à la diversification
59 RECHERCHES ET PRÉVISIONS W 57/M - f «M
alimentaire, est un indice de l'évolution des connaissances médicales en la matière et de la volonté d'uniformiser les conseils donnés par les différents praticiens. Par exemple, à la séance de formation continue consacrée à la diversification alimentaire en 1995, les réponses des médecins présents à un petit sondage sur les conseils qu'ils donnent à leurs patients sont loin d'être unanimes : plus du quart diversifient à trois mois ou avant, le tiers à quatre mois, près du quart à six mois ou plus. Quant à l'aliment introduit en premier, un quart commencent par prescrire des farines, autant prescrivent du jus d'orange, plus du tiers commencent par les légumes, environ un sur dix par les fruits (4).
Ces variations peuvent dépendre de la spécialité (généraliste ou pédiatre) et de l'âge. En effet, les normes d'introduction des aliments dans l'alimentation de l'enfant ont subi de fortes variations au cours des dernières décennies (5). Par conséquent, la période à laquelle un médecin a fait ses études peut avoir une influence sur ses connaissances en matière de diversification alimentaire, donc sur les conseils qu'il donne à ses patients.
Incohérence des divers conseils
Les changements dans les calendriers de diversification des modèles jouent aussi sur les conseils d'origine non médicale : ce que conseillent les grands-parents ou les membres de l'entourage (voisins, amis, frères et sœurs) est en général fondé sur ce qu'eux- mêmes ont fait en élevant leurs propres enfants, donc sur ce qui se faisait à l'époque. Il n'y a aucune raison pour que ces conseils soient conformes à ce que prescrivent les médecins. Un autre élément de complication est sans doute à trouver dans l'expérience propre des parents : à partir du moment où ils ont plus d'un enfant, ils peuvent prendre de l'autonomie par rapport aux prescriptions, ou continuer à les appliquer aussi rigoureusement.
Par ailleurs, travaillant sur l'alimentation dans la petite enfance, l'auteur de l'article
a eu de nombreuses discussions, que ce soit avec des enquêtées au cours d'entretiens ou avec des amies, sur la diversification alimentaire, et un thème récurrent de ces discussions était l'incohérence des divers conseils. Les jeunes mères se posent parfois des questions très précises (comme l'âge exact à partir duquel on peut donner des carottes au bébé) ; dans ces cas, elles se satisfont mal de réponses vagues ou de l'invocation de l'instinct maternel censé leur dicter leur conduite.
Pour théoriser un peu, la question qui se pose est la suivante : la concurrence de normes non compatibles entre elles est-elle créatrice d'anomie ? Sinon, comment cette concurrence est-elle organisée ? En effet, si l'on n'est pas dans une situation d'anomie, c'est qu'il existe une forme de hiérarchisation entre les normes ou bien de segmentation, situation dans laquelle différentes catégories de la population appliquent différentes normes. L'analyse des pratiques d'alimentation des nourrissons donne des éléments de réponse à ces questions.
Dans la mesure où les données dont on dispose sont disponibles uniquement pour les enfants qui ont déjà commencé à consommer les aliments qu'on considère, une précaution consiste à s'assurer que les distributions observées ne sont pas biaisées. Lorsqu'on travaille uniquement sur les mères qui ont répondu que leur enfant avait commencé à consommer tel ou tel aliment, on néglige une partie de l'information, celle qui concerne les enfants âgés de tel âge et qui n'ont pas encore commencé à consommer l'aliment considéré. On tend donc, potentiellement, à sous-estimer la fréquence des diversifications tardives. Sur les graphiques 1 à 4 (6), on compare, pour chaque aliment, la distribution observée et la distribution estimée, ainsi que les valeurs de la moyenne et de la médiane pour la distribution observée et pour la distribution estimée.
Sur les graphiques 2 à 4, les écarts entre les deux courbes sont faibles et si les âges moyens diffèrent légèrement, les âges médians en revanche sont égaux. Pour le
60 RBCHmCHESETPRÊVtStONSfrST/Sa-IBM
graphique 1, les écarts entre les courbes sont plus élevés, et la moyenne et la médiane sont nettement modifiées par l'estimation de la distribution. En effet, non seulement c'est dans le cas du jus de fruits que le taux de censure (pourcentage d'enfants qui n'ont pas encore commencé à consommer l'aliment) est le plus élevé, mais si onregarde les âges des enfants qui n'ont pas encore commencé à boire du jus de fruits, on remarque que 90 % ont plus de trois mois. Il est donc normal que la prise en compte de l'âge de l'enfant quand il ne boit pas encore de jus de fruits décale la distribution vers la droite. Pour les légumes, le taux de censure est extrêmement faible et plus de la moitié des enfants qui n'en mangent pas encore ont moins de trois mois et demi. Pour la viande et le poisson, les trois quarts des enfants qui n'en mangent pas encore ont, respectivement, moins de six et sept mois.
Le jus de fruits à un mois ou quatre mois ?
Ces résultats montrent un reflet de l'extrême variété des normes portant sur le jus de fruits. Certains auteurs recommandent
de faire boire aux nourrissons un peu de jus d'orange dès un mois, par souci d'apport vitaminé ; d'autres estiment qu'il faut attendre l'âge de quatre mois, parce que les jus de fruits sont acides, et peuvent entraîner des réactions allergiques ou des régurgitations. En outre, selon sa présentation, le jus de fruits peut être administré plus ou moins tôt ; des ampoules de jus d'orange « spécial bébé » vendues en pharmacie sont sans doute susceptibles d'être administrées plus tôt au bébé que du jus d'orange « standard ».
Par ailleurs, la formulation de la question (« votre enfant boit-il du jus de fruits ? si oui, depuis quel âge ? ») est telle que peut apparaître comme ne buvant pas de jus de fruits un enfant qui n'en boit plus. On pense, par exemple, à des enfants à qui leur mère donnerait des fruits pour l'apport vitami- nique et de l'eau comme boisson. La consommation de jus de fruits dans la prime enfance est essentiellement un substitut aux compotes et aux fruits frais. En revanche, lorsque l'enfant grandit et mange des fruits, les jus de fruits peuvent être abandonnés au profit d'autres boissons sucrées, ou de l'eau. Cela peut expliquer la présence dans l'échantillon d'enfants non consom-
L'enquête
Une enquête spécifique a été menée en avril 1997 (1) auprès de mères d'enfants de moins de trois ans tirées au sort parmi les allocataires de la caisse d'Allocations familiales du Val-de-Marne. On se base ici sur l'analyse statistique de données d'enquête. Un questionnaire -centré sur l'alimentation de l'enfant, sur l'apprentissage par la mère des soins aux jeunes enfants, sur l'organisation de la vie quotidienne - a été envoyé par la poste à 4 000 mères, dont 45 % ont répondu à l'enquête. Deux ensembles de questions ont été essentiellement utilisés. Le premier porte sur la diversification alimentaire : il s'agit de questions ouvertes portant sur l'âge à partir duquel l'enfant a commencé à boire du jus de fruits, manger des légumes, de la viande ou du poisson. Le second concerne l'ajout de sucre et de sel dans les aliments du bébé. Ici, un précodage a été imposé en trois fréquences : jamais, de temps en temps, toujours. La différence entre ces deux ensembles de questions est que pour le premier coexistent de nombreuses prescriptions contradictoires, tandis que, pour le second, les prescriptions négatives semblent faire l'objet d'un consensus entre les spécialistes, mais sont diffusées avec plus ou moins d'insistance. Par exemple, en PMI, l'information sur le sucre est omniprésente, du moins dans les centres visités. Elle est beaucoup plus discrète ou inexistante sur le sel.
(1) Pour de plus amples renseignements concernant l'enquête, voir Gojard S., L'allaitement : une pratique socialement différenciée, Recherches et Prévisions, 1998, n° 53.
61 RECHBiCHES ET PRÉVISIONS W S7/SB - 199»
mateurs de jus de fruits et relativement âgés (plus de six mois). Dans la suite de l'article, on laissera de côté l'étude de l'âge d'introduction du jus de fruits. Retenons simplement que la distribution (même estimée) est assez régulière, ce qui traduit la régularité des comportements.
L'âge d'introduction des légumes se situe rarement avant trois mois ou après sept (graphique 2). C'est sans doute lié au fait que les normes d'introduction des légumes sont relativement homogènes. Les légumes suscitent moins de controverses que le jus de fruits, et on recommande rarement de les introduire avant trois mois ou après quatre (sauf pour certains légumes difficiles à digérer comme le chou par exemple).
De la viande et du poisson à six mois
L'introduction des aliments protidiques que sont le poisson et la viande (7) se produit de façon similaire (graphiques 3 et 4). Dans le cas de la viande comme dans celui du poisson, l'âge modal d'introduction correspond à la norme actuellement la plus répandue, soit six mois. Mais plus du tiers des enfants ont commencé à manger du poisson ou de la viande avant cet âge, et la distribution est très étalée sur la droite : si plus de 80 % des enfants ont commencé à manger du poisson ou de la viande à l'âge de neuf mois, il faut attendre deux ans (pour la viande) ou près de deux ans et demi (pour le poisson) pour que la totalité des enfants en mangent.
Le lien entre âge d'introduction de la viande et âge d'introduction du poisson se vérifie en regardant le coefficient de corrélation linéaire entre ces deux variables, qui est extrêmement élevé (de l'ordre de 80 %). Par la suite, on se contentera d'étudier l'âge d'introduction de la viande. Les coefficients de corrélation entre l'âge d'introduction du poisson ou de la viande et celui des légumes sont moindres, mais encore relativement élevés : de l'ordre de 60 % avec l'âge d'introduction des légumes. Les parents qui introduisent des légumes de manière précoce
dans l'alimentation de leurs nourrissons tendent aussi à introduire de la viande de manière précoce, et inversement.
La dispersion observée sur les variables d'âge d'introduction des aliments permet d'effectuer un découpage en trois modalités : introduction conforme à l'âge médian (8), introduction précoce, et introduction tardive. On constate que les âges médians d'introduction de ces divers aliments correspondent à peu près au calendrier de diversification standard [tel qu'on le trouve dans le manuel de Laurence Pernoud (9), ce qui ne signifie évidemment pas que les parents qui pratiquent la diversification à ces âges ont lu ce livre]. Le calendrier obtenu à partir des âges médians est suivi par environ un tiers de l'échantillon (tableau 1).
L'étude statistique des calendriers de diversification pratiqués par les parents montre qu'on n'est pas dans une situation anomique, puisqu'une fraction non négligeable de parents pratiquent des calendriers de diversification similaires. La dispersion des variables indique toutefois que cette norme de comportement (quelle que soit sa provenance) est appliquée avec souplesse, sans doute parce qu'elle subit la concurrence d'autres modèles de diversification alimentaires, certains plus précoces, d'autres plus tardifs (10).
Le sel est préféré au sucre
L'autre aspect diététique envisagé dans l'enquête concerne l'ajout de sucre ou de sel dans les aliments du bébé. Dans un cas comme dans l'autre, l'abstention renvoie à des préoccupations d'éducation du goût comme à des préoccupations d'ordre sanitaire (prévention de l'obésité pour le sucre, de l'hypertension pour le sel). Toutefois, d'après ce qui a pu être constaté, le conseil de ne jamais rajouter de sucre est plus souvent donné que celui de ne jamais saler. Par exemple, en PMI, une abondante publicité est faite aux méfaits du sucre, mais ceux du sel sont moins souvent mentionnés (11).
62 RECHB*CHES ET PRÉVISIONS fTST/SB- 1999
Graphique 1 - Diversification alimentaire : jus de fruits
% 40-
35-
30-
25-
20-
15
10
5H
0
moyenne observée : 4,5 mois moyenne estimée : 7 mois médiane observée : 3 mois médiane estimée : 4 mois taux de censure : 17 %
-il
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Age en mois
■ Données observées B Données estimées |
Source : Enquête CNAF-INRA, 1997.
Graphique 2 - Diversification alimentaire : légumes
% 45- 40- 35 30 25- 20- 15- 10- 5- 0
moyenne observée : 4 mois moyenne estimée : 4,5 mois médiane observée : 4 mois médiane estimée : 4 mois taux de censure : 5 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Age en mois
I Données observées O Données estimées
Source : Enquête CNAF-INRA, 1997.
Taux de censure : représente le pourcentage d'enfants qui, à la date de l'enquête, n'avaient pas encore commencé à consommer l'aliment considéré. La moyenne observée est calculée sur les seuls enfants ayant commencé à consommer cet aliment alors que la moyenne estimée se rapporte à toute la population.
63 ACCMERCMES ET PRÉVISIONS M" S7/BB ■ 199»
Graphique 3 - Diversification alimentaire : viande
40-
35-
30-
25-
20-
15-
10-
5-
0
moyenne observée : 6 mois moyenne estimée : 6,5 mois médiane observée : 6 mois médiane estimée : 6 mois taux de censure : 13 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Age en mois
I Données observées O Données estimées
Source : Enquête CNAF-INRA, 1997.
Graphique 4 - Diversification alimentaire : poisson
% 40-1
35
30-
25-
20-
15-
10-
5-
0
moyenne observée : 6 mois moyenne estimée : 7 mois médiane observée : 6 mois médiane estimée : 6 mois taux de censure : 14 %
123456789 10111213141516171819 20 2122 23 24 25 26 27 28 Age en mois
I Données observées M Données estimées
Source : Enquête CNAF-INRA, 1997.
64 RECHERCHES ET PRÉVISIONS M* 67/68 - 1998
On constate effectivement (tableau 2) que les prescriptions négatives sur le sucre sont dans l'ensemble plus suivies que celles sur le sel : environ un tiers des parents ajoutent du sel systématiquement dans les aliments du nourrisson ; pour le sucre, l'ajout systématique concerne seulement un parent sur dix. Les modalités correspondant aux fréquences moyennes (de temps en temps) représentent à peu près les mêmes pourcentages pour le sucre et pour le sel, soit moins de la moitié de l'échantillon. Le quart des mères ne salent jamais, tandis que 45 % ne sucrent jamais.
Diversification alimentaire et ajout de sucre ou de sel sont liés : on observe des corrélations entre fréquence d'ajout de sucre ou de sel et introduction d'une alimentation diversifiée. Globalement, l'introduction précoce des aliments s'accompagne d'une application des interdits portant sur le sucre et le sel (12); l'introduction tardive est souvent accompagnée d'un ajout systématique de sucre et de sel. Par exemple, parmi les mères qui sucrent systématiquement les
aliments de leur plus jeune enfant, 32 % donnent des légumes après quatre mois et 27 % donnent de la viande après six mois (diversification tardive) ; pour celles qui ne sucrent jamais on obtient, respectivement, 25 % et 22 %. Inversement, parmi celles qui ne sucrent jamais, 46 % donnent des légumes avant quatre mois, et 44 % donnent de la viande avant six mois (diversification précoce) ; pour celles qui sucrent systématiquement, on obtient, respectivement, 37 % et 31 %.
Une cohérence des principes éducatifs
Plus généralement, on remarque aussi des corrélations entre respect des normes diététiques et attitudes éducatives, lorsque l'enfantrefuse de manger ce qu'onlui donne, ou inversement lorsqu'il réclame à manger en dehors des heures de repas. En croisant ces variables avec la fréquence d'ajout de sucre, on obtient les résultats les plus convaincants (et les plus significatifs au
Tableau 1 - Les calendriers de diversification
Introduction précoce Introduction normale Introduction tardive
Légumes - norme : 4 mois
%
43 30 27
Effectifs (1)
732 503 459
Viande - norme : 6 mois
%
40 36 24
Effectifs (1)
612 551 378
Source : Enquête CNAF-INRA, 1997. (1) 122 non-réponses à la question sur l'âge d'introduction des légumes et 275 sur l'âge d'introduction de la viande. Lecture du tableau : 43 % des mères (soit 732) ont commencé à faire manger des légumes à leur plus jeune enfant avant l'âge de quatre mois.
Tableau 2 - Ajout de sucre et de sel dans les aliments du nourrisson
Oui, toujours Oui, de temps en temps Non, jamais
Ajout de sucre dans les aliments
%
10 45 45
Effectifs
182 812 822
Ajout de sel dans les aliments
%
32 43 25
Effectifs
590 778 448
Source : Enquête CNAF-INRA, 1997. Lecture du tableau : 45 % des mères (soit 822) ne rajoutent jamais de sucre dans les aliments de leur plus jeune enfant.
65 AECHERCHES ET PRÉVISIONS W ST/Sê - 1 000
sens statistiques). En effet, des différents aspects d'éducation alimentaire considérés, le fait de ne pas rajouter de sucre dans les aliments du bébé est celui qui relève le plus d'une application consciente d'une norme diététique (13). La réaction des parents lorsque l'enfant réclame à manger en dehors des repas, ou lorsqu'il refuse de manger ce qu'on lui sert, relève elle aussi d'une mise en application de principes (quoiqu'elle ne soit pas toujours consciente). Ce qu'on met ici en évidence est la cohérence des principes éducatifs.
Le respect des prescriptions négatives sur le sucre s'accompagne d'une attitude plus stricte face au comportement alimentaire de l'enfant (tableau 3) : les parents qui ne rajoutent jamais de sucre dans les aliments de leur plus jeune enfant sont les moins nombreux à lui servir autre chose ou à adopter une attitude de négociation lorsque l'enfant rechigne à manger, mais sont les plus nombreux à insister ou à considérer que le repas est fini. Inversement, ceux qui rajoutent systématiquement du sucre semblent plus conciliants, et sont les plus nombreux à lui servir autre chose (14).
Les choix des parents, reflets de leurs conceptions éducatives
On observe un effet similaire lorsqu'on regarde le lien avec l'attitude adoptée par les parents quand l'enfant réclame à manger en dehors des repas (tableau 4). Là encore, les mères qui ne sucrent jamais les aliments de leurs enfants sont surreprésentées parmi celles qui ont les attitudes les plus strictes concernant le respect des horaires de repas, tandis que celles qui sucrent systématiquement ont tendance, au contraire, à avoir une attitude plus souple. Les choix que les parents mettent en œuvre dans l'alimentation de leur petit enfant sont donc le reflet de leurs conceptions éducatives. De nombreux travaux (15) ont montré que les conceptions éducatives sont liées au milieu social.
Si on croise les variables précédemment étudiées avec les sources de conseil
mentionnées par la mère, les corrélations sont la plupart du temps non significatives, à l'exception notable des sources écrites. En effet, la consultation de livres de puériculture s'accompagne d'un plus grand respect des prescriptions négatives portant sur le sucre (tableau 5). On obtient des résultats similaires en croisant la consultation de livres et l'ajout de sel dans les aliments de l'enfant.
Les livres de puériculture : source de conseil
En ce qui concerne la diversification alimentaire, on constate que la consultation fréquente de livres spécialisés favorise une introduction conforme à la norme ou précoce des différents aliments, et tend à défavoriser une introduction plus tardive. Ces résultats correspondent avec les prescriptions des manuels. On a mentionné que les calendriers construits à partir des âges modaux d'introduction des aliments correspondent au calendrier type du livre de L. Pernoud. Or, du moins parmi les manuels consultés, le calendrier de L. Pernoud est un des moins précoces. On observe globalement une correspondance entre les pratiques des parents et les prescriptions des livres qu'ils consultent (16).
L'absence de corrélation entre les variables de comportement étudiées et le recours aux autres diffuseurs de conseils est complexe à interpréter en raison de l'absence d'information sur les conseils qu'ils donnent. Si la consultation de manuels est aisée, en revanche, l'accès aux conseils donnés par les pédiatres, les membres de la famille ou les amis l'est nettement moins. On ne peut donc pas savoir si l'absence de corrélation entre recours à tel ou tel conseiller et éducation alimentaire est liée à l'attitude des parents qui ne suivent pas les conseils reçus, ou à l'absence d'homogénéité des conseils délivrés par ces différents conseillers. En d'autres termes, les données sont compatibles avec l'hypothèse suivante : lespédiatres ne sontpas d'accord entre eux sur les calendriers de diversification (chacun conseille un âge
66 RECHERCHES ET PRÉVISIONS W «7/88 - «M»
Tableau 3 - Fréquence d'ajout de sucre dans les aliments du plus jeune enfant et attitude lorsqu'il ne finit pas son plat ou refuse de manger ce qu'on lui propose
Insister pour qu'il le mange Considérer qu'il n'a plus faim et que le repas est fini Négocier pour qu'il en mange au moins un peu Lui servir autre chose
Ensemble %
Effectifs
Jamais
(en %)
46 53 39 43
45
789
De temps en temps (en %)
45 38 50 46
45
799
Toujours
(en %)
9 9
11 11
10
181
Ensemble
%
18 27 43 12
100
Effectifs
315 483 757 214
1769
Source : Enquête CNAF-INRA, 1997. Lecture du tableau : parmi ceux qui insistent pour que leur enfant mange ce qu'ils lui proposent, 46 % ne sucrent jamais ses aliments. Seuil de significativité du test du yf : 0,1 %. Les chiffres en vert, les plus fortes surreprésentations (47 non-réponses).
Tableau 4 - Fréquence d'ajout de sucre dans les aliments du plus jeune enfant et attitude lorsqu'il réclame à manger en dehors des repas
Lui donner à manger, tout ce qu'il réclame Lui donner à manger, en choisissant Refuser Sans objet (ne réclame jamais)
Ensemble %
Effectifs
Jamais
(en %)
39 43 50 54
45
776
De temps en temps (en %)
45 46 43 40
45
782
Toujours
(en %)
16 11 7 6
10
180
Ensemble
%
11 64 15 10
100
Effectifs
198 1107 259 177
1741
Source : Enquête CNAF-INRA, 1997. Lecture du tableau : parmi ceux qui donnent à manger à leur enfant en dehors des repas, tout ce qu'il réclame, 39 % ne sucrent jamais ses aliments. Seuil de significativité du test du y£ : 0,1 %. Les chiffres en vert, les plus fortes surreprésentations (75 non-réponses).
Tableau 5 - Ajout de sucre dans les aliments du plus jeune enfant et consultation de livres spécialisés
Livres cités en premier parmi les sources de conseils Livres cités en seconde position ou plus Livres jamais cités comme source de conseils
Ensemble
Jamais
(en %)
48 44 45
45
De temps en temps (en %)
43 48 43
45
Toujours
(en %)
9 8
12
10
Ensemble
%
19 36 45
100
Effectifs
353 650 813
1816
Source : Enquête CNAF-INRA, 1997. Lecture du tableau : parmi ceux qui citent en premier les livres comme source de conseils, 48 % ne sucrent jamais les journeaux
67 RECHERCHES ET PRÉVISIONS AT 67/56 - 1 MS
Tableau 6 - Diplôme de la mère et âge d'introduction des légumes
Diplôme le plus élevé détenu par la mère
Non-réponse Pas de diplôme ou certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges CAP ou équivalent BEP ou équivalent Baccalauréat, brevet professionnel ou de technicien, autre brevet Diplôme universitaire de 1er cycle, BTS, DEUST, DUT, diplôme des professions sociales ou de la santé Diplôme universitaire de 2*"* ou 3toe cycle, diplôme d'ingénieur ou d'une grande école
Total
Introduction précoce
(en %)
37 34 50 44 46
45
44
41
43
Introduction conforme à la norme
(en %)
20 31 28 26 26
31
32
38
30
Introduction tardive
(en %)
43 34 22 30 28
24
24
21
27
Ensemble
%
6 7 6
14 14
22
17
14
100
Effectifs
106 125 100 238 239
371
284
231
1694
Source : Enquête CNAF-INRA, 1997. Lecture du tableau : parmi les titulaires d'un CAP ou équivalent, 26 % introduisent les légumes dans l'alimentation de leur enfant à 4 mois. Norme = 4 mois. Seuil de significativité du test du x* : 1 %. Les chiffres en vert, les plus fortes surreprésentations.
Tableau 7 - Diplôme de la mère et ajout de sucre dans les aliments du plus jeune enfant
Diplôme le plus élevé détenu par la mère
Non-réponse Pas de diplôme ou certificat d'études primaires BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges CAP ou équivalent BEP ou équivalent Baccalauréat, brevet professionnel ou de technicien, autre brevet Diplôme universitaire de 1er cycle, BTS, DEUST, DUT, diplôme des professions sociales ou de la santé Diplôme universitaire de 2*°* ou 3*°* cycle, diplôme d'ingénieur ou d'une grande école
Total
Jamais de sucre
(en %)
40 39 43 50 42
46
47
47
45
Sucre de temps en
temps (en %)
43 46 44 39 47
46
46
44
45
Sucre toujours
(en %)
17 15 13 11 11
8
7
9
10
Ensemble
%
6 7 6
14 14
22
17
14
100
Effectifs
106 125 100 238 239
371
284
231
1694
Source : Enquête CNAF-INRA, 1997. Lecture du tableau : parmi les femmes titulaires d'un CAP, 50 % ne rajoutent jamais de sucre dans les aliments de leur plus jeune enfant. Seuil de significativité du test du X2 : 5 %• Les chiffres en vert, les plus fortes surreprésentations.
68 RECHBiCHES ET PRÉVISIONS M* 67/50 - 1999
d'introduction des aliments différent), et les jeunes parents suivent les prescriptions de leur pédiatre. Les entretiens réalisés avec des mères de nourrissons confortent en partie cette hypothèse : celles qui (à la suite d'un déménagement par exemple) ont été confrontées à plusieurs pédiatres mentionnent souvent des variations dans les conseils qu'elles reçoivent pour la diversification alimentaire. Les résultats (cités dans l'introduction) d'un sondage sur les conseils donnés par les médecins à leurs patients, en matière de diversification alimentaire, sont un indice supplémentaire de la variabilité des prescriptions.
Guider les parents
Une autre interprétation (nonexclusive) est qu'une des fonctions des livres de puériculture serait précisément de guider les parents dans la détermination des étapes de la diversification alimentaire. Lorsqu'ils se posent une question pratique et ponctuelle (dois-je donner à mon bébé des carottes cette semaine ou la semaine prochaine ?), mais qui ne relève pas de l'urgence médicale, le recours aux manuels de puériculture est souvent une solution satisfaisante. Là encore, cette interprétation est suggérée par certains entretiens : lorsqu'on demande aux jeunes femmes qui ont consulté des livres de puériculture en quelle occasion elles s'en sont le plus servi, la diversification alimentaire (les menus adaptés à chaque âge) est presque toujours citée.
On sait aussi que les sources de conseils sont fortement corrélées avec le milieu social (17). Que l'on s'intéresse à l'âge d'introduction des légumes (tableau 6) ou de la viande, on constate que les calendriers de diversification sont liés avec le diplôme de la mère, mais de façon non linéaire. Pour les aliments considérés, l'introduction est sensiblement plus tardive lorsque la mère n'est pas diplômée ou possède uniquement un certificat d'études primaires ; elle tend à se conformer à la norme lorsqu'elle est diplômée de l'enseignement supérieur ; les plus précoces, enfin, se recrutent dans les
veaux de diplôme intermédiaires. On retrouve sensiblement les mêmes résultats si Ton croise ces variables avec la catégorie socioprofessionnelle de la mère ou du père, ou avec le niveau de revenu du ménage. L'introduction plus tardive de la viande et des légumes dans les ménages les moins aisés s'explique peut-être, en partie, par un effet de contrainte budgétaire.
L'examen du respect des normes diététiques concernant l'ajout de sucre (tableau 7) ou de sel dans l'alimentation du plus jeune enfant, montre que, globalement, les fréquences d'ajout de sucre et de sel augmentent quand le diplôme diminue. Mais les diplômées de l'enseignement supérieur pratiquent aussi un ajout modéré de sucre ou de sel, et les titulaires d'un diplôme intermédiaire sont aussi surreprésentées parmi celles qui ne sucrent ni ne salent jamais.
Quand les normes diététiques sont ignorées
Dans les classes populaires, les pratiques d'alimentation des bébés sont éloignées des prescriptions diététiques actuelles. On peut l'interpréter soit comme le signe d'une ignorance de ces normes, soit comme celui d'une indifférence : ayant une meilleure expérience des soins aux nourrissons (18), ces jeunes femmes ont un savoir-faire pratique qui les dispense de s'informer sur les normes actuellement en vigueur. Par ailleurs, l'ajout de sucre et de sel, plus systématique que dans les autres milieux sociaux, correspond sans doute à un autre système de normes (non savantes), liées à la formation du goût, et au souci de ne pas donner à l'enfant des aliments fades parce que non assaisonnés.
La plus forte tendance à diversifier de manière précoce, que l'on repère chez les femmes ayant un niveau de diplôme intermédiaire, peut s'interpréter comme une tendance à l'hypercorrection, liée à un souci de diversificationprécoce comme à un souci d'apport vitaminé. On parle ici d'hyper- correction parce que la diversification
RECHBtCHES ET PRÉVISIONS m/SB- 1MB
alimentaire est effectuée en moyenne plus tôt par rapport aux autres femmes de l'échantillon (19). Le respect des normes diététiques explique aussi que les mères titulaires d'un CAP, BEP ou bachelières soient surreprésentées parmi celles qui ne rajoutent jamais de sucre ou qui n'en mettent que de temps en temps.
Dans les classes supérieures, on observe un mélange de deux effets : l'un, lié à une prise de distance vis-à-vis des normes, tendant à leur faire ajouter du sucre ou du sel de temps en temps; l'autre, lié à une plus grande proximité par rapport aux diffuseurs de normes, donc à une meilleure connaissance de ces mêmes normes, tendant à leur faire respecter les prescriptions négatives portant sur le sucre et le sel.
Cette hypothèse d'application des normes actuellement à la mode chez les pédiatres est confirmée par ce qu'on observe sur les calendriers de diversification alimentaire.
Elle s'explique aussi par la moins grande expérience pratique des jeunes mères très diplômées dans le domaine des soins aux nourrissons (18) : pour compenser cette inexpérience, ces jeunes mères n'ont souvent
d'autre solution que d'appliquer les normes les plus répandues dans leur milieu.
Indicateur de position sociale et de proximité vis-à-vis de la sphère savante, le diplôme est aussi, pourvu que l'on ait des indications sur l'origine sociale, un indicateur de trajectoire. Un niveau de diplôme donné (par exemple, le baccalauréat) n'a pas la même signification pour une jeune femme d'origine populaire et pour une jeune femme issue des classes dominantes : signe d'ascension sociale dans le premier cas, il est signe de déclassement dans le second. On peut donc affiner l'analyse en distinguant ces deux sous-populations.
Les femmes en ascension sociale adoptent davantage les normes
Si l'on regarde uniquement les femmes d'origine populaire (20), et que l'on considère leur diplôme comme un indicateur de leur trajectoire sociale, on remarque effectivement que les femmes en ascension adoptent davantage les normes diététiques (tableau 8). Celles qui n'ont aucun diplôme (trajectoire stable dans le bas de l'échelle sociale) sont nettement surreprésentées
Tableau 8 - Diplôme de la mère et fréquence d'ajout de sucre dans les aliments. Femmes d'origine populaire
Diplôme le plus élevé détenu par la mère
Non-réponse ou aucun diplôme, ou certificat d'études BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges CAP ou équivalent BEP ou équivalent Baccalauréat, brevet professionnel ou de technicien, autre brevet Diplôme universitaire de 1er cycle ou 2tae cycle, ou équivalent
Total
Jamais (en %)
40 49 51 36
55
53
47
De temps en temps (en %)
45 40 38 53
37
42
43
Toujours (en %)
15 11 11 11
8
5
10
Ensemble %
23 7
19 17
18
15
100
Effectifs
199 63
166 144
156
132
860 Source : Enquête CNAF-INRA, 1997. Lecture du tableau : parmi les titulaires d'un diplôme universitaire, 53 % ne rajoutent jamais de sucre dans les aliments de leur plus jeune enfant. Pour éviter des effectifs trop faibles, on a dû procéder à des regroupements de classes. Seuil de significativité du test du %2 : 1 %. Les chiffres en vert, les plus fortes surreprésentations.
70 RECHERCHES ET PRÉVISIONS W 67/68 • 1999
Tableau 9 - Diplôme de la mère et introduction précoce des aliments. Femmes d'origine populaire
en %
Diplôme le plus élevé détenu par la mère
Non-réponse ou aucun diplôme, ou certificat d'études BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges CAP ou équivalent BEP ou équivalent Baccalauréat, brevet professionnel ou de technicien, autre brevet Diplôme universitaire de 1er cycle ou 2""* cycle, ou équivalent
Total
Niveau de significativité du test du %2
Introduction précoce de la viande
33 , 45 39 36 46 41
39
0,1
Introduction précoce des légumes
36 50 42 46 43 41
42
2
Source : Enquête CNAF-INRA, 1997. Lecture du tableau : parmi les titulaires d'un CAP, 45 % pratiquent une introduction précoce de la viande dans l'alimentation de leur plus jeune enfant. Pour éviter des effectifs trop faibles, on a dû procéder à des regroupements de classes. Les chiffres en vert, les plus fortes surreprésentations.
parmi les femmes qui ajoutent systématiquement du sucre, alors que celles qui ont un diplôme du supérieur, qui sont donc en ascension, sont surreprésentées parmi celles qui n'en mettent jamais. Si l'on regarde les calendriers de diversification, on voit apparaître un effet légèrement plus compliqué (tableau 9) : les femmes titulaires d'un diplôme du supérieur sont surreprésentées parmi celles qui pratiquent une diversification conforme à la norme, tandis que les femmes ayant un niveau de diplôme intermédiaire pratiquent le plus une diversification alimentaire précoce, les femmes non ou faiblement diplômées se caractérisant par une diversification plus tardive. On retrouve ainsi le phénomène observé sur l'ensemble de la population, à savoir l'hypercorrection (tendance à pratiquer une introduction précoce) des femmes ayant un niveau de diplôme intermédiaire. Ce phénomène d'hypercorrection est bien lié à l'ascension sociale (21).
Une diversité des pratiques et des usages
Inversement, pour les femmes dont le père était cadre supérieur, on ne peut pas rejeter l'hypothèse d'indépendance entre niveau de diplôme et attitude vis-à-vis des normes
diététiques et nutritionnistes. L'absence de lien entre diversification alimentaire et trajectoire sociale chez les femmes d'origine supérieure peut être interprétée comme l'indice d'une stabilité des comportements en cas de mobilité sociale descendante.
La diversité et l'hétérogénéité des règles de puériculture ne produisent pas une situation anomique, mais se retrouvent dans la diversité des pratiques et des usages d'éducation alimentaire. Ces usages dépendent en grande partie de la position et de la trajectoire sociale. Dans l'ensemble, les femmes de milieux populaires se caractérisent par une plus grande indifférence vis- à-vis des prescriptions diététiques, celles des milieux supérieurs pratiquent une application souple de ces prescriptions, et les femmes de milieux intermédiaires sont celles qui les mettent en pratique de la manière la plus scrupuleuse. Quant à l'influence de la trajectoire sociale, on retiendra qu'en cas de mobilité sociale ascendante, les pratiques d'alimentation des enfants sont plus proches de celles du milieu d'arrivée que de celles du milieu de départ, ce qui se traduit par des pratiques marquées par l'hypercorrection. En cas de déclassement, en revanche, les femmes tendent à reproduire les pratiques de leur milieu de départ.
71 AECMGRCMES ET PRÉVISIONS W «7/M • fMfl
Notes
(1) Cet article reprend et développe une communication présentée au séminaire « Petite enfance, débats sur les recherches en cours » organisé par la direction de la recherche, des prévisions et des statistiques de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), les 26 et 27 novembre 1998. D est issu de la thèse de doctorat de sociologie de l'auteur (Gojard, 1998 a). Cette recherche a bénéficié du soutien financier de la CNAF et de la participation de la caisse d'Allocations familiales du Val-de-Marne. (2) On en trouvera la liste dans la bibliographie. (3) Voir Dupont C. et Chouraqui J.-R, 1995 : « Sur le plan pratique, la diversification ne répond à aucune règle scientifiquement démontrée ; elle doit tenir compte du degré de maturation, notamment digestive, du nourrisson, être adaptée à son évolution psychomotrice et au contexte familial et culturel ». Cela n'empêche pas les auteurs, quelques lignes plus loin, d'énoncer que « la diversification ne doit pas intervenir avant l'âge de quatre mois ». (4) Ibid. (5) Pour résumer, on retiendra que l'évolution se fait dans le sens d'une diversification de plus en plus précoce. Voir Delaisi de Parseval G. et LallemandS. (1980). Toutefois, depuis quelques années, on revient à une diversification plus tardive. On en trouve trace de façon indirecte dans certains manuels, sous la mention, par exemple, qu'aux Etats-Unis la diversification est pratiquée beaucoup plus tard qu'en France (neuf mois). Pour un exemple voir Naouri, 1993. (6) L'estimation a été réalisée en utilisant la méthode du produit limité. (7) On avait demandé le poisson en plus de la viande pour éviter d'avoir des non-réponses à la question sur la viande correspondant à des familles végétariennes. Cette précaution s'est révélée inutile : les réponses sont semblables pour ces deux aliments. (8) Le choix de la médiane pour constituer la « norme » statistique se justifie par des raisons statistiques comme par des raisons logiques. Les distributions étant très étalées vers la droite, il semblait peu judicieux de retenir la moyenne comme indicateur (la moyenne est en effet sensible aux fortes valeurs des variables) ; on aurait donc pu choisir le mode : cela revient d'ailleurs au même dans le cas de la viande et du poisson mais non dans le cas des légumes. Mais on souhaitait comparer ceux qui introduisent plus tôt ou plus tard que la « norme » statistique : il fallait donc avoir des effectifs non négligeables de parents pratiquant une diversification plus tardive ou plus précoce : par définition, la médiane se prête bien à ce genre de découpage (d'autant plus que dans ce cas, des effectifs importants se regroupent sur la médiane). De plus, l'estimation réalisée en tenant compte de l'âge des enfants non consommateurs de viande et de légumes montre que la moyenne est biaisée tandis que la médiane ne l'est pas. Aussi, ce dernier indicateur est plus fiable.
(9) Voir Pernoud, 1996 (l'édition de 1988 donne le même calendrier). Toutefois, Laurence Pernoud indique qu'on peut introduire la viande dès cinq mois. (10) Les manuels de puériculture actuels indiquent souvent des calendriers plus précoces. Les manuels anciens présentent un état des normes d'une ou deux générations précédente(s), et préconisent, en revanche, une diversification plus tardive. Les normes médicales les plus récentes se prononcent contre une diversification avant quatre mois. (11) Outre une prévention de l'obésité enfantine, l'insistance sur les méfaits du sucre vise à protéger la dentition des enfants. C'est peut-être pourquoi il est davantage présenté comme un danger que le sel. Par ailleurs, les membres des classes populaires attribuent souvent au sucre des vertus apaisantes, et ont tendance à en donner à leurs bébés pour les calmer (ou à tremper les tétines dans du miel). (12) Notons que c'est peut-être lié à l'usage d'aliments tout prêts pour bébés, qui sont souvent liés à une diversification précoce et qui, a priori, ne requièrent pas l'ajout de sucre ni de sel. (13) Elle semble davantage l'objet d'un consensus parmi les médecins actuels, mais est assez récente : on a longtemps conseillé aux mères de faire boire de l'eau sucrée aux nourrissons, par exemple. (14) Ces résultats ne sont guère affectés par la prise en compte de l'âge de l'enfant. (15) Pour ne retenir que les principaux, on peut citer Chamboredon J.-C. et Prévôt J. (1973), De Singly F., (1976), KellerhalsJ. et MontandonC (1991). (16) II était évidemment impossible de fairepréciser aux parents, dans le questionnaire, le titre et l'auteur des livres utilisés. De plus, pour certains ouvrages, il aurait fallu disposer aussi de la date de publication (selon les années, les conseils figurant dans le manuel de L. Pernoud varient, par exemple). (17) Pour une présentation de ces corrélations, voir Gojard, 1998 b. (18) On trouvera dans Gojard 1998 b une présentation des corrélations entre expérience auprès de nourrissons et milieu social. L'expérience pratique de soins aux nourrissons avant d 'avoir son premier enfant augmente quand on descend dans la hiérarchie sociale. (19) L'âge retenu comme âge « normal «correspond à l'âge médian. Le terme d'hypercorrection, qui suggère que la pratique finit par être erronée à force de vouloir être correcte, est ici bien adapté, dans la mesure où, actuellement, certains pédiatres sont hostiles à une diversification trop précoce, qui serait un facteur de risque d'obésité à l'âge adulte. (20) C'est-à-dire celles dont le père était agriculteur ou ouvrier, auxquelles on ajoute celles qui n'ont pas déclaré la profession de leur père. (21) D'ailleurs, on a commencé par l'observer sur des entretiens avec des jeunes femmes issues des classes populaires et en ascension sociale par l'école, avant de généraliser cette interprétation au moyen de l'analyse statistique.
72 RECHBiCHBS ET PRÉVISIONS fTST/SB- 1MB
Références bibliographiques
Ouvrages et articles de référence
Aymard M., Grignon C. et Sabban F. (dir.), Le temps de manger. Alimentation, emplois du temps et rythmes sociaux, Paris, éditions de la MSH, INRA, 1993. Becker H.-S., Outsiders, études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985. Boltanski L., Prime éducation et morale de classe, Cahiers du centre de sociologie européenne, Paris, éditions de l'EHESS 1969, (réédition 1984); Les usages sociaux du corps, Annales ESC, 1971, 26(1), pp. 205-233. Chamboredon J.-C. et Prévôt J., Le « métier à' enfant ». Definition sociale de la prime enfance et fonctions différentielles de l'école maternelle, Revue française de sociologie, 1973, XIV, 3, pp. 295-335. Delaisi de Parseval G. et Lallemand S., L'art d'accommoder les bébés. Cent ans de recettes françaises de puériculture, Paris, Seuil, 1980. De Singly F., La lutte conjugale pour le pouvoir domestique, Revue française de sociologie, XVII, 1, 1976, pp. 81- 100 ; Le soi, le couple et la famille, Paris, Nathan, 1996. Gérôme N., les formules du bonheur : « Parents » 1969-1976, l'information des familles par la grande presse, Le mouvement social, 1984, n° 129, pp. 89-115. Gojard S., « Nourrir son enfant une question d'éducation. Normes savantes, usages populaires et expérience familiale », thèse pour le doctorat de sociologie, Paris, EHESS, 1998 a. Gojard S., L'allaitement : une pratique socialement différenciée, Recherches et Prévisions, 1998 b, n° 53, pp. 23-34. Hoggart R.,. La culture du pauvre, Etude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre, Paris, éditions de minuit, 1970 (The uses of literacy, 1957). Kellerhals J. et Montandon C, Les stratégies éducatives des familles. Milieu social, dynamique familiale et éducation des préadolescents, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1991. Loux F.et Morel M.-F., L'enfance et les savoirs sur le corps. Pratiques médicales et pratiques populaires dans la France traditionnelle, Ethnologie française, 1976, n° 3-4, pp. 309-324. Norvez A., De la naissance à l'école. Santé, modes de garde et préscolarité dans la France contemporaine, Paris, PUF-INED, « Travaux et Documents », cahier n° 126, 1990.
Livres et articles spécialisés dans le domaine de la petite enfance
Bacus A., Votre bébé de 1 jour à 1 an, le livre de bord de la jeune maman, Alleur (Belgique), Marabout, 1991 ; Votre enfant de 1 à 3 ans, Alleur (Belgique), Marabout, 1993. Brazelton T.-B., Points forts. Les moments essentiels du développement de votre enfant, Paris, éditions Stock/ Laurence Pernoud, Livre de poche (édition américaine 1992), 1994. Dr. Chevallier B. (sous la dir.), Nutrition de l'enfant, de la naissance à trois ans. De la théorie à la pratique, édité par Guigoz, éditions de la consultation, D et D médical, Saint-Cloud, 1994. Dr. Cohen-Solal J., Comprendre et soigner son enfant, Paris, Robert Laffont, Livre de poche, 1975. Dr. Naouri A., L'enfant bien portant. De 0 à 2 ans, Paris, Seuil, 1993. Dr. Rossant L. et Dr. Rossant-Lumbroso J., Votre enfant, guide à l'usage des parents, Paris, Robert Laffont, collection Bouquins, 1987. Dr. Spock B., Comment soigner et éduquer son enfant, Verviers, Marabout, éditions Gérard et Cie (première édition française 1960), 1965. Dupont C. et Chouraqui J.-P., Carences et excès liés à la diversification, Médecine et enfance, 1995, vol 15, n° 10 (numéro spécial Medec 95 : compte rendu de la journée de pédiatrie pratique). Marcade B. et Dr. Bouchet H., La nouvelle cuisine de bébé, Alleur (Belgique), Marabout, 1986. Pernoud L., J'élève mon enfant, Paris, Pierre Horay éditeur (première édition 1965), 1996.
73 RBCHBiCHES ET PRÉVISIONS N* 67/88 -1$9$